mardi, 30 juin 2015
POUR CHARLIE HEBDO
 C’est un soutien inattendu que vient de recevoir l’équipe de Charlie Hebdo, maintenant désunie à cause du déluge de pognon qui s'est abattu sur elle après l'attentat. L'austère et très savante « Société française d’étude du 18ème siècle » vient en effet de publier son très gros volume annuel (747 pages numérotées), dont la partie thématique s’intitule « Raconter la maladie ». Pas grand-chose à voir avec Charlie Hebdo ? Peut-être. Et pourtant …
C’est un soutien inattendu que vient de recevoir l’équipe de Charlie Hebdo, maintenant désunie à cause du déluge de pognon qui s'est abattu sur elle après l'attentat. L'austère et très savante « Société française d’étude du 18ème siècle » vient en effet de publier son très gros volume annuel (747 pages numérotées), dont la partie thématique s’intitule « Raconter la maladie ». Pas grand-chose à voir avec Charlie Hebdo ? Peut-être. Et pourtant …
Nul n’ignore que la critique de toutes les religions (« superstitions », comme on disait) est devenue générale au 18ème siècle. On peut même dire qu'elle y a été inaugurée. Les attentats de janvier 2015, à commencer par Charlie Hebdo, ont fait réagir cette société de gens très sérieux, souvent compassés (au vu du sérieux de leurs travaux), mais à qui il arrive de se montrer espiègles.
C’est ainsi que la revue, dans le numéro qui sort de presse, reproduit en frontispice une gravure de l’époque. Car l’équipe dirigeante, gardienne si l’on veut bien de la liberté d’expression, ne pouvait faire autrement que de prendre parti (avec les quelques mois de retard que nécessitent la mise en ordre et l’impression de la revue) pour l’équipe du journal satirique, martyrisée le 7 janvier 2015.

Pour bien comprendre la gravure, il faut savoir qu’une demoiselle Cadière avait intenté un procès « contre le jésuite Jean-Baptiste Girard, accusé de sorcellerie, d’inceste spirituel et d’abus sexuel ». La justice avait acquitté le bon père. L’auteur de la gravure défend moins, en réalité, la liberté d’expression qu’il n’attaque le clergé.
Notons que si le curé garde ostensiblement les mains en position haute et s'interdit de les poser sur le fessier de la dame, c’est pour mieux accréditer l’idée qu’il est en train de purifier la personne au moyen du « vénérable cordon de saint François » qu'on voit en pleine action, même si la périphrase est transparente. L’hypocrisie langagière du clergé apparaît ainsi de façon évidente.
« Ah ! Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. »
Molière, Tartufe, III,3.
L’université prenant parti pour Charlie Hebdo : tout arrive. Ma foi, je salue l'initiative : bravo pour l'initiative de notre société savante. Que des messieurs graves puissent mettre à l'occasion les mains dans la gaudriole, voilà qui me rassure. Cela dit, c'est bien connu, le XVIIIème siècle est le siècle où la littérature érotique (et même porno), illustrations comprises, s'est déchaînée. Les gravures de la même espèce que ci-dessus ont littéralement pullulé.
Et les artistes n'avaient jamais peur de représenter le « cordon de saint François ».
Voilà ce que je dis, moi.
***********************
Pour célébrer la disparition d'une des plus vieilles fripouilles (du S.A.C. à l'Angolagate, en passant par les invraisemblables redécoupages électoraux à la petite scie) de la Cinquième République, qui a trempé dans tous les mauvais coups, je n'ai pas trouvé de caricature de Charles Pasqua par Cabu. Je le regrette. Et je n'oublie pas que, si nous avons subi Nicolas Sarkozy, nous le devons à Charles Pasqua, qui l'a mis en selle. Pour compenser, j'ai trouvé ce Grand Duduche en une de Charlie Hebdo (17 mars 1975).
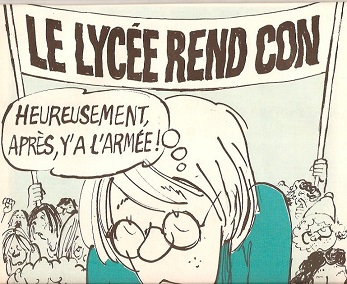
09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société française d'étude du 18ème siècle, sfeds, dix-huitième siècle, littérature, charlie hebdo, cabu, wolinski, critique des religions, gravure licencieuse, molière tartufe, charles pasqua, grand duduche, angolagate, cinquième république, s.a.c., france, société, nicolas sarkozy
vendredi, 19 juin 2015
L'ANARCHIE DES VALEURS 2
2/2
 De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.
De toute façon, je crois que les subtilités conceptuelles des « penseurs » sont de fort peu d’effet sur le concret des humains, vu que la pensée de la chose vient toujours après l’existence de la chose. En gros, si vous voulez, le penseur arrive comme les carabiniers (après la bagarre), pour essayer, tant bien que mal, de reconstituer les faits. Le penseur court après le réel, après l’histoire en train de se faire. Il est une sorte de flic : il vient sur les lieux du crime, pour tenter de donner une signification au drame de l’existence. Bien sûr, ça peut être utile. Et puis on ne sait jamais : ça peut rassurer ceux qui restent.
Pour ce qui est des valeurs, donc, à quoi les hommes peuvent-ils se raccrocher ? Du livre de Valadier, je retire trois possiblités. Soit on assiste à la « guerre des dieux » : mon absolu n’est pas ton absolu, la solution c’est qu’on se foute sur la gueule, et que le plus fort gagne. Soit on s’en remet à la Raison du devoir de fonder les valeurs, et dès lors, c’est la Science qui est chargée de régler la question morale (et ce n'est pas de la tarte !). Soit encore on fait du sujet la source unique de la valeur, et l’on débouche sur un relativisme généralisé, qui interdit de penser qu’il puisse y avoir une « communauté humaine ». Ceci dit pour simplifier, pour résumer et pour traduire. Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Pourquoi les gens s'embêtent-ils à emberlificoter ? Mais on n'y peut rien : les complications sont là.
On le voit : c’est la bouteille à l’encre ajoutée au combat de nègres dans un tunnel. On peut aussi penser au tableau « Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge », d'Alphonse Allais, immortel précurseur des monochromistes Kazimir Malevitch, Yves Klein et consort. On y voit toujours aussi clair.
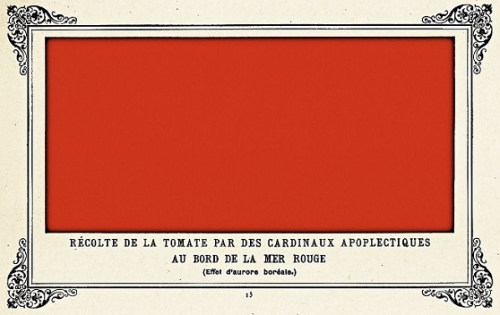
Archimède disait, paraît-il : « Donnez-moi un point fixe, et je soulève l’univers ». Mais il n’y a pas de point fixe. Le monde humain est en constant mouvement. C’est Montaigne qui le dit : « Le monde n’est qu’une branloire perenne. Toutes choses y branlent sans cesse : la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Ægypte, et du branle public et du leur. La constance mesme n’est autre chose qu’un branle plus languissant. Je ne puis assurer mon object. Il va trouble et chancelant, d’une yvresse naturelle » (Essais, III, 2, chapitre « Du repentir »). A quoi se raccrocher, donc ? Sur quoi l’ensemble des hommes peut-il espérer se mettre d’accord ?
Ce n’est pas évident. Paul Valadier lui-même, après avoir noté : « … la situation ontologique ainsi atteinte est plutôt celle de l’ "aliénation" (Arendt), du désarroi et du déboussolement de l’homme », écrit : « Parce qu’il ne peut plus adhérer à la problématique ancienne, si admirable qu’elle ait été, et parce qu’il ne peut y adhérer pour des raisons structurelles, non pas nécessairement par immoralisme ou par dédain de Dieu ou de la tradition, il est renvoyé à lui-même en tant que source de valeur, évidemment relative, mais comme seul levier d’Archimède à partir duquel soulever désormais son monde » (p. 55-56).
Faut-il se référer à des valeurs ? Il n’est même pas évident que ce soit nécessaire. Je dis une énormité, c’est certain, mais si on regarde le monde actuel, on ne voit que frénésie : l’économie en folie, la soif de pouvoir, tout est bon pour provoquer des conflits, des guerres, la mort. Discute-t-on avec tyrans et dictateurs pour autre chose que faire des affaires ? Pour discuter, il faudrait que la tyrannie soit fondée sur la Raison, le logos. On sait ce qu'il en est.
Tous les raisonnements ne m’enlèveront pas de l’idée que ce qui prime dans le monde (et ça ne date pas d’aujourd’hui), ce sont les rapports de forces. On aura beau tenir à Al Baghdadi des discours pertinents, forts et argumentés, il est probable que Daech continuera à terroriser les populations tombées en son pouvoir. Hors de l'état de paix, la Raison perd tous ses droits. Le livre de Valadier, fondé sur l'hypothèse que le monde est civilisé, reste muet au sujet des rapports de force.
Curieusement, Paul Valadier réintroduit dans son dernier chapitre l’universel qu’il avait semblé fuir jusque-là : « Seule la "nature" ou la raison universelle offre un recours suprahistorique, et par là même non violent, puisqu’elles illuminent d’une lumière qui irradie en tout homme » (p. 172). Il s’en prend alors à diverses façons de contester l’universalisme, que ce soit le « relativisme moral » (p. 178) : « … tes choix relèvent de toi seul, personne d’autre ne peut et ne doit en juger (…) tu ne dois rien imposer aux autres car leur vie est leur affaire … » (synthèse percutante des croyances des générations les plus actuelles), ou l’Américain Richard Rorty (libertarien jusqu'à l'extrémité des paturons, si j'ai bien compris), dont j’avoue que j’ai découvert le nom à la page 180 du bouquin, mais qui ne laisse pas que de tracer un sillon mortifère là où il passe.
Bref, Paul Valadier offre dans son dernier chapitre un véritable plaidoyer pour l’universalité de certaines valeurs, même si : « Il n’y a pas de position de surplomb à partir de laquelle certains, occidentaux ou non, pourraient juger et trancher en toute certitude » (p. 205). Ce n’est pas un hasard s’il cite Montaigne (encore lui !) : « Chaque homme porte la forme entiere de l’humaine condition » (Essais, III, 2).
Il va même jusqu’à s’appuyer sur des propos d’Eric Weil, qui soutient que, puisque la tradition européenne et occidentale est la seule qui ait été capable de se critiquer elle-même, elle est une « Tradition qui ne se satisfait pas de la tradition (…), notre tradition est la tradition qui met sans cesse en question sa propre validité, qui à chaque moment de son destin historique a eu à décider, et continuera d’avoir à décider, ce que nous devons faire pour nous rapprocher de la vérité, de la justice, de la sagesse » (p. 202). Et Valadier de conclure : « Or l’universel, n’est-ce pas essentiellement cette recherche permanente et jamais assurée de la justice et de la sagesse ? » (ibid.). C’est évidemment conceptuellement magnifique. Je note juste qu’il y a un peu de pain sur la planche.
Tout ça pour ça, donc : pour arriver à l’éloge de l’esprit critique. Pour réaffirmer, si j'ai bien compris, la supériorité de la vision européenne et occidentale du monde. De quoi se demander à quoi peut servir un tel livre : c’est bien joli de s’interroger sur des concepts, mais j’ai parfois l’impression, quand je me risque dans ce genre d’entreprise, de perdre le contact avec la réalité tangible.
Plus je regarde la réalité catastrophique, plus j'ai tendance à regarder d'un œil goguenard quelqu'un qui intellectualise. Il est possible, je l'ai dit, que ce soit une infirmité.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, civilisation occidentale, politique, france, littérature, paul valadier, christianisme, église catholique, l'anarchie des valeurs, éditions albin michel, religions, alphonse allais, kazimir malevitch, yves klein, monochrome, montaigne, essais de montaigne, al baghdadi, daech, richard rorty, éric weil
jeudi, 18 juin 2015
L'ANARCHIE DES VALEURS 1
1/2
 Je ne suis pas philosophe, dieu merci. Pour être franc, j'ai du mal à prendre au sérieux les discours et les débats qui ont pour objet d'organiser le monde des abstractions. J'ai un esprit épouvantablement concret. Prosaïque. Terrestre. Pour vous dire, quand j’ai ouvert Anthropologie philosophique, de Bernard Grœthuysen, et que j’ai compris, après plusieurs lectures de la page 11 (sur 284), que je n’aurais toujours rien compris à ce que me dégoisait le monsieur, même si j’insistais, j’ai évidemment refermé le bouquin. Définitivement, dois-je préciser.
Je ne suis pas philosophe, dieu merci. Pour être franc, j'ai du mal à prendre au sérieux les discours et les débats qui ont pour objet d'organiser le monde des abstractions. J'ai un esprit épouvantablement concret. Prosaïque. Terrestre. Pour vous dire, quand j’ai ouvert Anthropologie philosophique, de Bernard Grœthuysen, et que j’ai compris, après plusieurs lectures de la page 11 (sur 284), que je n’aurais toujours rien compris à ce que me dégoisait le monsieur, même si j’insistais, j’ai évidemment refermé le bouquin. Définitivement, dois-je préciser.
C'est un souvenir cuisant. Vaguement humiliant, même. C'est peut-être un handicap. Si c'est le cas, je dis : pitié pour les handicapés ! Je ne vois pas pourquoi je me gênerais. Je me suis fait ma religion : il y a deux sortes de savants. Oui, je sais, on va me ressortir l’histoire de De Gaulle disant à Malraux : « Il y a deux sortes de gens … », et puis, voyant s’allumer l’œil de son ministre, il complète et conclut : « … ceux qui pensent qu’il y a deux sortes de gens, et les autres ».
Désolé, je le répète, il y a deux sortes de savants : ceux qui parlent pour tout le monde, et ceux qui parlent entre eux. Par exemple, en psychanalyse, il y a Jacques Lacan, et puis il y a Didier Anzieu. Avec l’un, on reste entre spécialistes pointus. Avec l’autre, on est entre égaux (pas vraiment, mais quand il me parle, je comprends d’abord qu’il s’adresse à moi).
Je trouve pitoyable, voire méprisable, tout humain qui use du langage pour faire croire qu'il connaît des choses que tout un chacun serait infoutu de comprendre. Ce genre de pouvoir n'impressionne que ceux qui y croient. A cet égard, je suis un mécréant de l'espèce la plus incorrigible : je m'efforce de parler comme tout le monde, en offensant le moins possible la langue française. Je considère comme bien à plaindre celui qui éprouve le besoin d'intellectualiser et de créer des concepts abstrus (si possible innovants) pour avoir l'impression d'exister enfin. Et se donner l'apparence de comprendre le monde.
Chez les musiciens contemporains, c’est la même chose : il y a les très savants, qui considèrent mes oreilles comme des poubelles assez bonnes pour digérer ou recycler les déchets de leurs savants concepts (Nono, Berio, Boulez, Pauset, Stockhausen, Cage, …), et puis il y a ceux qui admettent que mes oreilles méritent quelques égards et un minimum de courtoisie, en plus du savoir-faire (Messiaen, Britten, Hersant, Grisey, Bryars, Kancheli, Pärt, …). C’est une philosophie de l’existence. C'est même un humanisme.
Tenez, l’autre jour, j’entendais Cédric Villani (qui arbore une cravate aussi impressionnante que sa médaille Fields), en tournée de promo pour l’album de bande dessinée qu’il vient de publier avec le formidable dessinateur Baudoin, Les Rêveurs lunaires (Gallimard / Grasset), sous-titré « Quatre génies qui ont changé l’histoire ». Villani est de ceux qui veulent, non pas faire de la « vulgarisation », mais réconcilier la science avec le grand public en faisant entrevoir à celui-ci les raisons de l’importance historique de certains chercheurs.
Paul Valadier, l’auteur de L’Anarchie des valeurs (Albin Michel, 1997), est de ceux qui s’adressent à tout le monde. C’est vrai qu’il a été formé pour ça : jésuite, il fut longtemps directeur de la revue de l’ordre, qui porte un titre aussi modeste que terriblement ambitieux, Etudes. Je connaissais un peu Jean Mambrino, poète, qui tenait pour la revue la rubrique de l’actualité poétique et théâtrale.
Dans L’Anarchie des valeurs, la langue n’a rien à voir avec quelque jargon technique. Valadier applique ce principe oratoire formulé jadis par le génial Chaïm Perelman (ne pas oublier Lucie Olbrechts-Tyteca) dans son Traité de l’argumentation (éditions de l'université de Bruxelles, 1988, pour la nouvelle édition) : s’adresser à un « auditoire universel » (I, § 7), pour virtuel qu’il soit. L' « auditoire universel » ! Quelle prétention ! Mais quel espoir ! Car il s’agit en définitive de faire de la connaissance acquise un objet socialisé. Un « Bien Commun », en quelque sorte, que tout un chacun soit en mesure de s’approprier pour peu qu’il en fasse l’effort.
Pourtant, le sujet de Valadier n’est pas évident : comment établir des valeurs ? Sur la base de quoi a-t-on le droit de fonder des jugements (de valeur) ? Ces « valeurs » que les responsables politiques, mais aussi les grandes entreprises, brandissent comme des étendards (je me souviens du panneau d’affichage dans le hall du siège de Mérial, à Gerland, qui trompetait fièrement « Nos Valeurs », et qui les énumérait). Hollande s’est particulièrement illustré dans ce domaine après le 7 janvier.
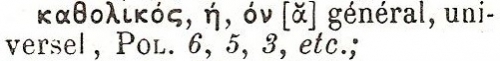
Si tout un chacun peut revendiquer ses valeurs, c’est la confusion. C’est l’anarchie, comme le dit le titre du livre. Le temps est fini où une religion pouvait, sans être contredite, s’intituler « catholique », c’est-à-dire « universelle », et imposer les valeurs constituant la Vérité révélée qu’elle voulait répandre (« propager » serait plus juste : on parle bien de « propagation de la foi »).
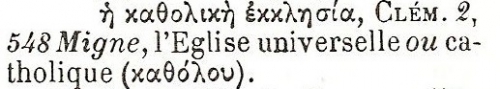
A cet égard, reconnaissons qu’elle a mis de l’eau dans son vin de messe, par la force des choses. Il faudra bien que l’Islam descende aussi de son piédestal de « Seul authentique détenteur de la Vérité révélée », même si ça n’en prend pas le chemin.
Maintenant qu’est réalisé l’inventaire exhaustif des sociétés humaines, des cultures, des croyances, des systèmes sociaux, la question se pose de savoir sur quelle base unique de valeurs pourrait s’amorcer un accord général de l’humanité entière. Autant le dire tout de suite : ce n’est pas simple, nul n’ayant l’autorité requise pour imposer à qui que ce soit sa manière de voir les choses et d’interpréter le monde.
Je n’ai pas envie de m’attarder sur les analyses et les références que livre Paul Valadier. C’est très savant et très documenté, il a beaucoup lu, beaucoup compris, c’est très subtil et très nuancé : le monsieur montre qu’il n’est pas sorti de nulle part, vu qu’il donne des gages incontestables de la connaissance qu’il a des enjeux de la discussion.
Moi qui suis le rustaud du service de com’, je vais vous dire, toutes ces références me font l’effet de « validation du permis de conduire » : Paul Valadier, bien qu’il sache qu’on connaît sa science de la chose, tient à montrer qu’il n’est pas philosophe pour du beurre et qu’il s’y connaît (il est jésuite). Et ça défile : Lefort, Boudon, Nietzsche, Hobbes, Marx, Dognin, Freud, Mauss, Proust, Lévi-Strauss, Saint-Exupéry, par ordre d’entrée en scène. Pardon, j’oubliais Kant (et quelques autres). Et l’on n’a fait que les quarante premières pages ! C’est le vice universitaire, sur lequel est fondé le rapport de la civilisation avec la connaissance : prouver qu’on sait de quoi on cause.
C'est aussi l'un des aspects rebutants de ce que l'on a appelé la scolastique.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, littérature, paul valadier, compagnie de jésus, jésuites, l'anarchie des valeurs, bernard groethuysen, anthropologie philosophique, relativisme, de gaulle, malraux, jacques lacan, didier anzieu, musique contemporaine, boulez, stockhausen, berio, messiaen, brittent, philippe hersant, gérard grisey, gavin bryars, cédric villani, edmond baudoin, les rêveurs lunaires, éditions gallimard, éditions grasset, revue études, éditions albin michel, chaïm perelman, traité de l'argumentation, mérial, gerland, catholique, église catholique, islam, claude lefort, raymond boudon, nietzsche, hobbes, karl marx, lévi-strauss, freud, marcel proust, christianisme
mercredi, 17 juin 2015
KADARÉ : LA NICHE DE LA HONTE
 Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici,
Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici, 28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.
28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.
J'ai lu un drôle de roman. Remarquez que Les Tambours de la pluie, ce n’était pas mal non plus, avec le sultan en personne, à la tête de toute son armée, qui vient mettre le siège devant une ville (albanaise, évidemment) qui ose lui tenir tête. Je me souviens d’énormes canons qu’il fait fondre sur place pour abattre les remparts, et dont l’un, sinistre présage, explose.
Je me souviens surtout que lorsque le sultan lance ses troupes pour l’assaut final à travers une brèche dans la muraille, celles-ci, les unes après les autres, sont comme « avalées » par la ville et disparaissent corps et bien, sous les yeux du sultan incrédule, mais vaincu. Pour dire que Kadaré est, certes, un écrivain, mais qu’il se revendique Albanais, au moins à égalité, si ce n'est davantage.
C’est de l’Albanie qu'il parle. Il en est pétri. Il en décrit la sinistre loi du « kanun » dans Avril brisé, une histoire de vendettas interminables et cruelles, mais étroitement codifiées, où le sang appelle le sang, et où le meurtrier (selon la coutume, il doit avertir sa victime avant de tirer), pour échapper à la sanction légale, peut se réfugier dans des tours construites à seule fin de servir d’asiles, mais qui ne le protègent qu’aussi longtemps qu’il reste dans les murs.
Kadaré m’a laissé des impressions très vives : l'existence humaine a une signification très simple. Et en général, c'est violent. Quand les points de repère sont nets et francs, les opinions sont tranchées, et la violence est présente, quoique canalisée. C'est quand les points de repère sont informes que l'anarchie s'installe et que la violence se généralise.
Avec La Niche de la honte, qu’on ne s’attende pas à un roman d’action. L’ambition de Kadaré est semble-t-il d’introduire le lecteur au cœur de l’énorme machine administrative (et militaire) qui a permis à l’Empire Ottoman d’atteindre les hauteurs d’une puissance si impressionnante qu’il en apparaissait à tous comme une figure de l’éternité indestructible.
Face à ce colosse qui occupe une bonne partie de l'Europe balkanique, l’orgueilleuse, violente et minuscule Albanie se dresse. Qui a suivi les travaux et cours de Gilles Veinstein au Collège de France (chaire d'Histoire turque et ottomane), n'est pas dépaysé par toute la partie historique du roman, qui évoque les somptueux palais d'Istambul, où s'agitent les milliers de fonctionnaires qui actionnent la machine impériale de la Sublime Porte, terriblement efficace et précise.
L’affaire se passe autour de 1820, puisqu’Ali pacha, le vieux gouverneur du pays, apprend la mort de Napoléon Bonaparte (1821). Ali pacha est très jaloux de Scanderberg, le plus grand héros de la nation albanaise, qui avait été capable de l’unifier et d’entrer en rébellion ouverte contre la Sublime Porte. Mais ce temps et ce héros appartiennent définitivement et depuis plusieurs siècles au passé et au mythe. Ali pacha est plus mesquin, moins grandiose dans ses ambitions. Incapable de sacrifier son intérêt à son pays, comme l’avait fait le glorieux ancêtre, il s’est comporté en gouverneur féroce, et toujours fidèle au sultan (comme un vulgaire collabo).
Jusqu’au jour où, sa puissance lui étant montée à la tête, il s’imagine qu’il fait peur au pouvoir central, et commence à se montrer moins docile, plus désinvolte, voire insolent dans les courriers officiels, de plus en plus espacés. Mais aucun des princes albanais qui ont eu affaire à ses mauvaises manières n’a oublié les avanies, tous lui font défection quand il leur demande de se rallier à lui pour faire officiellement sécession, et il se retrouve seul dans sa forteresse, face à l’armée ottomane.
Bon, c’est sûr qu’il vient à bout du premier général. Le suivant aura le dessus, mais grâce à une traîtrise de la Sublime Porte elle-même, qui fait porter un « haïr firman » (décret de grâce) à Ali pacha. Mais c'est un faux. Le vrai (le « katil firman »), envoyé en même temps, donne l'ordre de le décapiter dès qu'il se rendra. Il est donc vaincu par traîtrise, mais finalement, parce qu’il a été le premier à trahir. Hurshid pacha a vaincu le gouverneur félon.
Mais Hurshid n’est pas tranquille. Il est même inquiet. Les financiers de la Porte ont, à la suite de terribles et savants calculs, jugé que l’intégralité du trésor d’Ali pacha n’avait pas été livrée aux fonctionnaires chargés de le rapporter pour le verser au trésor impérial. Hurshid perçoit très vite sa prochaine disgrâce, allant jusqu’à anticiper la venue de Tundj Hata, en se suicidant, tout simplement.
Tundj Hata n’est qu’un fonctionnaire de rang moyen, mais sa place est véritablement au centre du roman : sa fonction est en effet de rapporter à brides abattues la tête du gouverneur qui a failli, où à propos de la fidélité duquel le sultan a tellement de doutes qu’il lui a retiré sa confiance. Le troisième chapitre raconte drôlement ce voyage de retour, au cours duquel le voisinage de la tête procure à Tundj Hata des extases inouïes qui le laissent pantelant. Il raconte aussi le détour devant des publics de villageois prêts à donner de l'argent en échange du spectacle de la tête du puissant qui vient de tomber.
Car le centre de gravité de La Niche de la honte, c’est la tête de ceux qui ont failli à leur mission. La niche en question, c’est celle qui a été creusée dans un des murs d’une place d’Istambul pour accueillir la tête qui a été coupée sur les épaules des mauvais serviteurs (ou supposés tels) de la Porte.
C’est véritablement la tête (coupée) qui porte le roman tout entier. La preuve en est dans le médecin-chef Evrenoz, qui a la lourde responsabilité de vérifier à heure fixe, en montant par une échelle jusqu’à la niche en question, l’état de la tête. Et gare à lui si elle se dégrade trop vite. A lui de demander au « Directeur des Poisons » les substances les plus à même de faire durer le plus longtemps possible la tête en bon état : le miel, la neige, le sel ou autre. Je ne parle que pour les mentionner des « spectacles » que Tundj Hata donne dans les villages des régions « dénationalisées » (les cinq étapes de la recette complète, proprement hallucinante de méthode en matière de décervelage, p. 178) avec la tête qu’il transporte dans un sac en cuir.
L’éloge de l’indomptable Albanie est formulé en quelque sorte par défaut dans le roman d’Ismaïl Kadaré : le sort de tous les serviteurs du sultan est tellement instable, lié à tellement de critères différents et hétérogènes, que nul, si puissant soit-il, n’est à l’abri de la décision de disgrâce qui peut tomber d’en haut à tout instant, ni de voir sa tête un jour exposée dans la niche de la honte.
D’ailleurs Hurshid pacha le sait : son ami Gizer, lui-même bientôt en disgrâce, lui a écrit un message transparent : « Je veux te dire aussi, à regret, qu’après-demain part te rejoindre un courrier de la Troisième Direction de la Cour, porteur, dit-on, d’un firman qui n’est guère faste. Tu jugeras et décideras par toi-même. Il y a partout un monde sous les étoiles, dit le sage Ibn-Sina. Je te salue et préférerais ne plus te revoir plutôt que te voir sans que toi-même puisses me voir » (p. 197). Hurshid perçoit aussitôt les sous-entendus (le salut dans la fuite, la tête séparée du corps) contenus dans le message, et voit déjà sa propre tête dans la « niche de la honte ».
Pour résumer, en négatif, m’apparaît dans ce livre l’injonction patriotique d’un roman national, albanais, pour ne pas dire nationaliste. L’Empire Ottoman a disparu, bien sûr, mais Ismaïl Kadaré creuse avec ardeur le sillon à vif du sentiment national.
Curieux sentiment d’une littérature surannée. J'ai peut-être tort, car il est possible après tout que la description de cette insupportable bureaucratie n'ait eu pour cible véritable le système policier totalitaire mis en place par Enver Hodja, le malade mental qui a terrorisé les Albanais de 1945 à 1985 (quarante ans), faisant disparaître ceux qui avaient cessé de lui plaire.
Peut-être après tout Kadaré, en dénonçant les horreurs de l'empire ottoman, pensait-il surtout au "Sultan" albanais. Peut-être même, à travers la silhouette d'Ali pacha, ce mauvais Albanais, Kadaré nous invite à discerner en filigrane celle du dictateur. Ali pacha se révoltant contre l'Empire serait alors une figure d'Enver Hodja le communiste, quittant le Pacte de Varsovie et l'Empire Soviétique, et se brouillant avec la Chine de Mao. Le vieux "rebelle" de 1820 n'était-il pas lui aussi seul, enfermé dans sa citadelle, exactement comme Enver Hodja ? En creux, on comprend que le véritable héros national de l'Albanie ne saurait être cet autocrate.
Allez savoir : peut-être Kadaré voyait-il, posée dans la "niche de la honte", la propre tête d'Enver Hodja.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, albanie, enver hodja, tedi papavrami, musique, ismaïl kadaré, la niche de la honte, jusuf vrioni, éditions fayard, fugue pour violon seul, les tambours de la pluie, avril brisé, vendetta, empire ottoman, sublime porte, napoléon bonaparte, scanderberg, collège de france, gilles veinstein, décervelage, histoire turque et ottomane, turquie, europe
mardi, 09 juin 2015
L'ASPECT DES CHOSES
« Sur cent femmes, il existe au moins une bonne demi-douzaine de créatures faibles qui, dans cette grande secousse, reviennent peut-être pour toujours à leurs maris, en véritables chattes échaudées craignant désormais l’eau froide. Cependant cette scène est un véritable alexipharmaque dont les doses doivent être tempérées par des mains prudentes » (c'est moi qui italique).
Honoré de Balzac, Physiologie du mariage, Deuxième partie (Des moyens de défense à l’intérieur et à l’extérieiur), Méditation XXII (Des péripéties).
On trouve aussi le mot "alexipharmaque" dans Là-bas, de Joris Karl Huysmans, cher au cœur du personnage de Soumission, le dernier roman de Michel Houellebecq.
********************************************************************************
Les jours se suivent ...
À noter, ci-dessus, les quatre martinets, à peu près alignés verticalement (désolé pour le format).
... eh bien tant pis ! Profitons-en pour en profiter !
Ici, j'ai fait presque (à beaucoup près) comme Harvey Keitel dans le film Smoke (1994, Wayne Wang, scénario de Paul Auster), où il jouait un marchand de cigares qui s'échinait, mais alors là tous les jours de toutes les semaines de tous les mois de toute l'année, à la même heure, à photographier son carrefour insignifiant pour en coller les tirages dans un album spécialement dédié, se disant peut-être : « Pas besoin de bouger. Le monde bouge déjà assez comme ça ».
mais alors là tous les jours de toutes les semaines de tous les mois de toute l'année, à la même heure, à photographier son carrefour insignifiant pour en coller les tirages dans un album spécialement dédié, se disant peut-être : « Pas besoin de bouger. Le monde bouge déjà assez comme ça ».
Je n'en suis pas encore là. J'ai peut-être tort.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, littérature, honoré de balzac, physiologie du mariage, harvey keitel, paul auster, smoke film, soumission, michel houellebecq
vendredi, 29 mai 2015
POUR TEDI PAPAVRAMI 2
2/2
 Tedi, aux yeux de son père, n’est pas assez acharné au travail. Oui, c’est bon, il a ce véritable don violonistique, prodigieux, et puis alors ? Le problème, c’est qu’il aime glander, jouer dans les rues avec son copain Albano : c’est un gamin normal, quoi. C’est la raison pour laquelle, quand il se retrouvera au Conservatoire Supérieur de Paris, en dehors de sa virtuosité instrumentale, il se retrouvera d’une nullité crasse dans toutes les disciplines académiques, à commencer par le solfège. Un comble, qui mettra son père en fureur.
Tedi, aux yeux de son père, n’est pas assez acharné au travail. Oui, c’est bon, il a ce véritable don violonistique, prodigieux, et puis alors ? Le problème, c’est qu’il aime glander, jouer dans les rues avec son copain Albano : c’est un gamin normal, quoi. C’est la raison pour laquelle, quand il se retrouvera au Conservatoire Supérieur de Paris, en dehors de sa virtuosité instrumentale, il se retrouvera d’une nullité crasse dans toutes les disciplines académiques, à commencer par le solfège. Un comble, qui mettra son père en fureur.
Ce qui domine, c'est que le gamin stupéfie son monde, jusqu’à l'immense Pierre Amoyal, qui accepte de le prendre comme élève. Il se voit offrir une bourse d’études. Une faveur spéciale du « Guide Suprême » délivre un bon de sortie (une rarissime exception) du territoire, et voilà le père et le fils partis pour Saint Jean de Luz (où habite le violoniste), via Paris et l’ambassade d’Albanie, étroitement contrôlés et suivis par les fonctionnaires : attention, ne pas dévier du programme.
Bon, je passe sur les détails. La prestation du petit Tedi (on est en 1983, il a douze ans) convainc d’emblée Amoyal, qui le prépare activement pour le concours d’entrée au CNSM de Paris, afin de le prendre dans sa classe (une autre étant tenue par Gérard Poulet). Simple formalité : il y sera reçu premier sur trois cents : c'est sûr, il stupéfie son monde.
Mais l’Albanie d’Enver Hoxha reste impitoyable : la mère ayant rejoint son fils, les choses se gâtent quand le père débarque à Paris avec l’intention de ne plus retourner à Tirana. Ils seront obligés de demander l’asile politique, ce qui déclenchera des représailles contre la famille restée au pays. Le sentiment de culpabilité des exilés n’en sera que plus vif. Le réseau des nouveaux amis, mais aussi la gendarmerie française leur permettront d’échapper aux recherches des services secrets du dictateur. Ils apprendront que leur maison a été rasée.
 Un dernier mot sur la musique proprement dite. Le petit Tedi est tellement doué qu’il transpose pour le violon, « à l’oreille », les sonates du célèbre disque « Horowitz-Scarlatti », qu’il adore. Sa première idole du violon n’est pas n’importe qui : sa Seigneurie Jascha Heifetz, dont l’époustouflant mariage de l’expressivité et de la virtuosité technique l’impressionne au plus profond.
Un dernier mot sur la musique proprement dite. Le petit Tedi est tellement doué qu’il transpose pour le violon, « à l’oreille », les sonates du célèbre disque « Horowitz-Scarlatti », qu’il adore. Sa première idole du violon n’est pas n’importe qui : sa Seigneurie Jascha Heifetz, dont l’époustouflant mariage de l’expressivité et de la virtuosité technique l’impressionne au plus profond.
Mais il sera aussi saisi par l’impeccable maîtrise de Nathan Milstein, qu’il vient écouter à Bordeaux. Il cite encore le nom du grand Christian Ferras, dont il évoque le caractère dépressif, l’alcoolisme, puis la défenestration volontaire, à même pas cinquante ans. Il a une pensée pour Zino Francescatti, un autre grand.
Ajoutons pour finir qu’une fois en France, Tedi Papavrami a fini par se soumettre, volontairement et de lui-même, à une discipline de fer dans le travail du violon, s’astreignant à d’interminables exercices, parmi lesquels des gammes exécutées avec la plus grande lenteur, dans le but d’arriver à la plus extrême justesse (est-ce Saint-Saëns, Fauré ou Poulenc qui déclarait,: « Tous les violonistes jouent faux, mais il y en a qui exagèrent » ?). Il s'est aussi mis à la traduction : prenant la succession de l'excellent Yusuf Vrioni (mort en 2003), c'est lui qui a traduit tous les derniers livres d'Ismaïl Kadaré.
Au total, un livre excellent. Bien sûr, l’auteur nous parle de son enfance, de ses chiens, de ses chats (qu’il martyrisait), de l’amour de sa vie (Silva), qui n’a jamais dépassé le stade du platonisme contemplatif, de ses sentiments, de ses impressions, et tout et tout, mais on lui pardonne, car il parle aussi et surtout, sobrement et sans pathos, de ce qu’il a fait, des événements, des situations que lui et sa famille ont traversés. Il dresse aussi quelques portraits et paysages albanais.
Par exemple, il découvre un jour, stupéfait, un aspect de Tirana qu’il ignorait totalement. On lui dit un jour de se rendre dans la maison de Shpati, muni de son violon. Elle est située dans un quartier gardé par des militaires armés, interdit à tous ceux qui n’ont pas une autorisation expresse. Il faut dire que Shpati est le petit-fils d’Enver Hoxha en personne, le dictateur bien aimé, le petit père du peuple. Tedi constate au cours de son incursion dans ce monde tabou qu’il y a deux villes, dans la capitale albanaise.
L’une pour la masse : elle est grise, délabrée, ses rues ne sont pas toujours bitumées, la télévision y est en noir et blanc, les voitures y sont rares, bref, c’est la ville pour tout le monde. Et voilà qu’au beau milieu de cette ville moche, existe une autre ville, réservée à quelques-uns, où se concentrent toutes les « saloperies » capitalistes, les « immondices » impérialistes et autres modernités « dégénérées » (télé couleur en particulier), que tout ça a l'éclat du neuf, et que tout ça est strictement réservé au petit cercle d’élus qui détient le pouvoir. En Russie soviétique, ça s’appelait la Nomenklatura.
Le 20ème siècle a décidément légué bien des laideurs au 21ème.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique classique, tedi papavrami, pierre amoyal, cnsm paris, gérard poulet, albanie, enver hoxha, jascha heifetz, vladimir horowitz, nathan milstein, christian ferras, zino francescatti, saint-saëns, gabriel fauré, francis poulenc, ismaïl kadaré, yusuf vrioni, tirana, communisme
jeudi, 28 mai 2015
POUR TEDI PAPAVRAMI 1
1/2
 Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.
Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.  Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.
Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.
Oh, et puis il y a les faits divers : quelques saisies d’héroïne dans les milieux albanais de la banlieue lyonnaise. Et puis un drôle de business, aussi : un immeuble destiné à la démolition dans un quartier en rénovation, squatté par une bande d’Albanais qui « louent » les « logements » à des compatriotes au tarif de 150 € la semaine. Et la police n’a pas le droit d’intervenir tant que personne n’a porté plainte. Mais est-ce qu’un sans-papiers porte plainte ? Ce serait étonnant, non ? Le monde actuel est décidément délicieux.
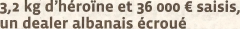
Le Progrès, 27 mai 2015 (p. 10).
Non, l’Albanie, ce n’est pas que ça, faut pas croire. Il y a le grand Ismaïl Kadaré et ses livres, Le Pont aux trois arches, Le Général de l’armée morte, Avril brisé, Les Tambours de la pluie, Qui a ramené Doruntine ?, …. Et puis il y a Tedi Papavrami. Il n’est pas écrivain. Il a quand même écrit un récit autobiographique, à l’incitation des quelques amis conseilleurs. Le livre s’intitule Fugue pour violon seul (éditions Robert Laffont, 2013).
Ne pas s’attendre à de la littérature. L’ouvrage se veut un témoignage. Car l’Albanie dont il parle est celle d’Enver Hoxha (prononcer Hodja ?), alias « Oncle Enver », l’avatar albanais du « Guide Suprême », l’égal des Staline, Ceaucescu, Pol Pot, à l’échelle d’un pays de 3.300.000 habitants, grand comme la région Poitou-Charente (dixit l’auteur, je n'ai pas vérifié). Je veux dire leur égal dans la folie tyrannique, la joie sanguinaire et la férocité des méthodes policières.
Le cher homme était même assez atteint pour quitter le Pacte de Varsovie, au grand dam du « Grand-Frère » soviétique, et se brouiller avec l’autre « Grand-Frère » Mao Dze Dong, et transformer son petit pays en forteresse retranchée du reste du monde, derrière ses barbelés. Ceux qui voulaient s’échapper de ce « paradis communiste » avaient tout intérêt à réussir du premier coup. Il va de soi que le niveau de vie et l’état économique et industriel du pays sont tombés plus bas que ceux du Burkina-Faso, ou même du Malawi. Ça explique peut-être les mafias.
Mais Tedi Papavrami n’était pas un gamin ordinaire : il appartient à l’espèce rarissime des enfants prodiges, des génies précoces. Ça ne s’explique pas : c’est comme ça. Lui, c'est le violon. Quelqu’un qui vous aligne aussi net les Caprices de Paganini à neuf ans, vous dites comme Victor Hugo dans William Shakespeare (2, IV, 3) : « A Pégase donné, je ne regarde point la bride. Un chef d’œuvre est de l’hospitalité, j’y entre chapeau bas ; je trouve beau le visage de mon hôte ». Il faut voir comment un gamin de onze ans est capable de vous envoyer dans la figure la Campanella de Paganini, en Grèce en 1982 (cliquez pour 10' 21" d'étonnement, ce n'est pas toujours « propre » dans les sautillés, mais bon). Il a onze ans. Et même pas peur.
J’ai commenté, il y aura bientôt un an (22-24 juin 2014) le livre de Nikolai Grozni, Wunderkind (« enfant prodige »), qui m’avait frappé de saisissement, par la terrible âpreté de l’aventure. Lui, c'était le piano. Le monde bulgare de l'époque soviétique, comme une jungle où n’évoluent que des fauves, qui n’attendent que l’occasion de s’entredéchirer, sous un ciel de pierre, dans un air irrespirable, au fond d'une bassine où bouillonne la noirceur. Un livre absolument glaçant et passionnant, avec au centre un Chopin hissé jusqu'au tragique.
Avec Papavrami, l’ambiance est plus amène, parfois même pleine d'urbanité. Grozni détestait son père, n’aimait pas trop sa mère. C’était sans doute réciproque. La famille Papavrami, d’origine bourgeoise, est tolérée par le régime communiste, qui lui laisse la maison ancestrale, avec son jardin, ses mandariniers, son mur protecteur, ses souvenirs. Mais c'est une famille solide, à l'ancienne. Une famille, quoi.
L’équilibre, socialement et politiquement, est toutefois instable. Papa travaille au « lycée artistique », dans la section musique, où sa réputation d’excellent pédagogue du violon fait merveille, en même temps qu’elle le protège tant soit peu des rigueurs du régime. C’est simple : tout le monde le respecte, voire le craint.
Il est frustré dans sa carrière depuis la sortie du Pacte de Varsovie, qui l’a obligé à retourner à Tirana avant d’avoir achevé ses études à Vienne (où il a acheté un violon Bergonzi, dans lequel un luthier parisien ne verra plus tard qu'un faux). Mais la famille vit dans une bonne ambiance de tranquillité, dans une maison agréable, avec un jardin clos de murs.
Des privilégiés, somme toute.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, wunderkind, nicolaï grozni, tedi papavrami, virtuosité, albanie, tirana, enver hoxha, ismaïl kadaré, rexhep qosja, la mort me vient de ces yeux-là, bande dessinée, narcotrafic, mafia albanaise, journal le progrès, le pont aux trois arches, le général de l'armée morte, avril brisé, les tambours de la pluie, qui a ramené doruntine, fugue pour violon seul, éditions robert laffont, ceaucescu, pol pot, comunisme, pacte de varsovie, mao tsé toung, caprices de paganini, paganini campanella
mercredi, 27 mai 2015
« POSSÉDÉS » ou « DÉMONS » ?
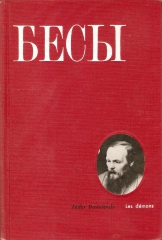 Ci-contre, l'édition "club" : lire "bessy" (ou "biessy ?"), qui veut dire "Les Démons".
Ci-contre, l'édition "club" : lire "bessy" (ou "biessy ?"), qui veut dire "Les Démons".
2/2
La deuxième moitié du livre nous fait prendre pied sur le terrain politique. Verkhovensky fils (Piotr Stépanovitch) est le chef d’une section clandestine de révolutionnaires. Il fait croire à ces exaltés tant soit peu nihilistes que celle-ci n’est qu’une cellule dans un vaste réseau dirigé depuis l’étranger par une sorte de Comité Central.
La réunion (intitulée « Chez les nôtres ») a quelque chose de proprement stupéfiant de prescience du régime qu’instaureront beaucoup plus tard Lénine, puis Staline. Sorties du cerveau de Chigaliov (le théoricien qui forme avec l'activiste Verkhovensky la transposition dans le roman du nihiliste frapadingue et historique Netchaïev) et expliquées par « le professeur boiteux », on lit des choses comme : « Partant de la liberté illimitée, j’aboutis au despotisme illimité ».
Plus fort encore : « Pour résoudre définitivement la question sociale, il propose de partager l’humanité en deux parts inégales. Un dixième obtiendra la liberté absolue et une autorité illimitée sur les neuf autres dixièmes qui devront perdre leur personnalité et devenir en quelque sorte un troupeau ; maintenus dans une soumission sans bornes, ils atteindront, en passant par une série de transformations, à l’état d’innocence primitive, quelque chose comme l’Eden primitif, tout en étant astreints au travail ».
Et Verkhovensky explique plus tard à Stavroguine : « Son projet est remarquable (…). [Chigaliov] établit l’espionnage. Chez lui, tous les membres de la société s’épient mutuellement et sont tenus de rapporter tout ce qu’ils apprennent. Chacun appartient à tous, et tous appartiennent à chacun. Tous les hommes sont esclaves et égaux dans l’esclavage ». Ah bon ? Ça vous rappelle quelque chose ?
Et puis encore : « La soif d’instruction est déjà une soif aristocratique. A peine laisse-t-on s’installer la famille ou l’amour, que naît aussitôt le désir de propriété. Nous tuerons ce désir : nous développerons l’ivrognerie, la calomnie, la délation ; nous plongerons les hommes dans une débauche inouïe, nous détruirons dans l’œuf tout génie ».
Allez, une dernière pour la route : « Seul le nécessaire est nécessaire, telle doit être dorénavant la devise de l’humanité. Mais il faudra aussi lui accorder de temps en temps quelques convulsions ; et nous, les chefs, nous y pourvoirons. Les esclaves doivent avoir des maîtres. Obéissance complète, dépersonnalisation absolue ; mais tous les trente ans, Chigaliov autorise les convulsions ; et alors tous se jetteront les une sur les autres et s’entre-dévoreront ; mais jusqu’à une certaine limite seulement, uniquement pour vaincre l’ennui. L’ennui est un sentiment aristocratique. La société de Chigaliov ne connaîtra plus les désirs ». Précisons que Stavroguine, qui écoute ce galimatias, se demande si l'autre n'est pas carrément cintré ou complètement ivre.
Que Chigaliov (à moins que ce ne soit Verkhovensky) et son programme transposent (en caricaturant ?) le hélas trop authentique et historique Netchaïev et son Catéchisme du révolutionnaire ne fait guère de doute. Intéressant de savoir aussi que Lénine s’inspira de celui-ci pour concevoir dès 1902, puis organiser le parti bolchévik qui allait prendre le pouvoir quinze ans plus tard, avec les suites bien connues, mises en musique par Staline et consort.
Pour confirmation, on se reportera à la remarquable bande dessinée La Mort de Staline, de Fabien Nury et Thierry Robin, pour se faire une idée de l’ambiance terrifiante qui régnait au sommet de l’Etat soviétique, y compris et surtout parmi les plus proches du pouvoir suprême, qui savaient comment ils étaient arrivés là, et qui avaient donc toutes les raisons de redouter le pire à tout instant de la part de leurs meilleurs « amis ».

Molotov, Krouchtchev : ils se les caillent sur le balcon, parce que Béria a fait poser des micros partout à l'intérieur. Ça ne les empêche pas de préparer l'avenir d'un certain nombre de leurs « amis » : « De très longues listes, où l'on n'oubliera personne ». Il n'y a pas que dehors qu'il fait très froid. Brrr ...
Le projet de ce petit noyau de révolutionnaires, à qui l’on a fait croire que la même chose se passerait partout dans les campagnes russes, est de gâcher la « fête » voulue par Julie Mikhaïlovna, épouse du gouverneur Von Lembke, une sorte de fantoche et de mari falot, et de semer le trouble dans la ville par tous les moyens, dans l’espoir de provoquer l’insurrection qui balaierait l’ordre établi.
On ne résume pas Les Possédés. Il faudrait encore citer le personnage de Lébiadkine, vaguement officier en retraite et diplômé d’ivrognerie, qui bat sa sœur, laide, boiteuse et plus qu’à moitié folle. On apprendra que celle-ci (Maria Timopheïevna) a été épousée autrefois, par bravade et par Nicolaï Vsévolodovitch (c'est un zeugma), fils de Varvara Petrovna Stavroguine.
Ce personnage, qui occupe dans le roman une place centrale, on découvre dans un chapitre censuré (« La Confession de Stavroguine », ou « Chez Tikhone »), qu’il a longtemps été complètement barré, désespéré, capable de prendre au pied de la lettre, dans une réunion mondaine, le nommé Gaganov affirmant : « On ne me mène pas par le bout du nez », le saisissant aussitôt par l’appendice nasal et lui faisant traverser le salon.
La vie ne lui est de rien, semble-t-il, aussi incapable de s’aimer que d’aimer Lisaveta Nicolaïevna. On comprend, dans sa « confession », qu’il a sans doute violé une fillette, qu’il n’empêche pas ensuite de se pendre après qu'elle lui a déclaré : « J’ai tué Dieu ». Et pourtant, le comploteur Piotr Stépanovitch l’admire tel un demi-dieu, qu’il rêve de voir sur le trône de Russie en tant que « tsarévitch Ivan ». Allez comprendre. Je garde après lecture le sentiment que Stavroguine est un personnage romanesque incohérent (un peu à l'image du livre pris dans son entier).
Lébiadkine et sa sœur seront assassinés, soi-disant par l’ancien forçat évadé Fédka qui croyait trouver une forte somme. Les assassins présumés ont tenté de dissimuler leur forfait en mettant le feu à la maison au cours de l’incendie qui a détruit tout un quartier de la ville, mais la maison, isolée au milieu d’un terrain vague, a refusé de brûler. Fédka sera lui-même retrouvé mort, sur un chemin.
Il semblerait aussi que Dostoïevski a voulu régler quelques comptes avec l'écrivain Tourgueniev, qui s'est paraît-il offusqué du portrait dressé par l'auteur de l'écrivain Karmazinov, qui le présente sous un jour très peu sympathique. Entre « amis », n'est-ce pas.
Alors maintenant, quel est le vrai titre du livre ? J’avais depuis longtemps dans mes rayons Les Démons, dans une édition « club ». Et puis j’ai découvert que ce livre et le « poche » que je viens d’acheter (traduction de Boris de Schloezer) à 1,60 € ne font qu’un. Enfer et damnation. Il paraît qu’il faut dire « Les Démons ». Même si la perspective en est modifiée, ça ne change rien à la folie des personnages.
Ce qui domine de très haut, une fois qu’on l’a refermé, c’est à coup sûr la dénonciation violente de cette folie destructrice contenue dans l’utopie véhiculée par le petit groupe de conspirateurs dirigé par Verkhovensky, et mû par les théories de Chigaliov. Toute la seconde moitié des Possédés est un pamphlet dirigé contre la folie criminelle de Netchaïev et de tous ses semblables. Faut-il les appeler « communistes », « socialistes », « nihilistes » ? Ou plus simplement : « association de malfaiteurs » ?
Je pencherais volontiers vers la dernière hypothèse (il est vrai que l'enrichissement personnel n'est le but d'aucun "révolutionnaire"). En me disant que Dostoïevski nous parle d'un temps, après tout, pas aussi lointain qu'on pourrait le penser.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, dostoïevski, les possédés, les démons, bolchéviks, nihilisme, révolutionnaires, lénine, staline, netchaïev, chigaliov, communisme, socialisme, catéchisme du révolutionnaire, la mort de staline, bande dessinée, nury robin, état soviétique, confession de stavroguine, boris de schloezer, association de malfaiteurs
mardi, 26 mai 2015
« POSSÉDÉS » ou « DÉMONS » ?
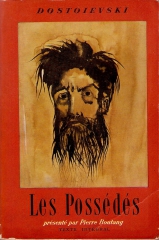 1/2
1/2
J’ai toujours entretenu une relation ambivalente avec Fédor Dostoïevski, échaudé vers l'âge de quatorze ans par des tentatives infructueuses dans L'Eternel mari et Le Joueur. Il a fallu du temps : rien de tel que l'étude de Cinna en classe de cinquième pour vous dégoûter durablement de Corneille. Et puis un jour, j’ai eu la chance de découvrir Les Frères Karamazov, qui m’avait transporté très loin et très haut. Si j’avais commencé par L’Idiot ou Crime et châtiment, je n’aurais probablement pas donné suite à l’invitation.
J’ai en effet laissé tomber L’Idiot à la page 454 (sur 751, édition Pléiade), pour dire que j'ai insisté. J’ai abandonné le prince Mnichkine en pleines parlotes. Crime et châtiment, c’était à la page 378 (sur 761, éditions Garnier), pour l’exacte même raison : des causettes interminables en cercles plus ou moins larges, dans des lieux plus ou moins confinés, voire inconfortables.
Après avoir achevé Les Possédés, œuvre qui recèle quelque chose de prodigieux, même si j’ai du mal à situer ce prodigieux-là, je me dis que la « parlote » n’est pas forcément un vice rédhibitoire dans un roman. Mais je devrais plutôt parler de « conversations ». Il m'appert même l'éventualité que la conversation ait été érigée par Dostoïevski en système romanesque à part entière.
Dostoïevski, je vais vous dire : c’est très spécial. Le lecteur est obligé de découvrir les faits, les situations, les relations à travers les yeux, la bouche et les oreilles de chacun des personnages. S’il veut saisir de quoi il est question, le lecteur doit endosser complètement un nouveau rôle à chaque changement d’interlocuteur, à travers les propos que les uns et les autres tiennent, au gré des circonstances. Une sacrée gymnastique : une nouvelle personnalité, sans même savoir de quoi celle-ci est faite, comme si vous changiez en permanence d'yeux, de cerveau, d'identité. Le récit à la troisième personne est réduit à la portion congrue.
L’auteur se garde bien d’expliquer quoi que ce soit, il embarque le lecteur dans une incroyable succession de points de vue spécifiques et de subjectivités embrouillées, souvent exaltées, ambiguës et contradictoires, toujours possédées par une passion inintelligible à la première approche. Comme une pièce de théâtre écrite dans une langue qu'ignore le spectateur, à qui l'auteur dirait : débrouille-toi. Sans sur- ou sous-titrage.
Disons-le, sur les 350 premières pages (la moitié), le sujet du livre reste dans un brouillard savamment entretenu. Ce n’est pas pour rien qu’on lit dans une notice consacrée au bouquin : « Aucune œuvre de Dostoïevski n’est plus difficile à lire que celle-ci, par la confusion et l’obscurité qui enserrent tous les personnages ».
Dostoïevski adopte une convention narrative complexe : c’est à force de s’emmêler dans les confrontations et interactions orales entre les personnages que le lecteur chemine vers la compréhension des caractères, des relations, des projets et intentions des uns et des autres. Le narrateur, qui s’affiche comme simple « chroniqueur » (sous le nom de « G…v »), se contente de témoigner de ce qu’il a vu, entendu, compris, même s’il lui arrive, comme n'importe quel ethnologue dans son enquête chez les Rakotofiringa ou les Pitjantjatjara, de pratiquer l’ « observation participante ».
Attention, ça ne l’empêche pas d’être bizarrement très au fait de tout un tas de détails concernant des événements auxquels il n’a carrément pas pu assister, et que nul n'a pu lui rapporter. Ainsi, comment s’y prend-il pour raconter dans le moindre détail l’assassinat de Chatov, qui n’a eu aucun autre témoin que la demi-douzaine de participants ? Ce n’est à coup sûr à aucun d’eux (Liamchine, Lipoutine, Piotr Stepanovitch, Virguinski, Chigaliov …) que serait venue l’idée de tout lui révéler. Disons que c’est tellement bien fait que le lecteur n’y voit que du feu, et gobe tout sans se poser de questions.
Il y a deux livres dans Les Possédés : la première moitié offre la peinture de la vie ordinaire et quotidienne d’une ville de la campagne russe, une ville dont on ne sait pas grand-chose de la taille ni de la distance qui la sépare de Pétersbourg, et où s’agitent un certain nombre de personnages plus ou moins oisifs qu’on verra en action dans la deuxième moitié. Leur occupation principale semble être de se rendre les uns chez les autres pour parler.
Chacun de ces personnages, à commencer par Stépane Trophimovitch Verkhovensky, intellectuel paresseux et parasite qui vit aux dépens de Varvara Pétrovna, riche veuve Stavroguine, est un peu fêlé, bizarre à sa façon, animé d’un déséquilibre qui lui appartient en propre, comme un trait d’identité. Tous se ressemblent sur un point : la médiocrité, qui confine en plus d’une occasion à la niaiserie et au ridicule.
Cette partie est pour l’essentiel énigmatique : on se demande où ça va. La deuxième moitié fonctionne donc à la manière d’un dévoilement, bien que le lien de nécessité entre les deux soit pour le moins évanescent. Sous les tensions, les désirs, les haines et les hypocrisies, on comprend que le masque des conventions et des rapports sociaux cachait une partie humainement âpre, qui trouve ses origines dans le passé et à l’étranger. Plusieurs des personnages ont séjourné, jadis ou naguère, aux Etats-Unis, en Suisse, à Berlin. Ce qu’ils y ont fait n’est évoqué que pour créer autour d’eux un climat de suspicion ou d’incertitude.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, dostoïevski, les possédés, les démons, les frères karamazov, crime et châtiment, l'idiot, prince mnichkine, stavroguine, verkhovensky, le joueur, l'éternel mari, corneille cinna
lundi, 11 mai 2015
LE DERNIER FRED VARGAS
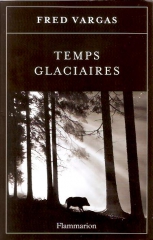 Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.
Note liminaire : je n'avais pas prévu que Le Masque et la plume inscrirait à son programme du 10 mai le dernier livre de Fred Vargas (ceci dit pour ceux qui ont écouté France Inter hier soir). Sur la chose, le modeste (et néanmoins péremptoire) commentaire qui suit était déjà entièrement écrit.
**************
Je pensais avoir délaissé le polar pour toujours. Quelqu’un m’a incité, dernièrement, à lire Adieu Lili Marleen, de Christian Roux (Rivages / Thriller, 2015). Désolé, je n’ai pas pu. Cette histoire de pianiste embarqué dans les sales histoires, ça m’est vite tombé des mains. J’ai renoncé. Peut- être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.
être à tort, je ne saurai pas, j'accepte l'idée.
L’argument avancé, le miel qui devait attirer l’ours hors de sa tanière, était pourtant alléchant : la musique, et pas n'importe laquelle. Avec des têtes de chapitres du genre interpellant. Pensez : « Opus 111 ». Mieux encore : « Muss es sein ? – Es muss sein ». Vous vous rendez compte ? Mais si, rappelez-vous : la dernière sonate (op. 111 en ut mineur, 1824) et la dernière œuvre (quatuor op. 135 en fa majeur, composé en 1826) écrites par Ludwig van ! De quoi tilter, évidemment, si le mot a encore un sens aujourd’hui. Ben non, je n’ai pas pu.
Mais le quelqu’un en question y est allé plus fort ensuite. Elle est têtue : revenant d’une visite au festival « Quais du polar », qui s’est tenu à Lyon récemment, elle m’a offert le dernier Fred Vargas : Temps glaciaires (Flammarion, 2015). C’est connu : « A cheval donné, on ne regarde pas les dents », tout le monde sait ça.
De Vargas, j'avais déjà lu Pars vite et reviens tard (avec sa fin en pirouette décevante), Sous les vents de Neptune (avec son criminel grandiose qui s'échappe à la fin), Un Lieu incertain (avec son ostéopathe et son évocation originale de Dante Gabriel Rossetti), L'Homme à l'envers (avec son Canadien obsédé par les loups du Mercantour). Des polars corrects qui m'ont laissé des souvenirs assez bons. Pas des chefs d'œuvre, mais. J’ai donc ouvert le livre.
J’ai failli le refermer vite fait. Pour une raison très simple, la même qui m’a fait refermer à toute vitesse Alexandre Dumas, quand j’ai voulu relire dernièrement Les Trois Mousquetaires : le tirage à la ligne. Le moyen est simple : quand vous êtes payé à la ligne, allez à la ligne au bout de trois mots. Les dialogues sont faits pour ça.
Vous organisez une bonne partie de ping-pong verbal entre plusieurs personnages, et vous voilà parti pour un volume épais comme un Bottin de l'ancien temps. C’est flatteur pour vous : vous avez lu cent pages en un temps record. Ici, les personnages ne manquent pas, c'est la brigade que commande le commissaire Adamsberg. A chacun son caractère, et toujours « le petit fait vrai ». C'est merveilleusement interactif. Donc ça permet d'allonger la sauce.
Malheureusement, ça sent le procédé à cent kilomètres. Pourtant, je n’ai pas lâché. A cause d’une circonstance particulière : le livre parle d’Akureyri. Alors là, vaincu, je me suis senti obligé. Je dois quand même dire que si mes chers J. et S. n’étaient pas allés traîner leurs guêtres par là-bas pour guetter les aurores boréales, le nom de la ville serait resté pour moi une suite de sons un peu exotique. Rien de plus. J'aurais laissé tomber.

Timbre portant le cachet de la poste d'Akureyri.
Or il est bel et bien question de l’Islande, dans le roman de Fred Vargas, et de sa région nord : Akureyri, au fond de son fjord, l’île de Grimsey, sur le cercle polaire arctique (66° 66’). Il est question du village de Kirkjubæjarklaustur (ouf !), où est né Almar. Il est aussi question du tölvar, « la sorcière qui compte ». Le tölvar n’est rien d’autre que l’ordinateur, en islandais.
Il est encore question d’un esprit dangereux et impérieux qu’on nomme l’afturganga, qui lance des appels irrésistibles à certains, même très éloignés, et qui châtie à coups de brume absolument impénétrable ceux qui s’attardent chez lui sans son accord. Rögnvar : « L'afturganga ne convoque jamais en vain. Et son offrande conduit toujours sur un chemin » (p. 406). A bon entendeur, salut ! C'est la majestueuse et puissante Retancourt qui sauve in extremis l'équipe et l'enquête. Rögnvar avait raison.

Voilà. Je ne vais pas résumer l’intrigue. Je dois avouer qu’elle est surprenante. En refermant le bouquin, j’ai envie de dire à madame Vargas : « Bien joué ! ». Il est vrai qu’il faut passer par-dessus l’horripilation produite par le choix du mode de relation des faits (le dialogue). La lecture épouse de l'intérieur toutes les circonvolutions cérébrales de l'équipe, les hésitations, conflits plus ou moins larvés entre ses membres, retours en arrière des personnages réunis autour d'Adamsberg. Disons-le : ça peut lasser, si l'on n'est pas prévenu.
L’avantage de l’inconvénient de ce choix narratif, c’est la maîtrise totale du rythme du récit par l’écrivain. Et c’est vrai que ça commence plan-plan, et même que ça se traîne au début. Et puis, insensiblement, ça accélère, ça devient fiévreux, un coup de barre à bâbord, puis à tribord, le vent forcit, la mer se creuse, et ça finit dans les coups de vent et la tempête. Va pour le dialogue, en fin de compte. Je ne suis quand même pas sûr que cette façon d'installer un "climat" soit absolument nécessaire.
A mentionner, le passage par une improbable association d’amoureux de la Révolution française en général et de Robespierre en particulier, qui s’ingénient, à dates fixes, à rejouer les grandes séances des Assemblées, depuis la Constituante jusqu’à la Convention. En perruque et costume, s’il vous plaît. Beaucoup d’adhérents, comme s’ils revivaient les passions de l’époque, se laissent emporter par l’exaltation historique. C’est assez impressionnant. Mettons : original.
Au sujet du bouquin, j’avais lu dans un Monde des Livres un commentaire condescendant d’Eric Chevillard, écrivain de petite renommée hébergé par les Editions de Minuit. J’imagine que dire du mal de la production de Fred Vargas n’est pas un enjeu majeur dans le microcosme littéraire parisien, et que Chevillard ne risque pas grand-chose à flinguer sa consœur. Passons. Quoi qu’il en soit, je sais gré à la dame de s’y être prise assez adroitement pour m’amener à m’intéresser à l’histoire, jusqu’à me permettre de surmonter ma répugnance à affronter tant de parlotes.
Tout juste ai-je noté quelques préciosités de vocabulaire (« alenti », p. 126 ; « étrécies », p. 203) ; quelques bourdes grammaticales ici ou là (« et celle de François Château qui, oui, lui semblait-il, le reconnaissait », au lieu manifestement de « qu’il reconnaissait », p. 193 ; « substituer » au lieu de « subsister », p. 221). Une étourderie scientifique : que je sache, le manchot empereur n'a rien à voir avec les « oiseaux nordiques » (p. 192). Rien de bien grave, comme on voit. Dernière précision : je n'ai jamais vu, dans aucun polar, mettre en œuvre une fausse piste aussi énorme.
Je finirai sur une préoccupation du moment. Manuel Valls, premier ministre, et Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, en plein débat sur la « loi renseignement », ne désavoueraient certainement pas cette parole de Robespierre rapportée p. 331 : « Je dis que quiconque tremble en ce moment est coupable ; car jamais l’innocence ne redoute la surveillance publique ». Robespierre était pour la transparence totale des individus.
Ça fait froid dans le dos, quand on y réfléchit un peu : quand on est innocent, on n'a rien à craindre des intrusions policières. Ça pourrait même faire un argument pour Valls et Cazeneuve : ceux qui protestent contre la « loi renseignement », c'est parce qu'ils sont coupables. Valls + Cazeneuve (+ Hollande) = Robespierre. Drôle d'équation, non ?
Avis à tous les "innocents" qui raisonnent en se disant : « Oh, moi, du moment que je n'ai rien à me reprocher, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent ». En ces temps d'espionnage généralisé et de collecte intégrale des données personnelles, la phrase de Robespierre est d’actualité ou je ne m’y connais pas.
Ne pas oublier que la période où "l'Incorruptible" dominait porte encore le nom de Terreur. Heureusement, il y eut le 9 thermidor an II (27 juillet 1794). Avis aux actuels adeptes de la « surveillance publique ».
Voilà ce que je dis, moi.
 Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!
Note : le sanglier visible sur la couverture est un vrai personnage. Il s'appelle Marc. Il protège Céleste. Il a une hure douce comme un bec de canard. Il est à deux doigts d'y passer, à coups de rafales de MP5 (ci-contre) (cliquez pour 1'48"). On est content qu'il survive. Même si les infirmiers ne sont pas contents. Un sanglier à l'hôpital ? Vous n'y pensez pas !!!
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : festival quais du polar, lyon, littérature, littérature française, polar, roman policier, fred vargas, lili marleen christian roux, beethoven, opus 111, muss es sein es muss sein, opus 135, temps glaciaires flammarion, alexandre dumas les trois mousquetaires, commissaire adamsberg, akureyri, aurores boréales, islande, tölvar, éric chevillard, éditions de minuit, manuel valls, bernard cazeneuve, françois hollande, manchot empereur, robespierre, révolution française, loi renseignement, l'incorruptible, la terreur, pars vite et reviens tard, sous les vents de neptune, un lieu incertain, l'homme à l'envers
samedi, 09 mai 2015
L'HOMME EST APPROXIMATIF
Est-ce ainsi que Pierre Reverdy envisageait ses "Flaques de verre" ?
A moins que ce ne soit qu'un grain de café presque transparent.
(Murakami Ryu a écrit l'allumé halluciné Bleu presque transparent.)
**********************************************************************************
Je n’ai jamais pu me dépêtrer de L’Homme approximatif. Cette œuvre de Tristan Tzara (qui a bien connu Pierre Reverdy), qui n'a pas arrêté de me courir après depuis des millénaires, m’a convaincu que, quand on est poète, on ne saurait se résumer au croupion d'un quelconque Mouvement Dada, ou au squelette d'une vulgaire Révolution Surréaliste. Et qu'il y a de la chair, et de la bonne, sur les os de cette volaille : c'est du corpulent.
Que l’homme ne sait jamais ce dont il est porteur quand il fait. Qu’il n’est jamais ce qu’il croit être. Qu'il est une flèche lancée par l'arc d'il ne saura jamais qui. Que la trajectoire humaine n'est jamais une ligne droite. Que ce qu’il est dépasse (je n’ose pas dire "transcende") de loin l’image qu'il s'est faite de ce qu'il doit être. Quand le poète est en état de produire cet effet, il dégage un puissant souffle de vérité. Ici, il me dépasse.

L’Homme approximatif me colle à la peau. Tenez ce petit fragment :
« frileux avenir – lent à venir
un écumant sursaut m’a mis sur ta trace de regard là-haut où tout n’est que pierre et nappe de temps voisin des crêtes argileuses où les jamais s’enflent sous robe d’allusion
je chante l’incalculable aumône d’amertume
qu’un ciel de pierre nous jette – nourriture de honte et de râle –
en nous rit l’abîme
que nulle mesure n’entame
que nulle voix ne s’aventure à éclairer
insaisissable se tend son réseau de risque et d’orgueil
là où l’on n’en peut plus
où se perd le règne du silence plat pulsation de la nuit ainsi se rangent les jours au nombre des désinvoltures et les sommeils qui vivent aux crochets du jour sous leur joug
jour après jour se rongent la queue et dansent autour et là-haut là-haut tout n’est que pierre et danse autour »
Rien que le titre du livre est un chef d’œuvre.
Voilà ce que je dis, moi.
**********************************************************************************
Babioles :
Elections législatives en Grande-Bretagne.
Une fois de plus, prosternons-nous devant l'infaillibilité Royale et Scientifique de leurs Majestés et de leurs Excellences les Sondages d'Opinion.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, littérature, tristan tzara, dada, surréalisme, dadaïsme, pierre reverdy, flaques de verre, la révolution surréaliste, andré breton, grande bretagne, david cameron, tory, labour, ed milliband, nick clegg, sondages d'opinion, élections législatives
lundi, 30 mars 2015
IL N’Y A PAS DE "SCIENCE ÉCONOMIQUE"
2/2
Je parlais de l'infirmité des pompeusement nommées « Sciences Humaines », qui ne portent le nom de sciences que par abus de langage. L'expression porte probablement le stigmate de son origine : le scientisme, cette croyance absolue dans le pouvoir de la science de résoudre tous les problèmes de l'humanité, imprégna jusqu'au coeur la moindre fibre de la seconde moitié du 19ème siècle.
Flaubert l'a personnifié sous les traits du pharmacien Homais, dont il a fait le masque de la bêtise satisfaite, la bêtise de « celui qui sait ». Parlant de je ne sais plus qui, Clémenceau disait joliment : « Il sait tout, mais rien d'autre ». Flaubert a tout compris : Bouvard et Pécuchet, me semble-t-il, ayant fait le tour du savoir encyclopédique, reviennent humblement pour finir à la tâche que s'assignaient les moines copistes du moyen âge.
Les « sciences molles » (le Collège de 'Pataphysique les appelle plus justement les « Sciences Inexactes », par opposition aux « Sciences Exactes », dites dures qui, elles, s'efforcent à l'exactitude) se sont empressées de se ranger sous cette bannière, qui leur conférait une dignité dont elles n'auraient jamais osé rêver sur leurs seuls mérites.
Sans pouvoir toutefois effacer le stigmate que constitue l'adjectif qualificatif "humaines" : quand on est obligé d'ajouter l'adjectif, c'est que son absence porterait à confusion. Quand on entre dans une « Faculté des Sciences », aucun doute sur les disciplines qu'on y enseigne, d'où l'absence d'adjectif.
Mais tout le monde a laissé faire, par pitié envers les « Sciences Humaines », ces cousines disgraciées, qu'on invite de temps en temps, le dimanche, parce qu'il faut bien se montrer un peu magnanime avec le pauvre monde. Ainsi l'habitude a été prise, et j'imagine que le 20ème siècle n'a jamais voulu, osé ou pu rétablir la vérité. Monsieur Homais est entré au Collège de France et à l'Académie Française. Il fait autorité. Alors même qu'il faudrait peut-être renommer les « Sciences Humaines » les Sciences Fausses.
Car le vice rédhibitoire dont souffrent les « Sciences Humaines », c’est précisément l’Homme, avec ses désirs, ses calculs, son hypocrisie et sa sincérité, ses manœuvres, ses intérêts particuliers, ses audaces et ses peurs, ses haines et ses amours, ses constructions comme ses destructions, bref, sa LIBERTÉ. C'est-à-dire ce dont sont démunies les forces aveugles et déterminées de la nature.
Non, l’économie n’est définitivement pas une science. Je n’énonce pas une énormité obscène : écoutez pour vous en convaincre l’émission de Dominique Rousset, le samedi sur France Culture. Quel que soit le thème choisi (dans l’actualité), vous les entendez, au bout d’un temps plus ou moins long, se chamailler. Deux économistes ne seront jamais entièrement d'accord.
Je rêve de les voir un jour en venir aux mains et, pourquoi pas, s'entretuer, pour qu'on s'amuse un peu. Vous imaginez, un combat à la loyale, à l'épée, « sur le pré », entre John Maynard Keynes et Milton Friedman ? Mais ils ne sont pas assez fous pour cela : ils se disent qu'un tel spectacle tuerait la poule aux œufs d'or, le « métier ». Il faut rester "digne", et pour cela, courtois et bien élevé. Propre.
Leurs désaccords n'en sont pas moins irréductibles. Ceci pour une raison très simple : l'étiquette "économiste" dissimule en règle très générale une tout autre personne que celle qui se donne pour spécialiste de ceci, expert en cela, capable d'assener (si, si, sans accent, c'est légal !) à toute la population du public terrorisé les certitudes absolues qu'il a acquises dans le domaine dont il se déclare le maître.
Cette personne est celle du militant politique. Les théories sur lesquelles ces gens s'appuient sont l'exact reflet du système politique dans lequel ils rêvent de les appliquer. En gros, sur le ring où ils s'affrontent, ça donne John Maynard Keynes contre Milton Friedman. Traduction : l'intérêt général contre les intérêts privés. Marx contre le Capital, si vous préférez.
Un économiste neutre est aussi crédible que ma sœur en monstre du Loch Ness. Il n'y a pas d'économie a-politique, mais des modèles d'organisation sociale qui s'affrontent : où faut-il placer le point d'équilibre entre les intérêts particuliers et l'intérêt supérieur du corps social dans son entier ? A qui et à quoi donner la priorité ? L'entrepreneur ou la collectivité ? L'efficacité économique ou la justice sociale ? Quand commence l'accaparement de la richesse ? Comment une société décide-t-elle de la façon dont elle veut vivre ?
Soit dit en passant, la logique à l'oeuvre dans le système actuel, et qui tend à imposer sa volonté aux Etats, elle est limpide : mettez en face le chiffre toujours plus impressionnant des pauvres qui ont besoin des Restos du cœur ou des Banques alimentaires pour survivre et le chiffre toujours plus astronomique des fortunes amassées par le centile des plus riches de la planète. Cela vous donne une idée de la montée irrésistible de l'Injustice. Or on sait que l'injustice produit immanquablement, à plus ou moins long terme, la violence.
Pas d'économiste objectif, donc : une théorie économique ne peut faire autrement que d'être au service de l'idée qu'on se fait de la société. Vous pouvez aisément vérifier. S’ils sont, en gros, d’accord sur le constat (il suffit de lire les journaux, les statistiques du chômage, les fermetures d’usines, …), dès qu’on aborde l’analyse des causes ou les propositions de solutions, rien ne va plus. Il m’est arrivé d’entendre des disputes homériques entre les quatre « scientifiques » invités par Dominique Rousset. J’ai fini par les abandonner à leur triste sort. Pas d'économie sans choix de société. D'où leurs disputes interminables.
Imagine-t-on se disputer ainsi deux physiciens évoquant l’existence du « boson de Higgs », dont le LHC du CERN a apporté la preuve (deux vrais spécialistes du climat évoquant le « réchauffement climatique » feront très bien l’affaire) ? Et tout le monde est d'accord pour traiter d'hurluberlu indépassable ce « scientifique » arabe (ou musulman, je ne sais plus, peut-être les deux) qui vient de décréter que la Terre est plate. Résumons : il y a des acquis irréfutables de la Science. Il n'y a pas de preuve définitive en économie.
Si l'économie était une science, un consensus finirait par s’établir entre « experts », exactement de la même manière que s’est établi le consensus des milliers de scientifiques du GIEC sur le climat, après la recension faite de l'intégralité de la littérature scientifique consacrée au sujet. Je compte pour rien les vociférations du gouverneur de Floride, Rick Scott, qui interdit aux fonctionnaires de son administration de prononcer l’expression « réchauffement climatique » (Le Monde, 24 mars), et autres élucubrations des « climatosceptiques ».
A ce propos, on peut cliquer sur le lien avec l'article : je conseille vivement la vidéo - 2'07" - désopilante : il faut voir quelques sénateurs américains se payer une bonne tranche de rigolade aux dépens du gars interrogé, tout propre sur lui et souriant, tournant autour de la formule taboue, mais complètement emberlificoté dans le ridicule à cause de la consigne reçue de ne pas la prononcer.
Malheureusement, si l'économie n'est pas une science, trop de gens riches et puissants ont intérêt à ce que tout le monde le croie quand même, malgré tous les démentis que leur inflige la réalité. Avec l'appui de quelles complicités les « Usurpateurs » (titre du dernier livre de Susan George sur le même sujet, voir ici même, 17 mars) ont-ils réussi à imposer dans les esprits l'expression "Prix Nobel d'économie", au mépris pur et simple des volontés testamentaires d'Alfred Nobel ? Le testament instaure cinq prix (Physique, Chimie, Médecine, Paix, Littérature), pas un de plus. C'est ce que Bernard Maris dénonce en p. 15 de Houellebecq économiste, livre polémique, c'est certain, mais tout à fait salutaire et nécessaire.
Voire indispensable. Et peut-être même utile. « Économiste sérieux » est un oxymore. La seule spécialité de l'économiste : l'enfumage.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, france, science économique, sciences humaines, flaubert, madame bovary, pharmacien homais, collège de pataphysique, collège de france, académie française, dominique rousset, france culture, john maynard keynes, milton friedman, karl marx le capital, restos du coeur, banques alimentaires, boson de higgs, cern lhc, réchauffement climatique, giec, gouverneur de floride rick scott, journal le monde, les usurpateurs susan george, prix nobel d'économie, michel houellebecq, houellebecq économiste, bernard maris, littérature
mercredi, 18 février 2015
QU'EST-CE QU'UN AEGAGROPILE ?
Cette chronique ne parlera de rien. Parce que je n’ai pas le temps de penser. On ne pense pas sans avoir du temps. A moins d’avoir l’esprit très vif. Comme le rat, ou les chansonniers. Et aussi le cheval d’Elberfeld qui calculait les racines carrées. Le rat, lui, démonte les engrenages quad ils l’empêchent d’arriver jusqu’au lard. Il flaire les pièges. Il a des moustaches qui le renseignent, très sensibles de l’extrémité. Les chansonniers, eux, n’en ont pas : ils ont l’habitude, qui compense. Mais l’homme moyen ne pense pas très vite ; il n’a ni moustache ni réflexe, sa pensée a besoin du temps. Et aussi d’un certain obstacle autour duquel elle s’agglomère, qu’elle essaie de digérer ; qui l’arrête, la provoque. Elle se forme comme les « moutons » sous le lit de la grand-mère dans une maison bourgeoise : de brimborions agglutinés ; de poussières venues d’un peu partout, dans un endroit inaccessible ; de temps qui passe et de balai qui ne passe pas.
Comme les moutons et les aegagropiles (j’aime bien parler des aegagropiles ; ils font chercher dans le dictionnaire et il n’y a pas de plus grande volupté ; on y prend un plaisir extrême) ; les aegagropiles se forment dans l’intestin des animaux qui se lèchent les poils : le chat, la chèvre, le cheval. Ces poils se collent dans l’intestin autour de quelque calcul ou de quelque grain de sable. Ils finissent par former des boules. Des concrétions brillantes. Parfois énormes, et le cheval en crève. Le philosophe aussi ; plus lentement : à force de se lécher les poils il forme des pensées énormes ; il en meurt ; mais plus tard d’autres les utilisent, on les retrouve dans le commerce ; on en joue au billard ; ses disciples en font en matière synthétique ; en plastique jaune ou en papier mâché ; qui ont autant de succès que ceux du maître.
Alexandre Vialatte,
Chroniques de La Montagne,
19 octobre 1965.
Mon ami Gilles m’avait montré, dans le temps, un de ces objets : bizarre, doux au toucher, léger, velu et apparemment indestructible tant il était dur. Cela sortait de l’estomac d’un veau, vous savez, un de ces animaux élevés en batterie, qui s’ennuient tellement qu’ils lèchent le voisin de leur langue râpeuse. La boule en question (il n’avait pas prononcé le mot « aegagropile »), faite de poils, de matières diverses et de sécrétion, avait l’aspect d’un galet assez rond, brunâtre, un peu aplati, d’une dimension capable de remplir une large main.

Ça m’avait laissé pantois.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : le dictionnaire indique l'orthographe "égagropile".
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, aegagropile, alexandre vialatte, égagropile, chroniques de la montagne, humour
mardi, 17 février 2015
MOBY DICK
2/2
Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre de la littérature ?
Je parlais hier de l'incroyable personnage de Quiequeg inventé par Herman Melville.
Le personnage d’Ismahel (le narrateur) occupe une place beaucoup moins nette. Au début du livre, il raconte « simplement » ce qui lui arrive : son arrivée à New Bedford, puis sa traversée vers Nantucket, son arrivée et son séjour à la « Taverne du Souffle », sa rencontre étonnante et son étrange cohabitation avec Quiequeg, son embarquement sur le Pequod, embauché par les armateurs Bilbad et Peleg, anciens capitaines eux-mêmes, tout cela le place sur le devant de la scène.
On le retrouvera à la toute fin, parce qu’il faut quand même un rescapé pour raconter l’histoire. Entre les deux, c’est-à-dire dans cent vingt-trois des cent trente-cinq chapitres, il se fait un narrateur polyvalent et effacé, capable de faire parler successivement tous les personnages. Je dois dire que le lecteur ne prête aucune attention à ce détail : tout coule de source.
Il faut faire un sort particulier, au début, au prêche que le père Mapple adresse du haut de sa chaire en forme de proue de navire (dont il retire soigneusement l’échelle de coupée une fois arrivé en haut), aux fidèles rassemblés dans la petite église. John Huston, pour son film Moby Dick (1956) ne pouvait pas choisir de meilleur père Mapple qu’Orson Welles. Le sermon vaut, en portée littéraire, morale, philosophique, la fiction poétique connue, dans Les Frères Karamazov, sous le titre « Le Grand Inquisiteur » : quel souffle !
On ne résume pas Moby Dick. On garde en mémoire quelques scènes particulières. La fable de Jonas dans le ventre du grand poisson, dans la flamboyance de sa restitution par le père Mapple en fait partie. La harangue d’Achab à son équipage, au chapitre 36, en est une autre.
Il fait jurer à tous de tout donner pour en finir avec le grand cachalot blanc (« … jurez la mort de Moby Dick ! »), en promettant à celui qui le signalera le doublon d’or de l’Equateur qu’il a incrusté à coups de masse dans le bois du grand mât, harangue dont la phrase maîtresse est sans doute cette question arrogante et impie : « Qui est donc au-dessus de moi ? », lancée à la face de Dieu et des hommes.
Seul maître à bord après lui-même, donc. Lui seul, Achab, maître de trente destins qu’il préfère conduire à l’abîme plutôt que de supporter encore l’humiliation infligée naguère par le géant des mers, cet albinos immense comme un monde, féroce et sournois, à qui il doit de boiter sur son tibia d’ivoire, et dont les autres capitaines (des gens normaux, eux, excepté le commandant de la "Rachel", qui y perdra ses deux fils) s’écartent prudemment de la route tant est sulfureuse la réputation diabolique de la baleine.
L’aspect le plus déroutant du livre est à mon avis l’effort d’encyclopédiste auquel s’adonne le narrateur, le seul qui ait survécu au naufrage. L’immersion dans le gigantesque corps du cachalot a beau s’étendre sur vingt chapitres et au-delà, j’avoue que j’ai gobé tout ça sans sourciller, et même avec gourmandise.
Herman Melville fait découvrir au lecteur l’invraisemblable succession de chefs d’œuvre de la nature qui forment l’infinité des couches (de l'épiderme jusqu'à l'intestin) enveloppant l’énormité stupéfiante du mystère que constitue le cachalot, de par son existence seule. L'être du cachalot est en soi un défi à l'imagination. On saura tout (non, pas tout) de son évent unique, de ses yeux minuscules, de la matière incroyable (le spermaceti) que recèle la fabuleuse citerne qui lui sert de proue (voire de bélier), à la conquête de laquelle se résume presque l’entièreté de la « chasse à la baleine ». Je n’insiste pas.
Melville fait aussi découvrir – comme personne ne l’a fait, je crois – l’extraordinaire dureté du métier de marin sur un navire baleinier au temps de la marine à voile : entre les manœuvres dans les vergues et les haubans, les coups de rames qu’il faut donner pour prendre de vitesse le cachalot et ne pas lui laisser le temps de fausser compagnie, et le travail d’amarrage du « poisson » contre le bord et son dépeçage, jusqu’à la récolte de la précieuse huile, dont les fûts finissent parfois par envahir le pont, le marin n’a jamais fini. On comprend qu’il faille des hommes à toute épreuve.
Impossible de faire le tour de Moby Dick : le livre déborde de tous côtés, et ce n’est pas en tirant un seul fil qu’on en finirait. Il faudrait mentionner la puissance avec laquelle sont dessinés les personnages principaux, chacun apparaissant doté d’un monde intérieur qui n’appartient qu’à lui. Il faudrait reparler de Quiequeg et de son « cercueil », qui servira de loch au navire après la destruction de l’original, et de bouée de sauvetage à Ismahel. On ne saurait décréter qu’on en a fini.
Plutôt relire le livre.
Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre de la littérature ? C’est Moby Dick.
Voilà ce que je dis, moi.
*************************************************
Je signale aux amateurs de livres que les éditions du Bug, fondées en 2014, viennent de faire paraître en janvier :
1 - Roland Thévenet : La Queue.
2 - Bertrand Redonnet : Le Silence des chrysanthèmes.
On peut contacter les éditions du Bug en passant par le blog Solko, ou par le blog L'exil des mots.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, herman melville, moby dick, nantucket, navire baleinier, baleinière, pequod, capitaine achab, orson welles, john huston, les frères karamazov, le grand inquisiteur, dostoïevski, père mapple, roland thévenet, bertrand redonnet, solko, les éditions du bug
lundi, 16 février 2015
MOBY DICK
Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre de la littérature ?
1/2
La première fois que j’ai lu Moby Dick, c’était en 2010 et un enchantement (notez le zeugma). J’ai avalé le pavé comme un bonbon de sucre aromatisé à l'existence humaine, comme dans un état second, hypnotisé par un livre comme je n’en avais jamais lu auparavant. Je me rappelle avoir jubilé de la première à la dernière page. Extraordinaire souvenir. Dans la foulée, j’avais enchaîné avec Mardi et Redburn.
Mais Mardi est une fantaisie métaphorique un peu lourde (et copieuse), racontant la circumnavigation en pirogue autour d’un archipel qui se révèle avoir les dimensions de la planète, avec à son bord quelques échantillons, disons, « typés » de l’humanité (où je vois le poète, le prêtre, le politique, le fou, …). L’intention d’Herman Melville a eu du mal à m’apparaître, y compris à travers le fait qu’ils boivent tous comme des trous.
Quant à Redburn, j’avais beaucoup aimé ce récit de l’apprentissage d’un novice, obligé par la misère noire où la faillite et la mort paternelles ont plongé la famille, de se faire mousse sur un de ces grands voiliers qui font la navette entre les deux rives de l’Atlantique. Il vend même à un juif, pour trois kopeks de l'époque, sa carabine patrimoniale, et se présente dans une tenue ridicule au capitaine qui l'enrôle.
L’apprentissage est d’une grande brutalité, surtout lorsque Redburn découvre que le Liverpool où il débarque n’a rien à voir avec la description minutieuse et presque touristique que son père, homme aux affaires autrefois florissantes, en a laissée dans un gros carnet qu’il gardait précieusement, mais comme un talisman dont les effets s’évanouissent face aux réalités mouvantes du monde. Un livre excellent.
Mais j'avais lu Moby Dick. Le reste pâlit forcément. A la deuxième lecture, l’effet d’émerveillement n’est évidemment plus le même : le lecteur sait à quoi s’attendre, il n’est plus dans la découverte d’un absolu. Comme dans les choses de l’amour, la « première fois » lui a fait perdre de - appelons ça : sa naïveté. Après, quoi qu'on dise, on recommence. On connaît les gestes à faire. Et puis il y a les records à battre. Ce qui différencie Moby Dick de Redburn et Mardi, c’est que dans Moby Dick, il y a tout.
Pour dire qu’il y a tout, on y trouve même, par exemple, une dénonciation des hiérarchies en vigueur dans la marine américaine, qui réserve les commandements de navires à des Américains blancs, recrutant le fretin et la piétaille de base parmi les autres nations du monde (métaphore du "melting pot" ?), et confiant le harpon à des « sauvages » (un Indien, un Fidjien - ou qui que ce soit d'autre -, un Africain).
Je passe rapidement sur les moyens littéraires : tour à tour le récit se fait poétique et inspiré, lyrique et exalté, éloquent et classique, narratif et palpitant, philosophique, historique, politique, moral, théâtral, méditatif, mystique, bref, tous les genres possibles – passés, présents et à venir – de la littérature.
Si Moby Dick était de la musique, je dirais qu’on y trouve l’amplitude la plus forte de ce qu’on appelle les « dynamiques » (tout ce que le format MP3 régnant a ratiboisé par nivellement) : du calme le plus plat à la violence la plus déchaînée. Du pianississimo au fortississimo et retour. Les oreilles actuelles (et tout ce qui va avec) ont perdu toute acuité auditive. Herman Melville n'est plus de notre monde. C'est de la littérature d'avant.
Dans Moby Dick, il y a aussi l’infinie variété des caractères humains, étant entendu que le personnage d’Achab fait figure d’exception inhumaine dans la galerie des portraits tracés par Herman Melville. Des trois « Seconds », Starbuck occupe le rôle du « craignant Dieu » : son sens de la discipline l’oblige à respecter son commandant, mais il n’en pense pas moins, par-devers lui. Stubb est l’optimiste de profession : il ne se départ (si, si, c’est comme ça qu’on conjugue) jamais d’une équanimité inentamable. Flask est celui qui pèse le moins, tout au moins quand il est assis à la table des officiers : son assiette est la dernière à être servie, quand il en reste.
Sur le Pequod (nom d’une tribu indienne exterminée, paraît-il, mais ce n’est pas dit dans le bouquin), il y a trois harponneurs : Tashtego, l’Indien, Daggoo, le géant noir aux dents d’ivoire et Quiequeg, originaire des îles, une force de la nature, augmentés d’une créature tant soit peu diabolique, amené clandestinement sur le bateau par Achab, du nom de Fedallah, selon toute vraisemblance porteur de maléfice. Sur les autres marins, en dehors d’Ismahel, et pour cause, on n’en saura pas plus. Sans doute une préfiguration de la « foule des anonymes ».
Quiequeg occupe une place à part, introduit dans l’histoire et sur le Pequod par le narrateur, Ismahel, dont le hasard, puis l’amitié lui a fait partager la chambre d’auberge, le lit et les étranges pratiques rituelles. Modèle d’une vie « sauvage » parfaitement organisée et tout aussi valable et signifiante que celle des civilisés, Quiequeg apparaît en plusieurs occasions, toujours pour montrer l’exactitude étonnante avec laquelle son instinct lui permet de s’adapter aux circonstances, des plus anodines (voire cocasses) aux plus dangereuses.
Voilà ce que je dis, moi.
*************************************************
Je signale aux amateurs de livres que les éditions du Bug, fondées en 2014, viennent de faire paraître en janvier :
1 - Roland Thévenet : La Queue.
2 - Bertrand Redonnet : Le Silence des chrysanthèmes.
On peut contacter les éditions du Bug en passant par le blog Solko, ou par le blog L'exil des mots.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, herman melville, moby dick, redburn herman melville, mardi herman melville, capitaine achab, pequod
dimanche, 15 février 2015
ÇA FAISAIT LONGTEMPS
De l'art et de l'élégance avec lesquels Alexandre Vialatte fait exploser les niaiseries qui planent avec autorité dans l'air du temps.
***********************************
J’aimerais apporter en étrennes, à tous les lecteurs de La Montagne, de nouvelles preuves de l’existence de Dieu et de plusieurs appartements vacants. Quels sont, en effet, les premiers besoins de l’homme ? Dieu et un appartement libre. Et d’ailleurs on ne peut pas trouver d’appartement si Dieu ne s’en mêle pas plus ou moins. L’inconfort gagne tous les jours. Nous ne vivons plus à la belle époque où le progrès n’avait pas encore supprimé les agréments, les commodités et jusqu’aux conditions de la vie. L’air de nos rues tue le rat, affaiblit le basset, et asphyxierait le sergent de ville si on ne le juchait sur des tours de bois blanc. L’eau de nos rivières empoisonne le poisson et nos mers salissent le baigneur. Nos solitudes sont envahies.
Nos oreilles assourdies, notre pain trafiqué, nos cigarettes cancérigènes, notre corps comprimé par la foule, nos rues bouchées par les autos, nos autos arrêtées par les autres autos, et nous cherchons vainement un toit. Si nous voulons en trouver un, il faut que la Providence s’en mêle.
Aussi devons-nous remercier deux fois Minou Drouet qui nous apporte de nouvelles preuves de l’existence d’une divinité qui est si nécessaire par elle-même et pour trouver un appartement. Elle en a eu la révélation en regardant Greta Garbo sur son écran de télévision.
« S’il n’y avait pas d’autres preuves de l’existence de Dieu, a-t-elle noté dans son journal intime, Greta Garbo suffirait à la prouver. » Et, en effet, on est saisi d’admiration comme devant une chose impossible, devant ces yeux qui ont fait tourner tant de têtes, ces pieds qui ont fait tant de kilomètres, ces mains qui ont gagné tant de millions, ce pouce qui s’oppose aux autres doigts comme chez l’homme et les grands singes, à l’exclusion de toute autre espèce de vertébrés, de sorte qu’ils peuvent prendre des chèques, allumer des cigarettes blondes, mettre du sucre dans une tasse et faire tout comme une grande personne ; ces poumons qui entretiennent l’oxygénation du sang ; ce cœur qui fonctionne sans moteur à la façon d’une pompe aspirante et foulante ; cet estomac qui digère le caviar, la truffe, le whisky, les cocktails, et tous les aliments d’une façon générale, par inspiration naturelle, sans que personne lui ait jamais appris ; ces membres inférieurs qui permettent à l’ensemble de progresser à la surface du sol sans le secours d’aucune mécanique, grâce à un ensemble de muscle, de nerfs et d’articulations si adroitement agencés qu’on en est comme dans le ravissement ; et cet équilibre du corps qui assure aux grandes actrices, aux caissiers, aux comptables, et même à l’homme, pour dire les choses en gros, la possibilité de marcher verticalement qu’on demanderait à la carpe, au mille-pattes ou au grabataire. C’est ainsi que Greta Garbo prouva Dieu à Minou Drouet par les merveilles de sa nature.
On se demande ce qu’eût dit Minou si elle avait vu l’éléphant. Et le tatou. Et les tatusiens. Qui mangent sans dents ! Et la grande tatusie. Et le gypaète barbu. Et tous ces animaux que Dieu créa en cachette pour échapper aux réflexions des grandes personnes. L’écrevisse, le homard ; et le grand singe à fesses bleues qui traverse l’Afrique en large en se rattrapant par la queue à la cime des palétuviers ! Et l’Auvergnat ! qui est moins agile, mais plus têtu. Et la mercière de rues pluvieuses ! qui vit de la vente d’un lacet brun tous les dix ans. Et Fantômas ! … Tout est merveille de la nature. (…)
Alexandre Vialatte,
Chroniques de La Montagne,
15 janvier 1967.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, chroniques de la montagne, littérature, greta garbo, minou drouet, fantômas, humour, dieu
samedi, 14 février 2015
ÇA FAISAIT LONGTEMPS
Le temps qu’il fera cette semaine ne sera pas toujours celui qu’on attendrait. Meilleur qu’on ne pourrait le craindre, il sera souvent moins bon qu’on ne pourrait l’espérer. Le thermomètre descendra dans certaines sous-préfectures jusqu’à des chiffres qui flatteraient des villes beaucoup plus importantes, voire des capitales étrangères. Le savoir-vivre empêchera d’en tirer vanité. La calvitie étant envin vaincue, comme il appert de la lecture de la plupart des journaux du matin et du soit, les chauves auront gros intérêt à laisser repousser leurs cheveux pour éviter les sinusites ; ils s’attacheront à garder les pieds secs en utilisant des taxis, en mettant des snow-boots, ou même tout simplement, quand la distance n’est pas trop grande, en traversant la chaussée sur les mains.
Alexandre Vialatte,
Chroniques de La Montagne,
6 février 1962.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, humour
vendredi, 06 février 2015
QU'EST-CE QU'UN GRAND ROMAN ?
Nous étions en train de causer de Soumission, de Michel Houellebecq, et de l'effet déflagrant produit, en général, par les livres du monsieur, et en particulier par le dernier, dans le tout petit nombril du monde des Lettres parisiennes. Bien que j'aie une idée floue de ce qu'un « effet déflagrant » donne dans un « tout petit nombril » (merci d'admettre la licence poétique des images !).
2/2
« Qu’on pèse donc les mots, polyèdres d’idées, avec des scrupules comme des diamants à la balance de ses oreilles, sans demander pourquoi telle ou telle chose, car il n’y a qu’à regarder, et c’est écrit dessus. » Il n’y a qu’à regarder, et c’est écrit dessus. Voilà, c’est lumineux. Remarquez que c'est contraignant : il faut avoir appris à lire. C’est Alfred Jarry qui écrit ça (dans le Linteau des Minutes ...). Vrai qu'Alfred Jarry était ambitieux et qu'il « n'écrivait pas pour les paresseux » (c'est Noël Arnaud qui dit ça). Rien à ajouter.
Mais il faut croire que non, soit ça crève les yeux tellement c’est simple, soit ça demande un effort tellement c'est simple. Je me demande si ce n’est pas précisément l’effort qui rebute mesdames Angot et Devarrieux. Ajoutons Raphaëlle Leyris (Le Monde, 8 janvier), pour faire bon poids. En tout cas, j'en conclus que ces dames préfèrent le tarabiscoté.
Pour elles, cette simplicité de l'évidence qui saute aux yeux à la lecture de Soumission est éminemment suspecte, alors que c'est, tout simplement, le summum actuel de l'art romanesque. Modiano est, dans une tout autre tonalité, du même tonneau, du genre qui coule de source. Essayez donc, pour voir si c'est facile. Je vous jette mon gant : allez-y, faites aussi bien.
Je signale libéralement aux bons amateurs, aux lecteurs de Faustroll et autres pataphysiciens à qui la chose avait échappé, que le « scrupule » dont parle Jarry correspond visiblement à la définition 1 du Littré (éditions du Cap, 1968, p. 5786) : « petit poids de vingt-quatre grains (proprement, petite pierre, prise primitivement pour peser) » (noter la rafale d’allitérations en p). Ce scrupule est en fait une unité de poids : 1,272 gramme, le grain pesant 0,053 g. Vous pouvez vérifier : ça vient du latin « scrupulus : petite pierre pointue». Comme quoi, avoir la conscience légère n'est pas seulement une métaphore. Passons.
Je reviens à mon idée de machine. Il faut noter que le romancier est dans l’absolue solitude pour fabriquer chacune de ses pièces. Supposons qu’il a une image globale précise de l’ensemble. Eh bien je vais vous dire, s’il veut que « ça marche », il est obligé de se mettre tout entier dans la fabrication de chacune des pièces. Chacune contient l'écrivain tout entier.
S’il veut que ça marche, il ne peut pas se permettre de prendre parti pour l’un de ses personnages contre un autre. Il ne peut se permettre d'en juger aucun. Il n'a pas le droit d'en penser quoi que ce soit. D'abord parce que tout le monde s'en fout. Ensuite parce que l'histoire s'effondrerait avant de commencer.
Ou alors s'il juge, il faut qu'il endosse successivement la tenue du président du tribunal, puis celle des assesseurs, puis celle de chacun des jurés, puis celle du procureur, puis celle de l'avocat, puis celle des parties civiles, puis celle des témoins, puis celle des experts, puis celle du greffier, puis celle des policiers de garde, puis celle de chacun des individus composant le public qui assiste au procès, puis celle des bancs, de la barre, des colonnes et des lambris, puis celle des plantes vertes en pot, puis celle de la serpillière qu'on passera après la fermeture, puis celle de la pendule, bref : il faut qu'il fasse tout à lui tout seul. Mieux : il faut qu'il soit tout, du président jusqu'à la serpillière. Tout simplement parce qu'il doit laisser chacun de ses personnages aller jusque tout au bout de sa logique. C’est précisément ce que sait faire Michel Houellebecq. Admirablement.
Oui : il doit impérativement être chacune des pièces, à 100 %, à tour de rôle, pour qu’elle joue son rôle vivant le moment venu. Le romancier joue successivement les rôles de toutes les marionnettes dont il manipule les gestes, les membres, les silhouettes, les âmes. Le grand roman est la machine qui parvient à donner chair à ces êtres de bois, comme la fée à la fin du Pinocchio de Walt Disney, pour le bonheur de Gepetto.
Le romancier se situe au sommet de l’échelle du métier d’acteur de théâtre : son art de la métamorphose vestimentaire, faciale, vocale et gestuelle n’a pas de rival dans toute la littérature dramatique. Le génie romanesque habite celui qui a su suivre modestement, pas à pas, la logique interne de la machine qu’il a conçue et mise au point, au point d'en faire un être vivant.
Quand on a cette maîtrise, ça donne Michel Houellebecq. Et pas besoin de fée : ce qu'il écrit est à prendre pour ce que c'est : un diagnostic froid, mesuré, raisonnable, impeccablement formulé, posé sur le spectacle du monde qui est le nôtre.
Imaginez : s’il prend parti pour telle pièce plutôt que pour telle autre, le roman est foutu, puisque c'est adopter le même langage binaire et manichéen qu'un certain George W. Bush en 2003 : « Ceux qui ne sont pas avec nous, dans cette croisade pour le Bien, sont contre nous, du côté de l’Axe du Mal ». En matière de littérature romanesque, ça donne du Christine Angot : ça ne fait pas de vrais livres, mais alors qu'est-ce que ça écrit !!!!!!
Allah nous en préserve ! Nous sommes modestes. Nous, ce qu'on aime, c'est seulement la littérature.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, soumission, les particules élémentaires, alfred jarry, les minutes de sable mémorial, journal le monde, christine angot, claire devarrieux, raphaëlle leyris, faustroll, scrupule, pinocchio, gepetto, george w. bush, axe du mal
jeudi, 05 février 2015
QU'EST-CE QU'UN GRAND ROMAN ?
Je reviens sur l'animal Houellebecq et le merdier que son Soumission a semé dans le jeu de quilles auquel le petit monde parisien (éditeurs, écrivains, critiques, bref les je-te-tiens-tu-me-tiens) consacre ses loisirs aseptisés.
1/2
Que pense Michel Houellebecq de ses personnages ? Et de la situation décrite dans Soumission, surtout à la fin (ah, la dernière phrase : « Je n’aurais rien à regretter » perdue toute seule tout en haut de la dernière page ! Vous vous rappelez Balavoine : « J'veux mourir malheureux Pour ne rien regretter » ?) ?
Mais faut-il seulement, comme l’écrit Christine Angot, que le romancier « pense » quelque chose de ses personnages ? Moi, sur l'îlot perdu de mon minuscule compte en banque de données mentales, je me permets de trouver cette idée très bête. Soyons péremptoire : cette question ne peut germer que dans la cervelle d'un abruti.
Autant demander à Ingres ce qu'il pense de L'Odalisque, à Michel-Ange ce qu'il pense de Moïse ou à Mozart ce qu'il pense de Figaro. Pour une raison très simple : un roman est un système autonome. Une machine si vous voulez. Enfantin, vraiment : l'œuvre se résume-t-elle au moi de celui qui l'a créée ? Poser la question, c'est y répondre. Quand Modiano termine un roman, n'a-t-il pas l'impression que celui-ci lui est déjà devenu hostile (voir récemment) ? Bonne définition de l'altérité radicale portée par l'œuvre une fois qu'elle est achevée.
Méfiez-vous des gens qui fusionnent l'œuvre et le moi du créateur : pour eux, "même" et "autre", c'est kif-kif. Le même c'est l'autre et lycée de Versailles. Inquiétant, non, ce moi tout-puissant ? Cette négation de l'autre ? Allez dire ça à Denis Vasse (Un parmi d'autres, Seuil, 1988). Même l'enfance de l'art distingue l'artiste et le résultat de son travail. Créer des œuvres, c'est passer son temps à couper des cordons ombilicaux. C'est sans doute ce que certains ne supportent pas.
Refuser de couper le cordon (par exemple poser la question formulée au début), c'est être très bête ou très menteur. C'est en tout cas n'avoir rien compris à l'art. L'œuvre achevée, je veux dire la belle, la grande, ne garde aucune trace des états d'âme de son auteur. Sauf à la rigueur aux yeux du spécialiste. Pour une raison très simple : l'auteur ne pense qu'à l'effet qu'il faut produire pour que l'œuvre puisse être dite "accomplie". Qu'il s'y projette, ce n'est supportable que quand ça reste accessoire, voire invisible.
Regardez même les Essais de Montaigne, qui n'était pas romancier, lui, et qui précisément prétendait se peindre au naturel : l'auteur y est partout et nulle part. Essayez donc de le saisir, tiens, si vous ne me croyez pas, et commencez à mesurer les rayons de bibliothèques occupés par la littérature que des légions de commentateurs ont pondue pour tenter de dessiner les contours de la silhouette de Michel de Montaigne, l'un des deux pères fondateurs littéraires de la Renaissance.
Le romancier, s’il veut que sa machine fonctionne, est face à une tâche délicate : concevoir et dessiner chacune des pièces avec la plus grande précision, fraiser, aléser, chantourner, polir, ajuster. Ensuite, il doit les assembler, les agencer, les emboîter les unes dans les autres, selon la logique implacable et forcément mécanique de la machine que son esprit a entrevue. Résultat : le roman est bon si la machine fonctionne. Or Soumission fonctionne à la perfection (avis personnel).
Comment est-ce possible ? La réponse que me dicte l'évidence est : dans le maelstrom des romans "de facture classique" qui paraissent à jet continu, Houellebecq dépasse tout le monde. Et je me dis que c'est un peu normal que chacune de ses parutions lance un débat : ces échauffourées autour de ses livres (et même de sa personne) sont une forme d'hommage des vassaux au suzerain. La supériorité est trop évidente. Le concert de coassements qui s'ensuit en est l'aveu. Houellebecq est loin au-dessus, loin devant. Et tout le monde le sait. Et ça en fait chier un bon nombre.
« Pensez-vous quelque chose de vos personnages ? » est donc une question dénuée de sens. Angot est seulement à côté de la plaque. On s'en doutait un peu. Remarquez qu’elle n’est pas la seule : Claire Devarrieux, dans son éditorial de Libération du 3 janvier, s’inquiète, à propos de l’auteur, qu’on ne « puisse déterminer quel est le fond de sa pensée ». Mais qu’est-ce qui leur prend ? Je vais vous dire : on s'en fiche, du fond de la pensée de Michel Houellebecq. Si toutefois ce qu'on attend de lui s'appelle "Littérature".
Autant demander à Balzac ce qu'il pense du Père Goriot. A-t-on seulement idée de proférer pareille niaiserie ? Dans son chef d'œuvre, Balzac est Goriot aussi bien que Delphine de Nucingen et Anastasie de Restaud, ses filles, tout comme il est la mère Vauquer avec toute sa pension, il est Vautrin, il est Rastignac, et tutti quanti. Seul moyen, en vérité, d'animer, de donner vie et souffle à tous ses personnages. C'est ainsi, je crois, qu'il faut comprendre la célèbre phrase : « Madame Bovary, c'est moi ».
On se fiche du fond de la pensée de Flaubert. On se fiche du fond de la pensée de Balzac.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel houellebecq, littérature, littérature française, soumission, daniel balavoine, christine angot, ingres, l'odalilsque, michel-ange, moïse, mozart, les noces de figaro, patrick modiano, denis vasse, un parmi d'autres, montaigne les essais, journal libération, claire devarrieux, balzac, le père goriot
mardi, 03 février 2015
LITTLE TULIP
1
Je ne pensais pas pouvoir un jour être de nouveau secoué par un album de bandes dessinées comme je l’ai été en d’autres temps par Tintin au Tibet (de qui-vous-savez), La Ballade de la mer salée (Hugo Pratt), C’était la Guerre des tranchées (Tardi), Sarajevo Tango (Hermann) et quelques autres (le dernier en date étant Notre Mère la guerre, de Maël et Kriss). Eh bien si, secoué, je l’étais en refermant ce Little Tulip de Boucq et Charyn.

Ce bouquin est en soi un éloge du dessin en général. Et du tatouage en particulier. Je me dis que ça devrait plaire à certain. Sans s. Je lui dis bonjour.
Secoué, je l’étais déjà en refermant mon Libé quotidien en août dernier, quand la BD y paraissait en feuilleton. Je m’étais juré d’acheter l’album à parution. C’est loupé, j'ai oublié : j’ai dû me contenter du deuxième tirage. J’enragerai quand je verrai la cote grimper dans le BDM. Tant pis pour moi. De toute façon, j’ai aussi loupé le Charlie Hebdo du 7 janvier (celui avec Houellebecq en « une », 200.000 € sur eBay, il paraît, je n’ai pas vérifié, quelqu'un qui avait du pognon à claquer, il s'en foutait de savoir que Charlie Hebdo était devenu "pas très bon" - euphémisme).
Boucq, je le connaissais depuis Mormoil, dont j’avais la collection complète (7 malheureux numéros, j’avoue que j’ai un peu oublié ce qu’il y avait dedans, je me souviens juste de la couverture où Bardot, généreusement caricaturée par Mulatier, y allait de sa bulle ahurie : « Mords-moi le quoi ? »).
J’aimais bien une série de Pilote où Boucq développait les aventures d’un citadin lambda, mais en prenant strictement au pied de la lettre l’expression « jungle urbaine ». C’était tout à fait réussi, marrant, surprenant. Une ville "forêt vierge", les bus à l'avenant, un délire bien homogène, quoi, entre le foutage de gueule et l'analyse de civilisation, de celle qui prend en compte le discours publicitaire, vous savez, celui qui vous fait vivre « l'aventure au coin de la rue » (Bruckner et Finkielkraut, 1979). J’aimais avant tout la virtuosité, l'incroyable précision de son trait, qui s’apparente de près ou de loin à la « ligne claire ».
Charyn, en revanche, j'avais juste entendu son nom comme ça, en passant. Bon, j’apprends que c’est un écrivain américain prolifique. J’apprends surtout qu’il n’en est pas à son coup d’essai avec Boucq. Je me suis promis d’aller voir de plus près de quoi il retourne avec ce bonhomme dont l’âge approche de la huitième dizaine et qui vous percute le sternum avec une histoire dessinée à la pointe affûtée d’un poignard. Je veux en savoir plus sur tout ce qu’a pu produire ce tandem depuis 1986. Et que j’ai soigneusement loupé. J’aime ce genre de surprises, celles qui vous disent qu’il vous reste des merveilles à découvrir. En même temps que ça vous laisse l'impression amère d'être passé à côté de quelque chose de géant au moment où ça se passait.
Car Little Tulip est une merveille à couper le souffle. Un bijou de BD. Et d’une prémonition proprement hallucinante, au vu des événements de Paris en janvier, comme le montre la vignette ci-dessous.

Simple curiosité : j'aimerais savoir qui est la personne dont Boucq a tiré ici le portrait.
Je ne vais pas résumer l’histoire, juste situer le cadre du récit. Paul/Pavel est « portraitiste-robot » pour la police new-yorkaise. Il assiste à l’entretien entre un inspecteur et un témoin et dessine ce qu’il « voit » quand il entend la description d’un délinquant ou d’un criminel. Ses portraits sont d’une ressemblance qui stupéfie les témoins. La police aimerait surtout mettre fin à la série de viols-meurtres dont se rend coupable un certain « Bad Santa », qui signe ses forfaits d’un bonnet de Père Noël, et compte pour cela sur l’étrange pouvoir graphique de Paul/Pavel. La suite de l'histoire montrera le problème sur lequel, cette fois, il bute pour « voir ».
C’est qu’il ne vient pas de n’importe où, Pavel/Paul. Il a sept ans et le génie du dessin. La petite famille américaine a émigré à Moscou avant la 2ème guerre mondiale. Elle vit petitement. Le père, un artiste, rêvait de cinéma et voulait travailler avec Eisenstein. Ce qu'il a fait.

"C'est l'esprit qui crée les formes" : ma parole, Jérôme Charyn a lu Bergson, l' "élan vital" qui se fraie un chemin dans la matière pour aboutir à la forme qui lui est propre, tout ça.
Paul/Pavel, 6 ans, très doué, est son meilleur élève. En 1947, les parents sont accusés d’espionnage et la famille est envoyée à la Kolyma, dont le nom générique est "Goulag". C’est des allers-retours entre l'effrayant camp de Magadan et New York, entre le passé et le présent, qu’est composé le récit.
On apprendra que le père est mort, que la mère appartient au « harem » du « Comte », un « pakhan » puissant. Les « pakhanys » sont de redoutables bandits, auxquels les autorités staliniennes laissent le soin de faire régner l’ordre dans le camp. Tout marche bien tant que tout le monde respecte les règles.
Faut-il dès lors se dire que l’ordre, qu'il soit terroriste ou démocratique, vaut mieux que le désordre ? Je n'en sais rien. Mais à observer quelques situations présentes, dans diverses contrées riantes de notre belle planète, on pourrait conclure que ce ne serait en aucun cas fortuit.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, boucq charyn, little tulip, france, staline, la kolyma, new york, tintin au tibeet, hergé, la ballade de la mer salée, hugo pratt, notre mère la guerre, maël et kriss, c'était la guerre des tranchées, tardi, sarajevo tango, hermann, journal libération, charlie hebdo, houellebecq, boucq, mormoil, pilote, bruckner et finkielkraut, au coin de la rue l'aventure, bd ligne claire, bd
dimanche, 01 février 2015
L'ISLAM N'AIME PAS LA FRANCE (3)
3
« L’enfant arabe, en dehors de l’école, lit six minutes pas an ». Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Yahya Alabdallah, un cinéaste jordanien. Evaluation confirmée par des statistiques de l’Unesco et de la Ligue arabe : 6 minutes pour l’écolier arabe, 12.000 minutes pour l’écolier européen. Même si ces chiffres indiquent des moyennes statistiques, inutile de les commenter : ils parlent d’eux-mêmes.
Si l’Unesco, en 2009, évalue à 40 % des Arabes de plus de 15 ans la population analphabète, Abderrahim Youssi, professeur à l’université Mohamed-V de Rabat, affirme que « la moitié de la population arabe est analphabète ». Les femmes sont particulièrement touchées, comme de bien entendu.
Le problème des Arabes avec leur langue, c’est qu’elle est double : on écrit la classique, on parle la populaire. Résultat, dit Mohamed Charfi, ancien ministre de l’éducation en Tunisie : « Je ne crois pas qu’un peuple puisse pendant très longtemps écrire une langue qu’on ne parle pas et parler une langue qu’on n’écrit pas ». On serait inquiet à moins.
Le problème s’aggrave du fait du poids croissant du religieux qui, en accroissant le poids de la langue classique, aboutit selon Abderrahim Youssi, à mutiler et endoctriner scientifiques, poètes et écrivains potentiels : « … l’enseignement scolaire est imprégné de religion ». Mohamed Metalsi (directeur des actions culturelles à l’Institut du Monde Arabe) juge ça préoccupant : « Pour les petits, l’éducation est fortement religieuse. Pour les grands, l’enseignement colle aux textes musulmans. Exit la Grèce ou les Lumières ». Si cela n'annonce pas un divorce de plus en plus flagrant avec le continent européen, c'est que je ne sais plus ce que les mots signifient.
Mohamed Charfi, qui « voulait un divorce entre la langue et le Coran », voit se développer le processus contraire. Chaque œuvre est réalisée sous l’œil du Prophète (voir plus bas). Certes, ce mouvement est bien favorisé par « la dictature, la pauvreté, la corruption, la guerre ». C’en est au point que, pour maintenir la culture au point le plus mort possible, les pouvoirs arabes s’entendent pour fliquer la création. Pas d’autre « politique culturelle » que la répression de l’imagination libre. Pour le développement culturel de la population, on repassera. Circulez, y a rien à voir.
Et puis tenez-vous bien : « … moins de livres ont été publiés en un an dans l’ensemble des pays arabes (380 millions d’habitants) qu’en Espagne (47 millions) ». Ben oui, évidemment, quand tout le monde connaît par cœur le seul livre en vente, plus personne n’a besoin de l’acheter. Je vous fais un dessin ? « Timeo hominem unius libri ». C’est Thomas d’Aquin qui écrit ça. Moi, je le traduis librement : maudit soit l’homme qui n’a lu qu’un seul livre.
Les livres religieux dans le monde, c’est 5 % de la production mondiale. Dans les pays arabes, c’est 17 %. Etonnez-vous, Français. Sans compter que le livre islamique est « parfois donné gratuitement au lieu d’être vendu ».
Un rapport des Nations Unies (2003) affirme que « le monde arabe n’aurait traduit que 10.000 livres en mille ans, soit ce que l’Espagne traduit en une année ». Certains contestent, mais Mohamed Metalsi confirme la tendance : les Arabes traduisent très peu de livres occidentaux. Et souvent de façon médiocre.
D’où une grave perte de prestige des universités arabes : ce sera le cas tant que les sciences humaines seront en soi un problème pour l’ordre établi. Le problème ? Réfléchir sur la société. C’est bête, au lieu d'acheter nos clubs de football, le Qatar et Dubaï pourraient bien nous acheter des équipes de sociologues : nous en avons à revendre, qui tuent le temps à en mouliner, de la réflexion sur la société. C'est dire si le verrouillage du couvercle sur la lessiveuse est une urgence permanente dans les pays arabes. Qu'arrivera-t-il quand ça pétera ?
Moulin El Aroussi est même plus tranchant : « Il y a de moins en moins de chercheurs sérieux qui savent faire la différence entre la foi et la science ». Par-dessus le marché ? « Centaines de brimades, censures, actes de vandalisme, emprisonnements que subissent les créateurs … dans tous les pays ». Nul doute : la liberté est encore très loin de mettre flamberge au vent dans les pays arabes, la Tunisie faisant figure d’exception miraculeuse.
L’écrivain Zafer Senocak conclut : « Les terroristes recrutent dans une communauté de plus en plus nombreuse, formée de masses musulmanes incultes ». Le seul drapeau : ISLAM. Rien derrière. C’est une marque commerciale. La différence avec les grandes marques occidentales ? Simple : personne ne se ceinturerait d’explosifs pour aller déchiqueter des gens qui se sont montrés « infidèles » aux dogmes dictés par Mac Do ou Apple.

Tous les éléments ci-dessus sont empruntés directement à l’excellente chronique écrite par Michel Guerrin dans Le Monde daté 24 janvier 2015. Vous avez relevé la consonance des noms des personnes citées par le chroniqueur : on ne saurait les suspecter de racisme. La plume sobre de l'auteur accroît l'effet du contenu, qui se suffit à lui-même. Les fioritures ont été ajoutées par votre serviteur.
Moralité et conclusion : l’islam arabe prend une tournure fort inquiétante. Si l'islam est un problème en France, c'est d'abord parce qu'il y a un problème à l'intérieur même de l'islam, vous ne croyez pas ? Laissons de côté l’islam dans ses variantes afghanes, pakistanaises, indiennes, indonésiennes, qui nous concerne de beaucoup plus loin. Inquiétons-nous en revanche de la façon dont évoluent les sociétés arabes, auxquelles la France a le plus à faire.
C’est le processus en cours qui est menaçant pour le peu de laïc qui subsiste encore dans les pays arabes. J'imagine volontiers que les smartphones et autres Apple-toys sont obligés de se convertir à l'islam avant d'y entrer.
Si ce que disent les Arabes cités dans l'article est vrai, alors ces sociétés prennent, jusque dans leurs profondeurs, une direction très peu sympathique. Et comme ce qui est arabe concerne une partie non négligeable de la population française (de souche ou non), il faudrait au moins se poser la question : qu'en sera-t-il demain ?
L’inquiétant, c’est que l’arabe classique de la lettre du Coran, je veux dire le plus étriqué de cette religion, s’infiltre partout dans la société et dans les esprits, contaminant jusqu'à la pratique des scientifiques. Si j’en crois l’article de Michel Guerrin, le nœud coulant de la lecture la plus bête, la plus racornie du Coran est en train de modeler, de modéliser, de formater des populations de plus en plus nombreuses, de plus en plus incultes et de plus en plus promptes à s'enflammer.
Tout se passe comme si l'islam arabe avait, planté dans le bras, un goutte-à-goutte de fanatisme, et que l'intégrisme religieux se diffusait ainsi dans tout le corps, contaminant chacune des cellules. S'il en est ainsi, cela veut dire que les pays arabes vont, sur les plans intellectuel et culturel, vers un sous-développement solidement constitué. En avant toute vers le moyen âge ! L'obscurité ! La violence !
Hayat Boumediene (qui est allée accoucher de son futur djihadiste en Syrie) reprochait à son époux, un certain Amédy Coulibally de ne rien connaître à la religion (Libération du 29 janvier, je crois). Combien sont-ils, sur le sol français, les gars du même vide culturel et de la même rancœur qu’Amédy Coulibally ?
C’est sans doute ce genre de réalité future que toutes les Christine Angot du marigot littéraire français en veulent à mort à Michel Houellebecq de faire plus que pressentir dans son formidable Soumission. A se demander si ce n'était pas Christine Angot qui était à la tête des glorieuses armées françaises en ce magnifique et mémorable mois de juin 1940.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yahya alabdalah, unesco, ligue arabe, abderrahim youssi, arabes, université mohamed-v rabat, mohamed charfi, tunisie, mohamed metalsi, institut du monde arabe, prophète mahomet, thomas d'aquin, timeo hominem unius libri, nations unies, moulin el aroussi, zafer senocak, mad donald, apple, michel guerrin, journal le monde, hayat boumediene, amédy coulibally, journal libération, christine angot, michel houellebecq, soumission, littérature
jeudi, 29 janvier 2015
CHRISTINE ANGOT A LA HAINE 5 (fin)
5
Je me serais arrêté au billet précédent pour dire tout le mal que je pense de ce qu'écrit Christine Angot, si la dame, en plus de la niaiserie épaisse de sa façon de voir le monde, les rapports humains et la littérature, n'avait pas montré, dans Le Monde du 16 janvier, le bout odieux de sa haine pour Houellebecq. Et plus généralement pour la littérature.
Je commence par l'insinuation venimeuse. Ce sont deux affirmations qui se suivent à quelque distance : « Le but, à travers la littérature, n'est pas de nier l'humain ni de l'humilier » ; « Les attentats des 7, 8, 9 janvier sont une autre façon de dénier l'humanité à des gens ». Quand on rapproche ces deux évidences éclatantes, l'odieux de la chose saute aux yeux. Christine Angot, pour insinuer cela, a au moins de la boue entre les deux oreilles. Comme si Michel Houellebecq déniait l'humanité des gens, comme elle le badigeonne à la truelle dans le développement qui va de l'une à l'autre.
Grave erreur, ma pauvre dame, qui montre bien que vous ignorez ce qu'est la littérature : Houellebecq observe seulement la dénégation d'humanité que le monde actuel fait subir à l'humanité. On pourrait même interpréter Soumission comme une dénonciation de ce processus inexorable.
Mais non contente d’exhiber la confusion notionnelle dans laquelle baignent ses « idées » pâteuses, en même temps qu’elle psalmodie la rengaine de ses incantations autour le « l’humain », qu’elle feint de sacraliser, elle opère un rapprochement que je qualifierai tout simplement de dégueulasse. Désolé, je ne trouve pas d’autre mot.
Voici la vomissure : « La société a des pulsions mortifères qui l’ont conduite à porter aux nues Marine Le Pen, Zemmour et Houellebecq, dans une suite logique, MLP, l’action, Z, le raisonnement, H, la rêverie, ça ne nous oblige pas à faire le même choix » (je cite strictement comme c’est publié). Ah, ils me font bien hennir, tous ces responsables qui appellent à ne pas faire des « amalgames ».
Qu’ils empêchent donc Christine Angot de commencer : elle s’y connaît, en amalgames. Houellebecq et Le Pen même combat ? Oui, elle s'y connaît aussi en « stigmatisation ». J'appellerai ça une saloperie. Quels autres crabes dans son panier ?
Notez l'enchaînement logique redoutable : 1 - La littérature doit célébrer l'humain ; 2 - Or Le Pen-Zemmour-Houellebecq sont dans le même bateau ; 3 - Donc Houellebecq est du côté des attentats islamistes. Tout ça pour que le lecteur déduise de lui-même : Houellebecq est un salaud. Mon dieu qu'elle est belle, l'âme de Christine Angot !
Une femme politique (MLP) qui fait miroiter des illusions d’espoir et de solutions aux yeux de millions de gens pris dans la nasse pour accroître la part de son gâteau électoral ; un histrion batteur d’estrade (EZ) qui s’est fait une spécialité lucrative, en compagnie de deux ou trois autres, de contester le système (je l’ai entendu intervenir dans les médias. Conclusion : pas sérieux, monsieur Zemmour !).
Comme mariage d’une carpe et d’un lapin, je trouve que c’est déjà pas mal. Leur point commun ? Ah si, ils en ont un : vendre du bla-bla à une clientèle qui ne demande que ça. Le Pen et Zemmour, non merci, ce n’est pas ma tasse de thé. Je n’ai rien à voir avec ces marchands de camelote (ceci dit au risque de chagriner Solko : qu’est-ce qu’il croit ?).
Leur relatif succès tient sans doute d’abord au fait qu’ils ne sont pas au pouvoir (et je n’ai aucune envie de les y voir). Et puis aussi, qu’ils tiennent un discours qui, apparaissant en rupture avec la langue de bois dominante, semble entrer en résonance avec les préoccupations profondes de la population. Fumées. Grave erreur. Le vraisemblable n’est pas le vrai. Le simulacre n'est pas la chose. Le mirage n'est pas l'oasis.
Par là-dessus, fourrez dans ce sac de nœuds de vipères le seul véritable écrivain français vivant qui soit connu à l’étranger (le monde a découvert Modiano avec le Nobel). Pour des raisons qu’il serait fastidieux d’examiner, mais enfin, elles doivent être un tout petit peu fondées. Les Allemands se l’arrachent et pondent des thèses sur son œuvre. Est-ce le moment d’entonner le refrain d’Obélix : « Ils sont fous, ces Germains ! » ? Serait-ce bien sérieux ? Disons-le : Michel Houellebecq est le seul écrivain français actuel que les étrangers lisent un peu. Je dis : tant mieux !
Parce qu’il faut bien dire qu’en France, c’est l’étouffoir. Non non, ce n’est pas la voix de Houellebecq qu’on étouffe. C’est sûr que beaucoup de gens voudraient bien. Mais il faudrait pouvoir. Rien qu’à voir le classement des ventes de livres paru dans Libé le 15 janvier, ce n’est pas parti pour. Tant mieux. Et je ne parle pas du succès du livre d’Eric Zemmour. Que je n’ai pas lu. Et que je ne lirai pas. Je me dis que ce simple fait devrait au moins inspirer un peu de modestie aux commentateurs, surtout malintentionnés.
Non, l’étouffoir dont je parle est celui que toutes sortes de groupes de pression font peser sur l’expression libre. Je veux parler de l’étouffoir policier ou judiciaire qui menace tous ceux qui n’entrent pas dans le moule idéologique dominant. Combien sont-ils, les chiens de garde, à surveiller, chacun dans son pré carré, que nul orteil ennemi ne s’avise de fouler une motte de son herbe minoritaire ?
Combien sont-ils, les glapisseurs, à attaquer le moindre mot qui dépasse et à en faire un délit ? « Punissons, ça nous permettra de ne pas traiter les problèmes et de garder la tête dans le sable ! ». Combien sont-ils, juifs, féministes, homosexuels, noirs, musulmans à avoir ainsi obtenu le rétablissement de la censure ? A avoir tué la liberté d'expression dont tout le monde se fait un drapeau aujourd'hui ? Les petits calculs salement électoraux des responsables politiques font le reste. Ils préfèrent laisser la société se gangrener de toutes sortes de haines mutuelles qui s'entre-nourrissent.
Ah, ils peuvent bien citer la phrase rebattue de Voltaire (« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, etc … »). Ah, ils peuvent bien défiler derrière la banderole « Je suis Charlie », tous les alligators, au nom de la « liberté d’expression ». Qu’elle était belle, la France, du temps de la liberté d’expression. Aujourd’hui, certains mots sont inscrits au Code Pénal. Cette seule idée que des paroles verbales soient inscrites au nombre des délits passibles de la correctionnelle est juste répugnante.
Cette France n'est pas la mienne. Ma France à moi ne connaît pas la diabolisation des opinions. Ma France à moi n'aime pas les Fouquier-Tinville, même de sexe féminin (Caroline Fourest, Christine Angot, Annie Ernaux, ...). Non plus que les curés façon Edwy Plenel (récitation pieuse du bréviaire le jeudi matin).
Ma France à moi laisse Dieudonné faire le pitre, Eric Zemmour et Alain Soral expliquer (à leur façon) le dessous des cartes à des ignorants, les Le Pen insulter l'histoire, Richard Millet planter ses banderilles provocatrices. Ma France à moi est assez forte pour supporter tous les propos, y compris ceux des malades mentaux et des fronts bas, à quelque obédience qu'ils appartiennent.
Ma France à moi, celle des Lumières, ne s'arroge pas le droit de faire taire. Si la loi pénale condamne des propos (hors diffamation ou injure), c'est la loi qui a tort.
Je ne confondrai jamais les paroles et les actes.
Pas de limite au droit de dire ce qu’on veut. Pas de limite au droit de se moquer. Pas de limite aux droits de la littérature.
Pas de limite aux mots.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, christine angot, michel houellebecq, journal le monde, soumission, marine le pen, front national, éric zemmour, solko, patrick modiano, journal libération, charlie hebdo, caroline fourest, annie ernaux, edwy plenel, dieudonné, alain soral, richard millet, france, société
mardi, 27 janvier 2015
CHRISTINE ANGOT A LA HAINE 3/?
3
Que dit-elle, la pauvre Christine Angot, de Michel Houellebecq ? Dès le début de son papier, on comprend que c’est très mal emmanché : « Quand on m’a proposé, fin décembre, d’écrire sur Houellebecq, je n’ai pas voulu. Je n’avais pas envie de m’intéresser à lui, il ne s’intéresse pas au réel, qui est caché, invisible, enfoui, mais à la réalité visible, qu’il interprète, en fonction de sa mélancolie et en faisant appel à nos pulsions morbides, et ça je n’aime pas ». Le « réel caché », apparemment, c’est le grand truc de l’existence de Christine Angot. Mais ça commence quand même par une énormité : apprendre que Houellebecq ne s'intéresse pas au réel, ça fait quand même un choc culturel.
Moi, ce que je n'ai pas compris, c’est ce qu’Angot met derrière le mot « réalité » : selon elle, est réel ce qui « est caché, invisible, enfoui ». Ah bon. Dès que je le vois, j'en parle à mon cheval. Notez que je ne dis pas que c’est faux. C’est une option. Mais ce qui suit est aussi un symptôme intéressant. J'en suis même à me demander si tout ce qu'écrit Christine Angot n'est pas à considérer, en soi et en bloc, comme un énorme symptôme. Non monsieur, je n'ai pas dit "furoncle".
En gros, elle reproche à Houellebecq de braquer son regard sur le monde qu’il a sous les yeux, mais avec de telles lunettes mélancoliques et morbides que l’image qu’il en restitue dans ses livres est fausse et haïssable. Ah bon. Je crois bien que c’est là que nos routes se séparent, madame. Je crois justement que Houellebecq figure parmi les auteurs qui ne font pas les autruches face aux menaces que le monde tel qu'il s'annonce fait peser sur l'avenir de l'humanité. Lui au moins, il propose un regard sur ce monde. Il ne se contente pas de manier sa touillette dans sa tasse en plastique devant la machine à café. Et le monde dont il parle est tout à fait « réel ».
Parce que, si j’ai bien compris Christine Angot (et je crois que j’ai bien compris), il ne faut pas se contenter de la réalité visible, il faut creuser cette matière dans l’espoir d’atteindre l’essence des choses. Enfin, ce ne sont pas ses termes : « Ce qu’il y a derrière la réalité visible, c’est le réel. Et le réel c’est nous. Mais c’est le nous qu’on ne voit pas ». Oui, j’ai peut-être mal traduit. Si je dis « l’essence des êtres », ça vous va ? Remarquez que ça ne change pas grand-chose : je ne sais toujours pas ce que c'est. Trop vaporeux pour moi. Nébuleux si vous préférez. Vous dites gazeux ? Pourquoi pas ?
Pour Angot, la littérature est le territoire sur lequel règne le tout-subjectif. Je l’ai dit, c’est une option, bien dans le vent de cette époque de narcissisme exacerbé (ah, la rage du « selfie » ! Même que Miss Israël a failli déclencher un incident diplomatique en faisant un « selfie » où figurait Miss Palestine). Christopher Lasch, au secours !
Et l’invisible, elle s’y accroche comme un morpion au poil de cul. Pour être franc, l'invisible selon Christine Angot, je n'ai pas réussi à en attraper le fil. L'invisible, je le pressens au contraire dans la fin des Particules élémentaires, dans la fin de La Carte et le territoire. Houellebecq sait, lui, ce que c'est que l'invisible. Contrairement à ce qu'elle affirme, Christine Angot ne connaît de la réalité que la plus extérieure pelure de la surface des choses. Elle n'a rien compris au monde dans lequel elle vit. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Le réel dont elle s'occupe est étriqué, plat.
Selon elle, il faut que le grand écrivain (grade académique auquel elle postule visiblement, mais ce n'est pas gagné) persévère, continue à faire descendre le seau dans le puits à sec. Et pour en remonter devinez quoi : « Le sentiment que l’être a de son humanité ». Démerdez-vous avec ça. Il faut que le grand écrivain poursuive obstinément sa quête.
Forcément, tôt ou tard, il tombera sur « un mini-indice qui n’était pas visible. Et ça Houellebecq ne le fait jamais. Non seulement il ne le fait jamais, mais il le détruit, il le raille. Il raille Mai 68, l’humanisme, l’antiracisme, la psychanalyse, les universitaires, ceux qui essayent de trouver quelque chose de la réalité, ceux qui se disent que l’humain ça doit exister, et pas besoin d’avoir recours à Dieu pour ça ». On commence à comprendre l'idéologie sous-jacente, bien qu'elle prenne soin de s'affubler d'un faux-nez. J’avoue que le « mini-indice » me semble une trouvaille délicieuse. Des esprits malveillants insinueraient sûrement que Christine Angot s’embête à « chercher la petite bête ».
Au fond, ce que Christine Angot reproche à Houellebecq, c’est de ne pas faire dans ses livres l’éloge de la bien-pensance telle qu’elle règne aujourd’hui sur les esprits. C’est de ne pas donner dans la littérature sans bec et sans griffes. De ne pas se résigner à donner dans la littérature embryonnaire, celle qui se contente d'inventorier les éléments de l'embryon. Elle lui reproche d'ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il va, de plus en plus terrible.
Elle lui en veut beaucoup, parce qu’il refuse de pratiquer cette littérature nombrilique qui ne risque pas d’écailler le verni du monde tel qu’il va, tel qu’il est en train d’écraser l’humanité. Houellebecq ne creuse pas dans l’impalpable fumeux de ses impressions évanescentes pour en tirer quelque « mini-indice » jusque-là indiscernable.
Il ne cherche pas la petite bête, lui. Il regarde le monde d'une façon pas gaie, c'est sûr. Le monde qu'il décrit est sans âme, sans but. Angot aura beau dire : il fait son métier. Un grand métier. Elle ne fait pas le même. L'un fait de la littérature. L'autre fait de la fumée avec le symptôme dont elle constitue un exemplaire exemplaire.
Elle ne peut pas lui pardonner d'être dans le vrai.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, christine angot, michel houellebecq, journal le monde, christopher lasch, les particules élémentaires, la carte et le territoire
lundi, 26 janvier 2015
CHRISTINE ANGOT A LA HAINE 2/?
2
Oui, je n’aurais rien dit, mais voilà, celle qui n’a aucune parenté avec la seule Madame Angot qui vaille à mes yeux (ou plutôt à mes oreilles : c'est la fille de la dame, selon Charles Lecoq), n’est pas seulement « écrivain » : elle est aussi, avec une apparente satisfaction, un personnage médiatique important. Elle consent à se laisser présenter à l’occasion micros et caméras quand des journalistes en mal de papier font appel à elle pour remplir leurs obligations, croient-ils, professionnelles.

Sous la direction de Jésus Etcheverry.
Et puis là, elle se laisse offrir, avec répugnance (qu'elle prétend, mais elle ne répugne pas longtemps), une page entière du Monde (daté 16 janvier). Quatre colonnes larges et bien tassées. Si la dame n’est pas une autorité, au moins est-on sûr qu’elle « a de la surface ». Et des relations bien placées.
Au moins est-on sûr qu'elle est du bon côté de l'establishment, tous gens garnis de bonne conscience, sûrs de leur bon droit, édictant au nom de l'Empire du Bien (cf. Philippe Muray) ce qu'il est loisible, voire licite de faire, et ce qui doit être conduit devant les tribunaux populaires.
Toute un grande page du Monde, donc. Et pour parler de quoi ? De qui ? De Houellebecq ! Farpaitement. Angot qui se mêle de critique littéraire ! On aura tout vu ! Il est vrai que certains enfants croient mordicus que c'est à eux d'apprendre à leur mère à faire des enfants ! Au point où on en est !...
Notez que si je l’ai traitée de « pauvre pomme tombée d’un poirier », c’est qu’elle l’a bien cherché. Pensez, sous le gros pavé du titre (« C’est pas le moment de chroniquer Houellebecq », mais dans le texte, elle met la négation, c’est bien un coup du Monde, ça), elle n’y va pas par quatre chemins : Houellebecq, elle n’aime pas. C'est son droit. Ensuite, ça dépend de la façon dont on s'y prend pour le dire.
Moi, Houellebecq, je ne le connais pas. Ce que je connais, ce sont ses romans. Et ce que je sais, c'est que ces romans sont les meilleurs que j'aie lus, tous auteurs français confondus, depuis fort longtemps, quoi qu'en disent des gens que j'ai appréciés par ailleurs. Par exemple Eric Naulleau, qui traite Houellebecq de « romancier de gare » en 2005 (Au Secours, Houellebecq revient !, Chiflet et Cie). Je ne sais pas s'il est revenu entre-temps sur cette erreur manifeste de jugement.
Naulleau s'est racheté en 2008 en assaisonnant Christine Angot, façon pimentée, qu'il habillait pour les hivers les plus rigoureux, dans un livre très drôle et très juste : Le Jourde et Naulleau, Mango. Ma doué, quelle avoinée il lui mettait ! Comme quoi les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis, mais j'ai de l'affection pour certains. D'autant plus que je note que Houellebecq ne figure pas dans le jeu de massacre auquel se livrent les deux compères dans leur bouquin. S'il n'y a pas amende honorable, on n'est pas loin. Et ça rassure.
Exemple de prose sur laquelle Naulleau dirigeait ses boulets rouges, pour montrer de quoi la dame est capable : « Vous avez beaucoup approuvé la construction de L'Inceste, qu'elle était remarquable. C'était complètement un hasard, c'était un moteur en marche, ça suffit vos appréciations, stylistiques, narrotologiques [sic], techniques. Construit, construit veut dire enfermé, enfermé veut dire emprisonné, emprisonné veut dire puni, puni veut dire bêtise, bêtise veut dire faute, faute, erreur, erreur, faute de goût ou morale très grave, moi je n'ai rien fait de mal donc il n'y a aucune raison que je me construise une raison et une construction. Compris cette fois, Quitter la ville, pas de construction » (Quitter la ville, p.79, cité p. 29 du livre de Jourde et Naulleau). Angot, c'est bête, à chaque nouveau bouquin, j'entrouvre, je feuillette, ça confirme, je repose. Vous comprenez maintenant pourquoi.
Je passe sur l'état larvaire de la langue et sur l'infantilisme qui conclut le tout à fait étrange enchaînement associatif (« Mais j'ai rien fait, m'sieur ! »). Je note juste que l'auteur propose le magma et le chaos de la pensée (si on peut appeler ça pensée) comme principe de création littéraire. C'est pourquoi le relatif succès de ses livres comporte quelque chose d'inquiétant quant à l'état intellectuel de la partie de la population qui les achète.
Aux yeux des autres (ceux qui ne lisent pas ça), j'espère que ce bref aperçu sur la panade que constitue la prose de la dame rend superflu une analyse en détail. Chacun peut percevoir l'état pathétique de ce que des esprits aveuglés, stipendiés ou pervers n'hésitent pas à appeler une entreprise littéraire innovante. Tout juste bonne, l'entreprise littéraire innovante, à finir dans une poubelle du musée de l'Art Brut (vous savez, cette PME spécialisée dans le recyclage des déchets de l'Art).
Houellebecq, Angot ne l'aime pas. On commence à comprendre pourquoi. Elle le dit, et ça m'a tout l'air d'être viscéral. Alors là, je dis non : « Touche pas à mon Houellebecq ! ». Remarque, je dis ça pour pasticher, parce qu'il se défend très bien tout seul, celui qui vient de perdre son ami Bernard Maris. Bel élan d’humanité, belle élégance du geste, soit dit en passant, de la dénommée Christine Angot en direction de l’équipe de Charlie Hebdo, que de s'en prendre à un livre que le dit Bernard Maris venait d'encenser dans l'hebdomadaire, dans son tout dernier article.
Quoi, toute une belle page du « journal de référence » ! Et pour dégoiser quel genre de gandoises, s’il vous plaît ? Remarquez qu’on pouvait s’y attendre : la démonstration lumineuse que Christine Angot n’a rien compris. Houellebecq, elle n’y entrave que pouic. Rien de rien. J’ajoute que par-dessus le marché, elle n’a sans doute aucune idée de ce qu'est la chose littéraire. Bon, elle n’est pas la seule à sortir des sottises au sujet de « l’écrivain controversé ». Dans le genre gognandises savantes, j’ai entendu de belles pommes tomber aussi de la bouche poirière d’un certain Eric Fassin. J’en ai parlé.
Et puis Houellebecq n’est pas le seul à subir les foudres féminines. Il n’y a pas si longtemps (2012), l’excellent Richard Millet s’est fait dégommer par la très oubliable Annie Ernaux qui, dans une tribune parue dans Le Monde (tiens tiens !), traitait l’auteur de « fasciste ». Rien de moins. Il faut dire que le cousin n’y allait pas de main morte : faire l’éloge "littéraire" d’Anders Breivik, auteur d’une tuerie en Norvège, était pour le moins une prise de risque.
Certaines femmes n’aiment vraiment pas les mots de certains hommes ! Elles sont les modernes Fouquier-Tinville. C'est sûrement un hasard : Millet, Houellebecq, Philippe Muray en son temps, vous ne trouvez pas que ça commence à dessiner un profil ? Comme si des rôles étaient en train de se distribuer. D'un côté, tous ceux (en l'occurrence toutes celles) qui lancent des fatwas. De l'autre, ... c'est facile à deviner. Gare la suite !
C’est dans un jardin public de Tarbes que Jean Paulhan trouva l’idée d’un de ses titres (Les Fleurs de Tarbes), parce qu’il avait lu cette inscription à l’entrée : « Il est interdit d’entrer dans le jardin avec des fleurs à la main » (si je me souviens bien). Le sous-titre était plus explicite : « La Terreur dans les Lettres ». La Terreur, il n'y a pas seulement celle de fanatiques qui répandent le sang pour la gloire d’Allah (ou d'Akbar, je n’ai pas bien compris de qui il s’agit, peut-être deux frangins ?), il y a aussi celle de fanatiques socio-culturels, bien décidés à imposer dans les esprits leur propre conception de l'art, de la littérature et de la vie en société. A faire régner leur ordre.
Après la Terreur de la vérité maoïste imposée en son temps par Tel Quel et Philippe Sollers (dont Simon Leys a fait amplement et durablement les frais), la Terreur des impératifs moraux selon les Papesses Jeanne des Lettres françaises actuelles, Annie Ernaux et Christine Angot. Les temps changent, la Terreur reste.
Nous sommes pris entre celle que font régner les modernes Fouquier-Tinville et celle que lancent des imams (quand ce ne sont pas des ayatollahs). Sale temps pour la culture et la vie de l'esprit. Il y aura toujours des braves gens pour tirer la chevillette pour faire choir la bobinette de la guillotine morale sur le cou des créateurs de littérature. Virtuel, le cou, heureusement. Tant que ce ne sont pas des balles islamistes qui le coupent ...
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, christine angot, michel houellebecq, soumission, la fille de madame angot, charles lecoq, journal le monde, l'empire du bien, philippe muray, éric naulleau, au secours houellebecq revient, pierre jourde, le jourde et naulleau, musée de l'art brut, charlie hebdo, bernard maris, oncle bernard, éric fassin, richard millet, anders behring breivik, annie ernaux, fouquier-tinville, jean paulhan, les fleurs de tarbes, la terreur, tel quel, philippe sollers
dimanche, 25 janvier 2015
CHRISTINE ANGOT A LA HAINE 1/?
Quelqu’un qui se fait appeler Scarlett a laissé un commentaire ici même il y a quelques jours. Pour résumer, elle me traitait de « patate ». Je me suis dit aussitôt que le mot n’était guère aimable à l’égard du tubercule (famille des solanacées, à laquelle appartiennent, entre autres, le tabac, le datura et l’aubergine) : je suis bien moins appétissant dans l’assiette. Je réussis cependant assez bien le gratin « dauphinois » (les guillemets à cause du gruyère, il paraît que c’est hétérodoxe).
La moutarde est montée au nez de la charmante personne en lisant les propos dont je gratifiais une de ses idoles, en la personne de Christine Angot. Pas même la personne : le personnage qui se présente comme écrivain. J’admets que les mots pouvaient être interprétés de façon désobligeante. Je comparais en effet cet « écrivain » à un fruit qui se serait trompé d’arbre. Tout ça pour dire que la littérature sortie de la plume de la dame n’est pas précisément « ma tasse de thé ». Et après tout, la liberté d’opinion n’est pas un vain mot. J’espère.
 Je suis d’ailleurs effaré de l’écho rencontré par les livres de la dame : faut-il que la magistrale analyse proposée par Christopher Lasch ait été prémonitoire. Pensez que son génial La Culture du narcissisme (Climats, 2000, préface de Jean-Claude Michéa) a été publié en 1979 aux Etats-Unis. A croire que Lasch avait anticipé dès cette époque la mise en devanture des livres de madame Christine Angot.
Je suis d’ailleurs effaré de l’écho rencontré par les livres de la dame : faut-il que la magistrale analyse proposée par Christopher Lasch ait été prémonitoire. Pensez que son génial La Culture du narcissisme (Climats, 2000, préface de Jean-Claude Michéa) a été publié en 1979 aux Etats-Unis. A croire que Lasch avait anticipé dès cette époque la mise en devanture des livres de madame Christine Angot.
Il a même intitulé le premier chapitre de son livre « L’invasion de la société par le moi ». Ce titre, ça fait un peu "pan dans la gueule" : la peste soit du moi, en vérité, si c'est pour tomber dans la bouillasse et la platitude la plus triviale. En gros et pour aller vite, il pensait que cette invasion n’était pas de très bon augure (c'est le moins qu'on puisse dire) pour un diagnostic sur l’état moral, culturel et psychologique futur de la civilisation en général et en particulier de nos sociétés américanisées.
En France, il se passe en littérature contemporaine ce qui s'est passé ailleurs : en musique, décrétons que tous les sons possibles et imaginables, bruits compris, sont musicaux. En arts plastiques, décrétons que tout le réel est artistique. En littérature, Angot illustre à merveille la tendance : décrétons que tout le déroulement de la vie quotidienne d'un individu lambda (raconté, s'il vous plaît, par un auteur qui porte le même nom que le narrateur) est littéraire. En l'occurrence, cela donne, avec Christine Angot, des conversations de dames pipi.
Je ne veux pas savoir qui a eu l'idée foireuse d'ériger ça, très pompeusement, en « autofiction ». Foireuse, l'idée : « ... comme dict le proverbe : "A cul de foyrard toujours abonde merde"» (Gargantua, IX).
Mais ce n’est pas cette « littérature » vantée par Angot (involutive dans sa platitude jusqu’à la saturation de l’exaspération) qui m’occupe ici, bien que l’auteur ait quelques peccadilles à se reprocher. « Peccadilles » est même inscrit dans son casier judiciaire, depuis sa condamnation pénale (à deux reprises) pour s’être acharnée à faire des livres de vautour en pillant, vampirisant et s’appropriant la vie privée d'une dame qui a eu le malheur d'être l' « ex-femme de son nouveau compagnon » (dixit l’encyclopédie en ligne). Sans que la moindre question morale lui effleure la conscience. George Orwell appelait ce sens moral la « common decency ». Jean-Claude Michéa traduit la formule par "décence ordinaire". Mais Christine Angot a d'autres chats à fouetter.
Si elle s’était contentée de continuer à éplucher ses patates (voir plus haut), je l’aurais laissée dans sa cuisine. Mais voilà, elle ne s'est pas contentée. Voilà qu'elle se mêle de littérature. Voilà qu'elle se pose en juge. Voilà qu'elle décrète ce qui est littéraire et ce qui ne l'est pas. Tout ça parce qu'elle ne peut pas encadrer les romans de Michel Houellebecq. Et dans Le Monde, s'il vous plaît. Elle n'aurait pas dû. Et pour faire bonne mesure, Le Monde (des livres, 16 janvier) fait figurer le libelle de Christine Angot dans un dossier intitulé "Ecrivains contre la terreur". Je trouve la plaisanterie de très mauvais goût.
Je vais encore me faire traiter de sale macho sexiste. Patriarcal. Réactionnaire. Archaïque. Bourré de stéréotypes. J'assume d'avance. Tiens, dites-moi de qui est ce vers : « Je fume au nez des dieux de fines cigarettes ». Gogol vous donne la réponse en 0,28 seconde. A condition de connaître le vers en question.
« Au nez des dieux », j'insiste.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, littérature française, christine angot, journal le monde, le monde des livres, critique littéraire, christopher lasch, la culture du narcissisme, jean-claude michéa, george orwell, common decency, michel houellebecq, jules laforgue, macho, machisme, sexisme, réactionnaire, réac, stéréotype










