mercredi, 06 avril 2016
HERMAN MELVILLE : TAÏPI
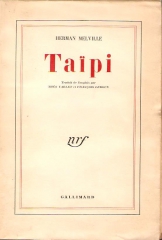 On va me trouver pisse-froid, pisse-vinaigre et rabat-joie : je viens de lire un livre du grand Herman Melville, et je suis obligé de dire que je m’y suis ennuyé. Il s’agit de Taïpi. Autant j’avais été ébloui, emporté par Moby Dick, intrigué par Mardi, touché par Redburn, autant j’ai tourné laborieusement les pages de Taïpi.
On va me trouver pisse-froid, pisse-vinaigre et rabat-joie : je viens de lire un livre du grand Herman Melville, et je suis obligé de dire que je m’y suis ennuyé. Il s’agit de Taïpi. Autant j’avais été ébloui, emporté par Moby Dick, intrigué par Mardi, touché par Redburn, autant j’ai tourné laborieusement les pages de Taïpi.
Il est présenté comme le premier roman de l’auteur mais, à la lecture, on se dit que si ce n’est pas autobiographique, c’est rudement bien imité. Va pour "roman". Il possède au moins un point commun avec Mardi, débutant comme lui par le sort apparemment invivable qui est fait au narrateur, embarqué sur un baleinier dirigé par un commandant incompétent et injuste. Le héros, comme dans Mardi, décide de déserter à la première occasion et, comme dans Mardi, trouve au dernier moment un complice qui accepte de courir l’aventure d’une évasion.
A partir de là, les trajectoires divergent : les deux fuyards de Mardi mettent à l’eau une des baleinières du navire et finiront par débarquer dans le très étrange archipel, alors que ceux de Taïpi attendent que leur navire fasse escale à Nuka Hiva (une des îles Marquises, dans la baie de laquelle mouille une escadre française, dont il faut voir la façon dont l'auteur assaisonne les manières de sauvages qu'il attribue à la puissance colonisatrice) pour profiter d’une permission de débarquer pour s’échapper dans les profondeurs de la végétation.
L’île n’est pas totalement explorée, et l’on commence par suivre la difficile progression de Tom (le narrateur) et Toby dans une nature hostile du fait d’un relief accidenté. Tom se blesse à la jambe. Ils survivent difficilement, ne disposant que de fort maigres provisions de bouche. Mais ils finissent par arriver aux abords du territoire d’une peuplade. Leur crainte est vive : sont-ils chez les Hapaas, connus pour leurs mœurs à peu près correctes à l’égard des blancs ? Ou chez les Taïpis, dont la réputation de férocité et de cannibalisme les remplit de crainte ?
En fait, si le livre porte ce titre, c’est qu’ils sont bel et bien chez les Taïpis, mais que ceux-ci sont beaucoup moins féroces que ce qu’en a fait leur réputation. Ils vont donc faire connaissance de la tribu en général, dévorée de curiosité au début, et de Marheyo en particulier, qui va adopter Tom au sein de sa famille : Mehevi, Kory-Kory, le fils dévoué qui s’occupe de porter le blessé dans les déplacements et Faïawaï, la fille ravissante pour laquelle le narrateur éprouve des sentiments tendres.
A partir de là, on quitte le « roman » pour entrer dans le traité d’ethnologie, et c’est là que je lâche Herman Melville. On va presque tout savoir des mœurs, des coutumes, des rites des Taïpis, et ça, je vais vous dire : trop, c’est trop. Il est vrai que l’action progresse cahin-caha, plan-plan, à son petit rythme. On assiste attendri, par exemple, au flirt auquel se livre Tom auprès de la ravissante Faïawaï, grâce à la dérogation exceptionnelle obtenue en sa faveur, qui l’autorise à enfreindre le tabou qui interdit aux femmes d’entrer dans l’espace de la lagune. On comprend l'attendrissement de Tom : les femmes Taïpis sont assez peu embarrassées de vêtements.
Mais dans l’ensemble, le héros, Tom, se lance avec un certain enthousiasme dans ce que les ethnologues modernes appellent pompeusement l’ « observation participante », et ne nous laisse rien ignorer des relations des Taïpis entre eux, entre les hommes et les femmes, entre la tribu et le sacré (le « Ti »), entre la tribu et les Hapaas. Et ça, franchement, ça a du mal à passer. L’intention ethnologique est éminemment louable, certes, mais a pour effet de lester l’intention romanesque d’un poids qui la rend indigeste. A part le fait que les Taïpis vivent au jour le jour, paresseusement, sans travailler, sans s’en faire outre-mesure pour le lendemain.
On saura que, longtemps après la fuite de Toby, dont Tom n’a aucune nouvelle jusqu’à la fin, celui-ci prend peur en observant le cadavre plus ou moins dépecé d’un ennemi : il se dit que la même chose risque de lui arriver, et dès lors il n’a plus qu’une pensée : retourner chez les blancs, malgré la volonté unanime de toute la tribu de garder celui-ci prisonnier. Choyé par tout le monde, mais seulement aussi longtemps qu’il n’essaie pas de quitter celle-ci. Après tout, ne doit-il pas se résoudre à mettre fin à ses grandes vacances ? Cela fera trois mois qu’il se la coule douce : il est temps de retrouver l’univers laborieux de la civilisation.
Le récit de l’évasion proprement dite de Tom donne un peu l’impression d’une pirouette. Il faut le prendre comme il est, y compris dans son aspect acrobatique. Il paraît que le livre, à parution, connut le succès. Ma foi, tant mieux pour Herman Melville. Pour mon compte, je le laisse (avec regret) à ceux qu’il intéresse.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, herman melville, taïpi, moby dick, melville redburn, herman melville mardi, îles marquises
mardi, 17 février 2015
MOBY DICK
2/2
Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre de la littérature ?
Je parlais hier de l'incroyable personnage de Quiequeg inventé par Herman Melville.
Le personnage d’Ismahel (le narrateur) occupe une place beaucoup moins nette. Au début du livre, il raconte « simplement » ce qui lui arrive : son arrivée à New Bedford, puis sa traversée vers Nantucket, son arrivée et son séjour à la « Taverne du Souffle », sa rencontre étonnante et son étrange cohabitation avec Quiequeg, son embarquement sur le Pequod, embauché par les armateurs Bilbad et Peleg, anciens capitaines eux-mêmes, tout cela le place sur le devant de la scène.
On le retrouvera à la toute fin, parce qu’il faut quand même un rescapé pour raconter l’histoire. Entre les deux, c’est-à-dire dans cent vingt-trois des cent trente-cinq chapitres, il se fait un narrateur polyvalent et effacé, capable de faire parler successivement tous les personnages. Je dois dire que le lecteur ne prête aucune attention à ce détail : tout coule de source.
Il faut faire un sort particulier, au début, au prêche que le père Mapple adresse du haut de sa chaire en forme de proue de navire (dont il retire soigneusement l’échelle de coupée une fois arrivé en haut), aux fidèles rassemblés dans la petite église. John Huston, pour son film Moby Dick (1956) ne pouvait pas choisir de meilleur père Mapple qu’Orson Welles. Le sermon vaut, en portée littéraire, morale, philosophique, la fiction poétique connue, dans Les Frères Karamazov, sous le titre « Le Grand Inquisiteur » : quel souffle !
On ne résume pas Moby Dick. On garde en mémoire quelques scènes particulières. La fable de Jonas dans le ventre du grand poisson, dans la flamboyance de sa restitution par le père Mapple en fait partie. La harangue d’Achab à son équipage, au chapitre 36, en est une autre.
Il fait jurer à tous de tout donner pour en finir avec le grand cachalot blanc (« … jurez la mort de Moby Dick ! »), en promettant à celui qui le signalera le doublon d’or de l’Equateur qu’il a incrusté à coups de masse dans le bois du grand mât, harangue dont la phrase maîtresse est sans doute cette question arrogante et impie : « Qui est donc au-dessus de moi ? », lancée à la face de Dieu et des hommes.
Seul maître à bord après lui-même, donc. Lui seul, Achab, maître de trente destins qu’il préfère conduire à l’abîme plutôt que de supporter encore l’humiliation infligée naguère par le géant des mers, cet albinos immense comme un monde, féroce et sournois, à qui il doit de boiter sur son tibia d’ivoire, et dont les autres capitaines (des gens normaux, eux, excepté le commandant de la "Rachel", qui y perdra ses deux fils) s’écartent prudemment de la route tant est sulfureuse la réputation diabolique de la baleine.
L’aspect le plus déroutant du livre est à mon avis l’effort d’encyclopédiste auquel s’adonne le narrateur, le seul qui ait survécu au naufrage. L’immersion dans le gigantesque corps du cachalot a beau s’étendre sur vingt chapitres et au-delà, j’avoue que j’ai gobé tout ça sans sourciller, et même avec gourmandise.
Herman Melville fait découvrir au lecteur l’invraisemblable succession de chefs d’œuvre de la nature qui forment l’infinité des couches (de l'épiderme jusqu'à l'intestin) enveloppant l’énormité stupéfiante du mystère que constitue le cachalot, de par son existence seule. L'être du cachalot est en soi un défi à l'imagination. On saura tout (non, pas tout) de son évent unique, de ses yeux minuscules, de la matière incroyable (le spermaceti) que recèle la fabuleuse citerne qui lui sert de proue (voire de bélier), à la conquête de laquelle se résume presque l’entièreté de la « chasse à la baleine ». Je n’insiste pas.
Melville fait aussi découvrir – comme personne ne l’a fait, je crois – l’extraordinaire dureté du métier de marin sur un navire baleinier au temps de la marine à voile : entre les manœuvres dans les vergues et les haubans, les coups de rames qu’il faut donner pour prendre de vitesse le cachalot et ne pas lui laisser le temps de fausser compagnie, et le travail d’amarrage du « poisson » contre le bord et son dépeçage, jusqu’à la récolte de la précieuse huile, dont les fûts finissent parfois par envahir le pont, le marin n’a jamais fini. On comprend qu’il faille des hommes à toute épreuve.
Impossible de faire le tour de Moby Dick : le livre déborde de tous côtés, et ce n’est pas en tirant un seul fil qu’on en finirait. Il faudrait mentionner la puissance avec laquelle sont dessinés les personnages principaux, chacun apparaissant doté d’un monde intérieur qui n’appartient qu’à lui. Il faudrait reparler de Quiequeg et de son « cercueil », qui servira de loch au navire après la destruction de l’original, et de bouée de sauvetage à Ismahel. On ne saurait décréter qu’on en a fini.
Plutôt relire le livre.
Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre de la littérature ? C’est Moby Dick.
Voilà ce que je dis, moi.
*************************************************
Je signale aux amateurs de livres que les éditions du Bug, fondées en 2014, viennent de faire paraître en janvier :
1 - Roland Thévenet : La Queue.
2 - Bertrand Redonnet : Le Silence des chrysanthèmes.
On peut contacter les éditions du Bug en passant par le blog Solko, ou par le blog L'exil des mots.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, herman melville, moby dick, nantucket, navire baleinier, baleinière, pequod, capitaine achab, orson welles, john huston, les frères karamazov, le grand inquisiteur, dostoïevski, père mapple, roland thévenet, bertrand redonnet, solko, les éditions du bug
lundi, 16 février 2015
MOBY DICK
Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre de la littérature ?
1/2
La première fois que j’ai lu Moby Dick, c’était en 2010 et un enchantement (notez le zeugma). J’ai avalé le pavé comme un bonbon de sucre aromatisé à l'existence humaine, comme dans un état second, hypnotisé par un livre comme je n’en avais jamais lu auparavant. Je me rappelle avoir jubilé de la première à la dernière page. Extraordinaire souvenir. Dans la foulée, j’avais enchaîné avec Mardi et Redburn.
Mais Mardi est une fantaisie métaphorique un peu lourde (et copieuse), racontant la circumnavigation en pirogue autour d’un archipel qui se révèle avoir les dimensions de la planète, avec à son bord quelques échantillons, disons, « typés » de l’humanité (où je vois le poète, le prêtre, le politique, le fou, …). L’intention d’Herman Melville a eu du mal à m’apparaître, y compris à travers le fait qu’ils boivent tous comme des trous.
Quant à Redburn, j’avais beaucoup aimé ce récit de l’apprentissage d’un novice, obligé par la misère noire où la faillite et la mort paternelles ont plongé la famille, de se faire mousse sur un de ces grands voiliers qui font la navette entre les deux rives de l’Atlantique. Il vend même à un juif, pour trois kopeks de l'époque, sa carabine patrimoniale, et se présente dans une tenue ridicule au capitaine qui l'enrôle.
L’apprentissage est d’une grande brutalité, surtout lorsque Redburn découvre que le Liverpool où il débarque n’a rien à voir avec la description minutieuse et presque touristique que son père, homme aux affaires autrefois florissantes, en a laissée dans un gros carnet qu’il gardait précieusement, mais comme un talisman dont les effets s’évanouissent face aux réalités mouvantes du monde. Un livre excellent.
Mais j'avais lu Moby Dick. Le reste pâlit forcément. A la deuxième lecture, l’effet d’émerveillement n’est évidemment plus le même : le lecteur sait à quoi s’attendre, il n’est plus dans la découverte d’un absolu. Comme dans les choses de l’amour, la « première fois » lui a fait perdre de - appelons ça : sa naïveté. Après, quoi qu'on dise, on recommence. On connaît les gestes à faire. Et puis il y a les records à battre. Ce qui différencie Moby Dick de Redburn et Mardi, c’est que dans Moby Dick, il y a tout.
Pour dire qu’il y a tout, on y trouve même, par exemple, une dénonciation des hiérarchies en vigueur dans la marine américaine, qui réserve les commandements de navires à des Américains blancs, recrutant le fretin et la piétaille de base parmi les autres nations du monde (métaphore du "melting pot" ?), et confiant le harpon à des « sauvages » (un Indien, un Fidjien - ou qui que ce soit d'autre -, un Africain).
Je passe rapidement sur les moyens littéraires : tour à tour le récit se fait poétique et inspiré, lyrique et exalté, éloquent et classique, narratif et palpitant, philosophique, historique, politique, moral, théâtral, méditatif, mystique, bref, tous les genres possibles – passés, présents et à venir – de la littérature.
Si Moby Dick était de la musique, je dirais qu’on y trouve l’amplitude la plus forte de ce qu’on appelle les « dynamiques » (tout ce que le format MP3 régnant a ratiboisé par nivellement) : du calme le plus plat à la violence la plus déchaînée. Du pianississimo au fortississimo et retour. Les oreilles actuelles (et tout ce qui va avec) ont perdu toute acuité auditive. Herman Melville n'est plus de notre monde. C'est de la littérature d'avant.
Dans Moby Dick, il y a aussi l’infinie variété des caractères humains, étant entendu que le personnage d’Achab fait figure d’exception inhumaine dans la galerie des portraits tracés par Herman Melville. Des trois « Seconds », Starbuck occupe le rôle du « craignant Dieu » : son sens de la discipline l’oblige à respecter son commandant, mais il n’en pense pas moins, par-devers lui. Stubb est l’optimiste de profession : il ne se départ (si, si, c’est comme ça qu’on conjugue) jamais d’une équanimité inentamable. Flask est celui qui pèse le moins, tout au moins quand il est assis à la table des officiers : son assiette est la dernière à être servie, quand il en reste.
Sur le Pequod (nom d’une tribu indienne exterminée, paraît-il, mais ce n’est pas dit dans le bouquin), il y a trois harponneurs : Tashtego, l’Indien, Daggoo, le géant noir aux dents d’ivoire et Quiequeg, originaire des îles, une force de la nature, augmentés d’une créature tant soit peu diabolique, amené clandestinement sur le bateau par Achab, du nom de Fedallah, selon toute vraisemblance porteur de maléfice. Sur les autres marins, en dehors d’Ismahel, et pour cause, on n’en saura pas plus. Sans doute une préfiguration de la « foule des anonymes ».
Quiequeg occupe une place à part, introduit dans l’histoire et sur le Pequod par le narrateur, Ismahel, dont le hasard, puis l’amitié lui a fait partager la chambre d’auberge, le lit et les étranges pratiques rituelles. Modèle d’une vie « sauvage » parfaitement organisée et tout aussi valable et signifiante que celle des civilisés, Quiequeg apparaît en plusieurs occasions, toujours pour montrer l’exactitude étonnante avec laquelle son instinct lui permet de s’adapter aux circonstances, des plus anodines (voire cocasses) aux plus dangereuses.
Voilà ce que je dis, moi.
*************************************************
Je signale aux amateurs de livres que les éditions du Bug, fondées en 2014, viennent de faire paraître en janvier :
1 - Roland Thévenet : La Queue.
2 - Bertrand Redonnet : Le Silence des chrysanthèmes.
On peut contacter les éditions du Bug en passant par le blog Solko, ou par le blog L'exil des mots.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, herman melville, moby dick, redburn herman melville, mardi herman melville, capitaine achab, pequod
vendredi, 28 juin 2013
POURQUOI JE LIS

JEUNES PAYSANS, PAR AUGUST SANDER
***
Je ne lis pas pour lire. La lecture est un moyen, pas une fin en soi, je ne sors pas de là. C’est vrai que si je me pose la question de savoir pourquoi je lis, la réponse ne vient pas de soi. Mais après tout, est-il si important de savoir pourquoi on fait les choses ? Et puis aussi : peut-on vraiment le savoir ?
Pour mon propre compte, les lecteurs qui viennent incidemment ou fidèlement sur ce blog s’en sont fait une idée plus ou moins précise : je l’avoue sans honte, sans fard et sans vergogne : je lis pour jubiler. Disons-le carrément : je lis pour jouir. Comme le chien rongeant son os, j'ai la lecture d'un égoïsme carabiné et d'une possessivité intempérante. En cette matière, l'injustice que je mets constamment en pratique est à toute épreuve, hors de portée des magistrats les plus empreints de rectitude morale et juridique.
Jubiler, donc. Pas que. Mais je déteste perdre mon temps, en particulier avec ce que l’actualité appelle « Littérature ». La petite crotte intitulée Qu’as-tu fait de tes frères ? est le dernier étron en date (chié par un certain Claude Arnaud) sur lequel je me suis penché, et à la non-écriture duquel j’ai consacré, hélas et en vain, de précieuses minutes, et accessoirement une note ici même, je veux oublier quand. Ces minutes et cette note eussent été mieux employées si j'eusse laissé le livre fermé. Mieux : si j'avais laissé le volume au libraire. La note eût eu le privilège de ne même pas être appelée à naître. Pauvre libraire, finalement, d'être obligé de vendre ça ! Pour ceux que ces propos défrisent, je renvoie à l'esprit d'injustice radicale revendiqué plus haut.
Oui, je lis pour jubiler. Cela veut dire que je ne lis pas pour savoir. Si du savoir découle, c'est en plus. Cadeau. Encore moins pour apprendre une leçon qu’il faudrait réciter. Je ne lis pas pour me conformer aux impérieux diktats de l’époque, qui vous ordonnent : il faut avoir lu Walter Benjamin.
Qu’est-ce qu’ils ont tous à aboyer le nom de Walter Benjamin (prononcer béniamine) ? Et qu'est-ce qu'ils en font, de leur lecture ? Ils se sentent coupables ? Redevables (Walter Benjamin, juif, s'est suicidé en 1940 à la frontière avec l'Espagne, faute, me semble-t-il, d'un visa) ? Je n'ai rien contre ce monsieur. La preuve, j’ai essayé : j’ai laissé tomber. De la tortillonnade de circonvolution cérébrale (mais je réessaierai peut-être, j’ai bien fini par lire Le 19ème … de Philippe Muray).
Jubiler, oui, ça m’a été donné par des livres très divers. J’ai déjà parlé de Moby Dick, un livre qui transporte la matière humaine infiniment loin, jusqu'aux confins, presque jusqu'à l'esprit, juste à côté de l'âme, je veux dire juste un peu avant ; un livre que j’ai regretté de fermer quand je l’ai fini, mais un livre qui a comblé mon âme d’un enthousiasme presque indécent. C’est vrai ça : comment Herman Melville a-t-il pu aligner vingt chapitres de description du cachalot sans me donner envie de jeter le bouquin ?
Je n'en suis toujours pas revenu. Comment a-t-il fait pour que, au contraire, tout au long de ces vingt chapitres ahurissants, la joie n’ait pas cessé de grandir (je précise quand même, pour les connaisseurs, que je l'ai lu dans la traduction de personne d'autre que l'immense Armel Guerne, qui exerçait, en plus du sacerdoce de poète, celui, combien plus exigeant et combien plus religieux à ses yeux, de traducteur) ?
Bien sûr, je peux analyser la chose, dire que Melville entre dans le cachalot comme on fait le tour du monde, pour l’explorer, et en découvrir, pays par pays, les merveilles, pôles compris. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait dans le très curieux Mardi, ce gros livre bizarre où quelques personnages montés dans une modeste pirogue (« royale » quand même) voyagent jusqu’à l’extrême des quatre points cardinaux, pôles compris.
Mais jubiler ne suffit pas, quand on lit. Encore faut-il pouvoir en faire quelque chose ensuite. Prenez le pur bonheur de Cent ans de solitude (dirai-je le nom de l’auteur ?). Ce livre pareil à nul autre vous plonge dans l’ambiance primordiale de la famille Buendia, native du village colombien de Macondo, avec Arcadio Buendia, Remedios la Belle et bien d'autres personnages, dans les générations desquels on se perd (j’ai lu ce livre une seule fois, il y a fort longtemps, sur le conseil de mon ami Bosio, merci Bosio, car il n'a toujours pas fini de faire résonner ses harmoniques). Ce que la grande Marthe Robert appellerait un « Roman des Origines »
Mais finalement, ce livre-monde, quels effets a-t-il produits en moi ? Même question avec ce livre formidable de Yachar Kemal, Mémed-le-Mince : un tout petit endroit du monde que le talent (ou le génie) de l’écrivain transforme en univers par la seule magie du verbe : on comprend bien que le cadi est un petit chef local qui impose la loi de son bon plaisir arbitraire et minable, mais on est emporté dans les dimensions quasiment célestes dans lesquelles le récit et les personnages sont enchâssés (les savantasses appellent ça de « l'épique »).
Ces livres, si je regarde ce qu’ils m’ont laissé, restent un peu comme ce que les physiciens appellent des « solitons », ces « ondes solitaires qui se propagent sans se déformer dans un milieu non linéaire et dispersif ». Ce que je retiens ici, c’est « ondes solitaires ». Le reste m’échappe évidemment : c’est de la physique, n’insistez pas.
Des livres sans cause et sans conséquence. Sans cause parce que leur lecture est venue par hasard, au gré des circonstances. Sans conséquence parce que, comme le nuage dans le ciel ou l’homme dans la femme (proverbe chinois idiot, mais peut-être que celui qui l'a inventé connaissait la pilule contraceptive, et qu'il ne parlait que du plaisir), ils ne laissent pas de trace. Tout au moins visible : je n'aimerais pas qu'on voie sur ma figure que j'ai lu les romans de Goethe.
Je veux dire que ces livres ne construisent rien en vous après être passés. Un buron, une borie, un bastidon, je ne sais pas, mais quelque chose qui ait à voir avec un abri de berger. Ou alors à votre insu. Des livres morts en vous, des morts sans descendance apparente et dont vous êtes le cul-de-sac, bon gré mal gré.
Des livres dont vous ne saurez jamais comment vous pourriez restituer le bonheur qu’ils vous ont procuré. Sinon en en conseillant la lecture aux gens que vous aimez, piètre consolation. Des livres dont vous auriez envie, si c'était possible, de rendre au monde les bienfaits qu'ils vous ont offerts. Des livres qui vous laissent inconsolable d'avoir à les fermer, et dont le deuil en vous ne finira jamais. Oh, l'amour de ce deuil qui est une joie !
Des livres qui sont à eux-mêmes des culs-de-sac définitifs, parce qu’au-delà d’eux, il n’y a plus rien. Dans la même direction, personne n'est en mesure d'aller plus loin. Ils ont vidé le paysage. Non : ils ont vidé le fini du monde sans limite dans l’infini de leur espace borné. Ils ont transféré la soluble et frêle substance de l’univers dans la matière indestructible dont ils ont été faits, grâce au génie d’un homme unique et désespéré, comme le sont tous les hommes, car en lui s’est déversé, on ne sait pourquoi ni comment, le sens entier de l’existence humaine. Et que s'il n'en est pas mort, c'est juste parce qu'il a tout délégué, jusqu'à sa propre mort, à l'encre posée sur le papier.
Ce ne serait pas mal, comme définition d'un chef d'oeuvre : un livre qui est allé tout au bout de lui-même, un cul-de-sac qui a vidé son auteur de toute sa mort pour en faire un être vivant, et au-delà duquel il n'y a plus rien, que le vide sidéral. Oui, ce ne serait pas mal. Là, je verrais bien Au-dessous du Volcan. A la Recherche du temps perdu. Qu'en pensez-vous ? Mais moi qui ne fais jamais de liste, même pour faire les courses, ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Chacun pour soi.
C'est de l'ordre de l'accomplissement. C'est seulement pour ça que je lis des livres. Chacun pour soi.
Voilà ce que je dis, moi.
09:02 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, claude arnaud, qu'as-tu fait de tes frères, librairie, lecture, moby dick, herman melville, armel guerne, cent ans de solitude, gabriel garcia marquez, yachar kemal, mémed-le-mince, goethe
mardi, 21 mai 2013
AU-DESSOUS DU VOLCAN 3

MALCOLM LOWRY EN PERSONNE. - AVEC DE QUOI TENIR COMBIEN DE TEMPS ?
Au-dessous du volcan raconte quelque chose d’extrêmement simple, on peut même dire pauvre, si l'on s'en tient à ce que le lecteur moderne attend du best-seller (je veux dire l'action, le suspense) dont il vient de glisser subrepticement dans son sac un exemplaire pris sur la pile à la FNAC, en espérant qu'aucun dispositif discret glissé dans le volume ne déclenchera l'alarme quand il passera le portique sous l'oeil vigilant d'un grand noir portant le blazer sombre siglé "Sécuritas" et armé d'un téléphone.
L'action tiendrait sur un timbre-poste, mais il faut bien les 400 pages bien denses pour faire tenir tout ce que Lowry nous balance tout au long des douze chapitres. C'est bourré à craquer (sans jeu de mots sur "bourré"). L'action s'étend sur douze heures. Au-dessous du volcan est d'abord un livre qui compte le temps qui reste. Autant Ulysse propose des indices presque invisibles pour suivre l'écoulement des minutes, autant Lowry souligne le tic-tac inexorable de l'horloge au moyen de balises voyantes.
Après une absence d’un an, Yvonne revient à Quauhnahuac, chez le Consul qu’elle avait quitté, et dont le frère Hugh est de passage au même moment. Tous décident d’aller à Tomalin assister à un spectacle taurin. Au retour, Geoffrey les laisse pour aller boire au Farolito. C’est là qu’il se fait trucider. Point à la ligne.
Pardon, entre-temps Yvonne et Hugh ont fait une promenade à cheval et un tour à la foire de la ville. Entre-temps, Geoffrey a eu une petite conversation avec son sévère voisin Quincey, il a dormi, s’est réveillé. Entre-temps, Hugh a même pu le raser (les mains du Consul tremblent trop pour le faire elles-mêmes), pendant qu’Yvonne était à la salle de bains. Entre-temps, ils sont aussi allés tous les trois boire un « apéro » chez Jacques Laruelle, avant de partir pour Tomalin.
Ajoutons l'épisode crapoteux de l'Indien qui agonise sur la route de Tomalin, avec une grave plaie à la tempe. C'est lui qui montait le matin même ce cheval marqué du chiffre 7. Sans surveillance, celui-ci maintenant croque dans la végétation d'un buisson, mais les sacoches pleines de tout à l'heure ont disparu. L'épisode se termine lorsque trois policiers louches repoussent Hugh dans l'intérieur du car, où Geoffrey remarque qu'un passager manie sans se cacher les pesos couverts de sang qu'il vient de prendre à l'Indien.
Enfin vous voyez qu’il s’en passe, des choses, dans ce roman : les péripéties, rebondissements et coups de théâtre se succèdent à un rythme effréné, haletant, tenant le lecteur constamment en haleine … Ah non, faites excuse, je confonds avec le dernier SAS de Gérard de Villiers. Non, je voulais en fait citer un passage d’un livre totalement étranger (quoique ...) à notre Volcan. Le voici.
« L’homme a toujours le désir de quelque monstrueux objet. Et sa vie n’a de valeur que s’il la soumet entièrement à cette poursuite. Souvent, il n’a besoin ni d’apparat ni d’appareil ; il semble sagement être enfermé dans le travail de son jardin, mais depuis longtemps il a intérieurement appareillé pour la dangereuse croisière de ses rêves. Nul ne sait qu’il est parti ; il semble d’ailleurs être là ; mais il est loin, il hante des mers interdites. »
Je considère que ces quelques lignes magistrales dessinent un portrait exact de Geoffrey Firmin, alias le Consul. Jean Giono a écrit ça dans Pour Saluer Melville, après avoir traduit Moby Dick. Il parle évidemment du capitaine Achab, obnubilé par la poursuite de son cachalot. Avouez qu’il y a de ces rencontres …
Jean Giono qui, avec le capitaine Langlois, a lui-même donné vie à un drôle de lascar (Les Récits de la demi-brigade, et surtout Un Roi sans divertissement), qui finit par aller fumer dans la nuit une cartouche de dynamite après avoir allumé la mèche (« Et il y eut, au fond du jardin, l'énorme éclaboussement d'or qui éclaira la nuit pendant une seconde. C'était la tête de Langlois qui prenait enfin les dimensions de l'univers »). Toujours est-il que ces phrases tombent pile sur le grandiose et dérisoire personnage de Lowry : le Consul.
Bon, c’est vrai qu’avec Geoffrey Firmin, le voyage intérieur effectué sur les vagues brumeuses de l’alcool doit être repérable de l’extérieur, mais à part ce détail, tout concorde. D’autant plus que Geoff a réellement navigué, dans le passé.
Je n’ai aucune envie de parler d’Au-dessous du volcan selon une méthode construite et logique, bien qu’il soit lui-même charpenté comme la cage thoracique (si l’on peut dire) du cachalot surnaturel amoureusement et génialement détaillé dans ses moindres recoins (20 chapitres) par Herman Melville dans Moby Dick.
J’ai juste envie d’émettre, en direction de la surface du marigot au fond duquel je me tiens, quelques bulles imprévisibles d’un méthane spécialement distillé au cours de ma lecture, qui remontent des profondeurs dans le désordre de leur gré.
Un peu, finalement, à la manière des pensées de Geoffrey Firmin, le Consul, et, à l'occasion, d'Yvonne et d'Hugh, quand elles amènent à la surface du texte l'écheveau des méandres de leur passé personnel et de leur passé commun, comme des témoins plus ou moins titubants venus bredouiller leur vérité à la barre. Des témoins éprouvants, mais encore agissants. Le présent des personnages n'a rien oublié de leur passé. C'est tout ça qui remplit ce roman inclassable, et jusqu'à la gueule.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : malcolm lowry, littérature, au-dessous du volcan, ulysse, james joyce, le consul, geoffrey firmin, herman melville, moby dick, jean giono, pour saluer melville
vendredi, 18 mai 2012
ELOGE DE MAÎTRE RABELAIS
Comme promis (« Compromis, chose due », disait COLUCHE en parlant des femmes), aujourd’hui, j’attaque Maître FRANÇOIS, alias ALCOFRIBAS NASIER. Bien sûr, que c’est RABELAIS. Que puis-je dire, au sujet de RABELAIS ? Si je disais que j’ai l’impression que j’ai du rabelais qui me coule dans les veines, je ne serais pas très loin de la vérité, mais ce ne serait sans doute pas très bon pour ma réputation (quoique …).
Pourquoi ? Mais à cause de la réputation de grand buveur devant l’éternel, qu’il traîne depuis toujours, pas complètement à tort, probablement. Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas sa lecture qui vous empêchera de passer à l’éthylomètre avant de prendre le volant. Tout ça pour dire que parmi les auteurs français que ma prédilection m’a amené à cultiver de préférence aux autres, je l'avoue aujourd'hui, c’est RABELAIS qui vient en tête.
En confidence et par parenthèse, je peux vous dire aussi que celui qui vient en queue s’appelle PIERRE CORNEILLE, mais ça, c’est dû à la longue malédiction qui a poursuivi ce malheureux génie depuis un épouvantable Cinna étudié en classe de 5ème, sous la férule de Monsieur LAMBOLLET, au lycée Ampère. J’imagine que c’était au programme. Je vous jure, Cinna à douze ans, il y a de quoi être dégoûté des mathématiques. Euh, j’ai dit une bêtise ?
« Prends un siège, Cinna, et assieds-toi par terre, Et si tu veux parler, commence par te taire ». Non, je déconne, ce n’est pas Auguste qui dit ça à Cinna, c’est nos esprits mal tournés d’élèves mal élevés qui brodaient. Forcément, c’est ça qui m’est resté. Mais ça doit être du genre de la « pince à linge » des Quatre Barbus et de la 5ème symphonie de BEETHOVEN.
Si, j’ai quand même retenu « Je suis maître de moi comme de l’univers », parce que je vous parle d’un temps où l’on apprenait par cœur. Je crois bien que c’est dans la bouche d’Auguste. Mais CORNEILLE m’a collé à la semelle gauche (il paraît que ça porte bonheur !), parce que plus tard, j’ai dû me farcir Sertorius, et puis Suréna, et ce traumatisme, franchement, je ne le souhaite à personne. Et je n’ai rien dit d’Agésilas et d’Attila : « Après l’Agésilas, hélas, mais après l’Attila, holà ! ». Même que ce n’est pas moi qui le dis, c’est BOILEAU, alors.
Résultat des courses, il m’est resté un automatisme : de même que Gaston Lagaffe éternue dès qu’on prononce le mot « effort », de même, dès que j’entends le nom de CORNEILLE, je bâille. Bon je sais, la blague est un peu facile, mais avouez qu’il fallait la faire, celle-là, et c’est d’autant plus vrai que ce n’est pas faux. Et puis si, par-dessus le marché, ça désopile la rate, on a rien que du bon.
Mais foin des aversions recuites – et injustes comme sont toutes les vendettas, et je ne vais pas passer ma vie à assassiner CORNEILLE qui, après tout, ne m’a jamais empêché de vivre, malgré des dommages monumentaux à mon égard, pour lesquels je n’ai jamais reçu d’intérêts –, revenons à RABELAIS.
Le portrait ci-dessus est donné pour celui de RABELAIS en 1537. Il tranche avec tout ce qu'on connaît, et l'on est pris de doute. Pourtant, je me rappelle la collection de portraits accrochés dans un des bâtiments de La Devinière, la maison natale : beaucoup ressemblaient à l'officiel, de plus ou moins loin, il est vrai. Mais quelques-uns étaient de la plus haute fantaisie, faisant parfois de l'auteur une sorte de nègre.
Je ne vais pas refaire mon chapitre sur Lagarde et Michard, avec leur damnée tendance à tout tirer vers le sérieux, le pontifiant et l'asexué, bref, le SCOLAIRE (« ce qu’il faut savoir »), mais il est sûr que si on veut jouir de RABELAIS, c’est dans le texte qu’il faut aller. Et pour y aller, j’espère qu’on m’excusera, il faut avoir envie de jouir. C’est un aveu. Tant pis. J’espère qu’à mon âge, il ne me coûtera pas trop cher.
RABELAIS ? C’est ma respiration. C’est mon espace vital. C’est comme un socle. Je n’y peux rien, ça s’est fait malgré moi, comme ça, sans que j’y prête la main, c’est certain. RABELAIS m’a appris une chose : la JOIE est le centre nerveux, le cœur et le muscle de l’existence. Tout le reste est résolument secondaire, accessoire, décoratif, facultatif, marginal, subsidiaire, superfétatoire et, disons le mot, superflu. Ce que je trouve chez RABELAIS me ramène toujours à la JOIE.
Il serait d’ailleurs peut-être plus exact de dire que j’ai satisfait dans RABELAIS ce besoin d’éprouver la JOIE. C’est ce même genre de besoin vital qui m’a rendu récemment jubilatoire, proprement et absolument, la lecture de Moby Dick. Mais c’est vrai, je ne sais pas encore tout, et je ne suis pas sûr d’en savoir plus « quand fatale [sonnera] l’heure De prendre un linceul pour costume » (Le Grand Pan, GEORGES BRASSENS).
C’est sûr, MONTAIGNE me touche, mais c’est un homme qui s’écoute. Beaucoup de passages plaisants, c’est sûr (je me suis efforcé d’en indiquer à plusieurs reprises ici même), mais il y a à mon goût trop de gravité chez MICHEL EYQUEM, petit châtelain de Montaigne. En comparaison, RABELAIS, je vous jure, existe concrètement, jovial et fraternel. Dès qu’il vous aperçoit, il vous invite à sa table. C’est une tout autre vision de l’humanité.
Une humanité qui converse gaiement autour d’une table couverte de plats ventrus et de flacons vermeils. Une humanité qui parle de la vraie vie, poétique et réelle, qui est forcément celle de tout homme. Poétique, parce que tout homme rêve et que tout rêve est poétique. Réelle, parce que lire les livres de RABELAIS est une excellente recette pour apprendre à renoncer sans regret à devenir maître du monde. Il y a tout ça, dans l’œuvre de FRANÇOIS RABELAIS.
Voilà ce que je dis, moi.
Et ce n'est pas fini.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, françois rabelais, montaigne, pierre corneille, cinna, lycée ampère, français, beethoven, la pince à linge, les quatre barbus, gaston lagaffe, lagarde et michard, moby dick, georges brassens
samedi, 08 octobre 2011
LES YEUX RETROVISEURS DE LA BECASSE
Je préviens tout de suite : on y viendra, à la bécasse, mais s’il vous plaît, laissez-moi le temps d’y arriver.
Les merveilles du monde animal, on ne saurait s’en lasser. Pensez aux vingt chapitres qu’ HERMAN MELVILLE consacre à la description du grand cachalot dans Moby Dick. Pensez aux liens mystérieux que PIERRE MOINOT tisse entre l’humanité et les bêtes dans La Chasse royale ou Le Guetteur d’ombre.
Pensez à cette nouvelle posthume du magnifique LOUIS PERGAUD, La Rencontre (oui, le même qui a écrit La Guerre des boutons, assassiné en 1915 sur je ne sais quel champ de bataille, lors du grand suicide inaugural de l’Europe dans le petit matin glauque du XX° siècle), où deux jeunes garçons rentrent chez eux un soir de Jura couvert de neige, obstinément suivis, à dix mètres, par un drôle de « chien » qui, aux abords du village, n’a rien de plus pressé que de sauter en un clin d’œil sur Tom, le roquet détesté du détesté père Zéphyr, de l’égorger proprement et de l’emporter brusquement dans la forêt. C’était évidemment un loup. C’était en d’autres temps.
Personnellement, je suis aux anges lorsque j’entends, quelque part en l’air, le miaulement caractéristique de la buse variable ; lorsque, dans les hauts de la vallée d’Aspe, j’aperçois pendant quatre secondes le vol d’un percnoptère ; lorsque, du côté de Puy-Saint-Vincent, un circaète Jean-le-Blanc offre la surprise d’un passage à proximité ; lorsque, du fond des gorges du Verdon, j’aperçois le vol d’une quinzaine de vautours largement éployés au sommet de la falaise, posés sur un coussin d’air chaud.
J’aime ces surprises animalières : quand toi, perdu dans le massif du Pilat avec une carte que les bûcherons ont si méticuleusement saccagée que tu n’es plus en mesure de savoir où tu te trouves à dix kilomètres près, et que tu tombes nez à nez avec une biche qui te regarde fixement aussi longtemps que tu ne bouges pas un cil, mais « qui preste s’évanouit » (BRASSENS, « Les belles passantes »), dès que tu romps l’enchantement, parce qu’il faut bien bouger. Mais la biche, même un autre jour au-dessus de Crémieu, sur un sentier à peine dessiné, tu vois plus souvent son cul que ses yeux : peut-être ce qu’on appelle la « gentillesse » féminine ?
Je peux même te raconter la truite, dans ce qu’on appelle le « ruisseau de Chaumargeais » (à toi de trouver où ça se trouve), quand tu marches pieds nus dans la flotte et que, à chaque pierre qui « fait de l’ombre », tu t’arrêtes tout doux, tu te baisses tout doux, et tu passes tout doux les mains sous la pierre, le gras des doigts vers le haut. Quand le contact est soyeux, tu redoubles de douceur, comme un fétu qui suivrait le courant et qui effleurerait ce que tu as senti.
Tu mesures la dimension de la bête : une main tendre à la tête, une main tendre au ventre, tu crispes soudain les doigts, et tu jettes sur l’herbe, assez loin pour que, de son saut puissant, elle n’ait aucune chance de retourner à l’eau. Le soir, si tu t’es pas fait prendre, tu te régales : une poêle, les quelques jolies pièces de l’après-midi, la maille ou pas la maille, roulées dans la farine, un peu de beurre, que demande le peuple ?
Seulement un peu de bonheur. Tu peux aussi essayer dans la Cérigoule, ça marche aussi, mais elle est un peu large. Bien entendu, la « pêche à la main » est tout à fait illégale, prohibée, voire interdite, si ce n’est même proscrite. Parce que trop efficace et moins aléatoire, sans doute. Plus sûrement parce que tu n’as pas payé le timbre. Je vais te dire : « Attrape-moi si tu peux ! »
Regarde mourir un pic-vert, ça laisse également des souvenirs. Le fusil paternel résonne juste à côté de ton oreille : il a tiré ! Et tu vois l’oiseau tout d’un coup monter en flèche vers le ciel. Le fusil paternel te déclare : « Il a eu un plomb en pleine tête ». C’est sûr. Ça dure un instant seulement : après la flèche, la pierre, qui tombe verticale vers le sol. Au moins, tu n’as pas à chercher dans les broussailles. L’étonnant, une fois l’oiseau vert allongé sur la plaque de marbre : la langue ! Jamais vu une langue aussi longue, un peu dégoûtante au toucher. Bon, je sais bien que c’est très bête, de tuer un pic-vert.
La taupe, ce n’est pas mal non plus. Cela se passe dans « les marais ». Le jour est sec, le chemin et le soleil aussi, et les feuilles mortes aussi, qui commencent à crisser toutes seules les unes contre les autres. Bizarre. Tu t’es mis à l’ombre pour siroter ton breuvage. Le vélo est couché sur le bas-côté du chemin de terre. Tu es assis. Tu savoures la chose et le repos. C’est quoi, ces feuilles qui bougent ? Evidemment, tu vas voir, tu soulèves une feuille, puis deux, puis un paquet. C’est quoi, ce cylindre noir qui essaie de s’enfouir ? Mets-y les doigts ! Attention, ça mord et ça griffe. Incroyable, cette méchanceté ! Retournes-y, mais prudence.
C’est drôle, quand tu tiens la bête, le ventre en l’air : un museau de musaraigne, mais en moins long et en plus fort. Et des pattes comme des battoirs griffus, avec un dessous entre le rose et le gris. Bon, vous aurez beau insister, je ne dirai rien de ce qui arriva ensuite. Vous risqueriez de m’en vouloir. Sachez seulement que je m’intéressais fort à l’époque aux divers procédés de tannage des peaux. Ce que je peux parfaitement avouer, c’est qu’il n’y a pas plus doux sur terre que la fourrure de taupe, y compris la peau des filles, qui ont certes les griffes, mais même pas de la fourrure partout, et nulle part cette sorte de fourrure, à poils courts et droits, et d’une finesse inégalée. Passons.
Puisqu’on est à la chasse, venons-en au moustique. Je n’ajouterai rien aux sempiternelles lamentations du touriste en vacances. Je pense aussi à une aventure de Lucky Luke : ce salopard de « poor lonesome cowboy and far away from home » introduit par le trou de la serrure un moustique dans la chambre d’hôtel d’Averell Dalton, qu’il doit affronter le lendemain. Au matin, celui-ci a le teint tellement verdâtre qu’il suffit d’une pichenette pour l’assommer. C’est vrai que ça rend la nuit impossible, le moustique. Mais il faudrait interdire cette déloyauté.
Moi, j’en avais régulièrement dans ma chambre, des moustiques. Heureusement, j’ai inventé une arme imparable. Quand vous aurez le temps, allumez une bougie. Intercalez-la entre la bombe insecticide et le moustique posé sur le mur en plâtre peint en bleu clair un peu pisseux. Laissez au moins vingt centimètres entre la bougie et la bombe. Appuyez. Pas longtemps. Relevez maintenant l’index, et observez : vous avez du mal à retrouver quelque trace que ce soit de la bestiole. Ben oui, elle a eu un peu trop chaud, quoi. Quoi, c’est dangereux ? Evidemment ! Où serait le plaisir de la chasse au chalumeau, je vous le demande ?
Bon, bref. Alors comme ça, mon sujet, c’était les oiseaux. Puisque j’en étais à la chasse, je signale que beaucoup d’espèces d’oiseaux distinguent à merveille le promeneur inoffensif et le chasseur armé d’un fusil. Vous vous baladez les mains dans les poches, vous avez des chances d’observer des vols presque normaux à proximité. Vous portez un grand bâton noir luisant et qui fait du bruit au creux du bras : vous ne voyez plus la queue d'un. Etonnant, mais c’est comme je vous le dis !
Il n’y a pas que le bec qui soit intéressant, chez les oiseaux. Voyez leur œil. Et tenez-le à l’œil jusqu’au prochain épisode.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : animaux, oiseaux, ornithologie, oeil, herman melville, pierre moinot, moby dick, la chasse royale, le guetteur d'ombre, louis pergaud, circaète, percnoptère, vautour
jeudi, 06 octobre 2011
MON BON PLAISIR EN LITTERATURE
DU POPULAIRE EN GÉNÉRAL ET DU POLICIER EN PARTICULIER
Pourquoi je ne lis pas que des livres de « haute littérature » ? Pourquoi j’aime ça, disons, la « littérature populaire », à commencer par le « roman policier » ? J’ai certes jubilé intensément d’un bout à l’autre de Moby Dick, de HERMAN MELVILLE, peut-être, entre autres, à cause de la traduction parfaite d’ARMEL GUERNE. Mais le traducteur a beau faire des prouesses, l’essentiel, forcément, appartient au seul auteur. J’avoue cependant que j’ouvre avec plaisir, à l’occasion, un Maigret de GEORGES SIMENON, ou un Arsène Lupin de MAURICE LEBLANC. Pourquoi ce plaisir ?
Dans le premier cas, je me souviens des détails de l’action, j’ai pour ainsi dire vécu en compagnie des marins, sur le pont, dans les haubans ou dans la baleinière, et j’ai appris à les connaître. J’en ai bavé, j’ai bu la tasse, j’ai été secoué, chaviré. Longtemps après avoir lu, je mastique encore, je rumine, je persiste à digérer, je prolonge l’assimilation. C’est un livre qui dure.
Dans l’autre, dès que, satisfait de ma lecture, j’ai refermé sur la clé de l’énigme, j’ai déjà oublié les circonstances, les personnages, les lieux, sauf – encore que vaguement – cette cour sablonneuse d’une maison dans la Sarthe, un jour torride de juin, où il s’est passé quelque chose. Quelque chose, mais quoi ? Pourtant SIMENON est un excellent écrivain. D’abord tout le monde le dit, c'est sûrement vrai. D'autant plus vrai que j'en suis convaincu.
En un mot comme en cent, la "grande littérature" me transporte, la "petite littérature" me fait plaisir. Et j'ai grand respect et besoin de la digression, comme l'ont sans doute remarqué les lecteurs de ce blog.
Je dirais, tiens, ça me vient là, que ce sont des livres à « évaporation rapide », en face d’autres livres, que je dirais à « sédimentation durable ». Maigret, ce n’est pas le premier, c’est loin d’être le seul, mais avant tout, c’est un personnage de SÉRIE : « J’aime bien lire "un" Maigret, de temps en temps », peut-on souvent dire ou entendre. Ou "un" James Bond. Ou "un" Arsène Lupin. Je rappelle que le premier héros d’une série policière est le Dupin d’EDGAR ALLAN POE dans trois récits : Double assassinat dans la rue Morgue, Le Mystère de Marie Roget, La Lettre volée (1841, 1842, 1844). Rendons à César…
Alors derrière le "un", posez Nestor Burma, Miss Marple, Hercule Poirot, OSS 117, le commissaire Adamsberg, Pepe Carvalho, le Juge Ti, Erwin le Saxon, bref : QUI VOUS VOUDREZ. Chacun des livres de ces séries n’est pas fait pour rester. Je dirai donc que l’évaporation est le principe même de la série. Et que le héros de la série, à son tour, s’évapore : en fait, il ne lui arrive rien Á LUI personnellement.
C’est flagrant avec James Bond, dont j’imagine en toute logique le corps couturé, non : zébré de cicatrices en tous sens, de toutes sortes, de toutes profondeurs. Normalement, sa surface est toute en creux, cratères, et bosses, comme celle de la lune. Quand James entreprend d’emboîter son corps dans celui de la « james bond girl » de service, dans le roman suivant, la peau de celle-ci devrait croire qu’on la frotte à la paille de fer, ou à la râpe à chambre à air de vélo, suite à crevaison. En tout cas, il m’arriverait le centième de ce qu’il a subi au total, moi, je serais au moins mort, voire pire que ça.
Mais non, « the show must go on », comme chante FREDDY MERCURY quelques mois avant d’avaler son bulletin de naissance. James Bond, lui, deux minutes après être passé sous le char d’assaut, il est prêt à entrer en scène pour son récital, smoking repassé, mise en plis impeccable, lisse comme le crâne de YUL BRYNNER, propre et net comme un napoléon « fleur de coin ».
Ce qui vaut pour James Bond vaut pour tous les autres : voyez, dans Tintin en Amérique, lorsque le héros, capturé par le syndicat de gangsters de Chicago, est balancé au lac ficelé avec aux pieds d’énormes haltères qui doivent l’envoyer par le fond, et qui s’avèrent être en bois ; le drôle, c’est que Tintin lui-même semble fait de bois puisque, les mains attachées dans le dos, il est aussi flottable qu’un tronc d’arbre.
Les séries policières ? Je vais vous dire : c’est comme un coin du feu, un bon fauteuil, des pantoufles, bobonne à côté, avec Socrate le griffon Korthals, affalé sur sa carpette à somnoler goulûment après ses bambanes au grand air. Vous avez tout de suite le décor familier, les personnages familiers, les habitudes de la boutique. San Antonio appelle illico le tandem Pinuche-Bérurier, mais aussi sa « brave femme de mère », Félicie. Ce sont de solides et rassurants points de repère.
Prenez qui vous voulez, mettons Sherlock Holmes, qu’est-ce qui vous vient, là, tout de suite ? Le violon, la pipe, le chapeau, le mac farlane, le docteur Watson : voilà, c’est automatique, vous ne connaissez pas tout, mais vous reconnaissez, vous êtes en pays de connaissance. Mieux que ça, vous êtes chez vous, à la maison, au chaud. Ça fait du bien. La série policière, au fond, c’est le CONFORT BOURGEOIS pour le lecteur. La série policière est d’abord confortable.
En fait, le héros, dans la série, s’il ne lui arrive rien à lui, c’est qu’il est tout simplement immortel. Il ne peut rien lui arriver de définitif (sinon, pas de série). La preuve, c’est que ARTHUR CONAN DOYLE a même été obligé de ressusciter Sherlock Holmes, sous la pression d’un public qui tenait à son héros plus qu’à un vieux pull sentimental et nostalgique du temps de sa jeunesse, ce pull qui a suivi la déformation du corps avec l’âge (arrondissement du ventre, fléchissement du dos), et dont le corps s’est, comme qui dirait, imprégné. Le héros de série policière ne peut ni ne doit mourir avant son auteur, à moins qu’il passe de main en main (Nick Carter, assez oublié aujourd’hui), preuve supplémentaire d’immortalité.
Et s’il est immortel, je vais vous dire, c’est que le héros de série n’existe pas. Enfin pas vraiment. Pas complètement. D’ailleurs, l’auteur n’y croit pas trop lui-même. Du moins il fait semblant d’y croire. Ce qui l’intéresse, l’auteur, ce n’est pas le héros, mais la sombre et riche combinaison du coffre-fort. Car son roman, c’est comme un coffre. L’auteur, qui prend le lecteur par la main ou pour un imbécile, l’amène progressivement et méthodiquement jusqu’au moment de l’ouverture. Le héros, mis en face du coffre au début, est sommé d’avoir « cassé » la combinaison à la fin. La lourde porte s’ouvre devant les yeux haletants (oui oui !). En fait, il n’y a rien dans le coffre (« hin hin hin » , grince l’auteur sardonique, « je vous ai bien eus »).
Le héros de série, finalement, ça a juste l’existence très mince d’un ciseau à bois (ou d'une clé à pipe, ou d'un tiers-point, au choix) que l’auteur remet à sa place au tableau au-dessus de l’établi quand il a accompli sa tâche. On aura beau faire comme MANUEL VASQUEZ MONTALBAN, et donner à Pepe Carvalho, entre autres spécialités, celle d’un PAGANINI des cuisines, du « piano », du chinois et de la lèchefrite, ça ne change rien : la gastronomie intervient dans l’histoire, quoi qu’on fasse, à la manière des parenthèses dans une phrase.
Maintenant, il faut savoir que certains héros de série sévissent dans un seul récit. L’élégance expressive en vigueur aujourd’hui parle de « one shot ». Prenez La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil, de SEBASTIEN JAPRISOT. Prenez Fatale ou La Position du tireur couché, de JEAN-PATRICK MANCHETTE. Prenez Le Maître d’escrime, d’ARTURO PEREZ REVERTE. Le confort n’est pas aussi grand, mais presque, grâce parfois au jaune et noir de la couverture : c'est exprès que vous êtes entré dans cette boutique-là, vous savez que vous y trouverez l’article cherché.
Souvent, le plus marrant, dans le polar, c'est le titre. Parfois, il n'y a même que ça de drôle. Parce qu'il faut dire que les San Antonio, pendant un temps, ont été assez ratés. Mais quand vous tombez nez à nez avec Les Anges se font plumer, vous capitulez, bien sûr. Entre la vie et la morgue est une trouvaille. Ménage tes méninges n'est pas mal non plus. Mais il n'y a pas que San Antonio. Que pensez-vous de Enterrement pour Cythère (ANDRE HELENA ) ? J'aime beaucoup Mes Morts d'outre-tombe (PIERRE NEMOURS).
Bref : en peinture, il y a MICHEL-ANGE, et puis il y a mon oncle ; pour la musique, il y a BEETHOVEN, et puis il y a moi sous la douche; enfin il y a MARCEL PROUST et il y a FREDERIC DARD, pour ce qui est d'écrire des histoires. Et moi, j'ai un principe, je ne veux pas faire de jaloux. On a de la morale, ou on n'en a pas.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, moby dick, herman melville, armel guerne, georges simenon, littérature populaire, littérature policière, maigret, james bond, edgar poe, nestor burma, miss marple, hercule poirot, oss 117, commissaire adamsberg, pepe carvalho, juge ti, tintin, san antonio, sherlock holmes, arthur conan doyle, manuel vazquez montalban, sébastien japrisot, jean-patrick manchette, arturo perez reverte
mardi, 02 août 2011
QU'AS-TU FAIT DE TES FRERES ?
CLAUDE ARNAUD est l’auteur du livre qui porte ce titre. Editions Grasset, paru en 2010. Mon ami R. T. m’en avait dit grand bien. Comme c’est un vrai connaisseur, je l’ai cru. H. C., elle, a été emportée par l’enthousiasme. Littéralement. Même C. m’en a dit le plus grand bien. Il est libraire, c’est dire. Trois avis valent mieux qu’un, c’est certain. J’ai donc été convaincu que le livre était bon avant même de l’avoir ouvert.
Influencé par trois avis autorisés, je l’ai donc ouvert. J’aurais aussi bien fait de ne pas (vous savez, le célèbre « I would prefer not to » du Bartleby de MELVILLE). D’abord, qu’est-ce qui lui a pris d’appeler ça « roman » ? Le personnage principal, celui qui dit « je », s’appelle CLAUDE. Les deux frères, comme dans la vraie vie, s’appellent PIERRE ARNAUD et PHILIPPE ARNAUD. Le père, comme dans la vraie vie, s’appelle HUBERT ARNAUD.
Qu’est-ce qu’ils ont tous à étaler leur vie, celle de leurs proches, et surtout à appeler ça littérature ? Ce bouquin, c’est à la rigueur un récit de vie, récit autobiographique, ça va de soi. Mais pas un roman. Est-ce même de la littérature ? Pas sûr. J’en ai assez de la « littérature » française contemporaine. J’avais fait confiance au prix Goncourt, attribué en 1996 à Le Chasseur zéro, d’une certaine PASCALE ROZE. Une épouvantable nullité littéraire. Ce fut la dernière fois.
J’ai feuilleté MARIE DARRIEUSSECQ, CAMILLE LAURENS, CHRISTINE ANGOT et quelques autres. Même AMELIE NOTHOMB me « thombe » des mains. C’est moi qui dois être trop difficile. Parlez-moi de Moby Dick : je grimpe au rideau illico ! Au-Dessous du volcan, je plonge. Ulysse, je m’enflamme. Parlez-moi de littérature, enfin, ça marche.
La question qui se pose est : comment des livres nuls sont-ils achetés en masse ? « Nuls », pour moi, c’est le plat récit autobiographique de quelqu’un de peu intéressant qui trouve intéressant de raconter sa pauvre vie. « Nuls », c’est aussi le livre fabriqué selon un recette de cuisine bien huilée (ou bien beurrée, si vous préférez), comme sait si bien faire le cuisinier MARC LEVY. Pourquoi des masses de lecteurs se ruent-ils pour remplir le compte en banque de ce genre d’ « écrivain » ? Ce sont peut-être les mêmes qui regardent la télévision, allez savoir ?
Je renvoie au livre de PIERRE JOURDE et ERIC NAULLEAU : Le Jourde et Naulleau, Mango éditeur, 2008, pour les autres têtes de turc à démolir. Les auteurs alignent très correctement les gens cités précédemment, et ajoutent à la liste PHILIPPE SOLLERS et BERNARD-HENRI LEVY, ALEXANDRE JARDIN et MADELEINE CHAPSAL, et quelques autres. J’avais beaucoup aimé quelques livres du père JARDIN, PASCAL. Mais le style n’est pas dans les gènes.
Le problème actuel de la littérature en France, ou plutôt de sa diffusion, c’est la confusion des trois acteurs : écrivain, éditeur, critique littéraire. Et je ne parle pas de la « politique éditoriale », qui va au plus rentable. L’écrivain est souvent directeur de collection chez un éditeur. Le « critique » est souvent écrivain. Enfin, dans ce petit monde, qui fonctionne un peu comme le peloton du tour de France, sur base d’OMERTA et de service rendu, tout le monde sert la soupe à tour de rôle aux autres. Ils se tiennent tous par la barbichette.
En fait, ce qui manque à tous ces gens qui règnent, au moins médiatiquement, sur la littérature en France, c’est bien sûr le STYLE. Alors, peut-être est-ce tout à fait délibéré et volontaire de la part de CLAUDE ARNAUD, mais son récit est linéaire, chronologique, et les faits s’y succèdent selon le principe de l’absence de structure que constitue la juxtaposition des faits. Si l’auteur cherchait la platitude du style, alors son entreprise est couronnée de succès.
Alors maintenant, qu’est-ce que ça raconte ? En gros, les ravages accomplis sur toute une famille par les « événements » de mai 1968 et la suite. Le père est « à l’ancienne » (ça veut dire rigide, voire ringard). La mère, tiens, j’ai déjà oublié la figure de la mère. Pierre, l’aîné, est une « tête » brillantissime promise au plus brillant avenir. Philippe, c’est l’aventurier de la famille qui aura parcouru le monde en envoyant des « cartoline » à la famille « par à-coups ». Claude se définit lui-même comme un « Gavroche planant ».
Pierre, l’ « aventurier mental », finira mal, après avoir troqué les bibliothèques savantes pour des squats de plus en plus miteux, dans une espèce de long suicide social, qui deviendra suicide personnel du deuxième étage de l’hôpital psychiatrique où il a échoué. Philippe, le « penseur global », finira mal, lors d’une baignade où il se noie mystérieusement. Voilà pour l’explication du titre du bouquin. Mais même le père et la mère finissent par mourir ! Etonnant, non ? Qu’as-tu fait de ton père et de ta mère ?
Quant à Claude, il découvre la vie avec exaltation, et va goûter à tous les râteliers. Le râtelier sexuel d’abord, qui le conduit dans tous les lits possibles et imaginables, où il joutera avec les garçons et les filles, mais de préférence les garçons, si j’en juge par le nombre de pages (voir le chapitre « La chanson de Roland »). Le râtelier politique, évidemment, qui le conduit des trotskistes à la Gauche Prolétarienne, dont il vend la propagande sur les marchés. Le râtelier culturel et intellectuel, enfin, avec toutes les modes de l’époque.
Tout cela est exposé sérieusement, comme transcrit d’un journal tenu au jour le jour, et, je crois, honnêtement. Pour quelqu’un né au milieu des années 1950, il peut être rigolo de retrouver l’ambiance d’une période qui a marqué les esprits, de même que les vrais noms dont on parlait dans les années 1970 : ROLAND BARTHES, JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, FREDERIC MITTERRAND et un certain nombre d’autres. Voilà, s’il vous manque un « tableau » de ce que furent mai 1968 et la suite, ce livre est fait pour vous.
Mais s’il vous faut un livre vraiment « écrit », passez votre chemin. C’est le gros reproche que je lui fais. Ce n’est donc certainement pas un « roman ». Je dirais presque que ce n’est même pas un « récit ». Ce serait plutôt le « compte-rendu » établi au cours même de la réunion du conseil d’administration par le secrétaire de séance. Reste la photo du bandeau, rigolote finalement, où l’on voit un homme souriant couché en travers des rails, mais rassurez-vous, la voie est désaffectée et l’herbe folle passe abondamment le nez à travers le ballast.
Maintenant, un question reste : pourquoi ce livre a-t-il été publié ? Première hypothèse : il dessine les traits d'une époque (mai 1968 et après) que NICOLAS SARKOZY a mise à la mode, et c'est ce tableau qui attire le lecteur avide de se faire une idée de ce qu'elle fut, voire de se replonger dans une ambiance qu'il a lui-même connue de près ou de loin.
Deuxième hypothèse : je note le tir groupé que forme la publication quasi-simultanée de plusieurs livres traitant approximativement du même sujet. Il y a d'abord le livre de MATHIEU LINDON, Ce qu'Aimer veut dire, que je n'ai pas lu, et où il raconte, paraît-il, son "amitié" passionnée avec le philosophe MICHEL FOUCAULT, dans son appartement de la rue de Vaugirard.
Il y a ensuite le livre de JEAN-MARC ROBERTS, François-Marie, où l'auteur s'adresse à son "ami" FRANÇOIS-MARIE BANIER, pour prendre sa défense. Même si celui-ci n'a jamais pu coucher avec celui-là, ils "fréquentaient main dans la main les boîtes gays de la rue Sainte-Anne" (site bibliobs).
Le tir groupé en question, le voilà : les années 1970 ont été celles de la fin du tabou homosexuel. Cela n'invalide pas du tout la première hypothèse. En fait, elles se télescopent. La mode, aujourd'hui, est à la "gay pride". J'ajoute que le Nouvel Observateur désigne JEAN-MARC ROBERTS comme un "membre influent" du milieu littéraire parisien (c'est-à-dire français).
Il convient donc que cela se sache : la "communauté homosexuelle" a désormais pignon sur rue, et sans doute pas seulement dans le milieu littéraire. Et ce n'est pas monsieur PIERRE BERGÉ qui me contredira.
09:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude arnaud, littérature, société, mai 1968, herman melville, prix goncourt, darrieussecq, camille laurens, christine angot, amélie nothomb, moby dick, au-dessous du volcan, ulysse, marc lévy, jourde et naulleau, philippe sollers, bernard-henri lévy, alexandre jardin, roland barthes, homosexuels, gays

