jeudi, 26 mars 2015
BERTRAND REDONNET, AUTEUR
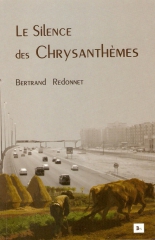 2/2
2/2
La place qu’occupe Bertrand dans la fratrie est une place à part. Au milieu de ces « manards » que sont ses frères, futurs artisans, ouvriers ou paysans, il fait figure d’ « intello », il passe du temps à lire et à écrire. L’auteur consacre des pages parfois ferventes aux relations étroites qu’il entretient et cultive avec ces deux activités, et rend hommage à l’instituteur qui lui a montré « le chemin à suivre » et qui lui permet, en se retournant sur son parcours d’affirmer : « … J’ai toujours eu l’impression de n’obéir qu’à moi-même » (p. 89). Autrement dit : c'est à l'école qu'on apprend la liberté individuelle : bel éloge de l'école d'avant l'effondrement.
Bertrand Redonnet retrace quelques scènes de cette vie campagnarde d’avant la mécanisation de l’agriculture et des hommes qui la font (le cochon, le repas familial, les relations avec les voisins, l’entraide au moment des travaux). Il évoque surtout cette vie de liberté en contact direct avec les éléments et la nature, avec ses côtés aventureux à l’occasion, avec ses bambées dans les chemins, ses grimpées aux arbres, bref, l’enfance insouciante et banale de tous ceux qui ont eu la chance de connaître ce monde et qui ont du mal à considérer la modernisation autrement que comme un saccage.
Pas de nostalgie pour autant : constater que les conditions d’existence se sont appauvries, enlaidies et compliquées, ça ne se réduit pas à regretter « le bon vieux temps ». Déplorer l’état de la réalité qui nous est faite n’a rien à voir avec le refrain : « C’était mieux avant ». Tout dépend de l’attitude. Celle de l’auteur fait une bonne place à la réflexion sur le monde comme il va mal. La colère face à ce que les hommes du présent font du monde et de l'humanité ne se réduit pas à la nostalgie pour le paradis perdu, l'enfance, le temps passé.
Certains épisodes retiennent l’attention, drôles ou plus dramatiques. Les frères qui se fabriquent un radeau "insubmersible" pour naviguer sur la rivière voisine ; l’auteur qui se fait prendre par les gendarmes avec la boîte d’allumettes dans la poche, après qu’une meule de foin a brûlé, acte qui plonge la mère dans la honte et fait passer le gamin pour dangereux auprès de tout le monde ; le séjour au pensionnat, avec la première autorisation de sortie accordée le jour de la Toussaint, qui donne son titre au livre (p. 71).
Là où l’auteur établit une sorte de cousinage avec le lecteur que je suis, c’est dans la référence à Georges Brassens, constante, souvent signalée comme telle, mais souvent aussi plus indirecte et souterraine, au travers de citations plus ou moins explicites, mais pas toujours. La première, par exemple : « Il est à la fois aurore et crépuscule et son hymen avec les ténèbres lui est promis dès le premier souffle » (p. 16). Ceux qui ne connaissent pas « Oncle Archibald » n’y verront que du feu (« Et notre hymen à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême »).
On trouve encore « Erreur on ne peut plus funeste » (L’orage, p. 24) ; « un arbre " nullement de métier" » (Le grand chêne, p. 43) ; « j’abandonnai la partie, mais "sur le chemin du Ciel ne feignis plus jamais de faire un pas" » (Le mécréant, p. 69) ; « Le cœur serré, j’espère que le croque mort qui t’a emporté a eu l’infinie bonté de te conduire à travers Ciel, au Père éternel ou ailleurs » (L’auvergnat, p. 78, bel hommage au frère mort, qui m’a touché pour une raison personnelle voisine) ; « ... et je n'en souffre pas avec trop de rigueur » (La tondue, p. 178) ; « champ de navets » (Le vieux Léon, p. 140).
J’arrête là : je n’en finirais pas. J'ajoute quand même que Redonnet a écrit un Georges Brassens, poète érudit, ce qui explique la présence du chanteur dans le récit, en filigrane, mais aussi en personne, un peu partout. Disons-le : sans avoir étudié la question au même degré, je me suis trouvé en pays de connaissance. Comme l'auteur, je suis du genre à suer du Brassens par tous les pores de la mémoire.
Chacun des quinze chapitres qui composent le livre de Bertrand Redonnet est construit selon le principe musical du contrepoint (ou contre-chant, et pourquoi pas contrechamp), et se clôt sur un personnage récurrent : un lundi, jour de marché, un « colosse moustachu » fait irruption dans l'écurie où le gamin attend on ne sait trop quoi, et lui demande s’il a des cordes parce que, dit-il, il va acheter des volailles au marché. Je ne dirai rien de la façon dont s’achève cette série de quinze « flashes », juste du choc, efficace et brutal, qu’elle produit.
La prose de Bertrand Redonnet est d’une belle simplicité, travaillée sans affectation, souvent poétique, et donne de la saveur à cette visite dans la campagne poitevine. L’auteur ne déteste pas les régionalismes qui lui reviennent : métives, détervirer, … même si je n’approuve pas des expressions comme « litornes aux abois » (p. 71) ou « des mouches et des taons vampirisés » (p. 50). Ce qui domine, c'est la prose ample. Je recommande les premiers chapitres, particulièrement inspirés.
A lire Le Silence des chrysanthèmes, je n’ai vraiment pas perdu mon temps. Merci, monsieur Redonnet.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature française, bertrand redonnet, autobiographie, nostalgie, éditions du bug, georges brassens, oncle archibald, chanson, le grand chêne, le mécréant, l'auvergnat, georges brassens poète érudit, le silence des chrysanthèmes
mercredi, 25 mars 2015
BERTRAND REDONNET, AUTEUR
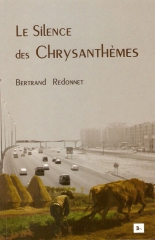
1/2
En même temps qu’elles faisaient paraître La Queue, de Roland Thévenet (voir ici même les 19 et 20 mars), les éditions du Bug publiaient, de Bertrand Redonnet, Le Silence des chrysanthèmes (site et blogs à visiter).
Le curieux de ces sorties simultanées, c’est qu’elles ne sont pas sans parenté thématique, même si le premier opte pour la fiction romanesque alors que le second offre un récit de vie.
Dans l’un comme dans l’autre, ce qui porte l’inspiration a quelque chose à voir avec la filiation paternelle et les origines. Thème : quand le père commence à merder (ou disparaître). Dans le livre de Thévenet, le premier (et l’unique, finalement) père de Félix Sy est Guillaume, le prêtre qui a accepté d’en assumer la garde.
Le magnifique logo des éditions du Bug.
Je conseille en passant aux éditions du Bug, pour leurs futures parutions, de lui donner une visibilité digne de sa qualité esthétique (voir plus haut, et rendu méconnaissable dans l'agrandissement ci-dessous).

Chez Redonnet, le père est le grand absent : « Nous sommes de la diaspora des orphelins et, loin de nous en dépiter, nous nous en nourrissons. – J’ai ainsi eu des centaines de pères » (p. 88). Je m’incline en passant devant la superbe formule « la diaspora des orphelins » : Bertrand Redonnet montre à mainte reprise qu’il possède à l’état aigu le sens du poétique, mieux : du véridique.
De même il dit ailleurs : « J’ai pourtant grandi sans épaules paternelles où déposer mes peurs ». Ça, c'est pour les peurs. Pour les pleurs, il faut l’épaule de la mère, à condition que celle-ci veuille bien les recevoir, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Et pour en finir avec ce thème : « Œdipe facétieux, j’avais éliminé une absence en tuant un père en jupe ».
Cela dit, on n’est pas forcé d’apprécier la référence à l’auteur de la théorie œdipienne, mais bon, qu’il soit entendu qu’on ne tue que rarement le père réel, même si beaucoup en ont rêvé. Il faut croire qu’on a besoin de lui, puisque ceux qui ne l’ont pas connu s'en inventent un capable de remplacer valablement la pièce manquante. Mais tout le monde sait que c'est peine perdue. Il reste que, dans Le Silence des chrysanthèmes, l’absence du père est omniprésente. On peut même dire : l’absence du père prend toute la place qu’il a laissée vacante en disparaissant. Et finit par vous éclater au visage.
Même si le lecteur comprend que le narrateur-auteur est exilé (il tient un blog d'ailleurs intitulé "L'exil des mots") en Pologne, non loin de la frontière orientale, l’essentiel se passe dans le Poitou profond, avant la « Grande Modernisation ». On est dans une ferme à l’ancienne. La mère, sans être présentée comme une « fille à tout le monde » (Brassens, La mauvaise herbe), a fait ses nombreux enfants (seulement des garçons, au nombre de sept) avec différents hommes.
Mais les enfants sont une matière éminemment plastique : ils sont les seuls à prendre la vie « comme elle vient ». C'est ensuite qu'il leur prend l'idée de la corriger, voire de la refaire. Pour eux, le monde ressemble à ce que leur font vivre leurs parents. Les problèmes commencent quand celui des enfants en diffère par trop.
Entre parenthèses, je me demande si l'avenir n'est pas en train de fabriquer des enfants qui seront, non plus "autres" que leurs parents, ce qui est, somme toute, la réalité historique depuis longtemps, mais qui leur seront de plus en plus "étrangers". Il n'y a pas de raison pour que le processus s'interrompe. A celui de l'origine et de la filiation, s'ajoute désormais le problème de la transmission. C'est logique.
Le monde des parents est en train de devenir, aux yeux des enfants, un paysage exotique, vaguement écœurant, dont ils sont en passe de préférer ignorer qu'il a pu exister. Osons le mot : qui est en train de perdre toute existence et toute validité à leurs yeux.
Et qu'on ne me dise pas « Il en a toujours été ainsi ». Ce faux argument n'est que le moyen pathétique (« Tout est dans tout et réciproquement. ») de tous ceux qui refusent de regarder en face ce que toutes les époques présentes ont toujours eu de fondamentalement spécifique, caractéristique, unique, original.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, éditions du bug, roland thévenet, la queue roman, le silence des chrysanthèmes, bertrand redonnet, georges brassens
mardi, 17 février 2015
MOBY DICK
2/2
Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre de la littérature ?
Je parlais hier de l'incroyable personnage de Quiequeg inventé par Herman Melville.
Le personnage d’Ismahel (le narrateur) occupe une place beaucoup moins nette. Au début du livre, il raconte « simplement » ce qui lui arrive : son arrivée à New Bedford, puis sa traversée vers Nantucket, son arrivée et son séjour à la « Taverne du Souffle », sa rencontre étonnante et son étrange cohabitation avec Quiequeg, son embarquement sur le Pequod, embauché par les armateurs Bilbad et Peleg, anciens capitaines eux-mêmes, tout cela le place sur le devant de la scène.
On le retrouvera à la toute fin, parce qu’il faut quand même un rescapé pour raconter l’histoire. Entre les deux, c’est-à-dire dans cent vingt-trois des cent trente-cinq chapitres, il se fait un narrateur polyvalent et effacé, capable de faire parler successivement tous les personnages. Je dois dire que le lecteur ne prête aucune attention à ce détail : tout coule de source.
Il faut faire un sort particulier, au début, au prêche que le père Mapple adresse du haut de sa chaire en forme de proue de navire (dont il retire soigneusement l’échelle de coupée une fois arrivé en haut), aux fidèles rassemblés dans la petite église. John Huston, pour son film Moby Dick (1956) ne pouvait pas choisir de meilleur père Mapple qu’Orson Welles. Le sermon vaut, en portée littéraire, morale, philosophique, la fiction poétique connue, dans Les Frères Karamazov, sous le titre « Le Grand Inquisiteur » : quel souffle !
On ne résume pas Moby Dick. On garde en mémoire quelques scènes particulières. La fable de Jonas dans le ventre du grand poisson, dans la flamboyance de sa restitution par le père Mapple en fait partie. La harangue d’Achab à son équipage, au chapitre 36, en est une autre.
Il fait jurer à tous de tout donner pour en finir avec le grand cachalot blanc (« … jurez la mort de Moby Dick ! »), en promettant à celui qui le signalera le doublon d’or de l’Equateur qu’il a incrusté à coups de masse dans le bois du grand mât, harangue dont la phrase maîtresse est sans doute cette question arrogante et impie : « Qui est donc au-dessus de moi ? », lancée à la face de Dieu et des hommes.
Seul maître à bord après lui-même, donc. Lui seul, Achab, maître de trente destins qu’il préfère conduire à l’abîme plutôt que de supporter encore l’humiliation infligée naguère par le géant des mers, cet albinos immense comme un monde, féroce et sournois, à qui il doit de boiter sur son tibia d’ivoire, et dont les autres capitaines (des gens normaux, eux, excepté le commandant de la "Rachel", qui y perdra ses deux fils) s’écartent prudemment de la route tant est sulfureuse la réputation diabolique de la baleine.
L’aspect le plus déroutant du livre est à mon avis l’effort d’encyclopédiste auquel s’adonne le narrateur, le seul qui ait survécu au naufrage. L’immersion dans le gigantesque corps du cachalot a beau s’étendre sur vingt chapitres et au-delà, j’avoue que j’ai gobé tout ça sans sourciller, et même avec gourmandise.
Herman Melville fait découvrir au lecteur l’invraisemblable succession de chefs d’œuvre de la nature qui forment l’infinité des couches (de l'épiderme jusqu'à l'intestin) enveloppant l’énormité stupéfiante du mystère que constitue le cachalot, de par son existence seule. L'être du cachalot est en soi un défi à l'imagination. On saura tout (non, pas tout) de son évent unique, de ses yeux minuscules, de la matière incroyable (le spermaceti) que recèle la fabuleuse citerne qui lui sert de proue (voire de bélier), à la conquête de laquelle se résume presque l’entièreté de la « chasse à la baleine ». Je n’insiste pas.
Melville fait aussi découvrir – comme personne ne l’a fait, je crois – l’extraordinaire dureté du métier de marin sur un navire baleinier au temps de la marine à voile : entre les manœuvres dans les vergues et les haubans, les coups de rames qu’il faut donner pour prendre de vitesse le cachalot et ne pas lui laisser le temps de fausser compagnie, et le travail d’amarrage du « poisson » contre le bord et son dépeçage, jusqu’à la récolte de la précieuse huile, dont les fûts finissent parfois par envahir le pont, le marin n’a jamais fini. On comprend qu’il faille des hommes à toute épreuve.
Impossible de faire le tour de Moby Dick : le livre déborde de tous côtés, et ce n’est pas en tirant un seul fil qu’on en finirait. Il faudrait mentionner la puissance avec laquelle sont dessinés les personnages principaux, chacun apparaissant doté d’un monde intérieur qui n’appartient qu’à lui. Il faudrait reparler de Quiequeg et de son « cercueil », qui servira de loch au navire après la destruction de l’original, et de bouée de sauvetage à Ismahel. On ne saurait décréter qu’on en a fini.
Plutôt relire le livre.
Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre de la littérature ? C’est Moby Dick.
Voilà ce que je dis, moi.
*************************************************
Je signale aux amateurs de livres que les éditions du Bug, fondées en 2014, viennent de faire paraître en janvier :
1 - Roland Thévenet : La Queue.
2 - Bertrand Redonnet : Le Silence des chrysanthèmes.
On peut contacter les éditions du Bug en passant par le blog Solko, ou par le blog L'exil des mots.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, herman melville, moby dick, nantucket, navire baleinier, baleinière, pequod, capitaine achab, orson welles, john huston, les frères karamazov, le grand inquisiteur, dostoïevski, père mapple, roland thévenet, bertrand redonnet, solko, les éditions du bug

