mardi, 26 mai 2015
« POSSÉDÉS » ou « DÉMONS » ?
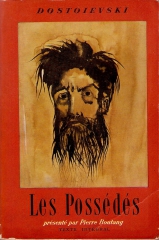 1/2
1/2
J’ai toujours entretenu une relation ambivalente avec Fédor Dostoïevski, échaudé vers l'âge de quatorze ans par des tentatives infructueuses dans L'Eternel mari et Le Joueur. Il a fallu du temps : rien de tel que l'étude de Cinna en classe de cinquième pour vous dégoûter durablement de Corneille. Et puis un jour, j’ai eu la chance de découvrir Les Frères Karamazov, qui m’avait transporté très loin et très haut. Si j’avais commencé par L’Idiot ou Crime et châtiment, je n’aurais probablement pas donné suite à l’invitation.
J’ai en effet laissé tomber L’Idiot à la page 454 (sur 751, édition Pléiade), pour dire que j'ai insisté. J’ai abandonné le prince Mnichkine en pleines parlotes. Crime et châtiment, c’était à la page 378 (sur 761, éditions Garnier), pour l’exacte même raison : des causettes interminables en cercles plus ou moins larges, dans des lieux plus ou moins confinés, voire inconfortables.
Après avoir achevé Les Possédés, œuvre qui recèle quelque chose de prodigieux, même si j’ai du mal à situer ce prodigieux-là, je me dis que la « parlote » n’est pas forcément un vice rédhibitoire dans un roman. Mais je devrais plutôt parler de « conversations ». Il m'appert même l'éventualité que la conversation ait été érigée par Dostoïevski en système romanesque à part entière.
Dostoïevski, je vais vous dire : c’est très spécial. Le lecteur est obligé de découvrir les faits, les situations, les relations à travers les yeux, la bouche et les oreilles de chacun des personnages. S’il veut saisir de quoi il est question, le lecteur doit endosser complètement un nouveau rôle à chaque changement d’interlocuteur, à travers les propos que les uns et les autres tiennent, au gré des circonstances. Une sacrée gymnastique : une nouvelle personnalité, sans même savoir de quoi celle-ci est faite, comme si vous changiez en permanence d'yeux, de cerveau, d'identité. Le récit à la troisième personne est réduit à la portion congrue.
L’auteur se garde bien d’expliquer quoi que ce soit, il embarque le lecteur dans une incroyable succession de points de vue spécifiques et de subjectivités embrouillées, souvent exaltées, ambiguës et contradictoires, toujours possédées par une passion inintelligible à la première approche. Comme une pièce de théâtre écrite dans une langue qu'ignore le spectateur, à qui l'auteur dirait : débrouille-toi. Sans sur- ou sous-titrage.
Disons-le, sur les 350 premières pages (la moitié), le sujet du livre reste dans un brouillard savamment entretenu. Ce n’est pas pour rien qu’on lit dans une notice consacrée au bouquin : « Aucune œuvre de Dostoïevski n’est plus difficile à lire que celle-ci, par la confusion et l’obscurité qui enserrent tous les personnages ».
Dostoïevski adopte une convention narrative complexe : c’est à force de s’emmêler dans les confrontations et interactions orales entre les personnages que le lecteur chemine vers la compréhension des caractères, des relations, des projets et intentions des uns et des autres. Le narrateur, qui s’affiche comme simple « chroniqueur » (sous le nom de « G…v »), se contente de témoigner de ce qu’il a vu, entendu, compris, même s’il lui arrive, comme n'importe quel ethnologue dans son enquête chez les Rakotofiringa ou les Pitjantjatjara, de pratiquer l’ « observation participante ».
Attention, ça ne l’empêche pas d’être bizarrement très au fait de tout un tas de détails concernant des événements auxquels il n’a carrément pas pu assister, et que nul n'a pu lui rapporter. Ainsi, comment s’y prend-il pour raconter dans le moindre détail l’assassinat de Chatov, qui n’a eu aucun autre témoin que la demi-douzaine de participants ? Ce n’est à coup sûr à aucun d’eux (Liamchine, Lipoutine, Piotr Stepanovitch, Virguinski, Chigaliov …) que serait venue l’idée de tout lui révéler. Disons que c’est tellement bien fait que le lecteur n’y voit que du feu, et gobe tout sans se poser de questions.
Il y a deux livres dans Les Possédés : la première moitié offre la peinture de la vie ordinaire et quotidienne d’une ville de la campagne russe, une ville dont on ne sait pas grand-chose de la taille ni de la distance qui la sépare de Pétersbourg, et où s’agitent un certain nombre de personnages plus ou moins oisifs qu’on verra en action dans la deuxième moitié. Leur occupation principale semble être de se rendre les uns chez les autres pour parler.
Chacun de ces personnages, à commencer par Stépane Trophimovitch Verkhovensky, intellectuel paresseux et parasite qui vit aux dépens de Varvara Pétrovna, riche veuve Stavroguine, est un peu fêlé, bizarre à sa façon, animé d’un déséquilibre qui lui appartient en propre, comme un trait d’identité. Tous se ressemblent sur un point : la médiocrité, qui confine en plus d’une occasion à la niaiserie et au ridicule.
Cette partie est pour l’essentiel énigmatique : on se demande où ça va. La deuxième moitié fonctionne donc à la manière d’un dévoilement, bien que le lien de nécessité entre les deux soit pour le moins évanescent. Sous les tensions, les désirs, les haines et les hypocrisies, on comprend que le masque des conventions et des rapports sociaux cachait une partie humainement âpre, qui trouve ses origines dans le passé et à l’étranger. Plusieurs des personnages ont séjourné, jadis ou naguère, aux Etats-Unis, en Suisse, à Berlin. Ce qu’ils y ont fait n’est évoqué que pour créer autour d’eux un climat de suspicion ou d’incertitude.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, dostoïevski, les possédés, les démons, les frères karamazov, crime et châtiment, l'idiot, prince mnichkine, stavroguine, verkhovensky, le joueur, l'éternel mari, corneille cinna
mardi, 17 février 2015
MOBY DICK
2/2
Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre de la littérature ?
Je parlais hier de l'incroyable personnage de Quiequeg inventé par Herman Melville.
Le personnage d’Ismahel (le narrateur) occupe une place beaucoup moins nette. Au début du livre, il raconte « simplement » ce qui lui arrive : son arrivée à New Bedford, puis sa traversée vers Nantucket, son arrivée et son séjour à la « Taverne du Souffle », sa rencontre étonnante et son étrange cohabitation avec Quiequeg, son embarquement sur le Pequod, embauché par les armateurs Bilbad et Peleg, anciens capitaines eux-mêmes, tout cela le place sur le devant de la scène.
On le retrouvera à la toute fin, parce qu’il faut quand même un rescapé pour raconter l’histoire. Entre les deux, c’est-à-dire dans cent vingt-trois des cent trente-cinq chapitres, il se fait un narrateur polyvalent et effacé, capable de faire parler successivement tous les personnages. Je dois dire que le lecteur ne prête aucune attention à ce détail : tout coule de source.
Il faut faire un sort particulier, au début, au prêche que le père Mapple adresse du haut de sa chaire en forme de proue de navire (dont il retire soigneusement l’échelle de coupée une fois arrivé en haut), aux fidèles rassemblés dans la petite église. John Huston, pour son film Moby Dick (1956) ne pouvait pas choisir de meilleur père Mapple qu’Orson Welles. Le sermon vaut, en portée littéraire, morale, philosophique, la fiction poétique connue, dans Les Frères Karamazov, sous le titre « Le Grand Inquisiteur » : quel souffle !
On ne résume pas Moby Dick. On garde en mémoire quelques scènes particulières. La fable de Jonas dans le ventre du grand poisson, dans la flamboyance de sa restitution par le père Mapple en fait partie. La harangue d’Achab à son équipage, au chapitre 36, en est une autre.
Il fait jurer à tous de tout donner pour en finir avec le grand cachalot blanc (« … jurez la mort de Moby Dick ! »), en promettant à celui qui le signalera le doublon d’or de l’Equateur qu’il a incrusté à coups de masse dans le bois du grand mât, harangue dont la phrase maîtresse est sans doute cette question arrogante et impie : « Qui est donc au-dessus de moi ? », lancée à la face de Dieu et des hommes.
Seul maître à bord après lui-même, donc. Lui seul, Achab, maître de trente destins qu’il préfère conduire à l’abîme plutôt que de supporter encore l’humiliation infligée naguère par le géant des mers, cet albinos immense comme un monde, féroce et sournois, à qui il doit de boiter sur son tibia d’ivoire, et dont les autres capitaines (des gens normaux, eux, excepté le commandant de la "Rachel", qui y perdra ses deux fils) s’écartent prudemment de la route tant est sulfureuse la réputation diabolique de la baleine.
L’aspect le plus déroutant du livre est à mon avis l’effort d’encyclopédiste auquel s’adonne le narrateur, le seul qui ait survécu au naufrage. L’immersion dans le gigantesque corps du cachalot a beau s’étendre sur vingt chapitres et au-delà, j’avoue que j’ai gobé tout ça sans sourciller, et même avec gourmandise.
Herman Melville fait découvrir au lecteur l’invraisemblable succession de chefs d’œuvre de la nature qui forment l’infinité des couches (de l'épiderme jusqu'à l'intestin) enveloppant l’énormité stupéfiante du mystère que constitue le cachalot, de par son existence seule. L'être du cachalot est en soi un défi à l'imagination. On saura tout (non, pas tout) de son évent unique, de ses yeux minuscules, de la matière incroyable (le spermaceti) que recèle la fabuleuse citerne qui lui sert de proue (voire de bélier), à la conquête de laquelle se résume presque l’entièreté de la « chasse à la baleine ». Je n’insiste pas.
Melville fait aussi découvrir – comme personne ne l’a fait, je crois – l’extraordinaire dureté du métier de marin sur un navire baleinier au temps de la marine à voile : entre les manœuvres dans les vergues et les haubans, les coups de rames qu’il faut donner pour prendre de vitesse le cachalot et ne pas lui laisser le temps de fausser compagnie, et le travail d’amarrage du « poisson » contre le bord et son dépeçage, jusqu’à la récolte de la précieuse huile, dont les fûts finissent parfois par envahir le pont, le marin n’a jamais fini. On comprend qu’il faille des hommes à toute épreuve.
Impossible de faire le tour de Moby Dick : le livre déborde de tous côtés, et ce n’est pas en tirant un seul fil qu’on en finirait. Il faudrait mentionner la puissance avec laquelle sont dessinés les personnages principaux, chacun apparaissant doté d’un monde intérieur qui n’appartient qu’à lui. Il faudrait reparler de Quiequeg et de son « cercueil », qui servira de loch au navire après la destruction de l’original, et de bouée de sauvetage à Ismahel. On ne saurait décréter qu’on en a fini.
Plutôt relire le livre.
Qu’est-ce qu’un chef d’œuvre de la littérature ? C’est Moby Dick.
Voilà ce que je dis, moi.
*************************************************
Je signale aux amateurs de livres que les éditions du Bug, fondées en 2014, viennent de faire paraître en janvier :
1 - Roland Thévenet : La Queue.
2 - Bertrand Redonnet : Le Silence des chrysanthèmes.
On peut contacter les éditions du Bug en passant par le blog Solko, ou par le blog L'exil des mots.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, herman melville, moby dick, nantucket, navire baleinier, baleinière, pequod, capitaine achab, orson welles, john huston, les frères karamazov, le grand inquisiteur, dostoïevski, père mapple, roland thévenet, bertrand redonnet, solko, les éditions du bug
samedi, 01 mars 2014
AUX CHIOTTES LES NORMES !
AUX CHIOTTES LES STEREOTYPES
Plus les progrès sociétaux font rage, plus les gens sont autorisés à donner libre cours à leurs moindres caprices, à leurs plus petites sautes d’humeur, à leurs « orientations » (si vous voyez ce que je veux dire) les plus déviantes, plus les points de repère hérités du passé sont jetés aux orties, bref, plus les « normes » en vigueur dans la toujours déjà trop vieille société sont battues en brèche, plus les gens semblent paumés, perdus, désorientés, en proie au doute sur ce qu’il leur convient de faire. En gros, plus la porte s’ouvre grand sur les anciens interdits devenus licites, plus les gens sont angoissés.
Le plus drôle (si l’on veut) dans l’affaire, c’est que tout le monde fait semblant de s’en étonner. Abattez les barrières, nous clame-t-on sans cesse dans les oreilles, abolissez les frontières, faites disparaître ce qui sépare, à commencer par les différences entre les sexes. Cultivez ce qui rapproche les êtres humains. Devenez tolérants. Jeunes, mettez-vous en « coloc » avec une mamie du quatrième âge. Presque pas de contrainte : juste sortir deux fois par jour la faire pisser au caniveau. Epousez un chien abandonné. Dieu vous le rendra et merci pour tout.
Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve l’air ambiant de plus en plus irrespirable. Parce que mine de rien, on commence à discerner à quoi ressemblera « le meilleur des mondes ». D’un côté, des individus qui ne doivent plus aucun compte à qui que ce soit d’aucun de leurs désirs (et, excepté la pédophilie, bientôt de leurs actes ?), qui ont jeté par-dessus les moulins toutes les bornes et toutes les limites autrefois imposées à leur moi devenu tout-puissant.
De l’autre, à mesure que monte en intensité l’angoisse qui accompagne nécessairement cette « libération », la pullulation de gourous de toutes sortes, la prolifération de toutes sortes de vermines et de charlatans qui se font appeler « consultants », « coaches », « guides ». Il y en a pour tout, il suffit pour s’en rendre compte d’aller mettre le nez dans les immenses rayons que la FNAC consacre au « développement personnel » : terrifiante épreuve, mais révélatrice de l’état de délabrement moral dans lequel vivent un nombre considérable de nos contemporains.
Des « coaches », il y en a des engeances multiples, avec chacun sa spécialité : pour se remettre au sport après une longue interruption, pour se nourrir, pour éduquer ses enfants (il semblerait que les jeunes générations ne sachent plus comment on fait), pour mieux se conduire dans l’existence, pour trouver le partenaire sexuel qui vous conviendra le mieux, pour « gérer » votre « agenda » de façon à concilier tous les aspects de votre personnalité, aussi contrastés soient-ils.
Ce que je tire de ces étonnants cocktails, qu’on appelle le « métissage » ou la « créolisation » de l’espèce humaine, c’est que plus l’individu devient libre, autonome et détaché de tous les liens sociaux « archaïques », plus il devient irresponsable de ce qu’il est et de ce qu’il fait. Cet improbable paradoxe est en passe de devenir une loi, bientôt en vigueur dans la « nouvelle société ».
Plus l’individu pourra faire ce que ses désirs intimes lui dictent, plus il sera dans le brouillard pour ce qui est de sa propre existence, et dès lors contraint de s’en remettre, perdu au milieu de nulle part, aux cornes de brume de tous les charlatans de bazar qui se précipiteront à son secours, moyennant finance.
Quel Vincent Peillon refondateur d'école (laissez-moi pouffer) rendra obligatoire d'apprendre par cœur le cinquième chapitre de la deuxième partie des Frères Karamazov de Dostoïevski ? Ce serait pourtant urgent et nécessaire. Si si, vous vous rappelez sûrement ce "poème" qu'Ivan Fédorovitch raconte à son frère Aliocha. Imaginant que Jésus est revenu sur terre, il fait parler ce personnage grandiose appelé « Le Grand Inquisiteur ».
S'adressant à Jésus, qu'il a fait emprisonner : « Tu n'avais pas le droit de revenir », lui lance-t-il (je cite en substance), développant ensuite l'extraordinaire parabole inventée par Dostoïevski sur le thème de la peur induite par la liberté humaine et sur le besoin irrépressible des individus d'être pris en charge et débarrassés de la responsabilité d'avoir à choisir pour soi et décider en permanence.
Quand je vois la croissance exponentielle du nombre des « conseillers » de vie, je suis obligé d'admettre qu'il a raison. Je me demande même si l'irruption du tout numérique dans la vie quotidienne de tous les individus ne fonctionne pas de façon comparable : le Grand Inquisiteur, aujourd'hui, n'est-il pas incarné dans les nouvelles technologies ? N'y a-t-il pas une sorte de confiance aveugle des gens en leur possibilité de rester en permanence connectés ? N'y a-t-il pas là un abandon de liberté personnelle ?
Caroline Fourest dira sûrement qu’aller vers plus de cette sorte de liberté (de consommer la société), évidemment inséparable de celle d’égalité, c’est forcément un progrès. Mais Caroline Fourest est sûrement un gourou, je veux dire un curé sans soutane. Ce sont les plus hypocrites. Et qui peut nous sauver des gourous ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : stéréotypes, clichés, idées toutes faites, normes, orientation sexuelle, tolérance, préjugés, coaching, métissage, fnac, vincent peillon, refondation de l'école, dostoïevski, les frères karamazov, le grand inquisiteur, caroline fourest
mercredi, 03 avril 2013
DE LA DEFINITION DE L'ART

CECI EST UN SUPERBE REVOLVER KORTH, CALIBRE 357 MAGNUM
(la cartouche de marque SJ, avec sa balle de 10,20g blindée, a des performances remarquables, en particulier la puissance d'arrêt)
***
Extrémisme démocratique, ai-je dit. Est-ce grave, docteur ? Pour parler franchement, je n’en sais rien, mais je crains le pire. Au moins, dites-nous en quoi ça consiste. Je vais essayer. L’extrémisme démocratique découle de ces trois lois : « Tout est beau. Tout est de l’art. Tout le monde est artiste ». Qui répondent à la même double question, trois fois posée : « Qu’est-ce qui est … ? / Qu’est-ce qui n’est pas … ? ». Tout tourne donc autour de l’épineuse question de la définition.
Vous l'avez remarqué : les termes qui désignent les arts se sont emplis d’une infinité de définitions nouvelles. Ainsi a-t-on progressivement appelé « musique » toutes sortes d’arrangements nouveaux des sons autrefois musicaux, toutes sortes de mauvais traitements infligés aux vieux instruments pour leur faire cracher leurs poumons (je n'ai pas dit "glavioter leurs éponges"), pour finir par faire entrer dans la catégorie « musique » tout ce que le monde réel est capable de produire de sonore.
Tout bruit (y compris les éructations et flatuosités qui accompagnent si dignement les repas les plus solennels) est potentiellement musical : tout dépend de ce que l’artiste en fera. La liste des matériaux utilisables en musique est devenue aussi longue qu’il y a de sons dans l’univers. Sans parler des sons artificiels ou synthétiques. John Cage n’a-t-il pas composé une pièce pour « piano-jouet » (la désopilante, écroulante Suite for Toy Piano, 1948) ?

JE N'AI RIEN INVENTÉ (je ne me permettrais pas) : LE PETIT JOHN CAGE, CLOWN DÉGUISÉ EN ADULTE RAISONNABLE, INTERPRÈTE LUI-MÊME, EN CONCERT, SA "SUITE FOR TOY PIANO"
IRRESISTIBLE, IS'NT HE ?
On a collé l’étiquette « roman », « poème », « littérature » sur toutes sortes de productions faites au moyen de mots assemblés de diverses manières. On a collé l’étiquette « art » sur des cailloux, des bouts de ficelle, des urinoirs, des poubelles. Voilà où on en est depuis déjà quelques décennies : « Qu’est-ce qui est de l’art ? Qu’est-ce qui n’en est pas ? ». Plus personne n’en sait rien. Plus personne, c’est-à-dire tout le monde. C’est ça, l’extrémisme démocratique.
Archimède clamait : « Donnez-moi un point fixe, et je soulève l’univers ». C’était fort bien vu. Seulement le problème, dans l’art actuel, c’est qu’il n’y en a plus aucun, de point fixe. Aussi longtemps que 100 % de la population sont convaincus que la Terre, centre de toute la création, est plate, que Dieu existe à n’en pas douter (la preuve, c’est qu’on tue en son nom), que le Roi est sacré, pas de problème : la définition coule de source. Elle s’impose. Dieu et le Roi peuvent dormir tranquilles.
Le problème survient dès le moment où vous accordez à l’individu la première parcelle de libre-arbitre, fût-elle la plus infime. Tant que l’homme est un « sujet », ça roule, Raoul. S’il devient « autonome », c’est là que les Athéniens s’atteignirent, que les Satrapes s’attrapèrent, que les Perses se percèrent. Le Grand Inquisiteur des Frères Karamazov l’a dit assez clairement : l’homme n’est pas fait pour la liberté, et n’a rien de plus pressé que de venir la déposer aux pieds d’un Maître qui le guide et, le guidant, le rassure, le protège et le valorise.
Tant que la définition des mots et des choses émane du Maître, à l’aise, Blaise : elle est homogène, compacte et ne souffre nulle discussion. Le monde a une figure, et les artistes sont là pour, chacun à sa manière, la figurer. Dit autrement : la célébrer.
Tant que la Vérité vient du Très-Haut, glisse, Régis. Le Très-Haut et le Roi donnent sa figure au monde que les artistes représentent. C’est d’ailleurs ça qu’on a appelé « l’art figuratif ». Et si l’art figuratif a disparu depuis le début du 20ème siècle, c’est bien qu’il y avait un problème avec la figure du monde, et avec sa définition. L’art abstrait a peut-être quelque chose à voir avec la mort de Dieu. Peut-être même avec la mort de l’homme. Une idée à creuser, non ?
Tant que les hommes ont été d’accord sur le tracé de la limite entre la réalité et l’art, facile, Mimile : être artiste est un métier qui s’apprend, patience et longueur de temps, et tout ça. Mais quand Antoni Tàpies est autorisé à écrire un livre intitulé La Réalité comme Art, rien ne va plus, trouducu. Si l’un est l’autre, où est passée la définition (voir le livre d’Elisabeth Badinter, justement intitulé L’un est l’autre) ? Fini, a pu, la définition. Parce que, s’il est vrai qu’il y a de « l’un dans l’autre », il est terriblement faux de soutenir que « l’un est l’autre », autre façon de soutenir que « tout est dans tout ».

L’amorce d’un débat au sujet de la définition survient-elle ? C’en est fini de la belle homogénéité, de la sainte unanimité, de la bienheureuse harmonie, du consensus universel. Soyons clair et net :
« Kaput, la définition = kaput, le sens ».
Qu’est-ce qui n’est pas de l’art ? Plus personne ne sait. Si tout son est « musical », tout matériau et tout geste « artistique », tout mot « littéraire », on ne sait plus à quel saint se vouer, parce que, des saints, il n’y en a plus. Faut-il les faire revenir pour autant ?
La définition a quelque chose à voir avec la notion d’immunité : la défense immunitaire d’un « soi » se met en route dès lors qu’elle repère un « non-soi » qui s’approche dangereusement. La définition, c’est la même chose. Elle dit : « Ceci est … / Ceci n’est pas … ».
Notons en passant que l’agonie de la définition coïncide (très grosso et surtout très modo) avec l’apparition du SIDA, qui est précisément une maladie de l’immunité. Il y a de la contamination dans l'air. Un contamination de ce qu'il y a d'humain dans l'homme. Sale temps pour la planète humaine.
Curieux endroit, pour parler du SIDA, vous ne trouvez pas ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, revolver, pistolet, arma à feu, 357 magnum, art contemporain, peinture, musique contemporaine, extrémisme, john cage, archimède, dostoïevsky, les frères karamazov, le grand inquisiteur, art figuratif, antoni tapies, la réalité comme art, élisabeth badinter, l'un est l'autre
dimanche, 28 octobre 2012
MA PETITE HISTOIRE DE LA CURIOSITE (2)
Pensée du jour : « La femme est bien dans son droit, et même elle accomplit une sorte de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle ; il faut qu'elle étonne, qu'elle charme ; idole, elle doit se dorer pour être adorée ».
CHARLES BAUDELAIRE
Résumé : il y a dans toute curiosité une insoumission à l’ordre du monde et à une autorité suprême (Jéhovah, Dieu, Allah, le Cosmos, ...), et le curieux est un contrevenant, immanquablement chassé du paradis de l’obéissance. Dès lors, il est obligé de se battre dans l’espoir de reconstituer le bonheur perdu. C’est ce qu’on appelle la liberté (voir l’extraordinaire chapitre des Frères Karamazov consacré au « Grand Inquisiteur »).
Mais si l’on fait abstraction de la circonstance somme toute extérieure que constitue le serpent de la Genèse (le principe du Mal qui s’oppose à celui du Bien), comment expliquer la naissance de la curiosité ? Satan est une trouvaille trop commode pour expliquer quoi que ce soit, je trouve. Pourquoi Adam et Eve abandonneraient-ils le confort absolu où Dieu les a placés dans un endroit où le temps ne passe pas ? Je me dis qu’il faut au moins un début de raison, non ?
Cela dit, l’image que je me fais d’un tel paradis a quelque chose à voir avec le règne animal. Ne faut-il pas être un complet abruti (je parle d’aujourd’hui) pour considérer le jardin d’Eden comme un paradis perdu ? Si Adam et Eve avaient été de bons chiens (domestiques, n’exagérons pas), ils auraient léché le nez de leur seigneur et maître quand celui-ci posait un sucre sur leur truffe pour qu’ils le chopent au commandement. Dieu ne voulait que des chiens domestiqués.
Il s’est donc passé quelque chose. Mais quoi ? L’animalité, c’est sûr que l’homme s’en est un peu extrait, et qu’il a tenté, tant que faire se peut, de couper les ponts. D’ailleurs, ceux qui suivent un peu l’actualité peuvent se rendre compte que les débats sur le « genre » (il faut savoir que le « genre » a remplacé définitivement le « sexe », notion reconnue par tous les savantasses un peu vieillotte et même carrément dépassée), tellement à la mode aujourd’hui, tournent finalement autour de ce qu’il reste d’animalité dans l’humanité.
Dit autrement : autour de ce qu’il reste de « nature » dans la « culture ». Le « sexe » est naturel, exclusivement naturel. Alors que le « genre » est culturel, exclusivement culturel. Il est universitairement et médiatiquement dangereux aujourd’hui de risquer d’être considéré comme un visqueux « essentialiste » : vous êtes impitoyablement classé sur le rayon marqué « has been ».
Cette « vérité », c’est SIMONE DE BEAUVOIR qui l’a instaurée : dans sa doctrine, en effet, « on ne naît pas femme, on le devient ». Phrase devenue le chef d’œuvre indéboulonnable des trouvailles du féminisme actuel. Le dogme par excellence. Et l’escroquerie du siècle : l’être humain, qu’est-ce qu’il fait d’autre, femme ou homme, que devenir humain ?
Je suis désolé pour la fondatrice du désastreux féminisme moderne, mais il faudrait dire : « On ne naît pas HUMAIN, on le devient ». Et qu'on ne me baratine pas sur le "moment historique". Ce n’est pas pour rien qu’il faut 18 ans pour devenir majeur. La phrase de BEAUVOIR est ce qu’on appelle, en rhétorique, un « truisme ». Et c’est là-dessus que pétaradent les « Chiennes de garde » et autres « Collectif la barbe ».
C’est sûrement une jolie formule, « on ne naît pas femme, on le devient », mais c’est quand même une magnifique imposture, en même temps qu’une belle saloperie. Qui sert à renvoyer le bon sens dans l’archéologie, voire la paléontologie du savoir, comme un morceau de la mâchoire de Lucy. C’est vrai, une femme ne naît pas femme : elle naît juste avec un sexe fendu, au lieu de la tige qui pousse aux garçons.
« Essentialiste », c’est l’équivalent moderne de la « vipère lubrique » des procès staliniens, le mot étant à prendre pour une accusation, « essence » étant synonyme de « nature ». Les « genristes » voudraient bien que l’homme soit le seul être vivant qui se fabrique entièrement lui-même. Ils ont une foi inébranlable dans un invraisemblable idéal de la liberté humaine. On peut voir exposé ce genre de problématique dans Les Particules élémentaires, de MICHEL HOUELLEBECQ.
Pour le « genriste », qu’on se le dise, le désir donne un droit. Phrase à méditer : le désir donne le droit. Quel droit ? « Tout est possible, tout est réalisable », disait une publicité pour une compagnie d'assurances. Droit à l'enfant, au mariage « pour tous » (délicieuse trouvaille pour faire avaler du n'importe quoi), à mourir dans la dignité, etc. On n'imagine pas l'énormité du gisement des « droits » qui attendent juste d'être mis au jour et correctement exploités.
Je me suis laissé embarquer dans ma digression. Je reviens au paradis. Pour qu’Adam et Eve aient tous deux l’ardent désir de croquer dans le fruit de l’arbre de la connaissance, il a quand même fallu autre chose que ce fantasme de serpent. Et moi, je finis par me demander si ce désir n’est pas venu du fait que le premier homme et la première femme n’avaient en fin de compte qu’une confiance limitée dans leur Créateur. On les comprend un peu, à la réflexion. Car je me dis que l’absolu de l’intégrité de la pureté de la divinité de Dieu, quand on observe le monde terrestre, il ne saute pas aux yeux.
Je veux dire que, dans l’esprit des premiers homme et femme, il s’est glissé comme un léger doute. Peut-être une sourde inquiétude. Quelque chose comme une question. Bon, je crois que maintenant, on peut laisser tomber Dieu, Adam, Eve et le paradis terrestre. C’était juste un détour pour introduire ce point d’interrogation. On peut maintenant s’en passer.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : baudelaire, poésie, littérature, religion, bible, dieu, allah, les frères karamazov, dostoïevski, le grand inquisiteur, la genèse, adam et ève, paradis terrestre, sexe et genre, féminisme, simone de beauvoir, le deuxième sexe, chiennes de garde, collectif la barbe, procès stalinien, michel houellebecq, les particules élémentaires
vendredi, 25 mai 2012
UN PEU DE SADO-MASO ?
"Que d'eau ! Que d'eau !", pourrait avoir déclaré le général MAC MAHON, président de la France, en contemplant des inondations dans le Sud-Ouest. QUENEAU ! QUENEAU ! aurait pu déclarer RAYMOND, l'immortel père de Zazie. Ô ! Ô ! nous contenterons-nous de grommeler aujourd'hui, comme PAULINE REAGE, l'auteur, donc de cette Histoire d'Ô, qui a renoué, au milieu de notre XXème siècle, avec la tradition scandaleuse de la jouissance amoureuse dans l'humiliation de la personne, dans la souffrance physique et dans la soumission.
Ces aventures du personnage que son auteur PAULINE REAGE a appelé Ô sont un classique de l’érotisme du 20ème siècle. Cela doit dater des années 1950. La préface de JEAN PAULHAN est une preuve qu’on n’est pas dans le « second rayon », mais dans la chose littéraire, dans le salon chic où des gens riches vont s’encanailler artistement en poussant des petits « oh » horrifiés qui humidifient certaines régions des dames bien élevées.

QUELLE DRÔLE D'IDEE, D'EN FAIRE UN FILM !
(NOTEZ QUAND MÊME LES "BRACELETS" MUNIS D'ANNEAUX)
Cette préface intitulée « Le Bonheur dans l’esclavage » n’est pas bête, et pourrait être une réponse au De la Servitude volontaire, d'ETIENNE DE LA BOETIE, et un héritage du Grand Inquisiteur imaginé par le Ivan Fiodorovitch créé par DOSTOIEVSKI dans Les Frères Karamazov : rien n’est plus difficile que d’être libre, pour ne pas dire angoissant, voire insupportable. Rien n'est plus rassurant que de déposer sa liberté aux pieds d'une personne entre les mains de laquelle on s'en remet.
Ah, la liberté ! Je ne parle pas de cette liberté veule que tout le monde a à la bouche aujourd’hui, la liberté de choisir, mais de choisir entre le plus de produits possible. Ce n’est pas ça, la liberté. La liberté de choix, ce n’est finalement qu’une LIBERTE DE SUPERMARCHE, qui consiste à décider de la façon dont on va consommer, c’est-à-dire à choisir comment on va être consommé par la machine consommation.
Ceux qui ont excellemment compris la logique de cette liberté au rabais sont les entrepreneurs de l’industrie numérique, téléphone mobile, internet à toutes les sauces, « tablettes » et autres jouets à trouver dans la cheminée les soirs de visite du Père Noël. Essayez pour voir de dresser un comparatif raisonné des contrats qui vont vous lier à Bouygues, SFR ou Orange pour votre téléphone transportable, et vous m’en direz des nouvelles. Au choix, c’est la jungle, le maquis, le labyrinthe. A condition que ce soit en ILLIMITE. C'est ça, la liberté de supermarché.
Vous voulez savoir ce que c’est, le téléphone portable, la tablette portable, l’ordinateur portable, et tout ce qui se présente sous le jour souriant de la « vie portable » ?
Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé.
" Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi ? rien ? - Peu de chose.
- Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
- Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ?
- Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. "
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor.
LA FONTAINE, Le Loup et le chien
Ah, la liberté ! La vraie ! Celle, fondamentale, par laquelle chacun décide (ou non) de rester en vie ou de mourir, ou de disparaître aux yeux des vivants. Le genre de liberté revendiquée par FRANÇOIS AUGIÉRAS, et qui fait dans son cas mourir jeune. Une oeuvre marginale, comme son auteur, et qui, comme lui, mérite d'être connue.
Revenons à nos moutons. On ne sait pas pourquoi Ô accepte librement, pour obéir à son amant René, de devenir, du jour au lendemain, comme il le dit lui-même « la fille que je fournis ». On ne saura pas grand-chose des individus qui gravitent autour de l’héroïne, sinon qu’ils sont amateurs de rituels compliqués, de cérémoniaux quasi-religieux, bien qu’ouvertement consacrés au sexe.
Je me rappelle m’être assez ennuyé au film compliqué Le Grand cérémonial, inspiré d’une œuvre de l'allumé et grand joueur d'échecs FERNANDO ARRABAL, qui raconte la délivrance de Cavanosa (il faut oser un nom pareil) de l’emprise de la mère incarnée par Ginette Leclerc, « la plus freudienne des mères », comme dit MICHEL AZZOPARDI dans son commentaire.
A propos de rituels sexuels, je me souviens d’avoir rencontré un type il y a bien longtemps, par l’entremise d’une certaine MARIE-JEANNE. Il était professeur de gym (pardon, il faut dire Education Physique et Sportive, c’est comme le prof de dessin, qui est élevé à la dignité des Arts Plastiques, et ça change tout, il paraît).
Le brave garçon, qui se prenait par ailleurs pour un grand joueur d'échecs, était obsédé de parties fines (et « carrées »). Libéral, il acceptait volontiers de partager sa femme, pas très belle au demeurant. Il la prêtait à qui voulait, pourvu qu’en échange, lui-même pût s’épanouir avec des jeunesses. Il avait évidemment lu Histoire d’Ô. Mais le désopilant de l’affaire, c’est qu’il n’avait pas compris dans leur vrai sens deux mots qui reviennent constamment, fréquemment et récurremment tout au long du livre : le mot « ventre » et le mot « reins ». Je m'étais senti obligé de lui expliquer. Il en était resté éberlué.
Le brave garçon croyait, dans une naïveté assez surprenante chez quelqu'un se prétendant "au parfum", que, au moment où Ô se fait « infibuler » (un piercing aux grandes lèvres par un anneau au moyen duquel l’amant mènera, vers la fin, au milieu des invités d’un château, sa maîtresse, au bout d’une « laisse », en fait une lourde chaîne), on lui perce platement la peau du « ventre ». Or, dans le bouquin, le mot désigne sans ambiguïté la vulve de l'héroïne.
Sir Stephen, le « maître » d’Ô, obtient d’elle en effet qu’elle consente à se laisser poser, dans la plus intime de ses chairs, « des anneaux de fer mat inoxydable ». « Anne-Marie lui ouvrit les cuisses et fit voir à O qu’un des lobes de son ventre, dans le milieu de sa longueur et à sa base, était percé comme à l’emporte-pièce ». On n’est pas plus clair, me semble-t-il. Passons sur les autres détails.

De même – mais là, j’ai plus de mal à comprendre l’incompréhension du « brave garçon » – Ô doit, à la demande de Sir Stephen, se faire « élargir les reins » au moyen de godemichés de plus en plus larges, pour faciliter la pénétration de l’orifice par la variété la plus variée des « membres » bien vivants de la secte, du plus modeste au plus majestueux.
Il n'y a pas besoin de ne pas être un demeuré pour comprendre de quels « reins » il s'agit. Comment le « brave garçon » dont je parle se représentait-il la « chose » ? Mystère. Toujours est-il qu’il s’agit bel et bien de pénétration systématique (et finalement sans joie aucune) de l’anus, et de rien d’autre.
Il n’avait pas dû bien comprendre non plus la chanson mondialement connue de SERGE GAINSBOURG, chantée d’abord avec BRIGITTE BARDOT (qui fut effrayée du scandale potentiel), puis avec JEANNE BIRQUAIN. Ah, on me dit que ça ne s’écrit pas comme ça ? Excusez-moi, je ne savais pas. Je tâcherai d’y penser la prochaine fois. La chanson dit : « Je vais et je viens entre tes reins ».
Le titre imbécile de la chanson est Je t’aime moi non plus (rudimentaire et ridicule technique surréaliste et publicitaire de destruction du « signifiant », rien que pour faire l’intéressant). Dans le texte, il me semble que JEANNE BIRQUAIN ne dissimule guère le plaisir qu'elle trouve à se faire enculer. Le comique de l’affaire, c’est que, au contraire de notre « brave garçon », le Vatican avait immédiatement et violemment réagi, parce qu’il avait immédiatement et violemment compris, on l’aura compris.
Le mystère règne sur les motivations d’O, qui devient cependant volontairement, peut-être par amour (tout est possible), une esclave sexuelle, un « instrument » dont se servent son amant et d’autres. Rien ne sert de raconter par le menu. Sir Stephen, le “maître”, déclare sans ambages : « And besides, I am fond of habits and rites » (p. 102). Ô entre dans l’esclavage avec la dignité d’une femme libre et avec la pudeur aristocratique d’une femme du monde.

SIR STEPHEN (ou RENE ?) ET Ô
Moralité de tout ça, et question : est-ce un livre « érotique », je veux dire qui donne des impressions, un de ces « livres qu'on ne lit que d'une main » (JEAN-MARIE GOULEMOT) ? Personnellement, tout ce qui donne dans les rituels sado-masochistes me laisse froid comme un poisson mort (quoique, même vivant, le poisson n'est pas très chaud).
A ce sujet, j’ai même tendance (au risque de me tromper) à jeter un œil soupçonneux sur la « philosophie » de MICHEL FOUCAULT, le philosophe mondialement célébré, connu pour s’être adonné à toutes ces sortes de jeux SM au long de sa vie. Et c’est ça qui fut nommé professeur au Collège de France. Bref, je n’insiste pas, parce que je sens qu’on va me bassiner avec la « vie privée ».
De même, j’avais sans plaisir vu, dans le temps, un film avec GERARD DEPARDIEU et BULLE OGIER (Maîtresse, de BARBET SCHROEDER, 1975). GERARD, à un moment, pissait sur un client de BULLE, qui se livrait au doux métier de prostituée spécialisée dans la vente de sévices, clouant à l’occasion à une planche la peau du scrotum d’un de ces messieurs, avide de souffrances raffinées. Bon, c’est sûrement très « documenté ». Pour m'en souvenir, faut-il que ça m'ait traumatisé !
Mais dans le genre cruel, nul ne saurait égaler le maître de la discipline, le marquis DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS DE SADE, à la cheville duquel nul n’est arrivé, deux siècles après, même ALFRED DE MUSSET, avec l’héroïne carrément cinglée de Gamiani ou deux nuits d’excès. Et je confesse que la lecture du « divin » (adjectif obligé, paraît-il) marquis devient très vite (pour moi) d’un ennui bien carré aux angles.
Même le baron de Charlus, dans la dernière partie de La Recherche du temps perdu, me paraît totalement pathétique, quand il se rend dans la « maison » tenue par Jupien pour se faire fouetter de chaînes par des jeunes gars dont il escompte le maximum de cruauté. C’est d’ailleurs bien sur le ton pathétique que PROUST raconte cette avant-dernière phase descendante du flamboyant Charlus.
Histoire d’Ô a-t-il fait scandale à parution (1954) ? J’avoue que j’ai la flemme de chercher. Cela dit, j’ai bien supporté la version Bande Dessinée du livre signée par GUIDO CREPAX, qui offre les charmes de l’élégance et de l’absence de vulgarité, en même temps que la virtuosité du dessin. Vous avez dit sado-maso ? Très peu pour moi, en fin de compte.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sado-maso, sm, mac-mahon, queneau, pauline réage, histoire d'ô, jean paulhan, de la servitude volontaire, étienne de la boétie, dostoiëvski, les frères karamazov, liberté, le grand cérémonial, fernando arrabal, serge gainsbourg, je t'aime moi non plus, brigitte bardot, jane birkin, michel foucault, gérard depardieu, bulle ogier, barbet schroeder, sade, sadisme, masochisme, musset, guido crépax, bande dessinée, enculer, sodomie

