lundi, 21 mars 2016
GEORGES PEREC : LA DISPARITION
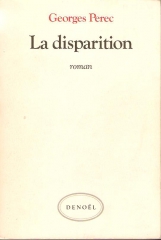 1
1
C’est curieux, n’est-ce pas, l'exceptionnelle biographie de Georges Perec par David Bellos m’a donné envie de rouvrir plusieurs livres de et sur l’écrivain. Parmi ceux-ci, le moindre n’est pas La Disparition, le désormais célébrissime lipogramme en « e », que les gens informés ont, paraît-il, beaucoup lu.
Le plus curieux dans l’affaire, c’est que le procédé est aujourd’hui très célèbre, mais qu’il n’a plus jamais, sauf erreur, donné lieu à la naissance d’un livre aussi digne d’attention. En littérature, La Disparition occupe la même place que « ptyx » dans le sonnet de Mallarmé, un « hapax » (du grec « une seule fois »). Disons-le : le roman de Perec, d’après ce que je sais (mais je peux me tromper) n’a rien de connu qui puisse lui être comparé. Comme si l’auteur avait tué le genre en lui donnant naissance.
J’ai donc relu La Disparition, ce roman de trois cents pages conçu et écrit avec une visible jubilation à partir de ce que le romancier s’est à lui-même interdit : la lettre la plus fréquente de la langue française. Un tour de force. Mieux, je dirai un numéro d’équilibriste. Ou plutôt de contorsionniste. On ne se lance pas, en effet, un tel défi sans s’exposer aux rudes nécessités de la langue. En français, se priver du « e », c’est réduire drastiquement la richesse du vocabulaire : une gageure.
Inutile de le nier : ça oblige à des acrobaties sans nom, je veux dire que Perec est évidemment obligé de tricher avec la langue, et même avec l’histoire (avec sa grande hache) : « Au nom du salut public, un Marat proscrivit tout bain, mais un Charlot Corday l’assassina dans son tub » (p.13). « Charlot Corday », il fallait oser. Je l’avoue, en tombant sur la trouvaille, j’ai bien rigolé. Et je dirai que c’est un peu le problème du livre tout entier : il fait souvent rire ou sourire (pourquoi le nier ?), mais on le prend rarement au sérieux.
Car c’est un livre bourré de clins d’œil faits au lecteur invité à devenir une sorte de complice. Par exemple, quand je tombe sur « l’arbin », « l'oisir », « sa vision qui l’hantait », « sarbacan », « bousins » (pour bouseux), je dis pourquoi pas. Je veux bien sourire encore, face à « un fort migrain », « aux cordons vocaux », « tout allait à vau-l’iau », « la mail-coach, un vrai guimbard », « Ah ! Moby Dick ! Ah maudit Bic ! ». A propos de Moby Dick, Perec se permet de résumer à sa façon lipogrammatique le chef d’œuvre de Melville. Je retiens ceci : « Puis, au haut du grand mât, il plantait, il clouait un doublon d’or, l’offrant à qui saurait voir avant tous l’animal » (mais, sauf erreur, Achab enfonce le doublon d’un coup de masse, sans le clouer).
Allez, j’accepte encore de m’amuser, avec « Blanc ou l’Oubli d’Aragon », « il s’agissait, dit-il, d’un rond portant au mitan un trait droit, soit, si l’on voulait, d’un signal s’assimilant à l’indication formulant la prohibition d’un parcours », « Trois chansons du fils adoptif du Commandant Aupick » (vous avez compris ce qu’il y a à comprendre : Blanche ou l’Oubli, le sens interdit, Charles Baudelaire).
J’apprécie aussi, à l’occasion, d’enrichir mon vocabulaire : je ne connaissais pas « baralipton » (je ne suis pas très fort en syllogismes), « avaro » (la tuile !) et quelques autres. Mais je me dis que l’auteur attige, qu’il en rajoute quand il écrit : « mais pour qui j’urai alors d’avoir un amour constant », « nous avions naquis », ou « la coruscation d’un automnal purpurin ». Soyons honnête : il m’est arrivé de me laisser prendre au récit, en des moments qui ne sont pas trop rares, heureusement. Georges Perec est excellent quand il fait oublier la contrainte formelle. Mais la plupart du temps, elle reste là, sous votre nez, à vous narguer, trop visible et parfois laborieuse.
Cette contrainte, il la formule d’ailleurs explicitement :
« Mais, plus tard, quand nous aurons compris la loi qui guida la composition du discours, nous irons admirant qu’usant d’un corpus aussi amoindri, d’un vocabulariat aussi soumis à la scission, à l’omission, à l’imparfait, la scription ait pu s’accomplir jusqu’au bout.
Abasourdis par l’inouï pouvoir marginal qui, contournant la signification tabou, la saisit pourtant, la produit pourtant par un biais subtil, la disant plus, l’ultradisant par l’allusion, l’association, la saturation, nous garantirons, lisant, la validation du signal sans tout à fait l’approfondir.
Puis, à la fin, nous saisirons pourquoi tout fut bâti à partir d’un carcan si dur, d’un canon si tyrannisant » (p.196).
On pense évidemment à la célèbre histoire d’Edgar Poe La Lettre volée, où Dupin, ce précurseur de Sherlock Holmes, grâce à la subtilité de son raisonnement, perce le secret et déjoue la machination du ministre qui voulait du mal à une grande dame. Je laisse de côté les savantes considérations, célèbres parmi les intellos, que Jacques Lacan a posées sur la nouvelle de Poe. L’idée, c’est que les gens ne remarquent pas, en général, ce qui leur crève les yeux. Comme l’écrit Perec : « Oui, fit Savorgnan, disons qu’Anton tout à la fois montrait mais taisait, signifiait mais masquait » (p.111).
Révéler un secret tout en le taisant, tout le paradoxe qui court dans l’œuvre de Georges Perec est là.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, david bellos, georges perec une vie dans les mots, georges perec la disparition, oulipo, lipogramme, ptyx, mallarmé, edgar poe, la lettre volée, jacques lacan
jeudi, 06 octobre 2011
MON BON PLAISIR EN LITTERATURE
DU POPULAIRE EN GÉNÉRAL ET DU POLICIER EN PARTICULIER
Pourquoi je ne lis pas que des livres de « haute littérature » ? Pourquoi j’aime ça, disons, la « littérature populaire », à commencer par le « roman policier » ? J’ai certes jubilé intensément d’un bout à l’autre de Moby Dick, de HERMAN MELVILLE, peut-être, entre autres, à cause de la traduction parfaite d’ARMEL GUERNE. Mais le traducteur a beau faire des prouesses, l’essentiel, forcément, appartient au seul auteur. J’avoue cependant que j’ouvre avec plaisir, à l’occasion, un Maigret de GEORGES SIMENON, ou un Arsène Lupin de MAURICE LEBLANC. Pourquoi ce plaisir ?
Dans le premier cas, je me souviens des détails de l’action, j’ai pour ainsi dire vécu en compagnie des marins, sur le pont, dans les haubans ou dans la baleinière, et j’ai appris à les connaître. J’en ai bavé, j’ai bu la tasse, j’ai été secoué, chaviré. Longtemps après avoir lu, je mastique encore, je rumine, je persiste à digérer, je prolonge l’assimilation. C’est un livre qui dure.
Dans l’autre, dès que, satisfait de ma lecture, j’ai refermé sur la clé de l’énigme, j’ai déjà oublié les circonstances, les personnages, les lieux, sauf – encore que vaguement – cette cour sablonneuse d’une maison dans la Sarthe, un jour torride de juin, où il s’est passé quelque chose. Quelque chose, mais quoi ? Pourtant SIMENON est un excellent écrivain. D’abord tout le monde le dit, c'est sûrement vrai. D'autant plus vrai que j'en suis convaincu.
En un mot comme en cent, la "grande littérature" me transporte, la "petite littérature" me fait plaisir. Et j'ai grand respect et besoin de la digression, comme l'ont sans doute remarqué les lecteurs de ce blog.
Je dirais, tiens, ça me vient là, que ce sont des livres à « évaporation rapide », en face d’autres livres, que je dirais à « sédimentation durable ». Maigret, ce n’est pas le premier, c’est loin d’être le seul, mais avant tout, c’est un personnage de SÉRIE : « J’aime bien lire "un" Maigret, de temps en temps », peut-on souvent dire ou entendre. Ou "un" James Bond. Ou "un" Arsène Lupin. Je rappelle que le premier héros d’une série policière est le Dupin d’EDGAR ALLAN POE dans trois récits : Double assassinat dans la rue Morgue, Le Mystère de Marie Roget, La Lettre volée (1841, 1842, 1844). Rendons à César…
Alors derrière le "un", posez Nestor Burma, Miss Marple, Hercule Poirot, OSS 117, le commissaire Adamsberg, Pepe Carvalho, le Juge Ti, Erwin le Saxon, bref : QUI VOUS VOUDREZ. Chacun des livres de ces séries n’est pas fait pour rester. Je dirai donc que l’évaporation est le principe même de la série. Et que le héros de la série, à son tour, s’évapore : en fait, il ne lui arrive rien Á LUI personnellement.
C’est flagrant avec James Bond, dont j’imagine en toute logique le corps couturé, non : zébré de cicatrices en tous sens, de toutes sortes, de toutes profondeurs. Normalement, sa surface est toute en creux, cratères, et bosses, comme celle de la lune. Quand James entreprend d’emboîter son corps dans celui de la « james bond girl » de service, dans le roman suivant, la peau de celle-ci devrait croire qu’on la frotte à la paille de fer, ou à la râpe à chambre à air de vélo, suite à crevaison. En tout cas, il m’arriverait le centième de ce qu’il a subi au total, moi, je serais au moins mort, voire pire que ça.
Mais non, « the show must go on », comme chante FREDDY MERCURY quelques mois avant d’avaler son bulletin de naissance. James Bond, lui, deux minutes après être passé sous le char d’assaut, il est prêt à entrer en scène pour son récital, smoking repassé, mise en plis impeccable, lisse comme le crâne de YUL BRYNNER, propre et net comme un napoléon « fleur de coin ».
Ce qui vaut pour James Bond vaut pour tous les autres : voyez, dans Tintin en Amérique, lorsque le héros, capturé par le syndicat de gangsters de Chicago, est balancé au lac ficelé avec aux pieds d’énormes haltères qui doivent l’envoyer par le fond, et qui s’avèrent être en bois ; le drôle, c’est que Tintin lui-même semble fait de bois puisque, les mains attachées dans le dos, il est aussi flottable qu’un tronc d’arbre.
Les séries policières ? Je vais vous dire : c’est comme un coin du feu, un bon fauteuil, des pantoufles, bobonne à côté, avec Socrate le griffon Korthals, affalé sur sa carpette à somnoler goulûment après ses bambanes au grand air. Vous avez tout de suite le décor familier, les personnages familiers, les habitudes de la boutique. San Antonio appelle illico le tandem Pinuche-Bérurier, mais aussi sa « brave femme de mère », Félicie. Ce sont de solides et rassurants points de repère.
Prenez qui vous voulez, mettons Sherlock Holmes, qu’est-ce qui vous vient, là, tout de suite ? Le violon, la pipe, le chapeau, le mac farlane, le docteur Watson : voilà, c’est automatique, vous ne connaissez pas tout, mais vous reconnaissez, vous êtes en pays de connaissance. Mieux que ça, vous êtes chez vous, à la maison, au chaud. Ça fait du bien. La série policière, au fond, c’est le CONFORT BOURGEOIS pour le lecteur. La série policière est d’abord confortable.
En fait, le héros, dans la série, s’il ne lui arrive rien à lui, c’est qu’il est tout simplement immortel. Il ne peut rien lui arriver de définitif (sinon, pas de série). La preuve, c’est que ARTHUR CONAN DOYLE a même été obligé de ressusciter Sherlock Holmes, sous la pression d’un public qui tenait à son héros plus qu’à un vieux pull sentimental et nostalgique du temps de sa jeunesse, ce pull qui a suivi la déformation du corps avec l’âge (arrondissement du ventre, fléchissement du dos), et dont le corps s’est, comme qui dirait, imprégné. Le héros de série policière ne peut ni ne doit mourir avant son auteur, à moins qu’il passe de main en main (Nick Carter, assez oublié aujourd’hui), preuve supplémentaire d’immortalité.
Et s’il est immortel, je vais vous dire, c’est que le héros de série n’existe pas. Enfin pas vraiment. Pas complètement. D’ailleurs, l’auteur n’y croit pas trop lui-même. Du moins il fait semblant d’y croire. Ce qui l’intéresse, l’auteur, ce n’est pas le héros, mais la sombre et riche combinaison du coffre-fort. Car son roman, c’est comme un coffre. L’auteur, qui prend le lecteur par la main ou pour un imbécile, l’amène progressivement et méthodiquement jusqu’au moment de l’ouverture. Le héros, mis en face du coffre au début, est sommé d’avoir « cassé » la combinaison à la fin. La lourde porte s’ouvre devant les yeux haletants (oui oui !). En fait, il n’y a rien dans le coffre (« hin hin hin » , grince l’auteur sardonique, « je vous ai bien eus »).
Le héros de série, finalement, ça a juste l’existence très mince d’un ciseau à bois (ou d'une clé à pipe, ou d'un tiers-point, au choix) que l’auteur remet à sa place au tableau au-dessus de l’établi quand il a accompli sa tâche. On aura beau faire comme MANUEL VASQUEZ MONTALBAN, et donner à Pepe Carvalho, entre autres spécialités, celle d’un PAGANINI des cuisines, du « piano », du chinois et de la lèchefrite, ça ne change rien : la gastronomie intervient dans l’histoire, quoi qu’on fasse, à la manière des parenthèses dans une phrase.
Maintenant, il faut savoir que certains héros de série sévissent dans un seul récit. L’élégance expressive en vigueur aujourd’hui parle de « one shot ». Prenez La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil, de SEBASTIEN JAPRISOT. Prenez Fatale ou La Position du tireur couché, de JEAN-PATRICK MANCHETTE. Prenez Le Maître d’escrime, d’ARTURO PEREZ REVERTE. Le confort n’est pas aussi grand, mais presque, grâce parfois au jaune et noir de la couverture : c'est exprès que vous êtes entré dans cette boutique-là, vous savez que vous y trouverez l’article cherché.
Souvent, le plus marrant, dans le polar, c'est le titre. Parfois, il n'y a même que ça de drôle. Parce qu'il faut dire que les San Antonio, pendant un temps, ont été assez ratés. Mais quand vous tombez nez à nez avec Les Anges se font plumer, vous capitulez, bien sûr. Entre la vie et la morgue est une trouvaille. Ménage tes méninges n'est pas mal non plus. Mais il n'y a pas que San Antonio. Que pensez-vous de Enterrement pour Cythère (ANDRE HELENA ) ? J'aime beaucoup Mes Morts d'outre-tombe (PIERRE NEMOURS).
Bref : en peinture, il y a MICHEL-ANGE, et puis il y a mon oncle ; pour la musique, il y a BEETHOVEN, et puis il y a moi sous la douche; enfin il y a MARCEL PROUST et il y a FREDERIC DARD, pour ce qui est d'écrire des histoires. Et moi, j'ai un principe, je ne veux pas faire de jaloux. On a de la morale, ou on n'en a pas.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, moby dick, herman melville, armel guerne, georges simenon, littérature populaire, littérature policière, maigret, james bond, edgar poe, nestor burma, miss marple, hercule poirot, oss 117, commissaire adamsberg, pepe carvalho, juge ti, tintin, san antonio, sherlock holmes, arthur conan doyle, manuel vazquez montalban, sébastien japrisot, jean-patrick manchette, arturo perez reverte

