mercredi, 06 avril 2016
HERMAN MELVILLE : TAÏPI
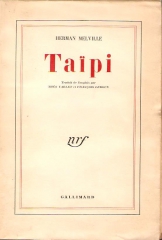 On va me trouver pisse-froid, pisse-vinaigre et rabat-joie : je viens de lire un livre du grand Herman Melville, et je suis obligé de dire que je m’y suis ennuyé. Il s’agit de Taïpi. Autant j’avais été ébloui, emporté par Moby Dick, intrigué par Mardi, touché par Redburn, autant j’ai tourné laborieusement les pages de Taïpi.
On va me trouver pisse-froid, pisse-vinaigre et rabat-joie : je viens de lire un livre du grand Herman Melville, et je suis obligé de dire que je m’y suis ennuyé. Il s’agit de Taïpi. Autant j’avais été ébloui, emporté par Moby Dick, intrigué par Mardi, touché par Redburn, autant j’ai tourné laborieusement les pages de Taïpi.
Il est présenté comme le premier roman de l’auteur mais, à la lecture, on se dit que si ce n’est pas autobiographique, c’est rudement bien imité. Va pour "roman". Il possède au moins un point commun avec Mardi, débutant comme lui par le sort apparemment invivable qui est fait au narrateur, embarqué sur un baleinier dirigé par un commandant incompétent et injuste. Le héros, comme dans Mardi, décide de déserter à la première occasion et, comme dans Mardi, trouve au dernier moment un complice qui accepte de courir l’aventure d’une évasion.
A partir de là, les trajectoires divergent : les deux fuyards de Mardi mettent à l’eau une des baleinières du navire et finiront par débarquer dans le très étrange archipel, alors que ceux de Taïpi attendent que leur navire fasse escale à Nuka Hiva (une des îles Marquises, dans la baie de laquelle mouille une escadre française, dont il faut voir la façon dont l'auteur assaisonne les manières de sauvages qu'il attribue à la puissance colonisatrice) pour profiter d’une permission de débarquer pour s’échapper dans les profondeurs de la végétation.
L’île n’est pas totalement explorée, et l’on commence par suivre la difficile progression de Tom (le narrateur) et Toby dans une nature hostile du fait d’un relief accidenté. Tom se blesse à la jambe. Ils survivent difficilement, ne disposant que de fort maigres provisions de bouche. Mais ils finissent par arriver aux abords du territoire d’une peuplade. Leur crainte est vive : sont-ils chez les Hapaas, connus pour leurs mœurs à peu près correctes à l’égard des blancs ? Ou chez les Taïpis, dont la réputation de férocité et de cannibalisme les remplit de crainte ?
En fait, si le livre porte ce titre, c’est qu’ils sont bel et bien chez les Taïpis, mais que ceux-ci sont beaucoup moins féroces que ce qu’en a fait leur réputation. Ils vont donc faire connaissance de la tribu en général, dévorée de curiosité au début, et de Marheyo en particulier, qui va adopter Tom au sein de sa famille : Mehevi, Kory-Kory, le fils dévoué qui s’occupe de porter le blessé dans les déplacements et Faïawaï, la fille ravissante pour laquelle le narrateur éprouve des sentiments tendres.
A partir de là, on quitte le « roman » pour entrer dans le traité d’ethnologie, et c’est là que je lâche Herman Melville. On va presque tout savoir des mœurs, des coutumes, des rites des Taïpis, et ça, je vais vous dire : trop, c’est trop. Il est vrai que l’action progresse cahin-caha, plan-plan, à son petit rythme. On assiste attendri, par exemple, au flirt auquel se livre Tom auprès de la ravissante Faïawaï, grâce à la dérogation exceptionnelle obtenue en sa faveur, qui l’autorise à enfreindre le tabou qui interdit aux femmes d’entrer dans l’espace de la lagune. On comprend l'attendrissement de Tom : les femmes Taïpis sont assez peu embarrassées de vêtements.
Mais dans l’ensemble, le héros, Tom, se lance avec un certain enthousiasme dans ce que les ethnologues modernes appellent pompeusement l’ « observation participante », et ne nous laisse rien ignorer des relations des Taïpis entre eux, entre les hommes et les femmes, entre la tribu et le sacré (le « Ti »), entre la tribu et les Hapaas. Et ça, franchement, ça a du mal à passer. L’intention ethnologique est éminemment louable, certes, mais a pour effet de lester l’intention romanesque d’un poids qui la rend indigeste. A part le fait que les Taïpis vivent au jour le jour, paresseusement, sans travailler, sans s’en faire outre-mesure pour le lendemain.
On saura que, longtemps après la fuite de Toby, dont Tom n’a aucune nouvelle jusqu’à la fin, celui-ci prend peur en observant le cadavre plus ou moins dépecé d’un ennemi : il se dit que la même chose risque de lui arriver, et dès lors il n’a plus qu’une pensée : retourner chez les blancs, malgré la volonté unanime de toute la tribu de garder celui-ci prisonnier. Choyé par tout le monde, mais seulement aussi longtemps qu’il n’essaie pas de quitter celle-ci. Après tout, ne doit-il pas se résoudre à mettre fin à ses grandes vacances ? Cela fera trois mois qu’il se la coule douce : il est temps de retrouver l’univers laborieux de la civilisation.
Le récit de l’évasion proprement dite de Tom donne un peu l’impression d’une pirouette. Il faut le prendre comme il est, y compris dans son aspect acrobatique. Il paraît que le livre, à parution, connut le succès. Ma foi, tant mieux pour Herman Melville. Pour mon compte, je le laisse (avec regret) à ceux qu’il intéresse.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, herman melville, taïpi, moby dick, melville redburn, herman melville mardi, îles marquises

