vendredi, 10 janvier 2020
2020 : DOLTO PÉDOPHILE ?
Aujourd'hui, c'est la fête à Françoise Dolto.
Oui, oui, l'icône en personne : sainte Françoise.
La mamie absolue.

Le Canard enchaîné, mercredi 8 janvier 2020. Dessin signé Aurel.
Décidément, c'est l'époque qui veut ça ! L'époque ? En état d'hébétude et d'ahurissement et dans une ambiance de scandale insoutenable, elle découvre les années 1970 et l'incroyable permissivité morale qui a vu s'ébattre et s'épanouir les grandes causes sociétales de la "libération sexuelle", de l'homosexualité, du féminisme et de la pédérastie (mot pris dans son sens étymologique d' "amour avec les enfants").
Sauf que la dernière de ces "grandes causes" est devenue, au fil des ans, des redressements moraux et des révisionnismes idéologiques, la grande pestiférée, alors que les deux autres prospéraient à qui mieux-mieux, au point d'édifier autour des homosexuels et des femmes un rempart pénal infranchissable. L'époque, qui a d'un côté sacralisé la cause des homosexuels et des femmes au point d'inscrire au Code Pénal les délits d'homophobie et de sexisme, désigne l'amour (physique) des enfants comme l'ennemi à abattre.
Un problème se pose néanmoins : que faire de la mémoire de personnes auxquelles, entre-temps, l'époque elle-même a élevé des statues en acier inoxydable et plaquées or, alors qu'elles ont publiquement avoué leur tolérance ou leur solidarité avec ceux que nous appelons rétrospectivement des "pédophiles" ? Sans parler de celles qui ont milité en leur temps pour la libéralisation de ces mœurs qui paraissent abominables à tant de gens aujourd'hui.
Prenez la liste des signataires de la "Lettre du 23 mai 1977" publiée par le journal Le Monde : que du beau linge ! Cette lettre, peut-être rédigée par un certain Gabriel Matzneff (qui en revendique la paternité), demande au législateur la révision, dans un sens plus "laxiste", des lois réprimant les abus dans les relations entre adultes et mineurs.
Des noms ? Allez, quelques-uns : Louis Althusser, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Jean-Louis Bory, Patrice Chéreau, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Françoise Dolto, André Glucksman, Félix Guattari, Roland Jaccard, Pierre Klossowski, Jean-François Lyotard, Michel Leiris, Christiane Rochefort, Alain Robbe-Grillet, Jean-Paul Sartre, Philippe Sollers (parmi les noms figurant sur la liste aimablement fournie par l'encyclopédie en ligne).
Parmi ces noms de gens ou très célèbres ou assez connus, on note celui de Françoise Dolto. Eh bien figurez-vous que ça tombe bien, parce que Le Canard enchaîné du mercredi 8 janvier 2020 consacre quasiment une demi-page à la célébrissime psychanalyste des enfants, auteur de nombre d'ouvrages savants et animatrice de mémorables émissions de radio.
Il se trouve qu'en novembre 1979, la revue "Choisir la cause des femmes" (Gisèle Halimi) a publié un entretien que Françoise Dolto a eu avec un juge des enfants, texte ensuite repris dans un ouvrage. Et l'on peut dire que ça décoiffe. Je cite Le Canard enchaîné.
« Dolto : Dans l'inceste père-fille, la fille adore son père et est très contente de pouvoir narguer sa mère !
Q. : Et la responsabilité du père ?
R. : C'est sa fille, elle est à lui. Il ne fait aucune différence entre sa femme et sa fille, ou même entre être l'enfant de sa femme ou bien le père de sa femme. La plupart des hommes sont de petits enfants. Il y a tellement d'hommes qui recherchent dans femme une "nounou". Et des femmes qui les confortent dans cette idée-là ! Alors la responsabilité du père, à ce niveau (...).
Q. : Donc, la petite fille est toujours consentante ?
R. : Tout à fait.
Q. : Mais enfin, il y a bien des cas de viol ?
R. : Il n'y a pas de viol du tout. Elles sont consentantes.
Q. : Quand une fille vient vous voir et qu'elle vous raconte que dans son enfance, son père a coïté avec elle, et qu'elle l'a ressenti comme un viol, que lui répondez-vous ?
R. : Elle ne l'a pas ressenti comme un viol. Elle a simplement compris que son père l'aimait et qu'il se consolait avec elle, parce que sa femme ne voulait pas faire l'amour avec lui. »
J'arrête ici la citation, car la suite est également assez gratinée, mais j'invite tout le monde à se procurer ce morceau d'anthologie, qui montre que les années 1970 étaient imprégnées jusqu'au trognon d'idées qu'une majorité s'accorde aujourd'hui à juger puantes, repoussantes, et même pornographiques. Le Canard enchaîné signale tout de même en fin d'article que Françoise Dolto, deux ans auparavant, jugeait que « l'initiation sexuelle des adolescents et des enfants par un adulte (...) est toujours un traumatisme psychologique profond ».
L'icône François Dolto prise en flagrant délit de pédalage dans la semoule de choucroute au yaourt ! Elle pourrait faire un tour chez le psy, non ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis althusser, roland barthes, simone de beauvoir, jean-louis bory, patrice chéreau, gilles deleuze, jacques derrida, françoise dolto, andré glucksman, félix guattari, roland jaccard, pierre klossowski, jean-françois lyotard, michel leiris, christiane rochefort, alain robbe-grillet, jean-paul sartre, philippe sollers, journal le monde, gabriel matzneff, le canard enchaîné, gisèle halimi, psychanalyse
samedi, 19 mars 2016
PHILIPPE MURAY : ULTIMA NECAT
IMPRESSIONS DE LECTURE
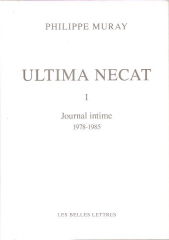 2
2
Je passerai rapidement sur la radicale incompatibilité d’humeur qui règle les relations entre Philippe Muray et Bernard-Henri Lévy, dont il déteste l’arrogance, le culot et la mauvaise foi. Quand l’occasion se présente, il lui assène de sévères avoinées, sur un ton d’une grande violence : « On dirait que la vocation de B.-H. Lévy est de confirmer et d’amplifier toutes les saloperies inventées depuis des siècles par les antisémites. Voleur, escroc, usurpateur, mystificateur sans talent, copieur, plagiaire, conspirateur, menteur, etc. » (II, p.473). Non, il n’y va pas de main morte (ce qu’on lit p.273 n’est pas mal non plus).
Sa relation avec Philippe Sollers est plus complexe et plus suivie. Bisbilles et rabibochages se succèdent. L’ambivalence gouverne. Ça l’embête beaucoup d’avoir besoin de lui et de BHL, qui restent incontournables s’il veut espérer voir ses livres publiés, vu la place qu’ils occupent dans le monde de l’édition parisienne (il parle du « pouvoir de Sollers », I, p.392).
Le copinage forcé avec Philippe Sollers, disons-le, n’est pas ce qui pourrait me rendre sympathique l’auteur des formidables Exorcismes spirituels : dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Son problème, c’est qu’il a besoin de lui. Mais ça ne l’empêche pas d’écrire : « Petite saloperie dégueulasse de Sollers » (I, p.246). Il ne le tient pas en grande estime : « La bêtise de Hugo était la bêtise ; celle de Sollers, la bêtise de l’intelligence » (p.251).
Une page plus loin, il parle de « Méphistophilippe ». Plus loin : « Je me sens m’éloigner maintenant de Sollers très vite » (ibid., p.282). On constate, en comparant le précieux index des noms propres du volume I et du volume II, qu’on trouve en fin de volumes, que cet éloignement semble en voie d’accomplissement à partir de 1986.
On comprend la difficulté quand on sait que les revues dans lesquelles Muray publie sont à l’image de ce qui a pu passer en France, pendant un temps, pour le fin du fin de l’avant-garde intellectuelle : Tel Quel (fondée entre autres par Sollers), Art press, bref, tout ce qu’on regroupe sous l’appellation « Modernité ».
La Modernité a fait régner la terreur sur les « intellectuels » : Simon Leys (Pierre Ryckmans) en sait quelque chose, qui a subi un total ostracisme institutionnel, pour avoir mis à poil la statue de Mao Tse Toung dans Les Habits neufs du président Mao, au moment même où Sollers, Barthes, Maria-Antonietta Macciocchi et toute l’ENS-Ulm, "maoïstes" pur jus, avaient le cœur et la tête à Pékin, en pleine « Grande Révolution Culturelle Prolétarienne ». Mais Simon Leys lisait le chinois dans le texte des journaux chinois, et il savait à quoi s'en tenir sur le mirage maoïste. Une terreur analogue, quoique moins sanguinaire, a régné sur le monde musical, lorsque l’autocrate Pierre Boulez, assis sur le trône du sérialisme intégral et de l’IRCAM, dictait les lois de la composition musicale.
La grande force morale de Philippe Muray est d’avoir su s’extraire de ce bocal confiné pour permettre à sa pensée de se déployer en toute autonomie. Au prix d’un arrachement et de contradictions. Quelle malchance, pour Philippe Muray, d’avoir germé dans le cloaque des avant-gardes. Mais je me dis en fin de compte que ça l’autorise d’autant plus à porter leur fumisterie sur la place publique.
Bon, à part ça, qu’est-ce que je retiens de ces onze cent et quelques pages de « Journal intime » ? D’abord, que l'auteur considère le 20ème siècle comme une « catastrophe » (je ne retrouve pas la page). Qu’on trouve, dans une telle masse de texte, assez peu de remarques à propos de « l’événementiel ». Que Muray évoque bien davantage ses parents que lui-même : « 27 janvier. Il y a des gens qui coûtent la vie à leur mère en naissant. J’ai coûté la vie à mon père en naissant (écrivain). J’ai fait mieux » (I, p.235). Sous-entendu : mieux que Jean-Jacques Rousseau (première phrase des Confessions).
Explication : Philippe Muray porte une culpabilité, celle d’avoir obligé, en naissant, son père à faire ce qu’il faut pour nourrir une famille, et donc à abandonner toute ambition littéraire pour son propre compte. En cultivant à son tour l’ambition de devenir écrivain, Muray a-t-il voulu « réparer » une « faute » ? Toujours est-il qu’il n’envisagera jamais sa future existence autrement que vouée à la littérature. Et surtout sans encombrer son chemin des enfants qu’il ferait à une femme. Il faut choisir : faire des enfants ou des livres. Il revient d’ailleurs assez souvent sur les bisbilles et incompréhensions que suscite, auprès des enfants de sa compagne : il refuse obstinément d’être considéré comme un substitut paternel.
C’est un point de vue. C'est un choix.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, philippe muray, ultima necat journal intime, bernard-henri lévy, bhl, philippe sollers, exorcismes spirituels, teel quel, art press, simon leys, pierre ryckmans, mao tse toung, mao dze dong, les habits neufs du président mao, roland barthes, maria-antonietta macciocchi, pierre boulez, ircam, musique contemporaine, jean-jacques rousseau confessions
jeudi, 16 avril 2015
ENNEMIS PUBLICS 3 (MH et BH)
3/4
 Bon, maintenant que j’ai bien répandu mon fumier, qu’est-ce qui reste des propos que BHL tient à son correspondant ? Je suis obligé de le dire : de mon point de vue, pas grand-chose. Quelques vagues accès de sincérité, mmoui, peut-être. Quant à soutenir qu'« il y a eu un vrai travail de parole » (p. 306) et que « Le parti adverse, le mien, va peut-être en profiter, foncer dans la brèche que j'ai ouverte et voir dans ces aveux la confirmation de ses pires suspicions » (p. 313), on n'y est pas du tout. Mais, monsieur Lévy, soyons sérieux : quel travail de parole ? quelle brèche ? quels aveux (pour les aveux, voir la conclusion du billet d'hier) ?
Bon, maintenant que j’ai bien répandu mon fumier, qu’est-ce qui reste des propos que BHL tient à son correspondant ? Je suis obligé de le dire : de mon point de vue, pas grand-chose. Quelques vagues accès de sincérité, mmoui, peut-être. Quant à soutenir qu'« il y a eu un vrai travail de parole » (p. 306) et que « Le parti adverse, le mien, va peut-être en profiter, foncer dans la brèche que j'ai ouverte et voir dans ces aveux la confirmation de ses pires suspicions » (p. 313), on n'y est pas du tout. Mais, monsieur Lévy, soyons sérieux : quel travail de parole ? quelle brèche ? quels aveux (pour les aveux, voir la conclusion du billet d'hier) ?
Beaucoup de vantardises fiérotes, ça c’est sûr. Que ce soit dans le café voisin (le Twickenham) de l’éditeur Grasset (où il a son bureau de directeur littéraire, j’imagine) ou à propos du village d’Esbly, il faut que nul n’en ignore : BHL aura été un homme "couvert de femmes". Cette fois ce n’est plus Sartre ou Malraux (quoique …), c’est carrément Chateaubriand : il lui suffit d’apparaître pour qu’elles lui tombent dessous (je suis assez content de la formule, servez-vous).
C’est MH qui cite le nom de la commune où les parents de BH avaient une maison, revendue à cause de la « cancérisation » par Disneyland. Réaction de BH : « Mon Dieu, Esbly ! ». Aussi sec, je vous jure que c'est vrai, il nous fait le coup de la madeleine (sur l'air de "J'avais totalement oublié", "Mon dieu quelle émotion !") !
Et c'est parti pour nous tartiner l’histoire de l’épouse-caissière du boucher surnommé « le cocu », cette femme qui payait de sa personne dans l’initiation sexuelle des jeunes mâles du coin. « Mon prince, on a les dames du temps jadis qu'on peut » (Georges Brassens). Pourquoi pas, après tout, la bouchère d'Esbly ? D'autant que Houellebecq réplique finement, dans la lettre qui suit, que c'est BHL lui-même qui a parlé de la commune dans un de ses livres. Simplement, il avait "oublié".
Houellebecq est peut-être moins intelligent que BHL, mais il n’est pas le moins subtil des deux. Il raisonne peut-être de façon plus "stratégique" que le philosophe. Il y a un côté « américain » chez BHL, je veux dire « banque de données », je-collecte-tout-on-triera-après (le syndrome NSA, "grandes oreilles", etc.), qui est à peu près absent de l’univers houellebecquien. Houellebecq voit venir de loin. Bernard-Henri Lévy a du mal à voir le monde tel qu’il est, je veux dire à le comprendre : son personnage, qui remplit son paysage, fait écran.
Si l'épisode du "Journal intime" qu'il tient et de sa peur qu'il finisse sur les rayons de l'IMEC (archives de l'édition contemporaine) vire au comique, je suppose que c'est involontairement. Ça commence p. 310, « au bar de l'hôtel Excelsior, à Venise, avec Olivier Corpet, le patron de l'IMEC ». Ça ne pouvait évidemment pas se situer à l'hôtel de la Gare de Gleux-les-Lure, la bourgade qui vit naître le sapeur Camember, un inoubliable 29 février. Ah, Venise !...
Quand Corpet lui soutient que, quelque précaution qu'il prenne, testamentaire ou autre, son Journal atterrira tôt ou tard dans ses collections, il va passer un temps fou « à fabriquer une usine à gaz, à mon avis unique en son genre » pour s'assurer "ante mortem" qu'il n'en sera rien. Et pourquoi tout ce cirque ? Parce que ce Journal « mirifique », « de vingt et quelques mille pages », pas moins, est « plein de secrets plus explosifs les uns que les autres » !! Farpaitement ! On s'en doutait un peu, BH, que ton importance intrinsèque t'a introduit dans le secret des dieux, et que tu te retiens de tout dire, parce que sans ça !
Pour ce qui est du style, je ne sais pas si c’est à Chateaubriand qu’il faut penser, j’ai du mal à faire le lien. Monsieur Lévy écrit par exemple : « … quand on a été ces jeunes gens orageux, frères en apocalypse et en pyromanie … » (p. 279). Désolé, cette enflure verbale me fait penser à Eloge des voleurs de feu, d’un certain Dominique de Villepin. Le lyrisme est souvent ridicule. Sinon, il est volontiers grotesque.
Désolé, ça n’a tout de même pas la gueule de « Levez-vous vite, orages désirés qui devez emporter René sur les rivages d’une autre vie … ». Je m'étonne presque que BHL n'ait pas senti « le vent sifflant dans [sa] chevelure », qu'il a pourtant abondante (peut-être à dessein ?). N'est pas Chateaubriand qui veut. J’ai constamment l’impression qu’ « il se la joue ». BHL mauvais imitateur. Peut-être parce qu'il rêve d'imiter tous les grands noms de la littérature et de la philosophie (sans compter les autres) ?
Sa plume sème aussi, ici ou là, des citations cachées, réservées sans doute à l'élite des initiés. Ainsi, p. 243 : « … le jour où on verra clair dans leur communauté inavouable, … » (un titre du très classieux, très chic et très « fashion » Maurice Blanchot) et, juste en dessous : « … des mouchards, des charognards plaqués sur du vivant … » (réminiscence assez niaise d'Henri Bergson, dans Le Rire).
Pour avoir besoin, à tout moment, de s’en référer à des autorités, on se demande finalement si BHL, le "philosophe" autoproclamé, arrive seulement à la cheville de ceux qui inventent des concepts ou des catégories de la pensée, ceux qu'on appelle, pour le coup, des philosophes. Tout compte fait, il ne semble pas. Il s’est beaucoup démené, il a beaucoup fait, mais qu'a-t-il fait bien ? Il fut peut-être un élève brillantissime, tant mieux pour lui, mais il faut un jour cesser d'être "scolaire". Un jour, il faut choisir, mais choisir, c'est éliminer.
Il frise parfois l’odieux. On trouve par exemple, p. 223 : « Je pense à tous les anonymes qui m’écrivent quand mes livres paraissent, ou que je passe à la radio et à la télé … ». Je ne sais pas vous, mais moi, il y a un mot qui ne passe pas. Le même mot écœurant que les journalistes emploient dans les événements dramatiques, les grands enterrements : c’est le mot « anonymes ». Mais si, ça vous dit sûrement quelque chose, « la foule des anonymes ». Ho BH, tu sais ce qu’il te dit, l’ « anonyme » ? Anonyme mon c..., dirait Zazie ! Moi, je serais plus grossier.
Alors au tour de Houellebecq, à présent. Je crois bien que c’est lui qui déclare : « Nous avons les mêmes ennemis ». Oui, c’est bien possible. Mais, cher monsieur Houellebecq, avec une différence de taille, me semble-t-il : pas pour les mêmes raisons. Je dirais même : pour des raisons opposées. Si BHL a joué les phalènes pour se placer dans la lumière des projecteurs, s’il a fait exprès pourrait-on dire, Houellebecq n’a pas cherché les feux de la rampe : ce sont ses livres, à commencer par le premier, Extension …, qui ont produit l’effet qu’on connaît (sans parler des Particules élémentaires). Ça lui est tombé dessus. C'est du moins ce que je suis enclin à croire.
On me dira qu’il s’est vite habitué. Sans doute, il n'a pas refusé. Je note cependant que son succès et le scandale qui est allé avec n’ont pas dévié d’un centimètre la trajectoire qu’il a imprimée dès le départ à sa production romanesque. Je reste persuadé qu’avant publication de son premier roman, il n’avait pas prévu qu’il déclencherait le schproum qui accompagne désormais chaque parution, et qu'il a alors pris en pleine figure. Ça ne lui a sans doute pas fait de bien, comme s'en inquiète Sollers, cité dans le livre de Dominique Noguez (cf. 3-4 avril).
Cela n’empêche pas Houellebecq de tomber dans la complaisance : « Tout ça pour vous dire, cher Bernard-Henri, que je n’ai aucun mal à vous croire quand vous me dites n’avoir nullement prémédité votre célébrité. J’y ai d’autant moins de mal que je n’ai pour ma part à peu près rien prémédité de ma vie (ou, plus exactement, que tout ce que j’ai prémédité a échoué) » (p. 269). J’espère pour lui qu’il fait semblant. Autant je crois à peu près à la sincérité de MH, autant je doute de celle de BH, que je crois constamment et résolument insincère. On me dira sûrement que je suis de parti pris. Ce n’est pas tout à fait impossible, mais.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, ennemis publics, bhl, bernard-henri lévy, éditions grasset, esbly village, sartre, malraux, chateaubriand, disneyland, georges brassens, imec, gleux-les-lure, sapeur camember, dominique de villepin, éloge des voleurs de feu, maurice blanchot, la communauté inavouable, henri bergson le rire, zazie dans le métro, extension du domaine de la lutte, dominique noguez, houellebecq en fait, philippe sollers, les particules élémentaires
mercredi, 15 avril 2015
ENNEMIS PUBLICS 2 (MH et BH)
2/4
 Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.
Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.
De même, je considère toujours Houellebecq comme un esprit d’une lucidité éminente sur le monde et lui-même. Un des rares à porter un regard neutre sur le merdier dans lequel plonge la civilisation. Une lucidité augmentée d’une franchise étonnante, parfois à la limite de l'impudeur, comme s'il n'en avait rien à foutre. Mais Houellebecq semble guidé de l'intérieur par une nécessité personnelle qui va bien au-delà de sa personne. Le livre esquisse deux façons d’être et de se représenter : ce n’est pas demain la veille qu’un humain se montrera objectif devant son miroir. Le duo/tandem/duel, ici, reste "costume d'époque" (BH) contre (partiellement) "déshabillé" (MH).
La grande différence entre les deux hommes, j’ai en effet l’impression de pouvoir la situer, précisément, dans leur rapport avec le miroir dans lequel ils se regardent et se dépeignent. BHL est peut-être bien plus intelligent que Houellebecq, je ne sais pas, c’est possible. Et ça m'est égal.
Ce qui est sûr, c’est que cet homme est littéralement bouffé par son intelligence, ou plutôt par l’image qu’il s’en est faite. Intellectuellement brillant, c’est incontestable, BHL porte apparemment à bout de bras – si ce n’est aux nues – l'infirmité du fantasme de sa propre intelligence. La preuve, c’est qu’il se prend pour un philosophe. Peut-être pour un penseur.
De même, Bernard-Henri Lévy n’est pas écrasé seulement par le massif cerveau en plâtre qui met fin à ses jours dans l’histoire dessinée par Castaza (cf. hier), mais aussi, littéralement, par la masse des lectures qu’il a faites, par l’énormité de la culture qu’il a accumulée. Je ne cite pas les auteurs auxquels il se réfère : ça n’arrête pas, c’est comme un robinet qu’on a oublié de fermer avant de partir en vacances. BHL est en quelque sorte un dégât des eaux.
Sous la plume de BHL, le Nom Propre prolifère comme le champignon de Champignac dans Z comme Zorglub et L’Ombre du Z. Le même délire onomastique que Yannick Haenel dans Je Cherche l’Italie (cf. mes billets des 14-15 mars), ou Philippe Sollers, très régulièrement à l’oral (pour l’écrit, je n’en sais foutrement rien, parce que devinez).

Le cerveau de BHL doit être bien infirme de quelque part pour éprouver ce besoin maladif de marcher avec autant de béquilles. Personne ne lui a dit qu’il était assez grand pour penser par lui-même ? S’il n’a plus toutes ses références, il a peut-être peur de s’écrouler. Il a besoin du dictionnaire des philosophes et du Who’s who pour mettre un pied devant l’autre. « Le pauvre homme », s’apitoyait Orgon dans (et à propos de) Tartuffe.
Même délire onomastique en ce qui concerne les lieux où l’homme a posé les semelles, du genre : « Je suis de retour à New York, cher Michel, ... » (p. 185), « Je vous écris de Calcutta », « J’étais alors à Bahia », ... Afin que nul n'en ignore : la planète n’a pas de secret pour le philosophe. Délire identique encore pour énumérer les régions où l’intellectuel d’action s’est posé en hélicoptère et en chevalier ardent : Bosnie, Darfour, Tchétchénie, … (notez le zeugma, mais je ne garantis pas l'hélicoptère, c'est « just for fun »).
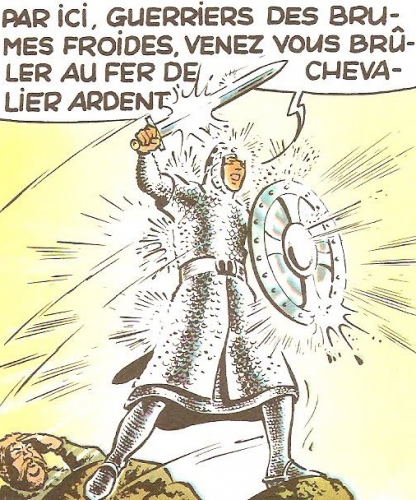
BHL dans ses rêves, Volsungs le barde en est ébloui.
Les Noms Propres ? Comme si la vie de Bernard-Henri Lévy ressemblait en fin de compte à une transposition de la litanie des saints. Il est infoutu de laisser son personnage au vestiaire : il l’emmène partout, un peu comme faisait Alfred Jarry avec son Père Ubu, dont il avait adopté quand il était en société le parler saccadé détachant chaque syllabe (voir le personnage dans Les Faux-monnayeurs, d'André Gide).
Mais Jarry s’affichait, sciemment et tout entier, comme un pur artifice. Il n'y avait pas tromperie sur la marchandise : c'est sans doute de ça qu'il est mort. BHL, lui, quand il sort dans le monde hostile (forcément), dégaine la marionnette qui lui sert à ventriloquer : il est sa propre marionnette. Ça protège.
Alors, le point commun de toutes ces références nominales ? Ce sont des « Grands » ou des « Noms qui frappent », voire des « Autorités », parce que tout le monde les a entendus dans les médias, je veux dire des flashes, des étendards, des pancartes, parfois des banderoles. C’est juste fait pour noyer l'adversaire, pour impressionner : qui oserait ouvrir sa gueule devant ce chapelet ?
Les hooligans, au foot, sont plus souvent dans l’intimidation que dans la violence (mais ça leur arrive). BHL est constamment dans l’intimidation (mais n’hésite pas à menacer un journaliste de lui casser la figure). On finit par se demander : « Mais bon sang, qu’est-ce qui lui manque, pour qu’il éprouve ce besoin de montrer ses muscles ? ». Ce qui ressort aussi de ce salmigondis de noms propres dont BHL soûle son correspondant et le lecteur, c’est, je crois, qu’il se prend pour Malraux. Ou alors Sartre. Peut-être les deux.
Tiens, puisque j'évoque Sartre, j'ajouterai que le "bocal" de BHL est "agité" (coucou, Céline) de deux grands fantasmes : penser le monde aussi superbement (!) que Sartre, agir sur le monde avec autant de « panache » (!) que Malraux (« Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un », André Breton). J’ai l’impression à certains moments qu’il se prend pour ses modèles, comme s’il y était aliéné. Rêve-t-il d’être à lui tout seul une synthèse accomplie de l’expérience humaine ? Si possible sous le coup de l’urgence (dernièrement les chrétiens d’orient) ? Il a besoin de causes pour exister. Et il doit se dire qu'on n’existe jamais autant que dans le regard des autres. D'où les "causes". Quelles que soient les conséquences.
Être sur tous les fronts, ne renoncer à rien. C’est lui qui l’écrit (p. 287) : « Ne pas choisir, voilà la règle », avant d’embrayer sur les bienfaits de l’opportunisme et de la piraterie. Ne pas choisir : c'était donc ça ! Peut-être le seul véritable aveu qu'il nous livre ici. Le problème, c’est que vouloir être partout, c’est risquer de n’être bon, voire de n’exister nulle part. Du coup, j’en viens à me dire qu’après tout, il est bien possible que BHL n’existe pas, tout simplement.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq bhl ennemis publics, bernard-henri lévy, éditions flammarion, éditions grasset, franquin, bande dessinée, champignac, spirou et fantasio, z comme zorglub, l'ombre du z, yannick haenel, je cherche l'italie, philippe sollers, molière tartuffe, françois craenhals, chevalier ardent, alfred jarry, père ubu, andré gide, les faux monnayeurs, andré malraux, jean-paul sartre, louis-ferdinand céline, l'agité du bocal, andré breton
samedi, 04 avril 2015
HOUELLEBECQ PAR NOGUEZ
2/2
 Alors maintenant, à part ça, le bouquin de Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, vous me direz ? Deux ingrédients : des pages d'un journal et des réflexions sur l'œuvre. D’abord les pages concernant Michel Houellebecq, extraites du journal tenu par l’auteur de 1991 à 2003, entrelardées de textes écrits par l’auteur pour la défense de l’écrivain, envoyés aux médias ou destinés au tribunal. Des lettres aussi qu'il lui a adressées. Ensuite, deux études : l’une sur le style houellebecquien, l’autre intitulée « Michel Houellebecq est-il réactionnaire ? ». En gros, quatre parties.
Alors maintenant, à part ça, le bouquin de Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, vous me direz ? Deux ingrédients : des pages d'un journal et des réflexions sur l'œuvre. D’abord les pages concernant Michel Houellebecq, extraites du journal tenu par l’auteur de 1991 à 2003, entrelardées de textes écrits par l’auteur pour la défense de l’écrivain, envoyés aux médias ou destinés au tribunal. Des lettres aussi qu'il lui a adressées. Ensuite, deux études : l’une sur le style houellebecquien, l’autre intitulée « Michel Houellebecq est-il réactionnaire ? ». En gros, quatre parties.
Disons-le, l’étude du style m’est tombée des mains : un relevé énumératif consciencieux des tournures, formules, termes favoris de l’écrivain. Même si tout est juste et bien observé, c’est tout à fait indigeste, comme un découpage de cadavre à la morgue. Que celui qui est allé à l'école lise ! Comme l'écrit Alfred Jarry dans le "Linteau" des Minutes ... (qui, j'imagine, n'a pas de secret pour Noguez) : « ... car il n'y a qu'à regarder, et c'est écrit dessus ».
L’étude sur le « réactionnaire » supposé est en revanche intéressante, montrant que le concept est brumeux et marécageux à souhait, et qu'il fonctionne comme certains bars, où l'on signale au client : « Ici on peut apporter son manger ». Noguez donne trois ou quatre listes de gens peu recommandables, qualifiés successivement de « réactionnaires » par Daniel Lindenberg (Le Rappel à l'ordre) et quelques autres après lui : certains voisinages sont pour le moins étranges ou inattendus. Si "réactionnaire" est un concept, ce qui n'est pas sûr, il est singulièrement élastique, plastique et déformable dans toutes les sauces idéologiques. Pour autant, l’analyse est-elle efficace ? Peut-elle servir à quelque chose ? Pas sûr.
Les « éléments » du langage mouliné en permanence par les médias privatisés (qui ont contaminé les chaînes publiques, que plus grand-chose n'en distingue) se moque allègrement de ce qu’on appelait autrefois la « justesse des termes » (cela s’appelle aussi la « rigueur intellectuelle »). Le média spectaculaire régnant (la télévision) se contente de la vitesse et de l'éclat de l’expression, au mépris de son poids, de son exactitude et de sa profondeur. La catastrophe « Philippe Sollers » a triomphé. Briller est un impératif.
Je crois, monsieur Noguez, qu’il ne sert à rien de définir le mot « réactionnaire » : tout le monde s’en fout. Son rôle est de servir de flash (de piquouse), d’étiquette, d’identifiant immédiat, de blason, d'étendard, voire de mot de passe. Bientôt peut-être de lieu de détention.
C’est la tâche de purification lexicale assignée par les tenants de la nouvelle « bien-pensance » (p. 252) à quelques projectiles fabriqués spécialement à l'intention des survivants de l’esprit critique et de la liberté de penser (qu’il suffit, pour les disqualifier, de désigner « facho », « macho », « réac », « sexiste », « homophobe », et j’en passe). S’attarder sur le contour du mot « réactionnaire », je vais vous dire, c’est du temps perdu. Dans un duel arme au poing, l’explication rationnelle et argumentée est programmée pour échouer.
Dominique Noguez est écrivain. Je n’en doute pas. Pas plus qu’il ne doute des qualités de son livre Les Derniers jours du monde. Je dirai ce que j’en pense quand je l’aurai lu. Mais, comme Daniel1, le personnage de La Possibilité d’une île, il est foncièrement honnête (bien que j'ignore l'extension sémantique exacte du mot "foncièrement" dans ce contexte) où on lit : « ... j'étais, par rapport aux normes en usage dans l'humanité, d'une honnêteté presque incroyable » (p. 400), phrase qui sonne a posteriori comme une déclaration de théorie littéraire.
Car Houellebecq lui-même est honnête, en ce que ses livres ne se racontent pas d'histoire. Etonnant comme ses fictions romanesques semblent porteuses d'une vérité très nue, presque écorchée (peut-être ce qui le rend insupportable aux yeux de beaucoup). Houellebecq déclare ainsi à Frédéric Martel : « Je connais les réponses simples, celles qui vous font aimer de tous (…) ; si je ne les emploie pas ce n’est pas par provocation, mais par honnêteté » (cité p. 252). Noguez est donc honnête : il reconnaît que Houellebecq est un plus grand écrivain que lui. Il n’est pas jaloux. Il a au moins ce mérite, et cela m’incite à aller y voir de plus près.
Il écrit d’un roman de M. H. (Extension du domaine de la lutte) : « Après trois lectures, je tiens que ce roman est un des plus grands d’aujourd’hui. Je dis bien "d’aujourd’hui". Je n’en vois pas en effet qui disent mieux un certain nouvel air du temps – du temps social et économique – que celui-là » (pp. 29-30). Il écrit ça en 1994, c’est-à-dire avant Les Particules élémentaires, avant La Carte et le territoire. Je regrette quant à moi de l’avoir lu après ces deux livres, beaucoup plus forts et accomplis, auprès desquels Extension … fait un peu pâle figure, tout en tenant fort bien son rang : l’univers maintenant bien connu de l’auteur est déjà pleinement présent.
Noguez, tenant son journal, montre donc qu'il est intervenu en faveur de Michel Houellebecq, dans la presse comme critique, au tribunal comme témoin de la défense. Il lui écrit aussi des lettres, où il note ses impressions de lecture, par exemple sur Les Particules ….
Le procès intenté contre l’auteur de ce roman à parution ajoute au ridicule du motif le contradictoire de la chose : un directeur réclamant l’anonymat pour le camping qu’il dirige reproche à M. H. de donner des informations qui permettent de le reconnaître et situer. Evidemment, l’action en justice donne une publicité énorme à ce qui serait resté inaperçu et cru fictif s'il avait fait le mort. Conclusion de Noguez : « Cela ressemble fort à une opération publicitaire faite sur le dos de la littérature » (p. 62). Auguste en personne aurait dit « tout juste ».
Le procès intenté par Dalil Boubakeur, de la grande mosquée de Paris, suite à la publication de Plateforme, est plus crucial et plus révélateur. Houellebecq islamophobe ? Et alors, quand bien même ? Ne pas aimer l'islam est un droit, que je ne me prive pas d'exercer pour mon propre compte, moi qui suis, de façon générale, religio-incompatible. Noguez écrit : « Avoir un avis sur les religions, préférer l’une à l’autre ou les rejeter toutes relève de la liberté d’expression la plus élémentaire dans une démocratie comme la nôtre » (p. 211). Je ne peux qu’approuver. J'irais même volontiers plus loin, jusqu'à paraphraser Lino Ventura dans Les Tontons, à propos de Claude Rich, le petit ami de sa protégée : « ... il commence à me les briser menu ».
Et Noguez de rappeler que M. H. n’est pas le premier à traiter l’islam de « religion la plus stupide », avec des citations de Montaigne, Pierre Charron, Pascal, Spinoza, Tocqueville, etc. (p. 210). Voltaire n’a-t-il pas écrit une pièce de théâtre intitulée Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète ? Jusqu’au respectable Claude Lévi-Strauss qui y voit « une religion de corps de garde » (p. 211, ce que l’actualité nous confirme tous les jours).
Là où j'ai le grand plaisir de me retrouver en bonne compagnie, dans ce livre, c’est chaque fois que Dominique Noguez aborde la question de la « bien-pensance » et de l’ambiance policière qu’elle tend à instaurer dans le monde de la pensée, de la création et de l’expression, amalgamant sans sourciller des actes répréhensibles ou délinquants et des personnages éventuellement déviants, mais pures créatures fictives. Noguez se paie en passant Claire Brisset, la « Défenseure » (!) des enfants, « une folle avérée » (p. 176, mais il ne la nomme que trois pages plus loin – par prudence ? –, je précise que c’est moi qui interprète) : certaines formules font du bien, c’est sûr. Du coup, on se sent moins seul.
Là aussi où j’ai l’impression de trouver une « tribu » où je puisse me sentir un peu moins mal dans mon époque, c’est en apprenant que Dominique Noguez a donné une conférence intitulée « Le livre sans nom » (BNF, 15 décembre 1999), qu’il évoque dans la note 48 (p. 165) : « J’y donnais, comme explication de la multiplication actuelle des procès en matière de littérature, "l’immense privatisation de tout à laquelle on assiste depuis une douzaine d’années" dans les sociétés occidentales capitalistes ou, plus exactement, dans la manière dont elles se donnent à voir. "Tandis que la fiction romanesque semble saisie d’un appétit de plus en plus grand de réalité, ajoutais-je, la réalité qu’elle veut ingurgiter se privatise et se dérobe. Il n’y a plus de nature, il y a des propriétés privées ; plus de pays, mais des multinationales ; plus de ville, mais des chaînes de magasins et des marques ; plus de foule, mais des individus qui peuvent interdire ou monnayer leur image." (Publié dans La Nouvelle Revue Française n° 555, octobre 2000) ». Je salue l'expression "l'immense privatisation de tout". Les curieux peuvent se reporter à mon billet du 17 mars, où j'évoque « La Grande Privatisation de Tout » (GPT pour les intimes). Depuis la publication de Houellebecq, en fait, il y a douze ans, Noguez à dû pouvoir constater la nette aggravation du processus. Mais quand même, ça fait plaisir de se retrouver en pays de connaissance. Je me dis : chouette, encore un que Laurent Joffrin ne doit pas porter dans son cœur !
Tiens, à propos de Laurent Joffrin, voici ce qu’on lit p. 229, à propos d’un article sur « les nouveaux réactionnaires » : « Pour sa phrase sur l’islam, "l’excellent Laurent Joffrin", explique-t-il [il s'agit de Houellebecq], l’a traité dans Le Nouvel Observateur de "beauf lambda" ». J’imagine que la phrase en question est celle où il qualifie l’islam de « religion la plus stupide » (voir plus haut). Je renvoie à mes deux billets consacrés à ce monsieur. Houellebecq et Noguez doivent se dire, à la façon de Courteline : « Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet ». Si j’étais à leur place, c’est en tout cas ce qui me viendrait à l’esprit. Avec délectation.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, dominique noguez, houellebecq en fait, réactionnaire, lindenberg les nouveaux réactionnaires, alfred jarry, minutes de sable mémorial, philippe sollers, les derniers jours du monde, la possibilité d'une île, frédéric martel, extension du doomaine de la lutte, les particules élémentaires, la carte et le territoire, dalil boubakeur, grande mosquée de paris, plateforme, voltaire, le fanatisme ou mahomet le prophète, islam, claude lévi-strauss, claire brisset, laurent joffrin, le nouvel observateur
vendredi, 03 avril 2015
HOUELLEBECQ PAR NOGUEZ
1/2
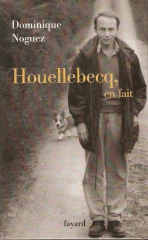 Sur l’œuvre de Michel Houellebecq, nul ne peut apprendre à Dominique Noguez quoi que ce soit qu’il ne sache déjà. Rien de ce que l’écrivain a publié ne lui est étranger. Et si l’on admet que l’un et l’autre sont de véritables amis (aucune raison d’en douter), on se dira que Dominique sait de Michel des choses qu’il ne mettra jamais sur la place publique. Je l’espère en tout cas. C’est aussi ce que je me disais de la relation de Bernard Maris avec l’auteur des Particules élémentaires, que je n'ai d'ailleurs apprise qu'au moment de son assassinat.
Sur l’œuvre de Michel Houellebecq, nul ne peut apprendre à Dominique Noguez quoi que ce soit qu’il ne sache déjà. Rien de ce que l’écrivain a publié ne lui est étranger. Et si l’on admet que l’un et l’autre sont de véritables amis (aucune raison d’en douter), on se dira que Dominique sait de Michel des choses qu’il ne mettra jamais sur la place publique. Je l’espère en tout cas. C’est aussi ce que je me disais de la relation de Bernard Maris avec l’auteur des Particules élémentaires, que je n'ai d'ailleurs apprise qu'au moment de son assassinat.
Le point commun entre Bernard Maris et Dominique Noguez, c’est qu’ils ont publié des choses sur Houellebecq, mais il m’étonnerait fort que leurs liens aient été très étroits. Je ne sais rien de la vie privée de Bernard Maris, mais je ne le vois pas fréquenter les mêmes cercles que Noguez. J’ai évoqué ici Houellebecq économiste (11-12, puis 29-30 mars), écrit par le premier. Je viens de lire Houellebecq, en fait, du second. Je n’aurais peut-être pas dû.
Je l’avoue, je ne connaissais rien de l’œuvre littéraire de ce monsieur. J’ai découvert que, comme il a travaillé sur Alfred Jarry, il ne saurait être entièrement mauvais. En effet, si j’en crois la rubrique « Du même auteur », il a publié L’Arc-en-ciel des humours. Jarry, Dada, Vian, etc..
Jarry, c’est bien, c’est la ‘Pataphysique, c'est l'invention du Curateur Inamovible du Collège, un Docteur riche de vingt-sept chefs d'œuvre de la littérature en butte aux tracasseries d'un huissier au nom inoubliable ; un Docteur qui pisse dans des bateaux qui flottent tout en étant percés ; un Docteur qui va "de Paris à Paris par mer" tout en restant sur la terre ferme, tout en persécutant un singe papion intitulé Bosse-de-Nage et qui ne sait dire que "Ha ha", bref : quelqu'un de bien.
Vian, ce n’est pas mal, bien que ce soit, en 'Pataphysique, une pièce rapportée. Son Mémoire concernant le calcul numérique de Dieu par des méthodes simples et fausses est finalement bien laborieux, comparé au chapitre "De la surface de Dieu", dans le Faustroll de son glorieux prédécesseur.
Je ne peux m'empêcher de voir dans Boris Vian ou Raymond Queneau des écrivains surévalués (une certaine idée de la modernité, tout ça ..., pardon aux mânes de Noël Arnaud), mais bon, admettons ; en revanche, pour Dada, je me demande un peu ce qui lui prend, à Noguez : pas de vide humoristique plus abyssal que chez Dada (ainsi que chez André Breton). Mais j’irai sans doute mettre le nez dans son bouquin : je ne demande qu’à m’instruire.
En attendant, l’ouvrage qu’il consacrait à son ami Houellebecq en 2003 m’a somme toute intéressé, même si j’ai des reproches à lui faire. D’abord, je regrette d’avoir découvert quelques aspects de la personne privée de Michel Houellebecq. La peste soit de la "société du spectacle" et de tous les Gustave Lanson ou Bernard Pivot, l’un parce qu’il a fait de la loi dichotomique de « L’homme-et-l’œuvre » un parcours obligé, l’autre à cause de sa manie d’interroger les écrivains qu’il invitait sur son plateau sur la part d’eux-mêmes qu’ils avaient mise dans leurs livres de fiction, vous savez, ces bouquins qui portent sur la couverture la mention "roman".
 Je me fiche de savoir ce qu’éprouve un poète ou un écrivain dans sa vie privée, à quelle heure il se couche, la boisson qu’il préfère (taux d'alcool, état après imbibition, sortie du coma, ...), sa façon d’aimer, que sais-je. Viendrait-il à l’idée de Pivot de demander à Jean Nouvel quelle part de lui figure dans le futur immeuble Ycone qu’il a dessiné pour la Confluence à Lyon (ci-contre) ? A voir le projet, j’aime à croire, pour la seule préservation de son équilibre psychique, que la réponse serait : « Rien ».
Je me fiche de savoir ce qu’éprouve un poète ou un écrivain dans sa vie privée, à quelle heure il se couche, la boisson qu’il préfère (taux d'alcool, état après imbibition, sortie du coma, ...), sa façon d’aimer, que sais-je. Viendrait-il à l’idée de Pivot de demander à Jean Nouvel quelle part de lui figure dans le futur immeuble Ycone qu’il a dessiné pour la Confluence à Lyon (ci-contre) ? A voir le projet, j’aime à croire, pour la seule préservation de son équilibre psychique, que la réponse serait : « Rien ».
Quand la vie et la personne d'un artiste deviennent un spectacle, son œuvre a du mouron à se faire pour son avenir : qu'y a-t-il de plus futile et combustible que la vie d'un individu, fût-il artiste ? Depuis l'aube de la curiosité humaine pour le monde, ce qui reste d'un individu, c'est son œuvre. Et encore : la plupart sont purement et simplement effacés de la surface et des mémoires. Le "devoir de mémoire" est une fumisterie.
Je me contrefiche d’apprendre quoi que ce soit d’autobiographique sur le bonhomme qui a tenu la plume : je sais pertinemment qu’un auteur se sert forcément, pour écrire un roman, du matériau qu’il connaît le mieux (quoique …) et qu’il a le plus directement à disposition sous la main : lui-même.
Les plus grandes œuvres de l'art et de la littérature sont composées à 100 % du bonhomme, auxquels s'ajoutent les 100 % de l’art qu’il y a déployé. Aux petits comptables, aux Lagarde-et-Michard, aux chefs de bureau et aux médecins légistes de faire ensuite le départ et de disséquer. La littérature commence après la question : qu’en a-t-il fait, de ce matériau ? Qu'est-ce que ça donne à l'arrivée ? Quel édifice a-t-il construit ? De quelle œuvre est-il l’auteur ?
Étonnant comme les animateurs, journalistes, "critiques", dans les "talk shows" (pardon) qui jalonnent la « tournée de promo » obligatoire, sont capables d’interroger les écrivains sur ce qu’ils sont (personnalité, penchants, musiques et yaourts préférés et autres fadaises genre questionnaires Proust) éprouvent, aiment, détestent, pensent, mais rarement sur ce qu'ils font, je veux dire sur les caractéristiques proprement littéraires du livre qu’ils viennent d’écrire.
La littérature n'intéresse guère les critiques littéraires. Ils veulent du vivant, de la tripe, du saignant. Au fond, le spectacle télévisuel qu'a fini par imposer "Apostrophes", a définitivement donné la priorité à « l'homme » sur « l'œuvre ». Et parmi les invités de Pivot, priorité au meilleur camelot vendeur de salade (à preuve les ventes en librairies dès le lendemain).
Voilà le rideau que je regrette d’avoir soulevé sur la personne privée qu’est Michel Houellebecq, d’autant qu’en plusieurs occasions, l’écrivain est loin d’être présenté à son avantage (l’état dans lequel il s’est mis quand il entre au "Queen", sur les Champs-Elysées !). Parfois, c’est même pire. A cet égard, je me permets de trouver ce livre bien indiscret. De la part d’un qui se dit son ami, c’est plutôt malvenu, je trouve.
Le deuxième reproche que je fais à Noguez, c’est de montrer les coulisses du petit bocal où évoluent les cyprins de la littérature parisienne : repas en ville, réceptions, soirées, copinage en bande, éditeurs, organes de presse, impression que tout le monde se connaît. J’imagine que l’auteur, par son ancienneté dans le métier ou par ses fonctions dans la profession, a tissé des relations multiples. La description des mœurs de ce petit monde parisien, avec énumération des gens présents ou rencontrés, rend celui-ci tout au plus antipathique. On n'est parfois pas loin de la rubrique mondaine et des pages "pipeul".
Je me moque éperdument de croiser au détour des pages des gens comme Arnaud Viviant, le péremptoire rayonnant du Masque et la Plume. Par curiosité, on peut se reporter au traitement de faveur que le grand Philippe Muray fait subir à ce « roquet des Inrocks » dans Après l’Histoire II (Essais, Belles Lettres, p. 451-452). Sa majesté Philippe Sollers a lui aussi une place de choix dans le bouquin : rien que le nom de ce type me rendrait presque la lecture pénible. Bon, c’est vrai que ces messieurs font partie des défenseurs de Houellebecq. Je me demande bien pour quelle raison.
Pour moi, Houellebecq et Sollers n'ont pas grand-chose à faire sur le même plateau. Mais peut-être qu'après tout, le second reconnaît en le premier un maître. Allez savoir.
Je ne parle pas de Viviant. Evidemment.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, dominique noguez, particules élémentaires, bernard maris, houellebecq économiste, houellebecq en fait, l'arc en ciel des humours, docteur faustroll, bosse-de-nage, pataphysique, collège de pataphysique, boris vian, raymond queneau, noël arnaud, dada, dadaïsme, gustave lanson, bernard pivot, lagarde et michard, jean nouvel ycone, lyon la confluence, devoir de mémoire, questionnaire proust, émission apostrophes, philippe sollers, philippe muray, arnaud viviant, les inrockuptibles
samedi, 14 mars 2015
YANNICK HAENEL, C'EST QUOI ?
1/2
 J’ai acheté puis lu Je Cherche l’Italie après avoir entendu Yannick Haenel en parler lors d’une interview radiophonique. Tewfik Hakem avait fait un parallèle entre cet ouvrage et l’univers houellebecquien. L’interview avait mis l’accent sur un aspect de la démarche : Haenel est allé vivre à Florence en emmenant femme et enfant, pendant trois ans. L’auteur décrivait la catastrophe dans laquelle la « modernité » économique, personnifiée dans cette verrue obscène qui a nom Berlusconi, avait plongé l’Italie. Le discours attirait mon attention.
J’ai acheté puis lu Je Cherche l’Italie après avoir entendu Yannick Haenel en parler lors d’une interview radiophonique. Tewfik Hakem avait fait un parallèle entre cet ouvrage et l’univers houellebecquien. L’interview avait mis l’accent sur un aspect de la démarche : Haenel est allé vivre à Florence en emmenant femme et enfant, pendant trois ans. L’auteur décrivait la catastrophe dans laquelle la « modernité » économique, personnifiée dans cette verrue obscène qui a nom Berlusconi, avait plongé l’Italie. Le discours attirait mon attention.
A l’entendre, au cours de son séjour, il n’avait pas rencontré d’Italiens : seulement des Sénégalais, qui refusaient de parler le français qu’ils connaissent, et ne s’exprimaient qu’en italien. A l’entendre, son livre était majoritairement consacré au tableau apocalyptique qu’il dressait de l’Etat italien et de sa décomposition, et du sort misérable dans lequel vivaient les dits Sénégalais, exposés aux cruautés des mafias qui les exploitaient et les terrorisaient. C’est cela qui avait motivé mon achat : je m’attendais à lire l’œuvre d’un cousin de Houellebecq, et apprendre des choses sur l’état du monde.
Quelques pages m’ont suffi pour déchanter. Il m’a donc fallu un rien d’obstination pour achever ma lecture : je tenais à ne pas avoir claqué pour rien 17,5 €. Autant rentabiliser. Heureusement, le livre est léger (à peine 200 pages), mais léger à tous les sens du terme. Futile comme un fétu qui fuit au vent mauvais qui l'emporte, pareil à la feuille morte. En un mot : un livre inutile. La parenté supposée avec Michel Houellebecq est une pure postulation imaginaire. Une maldonne. Une imposture.
D’ailleurs, au cours de l’interview, Yannick Haenel a tenu à se démarquer de ce cousinage hasardeux et encombrant. Pour lui, la littérature de Houellebecq est marquée par une détestable haine de soi et du monde. Autant dire, à ce stade, que Yannick Haenel ignore ce que peut (doit ?) être la grande littérature, syndrome largement partagé par les poissons et les grenouilles qui s’ébattent dans le marigot littéraire parisien. Yannick Haenel est l’un des innombrables descendants de « La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf ».
Qu’en est-il des Sénégalais italiens, dans Je Cherche l’Italie ? On en croise un, très vaguement, aux pages 12 et 13 : « Le jeune Noir était sénégalais, il venait de l’île de Gorée ». Ah, l’île de Gorée, Obama demandant pardon au continent africain pour le honteux trafic d’êtres humains à travers l’Atlantique ! Quel symbole !
Et puis le jeune Noir refait une apparition aux pages 119 à 121, où l’on apprend que son prénom, Issa, est le nom arabe de Jésus. Au total, trois pages de texte. Un point c’est tout. Autrement dit une crotte de mouche. La réalité sordide dans laquelle est plongée l’Italie fait l’objet de quelques flashs, allusions et incidentes, trop courts cependant pour former un sujet à part entière. Encore moins former le sujet du livre. L’interview radio faisait une publicité mensongère. Comme souvent, quand un auteur est doué oralement pour vendre sa camelote. Bien fait pour moi. Ça m’apprendra. Peut-être.
Bon, alors de quoi parle-t-il, ce bouquin ? Eh bien c’est très simple : Yannick Haenel parle de Yannick Haenel. C’est un truc très à la mode dans le marigot littéraire parisien : Christine Angot parle de Christine Angot ; Emmanuel Carrère parle d’Emmanuel Carrère…. Alors pourquoi pas lui, n’est-ce pas ? Qu’ont-ils donc tous, à faire étalage de leur moi ? De leur agenda ? De leurs petites réflexions sur eux-mêmes et le sens de la vie ?
Mais attention, Yannick Haenel ne parle pas de lui-même comme s'il était n’importe qui. Yannick Haenel n’est pas le premier venu, il faut que ça se sache. Cet homme est tellement plein de lui-même que toute sa prose exsude son moi comme s’il en pleuvait. Il arrose la compagnie de l’onction de soi-même, plus fort que Dassault n’achète ses électeurs. Il faut que le lecteur sache qu’il est en face d’un intelligent, qui fait profession d’intelligence et de culture : Yannick Haenel en personne.
Et puis il faut aussi qu’on sache que l’auteur est en très bonne et très auguste compagnie. C’est ainsi que le lecteur est invité à assister à un déluge : c’est, de la première à la dernière page, une cataracte, une avalanche de noms propres, de références, toutes plus savantes les unes que les autres. Une ribambelle de noms propres assez connus pour être incontestables, assez haut placés pour inspirer le respect. Une forêt d’oriflammes brandis comme des slogans. Attention les yeux ! Yannick Haenel vous en met plein la vue.
Vous ne savez plus où donner de la tête : entre les références à Nietzsche et les commentaires sur Georges Bataille (omniprésent tout au long des pages, pensez, il lit chacun des douze volumes de ses Œuvres complètes (Gallimard, des gros pavés) dans l’ordre chronologique), l’auteur vous assène : « Je lis Hegel, Bataille, Kojève » (p. 73). Ici, ce sera un « dropping » de Rimbaud, là un miasme de Maurice Blanchot, ailleurs une crotte de Guy Debord, plus loin, quelques relents de La Divine Comédie, etc.
Cette toile de fond de noms propres à grosse réputation, je vais vous dire, c’est juste fait pour intimider, exactement comme les hooligans se servent des signes d’une violence possible pour se rendre maîtres du terrain. Là, ce n’est plus dans la vue, c’est dans les gencives, car Hegel, il faut vraiment vouloir : quel héroïsme, quand même, ce garçon. Essayez seulement la « Préface » à La Phénoménologie de l’Esprit. Mais mon esprit épais et rustique est rétif à la philosophie, du moins ainsi entendue. Question d'altitude, sans doute.
Et puis, une bonne projection de postillons de noms propres à prestige dans la figure de l'interlocuteur, au fond, pas de meilleur moyen pour ne pas entrer dans le détail des problématiques propres à chacun. "Je lis Hegel", c'est comme un cuistot qui vous dit "ça mitonne", mais se garde bien de soulever le couvercle pour vous faire renifler la réalité de sa tambouille. Ça évite de fatiguer le lecteur, en même temps que ça le muselle. Je me rappelle quelques prestations et articles d’un certain Philippe Sollers, où celui-ci, tel un Larousse des noms propres, semait pareillement à tout vent les références savantes, pour dire que, n’est-ce pas …
C’est peut-être un hasard (mais j’en doute) si Je Cherche l’Italie est publié dans la collection « L’infini », dirigée par … Philippe Sollers. Toujours côté noms propres : « Qu’est-ce qui échappe au capitalisme ? L’amour ? La poésie ? Lacan disait : la sainteté » (p. 89). Et toc : voilà pour Lacan. Et puis avec le Sénégalais : « Comment s’appellent tes dieux ? – Chrétien de Troyes, Dante, Kafka ».
Yannick Haenel a mis toute la culture européenne et chrétienne dans son grand sac. Du moins, en affiche-t-il un concentré des signes prestigieux de la culture. En porte-t-il la chose ? On n'est pas forcé de le croire.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yannick haenel, je cherche l'italie, éditions gallimard, collection l'infini, philippe sollers, france culture, tewfik hakem, un autre jour est possible, michel houellebecq, silvio berlusconi, italie, mafia, littérature française, île de gorée, christine angot, emmanuel carrère, serge dassault, georges bataille, hegel, kojève, guy debord, la phénoménologie de l'esprit, jacques lacan
lundi, 26 janvier 2015
CHRISTINE ANGOT A LA HAINE 2/?
2
Oui, je n’aurais rien dit, mais voilà, celle qui n’a aucune parenté avec la seule Madame Angot qui vaille à mes yeux (ou plutôt à mes oreilles : c'est la fille de la dame, selon Charles Lecoq), n’est pas seulement « écrivain » : elle est aussi, avec une apparente satisfaction, un personnage médiatique important. Elle consent à se laisser présenter à l’occasion micros et caméras quand des journalistes en mal de papier font appel à elle pour remplir leurs obligations, croient-ils, professionnelles.

Sous la direction de Jésus Etcheverry.
Et puis là, elle se laisse offrir, avec répugnance (qu'elle prétend, mais elle ne répugne pas longtemps), une page entière du Monde (daté 16 janvier). Quatre colonnes larges et bien tassées. Si la dame n’est pas une autorité, au moins est-on sûr qu’elle « a de la surface ». Et des relations bien placées.
Au moins est-on sûr qu'elle est du bon côté de l'establishment, tous gens garnis de bonne conscience, sûrs de leur bon droit, édictant au nom de l'Empire du Bien (cf. Philippe Muray) ce qu'il est loisible, voire licite de faire, et ce qui doit être conduit devant les tribunaux populaires.
Toute un grande page du Monde, donc. Et pour parler de quoi ? De qui ? De Houellebecq ! Farpaitement. Angot qui se mêle de critique littéraire ! On aura tout vu ! Il est vrai que certains enfants croient mordicus que c'est à eux d'apprendre à leur mère à faire des enfants ! Au point où on en est !...
Notez que si je l’ai traitée de « pauvre pomme tombée d’un poirier », c’est qu’elle l’a bien cherché. Pensez, sous le gros pavé du titre (« C’est pas le moment de chroniquer Houellebecq », mais dans le texte, elle met la négation, c’est bien un coup du Monde, ça), elle n’y va pas par quatre chemins : Houellebecq, elle n’aime pas. C'est son droit. Ensuite, ça dépend de la façon dont on s'y prend pour le dire.
Moi, Houellebecq, je ne le connais pas. Ce que je connais, ce sont ses romans. Et ce que je sais, c'est que ces romans sont les meilleurs que j'aie lus, tous auteurs français confondus, depuis fort longtemps, quoi qu'en disent des gens que j'ai appréciés par ailleurs. Par exemple Eric Naulleau, qui traite Houellebecq de « romancier de gare » en 2005 (Au Secours, Houellebecq revient !, Chiflet et Cie). Je ne sais pas s'il est revenu entre-temps sur cette erreur manifeste de jugement.
Naulleau s'est racheté en 2008 en assaisonnant Christine Angot, façon pimentée, qu'il habillait pour les hivers les plus rigoureux, dans un livre très drôle et très juste : Le Jourde et Naulleau, Mango. Ma doué, quelle avoinée il lui mettait ! Comme quoi les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis, mais j'ai de l'affection pour certains. D'autant plus que je note que Houellebecq ne figure pas dans le jeu de massacre auquel se livrent les deux compères dans leur bouquin. S'il n'y a pas amende honorable, on n'est pas loin. Et ça rassure.
Exemple de prose sur laquelle Naulleau dirigeait ses boulets rouges, pour montrer de quoi la dame est capable : « Vous avez beaucoup approuvé la construction de L'Inceste, qu'elle était remarquable. C'était complètement un hasard, c'était un moteur en marche, ça suffit vos appréciations, stylistiques, narrotologiques [sic], techniques. Construit, construit veut dire enfermé, enfermé veut dire emprisonné, emprisonné veut dire puni, puni veut dire bêtise, bêtise veut dire faute, faute, erreur, erreur, faute de goût ou morale très grave, moi je n'ai rien fait de mal donc il n'y a aucune raison que je me construise une raison et une construction. Compris cette fois, Quitter la ville, pas de construction » (Quitter la ville, p.79, cité p. 29 du livre de Jourde et Naulleau). Angot, c'est bête, à chaque nouveau bouquin, j'entrouvre, je feuillette, ça confirme, je repose. Vous comprenez maintenant pourquoi.
Je passe sur l'état larvaire de la langue et sur l'infantilisme qui conclut le tout à fait étrange enchaînement associatif (« Mais j'ai rien fait, m'sieur ! »). Je note juste que l'auteur propose le magma et le chaos de la pensée (si on peut appeler ça pensée) comme principe de création littéraire. C'est pourquoi le relatif succès de ses livres comporte quelque chose d'inquiétant quant à l'état intellectuel de la partie de la population qui les achète.
Aux yeux des autres (ceux qui ne lisent pas ça), j'espère que ce bref aperçu sur la panade que constitue la prose de la dame rend superflu une analyse en détail. Chacun peut percevoir l'état pathétique de ce que des esprits aveuglés, stipendiés ou pervers n'hésitent pas à appeler une entreprise littéraire innovante. Tout juste bonne, l'entreprise littéraire innovante, à finir dans une poubelle du musée de l'Art Brut (vous savez, cette PME spécialisée dans le recyclage des déchets de l'Art).
Houellebecq, Angot ne l'aime pas. On commence à comprendre pourquoi. Elle le dit, et ça m'a tout l'air d'être viscéral. Alors là, je dis non : « Touche pas à mon Houellebecq ! ». Remarque, je dis ça pour pasticher, parce qu'il se défend très bien tout seul, celui qui vient de perdre son ami Bernard Maris. Bel élan d’humanité, belle élégance du geste, soit dit en passant, de la dénommée Christine Angot en direction de l’équipe de Charlie Hebdo, que de s'en prendre à un livre que le dit Bernard Maris venait d'encenser dans l'hebdomadaire, dans son tout dernier article.
Quoi, toute une belle page du « journal de référence » ! Et pour dégoiser quel genre de gandoises, s’il vous plaît ? Remarquez qu’on pouvait s’y attendre : la démonstration lumineuse que Christine Angot n’a rien compris. Houellebecq, elle n’y entrave que pouic. Rien de rien. J’ajoute que par-dessus le marché, elle n’a sans doute aucune idée de ce qu'est la chose littéraire. Bon, elle n’est pas la seule à sortir des sottises au sujet de « l’écrivain controversé ». Dans le genre gognandises savantes, j’ai entendu de belles pommes tomber aussi de la bouche poirière d’un certain Eric Fassin. J’en ai parlé.
Et puis Houellebecq n’est pas le seul à subir les foudres féminines. Il n’y a pas si longtemps (2012), l’excellent Richard Millet s’est fait dégommer par la très oubliable Annie Ernaux qui, dans une tribune parue dans Le Monde (tiens tiens !), traitait l’auteur de « fasciste ». Rien de moins. Il faut dire que le cousin n’y allait pas de main morte : faire l’éloge "littéraire" d’Anders Breivik, auteur d’une tuerie en Norvège, était pour le moins une prise de risque.
Certaines femmes n’aiment vraiment pas les mots de certains hommes ! Elles sont les modernes Fouquier-Tinville. C'est sûrement un hasard : Millet, Houellebecq, Philippe Muray en son temps, vous ne trouvez pas que ça commence à dessiner un profil ? Comme si des rôles étaient en train de se distribuer. D'un côté, tous ceux (en l'occurrence toutes celles) qui lancent des fatwas. De l'autre, ... c'est facile à deviner. Gare la suite !
C’est dans un jardin public de Tarbes que Jean Paulhan trouva l’idée d’un de ses titres (Les Fleurs de Tarbes), parce qu’il avait lu cette inscription à l’entrée : « Il est interdit d’entrer dans le jardin avec des fleurs à la main » (si je me souviens bien). Le sous-titre était plus explicite : « La Terreur dans les Lettres ». La Terreur, il n'y a pas seulement celle de fanatiques qui répandent le sang pour la gloire d’Allah (ou d'Akbar, je n’ai pas bien compris de qui il s’agit, peut-être deux frangins ?), il y a aussi celle de fanatiques socio-culturels, bien décidés à imposer dans les esprits leur propre conception de l'art, de la littérature et de la vie en société. A faire régner leur ordre.
Après la Terreur de la vérité maoïste imposée en son temps par Tel Quel et Philippe Sollers (dont Simon Leys a fait amplement et durablement les frais), la Terreur des impératifs moraux selon les Papesses Jeanne des Lettres françaises actuelles, Annie Ernaux et Christine Angot. Les temps changent, la Terreur reste.
Nous sommes pris entre celle que font régner les modernes Fouquier-Tinville et celle que lancent des imams (quand ce ne sont pas des ayatollahs). Sale temps pour la culture et la vie de l'esprit. Il y aura toujours des braves gens pour tirer la chevillette pour faire choir la bobinette de la guillotine morale sur le cou des créateurs de littérature. Virtuel, le cou, heureusement. Tant que ce ne sont pas des balles islamistes qui le coupent ...
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, christine angot, michel houellebecq, soumission, la fille de madame angot, charles lecoq, journal le monde, l'empire du bien, philippe muray, éric naulleau, au secours houellebecq revient, pierre jourde, le jourde et naulleau, musée de l'art brut, charlie hebdo, bernard maris, oncle bernard, éric fassin, richard millet, anders behring breivik, annie ernaux, fouquier-tinville, jean paulhan, les fleurs de tarbes, la terreur, tel quel, philippe sollers
mardi, 02 avril 2013
DE L'EXPANSION DE L'UNIVERS (ARTISTIQUE)

LE REVOLVER "1892", CALIBRE 8 mm
(après le Mauser C96, le Luger P08, et même le Webley 455 britannique, sans parler du Colt 1911, les performances balistiques de la munition furent considérées, avec raison, comme des plus médiocres, même si l'arme reste classée en 1ère catégorie)
***
On a vu que l’artiste actuel essaie de se faire passer pour un scientifique, dont il imite l’activité de recherche, sans pouvoir prétendre au même degré de scientificité que lui. Il ne parle plus de ses « œuvres », ni même de ses « ouvrages », mais du terme très neutre de « travail ». Il la joue modeste. Il a compris que c'est son intérêt, même si cette modestie cache un immense orgueil.
Il va de soi qu’une telle évolution ouvre la voie à une foule de gamins qui auraient reculé devant l’effort et l’abnégation que suppose le métier. Et comme il faut donner du boulot à toute la surpopulation, il n’y a pas trente-six moyens.
Tiens, prenez la grande question : « Qu’est-ce qui est beau ? Qu’est-ce qui est laid ? ». Ajoutez-y : « Qu’est-ce qui est de l’art ? Qu’est-ce qui n’est pas de l’art ? ». Question subsidiaire : « Qu’est-ce qu’un artiste ? Qu’est-ce qui n’est pas un artiste ? ». Là, on est au cœur du sujet. La réponse à cette rafale de questions simples est d’une simplicité raphaélique du fait de la pléthore d'artistes potentiels :
TOUT EST BEAU
TOUT EST DE L’ART
TOUT LE MONDE EST ARTISTE
TOUT LE MONDE IL EST BEAU IL EST GENTIL.
Ça ouvre plein de possibilités, même aux élèves les plus nuls. C'est ça, la démocratisation. Ou plutôt l'extrémisme démocratique. Et cela repose sur ce principe à marteler fortement : « On a tous le droit ! ».
En musique, c’est tellement évident qu’il n’y a pas trop lieu d’insister. Depuis les recherches du petit Pierre Schaeffer, la question est résolue sans ambiguïté : tous les bruits produits dans la nature et hors de la nature sont désormais de la musique. A égalité. Ah mais !
Seuls quelques vieux ronchons s'attachent encore aux beaux instruments de bois ou de cuivre. Seuls quelques orfèvres de la lutherie façonnent amoureusement de tels objets, qui ne doivent de ne pas avoir été guillotinés qu'au fait qu'ils sont dépourvus d'un cou formant transition entre un tronc et une tête.
Les ci-devant « instruments de musique » (notez la particule nobiliaire), c'est donc bien clair, ne produisent que des bruits parmi des myriades d’autres : le monopole qu’ils ont exercé depuis l’aube de l’humanité est un scandale auquel il a heureusement été mis fin, après des millénaires de dictature élitiste et arrogante.
Et le public ne s’est progressivement accoutumé (et encore !) à la « musique contemporaine » que parce qu’on lui a fait ingurgiter de force, au gavoir à canards, pendant trente ans, une foule de concerts sandwiches, où les organisateurs, dépensant des trésors d’ingéniosité dans la programmation, introduisaient une tranche de jambon contemporain entre deux tranches de pain classiques, plus ou moins beurrées pour aider à avaler.
Notez que la stratégie s'est révélée d'une grande habileté. D'abord on y va mollo : quelques espagnolades, un peu de flamenco et de gamelan balinais. Il faut à ce stade s'appeler Varèse pour marier de vieux sons dans des partouzes tout à fait neuves, bien faites pour émoustiller les sens de quelques vieux blasés avides d'érections nouvelles, et pour horrifier dans le même temps l'âme intègre de tous les autres, restés des auditeurs candides.
Ensuite le système des douze sons égaux. Ensuite on pousse les vieux instruments dans leurs derniers retranchements, jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme (du violon), en leur tapant dessus, en les engueulant comme du poisson pourri, en leur faisant dire des horreurs dont ils ont honte (je me rappelle un concert dirigé par Ivo Malec en personne, quelle triste expérience pour un jeune musicien plein d'espoir !). Quel triste spectacle que de voir un violoncelliste fouetter son instrument de son archet, pendant que ses voisins de quatuor passent un doigt mouillé sur le bord d'un verre a pied en cristal à moitié rempli) !
Ensuite viennent tous les instruments du monde, appelés à la rescousse. Ensuite viennent les moyens offerts par l'électricité, l'électronique et l'informatique : rendez-vous compte, tous ces sons potentiels, on ne pouvait pas les laisser au chômage, il fallait leur trouver un emploi. Pour couronner le tout débarquent en trombe tous les bruits du monde (Pierre Schaeffer et suiveurs), j'en ai déjà parlé.
Moralité : la musique occidentale explore à tout-va et dans l'enthousiasme des contrées sonores inconnues, pose le pied sur des planètes improbables, découvre des continents sur lesquels se jettent des armées d'oreilles saturées de sons du passé. En musique, comme en bien d'autres matières, l'Occident est un collectionneur monomaniaque effréné, un dangereux psychopathe atteint de kleptomanie compulsive aiguë, à l'instar d'un certain Aristide Filoselle (Le Secret de la Licorne, p. 59).

En littérature, si c’est moins évident, c’est juste parce que – du moins en France – les tendances expérimentales n’attirent que des groupuscules faméliques de militants de la nouveauté, portant des visages émaciés, graves et fiévreux : eux seuls ont assez de foi fervente et fidèle pour crier au génie quand Pierre Guyotat publie Eden Eden Eden ou Tombeau pour cinq cent mille soldats.
C’est sûr qu’après Ulysse de James Joyce, Mort à crédit de Céline, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry et quelques autres, l’idée d’imposer la sacro-sainte, obligatoire et quasi-statutaire « rupture », dans une surenchère du meilleur aloi dans le travail sur les moyens d’expression romanesque, est devenue pour le moins difficile à mettre en œuvre.
Le minuscule Philippe Sollers a sans doute voulu faire rigoler ses copains de la cour de récréation, quand il a écrit, sans majuscules ni ponctuation (juste parce que Céline s'était proclamé le cinglé en chef des points d'exclamation et de suspension), son livre sobrement intitulé H. Quoi, illisible ? Expérience, on vous dit ! La barre étant placée excessivement haut, quels éditeurs, quels lecteurs auraient assez d'entraînement et de détente des reins pour ne pas la faire tomber en tentant de franchir l’obstacle ?
Quant à la poésie, ce n’est même pas la peine d’en parler : est-ce qu’un poète existe, quand il est rare qu'ils touche 300 lecteurs ? D’autant que la cuisine des poètes actifs après la guerre s’est muée en une infinité de laboratoires secrets, où des alchimistes vaguement barbus se sont mis à extraire de leurs cornues la quintessence de liqueurs mystérieuses, dont l’amateur éventuel ne saurait imaginer l’effet qu’elles produiront une fois ingurgitées.
Je dirai même que le jus qu’on recueillait parfois à la sortie du serpentin de cet alambic forcené était carrément imbuvable. Je me souviens d’un « poème » d’un nommé Jean-Marc, qui commençait par cet inoubliable groupe nominal péremptoire, voire comminatoire : « Les cafards noirs de la lampe à souder ». L'expression, je ne sais pourquoi, s'est gravée. Jean-Marc, si tu me reconnais dans la rue, merci de ne pas me voir.
Remarque, j’ai bien dû pondre quelques horreurs comparables. Quand on est dans l’expérimental, c’est quasiment forcé. Quand on explore des voies nouvelles, on tombe fatalement sur bien des impasses et autres voies sans issue (via sin salida) : il y a donc beaucoup de déchet. La gangue autour de la pépite, quoi. Mais il y a des jours où l'on se dit que non, vraiment, ça fait un peu épais de gangue avant d'arriver à la pépite. C'est vrai, quoi, la vie est courte.
Le gros morceau de l’expérimental reste cependant, détachés loin devant le peloton étiré des principaux moyens d’expression, les « arts plastiques ». Normal, les arts plastiques, ça saute aux yeux, ça envahit votre espace visuel sans vous demander.
Le problème, avec les arts plastiques, c'est qu'ils sont devenus affreusement tributaires du langage (voire de la linguistique), de la pensée, de la formulation, de la capacité de l'artiste à transposer dans l'univers des mots l'esprit de ce qu'il veut donner à voir. Et le cortex cérébral de la théorie esthétique (ou sociale, ou morale, ou politique, ...) alourdit à tel point le crâne de l'art vers l'arrière que celui-ci en tombe sur le cul.
Je ne veux pas trop insister : j’ai déjà donné. Allez juste un aperçu du talent du petit Jan Berdyszak, « only for fun».

AVEC TOUTES NOS SINCERES FELICITATIONS AU PETIT JAN BERDYSZAK !
Je veux juste marquer deux particularités qui découlent de ce qui précède, concernant la création artistique : l’extrémisme démocratique et l’extrémisme totalitaire. Contrairement aux apparences, ce sont deux frères jumeaux, et de la pire espèce : l’espèce monozygote.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, le 1892 d'ordonnance, revolver, arme à feu, art contemporain, musique, art, artiste, pierre schaeffer, instrument de musique, edgar varèse, ivo malec, tintin, les dupondt, le secret de la licorne, pierre guyotat, eden eden eden, tombeau pour cinq cent mille soldats, ulysse, james joyce, mort à crédit, louis-ferdinand céline, malcolm lowrynau-dessous du volcan, philippe sollers, poésie, littérature, arts plastiques
lundi, 16 janvier 2012
QUI TE MANIPULE ?
Résumé : Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, livre de BEAUVOIS et JOULE, expose diverses techniques visant à faire faire à quelqu’un quelque chose qui, normalement, lui répugnerait. Si l’opération réussit, la personne va changer d’avis, pour se remettre en accord avec elle-même, parce que l’action a produit en elle une dissonance. Elle aura donc été manipulÉe.
Le point de vue de B. & J., pour le dire rapidement, se veut scientifique donc neutre, au moins théoriquement. C’est la merveille due au découpage du savoir en une infinité de « disciplines scientifiques ». Chacune est autonome. Et dans la bonne science, on ne regarde pas ce qu’il y a dans l’assiette du voisin.
Ça veut dire au passage que chaque discipline fonctionne en vase clos, selon sa propre logique, sans rendre de comptes à personne. Il faut bien se dire que, s’agissant de l’homme officinal (retenez bien la formule, c’est moi l’inventeur), plus personne n’est en mesure, depuis trois ou quatre siècles, d’envisager la totalité. C’est d’ailleurs pour compenser cette infirmité que l’ordinateur a été inventé.
Chaque rat est prié de croquer dans sa part individuelle de fromage. La « psychologie sociale » fait comme les autres. Elle n’a pas à se mêler de biologie moléculaire, de mécanique des fluides, de morale ou de politique. Oui, je sais, on me dira que morale et politique ne sont pas des « disciplines scientifiques ».
La conclusion de B. & J., à propos de leur notion de « soumission librement consentie », est : « P’têt ben que ce n’est pas bien, mais c’est nécessaire à la paix sociale ». Il est vrai que nous vivons dans une société de masse. Pour que la machine fonctionne, il faut, nous dit-on, huiler les rouages. La manipulation des foules serait donc le lubrifiant indispensable, pour que les gens continuent à « faire groupe ». Sinon, la collectivité se transforme en centrifugeuse, et elle éclate.
Peut-être, après tout, le « communautarisme » tant redouté par les républicains (ce qu’il en reste) est-il le lubrifiant de substitution qui permet de croire encore pour quelque temps au « vivre-ensemble » (comme ils disent), selon le vieux principe du « divide ut regnas » (c’est du latin : si tu veux régner, divise). Chaque « minorité » (asiatiques, noirs d’Afrique, Antillais, arabes, sans compter les ratons laveurs, aurait ajouté le détestable JACQUES PREVERT) restera bocalisée, aquariumisée dans son quartier. Peut-être, après tout, est-ce la fin de la fiction du « peuple » ?
On me dira ce qu’on voudra : s’il faut gouverner les gens sans qu’ils le sachent, c’est qu’on est arrivé aux frontières du totalitaire.
Car je me pose toujours la même question : comment se fait-il, dans un monde où il n’y a jamais eu autant de liberté, que tout le monde ou presque fasse la même chose, parfois au même moment (plages, supermarché, télévision, etc.) ?
Comment se fait-il que des masses d’individus LIBRES décident librement de faire la même chose que tout le monde au même moment ? On me dira ce qu’on voudra : CE N’EST PAS NORMAL.
Et puis, franchement, n’avons-nous pas déjà acclimaté dans nos démocraties exemplaires, que les petits hommes verts planètes les plus avancées de l’univers nous envient, les merveilleuses trouvailles mises au point par ADOLF HITLER ?
J’exagère ? Alors je demande qu’on me dise ce que c’est, l’échographie. Cette technique si pratique qui permet d’éviter l’amniocentèse tout en arrivant au même résultat, qu’est-ce d’autre qu’un moyen d’éviter la naissance de bébés mal formés ? Qu’est-ce que c’est, sinon cet EUGENISME dont on fait bêtement reproche à HITLER ? Accessoirement, l’échographie permet, par exemple en Inde, d’éviter la naissance des filles.

LE PETIT PERE DES PEUPLES

LE FÜHRER
(à moins que ce ne soit l'inverse)
Oui, l’EUGENISME est bel et bien parmi nous. Est-ce bien, est-ce mal, c’est autre chose. Je suis comme tout le monde, je n’aimerais pas du tout avoir un enfant mongolien. Si une technique « non invasive » permet de l’éviter, je m’en félicite, mais je me dis qu’il s’agit, qu’on le veuille ou non, de SELECTION.
Cette analogie avec ce qui se passait dans un régime politique unanimement VOMI par le monde démocratique actuel me laisse perplexe. C’est vrai qu’HITLER éliminait des personnes déjà nées, donc bien vivantes, alors que l'échographie débouche, en cas de mauvais diagnostic, sur un AVORTEMENT. A part cette « menue » différence, j'attends qu’on me dise en quoi le projet est différent (« élimination des mal formés », qu’on pratiquait déjà dans la Sparte antique).
Autre chose, tiens, pendant que j’y suis. Je ne vais pas, une fois de plus, m’insurger contre la télévision, mais là encore, je note que des gens comme HITLER ou STALINE auraient rêvé d’avoir à leur disposition un tel outil de domestication des masses. Le simple fait de les savoir assises devant l’écran les aurait sans doute rassurés.
Je trouve admirable que, bien avant le règne sans partage de la télévision sur les esprits, le 1984 de GEORGE ORWELL ait explicitement associé le télécran au régime totalitaire décrit dans le bouquin (le stalinisme en particulier, mais en regardant bien ...).

GEORGE ORWELL
Or, aujourd’hui, qu’un type comme PHILIPPE SOLLERS puisse, parlant de LOUIS ALTHUSSER, affirmer que ne saurait se prétendre penseur un homme qui n’a pas la télévision, en dit long. Qu’est-ce que c’est, la télévision comme mode de vie, sinon le bromure que les militaires mettaient dans la nourriture des bidasses le premier soir de leur incorporation, pour qu’ils se tinssent tranquilles pendant les premiers jours ?
Vous voulez encore un exemple ? Selon vous, qui a inventé l’architecture de masse, le gigantisme architectural ? Personne d’autre qu’ADOLF HITLER, brillamment secondé (ou précédé) par son ALBERT SPEER préféré. Il suffit d’aller voir les projets de stade, d’arc de triomphe et autres lubies, pour le comprendre. A qui devons-nous les premières autoroutes, ces structures dirigistes, autoritaires, voire policières ? BENITO MUSSOLINI. Vous pouvez vérifier (autoroute Milan-Lacs, 1924). HITLER n’a pas mis longtemps à comprendre tout l’avantage technique de la chose.
Dans quels régimes dénoncés comme totalitaires a été utilisée la manipulation mentale ? Vous le savez : l’Allemagne hitlérienne et la Russie stalinienne. Deux pays pour lesquels tout bon démocrate dûment estampillé au fer rouge sur la fesse gauche a autant de détestation que si c’étaient des enfers. Ceux que ça intéresse peuvent aller voir mes notes de 12 et 20 mai 2011 (c’est loin, je sais).
Voilà ce que je dis, moi.
A demain pour la suite.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : beauvois et joule, petit traité de manipulation, sociologie, psycho-sociologie, manipulation mentale, totalitaire, totalitarisme, adolf hitler, eugénisme, démocratie, staline, philippe sollers, louis althusser, albert speer, george orwell, 1984
dimanche, 06 novembre 2011
LYON, BIENNALE, BONBONS, CHOCOLATS
« UNE TERRIBLE BEAUTÉ EST NÉE » : un catalogue à vous faire penser contre votre gré (« Nous afons les moyens de fous vaire benzer ! »).
Comment regarder une œuvre de ce qu’on appelle aujourd’hui « art contemporain » ? Quand on parle de « musique contemporaine », c’est souvent pour parler de stridences, de concert de casseroles et autres gentillesses. Il y a de ça avec l’« art contemporain ». S’il est vrai que l’art exprime quelque chose du monde tel qu’il va, alors le monde est dans un triste état.
C’est vrai qu’en bien des occasions, j’en ai vu, des gribouillons, des morceaux, des objets, des monceaux de morceaux d’objets, les uns sur les autres, les uns dans les autres, des pneus, des ficelles, de vieilles portes vermoulues : on a parfois l’impression que l’art contemporain, c’est l’art du déchet. Faut-il en conclure que nous vivons dans le monde du déchet ?
Eh bien ça tombe bien : tout porte à croire que c’est le cas, que nous y sommes, dans le déchet. Ça y est, mes frères, nous sommes arrivés chez nous, à destination, dans la poubelle. Ça a pris du temps, mais « A coeur vaillant rien d'impossible ». Il n’y a aucune raison pour que l’art échappe au sort commun de l’humanité prochaine, et ne soit pas à son tour, comme tout le monde, tympanisé et jeté au rebut.
Il paraît que le ridicule ne tue plus. Alors faisons l'hypothèse que, si ce qui est mort ne saurait plus sombrer dans le ridicule, dans un monde devenu ridicule, l'art ne peut prétendre rester vivant. Simple logique.
Alors, dans ces conditions, comment regarder cette Biennale ? J’avoue que je ne sais pas répondre à cette question. Mais pour en parler, je sais à qui il faut s’adresser : au directeur du musée voué à l’art contemporain en personne : THIERRY RASPAIL.
Attention, je ne dirai rien de la Biennale en elle-même. Courageux, mais pas téméraire, je n’ai pas accompli la visite. Je ne sais pas, peut-être un découragement préventif ? Un accablement prémonitoire ? Un abattement avant-coureur ? Mais je dirai quelque chose de quelque chose qui est dit de la Biennale. J’espère que vous suivez.
Pour savoir ce qui est dit de l’exposition, je me suis laissé guider par le magnifique catalogue (32 euros). C’est vrai que, vu de l’extérieur, c’est un bel objet. Pour l’instant, je ne me prononce pas sur l’intérieur. Je lis en particulier ce que le directeur du M. A. C. en dit dans son propos introductif. J’aurais appelé ça « préface » si THIERRY RASPAIL avait placé son propos en tête d’ouvrage.
Autant être prévenu avant d’entrer dans le catalogue de cette dixième Biennale : monsieur THIERRY RASPAIL aime l’apocope, vous savez, cette figure de style des paresseux ou des snobs qui, pour dire « art contemporain », se contentent de « contempo ». On ne va pas faire l’inventaire de l’apocope courante, on n’en finirait pas, vélo, ciné, et la flopée de toutes les autres.
Bref, je ne sais pas si THIERRY RASPAIL fait son ciné, ni s’il a un petit vélo qui lui trotte dans la tête, mais il aime l’apocope. Surtout s’agissant du mot « exposition ». Je l’en félicite. Cela donne « expo ». C’est tout à fait seyant. Ça va très bien à son teint. Quand il prononce « exposition » en entier, on se demande si ça ne lui a pas écorché la bouche.
Monsieur THIERRY RASPAIL, par ailleurs, a travaillé, qu’on se le dise. Et il le fait savoir, je dirai comment. Mais comme il est homme de précaution, il prend une précaution. Cela se passe au début de son laïus.
Modestement, il a laissé l’art et les artistes précéder et annoncer le dit laïus, qui commence en page 20, pour s’achever page 24. Mais comme ce sont, comme on dit au scrabble, des « pages compte double », on va compter 10 pages. Desquelles il faut retrancher une et demie, consacrée aux augustes références qui lui servent d’appui, de contrefort et, pour mieux dire, de réconfort et de caution solidaire.
Quarante et une références, pas une de moins. Et précises, avec ça : figurent en effet toutes les informations (nom, titre d’ouvrage, année, page) que réclame dûment une méthodologie universitaire en ordre de marche. Aucun nom, aucune citation ne sont laissés à eux-mêmes : toutes les bêtes sont bien attachées à leur anneau par un licou solide, et ne risquent pas de divaguer dans le pré du voisin.
THIERRY RASPAIL ne manque pas de jugeote : sentant venir l’objection, il la prévient habilement au tout début de son propos : « Y a-t-il seulement un sens à tout cela ? Ou pas ? ». Notez que, s’il y a contestation du sens, celle-ci est contenue (à tous les sens du mot) dans la sécheresse de ce « Ou pas ? » comminatoire et dédaigneux : on comprend ce que THIERRY RASPAIL en a déjà fait, de la critique. Comme si le mot d’ordre était : « Faites toujours quelque chose ; pour le sens, on verra après, éventuellement ». On est prévenu.
Le propos est peut-être structuré, en tout cas tout est fait pour en donner l’impression, ponctué qu’il est par ce qui se présente comme têtes de chapitres, synthèse, quintessence : « multiples étendues, débuter, broder, intrigue, régime, l’art-le monde, récit, vérité, lignes de démarcation, beauté-l’expo, poésie, anthropologie, perplexité, enargeia, livre ». Rien qu'avec ça, on peut mettre en route la machine à réfléchir.
On est d’autant plus impressionné, après ce tracé des intentions, par le nom et le nombre des anges tutélaires appelés à la rescousse. Ce ne sont pas moins de soixante-seize noms plus ou moins prestigieux, dont l’autorité incontestable est censée donner à toute l’entreprise sa justification pleine et entière, en même temps qu’ils sont la preuve que THIERRY RASPAIL n’est pas le premier venu, parce que, s'il ne dit pas qu'il a tout lu, il le laisse entendre. Les voici, inchangés (nom, ou prénom + nom), mais remis dans l’ordre alphabétique :
|
aby warburg |
gustav metzger |
montaigne |
|
alain roger |
hannah arendt |
musil |
|
antonio pinelli |
hans ulrich obrist |
pächt |
|
aristote |
hans-ulrich gumbrecht |
patrick chamoiseau |
|
arjun appadurai |
hayden white |
paul ricoeur |
|
balzac |
héraclite |
paul veyne |
|
baudelaire |
imre kertesz |
picasso |
|
benedict anderson |
jack goody |
proust |
|
bergson |
jacques roubaud |
quintilien |
|
bertolt brecht |
jean-christophe ammann |
rank |
|
carlo ginzburg |
jimmie durham |
renouvier |
|
carlo ginzburg |
johann gustav droysen |
robert musil |
|
clément rosset |
jörn rüsen |
roger m. bürgel |
|
clifford geertz |
joyce |
s. m. eisenstein |
|
cormac mccarthy |
kracauer |
saint-rené taillandier |
|
croce |
kubler |
sarkis |
|
defoe |
lapoujade |
stendhal |
|
édouard glissant |
léonard |
tocqueville |
|
f. dosse |
louis althusser |
tolstoï |
|
f. hartog |
marc augé |
umberto eco |
|
fernand léger |
marc aurèle |
walter benjamin |
|
flaubert |
marcel conche |
weber |
|
françois jullien |
marcel detienne |
wittgenstein |
|
friedrich nietzsche |
michel de certeau |
wolff |
|
gadamer |
michelet |
yeats |
|
godard |
|
|
Rien n’est laissé au hasard, comme on voit. On est impressionné. Pas le plus petit interstice philosophique, littéraire ou esthétique n’est laissé vacant. Tout le champ de la pensée a été couvert. Le verre du cahier des charges est rempli plus haut que le bord. L'appareil digestif de THIERRY RASPAIL a quelque chose à voir avec celui de l'autruche.
TOUT, dans cette Biennale, qu’on se le dise, a été PENSÉ.
Un esprit chagrin pourrait cependant se dire, au vu de cet étalage de références, que l’avocat argumente en raison inverse de la consistance de sa matière. Plus le vide est palpable et compact (ce qui veut dire : plus l'accusé est difficile à défendre), plus il est tenté de suivre la voie ouverte par PHILIPPE SOLLERS. Il y a là de l’inversement proportionnel.
Grand admirateur d’estrades, dans son jeune temps, de bateleurs et de camelots vendant brosses à dents miracles, « éventre-tomates » et « écorche-poulets », PHILIPPE SOLLERS, en effet, est devenu le maître à penser dans l’art de l’esbroufe culturelle.
Aux puces de Saint-Ouen, on l'appelle le « Sultan de la Sublime Porte-Ouverte », vu l'aisance avec laquelle il enfonce les dites "portes ouvertes" quand il anime les journées du même nom au supermarché de Oinville-sur-Montcient (78), le samedi.
Son truc, à PHILIPPE SOLLERS ? Rabouter, quel que soit le sujet, les bribes de limaille (c'est la tactique de l'aimant) éparpillées de ses lectures, de ses souvenirs et de ses conversations, et en fleurir le flux qui jaillit de sa bouche, avec l’aisance et la brillance d’encaustique que donne une très longue fréquentation du salon parisien.
Comme par miracle, les bribes raboutées, grâce au savoir-faire du vieux "camelot bavard" (YVES MONTAND, Les Grands boulevards), deviennent fluides. Ça en jette. Au moins aux yeux des gogos avachis dans leur fauteuil face aux fulgurances de pacotille qui leur parviennent du plateau de télévision.
L’impression produite, quand on ne l’a jamais vu faire son numéro, peut être saisissante. Il marie à la vitesse de la lumière une porcelaine peu connue de la dynastie Ming et un repose-tête Bambara, un Traité des trois imposteurs et quelques-uns des Cantos d’Ezra Pound, tel crâne surmodelé de Papouasie et la légende de Harald à la dent bleue. Allez, encore une lichette de marquis de SADE, une pincée de VIVANT-DENON, pour la route.
PHILIPPE SOLLERS vous fait faire, à volonté, un Tour du Monde en douze minutes montre en main. Vous êtes déjà terrassé pour le compte, et vos poumons demandent de l’air. C’est sûr : cet homme a de la mémoire, malgré cet air de vieille mère maquerelle qui lui vient avec l'âge et la coupe de cheveux.
La préface de THIERRY RASPAIL au catalogue de la Biennale, c’est un peu ça : vous êtes assailli par la diversité des « savoirs mobilisés », comme disent les pédagoguenards (à moins que ce ne soient les pédagoguenots), principalement dans le domaine de l’art, comme de juste. Pas une seule des innombrables problématiques artistiques de notre monde n’est oubliée.
Il est sûrement tout à fait important de préciser la perspective dans laquelle a été conçue et mise en œuvre « l’expo », mais si l’on me demande mon avis, il est simple, le voici : « bourratif », « indigeste ». Je finis par me demander à quoi ça rime, de convoquer théoriciens et philosophes en masse. Si, je vois bien qu’il y a quelque chose à justifier. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Voilà que je me mets à faire comme Sancho Pança, qui parlait par proverbes.
Mais je me demande aussi si on ne se retrouve pas un peu dans Astérix et les Normands, quand l’un de ces derniers assène des coups de massue sur la tête d’un collègue qui s'enfonce peu à peu dans la neige, et lui demande : « Alors ? – Rien. Continue. Pour le moment, j’ai toujours plus de mal que de peur ».
A ceci près que j’en retire vaguement l’impression que tout ça sert à la fois à faire mal ET à faire peur. Mal, parce que THIERRY RASPAIL vous enfonce dans l’ignorance crasse où vous êtes de tout ce que le bien nommé « milieu » voudrait, par la prolifération des références savantes, faire prendre pour la continuation de « l’histoire de l’art ».
Peur, à cause de tout ce qu’il va me falloir apprendre avant de passer l’examen pour savoir si je suis autorisé à visiter « l’expo » sans pour autant passer pour un « plouc ». THIERRY RASPAIL voudrait bien me renvoyer sur les bancs du lycée, et ça, il faut qu’il sache que j’ai passé l’âge.
Je retire de cette préface au catalogue une sorte de confirmation d’un pressentiment que je traîne depuis déjà un certain temps. Je me dis que le « milieu » de l’art contemporain en général, et THIERRY RASPAIL en particulier, pratique volontiers l’intimidation.
Je ne me demande même pas s’il n’y a pas dans tout ça, tout simplement, du FOUTAGE DE GUEULE. Ça, au moins, je le savais déjà. Mais je me pose la question : est-ce qu’on ne chercherait pas, par l’avalanche de références savantes qu’on fait pleuvoir sur moi, par avance, à me CLOUER LE BEC ?
Finalement, cet étalage de confiture culturelle de haut parage a quelque chose à voir avec l’arrogance et la prétention. Par association d’idées, cela me fait penser au bocal dans lequel évoluent les « gros poissons » de ce monde cynique, qui dissertent à satiété de la façon de couper les cheveux, et en combien de tronçons c'est le plus recommandé, bien protégés du « vulgum pecus » qui gratte la terre de sa basse-cour à la recherche de quelque chose qui le nourrira … vraiment.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : biennale art contemporain lyon, thierry raspail, philippe sollers, yves montand, sade, astérix
mardi, 02 août 2011
QU'AS-TU FAIT DE TES FRERES ?
CLAUDE ARNAUD est l’auteur du livre qui porte ce titre. Editions Grasset, paru en 2010. Mon ami R. T. m’en avait dit grand bien. Comme c’est un vrai connaisseur, je l’ai cru. H. C., elle, a été emportée par l’enthousiasme. Littéralement. Même C. m’en a dit le plus grand bien. Il est libraire, c’est dire. Trois avis valent mieux qu’un, c’est certain. J’ai donc été convaincu que le livre était bon avant même de l’avoir ouvert.
Influencé par trois avis autorisés, je l’ai donc ouvert. J’aurais aussi bien fait de ne pas (vous savez, le célèbre « I would prefer not to » du Bartleby de MELVILLE). D’abord, qu’est-ce qui lui a pris d’appeler ça « roman » ? Le personnage principal, celui qui dit « je », s’appelle CLAUDE. Les deux frères, comme dans la vraie vie, s’appellent PIERRE ARNAUD et PHILIPPE ARNAUD. Le père, comme dans la vraie vie, s’appelle HUBERT ARNAUD.
Qu’est-ce qu’ils ont tous à étaler leur vie, celle de leurs proches, et surtout à appeler ça littérature ? Ce bouquin, c’est à la rigueur un récit de vie, récit autobiographique, ça va de soi. Mais pas un roman. Est-ce même de la littérature ? Pas sûr. J’en ai assez de la « littérature » française contemporaine. J’avais fait confiance au prix Goncourt, attribué en 1996 à Le Chasseur zéro, d’une certaine PASCALE ROZE. Une épouvantable nullité littéraire. Ce fut la dernière fois.
J’ai feuilleté MARIE DARRIEUSSECQ, CAMILLE LAURENS, CHRISTINE ANGOT et quelques autres. Même AMELIE NOTHOMB me « thombe » des mains. C’est moi qui dois être trop difficile. Parlez-moi de Moby Dick : je grimpe au rideau illico ! Au-Dessous du volcan, je plonge. Ulysse, je m’enflamme. Parlez-moi de littérature, enfin, ça marche.
La question qui se pose est : comment des livres nuls sont-ils achetés en masse ? « Nuls », pour moi, c’est le plat récit autobiographique de quelqu’un de peu intéressant qui trouve intéressant de raconter sa pauvre vie. « Nuls », c’est aussi le livre fabriqué selon un recette de cuisine bien huilée (ou bien beurrée, si vous préférez), comme sait si bien faire le cuisinier MARC LEVY. Pourquoi des masses de lecteurs se ruent-ils pour remplir le compte en banque de ce genre d’ « écrivain » ? Ce sont peut-être les mêmes qui regardent la télévision, allez savoir ?
Je renvoie au livre de PIERRE JOURDE et ERIC NAULLEAU : Le Jourde et Naulleau, Mango éditeur, 2008, pour les autres têtes de turc à démolir. Les auteurs alignent très correctement les gens cités précédemment, et ajoutent à la liste PHILIPPE SOLLERS et BERNARD-HENRI LEVY, ALEXANDRE JARDIN et MADELEINE CHAPSAL, et quelques autres. J’avais beaucoup aimé quelques livres du père JARDIN, PASCAL. Mais le style n’est pas dans les gènes.
Le problème actuel de la littérature en France, ou plutôt de sa diffusion, c’est la confusion des trois acteurs : écrivain, éditeur, critique littéraire. Et je ne parle pas de la « politique éditoriale », qui va au plus rentable. L’écrivain est souvent directeur de collection chez un éditeur. Le « critique » est souvent écrivain. Enfin, dans ce petit monde, qui fonctionne un peu comme le peloton du tour de France, sur base d’OMERTA et de service rendu, tout le monde sert la soupe à tour de rôle aux autres. Ils se tiennent tous par la barbichette.
En fait, ce qui manque à tous ces gens qui règnent, au moins médiatiquement, sur la littérature en France, c’est bien sûr le STYLE. Alors, peut-être est-ce tout à fait délibéré et volontaire de la part de CLAUDE ARNAUD, mais son récit est linéaire, chronologique, et les faits s’y succèdent selon le principe de l’absence de structure que constitue la juxtaposition des faits. Si l’auteur cherchait la platitude du style, alors son entreprise est couronnée de succès.
Alors maintenant, qu’est-ce que ça raconte ? En gros, les ravages accomplis sur toute une famille par les « événements » de mai 1968 et la suite. Le père est « à l’ancienne » (ça veut dire rigide, voire ringard). La mère, tiens, j’ai déjà oublié la figure de la mère. Pierre, l’aîné, est une « tête » brillantissime promise au plus brillant avenir. Philippe, c’est l’aventurier de la famille qui aura parcouru le monde en envoyant des « cartoline » à la famille « par à-coups ». Claude se définit lui-même comme un « Gavroche planant ».
Pierre, l’ « aventurier mental », finira mal, après avoir troqué les bibliothèques savantes pour des squats de plus en plus miteux, dans une espèce de long suicide social, qui deviendra suicide personnel du deuxième étage de l’hôpital psychiatrique où il a échoué. Philippe, le « penseur global », finira mal, lors d’une baignade où il se noie mystérieusement. Voilà pour l’explication du titre du bouquin. Mais même le père et la mère finissent par mourir ! Etonnant, non ? Qu’as-tu fait de ton père et de ta mère ?
Quant à Claude, il découvre la vie avec exaltation, et va goûter à tous les râteliers. Le râtelier sexuel d’abord, qui le conduit dans tous les lits possibles et imaginables, où il joutera avec les garçons et les filles, mais de préférence les garçons, si j’en juge par le nombre de pages (voir le chapitre « La chanson de Roland »). Le râtelier politique, évidemment, qui le conduit des trotskistes à la Gauche Prolétarienne, dont il vend la propagande sur les marchés. Le râtelier culturel et intellectuel, enfin, avec toutes les modes de l’époque.
Tout cela est exposé sérieusement, comme transcrit d’un journal tenu au jour le jour, et, je crois, honnêtement. Pour quelqu’un né au milieu des années 1950, il peut être rigolo de retrouver l’ambiance d’une période qui a marqué les esprits, de même que les vrais noms dont on parlait dans les années 1970 : ROLAND BARTHES, JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, FREDERIC MITTERRAND et un certain nombre d’autres. Voilà, s’il vous manque un « tableau » de ce que furent mai 1968 et la suite, ce livre est fait pour vous.
Mais s’il vous faut un livre vraiment « écrit », passez votre chemin. C’est le gros reproche que je lui fais. Ce n’est donc certainement pas un « roman ». Je dirais presque que ce n’est même pas un « récit ». Ce serait plutôt le « compte-rendu » établi au cours même de la réunion du conseil d’administration par le secrétaire de séance. Reste la photo du bandeau, rigolote finalement, où l’on voit un homme souriant couché en travers des rails, mais rassurez-vous, la voie est désaffectée et l’herbe folle passe abondamment le nez à travers le ballast.
Maintenant, un question reste : pourquoi ce livre a-t-il été publié ? Première hypothèse : il dessine les traits d'une époque (mai 1968 et après) que NICOLAS SARKOZY a mise à la mode, et c'est ce tableau qui attire le lecteur avide de se faire une idée de ce qu'elle fut, voire de se replonger dans une ambiance qu'il a lui-même connue de près ou de loin.
Deuxième hypothèse : je note le tir groupé que forme la publication quasi-simultanée de plusieurs livres traitant approximativement du même sujet. Il y a d'abord le livre de MATHIEU LINDON, Ce qu'Aimer veut dire, que je n'ai pas lu, et où il raconte, paraît-il, son "amitié" passionnée avec le philosophe MICHEL FOUCAULT, dans son appartement de la rue de Vaugirard.
Il y a ensuite le livre de JEAN-MARC ROBERTS, François-Marie, où l'auteur s'adresse à son "ami" FRANÇOIS-MARIE BANIER, pour prendre sa défense. Même si celui-ci n'a jamais pu coucher avec celui-là, ils "fréquentaient main dans la main les boîtes gays de la rue Sainte-Anne" (site bibliobs).
Le tir groupé en question, le voilà : les années 1970 ont été celles de la fin du tabou homosexuel. Cela n'invalide pas du tout la première hypothèse. En fait, elles se télescopent. La mode, aujourd'hui, est à la "gay pride". J'ajoute que le Nouvel Observateur désigne JEAN-MARC ROBERTS comme un "membre influent" du milieu littéraire parisien (c'est-à-dire français).
Il convient donc que cela se sache : la "communauté homosexuelle" a désormais pignon sur rue, et sans doute pas seulement dans le milieu littéraire. Et ce n'est pas monsieur PIERRE BERGÉ qui me contredira.
09:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : claude arnaud, littérature, société, mai 1968, herman melville, prix goncourt, darrieussecq, camille laurens, christine angot, amélie nothomb, moby dick, au-dessous du volcan, ulysse, marc lévy, jourde et naulleau, philippe sollers, bernard-henri lévy, alexandre jardin, roland barthes, homosexuels, gays

