dimanche, 20 mars 2016
PHILIPPE MURAY : ULTIMA NECAT
IMPRESSIONS DE LECTURE
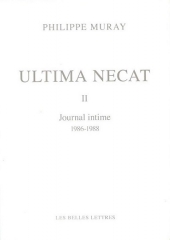 3
3
Le deuxième volume (1986-1988) consacre de longues pages à la préparation d’un roman qu’il intitule Postérité (paru en 1988), dans lequel il s’en prend à la volonté des femmes de procréer à tout prix, mais aussi aux hommes, parce qu’ils se laissent faire (les hommes font moins des enfants aux femmes qu’elles ne leur en font, dans le dos, pour mieux les soumettre).
Je n’ai pas l’intention de lire Postérité, pour deux raisons : j’ai lu d’une part des mots assez sévères le concernant (blog de Didier Goux), et d’autre part on suit pas à pas, dans ce même deuxième volume, la mise au point, la composition, l’élaboration du « roman ». L’impression qui découle de tout ça est celle d’un vague brouet informe et confus.
J’avoue que la seule lecture du « Journal » ne m’a guère donné envie d’aller y voir de plus près. Les cinq cents pages du roman ont à elles seules un aspect dissuasif : Postérité n’est pas Guerre et Paix. Le plus étonnant, c’est que l’auteur est catastrophé par le silence qui entoure la parution de son ouvrage, mais un silence qu’il tend à assimiler à un complot contre lui, à cause d’on ne sait quels « tabous » qui, heurtant l’époque de plein fouet, le rendraient inadmissible et, de ce fait, maudit.
Et c’est là, finalement, que se trouve l’intérêt principal de ce « Journal intime » : il nous montre une sorte d’indétermination, d’hésitation. Philippe Muray voit grand, très grand. Il rêve de fondre en un seul lingot littéraire les deux genres que sont l’essai et le roman. Et disons-le, il n’y arrive pas. En effet, qu’il s’agisse du 19ème siècle à travers les âges (1984) ou de Postérité (1988), il croit abattre la cloison qui sépare l’un et l’autre, mais il n’en fait rien de vraiment digeste.
Le problème, c’est qu’il veut mettre du roman dans l’essai (Le 19ème), et de l’essai (de la démonstration, si l’on préfère) dans Postérité. : « Le prologue de Postérité, quelques paragraphes sur la pensée, est important. Il signifie : ce n’est pas parce que je commence un roman que, à l’imitation de la plupart des écrivains, je vais renoncer à penser » (II, p.178). Il a beau soutenir mordicus l’intérêt de cette « innovation », ça ne marche pas.
Dans Le 19ème, livre génial d’un certain côté, le lecteur est frappé par l’originalité des analyses, par des trouvailles qui éclairent tout sous un jour nouveau, mais il est horripilé par la boursouflure de l’expression, qui champignonne à plaisir en cellules proliférantes, d’où les 700 pages, à comparer aux plus de 500 de Postérité : Muray aime faire des gros livres.
C’est un aspect curieux, d’ailleurs, de ce Journal : je ne sais combien de fois il mentionne le nombre des pages qu’il a écrites, le nombre des pages qu’il envisage, le labeur auquel il faut qu’il se tienne pour « tenir ses délais » : « D’après mes calculs, si j’écris 700 pages, tout devrait être tapé fin juin » (28 février 1987). La quantité semble parfois faire office d’horizon. Ce n’est pas ce qu’il y a de mieux.
Autant le dire : je ne vois pas Philippe Muray en romancier. Il a trop d’idées pour cela. Sa notion du roman passe trop par les concepts et les « problèmes de société ». La notion de personnage est dans son imaginaire beaucoup trop abstraite pour donner chair à des existences capables de toucher un éventuel lecteur. Pour tout dire, il est trop penseur et pas assez ... pas assez quoi, au fait ? Pour qu'un héros de roman accède au statut de personnage à part entière, il faut que l'auteur croie en lui. Qu'il l'aime, en quelque sorte. Philippe Muray n'aime pas assez l'humanité pour faire vivre ses personnages.
Plus un personnage est chargé par l’auteur de véhiculer une idée, moins il existe : il faut d’abord qu’il agisse. Idée, soit, mais incarnée. Même inspirés de personnes réelles (Michel Polac, Dominique Grange, …), Mélidonian, Camille, Mimsy, Bromios et les autres, autant qu’on peut en juger par ce que Muray dit de ses personnages dans son Journal, n’arrivent pas à vivre leur propre vie. L’auteur ne les laisse pas faire : il les tient en laisse. En plus, il se regarde écrire son roman : « Ma conception des personnages est au fond hégélienne. Il n’y a aucune raison d’imaginer que les êtres n’aient pas, dans tous leurs comportements, des motivations rationnelles » (II, p.114). Ce genre de notation n’aide pas.
Et le jugement qu’il porte lui-même sur ce qu’il a écrit de son roman encore moins : « 30 juin [1986]. Survol du brouillon de Postérité. 1000 pages dont je ne dois garder au maximum que 400 ou 500. Le problème était, à partir de ce survol, de repérer les épisodes, refaire un synopsis et voir où greffer les courts passages que je dois encore écrire. C’est fait. Le bilan n’est pas fameux. Monstrueuses longueurs. J’ai l’impression de n’avoir pas exprimé réellement ce que je voulais. Pas assez crûment. Il faut que je le dise mieux. Plus nettement. Tout est noyé dans tout et réciproquement » (II, p.106). Il dit ailleurs son obsession de « saturer ». Comme s’il tenait à se rendre illisible.
A ce propos, il a une remarque tout à fait intéressante : « Avant-gardes, etc. C’est très mal pensé, tout ça. Il y a eu une nécessité incontestable. Il a fallu se mettre à la hauteur de l’illisibilité du monde et, se faisant semblable à ce qu’on décrit, faire des livres illisibles. Finnegans Wake, Cantos, un peu Céline (les Guignol’s Band). A chercher : pourquoi, alors que le monde continue à éclater, alors que son illisibilité s’accentue, que les dépressions se multiplient, qu’il devient de plus en plus fou, pourquoi dont la désirabilité de l’illisible disparaît, même chez ceux qui l’aimaient vraiment ? » (II, p.85). C’est ma conviction : les arts, au 20ème siècle, se sont mis au diapason du 20ème siècle, appliquant méthodiquement son mot d’ordre, qui est « Détruire ». Ceux qui continuent à ne pas voir cette réalité se bercent, mentent ou font semblant.
C’est sûr, Philippe Muray n’est jamais meilleur que quand il regarde, observe, dissèque le monde qui l’entoure.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : il y aurait encore beaucoup à dire à la suite de cette lecture. Je le dis sans détour : vivement les volumes suivants.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, philippe muray, muray postérité, blog didier goux, ultima necat journal intime, éditions les belles lettres, le xix° siècle à travers les âges, finnegan's wake james joyce, ezra pound cantos, guignol's band
samedi, 19 mars 2016
PHILIPPE MURAY : ULTIMA NECAT
IMPRESSIONS DE LECTURE
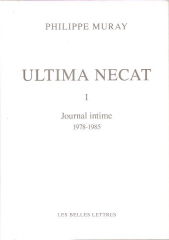 2
2
Je passerai rapidement sur la radicale incompatibilité d’humeur qui règle les relations entre Philippe Muray et Bernard-Henri Lévy, dont il déteste l’arrogance, le culot et la mauvaise foi. Quand l’occasion se présente, il lui assène de sévères avoinées, sur un ton d’une grande violence : « On dirait que la vocation de B.-H. Lévy est de confirmer et d’amplifier toutes les saloperies inventées depuis des siècles par les antisémites. Voleur, escroc, usurpateur, mystificateur sans talent, copieur, plagiaire, conspirateur, menteur, etc. » (II, p.473). Non, il n’y va pas de main morte (ce qu’on lit p.273 n’est pas mal non plus).
Sa relation avec Philippe Sollers est plus complexe et plus suivie. Bisbilles et rabibochages se succèdent. L’ambivalence gouverne. Ça l’embête beaucoup d’avoir besoin de lui et de BHL, qui restent incontournables s’il veut espérer voir ses livres publiés, vu la place qu’ils occupent dans le monde de l’édition parisienne (il parle du « pouvoir de Sollers », I, p.392).
Le copinage forcé avec Philippe Sollers, disons-le, n’est pas ce qui pourrait me rendre sympathique l’auteur des formidables Exorcismes spirituels : dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Son problème, c’est qu’il a besoin de lui. Mais ça ne l’empêche pas d’écrire : « Petite saloperie dégueulasse de Sollers » (I, p.246). Il ne le tient pas en grande estime : « La bêtise de Hugo était la bêtise ; celle de Sollers, la bêtise de l’intelligence » (p.251).
Une page plus loin, il parle de « Méphistophilippe ». Plus loin : « Je me sens m’éloigner maintenant de Sollers très vite » (ibid., p.282). On constate, en comparant le précieux index des noms propres du volume I et du volume II, qu’on trouve en fin de volumes, que cet éloignement semble en voie d’accomplissement à partir de 1986.
On comprend la difficulté quand on sait que les revues dans lesquelles Muray publie sont à l’image de ce qui a pu passer en France, pendant un temps, pour le fin du fin de l’avant-garde intellectuelle : Tel Quel (fondée entre autres par Sollers), Art press, bref, tout ce qu’on regroupe sous l’appellation « Modernité ».
La Modernité a fait régner la terreur sur les « intellectuels » : Simon Leys (Pierre Ryckmans) en sait quelque chose, qui a subi un total ostracisme institutionnel, pour avoir mis à poil la statue de Mao Tse Toung dans Les Habits neufs du président Mao, au moment même où Sollers, Barthes, Maria-Antonietta Macciocchi et toute l’ENS-Ulm, "maoïstes" pur jus, avaient le cœur et la tête à Pékin, en pleine « Grande Révolution Culturelle Prolétarienne ». Mais Simon Leys lisait le chinois dans le texte des journaux chinois, et il savait à quoi s'en tenir sur le mirage maoïste. Une terreur analogue, quoique moins sanguinaire, a régné sur le monde musical, lorsque l’autocrate Pierre Boulez, assis sur le trône du sérialisme intégral et de l’IRCAM, dictait les lois de la composition musicale.
La grande force morale de Philippe Muray est d’avoir su s’extraire de ce bocal confiné pour permettre à sa pensée de se déployer en toute autonomie. Au prix d’un arrachement et de contradictions. Quelle malchance, pour Philippe Muray, d’avoir germé dans le cloaque des avant-gardes. Mais je me dis en fin de compte que ça l’autorise d’autant plus à porter leur fumisterie sur la place publique.
Bon, à part ça, qu’est-ce que je retiens de ces onze cent et quelques pages de « Journal intime » ? D’abord, que l'auteur considère le 20ème siècle comme une « catastrophe » (je ne retrouve pas la page). Qu’on trouve, dans une telle masse de texte, assez peu de remarques à propos de « l’événementiel ». Que Muray évoque bien davantage ses parents que lui-même : « 27 janvier. Il y a des gens qui coûtent la vie à leur mère en naissant. J’ai coûté la vie à mon père en naissant (écrivain). J’ai fait mieux » (I, p.235). Sous-entendu : mieux que Jean-Jacques Rousseau (première phrase des Confessions).
Explication : Philippe Muray porte une culpabilité, celle d’avoir obligé, en naissant, son père à faire ce qu’il faut pour nourrir une famille, et donc à abandonner toute ambition littéraire pour son propre compte. En cultivant à son tour l’ambition de devenir écrivain, Muray a-t-il voulu « réparer » une « faute » ? Toujours est-il qu’il n’envisagera jamais sa future existence autrement que vouée à la littérature. Et surtout sans encombrer son chemin des enfants qu’il ferait à une femme. Il faut choisir : faire des enfants ou des livres. Il revient d’ailleurs assez souvent sur les bisbilles et incompréhensions que suscite, auprès des enfants de sa compagne : il refuse obstinément d’être considéré comme un substitut paternel.
C’est un point de vue. C'est un choix.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, philippe muray, ultima necat journal intime, bernard-henri lévy, bhl, philippe sollers, exorcismes spirituels, teel quel, art press, simon leys, pierre ryckmans, mao tse toung, mao dze dong, les habits neufs du président mao, roland barthes, maria-antonietta macciocchi, pierre boulez, ircam, musique contemporaine, jean-jacques rousseau confessions

