jeudi, 26 janvier 2017
PHILIPPE MANOURY
Menus propos tombés de la bouche d'un professeur au Collège de France.
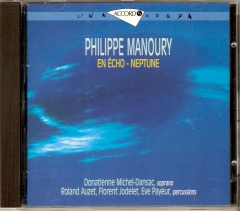 Philippe Manoury est un compositeur de musique contemporaine. Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais de lui, en dehors de quelques œuvres entendues en concert (oui, oui, c'est arrivé), que les sons sortis de ma chaîne audio quand, étourdi par les sirènes de la "modernité", j'avais commis la bévue de me procurer et de poser dans l'appareil idoine les galettes circulaires portant, gravés dans leurs sillons numériques, les bruits
Philippe Manoury est un compositeur de musique contemporaine. Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais de lui, en dehors de quelques œuvres entendues en concert (oui, oui, c'est arrivé), que les sons sortis de ma chaîne audio quand, étourdi par les sirènes de la "modernité", j'avais commis la bévue de me procurer et de poser dans l'appareil idoine les galettes circulaires portant, gravés dans leurs sillons numériques, les bruits 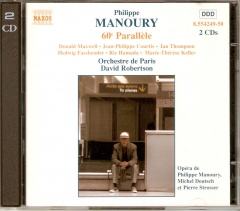 sortis de Neptune ou En Echo (label Accord, avec l'inévitable Donatienne Michel-Dansac dans le rôle de l'appât féminin), l'opéra 60è parallèle (label Naxos, direction David Robertson), La Partition du ciel et de l'enfer ou Jupiter (label IRCAM, sous la direction du commissaire du peuple Pierre Boulez, le délégué du soviet musical suprême). Assez peu en fin de compte. J'avoue que je ne les ai pas réécoutés pour l'occasion. Mais c'est juste pour que personne ne vienne me dire que je parle en totale ignorance de cause. J'ajoute qu'il m'est arrivé de trouver ici ou là de la musique dans ce que j'entendais. Pour dire que je ne suis pas complètement hermétique à ce qui se fait aujourd'hui en matière de musique : il m'arrive même de ne pas tourner le bouton les soirs, en général malheureux, où le programme est réservé aux "musiques d'aujourd'hui" (mais franchement, les œuvres diffusées hier soir par M. Franz Musik, de Gilbert Amy et Philippe Hurel, offrent une musique chétive, aride, squelettique : des vieux rapiats, des Harpagons de la musique ; les adeptes diront qu'ils n'ont gardé que l'essentiel, mais je n'ai pas envie de ronger les os).
sortis de Neptune ou En Echo (label Accord, avec l'inévitable Donatienne Michel-Dansac dans le rôle de l'appât féminin), l'opéra 60è parallèle (label Naxos, direction David Robertson), La Partition du ciel et de l'enfer ou Jupiter (label IRCAM, sous la direction du commissaire du peuple Pierre Boulez, le délégué du soviet musical suprême). Assez peu en fin de compte. J'avoue que je ne les ai pas réécoutés pour l'occasion. Mais c'est juste pour que personne ne vienne me dire que je parle en totale ignorance de cause. J'ajoute qu'il m'est arrivé de trouver ici ou là de la musique dans ce que j'entendais. Pour dire que je ne suis pas complètement hermétique à ce qui se fait aujourd'hui en matière de musique : il m'arrive même de ne pas tourner le bouton les soirs, en général malheureux, où le programme est réservé aux "musiques d'aujourd'hui" (mais franchement, les œuvres diffusées hier soir par M. Franz Musik, de Gilbert Amy et Philippe Hurel, offrent une musique chétive, aride, squelettique : des vieux rapiats, des Harpagons de la musique ; les adeptes diront qu'ils n'ont gardé que l'essentiel, mais je n'ai pas envie de ronger les os).
Il se trouve que monsieur Manoury prononce aujourd'hui même la "leçon inaugurale" des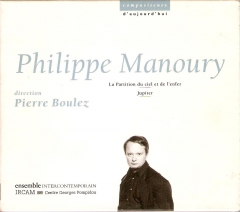 cours qu'il va donner pendant un an dans le collège le plus ancien de France (c'était sous François premier). A ce titre, il était invité hier à la table d'une antenne franzkulturelle pour expliquer tant que faire se peut comment il envisageait sa tâche. Il a profité de la tribune ainsi offerte pour asséner quelques-unes des sottises admises et véhiculées dans les milieux de la branchouille musico-moderniste.
cours qu'il va donner pendant un an dans le collège le plus ancien de France (c'était sous François premier). A ce titre, il était invité hier à la table d'une antenne franzkulturelle pour expliquer tant que faire se peut comment il envisageait sa tâche. Il a profité de la tribune ainsi offerte pour asséner quelques-unes des sottises admises et véhiculées dans les milieux de la branchouille musico-moderniste.
Soit dit pour commencer, le monsieur n'a rien contre les musiques de divertissement (merci pour elles), mais il ajoute dans la foulée que son domaine, c'est la "musique savante", qu'on se le dise. Je rétorquerai au monsieur que ce que j'attends, dans les musiques "savantes", ce n'est justement pas ce qu'elles contiennent de savant, mais un assemblage de sons musicaux qui me touche (je peux aussi être irrité ou indifférent). C'est parce qu'elles provoquent chez moi des résonances, des mouvements intérieurs divers et diversement puissants. Ce que les "spécialistes" de l'âme humaine appellent "affects" ou "émotions".
Je n'ai pas recopié mot à mot les convictions que Philippe Manoury a exprimées lors de l'entretien, et je citerai ses propos, comme on dit, "en substance". Le premier truisme formulé est un lieu commun : « Tous les compositeurs de l'histoire ont été des "contemporains" : il n'y a jamais eu d'autre musique que contemporaine ». Rien à dire de cette vérité d'évidence, sauf à préciser que les techniques d'enregistrement ont rendu "contemporaines" presque toutes les musiques produites par l'humanité depuis les origines, et que la musique dite contemporaine n'est plus qu'une modalité parmi l'infinité des autres. On est sur un marché où l'offre est pléthorique. Il y a du gavage et de la saturation dans la production musicale d'aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la demande ne suit pas. A moins que ça veuille dire autre chose (genre formatage, mise au pas des individus en passant par l'oreille, ...).
Quoi qu'il en soit, le fait d'enregistrer les sons pour qu'on puisse les réécouter à volonté les rend en effet potentiellement (et exactement) contemporains. On peut même dire que toute la musique existant ou ayant existé (celle qui a eu soit la chance d'arriver après l'idée géniale qu'il était possible d'écrire les sons musicaux, soit le temps de se faire enregistrer dans la collection Ocora Radio France avant de disparaître) nous est contemporaine. Les compositeurs qui s'estiment honnis n'ont qu'à protester et accuser les moyens techniques modernes de leur gâcher le métier, au lieu de bêler en chœur que ce sont « de formidables outils de création ».
La concurrence règne en maîtresse impitoyable : que la contemporaine pâtisse de la chose, au fond, rien de plus normal. Le créneau est étroit et on ne devrait pas être surpris que ce genre de musique (produire du "jamais ouï") ne concerne en fin de compte qu'un "marché de niche". Mais c'est le corollaire du raisonnement qui est intéressant : « Les compositeurs de l'histoire ont été des expérimentateurs ». Alors ça, c'est évidemment faux.
Que l'évolution (je n'ai pas dit le "progrès") de la musique ait accompagné une évolution des sensibilités liée aux changements sociaux et, si l'on veut, à l'édification progressive d'une civilisation, cela ne signifie en aucune manière que les compositeurs aient été, par profession, des "expérimentateurs". L'idée me semble juste risible.
C'est plutôt l'aveu de toute une conception : le compositeur d'aujourd'hui travaille dans son laboratoire au milieu de ses cornues et athanors, conçoit des protocoles d'expérience sophistiqués, explore le possible, fait des calculs, des hypothèses, des mélanges, des précipités. Puis un jour il en sort pour apporter au public agenouillé la "bonne nouvelle" (mot à mot grec, ça donne "évangile") : ça s'appelle une "création mondiale". Moralité : le compositeur d'aujourd'hui est un asocial. Le paradoxe, c'est qu'il est en même temps un marchand qui veut placer son produit. Par-dessus le marché, il se veut un prescripteur doté de l'autorité qui l'autorise à se donner le grand rôle.
Ce qu'il produit, moi j'appelle ça, sur le modèle imposé dans le milieu des "artistes-plasticiens", de la musique conceptuelle, c'est-à-dire du genre où le public est invité à se gratter le crâne ou le menton d'un air pénétré pour donner l'impression qu'il est descendu dans ses propres profondeurs pour s'interroger gravement sur le sens de tout ça. Mélasse dont il sort en général en déclarant à qui veut l'entendre que, tout bien réfléchi, « cela est intéressant ». Sûr que personne ne lui demandera s'il trouve intéressants telle "Fricassée parisienne" ou tel des Octonaires de la vanité du monde (Paschal de l'Estocart). La musique est certes faite pour être ouïe, mais elle est d'abord faite pour être jouie (j'assume le barbarisme, à moins que ce ne soit un solécisme).
Autre sujet d'hilarité, c'est quand le professeur au Collège de France (en CDD, heureusement) compare la musique contemporaine à une langue étrangère qu'il faut apprendre pour la comprendre. Cela se passe en deux temps.
Premier temps, une apostrophe à l'intervieweuse : « Quand vous allez en Chine et que vous ne connaissez pas la langue, si vous voulez vous faire comprendre, il va bien falloir que vous appreniez le chinois ». Autrement dit, pour comprendre un langage que vous ignorez, il faut l'apprendre. Même chose, donc, pour la musique contemporaine. Pure et simple intimidation. Soit dit en passant, je note que Philippe Manoury reconnaît ici, peut-être sans s'en rendre compte, que la musique qu'il écrit est a priori, aux oreilles du public, une langue étrangère. Prenons cela comme un aveu : Philippe Manoury est un prof de langue étrangère, il est au-dessus, et ses élèves (son public) ne savent pas. Il faut donc qu'il leur inculque.
Deuxième temps : « Est-ce que vous pouvez me dire, quand vous écoutez du Mozart, ce qu'il y a à comprendre ? ». Autrement dit, quand vous écoutez de la musique, il n'y a rien à "comprendre". Donc rien à "apprendre". Prenons cela comme un autre aveu : face à la musique, Philippe Manoury est notre égal, notre semblable, notre frère.
Conclusion et en résumé : un exemple lumineux de "double langage". Oh, Manoury, il faudrait savoir ce que tu veux. Dis-nous : il faut apprendre, ou il n'y a rien à apprendre ? Faut-il ou non éduquer le public ? La musique est-elle faite pour l'intellect ? Ou bien pour la sensibilité ? Tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre.
Cette idée de compréhension, ou plutôt cette grande plainte d'être un grand "incompris" poussée par tous les "innovateurs" (qui se disent "créateurs" et se plaignent que le public "ne suive pas"), est un refrain qui date de très longtemps : c'est aux destinataires des œuvres de s'adapter aux inventions de leurs auteurs. Le devoir premier des compositeurs n'est en aucune manière de chercher à plaire, ce qui serait bassement servile. Car la musique contemporaine nécessite une "éducation" spécifique : sans doute ce qu'on appelle "dresser" l'oreille. C'était donc ça ! Manoury et ses semblables se considèrent comme des dompteurs face à des fauves : il faut dresser les oreilles des contemporains pour les plier aux impératifs de la nouveauté. On appelle ça le cirque.
Monsieur Manoury, comme la plupart des gens qui "font" dans les arts contemporains, veut à toute force que son public retourne sur les bancs de l'école pour apprendre pour quelles raisons il doit aimer ses œuvres. Pour monsieur Manoury, le public est dans son tort, c'est lui qui devrait faire l'effort. Tout ça parce que, s'il n'aime pas ce qu'on lui donne, c'est qu' « il n'a pas assez l'habitude ». Moi je dis qu'on aura beau m'expliquer que je devrais me sentir coupable de mes refus d'admettre comme de la musique toutes les "new things" qui se présentent à mes oreilles endolories, quand ça veut pas, ça veut pas, et puis c'est tout.
Car cette histoire d'habitude, j'ai envie de dire : ben v'là aut'chose ! Je pose une question : est-ce seulement à cause de l'habitude que les gens du peuple qui dansaient sur les places dans les fêtes autrefois aimaient les sons qui sortaient de la flûte, du tambourin, de la cabrette ou de l'accordéon ? Ou bien ne serait-ce pas plutôt parce que ces sons sont organisés selon les lois d'une harmonie naturelle ? Le grand mot est lâché.
On me dira qu'il ne faut pas confondre musiques "savante" et "populaire". Je ne vois vraiment pas ce que ça change à la question de fond : on n'écoutait pas les mêmes choses dans les hautes et basses classes, c'est certain. Mais c'est justement là, et pas ailleurs, qu'il faut situer le problème des "habitudes" (traduit en Bourdieu, ça donne "habitus", au moins en gros), qui chiffonne monsieur Manoury.
Au fond, pourquoi le public, depuis le début du XX° siècle, tourne-t-il en masse le dos à la musique contemporaine ? N'est-ce pas précisément parce qu'elle a outrepassé les limites imposées aux sons musicaux par la nature ? Car en musique, comme en d'autres domaines, la question des limites ne se laisse pas évacuer facilement. Pourquoi les directeurs de salles et les chefs d'orchestre sont-ils obligés d'emboquer le public en insérant dans leurs programmes une tranche de contemporaine entre deux tranches de "classique" ? Espèrent-ils que le public, à la longue, lassé de résister, rendra les armes ?
Last but not least, Philippe Manoury déclare : « Je serais bien incapable de vous dire, quand je compose, ce qu'il faudrait faire pour que ma musique soit bien reçue ». Traduction en langage humain : « Quand je compose, j'ai autre chose à faire qu'à penser aux gens auxquels ma musique est destinée ! Pour moi, le destinataire n'existe pas ! ». En français mot à mot : rien à foutre que ma musique plaise ou non.
On me rétorquera que Beethoven lançait à Schuppanzigh : « Eh ! Que m'importent vos boyaux de chat, quand l'inspiration me visite ! ». Je répondrai juste que tout le monde n'est pas Beethoven. Mieux : en face d'un Beethoven, combien de domestiques ? Combien de nos "innovateurs" ont du génie ? Je crois pouvoir répondre : faire de l'innovation sonore un critère de la composition musicale d'aujourd'hui est le meilleur moyen de nous épargner l'émergence d'un génie. Et d'établir durablement e règne des bidouilleurs de sons.
Le génie porte un monde, il ne se réduit pas à l'innovation, qui n'est au fond qu'un résidu. Le véhicule d'une intention, si vous voulez. Le génie, c'est juste une question d'altitude dans l'intention.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique contemporaine, philippe manoury, ircam, pierre boulez, donatienne michel-dansac, david robertson, france musique, gilbert amy, philippe hurel, france culture, musique savante, collège de france, schuppanzigh, ludwig van beethoven, musique classique, musique
samedi, 19 mars 2016
PHILIPPE MURAY : ULTIMA NECAT
IMPRESSIONS DE LECTURE
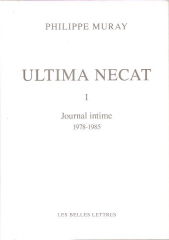 2
2
Je passerai rapidement sur la radicale incompatibilité d’humeur qui règle les relations entre Philippe Muray et Bernard-Henri Lévy, dont il déteste l’arrogance, le culot et la mauvaise foi. Quand l’occasion se présente, il lui assène de sévères avoinées, sur un ton d’une grande violence : « On dirait que la vocation de B.-H. Lévy est de confirmer et d’amplifier toutes les saloperies inventées depuis des siècles par les antisémites. Voleur, escroc, usurpateur, mystificateur sans talent, copieur, plagiaire, conspirateur, menteur, etc. » (II, p.473). Non, il n’y va pas de main morte (ce qu’on lit p.273 n’est pas mal non plus).
Sa relation avec Philippe Sollers est plus complexe et plus suivie. Bisbilles et rabibochages se succèdent. L’ambivalence gouverne. Ça l’embête beaucoup d’avoir besoin de lui et de BHL, qui restent incontournables s’il veut espérer voir ses livres publiés, vu la place qu’ils occupent dans le monde de l’édition parisienne (il parle du « pouvoir de Sollers », I, p.392).
Le copinage forcé avec Philippe Sollers, disons-le, n’est pas ce qui pourrait me rendre sympathique l’auteur des formidables Exorcismes spirituels : dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Son problème, c’est qu’il a besoin de lui. Mais ça ne l’empêche pas d’écrire : « Petite saloperie dégueulasse de Sollers » (I, p.246). Il ne le tient pas en grande estime : « La bêtise de Hugo était la bêtise ; celle de Sollers, la bêtise de l’intelligence » (p.251).
Une page plus loin, il parle de « Méphistophilippe ». Plus loin : « Je me sens m’éloigner maintenant de Sollers très vite » (ibid., p.282). On constate, en comparant le précieux index des noms propres du volume I et du volume II, qu’on trouve en fin de volumes, que cet éloignement semble en voie d’accomplissement à partir de 1986.
On comprend la difficulté quand on sait que les revues dans lesquelles Muray publie sont à l’image de ce qui a pu passer en France, pendant un temps, pour le fin du fin de l’avant-garde intellectuelle : Tel Quel (fondée entre autres par Sollers), Art press, bref, tout ce qu’on regroupe sous l’appellation « Modernité ».
La Modernité a fait régner la terreur sur les « intellectuels » : Simon Leys (Pierre Ryckmans) en sait quelque chose, qui a subi un total ostracisme institutionnel, pour avoir mis à poil la statue de Mao Tse Toung dans Les Habits neufs du président Mao, au moment même où Sollers, Barthes, Maria-Antonietta Macciocchi et toute l’ENS-Ulm, "maoïstes" pur jus, avaient le cœur et la tête à Pékin, en pleine « Grande Révolution Culturelle Prolétarienne ». Mais Simon Leys lisait le chinois dans le texte des journaux chinois, et il savait à quoi s'en tenir sur le mirage maoïste. Une terreur analogue, quoique moins sanguinaire, a régné sur le monde musical, lorsque l’autocrate Pierre Boulez, assis sur le trône du sérialisme intégral et de l’IRCAM, dictait les lois de la composition musicale.
La grande force morale de Philippe Muray est d’avoir su s’extraire de ce bocal confiné pour permettre à sa pensée de se déployer en toute autonomie. Au prix d’un arrachement et de contradictions. Quelle malchance, pour Philippe Muray, d’avoir germé dans le cloaque des avant-gardes. Mais je me dis en fin de compte que ça l’autorise d’autant plus à porter leur fumisterie sur la place publique.
Bon, à part ça, qu’est-ce que je retiens de ces onze cent et quelques pages de « Journal intime » ? D’abord, que l'auteur considère le 20ème siècle comme une « catastrophe » (je ne retrouve pas la page). Qu’on trouve, dans une telle masse de texte, assez peu de remarques à propos de « l’événementiel ». Que Muray évoque bien davantage ses parents que lui-même : « 27 janvier. Il y a des gens qui coûtent la vie à leur mère en naissant. J’ai coûté la vie à mon père en naissant (écrivain). J’ai fait mieux » (I, p.235). Sous-entendu : mieux que Jean-Jacques Rousseau (première phrase des Confessions).
Explication : Philippe Muray porte une culpabilité, celle d’avoir obligé, en naissant, son père à faire ce qu’il faut pour nourrir une famille, et donc à abandonner toute ambition littéraire pour son propre compte. En cultivant à son tour l’ambition de devenir écrivain, Muray a-t-il voulu « réparer » une « faute » ? Toujours est-il qu’il n’envisagera jamais sa future existence autrement que vouée à la littérature. Et surtout sans encombrer son chemin des enfants qu’il ferait à une femme. Il faut choisir : faire des enfants ou des livres. Il revient d’ailleurs assez souvent sur les bisbilles et incompréhensions que suscite, auprès des enfants de sa compagne : il refuse obstinément d’être considéré comme un substitut paternel.
C’est un point de vue. C'est un choix.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, philippe muray, ultima necat journal intime, bernard-henri lévy, bhl, philippe sollers, exorcismes spirituels, teel quel, art press, simon leys, pierre ryckmans, mao tse toung, mao dze dong, les habits neufs du président mao, roland barthes, maria-antonietta macciocchi, pierre boulez, ircam, musique contemporaine, jean-jacques rousseau confessions
dimanche, 10 janvier 2016
REGARD SUR OLIVIER MESSIAEN 3
3/3
Les compositeurs qui conçoivent les sens de la perception comme dignes de la poubelle et le cerveau rationnel comme seul et unique organe manifestant le Progrès, la Modernité, l'Avenir ou la Noblesse de l’homme sont des malfaiteurs et des escrocs. Le musicien Karol Beffa apporte bien du réconfort à tous ceux dont les hautaines expériences commises dans leurs laboratoires par le cérébral, autoritaire et péremptoire Pierre Boulez et ses disciples laissent l’émotion, la sensation, l’oreille et les organes de la perception à la température du poisson congelé.
Pour apprécier Boulez et ses semblables, il faut s’amputer de sa matérialité. De sa corporéité. Il demande à l'auditeur de se métamorphoser en concept. De devenir abstrait. C'est pour ça que je hais la "musique" de Pierre Boulez, cet intellectuel arrogant, ce porte-drapeau des « Avant-Gardes », cet adepte borné du « Progrès » et de la vaine « Modernité » dans les arts, cet obsédé d'innovations techniques brandies comme des fins en soi.
Comment peut-on admirer son imbécile et ringarde prosternation devant la technologie en général, et en particulier la "machine 4X", qui permet d'interagir avec l'ordinateur "en temps réel" lors des concerts ? Il faut l'avoir entendu s'extasier. Il faut l'avoir entendu proclamer la nécessité d'un effort de pédagogie auprès du public pour lui faire comprendre que cette musique est faite pour lui, et que c'est lui, refusant de comprendre, qui a tort de ne pas l'aimer. J'ignorais qu'aimer la musique passât par sa "compréhension". Autant j'admire l'immense chef d'orchestre qu'il fut (il faut l'avoir vu diriger "au doigt", impeccablement), autant je déteste à peu près toute sa production (à quelques très rares, mais notables exceptions près, je dirai peut-être quoi, un jour).

La salle de concert (et le public) de l'IRCAM.
Rien de tout ça dans les Vingt Regards. Si Boulez démontre, Messiaen montre : c'est infiniment supérieur. Messiaen ne se réclame d'aucune avant-garde, il ne porte aucun étendard, il ne milite pas, il ne défend aucune cause. Mais pour ce qui est d'être de son temps, ça oui, il le sait par cœur, allant chercher par toute la Terre de nouveaux éléments pour enrichir son langage. Messiaen s'exprime dans un langage "moderne", si l'on veut, mais il fait passer l’auditeur par le charnel intense de toutes sortes d’émotions et de sentiments, de la tendresse à la joie, en passant par la crainte, voire l’effroi (6 : « Par lui tout a été fait », 18 : « Regard de l’Onction terrible »), et tout ce qu’on trouve sur l’échelle qui va d’un extrême à l’autre. Messiaen n’est pas un tiède, qu’on se le dise ! Il revendique même une brutalité à l’occasion. Rien de ce qui est humain ne lui est étranger. On me dit que Vingt regards sur l'Enfant Jésus est animé par « une inspiration généreuse et spiritualiste ». Ma foi, j’avais un penchant spiritualiste et je ne le savais pas : je suis content de l’apprendre.
Bon, alors là, qu’est-ce qui me fascine tant, dans Vingt Regards sur l'Enfant Jésus ? Il va bien falloir y venir, il serait temps. D’abord, les cinq incroyables accords (3+2, ci-dessous) qui, montés des tréfonds (clé de fa4, doublée à l'octave grave) et descendus des hauteurs (clé de sol), ouvrent le « Regard du Père », riches et complexes, avec ce curieux écho répété qui se perd dans l’aigu, mais une suite d'accords formant une boucle impeccable. Messiaen les appelle le « thème de Dieu ». Sans parler du nom du titulaire officiel, c’est bien dire à quelle altitude il place cette ouverture, et aussi à quelle profondeur : le thème balise l’ensemble de l’œuvre, comme un pilier d’ancrage inébranlable. L' « amer » absolu. Le « cairn » ultime.

Et il me semble que, sans la foi profonde d’Olivier Messiaen, l’œuvre serait incapable d’atteindre au degré d’intensité que lui confère l’authenticité de la démarche. Dans cet ordre d’idées, avant Messiaen, je vois Bach le pieux, Beethoven le profane (malgré le « Überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen »). Qui d'autre ? L’auditeur, qui ne perçoit que le résultat final du « processus créateur », est saisi avant tout par cette authenticité de la démarche.
Il est au fond normal que, quand la puissance génératrice du compositeur est proportionnée à l’authenticité (certains disent la "sincérité"), l’œuvre devienne, pour qui l'aura aimée, une lumière dans la nuit. Allez, j'avoue : pour goûter pleinement la musique des Vingt Regards, j'ai un besoin vital de la foi brûlante d'Olivier Messiaen, moi qui ne la partage pas. Une "foi par procuration", en quelque sorte. Le prosélytisme musical, ça n'existe pas. Ou alors, je suis particulièrement rétif : je regarde Olivier Messiaen en pleine croyance et en train de traduire celle-ci en musique, et je me contente de jouir de la musique. Sans la foi de Messiaen, pas de musique de Messiaen. Le mélomane doit savoir ce qu'il veut. J'assume.
Je ne prête guère attention, par ailleurs, aux considérations théologiques et symboliques qui président à l’ordre des pièces (segmentation : 1 le Père, 5 le Fils, 10 l’Esprit, 15 Jésus, 20 l’Eglise ; doublement : de 7 la Croix, à 14 les Anges ; de 9 le Temps, à 18 l'Onction terrible ; …). Je n'intellectualise pas, et savoir tout ça ne m'est d'aucune utilité. Tout au plus suis-je, parfois, après coup, en mesure de mettre de l’ordre et des mots sur ce que j’ai ressenti. Ce n’est pas facile.
Par exemple, quels mots mettre sur la belle joie qui m’envahit à l’écoute de la dixième pièce des Vingt Regards, précisément intitulée « Regard de l’Esprit de Joie » ? Et plus encore, quels mots mettrais-je sur l’irrépressible enthousiasme qui me soulève et me secoue d’éclats de rire – ma manière à moi de manifester que je suis traversé de gratitude, et qui me transporte si loin au-delà de moi à l’écoute de la dernière pièce (« Regard de l’Eglise d’Amour »), moi qui ne fréquente plus depuis longtemps l’Eglise, et qui ne sais toujours rien en Vérité de ce qu’est finalement l’Amour (Cherubino chante : « Voi che sapete che cosa è l’amor ». "Vous qui savez", dit-il, mais personne, à jamais, n’est en mesure de lui répondre, parce que personne n’a LA réponse). Sur cette joie, sur cet enthousiasme, je n'ai pas de mot à mettre.
Il y aurait bien un mot, à bien y réfléchir, qui pourrait expliquer l’effet sur moi de Vingt Regards sur l’Enfant Jésus. Un petit mot tout simple. Malgré la difficulté réelle de l’écriture de Messiaen, qui vous met parfois devant une forêt de sons qui semble impénétrable, le compositeur se débrouille toujours pour déposer, quelque part, un flambeau à même de guider l’auditeur dans l'obscurité.
Vous pouvez prendre l’œuvre à n’importe quel moment, du plus aimant au plus terrible, du plus paisible au plus brutal, du plus limpide au plus touffu, vous y trouverez toujours, dissimulée parmi les frondaisons luxuriantes, la mélodie. Quelque part dans les ténèbres, quelqu'un chante. C'est tout. Certes, il prend souvent un malin plaisir à dissimuler le chant derrière des buissons d'harmonies qui en déplacent le centre de gravité, mais écoutez bien : Messiaen chante, alors que Boulez vous donne des ordres.
Et c’est parce que le chant éclate dans le « Regard de l’Eglise d’amour » que l’œuvre se clôt en vous laissant heureux, pantois, émerveillé, face à quelque chose de plus grand que vous. Quelque chose qui élargit vos limites. Son truc, à Messiaen, c'est d'édifier ce monument, animé d'une force motrice géante, qui s'appelle la foi. Libre à vous de poser un nom sur le mystère à lui révélé. Mon truc à moi, c'est de laisser vacante la place du nom. Comme pour Jean-Sébastien Bach, je prends la musique, je laisse Dieu en dehors, même si je sais qu'il fut, dans leur âme, le foyer de la vie et donc de la création. Pour donner un sens à sa vie, l'homme a besoin, m'a-t-on dit, de placer quelque chose au-dessus de lui. Il y faut de l'humilité.
Ce qui me transporte, c'est l'agencement miraculeux des sons sortis d'un bonhomme comme les autres (peut-être, à la réflexion, pas tout à fait comme tout le monde), mais qui "y croit" dur comme fer. Je sais parfaitement que, sans cette croyance inentamable, l'œuvre ne serait pas ce qu'elle est. Pire : elle ne serait pas. Je ne prends que le résultat : tout le reste appartient à l'inventeur de la chose. C'est si vrai, en ce qui concerne Messiaen, que ce professeur au Conservatoire déconseillait à ses élèves d'adopter son langage et ses méthodes, mais les incitait vigoureusement à suivre leur propre voie. On me racontera ce qu'on voudra, mais la voie royale que Messiaen a suivie toute sa vie s'appelle LE CHANT.
Car la musique de Messiaen en général, les Vingt Regards en particulier, quoi qu’il arrive, chante. Ne me demandez pas de le prouver techniquement, je ne saurais pas faire. Mais c’est une certitude absolument claire : la clé qui m’ouvre toute grande la porte de cette œuvre, c’est le chant, et rien que le chant. Pour moi, Messiaen est entièrement du 20ème siècle, mais à la façon d’un arbre très antique, poussé sur des racines immémoriales, nourri par l’instrument définitif qui a fait les premières musiques de l'univers : la voix humaine. Indétrônable.
Venu du fond des pièces qui composent Vingt Regards sur l'Enfant Jésus, j’entends chanter l’amour de Messiaen pour la voix si terrestre de l’humanité. Une voix qui chante sa joie d'être en vie, et qui rend grâce à l'être qu'il en croit à l'origine. Et une humanité que cette voix ne renonce jamais à vouloir élever au-dessus d'elle-même.
Quel que soit l' "au-dessus", je marche !
Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, france, pierre boulez, karol beffa, musique contemporaine, olivier messiaen, vingt regards sur l'enfant jésus, ircam, machine 4x ircam, jean-sébastien bach, regard de l'esprit de joie, regard de l'église d'amour, les noces de figaro, cherubino voi che sapete, mozart, beethoven
samedi, 09 janvier 2016
REGARD SUR OLIVIER MESSIAEN 2
2/3
 La preuve que tout l’être de Messiaen respire en musique, c’est la place qu’il a donnée dans son œuvre au chant des oiseaux (et à toute la « musique » de la nature, si l’on en croit le texte dont il a accompagné chaque pièce de son Catalogue d’oiseaux - ci-contre l'ornithologue en train de noter ce qu'il entend). Dans ces conditions, les étiquettes peuvent bien valser : son insatiable curiosité pour toutes sortes de sonorités et de rythmes interdit de le classer. Bien sûr, il a tâté de la musique atonale, de la « musique concrète », mais jamais pour s’y arrêter, et surtout : jamais pour en faire un système d’écriture.
La preuve que tout l’être de Messiaen respire en musique, c’est la place qu’il a donnée dans son œuvre au chant des oiseaux (et à toute la « musique » de la nature, si l’on en croit le texte dont il a accompagné chaque pièce de son Catalogue d’oiseaux - ci-contre l'ornithologue en train de noter ce qu'il entend). Dans ces conditions, les étiquettes peuvent bien valser : son insatiable curiosité pour toutes sortes de sonorités et de rythmes interdit de le classer. Bien sûr, il a tâté de la musique atonale, de la « musique concrète », mais jamais pour s’y arrêter, et surtout : jamais pour en faire un système d’écriture.
Messiaen est étranger à tout esprit de système, contrairement à d’autres (suivez mon regard), qui ont peut-être d'autant plus à démontrer qu'ils sont moins musicalement « inspirés ». La musique de Messiaen ne démontre pas : elle exprime, elle témoigne, elle habille de formes un monde intérieur intensément habité. Ça ne l'empêche pas d'innover. On lui doit, certes, les « modes à transposition limitée » (le mode 1 ne se transpose pas, le mode 2 se transpose une seule fois, etc…), les « rythmes non rétrogradables » (l’équivalent en musique du palindrome en littérature), etc.
Mais il n’en fait pas un usage systématique. Car Messiaen existe si intensément qu’il n’a pas besoin de béquilles techniques. Pour lui, la technique fournit des outils, rien de plus : l'instrument est un moyen. Il doit rester à sa place utilitaire et être mis au service de ... disons, allez, l'inspiration (puisqu'il faut nommer la chose). Ce qui prime sur tout le reste, c'est l'intention, c'est le contenu, c'est la signification. La forme musicale découlera toujours : elle ne sera jamais à la source. La recherche formelle est un moyen au service d'une intention. Même si l'auditeur, nécessairement et en toute liberté, traduit dans sa langue à lui (y compris athée) le "message" du compositeur.
Chez Messiaen, cette vie intérieure qui recèle l'intention est au premier chef celle d’une foi catholique profondément enracinée. Je me demande d’ailleurs si cet aspect n’est pas pour quelque chose dans mon attirance pour les Vingt Regards, comme la nostalgie sécularisée, paganisée, esthétisée (je dis des horreurs !) d’un temps plus ou moins religieux de ma vie, où je n’avais pas encore assisté, en moi, à l’extinction de la foi et à l'effacement de Dieu. Savoir ce qu’il en est demeure cependant le cadet de mes soucis : je me contente de prendre les plaisirs comme ils viennent, sans leur demander leurs papiers.
Mais s’il célèbre le Ciel, Messiaen n’en est pas pour autant un pur esprit. Il ne renie rien, bien au contraire, de ce que peut lui offrir la Terre, en matière de beauté ou de désir, comme le montre sa longue histoire d’amour avec Yvonne Loriod, son élève au Conservatoire et sa cadette de seize ans (la pièce la plus longue des Visions de l’amen (1943) s’intitule « Amen du désir »), qu'il attendit, pour l'épouser, le temps raisonnable du deuil, après le décès de sa première femme (en asile psychiatrique), Claire Delbos (la dédicataire de Poèmes pour Mi).
Comme le montre aussi sa contemplation passionnée des richesses de la nature, qu’il aura célébrées en plus d’une occasion. « Seigneur, j'aime la beauté de votre maison, et le lieu où habite votre Gloire ! », écrit-il d'ailleurs, en citant un psaume, pour le choral qui clôt La Transfiguration de N.S.J.C. Par exemple dans son monument sonore intitulé Des Canyons aux étoiles, qui eut un tel succès aux USA que les Américains baptisèrent une montagne de l’Utah du nom du musicien (Mount Messiaen).
Sans vouloir trop me hasarder sur le terrain proprement musical, je dirais volontiers qu’aucune des œuvres produites par Olivier Messiaen au cours de sa vie n’est conçue selon un schéma reproductible. Je me hasarde peut-être, mais je crois qu'aucune n'est conçue selon un "pattern". Messiaen a inventé son langage musical, mais il n'applique pas des "recettes". Chaque œuvre est animée d’une vie qui lui est propre, obéissant à une logique particulière.
Ce qui caractérise la musique de Messiaen, c’est la singularité : chaque morceau semble conçu en fonction d’une nécessité intérieure, à partir de laquelle s’élaborera l’unicité de la forme (par exemple, Cinq rechants, qui m’avait saisi dès la première audition, il y a bien longtemps, dans la version ORTF de Marcel Couraud ; par exemple le Quatuor pour la fin du temps, écrit au Stalag VIII A de Görlitz, pour un improbable ensemble d'instruments et d'instrumentistes, piano déglingué, clarinette, violon et violoncelle à l'avenant : ce qu'il avait sous la main, quoi !). C'est la spécificité de l'intention créatrice qui décide de la forme aboutie.
C’est pour ça que chaque œuvre a quelque chose de nouveau à dire. Ou plutôt à faire éprouver à celui qui écoute. Ce qui distingue en effet la musique de Messiaen des bidouillages de la musique concrète ou électronique, ainsi que des calculs formels et abstraits du sérialisme, c’est qu’elle est toujours profondément ressentie. Ce n’est pas une musique réduite au cérébral. Boulez pense trop, pour tout dire. Il lui arrive même de penser faux : n'affirme-t-il pas que la mitraillette du bec du pic-vert sur l'arbre ne produit pas un son, mais un bruit ? Comme si la résonance de l'arbre ne produisait pas une véritable note.
Dans la musique de Boulez (pour prendre cet exemple au hasard), il ne faut jamais perdre de vue qu'il compose en mathématicien, qui lorgne par-dessus le marché vers la physique. Il ne faut jamais perdre de vue que l'IRCAM, qu'il a fondé, est un "Institut de Recherche", et qu'il considère la production de musique sous l'angle "Acoustique" : la raison d'être de l'IRCAM est de "Coordonner" "Acoustique" et "Musique".
La réduction du domaine musical au service de la Science, quoi. La composition musicale confinée dans un laboratoire. La musique se fabriquant "à la paillasse", selon un "protocole" rigoureux, au moyen de "manips" menées par un musicien en blouse blanche. La musique "in vitro", quoi. C'est une musique chimiquement pure faite pour impressionner et pour faire peur. Pour faire taire.
Messiaen est lui-même pourvu d'un vaste cerveau. Mais c'est aussi un sensoriel. Il dit quelque part qu’il veut faire une musique « chatoyante ». Je ne sais plus où il va jusqu'à parler de "volupté". Messiaen fait une musique certainement très savante (au moins autant que Boulez), mais en plus, une musique célébrant le bonheur d'exister. Messiaen ne travaille pas dans un laboratoire : il appartient au monde.
Je vais vous dire ce qui me botte définitivement dans les Vingt Regards sur l’Enfant Jésus : c’est la volupté. Ça fait peut-être bizarre, pour quelqu’un qui verrait dans la foi les seules exigences de macérations permanentes et de pénitences sans nombre, mais tant pis, c’est ce qui me rend cette musique intimement humaine et vivante. Il y a du bonheur voluptueux dans cette musique dont il fait l'offrande à son Dieu. Je ne crois pas que la musique ait un contenu précis. Y a-t-il vraiment des « musiques religieuses » ? Y aurait-il davantage des musiques érotiques, des musiques communistes, des musiques écologistes ? Non : la musique est vierge de tout contenu idéologique.
Ma petite – mais constante, ô combien ! – expérience de la musique (même chose en peinture) me fait à présent rejeter les compositions purement cérébrales émanées à grands renforts de calculs de grands cerveaux penseurs et pondeurs de théories et de concepts sophistiqués et abstraits. Les musiques qui se réduisent à appliquer un système : l'esprit de système, dogmatique et réducteur par essence, est ennemi du mouvement de la vie. Car la musique, c’est d’abord des sons physiques que l'auditeur reçoit physiquement.
Des sons, c’est d’abord des effets physiques produits sur les organes de la perception que sont les oreilles. Et les effets des sons ne se limitent pas aux oreilles : passez donc, une fois, au cours des "Nuits sonores" de Lyon, à proximité d’un boomer de 1,80 mètre de haut, et vous m’en direz des nouvelles au niveau du sternum. Mais ce qui est valable pour les sons percussifs est aussi valable pour les sons soufflés ou frottés : c'est tout votre sac de peau qui héberge la musique. Toutes les vibrations sonores vous atteignent. La destination de la musique est l’univers sensoriel de ceux qui la reçoivent.
J’ai fini par nourrir de l'aversion à l’encontre de ce que produisent ces théoriciens qui veulent à tout prix faire avaler à notre oreille les concepts élaborés à froid par leurs cerveaux scientifiques. Ce sont gens à prétendre dompter l'auditeur en lui fouaillant les oreilles à grands coups d'éperons sonores. La musique ne doit jamais oublier qu’elle est faite pour être éprouvée par le corps, et un corps ne devient scientifique que sur la table de dissection. Pas seulement, bien sûr, mais en musique, on ne saurait atteindre l’esprit que si l’on touche les sens, pour commencer.
Les sens sont la porte d’entrée qui conduit à l’esprit.
C'est-y pas bien envoyé ?
Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, france, olivier messiaen, catalogue d'oiseaux, musique atonale, musique concrète, messiaen ornithologue, modes à transposition limitée, rythmes non rétrogradables, palindrome, vingt regards sur l'enfant jésus, yvonne loriod, claire delbos, visions de l'amen, poèmes pour mi, des canyons aux étoiles, la transfiguration de notre seigneur jésus christ, utah mount messiaen, cinq rechants, quatuor pour la fin du temps, pierre boulez, ircam, ortf, domaine musical, grm, lyon, nuits sonores

