vendredi, 20 octobre 2023
ISRAËL, ÉTAT INJUSTE ...
...DEPUIS QU'IL EXISTE.
Le Hamas est donc un ramassis d'ordure humaine, qui se contrefout joyeusement de la "cause palestinienne" et de la création d'un hypothétique Etat palestinien, et qui au surplus méprise allègrement la vie humaine, que ce soit celle des ennemis ou des civils qu'il a sous sa coupe, voire de celle des individus qui composent ses propres troupes. Il n'a qu'une obsession : détruire Israël. Et une grande idée en tête : instaurer, maintenir et aggraver son pouvoir absolu. Si d'aucuns tiennent à parler de dictature, qu'on sache que je n'ai rien contre.
Le problème, c'est que le dit Etat d'Israël n'a aucune envie d'être rayé de la carte, malgré l'envie urgente et pressante d'anéantissement de l'intrus qui a saisi ses voisins arabes dès le moment de sa proclamation par Ben Gourion en 1948, envie qui habite encore un certain nombre de gens et d'Etats, en général musulmans.
J'ai dit "intrus". Qu'on le prenne dans le sens qu'on voudra, la naissance de l'Etat d'Israël, c'est d'abord l'irruption d'un intrus, qui a dépossédé, avec l'aval des grandes nations du monde, trop heureuses de se débarrasser du problème, les occupants précédents d'un territoire où ils vivaient depuis longtemps. Là est la première injustice, une injustice originelle si l'on peut dire. Car les habitants arabes de la Palestine de 1947 ne sont coupables de rien.
L'argument de la plus haute antiquité du peuple juif est fallacieux : vous imaginez qu'un vindicatif vienne vous dire : « Rends-moi ce que tu m'as pris il y a 2.000 ans ! » ? A ce compte, nous autres Gaulois, descendants en ligne sinusoïdale d'Abraracourcix, Vercingétorix et autres héros, aurions bien des récriminations à adresser aux Italiens en tant que descendants supposés des armées romaines. Vous voyez le topo ? Bon, mon exemple, c'est pour de rire, mais.
J'ajoute que, bien que l'Etat d'Israël ait entrepris des fouilles archéologiques destinées à exhumer les vestiges de l'antique "Terre Promise" des Hébreux pour mieux pouvoir affirmer la priorité des juifs dans la désignation du propriétaire présent le plus "légitime" des lieux, cela n'en fait pas un argument moins fallacieux. Vous les voyez, les descendants de Priam, d'Hécube, d'Hector et d'Anchise organiser une manif. à Istanbul ou Ankara au prétexte que l'actuelle Turquie usurpe le territoire de leurs ancêtres : les anciens Troyens de l'époque homérique ? Vous vous rendez compte du bazar mondial que ça mettrait à l'O.N.U. dans la définition des frontières ?
Affirmer ses droits sur une terre dont on a été chassé 2.000 ans avant, ça comporte un côté complètement brindezingue. D'abord parce qu'entre gens bien élevés, cela "ne se fait pas". Et puis parce qu'après un an et un jour, un bien non réclamé appartient à celui qui l'a trouvé (it's a joke, natürlich). Ensuite parce que l'histoire est ce qu'elle est, qu'on ne saurait la refaire, et qu'il s'en est passé, des choses qu'on ne peut effacer, depuis la "Grande Diaspora". Enfin parce que les gens finalement délogés vivaient là depuis lurette et n'y pouvaient rien, c'était comme ça et puis voilà. Ils n'avaient chassé personne de sa terre. Je veux dire que depuis une date indéterminable mais de toute façon très ancienne, c'est là qu'ils naissaient, qu'ils vivaient, qu'ils mouraient, qu'ils étaient enterrés de génération en génération. Et dénués, au surplus et avec raison, du sentiment d'avoir pris cet endroit à quelqu'un.
Il y a dans la création de l'Etat d'Israël quelque chose du : « Ôte-toi de là que je m'y mette ! », à la façon des Russes en Crimée et dans le Donbass ou des troupes d'Ilham Aliyev dans le Haut Karabakh. L'existence de l'Etat d'Israël prend sans conteste son origine dans un coup de force, sans doute facilité par la situation coloniale d'une région qui vivait alors sous "protectorat" (on disait "mandat") britannique. Maintenant, qui oserait dénier au peuple juif (au sens ethnique et non religieux) son droit de s'implanter et de résider quelque part, en paix et en sécurité ? Il est vrai qu'on pourrait poser la question à pas mal de gens sur toute la planète : Amérindiens, Kurdes, Ouïgours, Arméniens, Tibétains, Aborigènes, etc.
Le malheur, c'est qu'Israël n'a jamais pu trouver la paix avec ses voisins de la région. Certes, il y a des exceptions et un certain "modus vivendi" a parfois pu s'installer, précaire et soumis aux caprices de l'actualité. Résultat des courses, une situation générale d'hostilité plus ou moins déclarée mais permanente entre l'Etat des juifs et son environnement géopolitique. Jamais la paix, parfois des hostilités carrément ouvertes, de temps en temps des escarmouches ou des "opérations". Rien que ça, ça doit finir par être fatigant.
Je serais bien incapable et n'ai aucune envie de reconstituer l'historique des aléas, des conflits ouverts, des fluctuations politiques, des accalmies. Trop compliqué. Pour cela il faut s'adresser à Monsieur Henri Laurens, du Collège de France, qui connaît sur le bout des doigts l'intégralité de l'histoire de ce coin de la planète, de ses peuples, des événements qui s'y sont produits depuis Mathusalem, et qui est capable, si vous lui demandez poliment, de vous réciter heure par heure dans ses moindres détails la guerre israélo-arabe de 1973 (Kippour). Je veux juste pointer quelques aspects de la question, à partir de ce que j'en perçois au fond de mon terrier.
Le premier de ceux-ci concerne la vie politique en Israël, pour autant que je puisse en juger. Voici un pays qui, si j'ai bien compris, n'a pas de Constitution, cette charte où — du moins chez nous et dans quelques pays au mode de vie avoisinant — sont formulés les grands principes, la forme du gouvernement, les rapports entre gouvernants et gouvernés, l'organisation des pouvoirs publics (merci Larousse). C'est au moins une curiosité dans le concert des nations occidentales. Il s'ensuit que personne ne dispose de la définition du "citoyen d'Israël" et que, lorsque Netanyahou fait adopter la loi qui remplace l'Etat des juifs par l'Etat juif (notez la nuance qui change tout), on ne sait pas à quel statut rattacher les populations arabes qui vivent au milieu des juifs.
Le deuxième aspect qui attire mon attention est le mode de scrutin sur lequel repose la composition de la Knesset : la proportionnelle intégrale. Entre nous, si je trouve imparfait le scrutin majoritaire à deux tours tel qu'on le connaît en France, j'imagine l'énorme et innommable caca politique qui s'abattrait sur notre pays si un tel mode y était adopté. Car l'équation qui se présente aux responsables des partis israéliens les soirs d'élection est devenue de plus en plus insoluble, du fait des négociations de marchands de tapis auxquelles ils sont astreints en vue de la formation d'un gouvernement de coalition pas trop instable. La question de savoir combien de partis (et de "partis") sont représentés à la Knesset est indiscrète. Plus encore celle de savoir quel est le poids politique des religieux les plus rigoristes dans la composition de cette drôle d'assemblée.
Le troisième et dernier aspect sur lequel il semble nécessaire d'insister découle du précédent. Car plus les partis de droite (et autres religieux de plus en plus intégristes et extrémistes : ce sont eux qui ont fait tuer Itzhak Rabin, le père des défunts accords d'Oslo) ont pris d'importance à la Knesset, plus les gouvernants ont été obligé de laisser la bride sur le cou à ces plus ou moins alliés, mais activistes à plein temps qui, pour des motifs religieux, historiques, philosophiques ou autres, pensent dur comme fer que c'est TOUTE la Palestine qui leur appartient en exclusivité. Et que, puisque c'est eux les propriétaires, c'est là qu'ils vont construire leur maison et cultiver la terre. Une terre débarrassée des Palestiniens.
A cet égard, j'ai entendu des discours hallucinants et hallucinés, tenus par des monsieurs et madames tout-le-monde installés en Israël, qui ne laissaient aux Palestiniens plus qu'un seul droit : celui de foutre le camp. A les entendre, il serait sans doute plus facile de faire le décompte des modérés. Ceci pour dire que le Likoud (plus ou moins "socialiste", je crois) est dans les mêmes lamentables choux que notre défunt Parti "Socialiste", et que les électeurs de gauche se sont beaucoup raréfiés sur la scène politique israélienne, voire sont en voie d'extinction de voix. Dans le même temps, la loi des vases communicants remplissait les urnes de bulletins marqués à droite de la droite, avec les conséquences jusqu'au-boutistes que l'on voit à l'œuvre d'élection en élection.
On appelle ça la "Colonisation". Le but ultime de la colonisation, cela s'appelle "Annexion". Cela suppose l'éviction totale des Palestiniens. D'ailleurs certains parmi les hauts responsables politiques israéliens y pensent et en parlent ouvertement. Mais pour en rester au grignotage territorial opéré par les colons, c'est évidemment un fléau et une injustice majeure, jumeau monozygote de la très basse considération (disons carrément : le mépris total et très calculé) dont tous les gouvernements israéliens successifs ont entouré l'Autorité Palestinienne, dans le but presque avoué de faire monter l'influence, le rayonnement, le prestige et la puissance — précisément — du Hamas qui, aujourd'hui, représente sans doute — et à tort — aux yeux d'une forte majorité de Palestiniens, la seule "Autorité" légitime. Les chefs israéliens ont toujours violemment rejeté l'O.L.P., Yasser Arafat, Mahmoud Abbas et consort comme interlocuteurs et partenaires de négociations de paix.
On pourrait d'ailleurs se dire qu'Israël, au vu des assassinats massifs que le Hamas vient de commettre, a reçu l'horrible salaire de cette ligne stratégique démente, obstinément suivie depuis fort longtemps. Déconsidérer Mahmoud Abbas et son entourage du Fatah, disqualifier méticuleusement ce petit monde corrompu comme éventuel partenaire de négociations de paix, tous les dirigeants israéliens se sont attelés à ce travail de démolition des espoirs de paix. Tout ce qui aurait pu ressembler à une volonté de négociation avec l'Autorité Palestinienne a été sciemment tué dans l'œuf à cause des va-t-en guerre israéliens. Je me demande même si l'évacuation manu militari (je ne sais plus si c'était Ariel Sharon ou Ehoud Barak) des colonies juives de Gaza n'ont pas eu en leur temps pour objectif tout à fait délibéré de laisser le champ libre au Hamas.
Quant à la colonisation, je me souviens d'une carte publiée il y a bien des années dans Le Monde Diplomatique, qui représentait ce que la politique israélienne avait alors laissé de territoires aux Palestiniens de Cisjordanie. Pour donner une idée de la fragmentation extrême de ces territoires, le service cartographie les avait figurés sous la forme d'un archipel, où toutes les "îles" palestiniennes vivaient complètement isolées des autres, et que seules des "navigations" compliquées permettaient de les relier en slalomant parmi les portions grignotées par des colons juifs. On comprend que ces conditions de vie rendent insupportable le quotidien des Palestiniens.
Je ne parlerai pas de la psychologie "de combat" généralement partagée dans la communauté des colons, de l'arrogance souvent manifestée par ceux-ci à l'égard de leurs voisins Palestiniens, de l'appropriation arbitraire des terres, de la destruction des maisons, de la liquidation des champs d'oliviers, du mur de séparation et des routes qui le longent sans jamais se rencontrer, etc. Cette façon d'ouvrir la "Judée / Samarie" aux colons a quelque chose de carrément cinglé, cintré, givré, malade. Disons-le : la permissivité (la lâcheté) des pouvoirs successifs à l'égard des colons juifs a quelque chose de criminel.
Il faudrait qu'en Israël on finisse par se demander comment il se fait que la population palestinienne ordinaire de Cisjordanie et Gaza ait été rendue si perméable au discours et aux actions de ce Hamas extrémiste, terroriste, jusqu'au-boutiste. Est-ce que ça ne serait pas parce que le sort réservé par les Israéliens aux Palestiniens en tant que peuple est humainement inique ?
L'Afrique du Sud a pu en finir, après bien de la casse, avec le régime d'apartheid après des dizaines d'années cruelles pour les Noirs, Métis, Indiens et autres catégories raciales établies par les Blancs. Nul ne peut avancer une raison raisonnable et rationnelle pour qu'il n'en soit pas de même en Palestine. Mais pour cela, il faudrait ..., il faudrait..., il faudrait ..., il faudrait .............
Mais non, contrairement à tous les spécialistes estampillés et dûment autorisés, j'avoue fièrement que je n'ai aucune idée de ce qu'il faudrait, bien que je le souhaite ardemment. Je voudrais tant que le peuple d'Israël tout entier ait envie de se comporter de façon JUSTE ! Une chose quand même : il faudrait que les acteurs de la région se mettent d'accord pour tenter de se mettre d'accord sur les termes d'un éventuel accord sur les modalités d'un éventuel accord en vue d'une éventuelle cohabitation.
Mais je crains que les griefs de tous à l'encontre de tous aient atteint un tel point de non-retour et de gravité que plus personne ne peut pardonner à qui que ce soit. Les dettes mutuelles ont atteint des montants tellement exorbitants que plus aucun débiteur n'est aujourd'hui en mesure de les acquitter. Nous assistons à une forme de faillite généralisée.
En attendant, l'injustice originaire faite aux Palestiniens par l'Etat désormais juif se perpétue et s'aggrave de décennie en décennie, et il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Le monde n'a pas fini de braquer ses jumelles et son incompréhension sur cette région, à la fois si proche et si lointaine. Si chère et si douloureuse. Si forte et si folle. Si attirante et si dangereuse. Si belle et si laide.
C'est dans cette même région que, dans un de ses premiers livres (Aujourd'hui, demain et après ou Cela se produira bientôt, je ne me rappelle plus), l'écrivain Jean-Pierre Andrevon imaginait une guerre régionale qui durait depuis on ne savait plus quand, une guerre dont on avait perdu jusqu'au souvenir de la raison première, une guerre qui s'était éternisée on ne sait ni pourquoi ni comment, une guerre qui ne finissait jamais et ne pouvait pas finir. Une guerre éternelle, quoi. Il ne croyait pas si bien dire : qui aujourd'hui, parmi les vrais acteurs de tout ce merdier, désire faire la paix ?
Les guerriers les plus belliqueux du monde ne sont pas près de manquer de travail. Et les partisans de la paix (il y en a) n'ont pas fini de se lamenter.
***
Bilan : J'entends la question : « Alors, tu votes pour qui, baratineur de blog ? » Bonne question. Oui, quel est l'élu de mon cœur, de mon intelligence, de mon orientation politique ? L'Israélien ou le Palestinien ? J'espère que le lecteur, au bout de ce triplé de billets, a compris que ma réponse n'est ni facile, ni même possible. Israël a le droit d'exister, mais les Palestiniens ont un droit tout aussi clair de pouvoir en toute liberté vaquer à leurs affaires et cultiver la terre là où le sort les a semés. C'est sur ce point que l'Etat juif commet l'injustice terrible. Car tout ce monde a le droit de vivre en paix et en sécurité.
Mais alors, qui donc veut encore la guerre ? Poser la question, c'est presque y répondre : il y a d'un côté les colons, la colonisation de la Cisjordanie, le vol des terres palestiniennes, tout cela étant admis ou toléré par les gouvernements successifs d'Israël. Et puis en face, il y a le Hamas, le Hezbollah, et quelques autres groupes plus ou moins identifiables. Pour les deux groupes cités, Israël est et reste un ennemi à éradiquer.
Or quand on sait qu'ils ne sont que les faux-nez de la République islamique, on aboutit à cette conclusion : côté israélien, quelques juifs fanatiques entretiennent le climat d'hostilité du fait de leur folie de conquête territoriale. Côté arabe, seul l'Iran et ses pseudopodes régionaux, veulent la guerre et la destruction d'Israël (je fais abstraction des Etats simplement hostiles ou a priori méfiants et des velléités d'autres pays musulmans exaltés, mais beaucoup plus éloignés du terrain des opérations, comme l'Indonésie par exemple).
Je resterai donc le spectateur de cette longue tragédie à laquelle je ne peux rien, que je comprends à peine, qui me remplit de tristesse et d'amertume, et qui envahit les journaux, les ondes, les écrans, les réseaux sociaux et les esprits de récits d'horreur. Cela dit, il me reste l'impression répugnante que le Hamas aura mené, avec cette opération de massacres tous azimuts contre des juifs, une fabuleuse campagne de propagande, et couronnée de succès, puisque l'expédition a, partout dans le monde, réussi le tour de force de disparaître derrière les destructions et massacres indiscriminés conduits par l'aviation israélienne, en attendant l'armée de terre, les chars et le carnage. Qui parle encore de la saloperie du Hamas ?
Chapeau, les assassins ! J'espère au moins que vous ne l'emporterez pas au paradis d'Allah, ce jardin, paraît-il, « où les ruisseaux coulent » (ça, c'est un peu partout dans le Coran) et où de purs salauds parfaitement cyniques vous font croire que d'accortes houris vous attendent.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israël, palestine, palestiniens, arabes, cisjordanie, bande de gaza, jérusalem, tel aviv, ramallah, mahmoud abbas, benjamin nétahnyhou, jean-pierre andrevon, apartheid, juifs, musulmans, islam, islamistes, henri laurens, collège de france, guerre du kippour, knesset, ithzhak rabin, accord d'oslo, andrevon aujourd'hui demain et après andrevon cela se produira b, azerbaïdjan, arménie, arménien, haut karabakh, journal le monde
lundi, 14 février 2022
MORT D'UNE GRANDE DAME
Une grande dame vient de mourir. Une grande dame du droit. Je ne suis pas juriste, mais j'avais lu avec un immense intérêt Libertés et sûreté dans un monde dangereux (Seuil, 2010). J'écoutais avec le même immense intérêt ses cours au Collège de France, vous savez, à l'époque où France Culture diffusait, à l'usage de « la France qui se lève tôt » (citation), une émission intitulée "L'Eloge du Savoir", sous les auspices de Christine Goémé, entre cinq et six heures du matin.
Pour rendre hommage à l'impeccable juriste qui vient de mourir, je ne trouve rien de mieux que de republier un texte que j'avais écrit en 2015 après la lecture du livre cité ci-dessus. Les réflexions qu'il m'inspire encore sur les restrictions apportées à l'état de droit par les gouvernements successifs pourraient, je crois, alimenter utilement certains débats actuels et en particulier certains "convois de la liberté".
MADAME MIREILLE DELMAS-MARTY

L’inconvénient des formations juridiques, c’est qu’elles donnent en fin de parcours aux étudiants une tournure d’esprit excessivement attachée à la « lettre » du droit. D’où une certaine rigidité intellectuelle. Je ne sais pas si vous avez jamais mis le nez dans le texte de la « Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant » (1989) : à vous dégoûter de faire des enfants.
Et je ne parle pas du « Traité établissant une Constitution pour l’Europe », de sinistre mémoire, dont le pavé particulièrement indigeste (191 pages découpées en un déluge de parties, de chapitres, de sections, d'articles et de paragraphes), envoyé à tous les Français en 2005, après un rejet par référendum, leur a été enfoncé de force, légalement et démocratiquement dans la gorge par Nicolas Sarkozy, un peu plus tard, pour les punir d'avoir "mal voté" la première fois.
Libertés et sûreté dans un monde dangereux (Seuil, 2010), le livre de Mireille Delmas-Marty n’échappe pas à cette rigidité. En revanche, si les formations juridiques ont l'inconvénient que j'ai dit, elles ont l'avantage qui en découle : précision et exactitude. On appellera ça la rigueur. Un certain aspect « scolaire », si l’on veut, dans l’effort de construction, un peu « dissertation », avec introduction générale, trois parties subdivisées et chaque fois introduites et conclues, et une conclusion générale. Personne ne peut se perdre sur un parcours aussi visiblement balisé. La supériorité indéniable de cette méthode, c’est son impeccable netteté.
Alors, de ce livre un peu ardu pour l'éternel néophyte que je suis dans la langue des juristes, je ne retiens pas tout. Je laisse en particulier de côté ce qui fait la complexité et les vents contraires qui agitent les relations entre les instances juridiques nationales, européennes et internationales, les subsidiarités, les conflits, les résistances.
Je garderai juste la convergence de vues entre l’auteur et un juge dont j’ai lu récemment Le Rapport censuré (Jean de Maillard, voir mon billet du 9 mars), au sujet du poids incroyable que pèsent les Etats-Unis dans le domaine des relations (judiciaires et autres) internationales. Si je voulais résumer en simplifiant, je dirais que les Etats-Unis, non seulement se permettent tout quand leurs intérêts sont en jeu (Guantanamo, Bagram, …), mais font pression sur les autres nations pour qu’elles adoptent les mêmes critères qu’eux dans la « lutte contre le terrorisme ». Traduction : ils les y obligent, au motif de la loi du plus fort (le juge Maillard parle des transactions commerciales en dollar, qui doivent impérativement passer par une banque américaine sous peine de).
Ce qui m’a en revanche intéressé au plus haut point dans le livre de Mireille Delmas-Marty, c’est tout ce qu’elle dit de l’évolution inquiétante du droit, qu’il soit national ou international. Et pas dans le sens de l’Etat de droit. Je le dis tout net : tout en n’étant pas juriste, j’ai trouvé passionnante l’analyse qu’elle fait de deux conceptions opposées du droit, qui renvoient à deux conceptions antinomiques de l’humanité, l’une de tradition « humaniste », l’autre de tradition « guerrière ». Les gens au courant trouveront sûrement "basique" cette petite leçon de philosophie du droit. Elle est à mon niveau.
En France, traditionnellement, la justice attend qu'un individu ait commis un délit ou un crime pour le juger et le condamner, après établissement irréfutable des faits. L’auteur appelle cela « le couple culpabilité / punition », ajoutant que cette « école pénale » est « fortement influencée par Kant et Beccaria », c’est-à-dire qu’elle repose sur « l’universalisme des droits de l’homme » (p. 84-85)
Mais elle repose aussi sur l'idée que l'individu, sauf circonstances spéciales, sait ce qu'il fait. Il est mû par la raison, il est libre, donc il est responsable. "Justiciable", comme on dit. Le corollaire, c’est que personne ne peut être poursuivi avant. C’est l’acte qui fait le délinquant. C’est l’infraction qui justifie la poursuite. C’est un individu particulier qui est présenté au juge ("individualisation de la peine").
Or il existe une « école pénale » qui prône des idées radicalement autres. Une école dont la philosophie repose sur une « anthropologie guerrière ». Une école « positiviste », qui fait de l'homme, non un être libre et responsable, mais un être entièrement déterminé. Une école fondée par un certain docteur Lombroso au tournant du 20ème siècle. Une école qui invente le concept de « criminel-né ». Un juriste allemand, Carl Schmitt (1932), ira jusqu’à formuler l’idée d’ « ennemi absolu ». Deux concepts qui semblent s'imposer de nos jours.
Cette école divise donc l'humanité en une masse de gens normaux d'une part, et d'autre part une catégorie d’humains naturellement prédisposés à commettre des crimes. Des humains dans lesquels le Mal est inné (à supposer que tous les autres en naissent exempts). Mais le soupçon peut se porter pratiquement sur n'importe qui, étant donné que cette prédisposition ne se porte pas sur le visage. La preuve, c'est la stupéfaction des voisins quand le père tranquille tue sa femme, ou autres circonstances tragiques.
Selon cette conception, on ne parle plus de « culpabilité », mais de « dangerosité potentielle ». On ne parle plus de « peines de prison », mais de « mesures de sûreté », aux contours éminemment flous, à durée indéfinie. Ce n'est plus ce que vous avez fait qui compte, mais ce qu'un collège d' « experts » vous aura jugé capable de commettre dans l'avenir.
Autrement dit, on passe du diagnostic (acte avéré) au pronostic (acte potentiel, virtuel ). Sarkozy, on s’en souvient, était même allé jusqu’à proposer un « dépistage » précoce (dès trois ans) de la dangerosité future des enfants. Si vous enfermez un type pour des actes qu’on l’imagine potentiellement capable de commettre, il passera sa vie derrière les barreaux, plus sûr moyen de ne jamais savoir s’il en aurait commis.
Autrement dit, dès la naissance, il y a les humains et les autres. Des « monstres », pourquoi pas. Souvent présentés comme tels, en tout cas. Cette conception est éminemment anti-humaniste. Je reste convaincu qu'Adolf Hitler, Staline, Pol Pot et consort ne sont pas des monstres inhumains, mais qu'ils font hélas partie de l'espèce humaine. Hitler et Pol Pot sont nos semblables. Je déteste l'idée, mais je la crois vraie. L'horreur est humaine, trop humaine.
De plus, Mireille Delmas-Marty pointe, chez Carl Schmitt, une tendance à assimiler dans la même personne l’ « ennemi absolu » et le « criminel-né ». C’est-à-dire qu’il fusionne potentiellement deux institutions : celle destinée à maintenir l’ordre et celle destinée à défendre le territoire national contre une attaque étrangère.
Maintien de l’ordre et guerre reviendraient alors à une tâche unique. Armée et police même combat, avec pour conséquence l'extension de la notion d' « état d'urgence » dans le temps et dans l'espace, avec toutes les restrictions à l' « état de droit » que cela suppose. Je pose la question : qu'est-ce que c'est, l'opération « Vigipirate » (à laquelle vient de succéder « Sentinelle ») ? La « loi renseignement » est du même tonneau.
Elle cite un certain Gunther Jakobs, qui réclame le droit pour la société de « se défendre par des mesures radicales comme l’internement de sûreté ou la création de camps du type de celui de Guantanamo ou de Bagram ». Le vocabulaire employé pour justifier aujourd'hui l'action de l'armée française en Afrique et ailleurs (« Sécurité » ? « Maintien de la Paix » ? « Guerre au terrorisme » ?) est assez élastique pour tout confondre.
Pour le coup, l'état d'urgence tend à se pérenniser, étant entendu que l'urgence devient une norme permanente. C'est comme la drogue : ça commence par le plaisir, ça continue par la dépendance, et après une phase d'accoutumance (augmentation incessante de la dose), ça finit par une overdose.
Ce qui ressort, en définitive, de tout le livre, c’est ce qu’on voit se développer dans toutes les directions depuis le 11 septembre 2001 : la collecte généralisée des données, en particulier des données personnelles. Le nœud coulant policier, dans le monde entier, se resserre autour du cou des individus, que ce soit pour des raisons commerciales (profilage algorithmique des habitudes des consommateurs) ou pour satisfaire le besoin toujours accru de sécurité collective (repérage de mots-clés supposés se rapporter au terrorisme).
Tout cela se passe avec la complicité des plus hautes instances juridiques (Conseil constitutionnel en France, Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne, …) qui avalisent, non sans contradictions, des lois restreignant les droits, même si d’autres institutions font de la résistance (Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), par exemple).
Bref, en plein débat sur la « loi renseignement », ce livre de 2010 est encore plus actuel, et devrait alerter les défenseurs de ce qui reste de l’ « état de droit ». Un témoignage de plus sur l’aspect peu ragoûtant du monde qui est en train de mijoter sur les fourneaux de tous les pouvoirs.
Merci madame, pour la confirmation. Total respect.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : Je préfère ne pas trop évoquer l'optimisme de commande que Mireille Delmas-Marty manifeste en conclusion. Elle veut parier sur la raison des hommes et leur « communauté de destin », plutôt que sur la crainte que s'établissent des « sociétés de la peur ». Je veux bien. C'est son droit. En tant que grande universitaire, elle ne se sent peut-être pas le droit de faire autrement. On n'est pas obligé de partager cet optimisme, vu les évolutions actuelles sur de multiples terrains différents (politique, société, économie, écologie, ...).
***
On a eu le temps de perdre de vue le contexte de l'époque qui a assisté aux débats sur la « loi renseignement », mais sept ans après cette lecture marquante et après deux ans d'alerte sanitaire constante quoique sinusoïdale au gré des navigations à vue et des "stop and go" du gouvernement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup à changer ou ajouter.
Quand Mireille Delmas-Marty a pris sa retraite en 2012, c'est monsieur Alain Supiot qui lui a succédé. Si ses perspectives sont très différentes de celles de notre grande dame, son propos reste accroché à une altitude où la raréfaction de l'air nécessite une contention permanente de l'esprit : la densité des analyses n'est pas faite pour les paresseux.
En témoigne une lecture que je ne suis pas près d'oublier et que je conseille à tous les lecteurs avides de comprendre dans quel monde les pouvoirs modernes cherchent à nous faire vivre : La Gouvernance par les nombres.
TOTAL RESPECT !!
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mireille delmas-marty, libertés et sûreté dans un monde dangereux, état de droit, france, société, jean de maillard, imanuel kant, beccaria, docteur lombroso, carl schmitt, adolf hitler, staline, pol pot, guantanamo, france culture, christine goémé, collège de france, alain supiot, la gouvernance par les nombres
mercredi, 26 juin 2019
L'ISLAM ET SON PIÈGE 3/3
Je creuse encore le sillon que j'ai commencé à creuser sur l'islam et la place qu'il pourrait éventuellement trouver dans la culture proprement française et européenne. Je dois bien dire que plus j'y réfléchis, moins je trouve des raisons valables de laisser une place à l'islam dans la vie publique en France. Je précise que je ne suis pas un docte : je suis juste un citoyen ordinaire attentif à l'évolution de la société où il est né. Je n'ai pas de théorie ("grand remplacement" ou autre). J'observe, je ressens, et j'essaie de formuler.
3
Quoi qu’il en soit, Allah et Mahomet n’exigent du croyant que des devoirs à rendre concrètement, en gestes et en actes : c’est une religion pratique, où la piété doit se montrer (et l'impiété se cacher : j'ai vu, rue Belfort, un maghrébin sortir de l'épicerie avec une grosse bouteille de Coca dans une main, tandis que, de l'autre, il dissimulait dans sa manche une fiasque d'alcool fort, sans doute pour porter discrètement un toast à la santé du Prophète une fois rentré chez lui). On peut même trouver très contraignante l'obligation des cinq prières par jour.
Vous imaginez l'angoisse du soir ? Ai-je bien coché toutes les cases ? Pour un peu, j'irais jusqu'à dire que l'islam est une religion purement formelle : petit musulman, si tu respectes les formes imposées, si tu te comportes conformément aux préceptes sous l'oeil des caméras de surveillance, Allah te promet l'éternel séjour dans "les jardins où les ruisseaux coulent". Peu importe, dans le fond, ce que tu en penses : ce qui compte, c'est ce que tu manifestes concrètement, dans tes gestes et tes comportements. Ce qui compte, c'est ce que tu montres (peut-être une raison de la crispation générale sur le voile "islamique" en France, pays où l'ostentation n'est pas bien vue).
Et cette idée qui me vient laisse à deviner, derrière toute la croyance musulmane, toute la compacité du corps social qu'elle porte et qu'elle édifie. Les gestes qu'on fait, c'est aux yeux des autres. Cela peut paraître bête à dire, mais il n'y a pas de foi musulmane sans l'intégralité organique d'une société musulmane qui observe le croyant. Je ne suis pas le premier, loin de là, à le dire : l'islam est une religion qui joue un rôle de cohésion et de structuration sociale. Les commentateurs parlent bien d'un "islam politique" : en islam, le religieux, le social et le politique semblent indissolublement liés. En insistant là-dessus, je veux juste dire que la vérité individuelle de la croyance, en importance, arrive loin derrière.
Le nombre des croyants garantit la vérité et la force de la croyance. De même, l'ostentation individuelle de la conviction musulmane garantit la validité de la société musulmane. J'ajoute que le nombre des croyants est en lui-même un extraordinaire moyen de faire pression sur l'individu : il faut un culot monstre, le goût du danger et des nerfs en acier pour oser enfreindre l'obligation du jeûne pendant les journées de Ramadan.
Le plus important, à mon avis, c'est que le musulman n'est nullement tenu de vraiment croire (comme on dit "croire" quand on est de culture chrétienne) en Allah et Mahomet : il a juste besoin de faire les gestes commandés, et impérativement en présence de tous les autres membres de la communauté. Pas besoin de croire, il faut faire. Et il faut faire aux yeux des autres, ainsi intronisés témoins et garants de la piété de l'individu qui se plie au rituel.
Moralité : l'islam est la religion la plus laxiste au plan psychologique, en ce qui concerne l'authenticité, la sincérité de la foi, parce que c'est une religion d'ostentation et de démonstration. Une religion de l'extériorité et de la pression sociale. C'est la raison pour laquelle c'est la religion la plus dominatrice qui soit : ta religion, c'est le regard des autres sur toi et sur les gestes que tu fais. Il n'y a pas de religion plus conformiste que l'islam..
Je dirai qu'à la limite, le musulman n'a pas besoin d'être musulman pour être agréable aux yeux d'Allah et de ses semblables, il doit juste se comporter conformément au texte et accomplir les gestes qu'il lui commande. Pas besoin de croire : il faut faire (la "lecture" - ou "récitation", la prière, l'aumône, le pèlerinage, etc.). Si l'on admet cette façon de voir, il devient difficile de prendre l'islam au sérieux (je parle du point de vue chrétien). Religion du concret. Religion du visible, de l'extériorité, de l'ostensible, de l'ostentatoire.
Allah est assez bon pour laisser mon esprit penser ce qu'il veut, pourvu que mes bras, mes mains, mes jambes et mon corps effectuent quotidiennement la chorégraphie exigée : je garde l'esprit libre. Si ce n'est pas complètement idiot, je dirai que l'islam est la religion qui consacre le mime (le masque si vous voulez) comme garant de la vérité. Si cette conception n'est pas fausse de l'islam comme religion de l'extériorité, on comprend aussitôt la profondeur du fossé qui le sépare du christianisme, religion où l'intériorité, la conscience, le "for intérieur" jouent les premiers rôles.
En comparaison, le dieu des chrétiens est d'une violence infiniment plus pernicieuse, qui s'introduit par effraction jusqu'au tréfonds de la conscience du croyant et qui ne cesse de torturer celle-ci pour lui faire avouer, dans un élan de sincérité, qu'elle n'est qu'une pécheresse juste bonne à s'humilier devant son Seigneur. L'islam épargne à ses croyants de telles inquisitions, pourvu qu'ils accomplissent les "gestes". Ah bon, ce n'est que ça ?
Les conditions de l'unité globale sont donc si faciles à remplir que cela ouvre un boulevard à l’ « Oumma » : il s'agit simplement d'accomplir les bons gestes au bon moment dans sa vie quotidienne. Le dieu des chrétiens est, en comparaison, beaucoup plus intrusif, en même temps qu'il laisse le croyant beaucoup plus libre, parce que plus responsable de lui-même, et en même temps beaucoup plus inquiet du fait même de cette responsabilité qui lui incombe.
Le musulman est beaucoup plus tranquille et confortable, puisque non responsable de soi, pourvu qu'il accomplisse les gestes. Si l’on n’attend des gens rien d’autre que des comportements sociaux visibles, on peut aisément se mettre d’accord. Car de toute façon, et le Coran vous le ressasse jusqu'à plus soif : quoi que vous fassiez, Allah sait, et nul ne peut lui cacher quoi que ce soit.
Dans ces conditions, la diversité des islams peut se donner libre cours : le socle commun (Coran, cinq piliers) est tellement réduit qu'il est indestructible, et qu'il peut à loisir servir de base à une extrême hétérogénéité. Le tronc unique (Coran, cinq piliers) peut développer sans problème plusieurs branches maîtresses qui se subdivisent ensuite en branches, qui se séparent en branchettes, qui se répartissent en rameaux, eux-mêmes fractionnés en brindilles, etc.
Dans ces conditions, la « communauté des croyants » prend une existence tangible : toutes les sectes musulmanes, si différentes et opposées soient-elles, se souviennent du tronc unique dont elles sont issues (Coran, cinq piliers). Elles n'oublient jamais le lien d'étroite parenté avec l'ensemble dont elles constituent un élément. Tout ce qui se déclare musulman est donc musulman, quelles que soient sa conception et sa pratique, classiques ou bizarres, modérées ou fanatiques, de la religion.
Et c’est ainsi que l’islam n’a pas besoin d’une autorité unique (un « pape ») pour intégrer ou excommunier, contrairement au catholicisme. Le Coran et les cinq piliers une fois admis, tout est possible. S’il y a des hérésies ou des incompatibilités, on se fera éventuellement la guerre, mais on la fera avec une grenade dans la main droite et le Coran dans la main gauche. Et en respectant les cinq piliers.
Pas besoin d’un clergé hiérarchisé, de conciles pour unifier un corps de doctrine. D’où, par exemple, la répugnance des musulmans français lors des attentats de 2015 à dénoncer les criminels comme non-musulmans : qui parmi eux, s’ils sont de fervents croyants, s’érigerait en juge de ses coreligionnaires ? Pour eux, les Kouachi et Coulibaly étaient aussi de vrais musulmans. Pour les musulmans français, il était tout à fait évident que les assassins du Bataclan étaient des musulmans : comment auraient-ils pu déclarer, comme beaucoup les sommaient de le faire, que l'islam, ce n'est pas ça (les pancartes « Not in my name ! » ont été de pures velléités) ?
Car la formule « tout ce qui se déclare musulman est musulman » signifie que, du plus pacifique, du plus mystique, du plus contemplatif jusqu’aux plus cruels et sanguinaires des coupeurs de têtes de Daech, nul n'a le droit de dénier aux autres leur qualité de musulmans, pour autant qu’ils s’appuient sur le plus petit commun dénominateur du Coran et des cinq piliers. Tous les musulmans ont raison, toutes les façons d’être musulman sont valides, du point de vue de l’islam.
Il est donc très vain, il est même dangereux de soutenir mordicus, comme le font tant de bonnes âmes, tant de "responsables" et tant de politiciens, la bouche en cul de poule et la main sur le cœur : « Il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas stigmatiser. Il ne faut pas confondre "islam" et "islamisme". » L'a-t-on assez entendu seriner, cette rengaine : "il ne faut pas confondre islam et islamisme" ! En réalité, le guerrier impitoyable ou suicidaire ("djihadiste") et le soufi mystique et inoffensif sont frères de lait. Je veux dire qu'ils ont poussé sur le même arbre, sur des branches certes éloignées, mais intimement apparentées et unies par la même sève qui coule dans leurs veines. Ils sont issus du même tronc, ils ont les mêmes racines.
L'islam est au total une religion tellement rudimentaire et schématique que tout un chacun peut y projeter ce qu'il veut. N'est-ce pas pour cette raison d'ailleurs que le héros de Soumission (Michel Houellebecq, Flammarion, 2015) finit par se faire une raison et se convertir ? « Ce n'est que ça ? », semble-t-il se dire à la fin du roman. Et Dominique Noguez, dans son Houellebecq, en fait (Fayard, 2003), cite Claude Lévi-Strauss, qui voit dans l'islam « une religion de corps de garde ». Une religion si simpliste au fond qu'elle est à la portée du premier abruti venu. Il n'est pas loin, le point où tout être sensé pourrait se dire que l'islam est "la religion la plus stupide" (procès perdu de Dalil Boubakeur contre Houellebecq, à cause de Plateforme).
Les gens de chez nous, modérés, tolérants et bien intentionnés, qui appellent à ne pas faire d’amalgame entre les bons musulmans et les djihadistes, n’ont pas complètement tort : il y a bel et bien des islams. Les pratiques religieuses des Bosniaques ne ressemblent sans doute guère à celles des Tchétchènes, des Ouïghours, des Soudanais ou des Indonésiens. Mais il est encore plus vrai qu’il y a bel et bien un islam.
Ce n'est pas pour rien que, à l'époque des caricatures de Mahomet, des musulmans d'Afrique, du Proche-Orient et d'Indonésie s'étaient violemment insurgés, brûlant au passage un consulat. Oui, l'islam est viscéralement un. On est très valablement fondé à faire des amalgames et à mettre tous les musulmans dans le même sac. Et tant pis pour ceux qui m'accuseront de "stigmatiser" les musulmans : l’islam est en mesure de présenter tous les visages, et tous ces visages sont la vérité de l’islam.
Il est légitime de considérer l'islam en bloc, et de dire qu'il n'a rien à faire en Europe, où le peu qui en a été implanté (Espagne jusqu'en 1492, Balkans) l'a été en lui faisant la guerre. L'islam est en soi totalement inassimilable dans la république ou dans la culture européenne. Son côté protéiforme fait apparaître une infinité de visages divers, aimables ou terribles, mais cette hétérogénéité n'est qu'une apparence : la base qui lui sert de socle est indestructible.
Conclusion : ce qui unit les musulmans du monde entier est infiniment plus puissant que ce qui les sépare. Ce qui fait la force de leur identité commune dépasse de très loin ce qui les différencie. C'est ce que les démocraties occidentales ont un mal fou à comprendre.
Cela veut dire que, pour les consciences européennes scrupuleuses, le problème posé par l’islam en terre de culture très anciennement chrétienne est absolument insoluble. Voilà où se situe le piège : dans la double nature de l'islam, multiple et un, indissolublement et dans le même temps, ce qui lui permet de jouer sur tous les tableaux. Il est tellement multiforme qu'il a réponse à tout et à son contraire. Car pendant que l’islam individuel, pacifique et bon enfant se fait admettre comme un acteur bien intégré dans la société, l’autre islam, l'islam collectif, l'islam global, l'islam militant (voire militaire), l'islam qui ne rêve rien d’autre que la conquête ou la destruction de ce qui n'est pas encore musulman, avance tranquillement.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : islam, musulmans, coran, la mecque, la bible, infidèles, djihadistes, chrétiens, ancien testament, journal le monde, pascal galinier, mahmoud hussein, daech, malek chebel, livre saint, moïse, noé, jésus, mahomet, mohamed, sourates, thomas römer, collège de france, allah, frères kouachi, coulibaly, poitiers 732, boualem sansal, gouverner au nom d'allah, chiites sunnites, bachar el assad, cinq piliers, pèlerinage à la mecque, ramadan, évangile de luc, oumma
mardi, 25 juin 2019
L'ISLAM ET SON PIÈGE 2/3
Avertissement (2 novembre 2019) : à force de revenir sur ce billet, d’y ajouter et d’y modifier des éléments de taille plus ou moins importante, je me vois dans l’obligation, pour une simple question de confort et de lisibilité, de le couper en deux.
2
La Communauté des croyants.
C’est la raison pour laquelle, d’après ce que j’en sais, dans l’islam, on ne touche pas à la lettre du Coran : il faut la prendre telle quelle, sans rien y changer. Il semblerait qu’un jour (au dixième ou onzième siècle ?), un calife ait décrété qu’il était formellement interdit de questionner le texte même qu’on avait eu, il est vrai, tant de mal à établir. Ce qui est demandé aux hommes, c’est seulement de se pénétrer de la parole divine en l’apprenant par cœur, et en se la récitant fidèlement.
Cette interdiction de toute interprétation est juste une hypocrisie et une lâcheté, en même temps qu’une outrecuidance et un coup de force. Car comme on pouvait s’y attendre, l’interdit n’a pas du tout empêché la prolifération des interprétations, non explicites mais traduites dans la réalité par la formation d’une multitude de communautés, tendances, sectes et courants.
Car l’islam est une religion éminemment plastique : elle prend racine rapidement et sans difficulté dans n’importe quel sol, comme l’ont prouvé les fulgurantes conquêtes arabes aux 7ème et 8ème siècles (vous savez, celles qui se sont "arrêtées à Poitiers"). Mais si l'islam s'acclimate aisément dans chaque sol où il est semé, celui-ci en retour le marque de son empreinte. D'où un paysage tout à fait composite.
Si l’on regarde le tableau d’ensemble, on voit une sorte de manteau d’Arlequin, un patchwork de traditions liées au lieu, à la coutume locale, aux individus, etc. Cela donne une multiplicité de « communautés », toutes si diverses qu’on peut s’étonner que toutes puissent, d'un seul élan, se réclamer de l’islam. Malek Chebel, grand spécialiste en la matière, musulman lui-même, le disait : « L’islam est une auberge espagnole ».
On peut s’en faire une petite idée dans un opuscule de Boualem Sansal : Gouverner au nom d’Allah (Gallimard, 2013), où l’on constate que la compartimentation de l’islam en cellules séparées confine parfois à ce qu’on observe dans les groupuscules trotskistes : la scissiparité. Tout le monde connaît le fossé qui sépare chiites et sunnites. Mais Sansal ajoute à ces deux frères ennemis le soufisme et le kharidjisme. Et il poursuit en précisant, rien que pour le sunnisme, qu’il existe quatre grands rites, et que ça ne s’arrête pas là : « Ces rites sont : le malékisme, le hanafisme, le chafiisme, le hanbalisme, chaque rite s’étant lui-même scindé en plusieurs branches et rameaux ». N’en jetez plus !
Quant aux chiites, ils ne sont pas en reste. C’est un « courant complexe, à la fois rationaliste, spiritualiste et ésotérique », c’est pire que le sunnisme : il « se divise en quatre branches se divisant elles-mêmes en de nombreuses écoles et sectes dissidentes ». Il y a les duodécimains (ou jafarites), les zaïdites (« exclusivement dans les montagnes du nord-ouest du Yemen »), les ismaéliens, parmi les nombreuses branches desquels on trouve les hétérodoxes druzes (Liban), qui rejettent la charia et croient en la métempsycose. Il y a enfin les ghoulâts, parmi lesquels la secte alaouite de Bachar El Assad. N’en jetez plus !
Et pourtant, au-delà des inimitiés, des guerres et des dissidences, il existe vraiment une « Oumma » (communauté des croyants) où tous les musulmans se rassemblent. Et je trouve incompréhensible qu’une telle hétérogénéité n’ait pas fait éclater cette « Oumma » en mille morceaux définitivement étrangers les uns aux autres, comme le sont par exemple, chez les chrétiens, catholiques romains et orthodoxes. Quel lien coud les pièces du puzzle musulman de façon à les faire tenir ensemble ? Quel facteur leur donne une telle apparence d’unité ?
N’étant ni ouléma, ni mufti, ni musulman, ni même croyant de quelque religion, j’en suis réduit à mon petit raisonnement de citoyen ordinaire. Et je me dis que pour qu’une telle salade russe soit considérée comme « une » (par ses membres comme par ceux qui n’en font pas partie), la seule possibilité, c’est que le dénominateur commun soit réduit au strict minimum. Plus l'accord repose sur un nombre réduit de clauses, plus il est solide. Plus l'accord est minimal, plus il a des chances de durer. Ce sont les pactes subtils et complexes qui sont les plus fragiles.
Vu du dehors, ce dénominateur existe : en dehors du Coran proprement dit, ce sont les « cinq piliers » (on devrait dire : les cinq commandements) : 1 – la profession de foi (s’il est horriblement long et compliqué de se convertir officiellement au judaïsme, pour devenir musulman, c’est simple comme bonjour : une formalité vite expédiée) ; 2 – l’aumône (j’ignore dans quelles conditions) ; 3 – le pèlerinage à La Mecque ; 4 – le jeûne du mois de ramadan ; 5 – les cinq prières par jour. La foi chrétienne me semble infiniment plus exigeante, puisqu'elle veut un engagement de la personne tout entière, extérieure et intérieure. Et puis, sa table de la loi compte dix commandements.
Car je note déjà un point commun : les cinq critères concernent des actes sociaux, et comme tels, ils doivent être visibles, pour ne pas dire ostensibles. Je ne suis pas sûr que les musulmans comprennent ce qui, pour les chrétiens, tourne autour de la « conscience » (cas de, crise de, scrupule de, problème de, examen de, directeur de, liberté de, etc.), je veux dire tout ce qui concerne l’intériorité individuelle, ce lieu de la délibération intime. Et chez les chrétiens, au contraire de l'islam, plus la foi est voyante, plus elle est suspecte (voir la parabole du pharisien et du publicain dans l'évangile de Luc).
Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que la religion musulmane est une religion de la pure extériorité et de la socialité. Le comble de cette extériorité, dans l'islam de France, est évidemment atteint par le "voile islamique". En islam, pas de « for intérieur », cette instance qui soumet le chrétien à son propre jugement et qui, avant même la confession, en attend sincérité et transparence. Allah et Mahomet tolèrent magnifiquement la dissonance entre le geste social et la pensée intime. Je veux dire que, pour eux, l'hypocrisie n'est pas un péché, pourvu que les devoirs soient rendus. L'islam ignore la "conscience", ainsi que la liberté, la délibération et le conflit éventuel qui vont avec.
Allah considérerait cette liberté comme une offense, et Mahomet la tiendrait pour un sacrilège. Pour Allah et Mahomet, la liberté individuelle est juste une insoutenable pornographie. Cette seule idée en dit long sur la compatibilité de l'islam en général et de la démocratie à l'européenne. Allah et Mahomet conchient, compissent et vomissent la démocratie. D'ailleurs "musulman" signifie "soumis à Dieu". L'individu autonome ? Scandaleux ! Inadmissible !
09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : islam, musullmans, coran, la mecque, la bible, infidèles, djihadistes, chrétiens, ancien testament, journal le monde, pascal galinier, mahmoud hussein, daech, malek chebel, livre saint, moïse, noé, jésus, mahomet, mohamed, sourates, thomas römer, collège de france, allah, frères kouachi, coulibaly, poitiers 732, boualem sansal, gouverner au nom d'allah, chiites sunnites, bachar el assad, cinq piliers, pèlerinage à la mecque, ramadan, évangile de luc, oumma
lundi, 24 juin 2019
L'ISLAM ET SON PIÈGE 1/3
Avertissement : je crois que l’islam façonne la personne humaine tellement en profondeur que les données qui caractérisent la société française le rendent inassimilable. Je crois aussi que cette religion a été façonnée de telle manière par l’histoire que tous ceux qui s’en réclament le font à bon droit, quelles que soient leur conception et la pratique qu’ils en ont. J’en conclus que les modérateurs professionnels qui appellent à ne pas « faire d’amalgame » entre les musulmans pacifiques et le djihadistes fanatiques se trompent. Ils n’ont pas tort de parler de la pluralité des islams, mais on peut et on doit aussi considérer que l’islam est essentiellement un. C’est dans le piège de cette double nature (Janus de la modernité, double visage, double langue) de l’islam que tombent les partisans de l’accueil à bras ouverts et aveugles. En jouant sur tous les tableaux, l'islam gagne à tous les coups.
1
Le Coran.
Le Coran est un texte sacré. Attention, on ne plaisante pas : total respect. Les musulmans sont plus que chatouilleux sur le sujet, et sont prêts à tout s’ils pensent que quelqu’un dans le monde a manqué de respect au bouquin ou à l'homme par qui celui-ci est arrivé sur terre (je devrais dire "sur omoplates de camélidés"). Gare aux infidèles qui se moqueraient de l’un ou de l’autre : on peut aller jusqu’à vous brûler quelques ambassades ou à vous couper quelques têtes de mécréants. Cela s’est vu il n’y a pas très longtemps.
Ben mon pote, c’est pas les chrétiens d’aujourd’hui qui feraient ça pour la Bible. Bon, c’est vrai, l’histoire prouve qu’ils ont énormément de sang versé à se faire pardonner. Et puis aussi, il faut dire que le chrétien, ça commence à se faire rare sous nos climats tempérés. Aujourd’hui, franchement, combien de chrétiens sont prêts à jouer les redresseurs de torts ? A mourir pour leur foi ? Pas grand-monde. A croire que la chrétienté n’a plus une grande consistance de nos jours. Bon, il faut dire qu’en termes de composition, les deux bouquins sacrés n’ont pas grand-chose à voir.
Côté Bible (je parle de l’Ancien testament), une réunion de quarante-six "livres" sans beaucoup de liens entre eux, quoique sur une thématique unique, où s’entremêlent des pages d’histoire (exode), des invocations et prières (psaumes), des prescriptions et interdictions (lévitique), etc. Côté Coran, une inspiration unique, certes, mais une inextricable compilation de petits bouts de phrases, des morceaux de paragraphes et cent quatorze chapitres (sourates) répartis du plus long au plus court.
Dans la Bible, au moins, le premier quidam venu peut suivre s’il en fait l’effort : il y a une construction narrative et une unité globale qui lui confère, par comparaison, la cohérence logique d’un traité scientifique ; dans le Coran, le coq-à-l’âne domine, il est même permanent. Ce sont sans cesse des redites et des coupures, une pulvérisation formelle telle qu’il n’est pas possible à un lecteur ordinaire de s’y retrouver. Et puis ça rabâche, ça serine, ça ressasse. Comme si l’auteur voulait enfoncer dans le crâne un petit nombre d’éléments, mais carrément à coups de marteau. Combien de mots et de pages resterait-il dans le Coran si l'on éliminait toutes les répétitions ? Pas lourd.
Résultat pour le lecteur ordinaire : tu nages, tu te noies, tu ne sais pas par quel bout prendre la chose. C’est ce que disait le journaliste Pascal Galinier, quand il rendait compte, dans Le Monde du 24 décembre 2016, de l’essai de Mahmoud Hussein, Les Musulmans au défi de Daech : « Le Livre saint est un texte hermétique pour le commun des mortels, donc sujet à d’infinies interprétations, chacun y piochant ce qu’il veut ».
Il faut insister sur cet hermétisme du texte, qui tient à sa composition : il a été recueilli sur un nombre invraisemblable de supports divers, tessons, planchettes, omoplates de camélidés, etc. Comment faire tenir tout ça ensemble et donner un semblant de cohérence ? Le puzzle est infernal et infaisable : le comble du saucisson découpé en tranches fines. Imaginez une immense mosaïque antique dont les milliers de petits morceaux (tesselles) auraient été versés en vrac dans une grande caisse : imaginez les trésors d'orfèvrerie méticuleuse qu'il faudrait à une armée de spécialistes pour reconstituer le visage du chef d'œuvre dans son intégralité. Le Coran est dans ce cas, et les orfèvres ont échoué.
Je crois me souvenir qu’il a bien fallu deux siècles pour aboutir à un consensus à peu près général et au texte "définitif" ("définitivement provisoire" aurait été plus juste). Il ne faut pas s’étonner qu’à nos yeux celui-ci ne tienne pas debout, tant ça part dans tous les sens. Mais il est stupéfiant d’apprendre qu’un tel salmigondis sert de table de la loi à un milliard et demi d’êtres humains : ça défie toute raison.
Je n’ai pas fait une étude approfondie du Coran, je me suis contenté de le lire intégralement et avec beaucoup d'attention, en lecteur ordinaire, pour me faire une idée personnelle de la chose, et ce n’est déjà pas si mal, tant j’ai trouvé la lecture éprouvante, moi qui suis habitué à des récits reposant sur la continuité (mais je n’ai jamais pu arriver au bout d’une lecture intégrale de la Bible : je dois avoir un problème avec le sacré).
Ma conclusion est que le Coran, ce livre rebutant, n’aime pas les hommes. A se demander si Dieu en personne ne les déteste pas. C’est un livre destiné à la crème des élites qui ont fait bac+12 (et qui par ailleurs détiennent le pouvoir), et qui dit au commun des mortels : "Tu n’es pas en état d’accéder à l’essence de cet enseignement. Sois humble et fais confiance à ceux qui te disent qu'ils savent". L'islam est une religion qui légitime ceux qui ont le savoir et ceux qui sont au pouvoir, et qui fait en sorte que ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre se contentent de leur sort. L'islam, par nature, déteste la démocratie.
Je me dis que ma lecture en vaut une autre. Pourquoi serait-on, s’agissant de ce livre, obligé de s’en remettre à l’autorité de quelque savant qui nous expliquerait que nous avons tort, et qui nous apprendrait comment il faut le lire ? C'est un peu la même chose pour la musique contemporaine : le plus grand spécialiste aura beau me bourrer le crâne d'arguments, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Je n'ai jamais aimé que l'on m'impose "ce qu'il faut savoir", et encore moins comment il faut le savoir. Je suis aussi habilité qu’un plus savant que moi à me faire une idée valide de ce que j’ai lu par moi-même. Les musulmans ne sont pas logés à même enseigne, contraints qu’ils sont de s’en remettre aveuglément à des spécialistes, quand on ne les oblige pas à apprendre le livre par cœur.
Pour ce qui est du « message », je dirais que le Coran assène pesamment, de son début jusqu’à sa fin, des louanges à Dieu. Il vous assomme de prescriptions impérieuses, d’interdictions formelles et de promesses vagues : châtiments cruels aux mauvais croyants (juifs, chrétiens et mauvais musulmans) et récompenses sublimes (jardins où les ruisseaux coulent) à ceux qui se soumettent sans rouspéter (musulman = soumis à Dieu).
En dehors de ça, des allusions fugitives à l’Ancien testament, à des événements ; plus insistantes à des personnages présents dans la Bible (Moïse, Noé, Jésus), etc. Et puis le maître-mot, qui différencie radicalement l’islam du christianisme : Dieu n’a pas été engendré et n’a jamais engendré (sourate 112) ! Rien de plus autoritaire et de plus terrorisant que le Coran. Rien de plus binaire, de plus dichotomique, de plus manichéen que le Coran.
Autre différence entre Bible et Coran : le rapport des croyants au texte qui les guide. Je passe sur tous les types de chrétiens créationnistes, qui prennent la Bible au pied de la lettre, et persistent à penser que le monde a été créé en six jours, il y a environ six mille ans, et autres fadaises. Il faut le reconnaître, la chrétienté n’a pas cessé d’interroger la lettre de la Bible pour en dégager l’esprit. Les chrétiens ont passé beaucoup de temps et d’énergie en exégèses, efforts d’herméneutique, commentaires, …
Thomas Römer, professeur au Collège de France, poursuit son travail monumental : il s’efforce d’identifier, dans les chapitres de la Bible, toutes les strates dont ils sont faits : indo-iraniennes, mazdéennes, mésopotamiennes, etc. Autrement dit, sa démarche consiste à reconnaître ce qui, dans la Bible, n’est pas de la Bible, mais emprunté à des sources étrangères. Les innombrables rédacteurs réels de la Bible ont forcément, selon lui, puisé dans les textes qui circulaient déjà à leur époque.
Ce que Thomas Römer s’efforce d’établir scientifiquement, c’est l’historicité du texte de la Bible, ce à quoi se refusent l’immense majorité des musulmans, qui sont persuadés que le Coran est a-historique, puisque descendant directement de la révélation divine. Que deviendrait la « parole de Dieu » si elle redescendait dans un contexte purement terrien ? Cela risquerait de lui faire perdre son caractère d’absolu, et de la faire tomber dans un relativisme extrêmement dommageable.
Vous vous rendez compte ? Allah avec des dimensions humaines ? Tous les pékins anonymes auraient l’ambition de « devenir califes à la place du calife ». Je me demande d'ailleurs si on ne pourrait pas dire que c'est à ce résultat qu'a fini par aboutir le christianisme qui, avec la sécularisation et la démocratisation, a fait de l'individu une sorte de centre. Simple question en passant.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : islam, musullmans, coran, la mecque, la bible, infidèles, djihadistes, chrétiens, ancien testament, journal le monde, pascal galinier, mahmoud hussein, daech, malek chebel, livre saint, moïse, noé, jésus, mahomet, mohamed, sourates, thomas römer, collège de france, allah
mercredi, 20 mars 2019
J'AI LU SÉROTONINE 4
 Pour rappel : J'ai lu Sérotonine 1 et J'ai lu Sérotonine 2.
Pour rappel : J'ai lu Sérotonine 1 et J'ai lu Sérotonine 2.
Considérations d'un lecteur ordinaire (fin).
Camille entre dans la vie du narrateur à la page 161 du roman. Elle est citée dès la page 11, mais ne fait réellement irruption dans le paysage qu’au moment où Florent se la remémore : chargé par sa hiérarchie de promouvoir les fromages de Normandie (camembert, livarot, pont-l’évêque), une mission "pour du beurre" en réalité, il est amené à servir de tuteur, lui qui vient d'Agro, à une jeune stagiaire de l’Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort, qu’il vient attendre à sa descente de train, à la gare de Caen.
En l’attendant, il est atteint d’ « un cas de précognition bizarre » : dans une curieuse juxtaposition, il remarque les herbes et les fleurs jaunes qui poussent entre les rails (« végétation spontanée en milieu urbain »), dans le même temps qu’il aperçoit le « centre commercial "Les bords de l’Orne" ». En quoi est-ce bizarre ? en quoi une précognition ? se demande le lecteur. Toujours est-il qu'il s'attend à quelque chose d'au moins inhabituel.
Je remarque au passage un point du style de Michel Houellebecq, qui se débrouille toujours pour éteindre toute velléité d’élan sentimental ou lyrique, en posant à côté de l’ébauche de celui-ci une notation triviale. Une sorte de « romantisme refusé », qui induit une lecture déceptive (probable origine des nombreuses critiques du style, souvent jugé "plat", de Houellebecq). Sa conception, peut-être, du « roman sentimental » qu’il annonçait explicitement dans les médias en 2015, après Soumission. Ce sont peut-être ces impuretés qui font dénoncer à beaucoup de gens en général, et à Antoine Compagnon en particulier, cette « langue plate et instrumentale » (Le Monde, 4 janvier 2019), qui ne se demandent même pas si cet effet produit par la lecture n'est pas exactement celui que l'auteur voulait provoquer. Comme quoi on peut être professeur au Collège de France et connaître des pannes de courant.
« Lorsqu’elle me dit après un temps très long, dans lequel cependant n’existait aucune gêne (elle me regardait, je la regardais, c’était absolument tout), mais lorsqu’elle me dit, peut-être dix minutes plus tard : "Je suis Camille", le train était déjà reparti en destination de Bayeux, puis de Carentan et Valognes, son terminus était en gare de Cherbourg » (p.162). Economie des moyens, surtout ne pas trop en dire, affubler l’événement sentimental de défroques banales pour qu’il passe inaperçu : Houellebecq semble s’être demandé comment renouveler la scène du coup de foudre. Il enchaîne : « Enormément de choses, à ce stade, étaient déjà dites, déterminées, et, comme l’aurait dit mon père dans son jargon notarial, "actées" » (ibid., toujours ces impuretés).
Labrouste se perd alors dans des considérations bassement terriennes sur l’installation de Camille à Caen pour le temps de son stage. La réponse de Camille vaut son pesant de surprise émerveillée : « Elle me jeta un regard bizarre, difficile à interpréter, mélange d’incompréhension et d’une sorte de compassion ; plus tard elle m’expliqua qu’elle s’était demandé pourquoi je me fatiguais à ces justifications laborieuses, alors qu’il était évident que nous allions vivre ensemble » (p.163). Elle au moins elle sait. La messe est dite : Camille est la femme de sa vie. Ou du moins elle aurait dû le rester, s’il avait su. S’il avait pu.
Tout en étant incapable d'en tirer la seule conclusion logique (l'engagement définitif dans la vie à deux), il perçoit bien ce qu’il représente aux yeux de cette étudiante de dix-neuf ans : « … et j’étais bouleversé, chaque fois que je lisais dans son regard posé sur moi la gravité, la profondeur de son engagement – une gravité, une profondeur dont j’aurais été bien incapable à l’âge de dix-neuf ans » (p.179). Il sait aussi que cet amour qui a quelque chose d’absolu le comble. L’un de leurs « rites » est de dîner le vendredi soir à la brasserie Mollard : « Il me semble qu’à chaque fois j’ai pris des bulots mayonnaise et un homard Thermidor, et qu’à chaque fois j’ai trouvé ça bon, je n’ai jamais éprouvé le besoin, ni même le désir d’explorer le reste de la carte » (p.178, les bulots et le homard n'étant là que pour signifier qu'il ne demande rien de mieux à la vie que d'être là, avec cette femme-là).
C'est là que le livre atteint son point culminant (on est exactement à la moitié), la suite sera une longue pente descendante. Le grand amour : « Je ne crois pas me tromper en comparant l'amour à une sorte de "rêve à deux" » (p.165) ; « J’étais heureux, jamais je n’avais été aussi heureux, et jamais plus je ne devais l’être autant » (p.172) ; « … seuls face à face, pendant quelques mois nous avions constitué l’un pour l’autre le reste du monde … » (p.173) ; « … et il me paraît insensé aujourd’hui de me dire que la source de son bonheur, c’est moi » (ibid.). Pour dire le vrai, cet amour le dépasse. De leurs moments de bonheur, il garde seulement deux photos, dont une prise dans la nature, quand elle s’occupe de lui, agenouillée : « … je n’ai plus jamais eu l’occasion de voir une telle représentation du don » (p.174). Et il suffit qu'elle vienne vivre avec lui pour qu'il se rende compte que seule cette femme sait faire de la maison qu'il occupe un lieu vraiment habitable.
Oui, mais c’est lui qui n’est pas à la hauteur. On a compris : Sérotonine est un roman d’amour, mais un roman de la déception, voire du paradis perdu. Pas la déception de l’amour, mais de constater l’impossibilité de l'amour dans ce monde-là. Et là, ce n'est plus seulement l’individu Florent-Claude Labrouste qui est responsable : c’est la société : « … j’avais bien compris, déjà à cette époque, que le monde social était une machine à détruire l’amour » (p.173). Je n’ai pas envie de peser les autopsies respectives de ce qui, dans Sérotonine, relève de l’individu, de la société et de la civilisation, je crois que, dans l’entreprise de Houellebecq, tout cela forme un tout, et je n’ai guère de goût pour le médico-légal. Il faut ici considérer l’individu comme une métaphore (plutôt une métonymie, d'ailleurs, si je me souviens bien, peut-être même une synecdoque, allez savoir).
Ce qui est sûr, c’est que le narrateur de Sérotonine s’inscrit dans une problématique qui dépasse la dimension individuelle de Florent-Claude Labrouste, cet être finalement sans consistance et baladé par les circonstances : « Plus personne ne sera heureux en Occident, pensa-t-elle », p.102 ; « …une civilisation meurt juste par lassitude … », p.159 ; « La France, et peut-être l’Occident tout entier, était sans doute en train de régresser au "stade oral" », p.323. L’individu est peut-être libre, au moins en partie, et peut espérer se construire lui-même s’il en a la force et la volonté, mais il ne pourra s’abstraire du cadre dans lequel il a grandi et qui l’a au moins en partie fabriqué : la société, la civilisation.
Je crois que Florent-Claude Labrouste, dans l’esprit de Michel Houellebecq, est la figure quintessentielle de ce pauvre individu de sexe masculin que produit à la chaîne la civilisation occidentale. Il est à l’image de cette civilisation : impuissant à faire que la vie des gens soit guidée par la puissance de l’amour. Ce dont le héros ne se remet pas. C'est le docteur Azote, une trouvaille romanesque d'une force extraordinaire, qui lui déclare : « J'ai l'impression que vous êtes tout simplement en train de mourir de chagrin » (p.316). Il faut entendre tous les propos que tient ce médecin carrément atypique au pauvre narrateur livré aux aléas du destin. On pourrait presque lire Sérotonine juste pour le docteur Azote (pas vrai, bien sûr, mais).
Aymeric (l'héritier aristocrate et paysan qui se suicide devant les caméras de la télévision) non plus ne se remet pas de l'échec de son couple, ni du sort réservé à la paysannerie française par « les standards européens » (« … et l’Union européenne elle aussi avait été une grosse salope, avec cette histoire de quotas laitiers … », p.259). Seules les femmes maintiennent un semblant de mémoire de l'espèce humaine : « ... enfin elles faisaient plus qu'honnêtement leur travail d'érotisation de la vie, elles étaient là mais c'est moi qui n'étais plus là, ni pour elles ni pour personne, et qui n'envisageais plus de l'être » (p.324).
Les individus sont les jouets de « mécanismes aveugles dans l'histoire qui se fait » (Jaime Semprun), impuissants à prendre en main la trajectoire de leur vie et incapables de s’engager durablement quand l’amour se présente, comme la civilisation occidentale qui leur sert de cadre et de destin est impuissante à donner naissance à un monde conduit par la force de l’amour, c’est-à-dire à donner à l’existence des individus un autre sens que la "fonction sociale" qu'ils sont sommés d'assurer. Une civilisation qui a dévoré « le sens de la vie », la vidant de toute raison d'être. Une civilisation qui, avec l'aide indéfectible des sciences humaines, vidange la substance vivante des individus dans la grande machine à produire du pouvoir et du profit.
Une civilisation qui a, grâce à la grande marchandisation de tout, réduit l'amour véritable à une simple « activité sexuelle ».
Et ce genre de système porte un qualificatif infamant, que je dédaigne ici de prononcer.
Voilà ce que je dis, moi.
Notes : 1 - Petite remarque à l'auteur : la carabine Steyr Mannlicher HS50, dans la position du tireur couché, ne repose pas sur un « trépied » comme indiqué p.232, mais sur un bipied.
2 - Autre petite remarque, à propos d'une « édition intégrale du marquis de Sade » (p.281) : je doute que les "fioritures dorées" figurent sur la "tranche", comme indiqué : ce genre de décor se trouve plutôt sur le "dos" du livre.
3 - J'aime bien le « J'aimerais mieux pas » de la page 309, simple et rapide clin d’œil au "I would prefer not to", d'un héros bien connu de la littérature (le Bartleby d'Herman Melville).
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, sérotonine, impuissance sexuelle, florent-claude labrouste, monique canto-sperber la fin des libertés, éditions flammarion, stendhal armance, antoine compagnon, journal le monde, collège de france
vendredi, 04 mai 2018
LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES 2
 10 septembre 2015
10 septembre 2015
J'ai lu La Gouvernance par les nombres, d'Alain Supiot, professeur au Collège de France. J'en étais resté au "délabrement des institutions", qu'elles soient nationales ou internationales. C'est-à-dire à la déliquescence progressive de la notion de Loi (s'imposant d'en haut à tous de manière égale), au profit de celle de Contrat (horizontalité, bilatéralisme et rapport de forces : c'est le plus fort qui gagne ; mais depuis Le Livre des ruses, on sait qu'il n'y a pas que de la force dans le rapport de forces).
2/2
Qu’est-ce qu’une « institution » ? La structure qui organise la vie commune et en fixe les règles. Chacune est spécialisée dans un domaine. En gros, la justice, la santé, la politique, l’éducation, la protection sociale … En gros, tout ce qui fait ce qu'on appelle une Société, qui lie les individus par un certain nombre de relations et qui encadre la vie de la collectivité dans un certain nombre de règles. Une institution est un facteur de stabilité et de cohésion. Elle sert de point de repère. Inutile de dire que le « délabrement » n’annonce rien de bon, et que la déliquescence qui touche les institutions risque bien d'annoncer celle de la Société. Le « délabrement » annonce l’affaissement de l’Etat, cette instance « verticale » dont les lois permettent à tous les individus d’une population d’être logés à même enseigne sur le plan du droit.
Alain Supiot montre ce que veut dire le passage du « gouvernement par les lois » (principe admis comme venu d’en haut : d’un dieu ou d’une « volonté générale » définissant le « bien commun ») à la « gouvernance par les nombres » (pour résumer : toute relation humaine est fondée sur des éléments négociables) : « On n’attend plus des hommes qu’ils agissent librement dans le cadre des bornes que la loi leur fixe, mais qu’ils réagissent aux multiples signaux qui leur parviennent pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés [sous-entendu : par contrat] ». Non plus une Société, mais un « marché total, peuplé de particules contractantes n’ayant entre elles de relations que fondées sur le calcul d’intérêt ». Cette façon de concevoir le collectif, Susan George l’appelle « liberté pour les loups ». A bon entendeur.
A cette façon de s’entendre politiquement pour définir les contours d’une autorité surplombante qui s’impose à tous indistinctement (la Loi, la volonté générale, si je ne m’abuse), s’est substituée l’instrumentalisation de la Loi entre les mains d’un pouvoir, qui n’est plus référé à autre chose que lui-même. La Loi elle-même est devenue un instrument destiné à renforcer un pouvoir, au détriment de l’autorité (deux notions qu’il ne faut pas confondre, cf. Hannah Arendt). Plus rien ne "fait autorité" pour cimenter une collectivité. Une telle population est faite d'individus de moins en moins liés à une totalité.
Alain Supiot parle de l’humilité des législateurs de l’antiquité : ils voulaient des lois en tout petit nombre. Et des lois simples, donc courtes. De plus, ils recommandaient aux générations à venir de n’y toucher, de ne les modifier qu’en prenant d’extrêmes précautions, et seulement en cas de nécessité absolue. Nicolas Sarkozy et François Hollande devraient en prendre de la graine, eux qui bâclent des lois à la petite semaine et à toute vitesse, souvent obèses, au moindre frémissement des faits divers. Trop de lois, et des lois à n’importe quel propos, rien de tel pour disqualifier la notion même de loi.
En théorie, gouverner revient à maintenir la cohésion (l’harmonie) du corps social, et non à parer au plus pressé ou naviguer à vue : « Dire qu’un gouvernement est représentatif, c’est dire que les gouvernés peuvent "s’y reconnaître" ». Or on est passé d’une sorte de « poétique du gouvernement » (p.28) à la recherche d’une « machine à gouverner ». Ce n’est pas d’hier, mais la tendance se précise et devient de plus en plus prégnante. Simplement, la conception d’une sorte de mécanisme d’horlogerie (du moyen âge au Léviathan de Hobbes) a été remplacée par la structure réticulaire élaborée sur le modèle de la cybernétique.
L'apparition dans le langage courant du terme "numérisation" est un révélateur lumineux de l'inexorable processus menant à la "gouvernance par les nombres". Au niveau du quotidien, je pense à l'obsession qui semble guider tous les hauts responsables (politiques, économiques, administratifs, ...) vers un Graal : la "dématérialisation", c'est-à-dire la généralisation du numérique jusque dans les gestes les plus quotidien (en passant, je m'amuse beaucoup à la caisse de magasins de plus en plus nombreux, de voir l'empressement des clients à user pour payer de leur carte bleue dite "sans contact" mais qu'ils posent quand même sur la machine, sans voir de contradiction).
L’effet de la mise en réseau et de la programmation informatique est d’abolir en apparence la relation hiérarchique dans le travail, et de faire émaner la tâche de la tâche elle-même, comme une pure et simple nécessité : le travailleur devient un rouage dans la machine. Il n’est plus le Charlot de la déshumanisation mécanique du travail dans Les Temps modernes, dévoré par celle-ci, mais un objet interchangeable. Une pièce de rechange, si vous voulez.
La fin du livre évoque les conséquences de cette évolution générale des relations humaines dans ce système économique qui exacerbe l’exigence de rentabilité et de productivité. Alain Supiot voit dans la disparition de la Loi au profit du contrat (il parle du « dépérissement de l’Etat ») la promotion d’une nouvelle forme de féodalité.
Je crois qu’il a raison de parler de « liens d’allégeance » (entre individus, entre entreprises et entre Etats), mais j’aurais trouvé plus explicite et parlant de dire « vassalité ». L’allégeance manifeste une sorte de volonté du vassal de servir un suzerain en échange d’une protection. Or dans le système qui s’est mis en place, je ne vois pas où pourrait se situer une quelconque volonté, mais je peux me tromper.
Je pense par exemple aux liens qui existent entre l’Europe et les Etats-Unis : qu’il s’agisse de l’attitude envers la Russie de Poutine ou des relations commerciales entre l’Etat américain et le continent européen, on peut nettement affirmer que ce dernier est à la remorque, obligé de suivre le grand « Allié ». Pour preuve l'amende d'1 milliard de dollars qui vient d'être infligée au Crédit Agricole parce que cette banque a eu le culot de commercer avec des pays placés sous embargo par les seuls Etats-Unis, au motif que les transactions étaient rédigées en dollars. C’est bien d’une vassalité qu’il s’agit, et qui ne résulte pas d’un choix ou d’une décision. C’est bien une telle vassalité que proclamait avec arrogance le titre français de l’ouvrage de Robert Kagan, La Puissance et la faiblesse (Plon, 2003).
Je n’en finirais pas d’énumérer les idées importantes soulevées par Alain Supiot dans La Gouvernance par les nombres, un livre qu’il faut lire impérativement. Je finirai sur la conséquence ultime que laisse entrevoir la fin du règne d’une Loi surplombante qui s’impose à tous sans distinction et l’avènement de la « gouvernance par les nombres ». Si la Loi (principe d’ « hétéronomie ») n’est plus garante de ce qu’on appelle encore le « Bien commun », c’est toute la société qui se fragmente : « Une société privée d’hétéronomie est vouée à la guerre civile ».
Ce que la Commission européenne est en train de négocier avec les Etats-Unis en est un exemple archétypal. Car ce qui est en jeu, c’est la défaite de la souveraineté de ce qui reste de nos Etats : en cas de conflit entre ceux-ci et les grandes entreprises (Google, Monsanto, etc.), les USA voudraient bien que les Européens renoncent à recourir à la justice officielle et s’en remettent à un tribunal arbitral.
Quand on pense à ce qu’a donné l’arbitrage dans l’affaire Tapie, on devine ce que donnerait un arbitrage entre Monsanto (OGM, phtalates, etc.) et l’Etat français si celui-ci continuait à entraver les affaires du géant des biotechnologies. Monsanto ferait tout pour se faire payer lourdement le manque à gagner que des lois restrictives ou prohibitives auraient selon lui engendré. C’est la fin du Bien commun.
S’il n’y a plus de Bien Commun, il n’y a plus que des rapports de forces et des calculs d’intérêts. Cela fait-il une société ? Non.
S’il n’y a plus de Bien Commun, il n’y a plus de société.
Allons-y ! Continuons dans cette voie ! Supprimons la Loi ! Sacralisons le Contrat ! Contractualisons l'existence ! Individualisons à l'extrême les relations sociales ! Jetons le principe d'Egalité à la poubelle ! Tout est négociable ! Rétablissons les droits de la jungle : d'un côté le prédateur, de l'autre la proie !
Liberté pour les loups !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alain supiot, la gouvernance par les nombres, collège de france, éditions fayard, naomi oreskes, susan george, fabrice nicolino, pablo servigne, paul valadier, thomas piketty, jean de maillard, roberto saviano, extra pure, gomorra, philippe muray, laurent joffrin, paul jorion, jacques ellul, le système technicien, journal le monde, pierre le hir, medef, alena, tafta, ttip, code du travail, nicolas sarkozy, françois hollande, charlie chaplin, les temps modernes charlot, robert kagan la puissance et la faiblesse, russie poutine, monsanto ogm
jeudi, 03 mai 2018
LA GOUVERNANCE PAR LES NOMBRES 1
9 septembre 2015
1/2
A force, d’une part, de suivre d’assez près l’actualité et d’entendre les discours, analyses et autres déclarations de responsables politiques, d’experts et de spécialistes de tout poil ; et d’autre part d'avoir lu un certain nombre d’ouvrages (Naomi Oreskes, Susan George, Fabrice Nicolino, Pablo Servigne, Paul Valadier, Thomas Piketty, Roberto Saviano, Jean de Maillard, Bernard Maris, Günther Anders, Jacques Ellul … : ce n’est pas ce qui manque, mais ce dont on est sûr, c'est que ce ne sont pas des « best-sellers ») qui parlent de l’état du monde (dans des domaines et avec des grilles de lectures très divers, ce qui renforce l'impression d'ensemble, accablante), je finis par ranger tout ce qui pense et qui « cause dans le poste » en deux catégories. On dira ce qu'on voudra, mais un peu de manichéisme aide à clarifier les problèmes et les idées. D'abord les couleurs, ensuite les nuances (et tant pis pour Verlaine et son "Art poétique").
Du côté du Mal, tout ce qui adhère béatement au monde tel qu’il va, que ce soit par foi, enthousiasme ou parce qu’il y a un bénéfice à en tirer ou un pouvoir à exercer (ça, c’est le « mainstream », et ça occupe le terrain, pousse-toi de là que je m'y mette) ; du coté du vrai et seul Bien, tout ce qui voit dans cette marche du monde une forme de « marche au supplice » (Berlioz), un cheminement vers la catastrophe annoncée (dans les médias, ça occupe le strapontin, là-bas, tout au fond de la salle). Le mensonge contre l’effort de vérité. Avec priorité massive au mensonge (langue de bois, baratin, pipeau, « storytelling » et compagnie).
D’un côté la pure et simple propagande produite par les adeptes et les adorateurs prosternés de « l’Empire du Bien » (Philippe Muray), les optimistes fanatiques, adulateurs du temps présent et apologistes serviles du « progrès de l’humanité » genre Laurent Joffrin ; de l’autre le dévoilement et la désintoxication, par les partisans de la lucidité, qui persistent à chercher, dans le magma contemporain, un sens à l’aventure humaine dans un système de plus en plus inhumain. Pris globalement, on est bien obligé de voir que le monde actuel, à beaucoup de points de vue, est dans un état inquiétant. Ceux qui refusent de le voir sont dans le déni du réel : faire de l'individu la base toutes les réflexions sur le monde contemporain, alors même que dans les faits il compte pour virgule de guillemet d'accent circonflexe, cela tient du cynisme le plus méprisant (de quel poids pèse un milliardième de vote dans l'élection du président de la Terre ?).

Je ne connaissais ni le nom de l'auteur, ni les ouvrages d’Alain Supiot. Un petit tour sur le blog de Paul Jorion m’a convaincu de lire La Gouvernance par les nombres (Fayard, 2015). A ceux qui, gavés des discours qui nous chantent les merveilles du monde à venir, veulent décaper le vernis rutilant dont cet horizon est dépeint, je conseille la lecture de ce bouquin. Ils y trouveront la substance du cours que Supiot a donné au Collège de France de 2012 à 2014. Pas à dire, c’est du solide. Mais ça réclame un effort.
Le titre peut sembler énigmatique. Peut-être « par les mathématiques » aurait-il été plus explicite (Condorcet – 1743-1794 – avait envisagé très sérieusement l’application des mathématiques à l’organisation de la société). Dans « nombres », il faut entendre toutes sortes de considérations fondées sur les données chiffrées, à commencer par le règne des statistiques (et autres indicateurs). L’auteur analyse l’évolution des activités humaines vues à travers le prisme de la quantité, de la quantification, du dénombrement. A travers ce prisme, rien de ce qui est humain n’échappe à l’évaluation chiffrée. Et ça fait très peur.
Car autant dire que Supiot examine une tendance de fond du monde actuel, qui enserre progressivement toute l’existence des individus, et dans la diversité de ses facettes. Mais aussi l’ensemble des individus : Alain Supiot décrit ce qu’il faut bien appeler un système, et un système à visée totale. Jacques Ellul avait décrit en son temps, dans une perspective voisine, Le Système technicien (Calmann-Lévy, 1977). Supiot s’efforce de nous éclairer sur l’avènement d’un autre système : le « Marché total » (p. 15). Et ça fait froid dans le dos, quand on sait ce qui se dissimule sous le mot « total ».
Remarquez que sur le fond, je n’ai pas appris grand-chose : il faut être aveugle pour ne pas voir que toutes sortes de menaces se font sentir depuis trois ou quatre décennies, qu’il s’agisse de la planète (voir l’article de Pierre Le Hir dans Le Monde (23-24 août) sur les maux qui affectent toutes les forêts, sans exception) ; des animaux terrestres ou marins (voir, toujours dans Le Monde (22 août) l’article montrant que l’homme est un prédateur jusqu’à quatorze fois plus gourmand que les prédateurs sauvages) ; de l’homme en personne (la liste est trop longue et s’allonge plusieurs fois par jour, il n’y a qu’à lire le journal). Que l’humanité va (mode indicatif, s’il vous plaît) vers le pire, on le savait un peu.
A cet égard, le livre d’Alain Supiot vaut confirmation de cette tendance de fond. Mais ce qu’il apporte de nouveau et de passionnant, c’est un angle d’attaque, une grille de lecture, tout cela dans une impeccable rigueur méthodologique, et avec une incroyable richesse conceptuelle et documentaire. Son « créneau » à lui se situe « au carrefour du droit, de l’anthropologie et de la philosophie » (rabat de couverture). Cela veut dire que l’ouvrage exige un lecteur volontaire, actif, éveillé, attentif et concentré. Au début, cette formule (« gouvernance par les nombres ») paraît fumeuse. Pas pour longtemps.
Dès l’introduction, il résume la problématique : « Le projet de globalisation est celui d’un Marché total, peuplé de particules contractantes n’ayant entre elles de relations que fondées sur le calcul d’intérêt. Ce calcul, sous l’égide duquel on contracte, tend ainsi à occuper la place jadis dévolue à la Loi comme référence normative ». Autrement dit, le système qui se met en place et qui tend de plus en plus à occuper tous les compartiments de l’existence humaine, dans le privé comme dans le public, substitue à la verticalité d’une Loi (Supiot appelle cela l’ « hétéronomie ») qui surplombe les hommes et s’impose également à tous, l’horizontalité du Contrat entre deux « particules » (le terme « particule » me paraît fort bien trouvé).
[Rien de plus américain dans l'esprit, comme le montrent les propos de l'artiste Kerry James Marshall dans l'émission La Grande Table d'Olivia Gesbert le 1 mai 2018 : d'après lui, tout ce qui doit guider l'individu est le calcul de ses intérêts. Rien de plus américain non plus, comme le montre la présidence de Donald Trump, avec les défis que celui-ci lance tous azimuts à la Chine, à la Corée, à l'Iran, à l'Europe même : venez vous mesurer avec moi dans une partie de bras-de-fer, on verra qui est le plus fort. Rien de plus américain que le "bilatéralisme", qui met aux prises deux adversaires (partenaires ? ennemis ? concurrents ?) et qui voit le plus fort gagner.]
Pour illustrer la chose, voir ce qui se passe en ce moment [2015] entre le gouvernement Valls-Hollande et le MEDEF de Gattaz autour de la réforme du Code du Travail (on prévoit de donner la priorité aux "accords de branche" ou aux "accords d'entreprise" sur le respect des normes légales contenues dans le Code du Travail, dont tout le monde s'entend pour dire qu'il est devenu "illisible"). Travailleurs, gare à vous !
Ce nouvel ordre des choses a été pensé, voulu et mis en œuvre par le monde anglo-saxon, disons par les Etats-Unis. Ceux-ci, en effet, préfèrent de très loin passer des accords bilatéraux (ALENA en 1994 avec le Canada et le Mexique, il n’y a qu’à voir le pauvre Mexique vingt ans après ; bientôt TAFTA avec l’Union Européenne, pauvre Europe, déjà que …), plutôt que de se soumettre à des traités contraignant toutes les nations du monde à se référer à des critères universels : il suffit de voir le nombre de traités internationaux que le Congrès US a refusé de ratifier.
[Je le répète : cette tendance américaine à donner la priorité absolue à la relation bilatérale (horizontalité et préférence pour le rapport de forces) et à disqualifier les instances juridiques internationales (verticalité : ONU, OMC, ...) est portée à son comble depuis l'élection de Donald Trump.]
Alain Supiot part d’un constat qui a de quoi effrayer : au lieu d’aller vers « l’avenir radieux prophétisé par les chantres de la fin de l’Histoire et de la mondialisation heureuse », le monde se trouve aujourd’hui face à des crises de toutes sortes (« Montée des périls écologiques, creusement vertigineux des inégalités, paupérisation et migrations de masse, retour des guerres de religion et des replis identitaires, effondrement du crédit, qu’il soit politique ou financier … ») : « Toutes ces crises s’enchevêtrent et se nourrissent les unes les autres comme autant de foyers d’un même incendie. Elles ont un facteur en commun : le délabrement des institutions, qu’elles soient nationales ou internationales ».
Nous voilà fixés.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alain supiot, la gouvernance par les nombres, collège de france, éditions fayard, naomi oreskes, susan george, fabrice nicolino, pablo servigne, paul valadier, thomas piketty, jean de maillard, roberto saviano, extra pure, gomorra, philippe muray, laurent joffrin, paul jorion, jacques ellul, le système technicien, journal le monde, pierre le hir, medef, alena, tafta, ttip, code du travail
samedi, 31 mars 2018
PAPA, C'EST QUAND L'EFFONDREMENT ? 1/2
Je crois aujourd'hui que toutes les questions qu'on peut se poser sur la politique, l'économie, les relations entre les gens (la vie "sociétale") sont du pipi de chat par rapport à la question globale de la survie des êtres vivants sur la planète. Après la démonstration faite par les Allemands que 80% des insectes ont disparu du territoire en trente ans, on apprend que 30% des oiseaux "ordinaires" de nos campagnes ont également disparu en 15 ans. Les spécialistes de la biodiversité font des diagnostics à peu près identiques sur tous les continents. Qui s'en soucie ? J'ai du mal à prendre au sérieux tout ce qui ne tourne pas autour des questions de la survie de l'espèce humaine et de toutes les espèces vivantes. Ce ne sont pas, par exemple, quelques malades mentaux (je veux parler des "vegans") qui insultent un mort du Super U de Trèbes au motif qu'il était boucher qui me convaincront du contraire (écrit le 31 mars).
Je remets donc en ligne, plutôt deux fois qu'une, ce billet écrit le 13 décembre 2017.
Des nouvelles de l'état du monde (10).
1/2
Paul Jorion (encore lui) vient de publier A quoi bon penser à l’heure du grand collapse ? (Fayard). Pardonnons-lui l’anglicisme : l’anglais lui est si familier qu’il lui est devenu  naturel. Un « collapse », c’est un effondrement. Il en est convaincu : la catastrophe est inéluctable. J’avais suivi le conseil de lecture qu’il donnait dans le billet audiovisuel qu’il poste chaque semaine sur son blog ("Le temps qu'il fait") : j’avais lu Comment tout peut s'effondrer (sans point d’interrogation) de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Seuil, 2015).
naturel. Un « collapse », c’est un effondrement. Il en est convaincu : la catastrophe est inéluctable. J’avais suivi le conseil de lecture qu’il donnait dans le billet audiovisuel qu’il poste chaque semaine sur son blog ("Le temps qu'il fait") : j’avais lu Comment tout peut s'effondrer (sans point d’interrogation) de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Seuil, 2015).
Les auteurs constataient l’état déplorable de la planète dans une foule de domaines, et pronostiquaient le pire si rien n’était fait. La première partie du livre (jusqu’à la page 133, c’est l’état des lieux), donnait froid dans le dos, avec plein de petits graphiques montrant très bien l’emballement planétaire des productions et des destructions à partir de 1950.

Dioxyde de carbone, azote, méthane, poissons, forêts, températures, acidification, ...
J’avais hélas été horriblement déçu ensuite par ce qu’ils entrevoyaient et proposaient pour éviter que l’histoire humaine s’achève en eau de boudin. J'avais dit ici même cette déception dans mon billet du 24 juin 2015 (voir lien plus haut, et note en fin de billet). Au lieu de dire franchement et directement que le monde va à la catastrophe si les nantis du Progrès, du bien-être et de la technique (en gros : l'occident) ne renoncent pas à leur mode de vie de gaspillage et de dévoration des ressources, ils misaient tous leurs espoirs sur la nécessité de « changer les mentalités » (ben voyons, ma parole, ils n'ont pas compris ?), plaçant les solutions dans la sphère quasi-exclusive de la psycho-sociologie contemporaine, c’est-à-dire, pour aller vite, sur la capacité des moyens techniques et médiatiques de façonner les comportements de masse par une propagande judicieusement conçue. Comme si le problème et sa solution étaient là.
Comme si les atteintes à l’environnement se réduisaient aux habitudes de consommation inculquées aux populations. Comme si la question du mode de production des nuisances n’était pas concerné en premier lieu. Comme si - soit dit en passant - le rôle des sciences humaines était d'agir sur les orientations des sociétés (aveu de militantisme "scientifique" ?). La question qui me vient, à chaque invention de telles solutions, c’est évidemment toujours la même : « Comment tu fais, coco ? ». Car malheureusement pour les auteurs, on a lu Beauvois et Joule (Petit traité de manipulation ...), Edward Bernays (Propaganda) et quelques autres : on sait ce qu'il en est de la manipulation mentale et du formatage des esprits par l'intermédiaire d'une psychanalyse habilement instrumentalisée et correctement mise en œuvre.
La question, en l’occurrence : si la publicité peut influencer ponctuellement (dans une certaine mesure) les attitudes des populations ordinaires, comment va-t-on procéder au changement de « mentalité » de tous les gens qui trouvent un puissant intérêt matériel et financier dans l’actuelle marche du monde et dans une « mondialisation » qui se réduit à une compétition féroce entre acteurs transnationaux ? Comment va-t-on faire changer d'avis les gens qui détiennent le pouvoir et l’argent qui va avec ? Ils croient vraiment, Servigne et Stevens, que les gros lards de l'économie mondiale vont battre leur coulpe et se laisser tondre ? Le diagnostic des deux compères est sans appel, mais leur remède est plus foireux qu’une colique frénétique.
Paul Jorion est plus lucide, plus réaliste et plus rationnel : La Crise du capitalisme américain, écrit en 2004-2005, où il annonçait, entre autres, la crise des « subprimes », est sorti en janvier 2007, trop tard pour servir à qui que ce soit pour parer la menace. Aurait-il permis d’empêcher la crise si un éditeur courageux et conscient avait osé le publier aussitôt écrit ?
La conclusion que l'auteur tire aujourd’hui ("Le temps qu'il fait", 1 décembre 2017) de sa débauche d’activités pendant tant d’années pour expliquer l’urgence, avertir les responsables et mobiliser les foules laisse à penser que lui-même n'y croit guère, avec raison selon moi (« J'ai fait ce que j'ai pu », dit-il, comme quoi même les gens spécialement doués ne peuvent que ce qu'ils peuvent). C'est sans doute pourquoi, lassé de rompre des lances contre les moulins à vent, il a décidé de passer le relais de l’action à des bonnes volontés neuves et encore fraîches. Paul Jorion, fatigué, raccroche les gants, pour consacrer sa belle intelligence à des tâches plus personnelles et plus gratifiantes. C’est regrettable, mais on le comprend : militant, ce n'est vraiment pas un métier. Heureusement.
Alors l’effondrement, maintenant ? Comme Servigne et Stevens, Jorion le voit inéluctable. Il n’est pas le seul : Guy McPherson, Claude Bourguignon, Gilles Bœuf et tant d’autres dont, tout dernièrement, 15.000 scientifiques du monde entier, ne cessent d’alerter sur ce qui attend la planète et l’humanité si sept, et bientôt dix milliards d’hommes se mettent à vouloir vivre comme des nababs sur un gâteau en train de fondre.
J’ai déjà dit ici ("L'humanité en prière") pourquoi je crois que l’inéluctable est inéluctable : pour la raison que plus un système est global et interdépendant, moins les individus, même regroupés en vastes ensembles d'influence (partis, lobbies ou autres), peuvent y changer la moindre virgule ou le plus petit guillemet. Je n’y reviens pas. La question que je me pose aujourd’hui porte sur la raison de l’apathie, de la passivité massive qui accueille obstinément les cris poussés par des savants d’ordinaire froids comme des constats. Pourquoi une telle surdité ?
Un effondrement, tous ceux qui ont assisté à l’implosion des grandes barres de La Duchère à Lyon (on pourrait dire la même chose dans bien des endroits) savent comment ça se passe : ça fait du bruit, de la poussière et un gros tas de gravats à déblayer (pour les mettre quelque part, pourvu que ce soit ailleurs). Ça dure quoi ? En un clin d’œil tout est terminé, il n’y a plus rien à voir. Voilà justement le problème : un effondrement, c’est instantané.
Or, l’effondrement dont parlent Servigne et Stevens, Paul Jorion, Gilles Bœuf et consort n’est pas visible à l’œil nu. Il se produit sous nos yeux, mais si lentement ! Un effondrement qui se produit à la vitesse imperceptible, si l’on veut, de l’aiguille des minutes sur le cadran de la montre ou de l’ombre du soleil à midi en plein été, est-ce crédible ? Pas assez en tout cas pour que le détecteur de mouvement déclenche le signal. Ce n’est pas une durée d’ordre géologique, mais ça donne une idée. Apprendre que 80% des insectes ont disparu en trente ans sur le territoire européen est déjà plus parlant. Mais pour ça, il faut des statistiques scientifiquement établies.
Pour notre malheur, l’effondrement qui nous entraîne aujourd’hui se produit donc avec beaucoup trop de lenteur pour que nos moyens de perception soient mis en alerte. C’est un effondrement indolore, inodore et sans saveur. Un effondrement qui s'écoule tranquillement, grisâtre, et si lentement que nous sommes déjà fatigués d'en entendre parler : arrête de rabâcher, vieux schnock, il est où l'effondrement ? Rien en effet ne semble avoir changé depuis la veille, tout le paysage est semblable ou presque, si l’on excepte quelques changements imperceptibles ou hors de notre portée visuelle. Tout le monde regarde le même film, mais c’est un immense plan-séquence tourné en immense ralenti. Ce n’est pas l’immobilité complète, mais comme ça semble ne pas avancer, on se dit qu’à ce rythme-là, on a le temps de voir venir. Qui remarque le vieillissement, jour après jour, sur le visage aimé de la personne qui partage sa vie ?
Gilles Bœuf, dans un cours au Collège de France où il parlait de l’effondrement des effectifs dans les espèces animales, voyait très juste : aux écologistes qui clament que « l’humanité va dans le mur » (ils n’ont pas tort sur le fond, mais), il répondait qu’il n’y a pas de mur et qu’il n’y aura pas de grand choc. Simplement, plus la situation va aller en se dégradant, plus le cadre et les conditions de vie des vivants vont devenir difficiles. On en voit déjà des manifestations, mais si parcellaires et circonscrites dans leurs dégâts (l'île de Saint-Martin n'est pas New York) que très peu de gens font le lien entre elles pour se dire que la situation d'ensemble est grave. Pour les journalistes, ce sont des "événements". A la rigueur des "catastrophes", mais soigneusement localisées, et prises en charge par la "communauté internationale". (« Mais que fait la communauté internationale ? », pleurent en chœur les journalistes des plus gros journaux du monde et les présidents des plus grosses ONG).
L'espace de la conscience individuelle a bien du mal à se hisser jusqu'à la hauteur de l'enjeu global. Et, s'il y parvient, à en tirer toutes les conséquences pour son propre compte.
Voilà ce que je dis, moi.
15 décembre 2017 : Pablo Servigne est interviewé sur France culture. Il n'y a décidément pas grand-chose à espérer du monsieur. Pour contrer les représentations catastrophistes de l'avenir du monde, il vient avec des collègues de publier un ouvrage qui tend à démontrer que l'on ne trouve pas dans la nature seulement des rapports "prédateur-proie", mais qu'il y a aussi, partout, de l'entraide. Comme exemple d'entraide, il cite la pollinisation. Ah bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. La pollinisation, c'est de l'entraide, maintenant. Ça m'a bien fait rire. Les pommiers de font pas des poires. Pablo Servigne est atteint jusqu'au verre de ses lunettes d'une maladie qui continue à faire des ravages : l'optimistose aiguë. Symptôme principal : une bonne grosse pomme bien rouge et bien gonflette. Mais la pomme gonflette est dans l'air du temps : Peter Wohlleben est l'auteur à succès de La Vie secrète des arbres, où il développe l'idée qu'il n'y a pas que les humains à pratiquer l'entraide (surtout quand ça les arrange) : il y a aussi les arbres. La nature sera désormais un modèle idéal de ce que doit être, et sera peut-être, la société altruiste. Message : il suffirait que les humains s'inspirent de ... pour ... « Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain ». Ouais ! Farpaitement !
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul jorion, à quoi bon penser à l'heure du grand collapse, blog de paul jorion, pablo servigne comment tout peut s'effondrer, éditions du seuil, psycho-sociologie, changer les mentalités, environnement, écologie, écologistes, biodiversité, beauvois et joule petit traité de manipulation, edward bernays, bernays propaganda, manipulation mentale, mondialisation, globalisation, psychanalyse, jorion la crise du capitalisme américain, crise des subprimes, guy mcpherson, claude bourguignon, gilles boeuf, collège de france, lyon la duchère, nicolas hulot, eelv, les verts, sciences humaines
jeudi, 26 janvier 2017
PHILIPPE MANOURY
Menus propos tombés de la bouche d'un professeur au Collège de France.
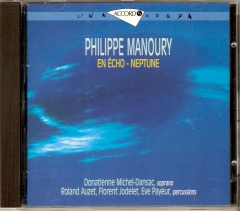 Philippe Manoury est un compositeur de musique contemporaine. Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais de lui, en dehors de quelques œuvres entendues en concert (oui, oui, c'est arrivé), que les sons sortis de ma chaîne audio quand, étourdi par les sirènes de la "modernité", j'avais commis la bévue de me procurer et de poser dans l'appareil idoine les galettes circulaires portant, gravés dans leurs sillons numériques, les bruits
Philippe Manoury est un compositeur de musique contemporaine. Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais de lui, en dehors de quelques œuvres entendues en concert (oui, oui, c'est arrivé), que les sons sortis de ma chaîne audio quand, étourdi par les sirènes de la "modernité", j'avais commis la bévue de me procurer et de poser dans l'appareil idoine les galettes circulaires portant, gravés dans leurs sillons numériques, les bruits 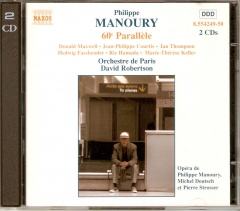 sortis de Neptune ou En Echo (label Accord, avec l'inévitable Donatienne Michel-Dansac dans le rôle de l'appât féminin), l'opéra 60è parallèle (label Naxos, direction David Robertson), La Partition du ciel et de l'enfer ou Jupiter (label IRCAM, sous la direction du commissaire du peuple Pierre Boulez, le délégué du soviet musical suprême). Assez peu en fin de compte. J'avoue que je ne les ai pas réécoutés pour l'occasion. Mais c'est juste pour que personne ne vienne me dire que je parle en totale ignorance de cause. J'ajoute qu'il m'est arrivé de trouver ici ou là de la musique dans ce que j'entendais. Pour dire que je ne suis pas complètement hermétique à ce qui se fait aujourd'hui en matière de musique : il m'arrive même de ne pas tourner le bouton les soirs, en général malheureux, où le programme est réservé aux "musiques d'aujourd'hui" (mais franchement, les œuvres diffusées hier soir par M. Franz Musik, de Gilbert Amy et Philippe Hurel, offrent une musique chétive, aride, squelettique : des vieux rapiats, des Harpagons de la musique ; les adeptes diront qu'ils n'ont gardé que l'essentiel, mais je n'ai pas envie de ronger les os).
sortis de Neptune ou En Echo (label Accord, avec l'inévitable Donatienne Michel-Dansac dans le rôle de l'appât féminin), l'opéra 60è parallèle (label Naxos, direction David Robertson), La Partition du ciel et de l'enfer ou Jupiter (label IRCAM, sous la direction du commissaire du peuple Pierre Boulez, le délégué du soviet musical suprême). Assez peu en fin de compte. J'avoue que je ne les ai pas réécoutés pour l'occasion. Mais c'est juste pour que personne ne vienne me dire que je parle en totale ignorance de cause. J'ajoute qu'il m'est arrivé de trouver ici ou là de la musique dans ce que j'entendais. Pour dire que je ne suis pas complètement hermétique à ce qui se fait aujourd'hui en matière de musique : il m'arrive même de ne pas tourner le bouton les soirs, en général malheureux, où le programme est réservé aux "musiques d'aujourd'hui" (mais franchement, les œuvres diffusées hier soir par M. Franz Musik, de Gilbert Amy et Philippe Hurel, offrent une musique chétive, aride, squelettique : des vieux rapiats, des Harpagons de la musique ; les adeptes diront qu'ils n'ont gardé que l'essentiel, mais je n'ai pas envie de ronger les os).
Il se trouve que monsieur Manoury prononce aujourd'hui même la "leçon inaugurale" des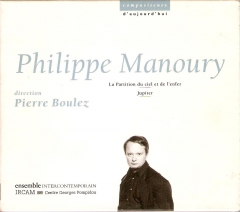 cours qu'il va donner pendant un an dans le collège le plus ancien de France (c'était sous François premier). A ce titre, il était invité hier à la table d'une antenne franzkulturelle pour expliquer tant que faire se peut comment il envisageait sa tâche. Il a profité de la tribune ainsi offerte pour asséner quelques-unes des sottises admises et véhiculées dans les milieux de la branchouille musico-moderniste.
cours qu'il va donner pendant un an dans le collège le plus ancien de France (c'était sous François premier). A ce titre, il était invité hier à la table d'une antenne franzkulturelle pour expliquer tant que faire se peut comment il envisageait sa tâche. Il a profité de la tribune ainsi offerte pour asséner quelques-unes des sottises admises et véhiculées dans les milieux de la branchouille musico-moderniste.
Soit dit pour commencer, le monsieur n'a rien contre les musiques de divertissement (merci pour elles), mais il ajoute dans la foulée que son domaine, c'est la "musique savante", qu'on se le dise. Je rétorquerai au monsieur que ce que j'attends, dans les musiques "savantes", ce n'est justement pas ce qu'elles contiennent de savant, mais un assemblage de sons musicaux qui me touche (je peux aussi être irrité ou indifférent). C'est parce qu'elles provoquent chez moi des résonances, des mouvements intérieurs divers et diversement puissants. Ce que les "spécialistes" de l'âme humaine appellent "affects" ou "émotions".
Je n'ai pas recopié mot à mot les convictions que Philippe Manoury a exprimées lors de l'entretien, et je citerai ses propos, comme on dit, "en substance". Le premier truisme formulé est un lieu commun : « Tous les compositeurs de l'histoire ont été des "contemporains" : il n'y a jamais eu d'autre musique que contemporaine ». Rien à dire de cette vérité d'évidence, sauf à préciser que les techniques d'enregistrement ont rendu "contemporaines" presque toutes les musiques produites par l'humanité depuis les origines, et que la musique dite contemporaine n'est plus qu'une modalité parmi l'infinité des autres. On est sur un marché où l'offre est pléthorique. Il y a du gavage et de la saturation dans la production musicale d'aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la demande ne suit pas. A moins que ça veuille dire autre chose (genre formatage, mise au pas des individus en passant par l'oreille, ...).
Quoi qu'il en soit, le fait d'enregistrer les sons pour qu'on puisse les réécouter à volonté les rend en effet potentiellement (et exactement) contemporains. On peut même dire que toute la musique existant ou ayant existé (celle qui a eu soit la chance d'arriver après l'idée géniale qu'il était possible d'écrire les sons musicaux, soit le temps de se faire enregistrer dans la collection Ocora Radio France avant de disparaître) nous est contemporaine. Les compositeurs qui s'estiment honnis n'ont qu'à protester et accuser les moyens techniques modernes de leur gâcher le métier, au lieu de bêler en chœur que ce sont « de formidables outils de création ».
La concurrence règne en maîtresse impitoyable : que la contemporaine pâtisse de la chose, au fond, rien de plus normal. Le créneau est étroit et on ne devrait pas être surpris que ce genre de musique (produire du "jamais ouï") ne concerne en fin de compte qu'un "marché de niche". Mais c'est le corollaire du raisonnement qui est intéressant : « Les compositeurs de l'histoire ont été des expérimentateurs ». Alors ça, c'est évidemment faux.
Que l'évolution (je n'ai pas dit le "progrès") de la musique ait accompagné une évolution des sensibilités liée aux changements sociaux et, si l'on veut, à l'édification progressive d'une civilisation, cela ne signifie en aucune manière que les compositeurs aient été, par profession, des "expérimentateurs". L'idée me semble juste risible.
C'est plutôt l'aveu de toute une conception : le compositeur d'aujourd'hui travaille dans son laboratoire au milieu de ses cornues et athanors, conçoit des protocoles d'expérience sophistiqués, explore le possible, fait des calculs, des hypothèses, des mélanges, des précipités. Puis un jour il en sort pour apporter au public agenouillé la "bonne nouvelle" (mot à mot grec, ça donne "évangile") : ça s'appelle une "création mondiale". Moralité : le compositeur d'aujourd'hui est un asocial. Le paradoxe, c'est qu'il est en même temps un marchand qui veut placer son produit. Par-dessus le marché, il se veut un prescripteur doté de l'autorité qui l'autorise à se donner le grand rôle.
Ce qu'il produit, moi j'appelle ça, sur le modèle imposé dans le milieu des "artistes-plasticiens", de la musique conceptuelle, c'est-à-dire du genre où le public est invité à se gratter le crâne ou le menton d'un air pénétré pour donner l'impression qu'il est descendu dans ses propres profondeurs pour s'interroger gravement sur le sens de tout ça. Mélasse dont il sort en général en déclarant à qui veut l'entendre que, tout bien réfléchi, « cela est intéressant ». Sûr que personne ne lui demandera s'il trouve intéressants telle "Fricassée parisienne" ou tel des Octonaires de la vanité du monde (Paschal de l'Estocart). La musique est certes faite pour être ouïe, mais elle est d'abord faite pour être jouie (j'assume le barbarisme, à moins que ce ne soit un solécisme).
Autre sujet d'hilarité, c'est quand le professeur au Collège de France (en CDD, heureusement) compare la musique contemporaine à une langue étrangère qu'il faut apprendre pour la comprendre. Cela se passe en deux temps.
Premier temps, une apostrophe à l'intervieweuse : « Quand vous allez en Chine et que vous ne connaissez pas la langue, si vous voulez vous faire comprendre, il va bien falloir que vous appreniez le chinois ». Autrement dit, pour comprendre un langage que vous ignorez, il faut l'apprendre. Même chose, donc, pour la musique contemporaine. Pure et simple intimidation. Soit dit en passant, je note que Philippe Manoury reconnaît ici, peut-être sans s'en rendre compte, que la musique qu'il écrit est a priori, aux oreilles du public, une langue étrangère. Prenons cela comme un aveu : Philippe Manoury est un prof de langue étrangère, il est au-dessus, et ses élèves (son public) ne savent pas. Il faut donc qu'il leur inculque.
Deuxième temps : « Est-ce que vous pouvez me dire, quand vous écoutez du Mozart, ce qu'il y a à comprendre ? ». Autrement dit, quand vous écoutez de la musique, il n'y a rien à "comprendre". Donc rien à "apprendre". Prenons cela comme un autre aveu : face à la musique, Philippe Manoury est notre égal, notre semblable, notre frère.
Conclusion et en résumé : un exemple lumineux de "double langage". Oh, Manoury, il faudrait savoir ce que tu veux. Dis-nous : il faut apprendre, ou il n'y a rien à apprendre ? Faut-il ou non éduquer le public ? La musique est-elle faite pour l'intellect ? Ou bien pour la sensibilité ? Tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre.
Cette idée de compréhension, ou plutôt cette grande plainte d'être un grand "incompris" poussée par tous les "innovateurs" (qui se disent "créateurs" et se plaignent que le public "ne suive pas"), est un refrain qui date de très longtemps : c'est aux destinataires des œuvres de s'adapter aux inventions de leurs auteurs. Le devoir premier des compositeurs n'est en aucune manière de chercher à plaire, ce qui serait bassement servile. Car la musique contemporaine nécessite une "éducation" spécifique : sans doute ce qu'on appelle "dresser" l'oreille. C'était donc ça ! Manoury et ses semblables se considèrent comme des dompteurs face à des fauves : il faut dresser les oreilles des contemporains pour les plier aux impératifs de la nouveauté. On appelle ça le cirque.
Monsieur Manoury, comme la plupart des gens qui "font" dans les arts contemporains, veut à toute force que son public retourne sur les bancs de l'école pour apprendre pour quelles raisons il doit aimer ses œuvres. Pour monsieur Manoury, le public est dans son tort, c'est lui qui devrait faire l'effort. Tout ça parce que, s'il n'aime pas ce qu'on lui donne, c'est qu' « il n'a pas assez l'habitude ». Moi je dis qu'on aura beau m'expliquer que je devrais me sentir coupable de mes refus d'admettre comme de la musique toutes les "new things" qui se présentent à mes oreilles endolories, quand ça veut pas, ça veut pas, et puis c'est tout.
Car cette histoire d'habitude, j'ai envie de dire : ben v'là aut'chose ! Je pose une question : est-ce seulement à cause de l'habitude que les gens du peuple qui dansaient sur les places dans les fêtes autrefois aimaient les sons qui sortaient de la flûte, du tambourin, de la cabrette ou de l'accordéon ? Ou bien ne serait-ce pas plutôt parce que ces sons sont organisés selon les lois d'une harmonie naturelle ? Le grand mot est lâché.
On me dira qu'il ne faut pas confondre musiques "savante" et "populaire". Je ne vois vraiment pas ce que ça change à la question de fond : on n'écoutait pas les mêmes choses dans les hautes et basses classes, c'est certain. Mais c'est justement là, et pas ailleurs, qu'il faut situer le problème des "habitudes" (traduit en Bourdieu, ça donne "habitus", au moins en gros), qui chiffonne monsieur Manoury.
Au fond, pourquoi le public, depuis le début du XX° siècle, tourne-t-il en masse le dos à la musique contemporaine ? N'est-ce pas précisément parce qu'elle a outrepassé les limites imposées aux sons musicaux par la nature ? Car en musique, comme en d'autres domaines, la question des limites ne se laisse pas évacuer facilement. Pourquoi les directeurs de salles et les chefs d'orchestre sont-ils obligés d'emboquer le public en insérant dans leurs programmes une tranche de contemporaine entre deux tranches de "classique" ? Espèrent-ils que le public, à la longue, lassé de résister, rendra les armes ?
Last but not least, Philippe Manoury déclare : « Je serais bien incapable de vous dire, quand je compose, ce qu'il faudrait faire pour que ma musique soit bien reçue ». Traduction en langage humain : « Quand je compose, j'ai autre chose à faire qu'à penser aux gens auxquels ma musique est destinée ! Pour moi, le destinataire n'existe pas ! ». En français mot à mot : rien à foutre que ma musique plaise ou non.
On me rétorquera que Beethoven lançait à Schuppanzigh : « Eh ! Que m'importent vos boyaux de chat, quand l'inspiration me visite ! ». Je répondrai juste que tout le monde n'est pas Beethoven. Mieux : en face d'un Beethoven, combien de domestiques ? Combien de nos "innovateurs" ont du génie ? Je crois pouvoir répondre : faire de l'innovation sonore un critère de la composition musicale d'aujourd'hui est le meilleur moyen de nous épargner l'émergence d'un génie. Et d'établir durablement e règne des bidouilleurs de sons.
Le génie porte un monde, il ne se réduit pas à l'innovation, qui n'est au fond qu'un résidu. Le véhicule d'une intention, si vous voulez. Le génie, c'est juste une question d'altitude dans l'intention.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique contemporaine, philippe manoury, ircam, pierre boulez, donatienne michel-dansac, david robertson, france musique, gilbert amy, philippe hurel, france culture, musique savante, collège de france, schuppanzigh, ludwig van beethoven, musique classique, musique
mercredi, 17 juin 2015
KADARÉ : LA NICHE DE LA HONTE
 Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici,
Dans son livre, Fugue pour violon seul (voir ici, 28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.
28-29 mai), Tedi Papavrami cite le nom d’Ismaïl Kadaré. J'ai lu bien des livres de cet auteur, il y a bien longtemps. Le violoniste, compatriote de l’écrivain, est devenu son traducteur en français, en 2000 je crois, quand le vieux Jusuf Vrioni s’est retiré. Du coup, quand j’ai déterré dans mes rayons La Niche de la honte (Fayard, 1984), j’y ai mis le nez.
J'ai lu un drôle de roman. Remarquez que Les Tambours de la pluie, ce n’était pas mal non plus, avec le sultan en personne, à la tête de toute son armée, qui vient mettre le siège devant une ville (albanaise, évidemment) qui ose lui tenir tête. Je me souviens d’énormes canons qu’il fait fondre sur place pour abattre les remparts, et dont l’un, sinistre présage, explose.
Je me souviens surtout que lorsque le sultan lance ses troupes pour l’assaut final à travers une brèche dans la muraille, celles-ci, les unes après les autres, sont comme « avalées » par la ville et disparaissent corps et bien, sous les yeux du sultan incrédule, mais vaincu. Pour dire que Kadaré est, certes, un écrivain, mais qu’il se revendique Albanais, au moins à égalité, si ce n'est davantage.
C’est de l’Albanie qu'il parle. Il en est pétri. Il en décrit la sinistre loi du « kanun » dans Avril brisé, une histoire de vendettas interminables et cruelles, mais étroitement codifiées, où le sang appelle le sang, et où le meurtrier (selon la coutume, il doit avertir sa victime avant de tirer), pour échapper à la sanction légale, peut se réfugier dans des tours construites à seule fin de servir d’asiles, mais qui ne le protègent qu’aussi longtemps qu’il reste dans les murs.
Kadaré m’a laissé des impressions très vives : l'existence humaine a une signification très simple. Et en général, c'est violent. Quand les points de repère sont nets et francs, les opinions sont tranchées, et la violence est présente, quoique canalisée. C'est quand les points de repère sont informes que l'anarchie s'installe et que la violence se généralise.
Avec La Niche de la honte, qu’on ne s’attende pas à un roman d’action. L’ambition de Kadaré est semble-t-il d’introduire le lecteur au cœur de l’énorme machine administrative (et militaire) qui a permis à l’Empire Ottoman d’atteindre les hauteurs d’une puissance si impressionnante qu’il en apparaissait à tous comme une figure de l’éternité indestructible.
Face à ce colosse qui occupe une bonne partie de l'Europe balkanique, l’orgueilleuse, violente et minuscule Albanie se dresse. Qui a suivi les travaux et cours de Gilles Veinstein au Collège de France (chaire d'Histoire turque et ottomane), n'est pas dépaysé par toute la partie historique du roman, qui évoque les somptueux palais d'Istambul, où s'agitent les milliers de fonctionnaires qui actionnent la machine impériale de la Sublime Porte, terriblement efficace et précise.
L’affaire se passe autour de 1820, puisqu’Ali pacha, le vieux gouverneur du pays, apprend la mort de Napoléon Bonaparte (1821). Ali pacha est très jaloux de Scanderberg, le plus grand héros de la nation albanaise, qui avait été capable de l’unifier et d’entrer en rébellion ouverte contre la Sublime Porte. Mais ce temps et ce héros appartiennent définitivement et depuis plusieurs siècles au passé et au mythe. Ali pacha est plus mesquin, moins grandiose dans ses ambitions. Incapable de sacrifier son intérêt à son pays, comme l’avait fait le glorieux ancêtre, il s’est comporté en gouverneur féroce, et toujours fidèle au sultan (comme un vulgaire collabo).
Jusqu’au jour où, sa puissance lui étant montée à la tête, il s’imagine qu’il fait peur au pouvoir central, et commence à se montrer moins docile, plus désinvolte, voire insolent dans les courriers officiels, de plus en plus espacés. Mais aucun des princes albanais qui ont eu affaire à ses mauvaises manières n’a oublié les avanies, tous lui font défection quand il leur demande de se rallier à lui pour faire officiellement sécession, et il se retrouve seul dans sa forteresse, face à l’armée ottomane.
Bon, c’est sûr qu’il vient à bout du premier général. Le suivant aura le dessus, mais grâce à une traîtrise de la Sublime Porte elle-même, qui fait porter un « haïr firman » (décret de grâce) à Ali pacha. Mais c'est un faux. Le vrai (le « katil firman »), envoyé en même temps, donne l'ordre de le décapiter dès qu'il se rendra. Il est donc vaincu par traîtrise, mais finalement, parce qu’il a été le premier à trahir. Hurshid pacha a vaincu le gouverneur félon.
Mais Hurshid n’est pas tranquille. Il est même inquiet. Les financiers de la Porte ont, à la suite de terribles et savants calculs, jugé que l’intégralité du trésor d’Ali pacha n’avait pas été livrée aux fonctionnaires chargés de le rapporter pour le verser au trésor impérial. Hurshid perçoit très vite sa prochaine disgrâce, allant jusqu’à anticiper la venue de Tundj Hata, en se suicidant, tout simplement.
Tundj Hata n’est qu’un fonctionnaire de rang moyen, mais sa place est véritablement au centre du roman : sa fonction est en effet de rapporter à brides abattues la tête du gouverneur qui a failli, où à propos de la fidélité duquel le sultan a tellement de doutes qu’il lui a retiré sa confiance. Le troisième chapitre raconte drôlement ce voyage de retour, au cours duquel le voisinage de la tête procure à Tundj Hata des extases inouïes qui le laissent pantelant. Il raconte aussi le détour devant des publics de villageois prêts à donner de l'argent en échange du spectacle de la tête du puissant qui vient de tomber.
Car le centre de gravité de La Niche de la honte, c’est la tête de ceux qui ont failli à leur mission. La niche en question, c’est celle qui a été creusée dans un des murs d’une place d’Istambul pour accueillir la tête qui a été coupée sur les épaules des mauvais serviteurs (ou supposés tels) de la Porte.
C’est véritablement la tête (coupée) qui porte le roman tout entier. La preuve en est dans le médecin-chef Evrenoz, qui a la lourde responsabilité de vérifier à heure fixe, en montant par une échelle jusqu’à la niche en question, l’état de la tête. Et gare à lui si elle se dégrade trop vite. A lui de demander au « Directeur des Poisons » les substances les plus à même de faire durer le plus longtemps possible la tête en bon état : le miel, la neige, le sel ou autre. Je ne parle que pour les mentionner des « spectacles » que Tundj Hata donne dans les villages des régions « dénationalisées » (les cinq étapes de la recette complète, proprement hallucinante de méthode en matière de décervelage, p. 178) avec la tête qu’il transporte dans un sac en cuir.
L’éloge de l’indomptable Albanie est formulé en quelque sorte par défaut dans le roman d’Ismaïl Kadaré : le sort de tous les serviteurs du sultan est tellement instable, lié à tellement de critères différents et hétérogènes, que nul, si puissant soit-il, n’est à l’abri de la décision de disgrâce qui peut tomber d’en haut à tout instant, ni de voir sa tête un jour exposée dans la niche de la honte.
D’ailleurs Hurshid pacha le sait : son ami Gizer, lui-même bientôt en disgrâce, lui a écrit un message transparent : « Je veux te dire aussi, à regret, qu’après-demain part te rejoindre un courrier de la Troisième Direction de la Cour, porteur, dit-on, d’un firman qui n’est guère faste. Tu jugeras et décideras par toi-même. Il y a partout un monde sous les étoiles, dit le sage Ibn-Sina. Je te salue et préférerais ne plus te revoir plutôt que te voir sans que toi-même puisses me voir » (p. 197). Hurshid perçoit aussitôt les sous-entendus (le salut dans la fuite, la tête séparée du corps) contenus dans le message, et voit déjà sa propre tête dans la « niche de la honte ».
Pour résumer, en négatif, m’apparaît dans ce livre l’injonction patriotique d’un roman national, albanais, pour ne pas dire nationaliste. L’Empire Ottoman a disparu, bien sûr, mais Ismaïl Kadaré creuse avec ardeur le sillon à vif du sentiment national.
Curieux sentiment d’une littérature surannée. J'ai peut-être tort, car il est possible après tout que la description de cette insupportable bureaucratie n'ait eu pour cible véritable le système policier totalitaire mis en place par Enver Hodja, le malade mental qui a terrorisé les Albanais de 1945 à 1985 (quarante ans), faisant disparaître ceux qui avaient cessé de lui plaire.
Peut-être après tout Kadaré, en dénonçant les horreurs de l'empire ottoman, pensait-il surtout au "Sultan" albanais. Peut-être même, à travers la silhouette d'Ali pacha, ce mauvais Albanais, Kadaré nous invite à discerner en filigrane celle du dictateur. Ali pacha se révoltant contre l'Empire serait alors une figure d'Enver Hodja le communiste, quittant le Pacte de Varsovie et l'Empire Soviétique, et se brouillant avec la Chine de Mao. Le vieux "rebelle" de 1820 n'était-il pas lui aussi seul, enfermé dans sa citadelle, exactement comme Enver Hodja ? En creux, on comprend que le véritable héros national de l'Albanie ne saurait être cet autocrate.
Allez savoir : peut-être Kadaré voyait-il, posée dans la "niche de la honte", la propre tête d'Enver Hodja.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, albanie, enver hodja, tedi papavrami, musique, ismaïl kadaré, la niche de la honte, jusuf vrioni, éditions fayard, fugue pour violon seul, les tambours de la pluie, avril brisé, vendetta, empire ottoman, sublime porte, napoléon bonaparte, scanderberg, collège de france, gilles veinstein, décervelage, histoire turque et ottomane, turquie, europe
lundi, 30 mars 2015
IL N’Y A PAS DE "SCIENCE ÉCONOMIQUE"
2/2
Je parlais de l'infirmité des pompeusement nommées « Sciences Humaines », qui ne portent le nom de sciences que par abus de langage. L'expression porte probablement le stigmate de son origine : le scientisme, cette croyance absolue dans le pouvoir de la science de résoudre tous les problèmes de l'humanité, imprégna jusqu'au coeur la moindre fibre de la seconde moitié du 19ème siècle.
Flaubert l'a personnifié sous les traits du pharmacien Homais, dont il a fait le masque de la bêtise satisfaite, la bêtise de « celui qui sait ». Parlant de je ne sais plus qui, Clémenceau disait joliment : « Il sait tout, mais rien d'autre ». Flaubert a tout compris : Bouvard et Pécuchet, me semble-t-il, ayant fait le tour du savoir encyclopédique, reviennent humblement pour finir à la tâche que s'assignaient les moines copistes du moyen âge.
Les « sciences molles » (le Collège de 'Pataphysique les appelle plus justement les « Sciences Inexactes », par opposition aux « Sciences Exactes », dites dures qui, elles, s'efforcent à l'exactitude) se sont empressées de se ranger sous cette bannière, qui leur conférait une dignité dont elles n'auraient jamais osé rêver sur leurs seuls mérites.
Sans pouvoir toutefois effacer le stigmate que constitue l'adjectif qualificatif "humaines" : quand on est obligé d'ajouter l'adjectif, c'est que son absence porterait à confusion. Quand on entre dans une « Faculté des Sciences », aucun doute sur les disciplines qu'on y enseigne, d'où l'absence d'adjectif.
Mais tout le monde a laissé faire, par pitié envers les « Sciences Humaines », ces cousines disgraciées, qu'on invite de temps en temps, le dimanche, parce qu'il faut bien se montrer un peu magnanime avec le pauvre monde. Ainsi l'habitude a été prise, et j'imagine que le 20ème siècle n'a jamais voulu, osé ou pu rétablir la vérité. Monsieur Homais est entré au Collège de France et à l'Académie Française. Il fait autorité. Alors même qu'il faudrait peut-être renommer les « Sciences Humaines » les Sciences Fausses.
Car le vice rédhibitoire dont souffrent les « Sciences Humaines », c’est précisément l’Homme, avec ses désirs, ses calculs, son hypocrisie et sa sincérité, ses manœuvres, ses intérêts particuliers, ses audaces et ses peurs, ses haines et ses amours, ses constructions comme ses destructions, bref, sa LIBERTÉ. C'est-à-dire ce dont sont démunies les forces aveugles et déterminées de la nature.
Non, l’économie n’est définitivement pas une science. Je n’énonce pas une énormité obscène : écoutez pour vous en convaincre l’émission de Dominique Rousset, le samedi sur France Culture. Quel que soit le thème choisi (dans l’actualité), vous les entendez, au bout d’un temps plus ou moins long, se chamailler. Deux économistes ne seront jamais entièrement d'accord.
Je rêve de les voir un jour en venir aux mains et, pourquoi pas, s'entretuer, pour qu'on s'amuse un peu. Vous imaginez, un combat à la loyale, à l'épée, « sur le pré », entre John Maynard Keynes et Milton Friedman ? Mais ils ne sont pas assez fous pour cela : ils se disent qu'un tel spectacle tuerait la poule aux œufs d'or, le « métier ». Il faut rester "digne", et pour cela, courtois et bien élevé. Propre.
Leurs désaccords n'en sont pas moins irréductibles. Ceci pour une raison très simple : l'étiquette "économiste" dissimule en règle très générale une tout autre personne que celle qui se donne pour spécialiste de ceci, expert en cela, capable d'assener (si, si, sans accent, c'est légal !) à toute la population du public terrorisé les certitudes absolues qu'il a acquises dans le domaine dont il se déclare le maître.
Cette personne est celle du militant politique. Les théories sur lesquelles ces gens s'appuient sont l'exact reflet du système politique dans lequel ils rêvent de les appliquer. En gros, sur le ring où ils s'affrontent, ça donne John Maynard Keynes contre Milton Friedman. Traduction : l'intérêt général contre les intérêts privés. Marx contre le Capital, si vous préférez.
Un économiste neutre est aussi crédible que ma sœur en monstre du Loch Ness. Il n'y a pas d'économie a-politique, mais des modèles d'organisation sociale qui s'affrontent : où faut-il placer le point d'équilibre entre les intérêts particuliers et l'intérêt supérieur du corps social dans son entier ? A qui et à quoi donner la priorité ? L'entrepreneur ou la collectivité ? L'efficacité économique ou la justice sociale ? Quand commence l'accaparement de la richesse ? Comment une société décide-t-elle de la façon dont elle veut vivre ?
Soit dit en passant, la logique à l'oeuvre dans le système actuel, et qui tend à imposer sa volonté aux Etats, elle est limpide : mettez en face le chiffre toujours plus impressionnant des pauvres qui ont besoin des Restos du cœur ou des Banques alimentaires pour survivre et le chiffre toujours plus astronomique des fortunes amassées par le centile des plus riches de la planète. Cela vous donne une idée de la montée irrésistible de l'Injustice. Or on sait que l'injustice produit immanquablement, à plus ou moins long terme, la violence.
Pas d'économiste objectif, donc : une théorie économique ne peut faire autrement que d'être au service de l'idée qu'on se fait de la société. Vous pouvez aisément vérifier. S’ils sont, en gros, d’accord sur le constat (il suffit de lire les journaux, les statistiques du chômage, les fermetures d’usines, …), dès qu’on aborde l’analyse des causes ou les propositions de solutions, rien ne va plus. Il m’est arrivé d’entendre des disputes homériques entre les quatre « scientifiques » invités par Dominique Rousset. J’ai fini par les abandonner à leur triste sort. Pas d'économie sans choix de société. D'où leurs disputes interminables.
Imagine-t-on se disputer ainsi deux physiciens évoquant l’existence du « boson de Higgs », dont le LHC du CERN a apporté la preuve (deux vrais spécialistes du climat évoquant le « réchauffement climatique » feront très bien l’affaire) ? Et tout le monde est d'accord pour traiter d'hurluberlu indépassable ce « scientifique » arabe (ou musulman, je ne sais plus, peut-être les deux) qui vient de décréter que la Terre est plate. Résumons : il y a des acquis irréfutables de la Science. Il n'y a pas de preuve définitive en économie.
Si l'économie était une science, un consensus finirait par s’établir entre « experts », exactement de la même manière que s’est établi le consensus des milliers de scientifiques du GIEC sur le climat, après la recension faite de l'intégralité de la littérature scientifique consacrée au sujet. Je compte pour rien les vociférations du gouverneur de Floride, Rick Scott, qui interdit aux fonctionnaires de son administration de prononcer l’expression « réchauffement climatique » (Le Monde, 24 mars), et autres élucubrations des « climatosceptiques ».
A ce propos, on peut cliquer sur le lien avec l'article : je conseille vivement la vidéo - 2'07" - désopilante : il faut voir quelques sénateurs américains se payer une bonne tranche de rigolade aux dépens du gars interrogé, tout propre sur lui et souriant, tournant autour de la formule taboue, mais complètement emberlificoté dans le ridicule à cause de la consigne reçue de ne pas la prononcer.
Malheureusement, si l'économie n'est pas une science, trop de gens riches et puissants ont intérêt à ce que tout le monde le croie quand même, malgré tous les démentis que leur inflige la réalité. Avec l'appui de quelles complicités les « Usurpateurs » (titre du dernier livre de Susan George sur le même sujet, voir ici même, 17 mars) ont-ils réussi à imposer dans les esprits l'expression "Prix Nobel d'économie", au mépris pur et simple des volontés testamentaires d'Alfred Nobel ? Le testament instaure cinq prix (Physique, Chimie, Médecine, Paix, Littérature), pas un de plus. C'est ce que Bernard Maris dénonce en p. 15 de Houellebecq économiste, livre polémique, c'est certain, mais tout à fait salutaire et nécessaire.
Voire indispensable. Et peut-être même utile. « Économiste sérieux » est un oxymore. La seule spécialité de l'économiste : l'enfumage.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, france, science économique, sciences humaines, flaubert, madame bovary, pharmacien homais, collège de pataphysique, collège de france, académie française, dominique rousset, france culture, john maynard keynes, milton friedman, karl marx le capital, restos du coeur, banques alimentaires, boson de higgs, cern lhc, réchauffement climatique, giec, gouverneur de floride rick scott, journal le monde, les usurpateurs susan george, prix nobel d'économie, michel houellebecq, houellebecq économiste, bernard maris, littérature
samedi, 08 novembre 2014
LES MATINS DE FRANCE CULTURE
UNE PENSÉE POUR CHRISTINE GOÉMÉ
3
Je garde en mémoire les noms d’Henri Laurens, de Mireille Delmas-Marty, d’Yves Lacoste, d’autres. Le premier, hélas invité parmi d’autres, avait malgré tout eu un peu de temps pour expliquer que le Proche-Orient est un problème désespérément insoluble (multiplicité des intérêts divergents ou incompatibles, renversements d'alliances extraordinaires, calculs politiques, ...). Mais je connaissais un peu ses travaux, irréfutables et d'une précision diabolique. La seconde avait évoqué les entorses faites aux principes démocratiques sous prétexte de sécurité.
Le dernier avait éclairé (entre autres) les différences des tracés frontaliers effectués respectivement sur les cartes par les officiers de l’infanterie et ceux de la marine. Eclairage très drôle, quoique peu à l'avantage des premiers, davantage portés (paraît-il) sur l'abus de la ligne droite. Les gens qui ont quelque chose d’intéressant à dire – ceux qui connaissent à fond une question, pas les habitués des micros et des caméras – ont besoin de la durée, de la continuité, bref, d’une température pas trop élevée de l’atmosphère.
Mais avant la "Matinale" (ancienne manière), j’écoutais aussi avidement l’émission qui précédait (je suis un « lève-très-tôt »). Mais c’était avant l’intrusion dans mes petits matins de « Un autre jour est possible », piloté par le multiculturaliste Tewfik Hakem, émission de divertissement et de promotion de l’actualité culturelle, s’efforçant consciencieusement de coller à l'événement en train de se produire, en vendant tout ce qui se fait de mieux en termes de modernité esthétique et sociétale.
Cette émission lente et posée, supplantée par l'air du temps, s’appelait « Eloge du savoir ». Elle était produite par une dame sûrement un peu ennuyeuse, qui a pour nom Christine Goémé, mais qui savait s’abreuver (et abreuver l’auditeur dans la foulée) aux plus hautes sources. Son émission était absolument formidable, partagée entre des cours au Collège de France et des conférences de haut niveau données dans le cadre d’ « Université de tous les savoirs ».
Je perdrais sans doute mon temps à expliquer tout ce que j’ai ainsi appris dans cette tranche horaire de 6h – 7h (eh oui, c’est aux aurores, mais c’est justement ça qui me convient), sur des sujets aussi divers que le recrutement des Janissaires à l’époque de l’Empire Ottoman triomphant, les origines composites de bien des récits de l'Ancien Testament, les religions indo-iraniennes, le contexte de civilisation européenne dans lequel a pu prospérer un mythe comme celui de Perceval, combien d’autres ? … Cette émission suait par tous les pores le miel délectable et embaumé de la Haute Culture.
L’agression a commencé avec la déprogrammation de l’émission, l'exil à 0h, et son remplacement par le nommé Tewfik Hakem et sa tambouille culturalo-moderne de « promotion » de l’air du temps, ce qui s’appelle, pour le coup, « sauter sur l’actualité » (comme la Légion Etrangère sur Kolwesi). Sans compter la demi-heure de bonus accordée à la « Matinale » de Marc Voinchet, sans doute pour favoriser une émission qui « dopait l’audience ».
J’ai bien été obligé de faire mon deuil et de me les accrocher en bandoulière (je parle des cours du Collège de France, qu’alliez-vous penser ?). Exit Christine Goémé, exit L’Eloge du savoir, précipités « Dans l’grand trou noir d’ousse qu’on n’revient jamais » (Chanson du décervelage, on la trouve dans toute bonne Bible de la 'Pataphysique).
On me dira que je n’ai qu’à veiller ou à me brancher sur franceculture.fr pour écouter ? Et puis quoi encore ? Cette placardisation brutale de la culture sur France Culture, sans doute pour crime d’ « élitisme », m’avait déjà semblé de mauvais augure. Le râteau à ratisser large, cela s’appelle un attrape-tout. Pour trouver, c'est facile, vous ne pouvez pas vous tromper : c’est juste avant le grand n’importe quoi.
C’est aussi quand France Culture, sous prétexte de « s’adapter à la modernité », de « suivre le mouvement de la société », commence à sacrifier la culture.
Encore un bel exemple de « Négation de soi » (voir quelques billets précédents).
Voilà ce que je dis, moi.
Note : j'entends dire que madame Christine Goémé ne va pas bien. Une pensée pour elle.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france culture, radio france, christine goémé, henri laurens, mireille delmas-marty, yves lacoste, proche orient, éloge du savoir, collège de france, université de tous les savoirs, tewfik hakem, un autre jour est possible, marc voinchet, pataphysique, les matins de france culture
vendredi, 31 mai 2013
TOUT EST NORMAL

LE 1er FEVRIER 1968, EDDIE ADAMS (PRIX PULITZER ET WORLD PRESS POUR CETTE IMAGE) PHOTOGRAPHIE NGUYEN NGOC LOAN, CHEF DE LA POLICE DU SUD VIETNAM, TIRANT UNE BALLE DANS LA TÊTE DE NGUYEN VAN LEM, MEMBRE DU VIETCONG. IL SE REPROCHERA CETTE PHOTO EN APPRENANT PLUS TARD QUE LA "VICTIME" DU POLICIER AVAIT ASSASSINÉ LE MEILLEUR AMI DE CELUI-CI, ET MASSACRÉ SA FAMILLE.
DE QUEL CÔTÉ, LE BIEN ? DE QUEL CÔTÉ, LE MAL ?
***
Suite du billet d'hier.
Reste que je n’ai toujours pas compris ce qu’il y avait « de gauche » dans la revendication du mariage homosexuel. On me dira que je suis bouché, ou qu’il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, ou que je suis "de droite". Certes, c’est une possibilité. Mais je vais sans doute aggraver mon cas, car je ne comprends pas davantage l’argument de l’ « égalité ».
Je croyais bêtement que le 2ème terme de la devise nationale s’appliquait aux individus, point barre. Je croyais qu’il y avait une institution qui s’appelait « mariage », point barre. Et puis voilà-t-il pas qu’il faut maintenant des qualificatifs, des compléments du nom, des propositions subordonnées : individu « quelle que soit son orientation sexuelle » ; mariage « pour tous ». Et les phrases, du coup, prennent un aspect proliférant, puisqu’on est obligé de préciser.
Je ne comprends pas non plus ce qui peut, dans l’instauration du mariage homosexuel, ressembler à un quelconque « progrès ». Sauf, évidemment, à considérer que la progression de l’homosexualité dans la société (et dans le monde) est en elle-même un « progrès ». Cela commence à en faire beaucoup, des choses que je ne comprends pas. Eh bien tant pis.
Je n’ai pas manifesté dans les rues contre le mariage homosexuel. Pour une raison précise : je n’avais aucune envie de me retrouver en compagnie de gens adossés à des doctrines ou des croyances qui ne sont pas les miennes : Eglise catholique, mouvement Civitas, UMP ou autre parti politique, encore moins groupes « identitaires ». Les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis.
Il n’empêche que je me retrouve du même côté que tous ces gens, qui sont opposés pour des raisons variées au mariage de deux hommes ou de deux femmes. Combien de citoyens ont réagi comme moi ? Mystère. Les médias se sont précipités sur Monseigneur Vingt-Trois, sur Frigide Barjot et sur Jean-François Copé. Oui, combien sommes-nous à ne nous reconnaître ni dans les cathos, ni dans les ultras, ni dans l'UMP, et à rester heurtés, dans leur conscience, par la loi votée et par la façon dont elle l'a été ?
Ce qui me turlupine dans cette affaire, c’est qu’il me semble, à tort ou à raison, apercevoir derrière cette « conquête » de nouveaux « droits », une des nombreuses forces qui, dans le monde actuel, ne supportant pas qu’il subsiste des « valeurs » - « universelles » qui plus est -, s’en prennent délibérément aux « points de repère » et à tout ce qui sert de cadre stable aux représentations collectives. Au premier plan de ces points de repère, bien sûr, la différence des sexes.
Pour dire les choses plus directement et plus crûment, je pense que ce qu’il y a, derrière cette « conquête » de « droits », c'est la dernière tentative en date de briser une fois pour toutes l’idée même de « norme ». Voilà, le gros mot est lâché. Je ne sais pas ce qui s’est passé au cours du 20ème siècle, pour que, progressivement, le mot « norme » soit devenu imprononçable, un mot grossier, quasiment une injure.
Et cela au moment même où la France n'a jamais croulé sous un tel poids de normes. Certains parlent de 400.000 normes en vigueur sur le territoire national. Etonnant, non ? Et ça va de la taille des préservatifs à la courbure des concombres, les premiers n'étant pas, selon toute vraisemblance, prévus pour les seconds. Mais en matière de vie collective, le mot a été purement et simplement rayé du vocabulaire admis. Au nom de l'appel à la tolérance et du droit à la différence, il est devenu normal de ne plus supporter les normes. Allez comprendre.
Le problème du mot « norme », c’est qu’on a formé, à partir de lui, l’adjectif « normal ». Et le problème du mot « normal », c’est que c’est lui qui est devenu un gros mot. Dans les dîners en ville, quand un convive audacieux veut le prononcer, il commence par baisser la voix, comme s’il avait honte de ce qu’il allait oser, puis il dresse l’index et le majeur des deux mains, dont il plie les extrémités d’un geste rapide, et articule dans un souffle : « Les gens, entre guillemets, normaux ». Il est gêné d’avoir osé proférer une obscénité. J’attends qu’on me dise, preuves à l’appui, que ce geste ne s’est pas généralisé.
La loi non écrite, que tout un chacun a intériorisée au point d’en faire un réflexe, un automatisme, peut se formuler ainsi : « Article 1er : tout le monde est normal. Article 2ème : toute infraction à l’article 1er s’appelle une stigmatisation, et est en conséquence punissable ». Ainsi en a décidé Michel Foucault (avec d’autres) dans les années 1970, quand il menait les « recherches » qui l’ont conduit au Collège de France.
Puisque les homosexuels ne veulent plus être « stigmatisés » comme « anormaux », c'est le diktat du « normal » qu'il va falloir jeter à bas. Ben oui, au nom de quoi, de quelles valeurs, de quelle autorité surplombante se permet-on de faire le départ entre le Bien et le Mal ? Dans la nouvelle Bible, tout ce qui se déclare normal est d'office suspect d'intolérance. Le verset principal est contenu dans la formule : « De quel droit ? ». Si possible accompagnée d'une mine courroucée. C'est peut-être l'autopsie et l'enterrement de la notion tout entière de norme qui doit être considérée comme un progrès ?

QUAND ON ABANDONNE LE POUVOIR A L'IDEOLOGIE, VOILÀ CE QUE ÇA DONNE
Cette façon de réécrire l’histoire consiste à « déconstruire » l'existant, en se débrouillant pour le faire apparaître comme arbitraire, donc abusif. Tout le monde, et en particulier les « victimes » de « discrimination » et de « stigmatisation », est pleinement fondé à le remettre en question, et même à inverser la charge des responsabilités (de responsable à coupable, il n'y a qu'un pas à franchir). Le tout est d'arriver à faire apparaître l'ordre (établi, traditionnel, etc.) comme injuste par principe. Pour, accessoirement, faire jouer les rapports de forces sous l'action de groupes de pression bien organisés et très militants pour changer tout ça.
C'est ainsi qu'un énorme et long travail idéologique a été fourni dans toutes les instances où s'élabore le savoir (université française, universités américaines, ce qui n'est pas la même chose, comme le montrent ici le singulier de l'une et le pluriel des autres) pour refaçonner les représentations collectives, et cette fois au bénéfice de tous ceux qui, précédemment, étaient catalogués (« stigmatisés ») comme anormaux.
C'est ainsi que cette nouvelle histoire à la sauce Michel Foucault (Histoire de la folie à l'âge classique, Surveiller et punir, ..., mais vous pouvez ajouter quelques pincées de Pierre Bourdieu en fin de cuisson, avec La Reproduction, Les Héritiers, La Domination masculine, ...) s’est désormais établie comme une vérité d’évangile, inculquée dès l’âge le plus tendre, et interdite de toute remise en question, sous peine pour le profanateur d’être catalogué « intolérant », « facho » et, comme tel, d’être désigné à l'universel opprobre (« du ruisseau », ajoute Boby Lapointe dans Le Papa du papa), et englouti dans le silence médiatique qui attend tous ceux qui portent atteinte aux nouvelles tables de la loi. Mis hors d'état de nuire, en tant qu'ennemi public n°1.
Il n’y a plus, qu’on se le dise, d’ « anormaux », qu’ils soient physiques, mentaux, sociaux ou sexuels. Ah si, pourtant, sur ce dernier point, ceux qui désirent copuler avec des enfants. Sans doute au motif que « les enfants, c’est sacré » (les bonnes âmes vertueuses, défenseuses des enfants, devraient aller voir dans les livres de Tony Duvert, Quand mourut Jonathan, L'Île atlantique, etc., aux éditions de Minuit). Quelqu’un a posé ici une limite infranchissable, au-delà de laquelle se situe ce que tout le monde s'accorde à désigner comme une « perversion».

AU BÛCHER, LES OUVRAGES NON CONFORMES !
En dehors de ce cas très précis touchant les enfants, le mot perversion a été rayé du vocabulaire. Pour le reste, TOUT EST NORMAL, on vous dit. Sous-entendu : tout est permis. C’est ainsi que la séquence de lettres LGBT est entrée dans le langage courant, comme n’importe quel mot ordinaire. Encore que quatre pauvres lettres pour résumer toutes les "particularités" humaines en matière de sexualité (on en a fait des dictionnaires pour les recenser toutes), cela ressemble à un abus injustement réducteur.
Ah non, pas tout à fait ordinaire cependant : le mot LGBT est devenu une NORME. Etonnant, non ? Non, ce n'est pas étonnant : c'est le progrès, qu'on vous dit. Bon Dieu, mais c'est bien sûr : c'était donc ça ! Un progrès dont le refrain est : pas touche à mon particularisme, sinon gare à toi !
Sale temps pour les gens normaux. Et sans guillemets.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, eddie adams, guerre du vietnam, saïgon, homosexualité, mariage gay, mariage, françois hollande, sexualité, église catholique, ump, jean-françois copé, monseigneur vingt-trois, frigide barjot, catholiques, michel foucault, collège de france, les anormaux, histoire de la folie à l'âge classique, surveiller et punir, pierre bourdieu, tony duvert, l'île atlantique, quand mourut jonathan, éditions de minuit, perversions, lgbt
mardi, 15 janvier 2013
ELOGE D'HENRI BERGSON 1
Pensée du jour :
« La brute se couvre, le riche ou le sot se pare, l’homme élégant s’habille », Traité de la vie élégante.
HONORÉ DE BALZAC
Ce n'est pas pour me vanter, mais je viens d’achever la lecture des œuvres d’HENRI BERGSON. Drôle d’idée, non ? Remarquez, on me dira que la tâche est loin d’être insurmontable. D’abord parce que ces « œuvres » ne sont pas si nombreuses que ça. C’est tout à fait vrai. Quatre livres, en tout et pour tout, ça reste à hauteur d’homme. Je ne parle pas des deux recueils d’articles, du petit bouquin intitulé Le Rire, des Ecrits et paroles, et de divers papiers plus récemment publiés.
Je me suis limité aux quatre piliers du temple bergsonien : Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), Matière et mémoire (1896), L’Evolution créatrice (1907), Les Deux sources de la morale et de la religion (1932). Un peu moins de mille pages. J'avais acheté (45 francs, si je me souviens bien) le volume chez le libraire du péristyle de l'opéra quand j'étais en classe de première. Oui, il ne faut jamais désespérer.
Oui, ça n’a l’air de rien, je sais. Encore faut-il s’y mettre, et puis s’y cramponner. Les trois premiers livres (augmentés de toutes les activités annexes) suffisent, en 1927, à lui faire attribuer le prix Nobel, même si c’est celui de littérature (révélateur, d'un certain point de vue).
Résultat des courses ? D’abord une impression curieuse : BERGSON écrit dans un français absolument parfait (en plus, absolument accessible et dépourvu de jargon) une philosophie qui exige une attention soutenue, pour ne pas dire un important effort de contention. N’a-t-il pas déclaré un jour : « Il faut avoir poussé jusqu’au bout la décomposition de ce qu’on a dans l’esprit, pour arriver à s’exprimer en termes simples », c’est-à-dire, comme PASCAL, DESCARTES ou ROUSSEAU, dans « la langue de toute le monde ». Voilà un philosophe qu'il est bon !
Voyez plutôt les dernières lignes de son dernier grand livre (1932) : « L’humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu’elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d’elle. A elle de voir si elle veut continuer à vivre. A elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement, ou fournir en outre l’effort nécessaire pour que s’accomplisse, jusque sur notre planète réfractaire, la fonction essentielle de l’univers, qui est une machine à faire des dieux ». Prémonitoire ou carrément utopique ?
Il a eu le temps d’écrire, juste avant, cette phrase merveilleuse, au sujet du « monde inconnu » qu’il appelle de ses vœux : « Le plaisir serait éclipsé par la joie ». Considérons cela comme le point d’orgue de l’œuvre du philosophe. Mort en 1941, il a eu le temps de voir venir l’horreur sur ses tout vieux jours. Pas celle de la bombe atomique. C’est déjà ça.
Je ne sais pas vous, mais moi, ça m’épastrouille, ces phrases. Cette force. Pour clore son œuvre sur de pareilles considérations, il faut être soit devenu sénile (en 1932, il a 73 ans), soit resté complètement culotté, tout comme un jeune con. Pour quelqu’un qui prend ça direct en face, ça peut sembler du n’importe quoi.
Pour quelqu’un qui referme le bouquin là-dessus, ça fait un effet incroyable, même si, la nuit et dans le brouillard, ça vous a un arrière-goût du fossile EDGAR MORIN, vous savez, le boursoufleur d’idées générales, le gonfleur de baudruches conceptuelles globalisantes et creuses.
Certains riront de mon pléonasme, toute globalisation abusive étant forcément creuse : « On ne saurait remplir du tout avec du rien » (je cite de mémoire et en substance). Quand je conduisais l’attelage de bœufs du père PIC, ce qu’il me disait là, c’était l’évidence. Et ça l’est restée. Il reste qu’EDGAR MORIN aura mouliné beaucoup de vent. Et « gonflé » beaucoup d’auditeurs. J’espère. Peut-être à tort.
BERGSON, contrairement à MORIN, ne dit jamais qu’il est en train de dire le sens du monde. Certes, dans son dernier livre, il se laisse aller à une exaltation, à un optimisme au sujet de l’avenir humain. Mais d’après ce que j’en ai compris, HENRI BERGSON ne brasse jamais du vent. Mais c'est un philosophe, lui. C’est peut-être pour ça qu’il ne passe jamais à la télé.
Ah, on me dit qu’il est mort en 1941. Soit. D’ailleurs, il aurait peut-être aimé les plateaux de TF1 : les « belles dames » à la mode se bousculaient à ses cours au Collège de France, et ce ne sont pas les dignités et responsabilités internationales qui l’ont effarouché ou fait fuir. Il avait une « cause » à défendre : ne fait-il pas l’éloge de la Société des Nations (SDN, ancêtre de l’ONU) à la fin des Deux Sources … ?
Je crains qu’HENRI BERGSON, en effet, n’ait appartenu au camp des increvables optimistes.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, honoré de balzac, littérature, henri bergson, philosophie, essai sur les données immédiates de la conscience, matière et mémoire, l'évolution créatrice, les deux sources de la morale et de la religion, prix nobel de littérature, langue française, france, edgar morin, sdn, onu, collège de france

