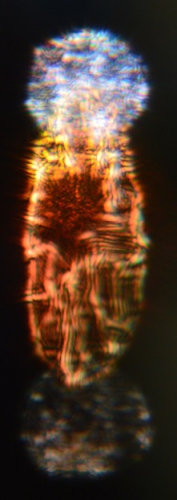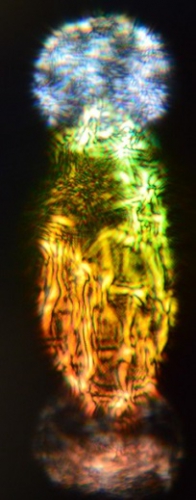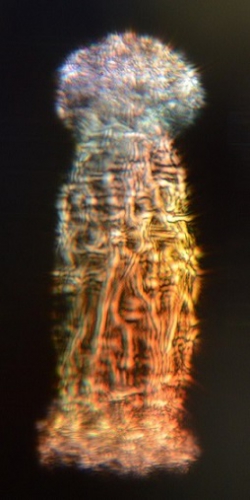mardi, 28 octobre 2025
MODESTE BLAGUE
Trois vignettes de la première page de Au Royaume d'Astap (Hachette, 1974), premier épisode des aventures de Norbert et Kari, habitants de Taaratatah, minuscule atoll de corail perdu dans le Pacifique, du côté de la Polynésie. L'histoire délectable inventée par Godard est sans doute inspirée du célèbre livre de William Golding Sa Majesté des mouches, mais attention, sur un mode burlesque et décomplexé, voire carrément claironné. Au début, Norbert et Kari sont perdus sur l'océan, et Norbert aimerait bien ne pas mourir de faim. La scène qui suit rend hommage à un champion du calembour-bon : Luc Etienne, Régent définitif du Collège de 'Pataphysique, oulipien enragé et inventeur de la "méthode S+7".



Les pointilleux et les spécialistes pourront faire remarquer au jeune Kari qu'un mérou de cette taille tient plutôt de l'alevin, mais ne soyons pas trop regardants.
09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, les aventures de norbert et kari, taaratatqh, polynésie, océan pacifique, humour, william golding, sa majesté des mouches, luc étienne, collège de pataphysique
dimanche, 17 octobre 2021
RENÉ LANAUD, PHOTOGRAPHE

Cette photo a été prise rue Saint-Jean le 10 novembre 1991. Quand je suis tombé dessus sur le site de la B.M.L., j'ai eu la surprise de reconnaître l'une des personnes présentes à l'image. Car on est au 29, rue Saint-Jean (maison Le Viste), là où un nommé Avon a fondé la librairie Diogène en 1974. C'est justement lui qu'on voit, dix-sept ans plus tard, installé dans son fauteuil dans son attitude favorite, devant le magasin à profiter du soleil de novembre. Je doute (je peux me tromper) que René Lanaud ait su exactement quelle figure de la librairie lyonnaise d'ancien il immortalisait ainsi : il faut avoir connu Avon.

Avon avait une conception tranquillement épicurienne de l'existence. En affaires, il était direct et redoutable : « Je suis ardéchois », avouait-il en guise d'explication. Sa barbe dense et proliférante devait être pour quelque chose dans l'"explication". Cela ne m'a pas empêché [j'ai eu cette chance], juste à l'ouverture de son échoppe (ce n'est que plus tard que c'est devenu une "entreprise"), de lui acheter pour une somme outrageusement modique les Œuvres Complètes d'Alfred Jarry.
C'était l'édition 1948 de René Massat (Fasquelle et Kaeser), et en tirage de tête s'il vous plaît (N°F22 sur "grand vélin filigrané Renage"). Une belle édition toujours méprisée par le cercle des Vestales du Collège de 'Pataphysique, qui veillent hargneusement sur les mânes du père du Père Ubu, et qui persistent à coller des guillemets à "complètes" au prétexte l'inventaire des œuvres et l'établissement des textes manquent de sérieux. Même si ces cerbères n'ont pas entièrement tort, et qu'il faut leur reconnaître une grande rigueur, leur susceptibilité au sujet de tout ce qui concerne Alfred Jarry montre tous les symptômes de la maladie sectaire.
En 1974, M. Avon débutait à peine, il n'était sans doute pas au courant des prix du marché et il essayait de mettre un peu d'ordre dans la masse de livres qu'il avait achetés pour inaugurer son commerce. A sa décharge, il faut ajouter que quatre des huit volumes avaient subi une très vilaine reliure d'amateur, dotée de quatre "faux nerfs", viles boursouflures comme des cicatrices mal soignées, du plus mauvais effet. M. Moura, le relieur de la rue Sala à qui j'avais confié la tâche de réparer les dégâts, avait fait une mine apitoyée.
La maison s'est bien rattrapée ensuite : il m'est arrivé d'assister à une vente aux enchères où le successeur d'Avon, un barbu plus falot mais aux puissants moyens, devenu une sorte de terreur sur la place de Lyon, a gardé d'un bout à l'autre de la vente la main levée, au point de rafler l'intégralité des lots (ou presque : le commissaire priseur a dû lui en vouloir, car plus personne n'osait enchérir contre lui).
Rue Saint-Jean, en face de "Diogène", sévissait J.P.C., un moustachu caractériel qui vendait d'occasion, aux clients dont la tête lui revenait, des disques de jazz (c'était l'époque des vinyles), en particulier des exemplaires du service de presse, reconnaissables à l'encoche que l'éditeur y découpait dans un des angles supérieurs. Je n'ai jamais su sur quels indices il s'appuyait pour refuser mordicus de vous délivrer quelque petit trésor dissimulé sur les rayons du bas.
Aux dernières nouvelles, je me suis laissé dire que la librairie Diogène a des soucis avec le propriétaire des murs : il semblerait que le loyer exigé soit soumis à la même scandaleuse logique spéculative que celle qui, après avoir failli détruire le Café de la Cloche (rue de la Charité), a jeté dehors la pizzeria Carlino (rue de l'Arbre-Sec), au grand dam de Carlino lui-même, de ses amis et de la foule des amateurs qui fréquentaient le lieu. J'aime à penser que, si Avon était encore aux manettes, on aurait droit à un beau spectacle bien "musclé" entre le propriétaire et son locataire.
Je me dis qu'il est loin, à Lyon, le temps où un père de famille nombreuse au revenu somme toute modeste avait malgré tout les moyens de loger sa smala entière dans les 300m² d'un superbe appartement du quai Lassagne où il pouvait se donner des airs de grand bourgeois, sur le parquet "Versailles" et sous un plafond à 4,2 mètres, où le thermomètre en hiver avait du mal à dépasser le seuil des 14°C à hauteur d'homme.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans FAÇON DE REGARDER | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, rené lanaud, lyon, vieux lyon, quartier saint-jean, rue saint-jean, librairie diogène, avon libraire, moura relieur, alfred jarry, bibliothèque municipale de lyon, numelyo, photographes en rhône-alpes, jarry oeuvres complètes rené massat, oeuvres complètes éditions fasquelle kaeser, café de la cloche rue de la charité, pizzeria carlino rue de l'arbre-sec, collège de pataphysique, père ubu
mercredi, 04 juillet 2018
THE SINKING OF THE TITANIC
Je ne sais pas si Gavin Bryars, membre éminent du Collège de 'Pataphysique (avec rang et dignité de T.S. = Transcendant Satrape), est un génie de la musique d'aujourd'hui, et je m'en contrefiche. Il se trouve simplement qu'un jour, j'ai placé sur la platine CD The Sinking of the Titanic, et que j'ai eu un peu de mal à m'en remettre. Si c'est une supercherie, elle vaut l'incendie de Rome par Néron qui agissait, faut-il le rappeler, dans un but purement esthétique (paraît-il, je précise quand même). Dans cette oeuvre de Gavin Bryars, l'avénement aquatique des sons musicaux épouse, presque moralement, les bruits du désastre naval. Il me semble que The Sinking of the Titanic exprime avec exactitude et tendresse l'héroïsme des musiciens supposés avoir joué jusqu'à leur propre disparition, avalés par la mer. Il y en a pour une heure.
Bon, c'est vrai, je trouve la version enregistrée en public moins aboutie que le travail original exécuté en studio. J'encourage l'amateur à préférer celle-ci.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, musique contemporaine, gavin bryars, the sinking of the titanic, collège de pataphysique, transcendant satrape
vendredi, 07 juillet 2017
TROIS PALOTINS
Giron.
Pile.
Cotice.
Je me permets de proposer aux pataphysiciens conscients ou inconscients (ça veut dire tout le monde) ces représentations toutes personnelles des Palotins. Je ne prétends surtout pas, pour autant, détrôner l'indétrônable effigie qu'en avait gravée, sur une plaque en bois d'arbre, leur géniteur officiel : Alfred Jarry.

On trouve la description exacte (sauf le nez des palotins) de cette gravure dans la bouche d'Ubu, à la scène IX de l'Acte héraldique de César-Antéchrist (1895) :
« Semblable à un œuf, une citrouille ou un fulgurant météore, je roule sur cette terre où je ferai ce qu'il me plaira. - D'où naissent ces trois animaux (apparaissent Giron, Pile et Cotice) aux oreilles imperturbablement dirigées vers le nord et leurs nez vierges semblables à des trompes qui n'ont point encore sonné ? ».
Si l'on regarde bien, la créature céleste qui surplombe les Palotins est effectivement "fulgurante" (zigzag de la foudre), "spiraloïde" (la gidouille) et "macroglosse" (l'excroissance buccale),
Jarry ne souffre d'aucun préjugé formel : si le nez en trompe n'apparaît pas sur la gravure ci-dessus, on est fort tenté de le repérer dans le détail de la suivante, gravure que j'avais eu l'honneur de commenter de façon originale (saluée par Michel Arrivé, j'ai la lettre), malgré un larcin de M. Henri Béhar en personne dans je ne sais plus quel numéro de la très estimable revue L'Etoile-Absinthe, appropriation rectifiée ensuite grâce à l'impeccable éthique de M. Michel Décaudin.

Je n'ai jamais pu me faire aux usages et mésusages en usage dans l'Université.
dimanche, 06 mars 2016
À PROPOS DE RAYMOND QUENEAU
 MODESTES CONSIDÉRATIONS SUR LA MODERNITÉ
MODESTES CONSIDÉRATIONS SUR LA MODERNITÉ
Résumé : on aura compris que ce que certains adorent encore sous le nom de "modernité" ou de "modernisme" me court depuis lurette sur le haricot. Il va de soi que la biographie de Raymond Queneau apparaîtra légitimement comme un simple prétexte à quelques réflexions oiseuses. Et inactuelles. Et dont je ne méconnais pas l'épaisseur du trait qui a servi à les écrire.
2/2
Comme les peintres du 20ème siècle ont élevé la matière, la forme et les outils à la dignité d’œuvres picturales, comme les musiciens ont élevé tous les sons possibles, y compris les bruits (chasse d'eau, aspirateur, ...), à la dignité de matériau musical, les littérateurs soucieux de toujours se tenir à l’avant-garde des mouvements d'avant-garde ont écrit des œuvres où ils font du matériau langagier l’objet de leur travail, dans un superbe effort d'objectivation.
Lécureur enfonce le clou, à propos des J.A.R. (jeunes auteurs réunis) : « Cependant, ils ont tous en commun ce désir, cet instinct, cette volonté de "démythisation" de notre société, qui les situe face à ceux qui voudraient abusivement exploiter de prétendus mythes, qui ne sont que des préjugés éculés et de superstitieuses survivances » (p.404). La messe est dite : la llittérature doit s’engager sous l’étendard du rationnel à tout crin. De l'intelligence comme valeur suprême. La croyance doit se savoir croyance, c'est-à-dire s'abolir. Pas de salut hors de ce credo impérieux. Retour aux combats des philosophes du dix-huitième siècle. Le nouveau diable s'appelle "mythe", "grand récit" ou ce qu'on veut. Sans prétendre militer pour la réhabilitation des superstitions, on peut se demander qui nous gardera des dégâts induits par les mésusages de la Raison.
Car le 20ème siècle, à travers ses théories picturales, musicales et littéraires, offre trois cas de fétichisme de la matière et de divinisation de l'Intelligence Rationnelle : après tout, pourquoi les outils patiemment mis au point par des millénaires d’histoire humaine (c'est-à-dire de "mythisation", de fantasmes, d'imagination, de "projections psychiques", bref : de délire lyrique) n’auraient-ils pas le droit d’être à leur tour promus au rang des œuvres d’art ? La technique, y a que ça de vrai. J’en suis venu à me demander, quant à moi, ce que peut avoir à dire un artiste qui ne parle pas du monde, mais qui commente ce qu'il fait. Ce que peut signifier cette promotion sur le devant de la scène, cette starisation des outils, moyens et autres instruments et supports au panthéon des valeurs esthétiques : la civilisation, confrontée à sa propre vacuité, a-t-elle encore quelque chose à dire?
C’est en tout cas la conclusion à laquelle Jean Dubuffet arrive, s’agissant du Collège de ’Pataphysique : « "Les réunions (remarquablement masculines) du Collège de ’Pataphysique ont quelque chose de vain, écrivait-il, de vacueux, mais tout l’édifice entier de la ’Pataphysique apparaît quelquefois fondé sur la "Vacuité". Il s’en sépara le 28 octobre suivant » (p.478). Dubuffet évoque la question dans Bâtons rompus (Minuit, 1986). Maintenant, on n’est pas obligé de le suivre dans ses « retours aux sources de l’art » (art brut, dessins d’enfant, etc.) et dans sa doxa : « Tout fait art ». Je ne sais pas au juste, finalement, ce que Dubuffet reprochait au Collège.
La civilisation, exténuée des efforts accomplis pour dominer le monde (avec les joyeusetés et autres beaux résultats offerts par le 20ème siècle), avait vidé les caves et les greniers de son imaginaire. N’ayant plus rien dans ses réserves pour dire le monde (qu’elle avait fini de dévorer), elle s’est retournée sur elle-même, dans un éperdu mouvement de questionnement et d’introspection narcissiques et culpabilisés (d'où la croissance proliférante des "sciences humaines").
Poussée dans ses retranchements, n’ayant plus rien à dire, elle a commencé à se regarder, à s'examiner, à se disséquer, à se "déconstruire". Elle s’est tournée vers ses propres moyens techniques, ses propres outils, ses propres façons de travailler et de vivre pour se donner l’impression que non, ce n’en était pas fini de ses ressources créatives. Elle s’est mise à se regarder vivre. Et les littérateurs se sont mis à se regarder écrire, les peintres à se regarder peindre, les musiciens à se regarder composer. Le concept s'est suffi à lui-même, délogeant l'imaginaire de son lopin, renvoyé à la préhistoire de l'art. Dans un retour réflexif sur elle-même, la civilisation a fait subir au sentiment qu’elle avait de sa validité et de sa légitimité une remise en question de tous ses paramètres, qui a quelque chose à voir avec l’Inquisition : quelle autre civilisation que la nôtre s'est dit, un jour : je suis un péché ?
Les travaux de l’Oulipo, selon moi, illustrent assez bien l’épuisement des ressources imaginaires de l’Occident, puisque ses fondateurs (Le Lionnais et Queneau) avaient l’intention d’explorer les moyens de fabriquer de la littérature en puisant dans les ressources offertes par les mathématiques (ils étaient tous deux mathématiciens). Condorcet le révolutionnaire aurait été enchanté de cette perspective, lui qui avait dans ses cartons des projets d'application des principes mathématiques à l'organisation sociale. A quoi son malheureux suicide nous a-t-il permis d'échapper ! La "déesse Raison" ! Il ne faut pas exagérer !
On comprend d’ailleurs que Perec se soit senti comme chez lui dans les rangs oulipiens, puisque, de son côté, il avait essayé de mettre au point une telle machine, qu’il avait baptisée PALF (Production Automatique de Littérature Française). Et qui a demandé à Claude Berge, mathématicien, des conseils alors qu'il préparait La Vie mode d'emploi. Mais lui, il avait assez à dire pour donner vie à des machines structurales.
Franchement, qui peut prendre vraiment au sérieux le pari stupide de 100.000.000.000.000 de poèmes, livre qui doit poser quelques légers problèmes de fabrication (voir ci-dessous), et qui repose en plus sur une imposture : « Ce petit ouvrage permet à tout un chacun de composer à volonté cent mille milliards de sonnets » ? "Composer" ? Eh, menteur, qui les a écrits, les vers ? Un livre assez couillon, finalement. Aussi bête, en fin de compte, que ces "livres dont vous êtes le héros", où on fait croire au lecteur qu'il a le choix (la même gaminerie existe dans des partitions musicales !). Un défi, si l'on veut, une performance technique à la rigueur, mais une récréation de vieil érudit retourné au bac à sable, du genre : attention les yeux ! Vous allez voir ce que vous allez voir. Je ne comprends pas la béatitude de ceux qui admirent ça.

Ce bouquin, pour moi, tient du canular. Du jeu spéculatif, à la grande rigueur.
Maintenant, tout ce qui précède ne m’empêche pas de reconnaître le caractère exceptionnel de l’individu nommé Raymond Queneau. Il faudrait être idiot pour lui dénier ses multiples mérites, à commencer par la nature profondément encyclopédique de son intelligence, ce qui l’a amené à jouer un rôle éminent, et même central, dans l’existence des éditions Gallimard. Lécureur parle de sa « boulimie intellectuelle », qu’il juge « phénoménale » (p.343). Je suis évidemment d'accord. Sa curiosité tous azimuts, son énergie inlassable l’ont mis en contact avec d’innombrables interlocuteurs. En plus, quoiqu’amateur, il n’était pas mauvais peintre. J’ai du mal à le suivre dans ses goûts : Jean Hélion est-il un artiste à ce point inoubliable, lui qui est allé de la figuration à l'abstraction et retour, quoiqu'à contretemps des modes ?
Au total, je ne peux m’empêcher de comparer les biographies de Perec et de Queneau, que j’ai lues à la file. Et je vais vous dire, autant la première m’a donné envie de me replonger dans les œuvres de leur auteur, autant la seconde me renforce dans ma décision de regarder les livres de l'écrivain en me contentant de leur dos, sur le rayon.
Pour moi, tout le travail de Raymond Queneau illustre bien les malheurs qui affligent la littérature au 20ème siècle, une littérature exténuée, qui a cessé de croire en elle-même, en la légitimité intrinsèque de l'imaginaire (la "mythisation") qu'elle propose et instaure. Une littérature entrée dans l’ère du doute et du soupçon généralisés.
En attendant l’ « Ère du vide » (titre d'un livre de Gilles Lipovetsky). Et les « déconstructeurs » : l'intelligence déconstruit les mythes qui ont fondé nos sociétés, les stéréotypes et les éventuels préjugés qu'ils ont produits. Tout ça pour quoi ? A force d'intelligence, à force d'intellectualité, à force de se déconstruire, à force de contrôler la validité de son ticket de transport dans le train de l'existence et de la construction sociale, l'être humain est en train de se rendre compte que, au bout de la déconstruction, quand il a fait le tour du caractère artificiel et arbitraire de tous ses édifices culturels, il ne reste en lui que le vide.
En matière d'humanité, il ne saurait y avoir de Vérité : il n'y a que des choix, des décisions, des créations, des contextes, des situations. Il y a les principes ; et puis il y a la vie. Toute institution humaine est arbitraire (tiens, Queneau, l'orthographe, par exemple !). C'est vrai, après tout : pourquoi ainsi et pas autrement ? Pourquoi ceci plutôt que cela ? Mais l'humanité n'est pas un hypermarché. Il faut se poser des questions, c'est sûr, mais bon, il faut aussi se reposer. Car sous cet angle, tout ce qui est humain peut être déconstruit et passé à la moulinette.
Je pense à la phrase d'Archimède : « Donnez-moi un point fixe et je soulève l'univers ». Il demandait l'impossible : il n'y a pas de point fixe dans l'univers. Pourtant l'homme a besoin de fixer, et de se fixer. Or, les "vérités" auxquelles il s'attache ont besoin de la durée pour s'établir. Ce décalage est une infirmité : il faut le reconnaître. Et puis comme on dit : "il faut faire avec". L'esprit de l'homme tend à éterniser l'instant. C'est pour ça qu'il a un passé. C'est aussi pour ça qu'il s'est fabriqué des dieux.
Une société relativement rationnelle se donne les moyens d'y voir clair. Une société absolument rationnelle se propose de tirer la vie au cordeau, c'est-à-dire de la rendre invivable. Il faudrait penser à protéger, à sauver ce que Hermann Broch appelle le « résidu irrationnel », ce reste qui échappera toujours à la connaissance scientifique. Pour notre bonheur. Ce "résidu" s'appelle la liberté.
L'imaginaire (les mythes, etc.), c'est la vie qui nous dit à l'oreille : quelque chose plutôt que rien. La vie qui nous dit : cette chose plutôt qu'une autre. Tant pis : on ne peut pas tout rationaliser : vivre, c'est aussi choisir, donc éliminer. C'est entendu : ce que nous sommes collectivement résulte d'une convention : une "identité". C'est entendu : une identité n'est pas une Vérité. Notre identité est conventionnelle. Nos institutions sont conventionnelles. Et les religions. Et les cultures. Et les mœurs. Et les habits. Et ..., et ..., et ...
Pour pasticher la plus grande niaiserie en vigueur chez les promoteurs de la "modernité" : « On ne naît pas humain : on le devient ». Tu l'as dit, bouffie (et le "e" n'est pas une coquille) !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, raymond queneau, éditions gallimard, musique contemporaine, dubuffet, art brut, collège de pataphysique, dubuffet bâtons rompus, oulipo, georges perec, cent mille milliards de poèmes, condorcet, michel lécureur queneau, peintre jean hélion, l'ère du vide, gilles lipovetsky, hermann broch, art contemporain
jeudi, 24 septembre 2015
L'HOMME OBSOLÈTE
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 4
Sur la bombe et les causes de notre aveuglement face à l’Apocalypse
La remarque la plus étonnante – la plus amusante si l’on veut – qu’on trouve dans ce dernier essai composant L’Obsolescence de l’homme, se trouve p. 283. C’est le titre du §8 : « L’assassin n’est pas seul coupable ; celui qui est appelé à mourir l’est aussi ». Il se trouve que j’étais en train de lire Maigret et le clochard. Les hasards de l’existence … On lit en effet au chapitre IV ce petit dialogue entre M. et Mme Maigret : « – Les criminologistes, en particulier les criminologistes américains, ont une théorie à ce sujet, et elle n’est peut-être pas aussi excessive qu’elle en a l’air … – Quelle théorie ? – Que, sur dix crime, il y en a au moins huit où la victime partage dans une large mesure la responsabilité de l’assassin ». Le rapprochement s’arrête évidemment à cette coïncidence.
Günther Anders analyse ici les implications et significations de la bombe atomique. Il reprend une idée exprimée dans Sur la Honte prométhéenne : « Nous lançons le bouchon plus loin que nous ne pouvons voir avec notre courte vue » (p.315). Autrement dit, nous agissons sans nous préoccuper des conséquences de nos actes, et nous inventons des choses qui finissent par nous dépasser, voire se retourner contre nous.
Je me contenterai de picorer ici des réflexions qui m’ont semblé intéressantes. D’abord cette idée que, aujourd’hui, « c’est nous qui sommes l’infini », qui dit assez bien ce que la bombe, fruit de l’ingéniosité humaine, a d’incommensurable avec l’existence humaine : nous éprouvons désormais « la nostalgie d’un monde où nous nous sentions bien dans notre finitude ».
Faust est mort, dit l’auteur, précisément parce qu’il est le dernier à se plaindre de sa « finitude ». Je ne sais plus où, dans le Second Faust, le personnage s’adresse à Méphisto : « Voilà ce que j’ai conçu. Aide-moi à le réaliser ». Notons au passage qu’aux yeux de Goethe, c’est la technique en soi qui a quelque chose de diabolique, puisque c’est Méphisto qui l’incarne.
Une autre idée importante, je l’ai rencontrée récemment dans la lecture de La Gouvernance par les nombres d’Alain Supiot (cf. ici, 9 et 10/09) : ce dernier appelle « principe d’hétéronomie » l’instance d’autorité qui, surplombant et ordonnant les activités des hommes, s’impose à tous. Or ce principe, dans une civilisation dominée par la technique, tend à devenir invisible, conférant alors au processus lui-même une autorité d’autant plus inflexible qu’elle n’émane pas d’une personne. Ce qui fait que la finalité de la tâche échappe totalement à celui qui l’accomplit, avec pour corollaire : « Personne ne peut plus être personnellement tenu pour responsable de ce qu’il fait » (p.321).
C’est aussi dans le présent essai qu’on trouve le chapitre intitulé « L’homme est plus petit que lui-même ». Je ne reviens pas en détail sur cette idée formidable, qui développe d’une certaine manière les grands mythes modernes suscités par la créature du Dr Frankenstein (Mary Shelley) ou par le Golem (Gustav Meyrink) : l’homme, en déléguant sa puissance à la technique, a donné naissance à une créature qui lui échappe de plus en plus. Avec pour conséquence de multiplier les risques pour l’humanité : « Ce qui signifie que, dans ce domaine, personne n’est compétent et que l’apocalypse est donc, par essence, entre les mains d’incompétents » (p.301). Autrement dit, l’humanité a construit un avion pour lequel il n’existe pas de pilote.
Je signale une expression qui m’a aussitôt fait penser à Hannah Arendt : « cette horrible insignifiance de l’horreur » (p.304).
Pour terminer, ce passage (l'auteur vient d'évoquer Les Frères Karamazov) : « Accepter que le monde qui, la veille encore, avait un sens exclusivement religieux devienne l’affaire de la "physique" ; reconnaître, en lieu et place de Dieu, du Christ et des saints, "une loi sans législateur", une loi non sanctionnée, sans autre caution que sa seule existence, une loi absurde, une loi ne planant plus, « implacablement », au-dessus de la nature, bref la « loi naturelle » – ces nouvelles exigences imposées à l’homme de l’époque, il lui était tout simplement impossible de s’y plier » (p.333). Le « Système technicien » (Jacques Ellul) s’est autonomisé. L’homme se contente de suivre la logique de ce système, de se mettre à son service pour qu’il se développe encore et toujours et, pour finir, de lui obéir aveuglément.
Au total, un livre qui secoue pas mal de cocotiers.
Voilà ce que je dis, moi.
FIN
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer, maigret, georges simenon, maigret et le clochard, la banalité du mal, goethe, méphisto faust, alain supiot
mercredi, 23 septembre 2015
L'HOMME OBSOLÈTE
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 3
Le Monde comme fantôme et comme matrice
Le monde qu’analyse cet essai est celui de la médiatisation triomphante de tout. Günther Anders parle seulement de la radio et de la télévision, mais je suis sûr qu’il ne verrait aucun obstacle à étendre ses analyses aux médias qu’une frénésie d’innovation technique a inventés depuis son essai (1956). Aujourd’hui, tout le monde est « connecté », au point qu’être privé de « réseau » peut occasionner de graves perturbations psychologiques.
Il commence par nier la valeur de l’argument habituel des défenseurs de la technique face à ceux qui s’indignent de certains « dommages collatéraux » : ce n’est pas la technique qui est mauvaise, ce sont les usages qu’on en fait (air connu). Cet argument rebattu fait semblant d’ignorer que « les inventions relèvent du domaine des faits, des faits marquants. En parler comme s’il s’agissait de "moyens" – quelles que soient les fins auxquelles nous les faisons servir – ne change rien à l’affaire » (p.118).
Notre existence, dit-il, ne se découpe pas en deux moitiés séparées qui seraient les « fins » d’une part, les « moyens » d’autre part. L’ « individu », par définition, ne peut être coupé en deux (cf. le jugement de Salomon). L’argument n’a l’air de rien, mais il est puissant. Conclusion, il est vain de se demander si c’est la technique qui est mauvaise en soi, ou les usages qui en sont faits ensuite : une poêle sert à griller des patates, elle peut servir à assommer le voisin qui fait du bruit à deux heures du matin.
Pour qui est familiarisé avec les critiques lancées contre la télévision dans la dernière partie du 20ème siècle, le propos de Günther Anders compose un paysage connu. Les Situationnistes en particulier, à commencer par Guy Debord, ont constamment passé dans leur moulinette virulente la « société spectaculaire-marchande ». Il n’est d’ailleurs pas impossible que Debord (La Société du spectacle date de 1967) ait picoré dans l’essai d’Anders (paru en 1956).
Si les films, marchandises standardisées, amènent encore les masses à se réunir dans des salles pour assister collectivement à la projection, la télévision semble livrer le monde à domicile. Pour décrire l’effet produit par ce changement, Anders a cette expression géniale : « Le type de l’ "ermite de masse" était né ». « Ermite de masse » est une trouvaille, chacun étant chez soi, en quelque sorte, « ensemble seul ».
On peut ne pas être d’accord avec l’auteur quand il met exactement sur le même plan radio et télévision, car la réception d’images visuelles change pas mal de choses. Le point commun réside dans l’action de médiatisation : l’écran de télévision, et dans une moindre mesure le poste de radio, littéralement, « font écran » entre le spectateur et la réalité concrète du monde, qui du coup n’est plus l’occasion d’une expérience individuelle par laquelle chacun teste sa capacité d’action sur celle-ci.
L’auteur le dit : le monde, qui est servi « à domicile », n’est plus que le « fantôme » de lui-même : « Maintenant, ils sont assis à des millions d’exemplaires, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas pour fuit le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde "en effigie" ». L’exagération ne peut toutefois s’empêcher de ressurgir : « Chaque consommateur est un travailleur à domicile non rémunéré [il faudrait même dire "payant"] qui contribue à la production de l’homme de masse ». Mais on a bien compris l’idée.
Autrement intéressante est l’idée que radio et télévision induisent l’établissement, entre la source et le récepteur (entre les animateurs du spectacle et les auditeurs et téléspectateurs) une « familiarité » pour le moins étrange, qui semble tisser entre eux des liens de proximité immédiate, du seul fait que ces voix semblent s’édresser à eux personnellement. On pense ici à tout ce que peuvent déclarer de charge affective et d’identification les consommateurs quand ils s’adressent aux animateurs par oral ou par écrit. De plus, ces liens apparents entraînent une relative déréalisation des proximités concrètes (exemple p. 148-149). Ces liens sont en réalité une grande imposture qui fait que l’ « individu devient un "dividu" » (p.157). C’est bien trouvé.
Anders évoque aussi l’espèce d’ubiquité que produit le média et la schizophrénie artificiellement produite qui en découle. S’il voyait aujourd’hui avec quelle attention fascinée passants, clients de terrasses de bistrots et passagers du métro fixent l’écran de leur téléphone, même marchant ou en compagnie, il serait encore plus catastrophé par le monde que les hommes ont continué à fabriquer.
Faisant semblant d’être ici (puisqu’ils « communiquent » et sont « connectés ») et faisant semblant d’être ailleurs (pour les mêmes raisons !), ils constituent une sorte d’humanité « Canada dry », cette boisson qui « ressemble à de l’alcool, mais ce n’est pas de l’alcool ». Voilà : ça ressemble à de l’humanité, mais ce n’est pas de l’humanité. L’incessante innovation technique au service de la marchandise tient l’humanité en laisse.
Je n’insiste pas sur le conditionnement du désir, en amont de la manifestation d’une volonté et d’une liberté, pour orienter celui-ci sur des marchandises. Je n’insiste pas sur le caractère impérieux, voire vaguement totalitaire, de cette façon d’imposer une représentation du monde (une idéologie) : « Que ma représentation soit votre monde » (p. 195), façon plus sophistiquée que celle qu’Hitler utilisait pour formater les esprits. Günther Anders suggère que le règne de la radio et de la télévision produit un autre totalitarisme.
L’essai Le monde comme fantôme et comme matrice (titre pastichant Schopenauer), par sa radicalité dans l’analyse de la radio et de la télévision, indique assez que son auteur n’attend rien de bon de l’évolution future de l’humanité et du sort que l’avenir, sous l’emprise de la technique, lui réserve.
Il serait désespéré que ça ne m’étonnerait pas. Sa réflexion, qui remonte à plus d’un demi-siècle, n’a en tout cas rien perdu de sa force.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer
mardi, 22 septembre 2015
L’HOMME OBSOLÈTE
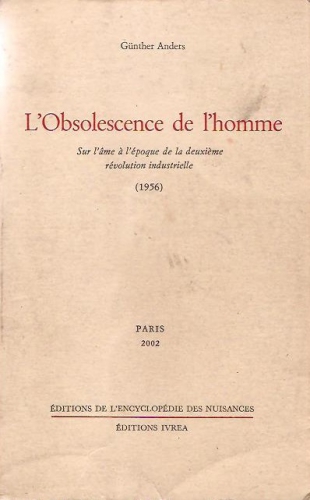 GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2
Je disais que, selon Günther Anders, l'homme n'est plus à la hauteur du monde qu'il a fabriqué.
Sur la honte prométhéenne
Le premier essai de l’ouvrage, développe cette idée. L’auteur parle de la réaction de son ami T. lors de leur visite à une exposition technique : « Dès que l’une des machines les plus complexes de l’exposition a commencé à fonctionner, il a baissé les yeux et s’est tu ». Il va jusqu’à cacher ses mains derrière son dos. L'auteur en déduit que T. est saisi de honte devant tant de perfection, honte motivée par la cruauté de la comparaison entre l’organisme humain, fait d’ « instruments balourds, grossiers et obsolètes » et des « appareils fonctionnant avec une telle précision et un tel raffinement ».
J’imagine que certains trouveront gratuite l’interprétation de l’attitude de T., mais je pense à une page de Zola (L’Assommoir ?), où Coupeau et Gervaise visitent une usine, page où Zola décrit les machines comme douées de vie propre, alors que les visiteurs semblent rejetés hors de l’existence. Et Coupeau, abattu et découragé après une bouffée de colère contre les machines, de conclure : « Ça vous dégomme joliment, n’est-ce pas ? ». C’est bien une réaction du même genre.
Moralité : l’homme est « inférieur à ses produits ». J’avoue que je me tapote le menton quand il énonce : « Avec cette attitude, à savoir la honte de ne pas être une chose, l’homme franchit une nouvelle étape, un deuxième degré dans l’histoire de sa réification ». Mais après tout, quand on sait ce que suppose l’apprentissage des gestes sportifs et la discipline requise dans les sports de haut niveau aujourd’hui, on est obligé de se dire que le corps des plus grands champions que les foules vénèrent s'est peu ou prou mécanisé.
Il est de notoriété publique que l’industrie européenne a été amplement délocalisée dans les pays à bas coût de main d’œuvre. Et que quand on parle aujourd’hui de « relocalisation industrielle », c’est pour installer des usines entièrement robotisées, où une quinzaine d’humains suffisent pour surveiller et maintenir en état, quand l’installation précédente, avant délocalisation, avait besoin de plusieurs centaines d’ouvriers. Et Günther Anders a publié L’Obsolescence … en 1956 ! L’homme devient l’accessoire de la machine.
De même, l’auteur attige quand il affirme : « … les choses sont libres, c’est l’homme qui ne l’est pas ». De même : « Il espère, avec leur aide, obtenir son diplôme d’instrument et pouvoir ainsi se débarrasser de la honte que lui inspirent ses merveilleuses machines ». C’est la qu’on voit à l’œuvre la méthode de « l’exagération ». Il y a visiblement, dans cette façon de prendre les perceptions ordinaire à rebrousse-poil, un goût du paradoxe et un désir de provoquer.
Il n’empêche que, quand on prend conscience de l’emprise de plus en plus grande des machines sur le cadre et les conditions de notre vie, on se dit que les caricatures et hyperboles formulées par Günther Anders recèlent leur part de vérité. Il est assez juste de soutenir comme il le fait que l’homme « n’est plus proportionné à ses propres productions », même si ce qu’il dit un peu plus loin de « l’hybris » (démesure, orgueil) le conduit à tenir un raisonnement alambiqué.
Ce qui reste très étonnant malgré tout dans la lecture de « Sur la honte prométhéenne », c’est que l’auteur pressent quelques conséquences de la frénésie d’innovation technologique. Je pense au clonage, évoqué indirectement dans un très beau passage : « Mais si on la considère en tant que marchandise de série, la nouvelle ampoule électrique ne prolonge-t-elle pas la vie de l’ancienne qui avait grillé ? Ne devient-elle pas l’ancienne ampoule ? Chaque objet perdu ou cassé ne continue-t-il pas à exister à travers l’Idée qui lui sert de modèle ? L’espoir d’exister dès que son jumeau aura pris sa place, n’est-ce pas une consolation pour chaque produit ? N’est-il pas devenu "éternel" en devenant interchangeable grâce à la reproduction technique ? Mort, où est ta faux ? » (p.69). Devenir éternel en devenant interchangeable, c’est à peu de chose près le programme du héros de La Possibilité d’une île, de Michel Houellebecq. Il suffit de remplacer par l’être humain l’objet fabriqué. Pour Anders, l’homme est inférieur puisqu’une telle immortalité lui est refusée : à son époque, le clonage était inconcevable.
Pour être franc, je ne suis guère convaincu, à l’arrivée, par le concept de « honte », qui me semble inopérant. L’expression oxymorique « honte prométhéenne » est à prendre (selon moi) pour un tour de force intellectuel, pour un jeu conceptuel virtuose si l’on veut.
Dernier point : tout le §14 est étonnamment consacré à la musique de jazz. Je ne sais pas bien à quel genre de jazz pense Günther Anders en écrivant. En 1956, la vague « be-bop » est encore bien vivante. Miles Davis (Ascenseur pour l’échafaud, 1957) et Ornette Coleman (Change of the century, 1959) vont bientôt donner quelques coups de fouet à cette musique. Inutile de dire que le développement est fait pour choquer l’amateur de jazz, à commencer par celui (dont je suis) qui préfère les petites formations fondées sur le trio rythmique, éventuellement augmenté d’un ou plusieurs « souffleurs », où les uns et les autres ne cessent de se relancer, de se répondre et de se stimuler.
Le §14 est intitulé « L’orgie d’identification comme modèle du trouble de l’identification. Le jazz comme culte industriel de Dionysos » (p.103). Je me demande ce qui prend à l’auteur d’affirmer : « La "fureur de la répétition", qui neutralise en elles tout sentiment du temps et piétine toute temporalité, est la fureur du fonctionnement de la machine » (p.104). Je me dis pour l’excuser que la techno n’existait pas : il faut avoir assisté (je précise : par écran interposé !) à une « rave party » pour avoir une idée modernisée de ce qu’est le « culte industriel de Dionysos ».
Désolé, M. Anders, rien de moins machinal que le jazz auquel je pense.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre
lundi, 21 septembre 2015
L’HOMME OBSOLÈTE
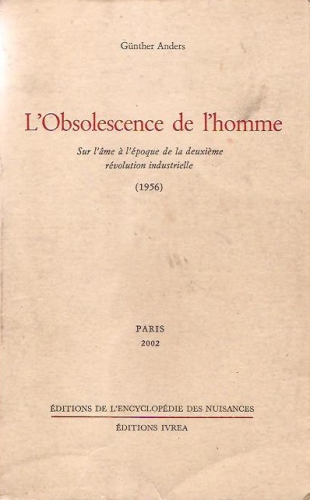 GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 1
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 1
L’Obsolescence de l’homme, (éditions de l’Encyclopédie des Nuisances + éditions Ivréa, Paris, 2002) du philosophe Günther Anders, voilà un livre qui m’a donné du fil à retordre (comme le montre ci-contre l'état de la couverture). Mais un livre important.
L’idée surgit au 20ème siècle : l’homme est désormais « de trop ». La preuve, l'homme (pas le même) est capable de l’éliminer en masse de 1914 à 1918, puis de 1939 à 1945. La preuve, Staline a supprimé sans doute cinquante millions de « mauvais soviétiques ». La preuve, les nazis furent les premiers industriels de la mort de populations civiles. La preuve, les Américains ont effacé de la surface de la Terre deux villes « ennemies », avec leurs habitants. D’autres preuves ne manquent pas, inutile d’énumérer.
Cette idée que l’homme a été rendu « superflu », je l’avais découverte en lisant Les Origines du totalitarisme, le grand ouvrage de Hannah Arendt. Pierre Bouretz la souligne dès son introduction (Gallimard-Quarto, 2002) : « Son horizon est un système dans lequel "les hommes sont superflus" » (p.151). Arendt enfonce le clou dans sa deuxième partie (« L’impérialisme »), attribuant à la « monstrueuse accumulation du capital » la production d’une richesse superflue et d’une main d’œuvre superflue (p.405). A deux doigts d'expliquer ainsi la concurrence colonialiste entre puissances européennes.
Je viens de trouver la même idée (pas tout à fait : "superflu" n’est pas "obsolète", mais le résultat est le même, répondant à la même question : « A quoi sers-je ? ») exprimée dans le dernier livre paru de Paul Jorion (Penser tout haut l’économie avec Keynes, Odile Jacob, septembre 2015), qui cite le célèbre économiste britannique : « Mais l’effet des machines des générations les plus récentes est toujours davantage, non pas de rendre les muscles de l’homme plus efficaces, mais de les rendre "obsolètes" » (p.94). Il écrivait cela en 1928. Que dirait-il aujourd’hui, où la numérisation bat son plein et où la robotisation avance par vent arrière et a sorti le spinnaker ?
Le livre de Günther Anders, sous-titré « Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle », publié en 1956, s’il n’invente pas la notion, la place en tant que telle au centre de la réflexion du philosophe. C’est du brutal. A noter que la notion d’ « obsolescence programmée » est inventée à la fin des années 1920, quand les fabricants d’ampoules lumineuses se rendent compte que si celles-ci sont éternelles ou presque (comme ils sont parfaitement capables de le faire), leurs entreprises ne survivront pas longtemps.
Je l’avoue : il m’arrive de lire des philosophes. J’exècre, je l’ai dit, les économistes qui jargonnent pour bien faire comprendre leur supériorité sur les gens ordinaires en usant de concepts sophistiqués et d’un vocabulaire amphigourique. C’est la même chose pour la psychanalyse : Lacan me fait rire, contrairement à quelqu’un comme Didier Anzieu, qui n’abrite pas son « autorité » derrière un sabir ou un volapük motivé selon lui par l’extrême précision technique que requiert sa discipline.
C’est encore la même chose avec les philosophes. Je ne suis pas familier de la discipline, mais il m’arrive d’en fréquenter, tout au moins parmi ceux qui me paraissent fréquentables, dans la mesure où ils écrivent pour être compris du commun des mortels, et non du seul petit cercle de leurs confrères spécialistes de la spécialité. Pour rendre intelligible leur pensée, en rédigeant en « langue vulgaire », c’est-à-dire – au sens latin – la langue « commune à tous ».
Ce qui est curieux (et qui rend la lecture tant soit peu ardue), avec le livre de Günther Anders, c’est qu’il cumule. Je m’explique. Il s’exprime dans une langue très accessible, sans toutefois s’interdire de recourir à l’occasion au dialecte propre à quelques philosophes (Hegel, Heidegger, …). Mais il accroît la difficulté : le contenu même des idées est fait pour rebuter le lecteur, dans la mesure où celui-ci se retrouve démuni et perdu, faute d’apercevoir quelques points de repère grâce auxquels il ait l’impression d’être en terrain connu. Indéniablement, on a à faire à un original authentique. L’éditeur le déclare d’entrée de jeu : si la traduction française paraît près d’un demi-siècle après l’édition allemande, « La difficulté du texte y est certainement pour quelque chose … ».
Anders (pseudo signifiant « autre », son vrai nom étant Stern) est un philosophe de toute évidence marginal, à cause de sa radicalité, et surtout à cause d’une « méthode » pour le moins idiosyncrasique. Il revendique en effet le droit à l’exagération comme méthode. Il justifie ce choix en comparant sa recherche à celles que mène un virologue, dont l’outil principal est le microscope : que serait une « virologie à l’œil nu » (encyclopédie en ligne) ?
L’argument semble d’autant plus valable qu’il soutient que ce n’est pas lui mais le monde dont il parle qui exagère : ce qu’il écrit « … n’est que l’exposé outrancier de ce qui a déjà été réalisé dans l’exagération » (p.35). Il le dit ailleurs : l’humanité a commencé à fabriquer « un monde au pas duquel nous serions incapables de marcher ». La grande idée qui traverse tout l’ouvrage est que certes, par son génie, l’homme a élaboré un monde qui tend à se rapprocher des œuvres divines, mais que, par sa nature, il en reste à jamais « pas à la hauteur ».
« L’homme est plus petit que lui-même » est d’ailleurs le titre d’un des chapitres. Le pataphysicien pense bien sûr au chapitre IX du livre II de Faustroll : « Faustroll plus petit que Faustroll ». « Tout est dans Faustroll », s’écriait d’ailleurs le docteur Irénée-Louis Sandomir (fondateur du Collège de 'Pataphysique), pour bien signifier qu’Alfred Jarry reste un grand précurseur.
L’homme n’est pas à la hauteur du monde qu’il a fabriqué à partir du 20ème siècle. Il y faudrait, comme dit Jarry, un SURMÂLE, du type d'André Marcueil.

Dessin de Pierre Bonnard pour Le Surmâle, d'Alfred Jarry.
Mais il n'y a pas de surmâle, comme le montre la baudruche appelée indûment Superman. Comme par hasard américaine.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les rigines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique
vendredi, 03 avril 2015
HOUELLEBECQ PAR NOGUEZ
1/2
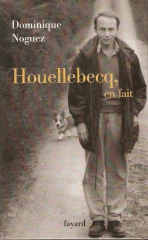 Sur l’œuvre de Michel Houellebecq, nul ne peut apprendre à Dominique Noguez quoi que ce soit qu’il ne sache déjà. Rien de ce que l’écrivain a publié ne lui est étranger. Et si l’on admet que l’un et l’autre sont de véritables amis (aucune raison d’en douter), on se dira que Dominique sait de Michel des choses qu’il ne mettra jamais sur la place publique. Je l’espère en tout cas. C’est aussi ce que je me disais de la relation de Bernard Maris avec l’auteur des Particules élémentaires, que je n'ai d'ailleurs apprise qu'au moment de son assassinat.
Sur l’œuvre de Michel Houellebecq, nul ne peut apprendre à Dominique Noguez quoi que ce soit qu’il ne sache déjà. Rien de ce que l’écrivain a publié ne lui est étranger. Et si l’on admet que l’un et l’autre sont de véritables amis (aucune raison d’en douter), on se dira que Dominique sait de Michel des choses qu’il ne mettra jamais sur la place publique. Je l’espère en tout cas. C’est aussi ce que je me disais de la relation de Bernard Maris avec l’auteur des Particules élémentaires, que je n'ai d'ailleurs apprise qu'au moment de son assassinat.
Le point commun entre Bernard Maris et Dominique Noguez, c’est qu’ils ont publié des choses sur Houellebecq, mais il m’étonnerait fort que leurs liens aient été très étroits. Je ne sais rien de la vie privée de Bernard Maris, mais je ne le vois pas fréquenter les mêmes cercles que Noguez. J’ai évoqué ici Houellebecq économiste (11-12, puis 29-30 mars), écrit par le premier. Je viens de lire Houellebecq, en fait, du second. Je n’aurais peut-être pas dû.
Je l’avoue, je ne connaissais rien de l’œuvre littéraire de ce monsieur. J’ai découvert que, comme il a travaillé sur Alfred Jarry, il ne saurait être entièrement mauvais. En effet, si j’en crois la rubrique « Du même auteur », il a publié L’Arc-en-ciel des humours. Jarry, Dada, Vian, etc..
Jarry, c’est bien, c’est la ‘Pataphysique, c'est l'invention du Curateur Inamovible du Collège, un Docteur riche de vingt-sept chefs d'œuvre de la littérature en butte aux tracasseries d'un huissier au nom inoubliable ; un Docteur qui pisse dans des bateaux qui flottent tout en étant percés ; un Docteur qui va "de Paris à Paris par mer" tout en restant sur la terre ferme, tout en persécutant un singe papion intitulé Bosse-de-Nage et qui ne sait dire que "Ha ha", bref : quelqu'un de bien.
Vian, ce n’est pas mal, bien que ce soit, en 'Pataphysique, une pièce rapportée. Son Mémoire concernant le calcul numérique de Dieu par des méthodes simples et fausses est finalement bien laborieux, comparé au chapitre "De la surface de Dieu", dans le Faustroll de son glorieux prédécesseur.
Je ne peux m'empêcher de voir dans Boris Vian ou Raymond Queneau des écrivains surévalués (une certaine idée de la modernité, tout ça ..., pardon aux mânes de Noël Arnaud), mais bon, admettons ; en revanche, pour Dada, je me demande un peu ce qui lui prend, à Noguez : pas de vide humoristique plus abyssal que chez Dada (ainsi que chez André Breton). Mais j’irai sans doute mettre le nez dans son bouquin : je ne demande qu’à m’instruire.
En attendant, l’ouvrage qu’il consacrait à son ami Houellebecq en 2003 m’a somme toute intéressé, même si j’ai des reproches à lui faire. D’abord, je regrette d’avoir découvert quelques aspects de la personne privée de Michel Houellebecq. La peste soit de la "société du spectacle" et de tous les Gustave Lanson ou Bernard Pivot, l’un parce qu’il a fait de la loi dichotomique de « L’homme-et-l’œuvre » un parcours obligé, l’autre à cause de sa manie d’interroger les écrivains qu’il invitait sur son plateau sur la part d’eux-mêmes qu’ils avaient mise dans leurs livres de fiction, vous savez, ces bouquins qui portent sur la couverture la mention "roman".
 Je me fiche de savoir ce qu’éprouve un poète ou un écrivain dans sa vie privée, à quelle heure il se couche, la boisson qu’il préfère (taux d'alcool, état après imbibition, sortie du coma, ...), sa façon d’aimer, que sais-je. Viendrait-il à l’idée de Pivot de demander à Jean Nouvel quelle part de lui figure dans le futur immeuble Ycone qu’il a dessiné pour la Confluence à Lyon (ci-contre) ? A voir le projet, j’aime à croire, pour la seule préservation de son équilibre psychique, que la réponse serait : « Rien ».
Je me fiche de savoir ce qu’éprouve un poète ou un écrivain dans sa vie privée, à quelle heure il se couche, la boisson qu’il préfère (taux d'alcool, état après imbibition, sortie du coma, ...), sa façon d’aimer, que sais-je. Viendrait-il à l’idée de Pivot de demander à Jean Nouvel quelle part de lui figure dans le futur immeuble Ycone qu’il a dessiné pour la Confluence à Lyon (ci-contre) ? A voir le projet, j’aime à croire, pour la seule préservation de son équilibre psychique, que la réponse serait : « Rien ».
Quand la vie et la personne d'un artiste deviennent un spectacle, son œuvre a du mouron à se faire pour son avenir : qu'y a-t-il de plus futile et combustible que la vie d'un individu, fût-il artiste ? Depuis l'aube de la curiosité humaine pour le monde, ce qui reste d'un individu, c'est son œuvre. Et encore : la plupart sont purement et simplement effacés de la surface et des mémoires. Le "devoir de mémoire" est une fumisterie.
Je me contrefiche d’apprendre quoi que ce soit d’autobiographique sur le bonhomme qui a tenu la plume : je sais pertinemment qu’un auteur se sert forcément, pour écrire un roman, du matériau qu’il connaît le mieux (quoique …) et qu’il a le plus directement à disposition sous la main : lui-même.
Les plus grandes œuvres de l'art et de la littérature sont composées à 100 % du bonhomme, auxquels s'ajoutent les 100 % de l’art qu’il y a déployé. Aux petits comptables, aux Lagarde-et-Michard, aux chefs de bureau et aux médecins légistes de faire ensuite le départ et de disséquer. La littérature commence après la question : qu’en a-t-il fait, de ce matériau ? Qu'est-ce que ça donne à l'arrivée ? Quel édifice a-t-il construit ? De quelle œuvre est-il l’auteur ?
Étonnant comme les animateurs, journalistes, "critiques", dans les "talk shows" (pardon) qui jalonnent la « tournée de promo » obligatoire, sont capables d’interroger les écrivains sur ce qu’ils sont (personnalité, penchants, musiques et yaourts préférés et autres fadaises genre questionnaires Proust) éprouvent, aiment, détestent, pensent, mais rarement sur ce qu'ils font, je veux dire sur les caractéristiques proprement littéraires du livre qu’ils viennent d’écrire.
La littérature n'intéresse guère les critiques littéraires. Ils veulent du vivant, de la tripe, du saignant. Au fond, le spectacle télévisuel qu'a fini par imposer "Apostrophes", a définitivement donné la priorité à « l'homme » sur « l'œuvre ». Et parmi les invités de Pivot, priorité au meilleur camelot vendeur de salade (à preuve les ventes en librairies dès le lendemain).
Voilà le rideau que je regrette d’avoir soulevé sur la personne privée qu’est Michel Houellebecq, d’autant qu’en plusieurs occasions, l’écrivain est loin d’être présenté à son avantage (l’état dans lequel il s’est mis quand il entre au "Queen", sur les Champs-Elysées !). Parfois, c’est même pire. A cet égard, je me permets de trouver ce livre bien indiscret. De la part d’un qui se dit son ami, c’est plutôt malvenu, je trouve.
Le deuxième reproche que je fais à Noguez, c’est de montrer les coulisses du petit bocal où évoluent les cyprins de la littérature parisienne : repas en ville, réceptions, soirées, copinage en bande, éditeurs, organes de presse, impression que tout le monde se connaît. J’imagine que l’auteur, par son ancienneté dans le métier ou par ses fonctions dans la profession, a tissé des relations multiples. La description des mœurs de ce petit monde parisien, avec énumération des gens présents ou rencontrés, rend celui-ci tout au plus antipathique. On n'est parfois pas loin de la rubrique mondaine et des pages "pipeul".
Je me moque éperdument de croiser au détour des pages des gens comme Arnaud Viviant, le péremptoire rayonnant du Masque et la Plume. Par curiosité, on peut se reporter au traitement de faveur que le grand Philippe Muray fait subir à ce « roquet des Inrocks » dans Après l’Histoire II (Essais, Belles Lettres, p. 451-452). Sa majesté Philippe Sollers a lui aussi une place de choix dans le bouquin : rien que le nom de ce type me rendrait presque la lecture pénible. Bon, c’est vrai que ces messieurs font partie des défenseurs de Houellebecq. Je me demande bien pour quelle raison.
Pour moi, Houellebecq et Sollers n'ont pas grand-chose à faire sur le même plateau. Mais peut-être qu'après tout, le second reconnaît en le premier un maître. Allez savoir.
Je ne parle pas de Viviant. Evidemment.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, dominique noguez, particules élémentaires, bernard maris, houellebecq économiste, houellebecq en fait, l'arc en ciel des humours, docteur faustroll, bosse-de-nage, pataphysique, collège de pataphysique, boris vian, raymond queneau, noël arnaud, dada, dadaïsme, gustave lanson, bernard pivot, lagarde et michard, jean nouvel ycone, lyon la confluence, devoir de mémoire, questionnaire proust, émission apostrophes, philippe sollers, philippe muray, arnaud viviant, les inrockuptibles
lundi, 30 mars 2015
IL N’Y A PAS DE "SCIENCE ÉCONOMIQUE"
2/2
Je parlais de l'infirmité des pompeusement nommées « Sciences Humaines », qui ne portent le nom de sciences que par abus de langage. L'expression porte probablement le stigmate de son origine : le scientisme, cette croyance absolue dans le pouvoir de la science de résoudre tous les problèmes de l'humanité, imprégna jusqu'au coeur la moindre fibre de la seconde moitié du 19ème siècle.
Flaubert l'a personnifié sous les traits du pharmacien Homais, dont il a fait le masque de la bêtise satisfaite, la bêtise de « celui qui sait ». Parlant de je ne sais plus qui, Clémenceau disait joliment : « Il sait tout, mais rien d'autre ». Flaubert a tout compris : Bouvard et Pécuchet, me semble-t-il, ayant fait le tour du savoir encyclopédique, reviennent humblement pour finir à la tâche que s'assignaient les moines copistes du moyen âge.
Les « sciences molles » (le Collège de 'Pataphysique les appelle plus justement les « Sciences Inexactes », par opposition aux « Sciences Exactes », dites dures qui, elles, s'efforcent à l'exactitude) se sont empressées de se ranger sous cette bannière, qui leur conférait une dignité dont elles n'auraient jamais osé rêver sur leurs seuls mérites.
Sans pouvoir toutefois effacer le stigmate que constitue l'adjectif qualificatif "humaines" : quand on est obligé d'ajouter l'adjectif, c'est que son absence porterait à confusion. Quand on entre dans une « Faculté des Sciences », aucun doute sur les disciplines qu'on y enseigne, d'où l'absence d'adjectif.
Mais tout le monde a laissé faire, par pitié envers les « Sciences Humaines », ces cousines disgraciées, qu'on invite de temps en temps, le dimanche, parce qu'il faut bien se montrer un peu magnanime avec le pauvre monde. Ainsi l'habitude a été prise, et j'imagine que le 20ème siècle n'a jamais voulu, osé ou pu rétablir la vérité. Monsieur Homais est entré au Collège de France et à l'Académie Française. Il fait autorité. Alors même qu'il faudrait peut-être renommer les « Sciences Humaines » les Sciences Fausses.
Car le vice rédhibitoire dont souffrent les « Sciences Humaines », c’est précisément l’Homme, avec ses désirs, ses calculs, son hypocrisie et sa sincérité, ses manœuvres, ses intérêts particuliers, ses audaces et ses peurs, ses haines et ses amours, ses constructions comme ses destructions, bref, sa LIBERTÉ. C'est-à-dire ce dont sont démunies les forces aveugles et déterminées de la nature.
Non, l’économie n’est définitivement pas une science. Je n’énonce pas une énormité obscène : écoutez pour vous en convaincre l’émission de Dominique Rousset, le samedi sur France Culture. Quel que soit le thème choisi (dans l’actualité), vous les entendez, au bout d’un temps plus ou moins long, se chamailler. Deux économistes ne seront jamais entièrement d'accord.
Je rêve de les voir un jour en venir aux mains et, pourquoi pas, s'entretuer, pour qu'on s'amuse un peu. Vous imaginez, un combat à la loyale, à l'épée, « sur le pré », entre John Maynard Keynes et Milton Friedman ? Mais ils ne sont pas assez fous pour cela : ils se disent qu'un tel spectacle tuerait la poule aux œufs d'or, le « métier ». Il faut rester "digne", et pour cela, courtois et bien élevé. Propre.
Leurs désaccords n'en sont pas moins irréductibles. Ceci pour une raison très simple : l'étiquette "économiste" dissimule en règle très générale une tout autre personne que celle qui se donne pour spécialiste de ceci, expert en cela, capable d'assener (si, si, sans accent, c'est légal !) à toute la population du public terrorisé les certitudes absolues qu'il a acquises dans le domaine dont il se déclare le maître.
Cette personne est celle du militant politique. Les théories sur lesquelles ces gens s'appuient sont l'exact reflet du système politique dans lequel ils rêvent de les appliquer. En gros, sur le ring où ils s'affrontent, ça donne John Maynard Keynes contre Milton Friedman. Traduction : l'intérêt général contre les intérêts privés. Marx contre le Capital, si vous préférez.
Un économiste neutre est aussi crédible que ma sœur en monstre du Loch Ness. Il n'y a pas d'économie a-politique, mais des modèles d'organisation sociale qui s'affrontent : où faut-il placer le point d'équilibre entre les intérêts particuliers et l'intérêt supérieur du corps social dans son entier ? A qui et à quoi donner la priorité ? L'entrepreneur ou la collectivité ? L'efficacité économique ou la justice sociale ? Quand commence l'accaparement de la richesse ? Comment une société décide-t-elle de la façon dont elle veut vivre ?
Soit dit en passant, la logique à l'oeuvre dans le système actuel, et qui tend à imposer sa volonté aux Etats, elle est limpide : mettez en face le chiffre toujours plus impressionnant des pauvres qui ont besoin des Restos du cœur ou des Banques alimentaires pour survivre et le chiffre toujours plus astronomique des fortunes amassées par le centile des plus riches de la planète. Cela vous donne une idée de la montée irrésistible de l'Injustice. Or on sait que l'injustice produit immanquablement, à plus ou moins long terme, la violence.
Pas d'économiste objectif, donc : une théorie économique ne peut faire autrement que d'être au service de l'idée qu'on se fait de la société. Vous pouvez aisément vérifier. S’ils sont, en gros, d’accord sur le constat (il suffit de lire les journaux, les statistiques du chômage, les fermetures d’usines, …), dès qu’on aborde l’analyse des causes ou les propositions de solutions, rien ne va plus. Il m’est arrivé d’entendre des disputes homériques entre les quatre « scientifiques » invités par Dominique Rousset. J’ai fini par les abandonner à leur triste sort. Pas d'économie sans choix de société. D'où leurs disputes interminables.
Imagine-t-on se disputer ainsi deux physiciens évoquant l’existence du « boson de Higgs », dont le LHC du CERN a apporté la preuve (deux vrais spécialistes du climat évoquant le « réchauffement climatique » feront très bien l’affaire) ? Et tout le monde est d'accord pour traiter d'hurluberlu indépassable ce « scientifique » arabe (ou musulman, je ne sais plus, peut-être les deux) qui vient de décréter que la Terre est plate. Résumons : il y a des acquis irréfutables de la Science. Il n'y a pas de preuve définitive en économie.
Si l'économie était une science, un consensus finirait par s’établir entre « experts », exactement de la même manière que s’est établi le consensus des milliers de scientifiques du GIEC sur le climat, après la recension faite de l'intégralité de la littérature scientifique consacrée au sujet. Je compte pour rien les vociférations du gouverneur de Floride, Rick Scott, qui interdit aux fonctionnaires de son administration de prononcer l’expression « réchauffement climatique » (Le Monde, 24 mars), et autres élucubrations des « climatosceptiques ».
A ce propos, on peut cliquer sur le lien avec l'article : je conseille vivement la vidéo - 2'07" - désopilante : il faut voir quelques sénateurs américains se payer une bonne tranche de rigolade aux dépens du gars interrogé, tout propre sur lui et souriant, tournant autour de la formule taboue, mais complètement emberlificoté dans le ridicule à cause de la consigne reçue de ne pas la prononcer.
Malheureusement, si l'économie n'est pas une science, trop de gens riches et puissants ont intérêt à ce que tout le monde le croie quand même, malgré tous les démentis que leur inflige la réalité. Avec l'appui de quelles complicités les « Usurpateurs » (titre du dernier livre de Susan George sur le même sujet, voir ici même, 17 mars) ont-ils réussi à imposer dans les esprits l'expression "Prix Nobel d'économie", au mépris pur et simple des volontés testamentaires d'Alfred Nobel ? Le testament instaure cinq prix (Physique, Chimie, Médecine, Paix, Littérature), pas un de plus. C'est ce que Bernard Maris dénonce en p. 15 de Houellebecq économiste, livre polémique, c'est certain, mais tout à fait salutaire et nécessaire.
Voire indispensable. Et peut-être même utile. « Économiste sérieux » est un oxymore. La seule spécialité de l'économiste : l'enfumage.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, france, science économique, sciences humaines, flaubert, madame bovary, pharmacien homais, collège de pataphysique, collège de france, académie française, dominique rousset, france culture, john maynard keynes, milton friedman, karl marx le capital, restos du coeur, banques alimentaires, boson de higgs, cern lhc, réchauffement climatique, giec, gouverneur de floride rick scott, journal le monde, les usurpateurs susan george, prix nobel d'économie, michel houellebecq, houellebecq économiste, bernard maris, littérature
lundi, 19 janvier 2015
POUR WOLINSKI, ORATEUR PAR ECRIT
CABU, WOLINSKI, REISER ET LES AUTRES (3)
WOLINSKI, LE SCEPTICISME ÉCLAIRÉ
Non, je l'ai dit ici même (le 9 janvier), je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas Cabu, ni Wolinski, ni aucun des autres. En dehors du deuil que je ressens après leur mort, je crois en revanche que ces meurtres, accomplis avec quel sang froid ..., sont d'une gravité sans précédent pour la France en tant que nation.
Et je penserais de même si je me disais qu'après tout, la disparition de la revue médiocre et basse de plafond qu'était devenu Charlie Hebdo ne serait pas un si grand drame. Raison de plus pour poursuivre la comparaison avec son vieux père, lui aussi hebdo, lui aussi Charlie, celui qui a défunté en 1981 faute de lecteurs.
Cabu, donc, a été assassiné. Wolinski a été assassiné. Je n’en reviens pas. Pour Wolinski en particulier, je crois qu’il serait resté incrédule si une voyante ou une diseuse de bonne aventure lui avait prédit qu’il mourrait pour ses idées, lui qui a publié aussi bien dans L’Humanité que dans Paris Match,

sans compter les innombrables collaborations, ponctuelles ou durables.
Des idées, vraiment ? Georges Brassens le dit : « Mourir pour des idées, L'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue ». Wolinski, au fond, regardait avec un recul et un scepticisme certains les affrontements proprement politiques.
Wolinski avait un cœur politique d'artichaut : il donnait une feuille dessinée à tout le monde (il devait connaître la chanson de Tonton Georges "Embrasse-les tous").
Et s'il avait des idées, il n'a sûrement jamais eu celle de mourir pour elles. Avait-il seulement des convictions ? Certainement et je n'en doute pas, au moins pour ce qui est de vivre joyeusement et entouré de jolies femmes. Pour les idées politiques, j'en doute avec force. Je peux me tromper : je ne le connaissais pas personnellement.

Pour les collaborations, je me garde bien de mettre Charlie Hebdo dans le même sac. On ne peut pas faire de Wolinski un simple collaborateur de Charlie Hebdo. Il a fait partie en effet de la grande équipe de Hara Kiri dès 1960 ; il a succédé à Gébé à la direction de Charlie, le fabuleux mensuel de bandes dessinées auquel il a donné une aura de gloire qui en fait un objet de collection bien connu des amateurs ;

il a pris en charge Charlie Hebdo première manière (1970-1981) après la mort de De Gaulle et l’interruption brutale de l’hebdo Hara Kiri. Bref, c’est un pilier de la boutique qui a dû être bien étonné de mourir sous les balles de fanatiques.

Mettons-nous d’accord, pour commencer : on me dira ce qu’on voudra, mais si Wolinski dessine, ce n’est certainement pas un dessinateur. Attention : ça ne l’empêche pas d’avoir un style de trait qui le rend immédiatement reconnaissable. Son truc à lui (comme à Cabu et Reiser), c’est d’être efficace.

Ce qui compte, c’est l’effet produit. Et Wolinski, avec les moyens graphiques qui sont les siens, parvient avec une aisance stupéfiante à son but. Comment ? Il ne s'encombre d'aucun accessoire inutile. Il va droit à son but : le propos qu'il veut tenir. Son économie de moyens ne l’empêche pas d’obtenir une étonnante expressivité et de mettre dans ses schémas de personnages assez de signes distinctifs pour les caractériser.

Est-ce qu'elle n'est pas géniale, cette formule ?
Son art à lui tient à autre chose que la virtuosité du trait. Wolinski, en dehors d’être l’érotomane accompli que tout le monde connaît, quand il ne fait pas l’éloge du cul des Cubaines, je veux dire quand il travaille pour un journal, il devient un très grand inventeur de situations.

Wolinski est avant tout un maître de logique. Les raisonnements qu’il élabore autour des questions les plus diverses sont des enchaînements irrésistibles de propositions successives, qui aboutissent invariablement à des conclusions au moins paradoxales, souvent loufoques et pleines de bon sens. Quand on arrive au bout, on se pose la question, ahuri et stupéfait : « Mais comment a-t-il fait pour arriver là ? ».

Du temps où j’achetais assidûment Charlie Hebdo, j’aimais énormément la page ou la colonne où il mettait face à face deux personnages assis devant un verre. Tout se passait dans les bulles.

L’art de Wolinski, c’est d’abord des petits bijoux de textes ouvragés et découpés par un orfèvre en matière de raisonnement. Il élabore des suites de propositions qu’il raboute l’une à l’autre de manière que l’enchaînement paraisse évident, et en bout de course, il vous pulvérise une cible inattendue. Vous n’avez pas vu venir. Et là, vous dites : « Chapeau ! ».

C’est ça que je retiens de Wolinski : son génie du discours construit, rationnel et raisonnable, mis au service de la mise à distance de tout ce qui est idéologie, doctrine, système ou théorie (les « – ismes »).

La vie, l’amour, les femmes : ma foi, ce credo vaut tous les autres. Wolinski aurait pu être pataphysicien. Il l’était sûrement (tout le monde l’est). Peut-être même faisait-il partie de la toute petite élite des « pataphysiciens conscients ».

Si ce n’est pas le cas, nul doute qu’il eût mérité d'être « élevé à la dignité » de Transcendant Satrape. A ne confondre en aucun cas, comme chacun est invité à le savoir, avec la fonction de Vice Curateur. Encore moins avec celle de Curateur Inamovible.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : cette série de Wolinski, c'est la page 2 du Charlie Hebdo n°90 du lundi 7 août 1972. La "Une" est de Reiser.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, wolinski, reiser, charlie hebdo, journal l'humanité, paris-match, georges brassens, mourir pour des idées, embrasse-les tous, hara kiri, gébé, hara kiri hebdo, de gaulle, collège de pataphysique, transcendant satrape
mardi, 05 novembre 2013
HENRI BOSCO : HYACINTHE (suite et fin)
Hyacinthe, de Henri Bosco.
« Maintenant l’hiver me donnait un pur paysage moral détaché de la terre. La moindre branche s’y dessinait, grêle et précis ; et j’avais un plan de candeur où placer les figures de l’âme. Sur cette surface à peu près irréelle, j’imaginais à mon usage, une géométrie sentimentale, où les courbes du souvenir, du regret, de l’espoir, semblaient formulées par une intelligence tendre. Nul obstacle. J’avais fourni aux opérations de mon âme une surface issue de l’âme même. Les constructions les plus hardies tout à coup devenaient possibles. Dans un monde où plus rien n’arrêtait le développement de mes desseins, l’agilité de mon esprit acquit alors une aisance inattendue. J’errais autant et plus vite que jamais. Je m’étais délesté de ces voluptés qui vous traînent ou vous ralentissent. Rien ne me tentait plus. En moi ne survivait qu’une passion plus légère que moi. Je ne vivais plus dans les formes colorées ; les odeurs m’atteignaient à peine ; et je me tenais, par miracle, au cœur d’une lucidité éclatante et fragile. Mon esprit pénétrait partout, et je me voyais. »
Je tenais à citer ce passage un peu long (qui incitera peut-être, allez savoir, mon lecteur à ouvrir Hyacinthe) pour donner une idée de la chose. Henri Bosco, dans plusieurs de ses livres, met ainsi en scène des personnages qui se demandent combien ils sont à l’intérieur d’eux-mêmes, et si ce n’est pas un autre, un étranger qui, au-dedans, est le vrai maître des lieux. On lit même ceci : « Mes souvenirs ne me reconnaissaient pas » (p. 168). Bien sûr l’auteur veut signifier par là qu’il est devenu un autre, mais j’y vois aussi l’afféterie de quelqu’un qui « fait des manières » et des préciosités.
J’avoue être moi-même assez étranger à ce genre de questionnement et aux problématiques qui en découlent. Il me semble qu’il y a, dans une telle interrogation, quelque chose qui ressemble à une « angoisse de nanti ». Je ne méprise certes pas, à cause des dimensions éventuellement métaphysiques auxquelles elles conduisent, mais pour mon propre compte j’y vois des questions oiseuses.
Et puis il y a Hyacinthe, évadée du mystérieux et immense domaine de Silvacane, alias « Le Jardin », dont le maître est un vieillard (tiens tiens). Elle fait irruption à « La Commanderie » le soir du 25 décembre. Quand on a lu les évocations d’Hyacinthe dans les autres ouvrages, il faut comme qui dirait un « temps d’accommodation », car la dernière fois que je l’ai croisée, c’était une fillette d’une dizaine d’années, petit animal vidé de son âme, qui ne faisait que si on lui disait de faire. Ici, le narrateur a à faire avec une femme jeune et belle (et ardente).
Ailleurs, je me souviens d’une fillette joueuse et impérieuse. Bref, c’est compliqué. Je ne suis même pas sûr qu’en raboutant tous les morceaux épars de l’histoire d’Hyacinthe comme les pièces d’un puzzle, on arriverait à une image homogène. J’avoue que le personnage m’intrigue beaucoup, même si j’ai un doute quant à la cohérence (et à une autonomie possible) de l’ensemble des données fournies par l’auteur au fil des livres. Mais que cela puisse intriguer (à force de récurrence du thème) est déjà le signe d’une réussite romanesque.
Hyacinthe est publié en 1940. Le narrateur n’est jamais nommé. Celui du Jardin d’Hyacinthe (1946), en revanche, s’appelle Méjan de Mégremut. Et, après avoir fait figurer le passage de L’Âne Culotte où M. Cyprien, le vieillard magicien, kidnappe la fillette de « La Saturnine » après s’être rendu maître de son esprit, le narrateur prend ses distances avec son « concurrent » du premier livre : « Car cette histoire a déjà été racontée, mais d’une manière bizarre. (…) Cette fille n’y apparaît que comme un fantôme impalpable. D’où vient-il, où va-t-il ? on ne sait. Il semble ne surgir du milieu de ces brumes que pour donner un corps, fût-il fugitif et décevant, aux rêveries effrénées de cet homme – d’ailleurs anonyme – qui prétend en dire l’histoire ». Bosco s’amuserait à brouiller les pistes qu’il ne s’y prendrait pas autrement.
Mais je l’ai dit, dans Hyacinthe, il n’y a pas qu’Hyacinthe. Il y a aussi et surtout le narrateur envahissant, avec le poids, la surface et l’opacité de ses états d’âme. J’imagine qu’il s’écrit des tas de thèses universitaires épaisses comme des encyclopédies qui s’écrivent sur Henri Bosco. Dans le tas, ce serait bien le diable si l’une au moins n’avait pas pris pour sujet central un thème presque central de l’imaginaire de l’auteur : la convalescence.
Que de convalescences, en effet, chez les narrateurs de Bosco ! Souvent elle suit un moment d’exacerbation nerveuse qui va jusqu’à produire un délire, aboutissant à un évanouissement. Mais à chaque fois, une mystérieuse main secourable intervient pour retirer la personne de la zone de danger, la mettre à l’abri et en prendre soin jusqu’au rétablissement.
Je comprends bien pourquoi la convalescence (plus ou moins prolongée) attire le romancier : c’est un état intermédiaire de la conscience, où celle-ci, rendue poreuse à l’extrême par la maladie proche, hésite entre le délire et le discours de la raison. Toutes les ambiguïtés sont alors permises, y compris les hallucinations présentées comme vérités et les observations présentées comme illusions. Durant la convalescence, la conscience est essentiellement réversible entre ces deux états. Et je ne doute pas que l’expérience personnelle de l’auteur en la matière soit la source directe des récits de convalescence qu’on trouve (un peu trop) souvent chez lui.
Les narrateurs de Henri Bosco sont, à n’en pas douter, une espèce fragile des nerfs. Obnubilé par son désir de voir au-delà des apparences, le narrateur « boscien » perd facilement celles-ci de vue, pour se laisser conduire par des forces qui en font la victime désignée de celles qui s’affrontent hors de lui, au-dessus de lui. Il en réchappe de justesse (L’Antiquaire, Un Rameau de la nuit, …), et puis sa conscience se recompose.
La convalescence du narrateur, dans Hyacinthe, montre celui-ci très faible, après avoir échappé à la mort dans des circonstances à la limite du crédible (une glissade dans la neige le projette dans la cave d’une maison où se réunissent les Caraques qui lui veulent du mal). Mais je ne suis pas contrariant. La convalescence dure, dure, dure. On comprend qu’il n’est plus à « La Commanderie », mais à « La Geneste », entre les mains fidèles et discrètes du couple de vieux serviteurs de l’ « autre ».
Le dernier épisode met en scène la rencontre entre le narrateur et le mystérieux maître du mystérieux domaine de Silvacane (j’espère qu’on excusera et comprendra l’obsédante apparition du mot « mystérieux »), appelé tantôt le « Jardin », tantôt le « Paradis ». Cyprien est très vieux : « … si vieux que j’ai fatigué la vieillesse » (encore une coquetterie de formule). Il livre à l’anonyme qui l’écoute quelques explications.
Tout ce qu’il a fait, il l’a fait par amour. Il comptait sur Hyacinthe (qu’il a volée) pour récupérer Constantin Gloriot. Il a échoué. Il espère qu’Hyacinthe et Constantin seront assez malheureux dans leur vie terrestre pour décider de se retrouver au « Jardin » et y refonder le « Paradis ». Et c’est alors qu’il aura leurs âmes. Il précise aussitôt que ce n’est pas pour son propre compte (mais alors pour le compte de qui ?).
Si j’ai bien compris (ce qui n’est pas sûr), la leçon de tout ça est que tous ceux qui manifestent le projet de refonder le paradis sur terre sont des gens dangereux. Si quelqu’un a une autre explication, merci d’avance. Je suis personnellement bien convaincu que vouloir sauver l'humanité c'est préméditer de commettre une crime contre ladite humanité. C'est d'ailleurs pour cette raison que la seule institution humaine qui m'inspire toute confiance (puisqu'il n'y a rien à en attendre, que ce soit en positif ou en négatif) est celle qui est nommée ci-dessous.
J'ajoute que la littérature non plus n'a pas pour vocation de sauver le monde. Parce que le monde, je vais vous dire, il est rigoureusement impossible de le sauver. Il ira ce qu'il ira. Avec nous dessus.
Voilà ce que je dis, moi.
lundi, 16 juillet 2012
DE LA VIRILITE EN LITTERATURE
ALFRED JARRY a occupé dans ma vie une place importante. Peut-être est-ce le folklore foutraque et infantile auquel son invention de la ’pataphysique a donné lieu dans les années 1950, avec la création du Collège de ’Pataphysique, et sa collection de grands enfants très savants et, au fond, très « philosophes ».

Peut-être est-ce l’intime saisissement poétique ressenti à la lecture de L’Amour absolu. Ou alors ce fut la perplexité foisonnante et vibrionnante ressentie à la lecture des Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. A moins que ce ne soit la bizarrerie antimilitariste et adelphique ressentie à la lecture de Les Jours et les Nuits. Mais après tout, peut-être fut-ce à cause de l’irréductible bigarrure des onze épisodes de l’ « éducation sentimentale » que raconte L’Amour en Visites.
Quoi, pas un mot d’Ubu roi ? Evidemment ! C’est le moins intéressant. On dirait même qu’ALFRED JARRY, en produisant son Ubu roi, a dressé un mur de protection entre lui et ses lecteurs potentiels en imposant, au milieu du paysage littéraire du début du 20ème siècle (la « première » de la pièce a été donnée le soir mémorable du 10 décembre 1896). Les œuvres citées ci-dessus ont donc été publiées bien à l’abri de cet énorme succès de scandale, qui leur a assuré un incognito à peu près parfait jusqu’aujourd’hui.

LE CRÂNE PIRIFORME, LE BÂTON-A-PHYSIQUE, ET LA GIDOUILLE
(XYLOGRAVURE D'ALFRED JARRY)
Il faut dire que le bonhomme JARRY est en soi un peu « spécial ». Il se faisait appeler Monsieur Ubu, dont il avait adopté, en société, l’articulation excessivement artificielle et segmentée. Un jour où, dans le « phalanstère » de Corbeil, il tire au pistolet, une voisine fait irruption pour protester en arguant de la présence de ses enfants derrière le buisson de séparation, à quoi, seigneurial, il répond : « Qu’importe, Madame, nous vous en ferons d’autres ».
A une visiteuse de son « entresol-et-demi » qui, avisant un phallus de dimension considérable sur la cheminée, demande si c’est un moulage, il réplique : « Non, Madame, c’est une réduction ». Il hébergeait chez lui quelques chouettes hulottes qu’il observa longuement pour en tirer quelques images et réflexions, notant par exemple que la chouette ferme les yeux quand elle lève les paupières. L'inconvénient était l'odeur qui accueillait le visiteur, les animaux étant nourris avec de la viande crue, qu'ils dispersaient et oubliaient dans la pièce. Certains ont parlé d'une « chambre encharognée ».

VOUS AVEZ NOTE LA SOURIS ?
PEUT-ÊTRE EST-CE UN MULOT ?
Ces anecdotes font partie d’une collection définitive et dûment inventoriée, répertoriée et certifiée, que les amateurs se transmettent pieusement de père en fils. Elles sont plus ou moins véridiques, plus ou moins controuvées, plus ou moins apocryphes, mais sans elles, la biographie d’ALFRED JARRY serait tellement moins savoureuse qu’on persiste à se les raconter. D’autant qu’il eut une courte vie (il est mort à 34 ans, sans doute d’une méningite tuberculeuse, peut-être en réclamant un cure-dent), qu’une absorption consciencieuse et constante de divers alcools, notamment l’absinthe, ne contribua guère à prolonger.
Quand JARRY a hérité de sa famille, il a tout claqué assez rapidement dans une revue illustrée, de luxe (Perhinderion, mot qui veut dire un « pardon » en breton), pour l’impression de laquelle il a fait fondre des caractères spéciaux, enfin bref : une folie, un geste artistique, ou ce qu’on voudra.
Pour le reste (de son existence), il a vécu sans un, raide comme un passe-lacet, comme on disait dans les anciens temps. Faut dire que ce n’étaient pas ses livres qui pouvaient lui rapporter beaucoup, vu le nombre des acheteurs potentiels auxquels ils étaient destinés : ça devait tourner autour de 37 ou de 42 exemplaires vendus.
Alors il a l’idée d’écrire deux romans « populaires » qui vont lui rapporter le magot. Ce seront Messaline et Le Surmâle. Bon, inutile de vous dire que le magot, il l’attend encore. Enfin, là où il est, n’est-ce pas, mon bon monsieur, ça ne lui tire plus sur l’estomac. Mais, comme dirait Gontran, tout ça ne nous dit pas l’heure. Et au fait : quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?

ILLUSTRATION DU PEINTRE PIERRE BONNARD,
COPAIN DE JARRY, POUR LE SURMÂLE
Or donc, Le Surmâle (roman moderne) raconte l’histoire des performances d’abord physiques, puis sexuelles d’André Marcueil, « homme ordinaire », d’apparence chétive, dont une mystérieuse transformation va faire un surhomme. Au début, scène mondaine et discussion mondaine autour de l’amour. Marcueil assène cette vérité : l’amour est un acte, et l’on peut le faire indéfiniment (sans aucun « dopage », cela va de soi, mais pas si sûr) : « L’amour est un acte sans importance, puisqu’on peut le faire indéfiniment ». Dans le fond, on ne peut pas dire que ce soit complètement faux.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, le surmâle, alfred jarry, docteur faustroll, ubu roi, collège de pataphysique, perhinderion, messaline, performances sexuelles
dimanche, 03 juin 2012
CONTREPETERIE : LA FIN ?
Un peu d’histoire aujourd’hui, non pas du pet (JEAN FEIXAS et ROMI s’en sont occupés en 1991, avec Histoire anecdotique du pet Ramsay-Pauvert, ouvrage jovial et très documenté), mais du contrepet, cette perversion amicale et presque familiale du langage, et finalement de bonne compagnie. On pourrait prétendre, en poussant la logique de cette perversion gentille et sale jusqu’au bout, que les phrases « normales » que tout le monde prononce tout le temps, devraient être considérées comme des suites de « contre-contrepets », c’est-à-dire, au fond, de la perversion revêtue du masque de la normalité. J'espère que vous suivez.
J’ai cité quelques noms. Il faut donc maintenant absolument préciser quels ont été les héros et les hérauts qui ont présidé au fabuleux destin de la contrepèterie dans la deuxième moitié du 20ème siècle, dont beaucoup ont trouvé refuge au sein de l’Oulipo, le céleste OUvroir de LIttérature POtentielle, fondé en 1960 par RAYMOND QUENEAU et FRANÇOIS LE LIONNAIS. Mais je parlerai de l’Oulipo une autre fois, sans ça, on n’est pas arrivés. Restons-en à la contrepèterie.
Disons quand même que FRANÇOIS LE LIONNAIS traîne derrière lui une lourde et terrible casserole. Dans ses Souvenirs désordonnés, JOSÉ CORTI (oui, celui de la maison d'édition magnifique) raconte qu'il doit (!?!) la mort de sa femme et de son fils dans les déportations de la deuxième guerre mondiale, à l'ahurissante et révoltante inconscience de cet homme, qui, d'après lui, tenait, si l'on peut dire, "table de résistance ouverte" dans les locaux de sa librairie, jusqu'au jour où il vit la Gestapo embarquer sa famille. J'imagine que l'événement ne l'a pas prédisposé à admirer les oeuvres nées de l'Oulipo.
A tout seigneur tout honneur. YVAN AUDOUARD, qui a inauguré la rubrique du Canard enchaîné intitulée « Sur l’Album de la Comtesse » (d’abord intitulée « la Comtesse M. de la F. », qui ne renvoie pas à l’antistrophe de RABELAIS (« molle de la fesse », mais l’intention est quand même bien d’induire en erreur), mais à la comtesse MAXINE DE LA FALAISE). A vrai dire, ce n’était pour Y. A. qu’un passe-temps exercé dans les moments creux. Il a en effet écrit beaucoup d’autres choses, dont un délicieux polar rigolard, Antoine le vertueux.
Il a par ailleurs laissé des sentences et autres apophtegmes frappés au marteau de la bonne forge, comme : « Je n’attendais rien d’elle. J’ai été comblé », ou : « C’est faire honneur au soleil que de se lever après lui ». Dans la préface qu’il a donnée au Manuel de contrepet de JOËL MARTIN (Albin Michel, 1986), il raconte l’exquise et délectable anecdote suivante :
« Du temps où j’étais responsable de "L’album de la comtesse", je reçus un coup de téléphone suppliant et affolé d’un chef d’entreprise qui me dit : « Je dirige un petit atelier de dessin industriel. Vous m’avez déjà coûté deux cents heures de travail. Mes dix-huit employés n’ont plus l’esprit à ce qu’ils font. Ils n’arrivent pas à trouver la contrepèterie de la semaine. » Elle était pourtant classique.
C’était le fameux : « Aucun homme n’est jamais assez fort pour ce calcul ». « Je vous en conjure, poursuivit le brave homme, donnez-moi la solution, sinon je suis ruiné ». Je la lui ai donnée. » La bonté d’YVAN AUDOUARD le perdra. Ah, on me dit qu’il est mort en 2004 ? Alors, paix à ses cendres. C’est vrai, qu’étant né en 1914, il avait le droit. Avant d’avaler sa chique, il a quand même écrit La Pastorale des Santons de Provence, à l’enregistrement de laquelle il a même participé, en donnant sa voix à l’âne.
Son successeur à « L’Album de la Comtesse » s’appelait LUC ETIENNE (né, lui en 1908, et décédé en 1984), qui fut, sauf erreur, Régent de Contrepet (ou d’Astropétique) au Collège de ’Pataphysique, a donné à « l’art de décaler les sons » l’ampleur et la noblesse d’un mode d’expression littéraire à part entière. Il a établi dans la durée la rubrique hebdomadaire du Canard, et l’a rendue indispensable comme un vrai rite.
Rompu à toutes sortes d’exercices de jonglerie avec les mots, il était néanmoins un scientifique averti (professeur de mathématiques), ainsi qu’un vrai musicien, par-dessus le marché. J’eus en ma possession, il y a déjà quelque temps, un fascicule intitulé Palindromes bilingues (anglais/français, c’était édité par le Cymbalum Pataphysicum).
Le palindrome, je ne sais pas si vous vous rappelez, c’est ce tour de force qui consiste à élaborer un texte qui puisse se lire indifféremment à l’endroit ou à l’envers, tout en gardant le même sens, parce qu’exactement symétrique (en miroir) autour de son point central, en ce qui concerne la suite des lettres.
GUY DEBORD a rendu hommage à la technique dans le titre de son film In girum imus nocte et consumimur igni (c’est du latin : « nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu », vous pouvez essayer dans les deux sens, ça marche, et c’est assez fortiche).
Le recordman de la discipline est sans contestation possible (quoiqu’un record soit a priori fait pour être battu) GEORGES PEREC, avec son texte de 1247 mots. Bon, c’est vrai qu’il ne faut pas être trop chatouilleux sur le sens de l’ensemble, mais la prouesse est là.
De LUC ETIENNE, j’ai gardé précieusement la cassette audio éditée par le Collège de ’Pataphysique en … (vulg. 1990) en hommage au Régent, qui, le diable d’homme, y présente des « palindromes phonétiques » et des « inverses phonétiques », dont l’incroyable début de Zazie dans le métro, du Transcendant Satrape RAYMOND QUENEAU.
Le successeur, en 1984, pour la rubrique du Canard enchaîné, des grands ancêtres qu’étaient YVAN AUDOUARD et LUC ETIENNE s’appelle JOËL MARTIN. Dans le civil, ce n’est pas un comique : c’est un ingénieur en physique nucléaire, il travaillait au CEA. Quand il est en uniforme, c’est indéniablement le pape qui porte sur sa tête la tiare de l’Eglise Contrepétante, dans la discipline de laquelle il a apporté la rigueur et la méthode propres à l’esprit des ingénieurs.
Et ça donne, dans Manuel de contrepet (Albin Michel, 1986, p. 320-321, j’aime bien la précision), des graphique savantissimes, en trois dimensions, qui sont supposés donner au lecteur les clés de la maison. C’est sûr que JOËL MARTIN, on dirait une usine à contrepet, qui tourne 24 / 24. Je pense qu’il doit faire la pause de temps en temps. Son agilité, qui plus est, est telle, qu’on a du mal à suivre. Pour un peu, je dirais qu’il est le PAGANINI de la contrepèterie.
Avec JOËL MARTIN, la contrepèterie acquiert la dignité de la Science, et je ne suis pas sûr que l’Université Française n’ouvrira pas, dans un avenir plus ou moins proche, une chaire de Contrepet, avec Licence, Maîtrise et Doctorat. Au point que cela risque d’en devenir intimidant pour le vulgum pecus auquel j’appartiens. Au point qu’on pourrait dire que « trop de science tue l’amour ».
JOËL MARTIN a pondu un nombre effrayant d'ouvrages sur la contrepèterie, à commencer par le Manuel de contrepet, en 1986, où il expose la méthode qu'il a mise au point pour fonder en science le contrepet, dans un chapitre horriblement savant (« Précis de Pataphysique (sans l'apostrophe obligatoire) du solide »), finissant par deux pages intitulées "morphologie, physiologie et pathologie du contrecube", et couvertes de schémas déliremment pataphysiques.
L'un d'eux mesure la tension artiérielle du contrapétiste, pour vous dire : on est dans le sérieux et le scientifique, mais il ne faut pas exagérer. De toute façon, ALFRED JARRY lui-même a donné l'exemple, dans le dernier chapitre des Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, intitulé « De la surface de Dieu ».
Le maître ouvrage de l'empereur de la contrepèterie, sorti en 2003 en collection "Bouquins", est sobrement intitulé Le Bible du contrepet (960 pages), et sous-intitulé "une bible qui compte pour décaler les sons" (deux permutations à faire).
JOËL MARTIN, en érigeant la contrepèterie en SYSTÈME, régi par des règles quasi-scientifiques (je dirai plutôt des règles quasi-mécaniques, puisque son système finirait presque par ressembler à une machine), risque de réduire le contrepet à un vulgaire tiroir des meubles de la cuisine oulipienne, dont il faudra bien un jour que je me décide, quoi qu’il m’en coûte (et quoiqu’il m’en coûte), à dire tout le mal que j’en pense, en tant qu’entreprise de destruction.
A mon avis, en effet, avec JOËL MARTIN, la contrepèterie a tout simplement perdu de vue Panurge, et ça, c’est plus que je ne peux supporter. Tout simplement parce que, dès qu’on fait de quelque chose d’humain, d’intimement lié au rire et à la joie, le support d’une THEORIE SCIENTIFIQUE, je fais comme le rat : je quitte le navire, même si je dois me noyer.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : contrepèterie, contrepet, joël martin, yvan audouard, luc étienne, alfred jarry, pataphysique, oulipo, raymond queneau, guy debord, in girum imus nocte et consumimur igni, l'album de la comtesse, histoire anecdotique du pet, le canard enchaîné, rabelais, pastorale des santons de provence, collège de pataphysique, georges perec, palindrome, zazie dans le métro, manuel de contrepet, josé corti, souvenirs désordonnés
vendredi, 01 juin 2012
VOULEZ-VOUS (CONTRE)PETER AVEC MOI ?
« Voulez-vous que je vous envoie dans la culture ? ». « Les nouilles cuisent au jus de cane » (x 2). « Le curé est devenu fou entre deux messes ». « Ma cousine joue au tennis en pension ». « Ce vieux marcheur veut courir sur le mont » (x 2, dont une dans un mot). « La magistrature assise ment debout ». « Le Suisse sortait sa pique au milieu des beatnicks ». « La pâtissière moule des quiches ». « Joseph a maculé Henri ». Bon, j’arrête là. Je sais que ceux qui ont compris ont compris. J'encourage les autres à lire ce qui suit.
Je chantais, il n’y a pas très longtemps, les beautés subtiles de la chanson que j’appelais « quasi-paillarde », où l’auteur se plaît à décevoir l’oreille de l’auditeur en substituant au terme « cru » (« le tout de mon cru », psalmodiait l’immortel LUC ETIENNE), au moment de la rime « sale » attendue, un terme innocent, que la rime suivante a pour mission de justifier.
Cela dit, non seulement le jeu de la « fausse rime » n’empêche nullement l’auditeur de comprendre, mais en plus, elle multiplie son plaisir par le taux d’intelligence qu’il se décerne (très objectivement, forcément) quand il estime qu’il a compris, sur le principe du « je ne prête qu’à moi, parce que je suis riche » (même si ce n’est pas vrai).
Je veux chanter aujourd’hui, dans le même esprit (c’est-à-dire avec les mêmes arrière-pensées, que je qualifierai pudiquement de « décolletées »), une des formes les plus anciennes de jeu sur les mots de notre belle langue. J’ai nommé la CONTREPÈTERIE. Certes, on peut prétendre que « cette menthe a le goût de fiel », mais il n’en est pas moins vrai que « Virginie prend les bols » (tout au moins chez BERNARDIN DE-SAINT-PIERRE, je dis ça pour aider).
L’inventeur de la contrepèterie est peut-être – ce n’est pas sûr – FRANÇOIS RABELAIS, que j’ai célébré ici même récemment. C’est vrai qu’on trouve dans Pantagruel deux exemples célébrissimes. Le premier est au chapitre 16, qui détaille les « mœurs et conditions de Panurge » : « car il disait qu’il n’y avait qu’un [sic] antistrophe entre "femme folle à la messe" et "femme molle à la fesse" ». Je laisse à Panurge la responsabilité de ce propos.
Le seul commentaire qui s’imposerait (éventuellement) concernerait la fréquentation, par les individus de sexe féminin, des lieux consacrés que les catholiques investissent chaque dimanche, et où ils se rassemblent « au nom du Christ », pour se faire une idée de la consistance de leur « partie charnue », à une époque où la déchristianisation est un fait accompli, mais ce commentaire-là, je m’en abstiendrai pour cette fois, parce que ça rallongerait inutilement (cela dit, tous les rallongements ne sont pas inutiles).
Notre vieil oncle GEORGES BRASSENS, puisqu’il faut aujourd’hui parler d’ « orientation textuelle », était plus VILLON que RABELAIS, a assez longtemps creusé le sillon de la rime qu’offrent ces deux mots (« messe » et « fesse », … pardon, il y a aussi (et même plutôt) « confesse ») pour que je me dispense d’ajouter mon grain de sel.
Le deuxième exemple se trouve un peu plus loin (chapitre 21) : « Madame, sachez que je suis tant amoureux de vous que je n’en peux ni pisser, ni fienter. Je ne sais comment vous l’entendez ; s’il m’en advenait quelque mal, qu’en serait-il ? – Allez, dit-elle, allez, je ne m’en soucie pas ! Laissez-moi ici prier Dieu. – Mais, dit-il, équivoquez sur "A Beaumont-le-Vicomte". – Je ne saurais, dit-elle. – C’est "A beau con le vit monte" ». Avouez : comment pourrait-on se lasser de Panurge ? Contrepèterie, « antistrophe », « équivoquer », tout ça, c’est du pareil au même. Vous pouvez aussi dire « métathèse » si voulez faire votre cuistre.
Contrepéter, c’est donc permuter (« j’ai glissé dans la piscine », c’est autorisé aux enfants en bas âge). On peut permuter des tas de choses : des consonnes, des voyelles, des syllabes. Le plus souvent, on permute les éléments par paire, mais on peut compliquer à plaisir. Deux grandes règles à respecter.
La première est de toujours se fier au son, à l’oreille, à la phonétique, jamais à l’orthographe ou à la séparation des mots écrits (quoique …). Comme le cite JOËL MARTIN, en couverture d’un de ses livres, le contrepet, c’est « l’art de décaler les sons » (deuxième exercice très facile).
La deuxième règle est, aussi cruel que ça puisse paraître, de ne jamais dévoiler la solution. C’est la règle du : tant pis pour ceux qui ne comprennent pas (ceux qui ont décrypté l’exemple ci-dessus l’admettront aisément, et décrypteront celle-ci de même : « on reconnaît les concierges à leur avidité »).
Elle s’apparente à celle de la fausse rime (déjà vue dans les « chansons quasi-paillardes ») : si l’on se donne la peine d’escamoter le mot qui heurte la morale, la religion, les bonnes mœurs, et qui taquine les bonnes sœurs en cornette et des bons pères en soutane jusque dans leurs parties intimes (la cornette et la soutane se sont diablement raréfiées), pour le remplacer par un « mot sage », qui cache le « message », ce n’est quand même pas pour des prunes.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, contrepèterie, jeux de mots, oulipo, luc étienne, collège de pataphysique, le tout de mon cru, rabelais, pantagruel, panurge, georges brassens, villon, joël martin, le canard enchaîné, yvan audouard, chanson paillarde, érotisme
mardi, 01 mai 2012
DES NOUVELLES DE LA PLANETE (1)
Les tendances de la mode.
Cette année, la terre cultivable se portera de plus en plus confisquée. La tendance est sans doute appelée à durer, peut-être à se renforcer.
Je ne sais pas si vous savez ce qu’est un « bail emphytéotique », ce qu’on appelle une location de longue durée, voire de très longue durée. Le plus souvent, ce sont des baux à 99 ans. Un siècle quoi. J'appelle ça de la confiscation. D'autres parlent d'accaparement. Les initiateurs du mouvement appellent ça « aide au développement ». Cherchez l'erreur.
J’ai entendu dire, mais je ne veux pas le croire, que certains baux emphytéotiques peuvent être signés sur une durée de 999 ans. En tout cas, on trouve ça sur wikipédia. Ça me semble une hallucination. Parce que déjà, 99 ans, ça fait sur trois générations. Pas une appropriation, mais pour ainsi dire.
Le tout, pour signer un bail de location, c’est d’être deux. Quelqu’un qui possède un bien, et quelqu’un qui aimerait bien user de ce bien, contre rétribution. En l’occurrence, le bien est la terre cultivable disponible. C’est une richesse (presque) naturelle. Celui qui veut en user, c’est évidemment quelqu’un qui en manque, de cette richesse. Mais lui, il a de l’argent. Or le propriétaire du bien, c’est justement quelqu’un qui n’en a pas beaucoup, d’argent. Qu’est-ce que ça tombe bien !
Maintenant, si on regarde qui sont les bailleurs et qui sont les « locataires », on commence à mieux comprendre ce qui se passe : des pays riches, voire très riches, qui manquent de terres cultivables, sont en train de confisquer (un « bail à 99 ans », c’est un euphémisme pour « confiscation », ou je ne sais plus que 2 + 2 = 4), d’immenses territoires à des pays pauvres, voire très pauvres.
Cette confiscation est rendue d’autant plus facile que la propriété des sols, dans les pays du tiers-monde, n’est pas juridiquement aussi précise et cadastrée que chez nous. Ah, ta famille cultive cette terre depuis cinq générations ? Peut-être, mais prouve-moi qu’elle t’appartient ! Où est l’acte notarié ? Bon, ben puisque c’est comme ça, tu vas prendre tes cliques et tes claques et me foutre le camp d’urgence. Maintenant, c’est ce Monsieur qui la cultivera.
En général, c’est le gouvernement du pays qui procède aux formalités légales. Et comment ne pas imaginer que le futur locataire sait trouver des arguments sonnants et trébuchants, capables de toucher les sentiments du gouvernant, d’abord réticent, puis intéressé au fur et à mesure que les enchères montent ? Des enchères à lui seul destinées, bien entendu. Comment ne pas se sentir enclin à céder quand on en tire un joli bénéfice personnel ?
Il va de soi que je ne fais qu’imaginer ce scénario fantasmatique, n’est-ce pas. On connaît trop la parfaite intégrité morale des élites dirigeantes des pays « pauvres » (KABILA en RDC, SASSOU-NGUESSO au Congo Brazza, OBIANG en Guinée Equatoriale, etc.). On ne voit pas ce qui pourrait laisser supposer qu’elles pourraient se laisser corrompre.

J'ESPERE QU'ON PEUT DECHIFFRER,
EN PARTICULIER LES CHIFFRES
On a déjà compris que le plus gros gisement de terres cultivables disponibles se trouve en Afrique. En l’état actuel des choses, on parle de 180.000 km². Oui, vous avez bien lu : cent quatre-vingt mille kilomètres carrés (18.000.000 d’hectares) de terres africaines cultivables ont été soustraites aux cultivateurs autochtones, pour être confiées pour 99 ans à des entreprises étrangères. Et quand je dis « entreprises », cela veut moins dire des agriculteurs les pieds dans la glèbe que des industries avec leurs engins lourds.
Rien qu’à Madagascar, ce sont 37.000 km² qui sont passés sous la coupe étrangère. Un peu plus de 30.000 en Ethiopie, un peu moins en République Démocratique du Congo. Les pays les plus touchés, ensuite, sont, dans l’ordre, le Soudan, le Bénin, le Mozambique. Bref, le tableau s’éclaire violemment. L’Amérique du sud est concernée à la marge. Dans le Pacifique, les Philippines semblent avoir été entièrement mises en vente, loin devant l’Indonésie.
Maintenant, demandons-nous sans plus longtemps tergiverser qui sont les acheteurs (terme plus approprié que locataire). Au premier rang, la Chine, suivie à plusieurs longueurs des Etats-Unis. Viennent ensuite la Grande-Bretagne, la Malaisie, la Corée du Sud, l’Arabie Saoudite, l’Inde, la Suède et l’Afrique du Sud.
Comment, vous dites « colonialisme » ? Mais non, voyons, on vous dit que c’est du contrat tout ce qu’il y a de parfaitement légal. Et puis de toute façon, ce ne sont pas des Etats qui les ont passés, ces contrats, mais de la bonne grosse entreprise industrielle tout ce qu’il y a de privé.
Quoi, ça dépossède le petit paysan d’Afrique de toute possibilité de cultiver ? Quoi, ça risque dans un avenir assez proche de semer la famine ? Quoi, ces terres sont utilisées à des productions directement réexportées vers le pays propriétaire ? Quoi, on y produit principalement des biocarburants à haute valeur financière ajoutée ? Mais tout ça, mon brave monsieur, ne nous regarde pas. Nous n’y pouvons rien. C’est de la bonne vieille transaction commerciale. Vieille comme le monde.
Alors vous voulez que je vous dise ? L’UNICEF pourra toujours hurler à la faim des enfants dans le monde, JEAN ZIEGLER pourra toujours aboyer contre les pays riches qui laissent mourir de faim les populations du tiers-monde, Action Contre la Faim pourra toujours organiser des collectes dans les rues pour que des populations culpabilisées remplissent la sébile de la charité universelle, ils peuvent attendre, tous les généreux et toutes les bonnes âmes de la planète.
Pendant que le pékin moyen donnera une goutte, une cohorte de vampires confisquera une citerne (c’est vrai, au fait, j’ai oublié de parler des menaces sur les ressources en eau potable que font peser sur les pays pauvres ces entreprises agricoles d’un nouveau genre).
Continuons comme ça. Le Paradis n’est plus très loin. Faisons confiance aux instances supérieures.
Mais quoi qu'il en soit, en toute circonstance, n'oublions jamais que

Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, tiers monde, agriculture, accaparement des terres, bail emphytéotique, pays en développement, rdc, kabila, congo brazzaville, sassou-nguesso, afrique, madagascar, corruption, éthiopie, soudan, bénin, mozambique, pacifique, philippines, chine, états-unis, grande-bretagne, malaisie, corée du sud, arabie saoudite, inde, suède, afrique du sud, colonialisme, collège de pataphysique
vendredi, 27 avril 2012
LA BÊTISE FEMINISTE
MARIE DARRIEUSSECQ écrit des livres. Elle a commencé par Truismes en 1996. J’avais lu ça, en son temps. Pas franchement mauvais, pas épastrouillant non plus.
Tiens, à propos d’ « épastrouillant », savez-vous que le mot se trouve dans A la Recherche du temps perdu ? On le trouve à la page 892 du tome III, dans la collection de La Pléiade. Mais attention, la première Pléiade, l’édition de PIERRE CLARAC en trois volumes, pas celle de JEAN-YVES TADIÉ, en quatre volumes.
Notons en passant que, d’une édition à l’autre, La Recherche a vu doubler son embonpoint (bondissant de 3558 à 7408 pages), à cause des bondieuseries de sacro-saintes « notes et variantes », pondues très sérieusement et très laborieusement par des universitaires cavernicoles et binoclards, dont on se demande ce qui les pousse à allonger à ce point la sauce, vu la maigreur squelettique de la rémunération qu’ils en tirent. La gloire, peut-être ? A moins que ce soit l’idéal ? Autre hypothèse : ça fait bien sur un Curriculum Vitae.
Je reviens à la petite DARRIEUSSECQ. Son histoire de transformation en truie (c’était une coiffeuse, si je ne me trompe) était somme toute assez mal bâtie. Rien à voir en tout cas avec La Métamorphose de FRANZ KAFKA, qui se déroule à une altitude pour le moins métaphysique, totalement inaccessible à la petite MARIE (comme dit la chanson : « La petit'Marie M'avait bien promis Trois poils de ... Pour faire un tapis »).
Si je me souviens bien, il n’y avait, sur le plan romanesque, presque aucune interaction entre les mutations physiques de la fille et les gens de son entourage. Un vrai défaut de conception. Un vice de forme, quoi. Mauvais signe, pour un « écrivain », je trouve. Et puis, la fin, avec la libération de tous les cochons et leur fuite dans la nature, c’est quand même ce qui s’appelle « finir en queue de poisson », non ?
La petite DARRIEUSSECQ a réussi à s’introduire dans une certaine intelligentsia parisienne. Visiblement, elle sait y faire, puisqu’après avoir un peu pompé un livre autobiographique de CAMILLE LAURENS, elle a réussi à l’évincer des éditions POL, PAUL OTCHAKOVSKY-LAURENS ayant pris parti pour elle dans la bisbille, que la deuxième avait, hélas pour elle, rendue publique. Je ne dis pas pour autant que CAMILLE LAURENS est un véritable écrivain, qu'on se rassure.
Aux dernières nouvelles MARIE DARRIEUSSECQ est parvenue à recycler une pointe de sa plume devant un micro de France Culture, où elle lit hebdomadairement un papier en général incolore, inodore et sans saveur, couleur de muraille, c'est-à-dire digne de passer inaperçu, parfois non dénué cependant d’une modeste pertinence, et d’une voix, comment dire, sans caractère. mais sans aucun caractère. Une voix d’une platitude parfaite et présentable. Les malveillants diront que la forme est conforme au fond. Dont acte.
Qu’est-ce qui lui a pris, l’autre jour, d’aller chercher des poux dans la tête d’une publicité ? Et quelle publicité ? Une invitation à aller faire de la randonnée dans le Jura. On se demande vraiment ce qui lui a pris d’aller y dénicher du sexisme.
Il faut vraiment que « les chiennes de garde » n’aient plus rien à se mettre sous les crocs et regrettent le beau temps où elles pouvaient se les aiguiser sur les mollets de DOMINIQUE STRAUSS-KAHN, en se déchaînant contre ses fureurs sexuelles. Ah oui, c’était un bon « client ». C'était le bon temps, en quelque sorte. Le venin coulait tout seul, ça venait bien.
Qu’est-ce qu’elle dit, cette publicité ? On peut voir le spot de 10 secondes sur internet (tapez "jura publicité") : « Tu veux des rencontres ? Vivre une aventure ? Goûter mes spécialités gourmandes ? Alors viens chez moi. Hmmm ! Je suis le Jura. Rejoins-moi sur jura-tourisme.com. Je t’attends ». Voilà, c’est tout. Enfin presque. Le message est comme susurré à l’oreille par une voix féminine qu’on peut trouver sensuelle (mais sensuelle comme une voix synthétique).
Dernier détail : comme c’est un message radiophonique, pas d’image. Mais le spot, sur internet, se déroule sur fond de photo de paysage verdoyant : un charmant village au pied d’une belle falaise, à l’entrée d’une vallée resserrée. Je suggère à MARIE DARRIEUSSECQ d’aller au bout de son obsession, et d’interpréter (au secours, la psychanalyse !) le paysage présenté comme le pubis offert d’une femme étendue sur le dos, où le promeneur est invité à pénétrer. Comme ça, le tableau sera complet.
Blague à part, cet aspect n’était sans doute pas absent des cogitations publicitaires quand il s’est agi de choisir la photo. Ce serait d’ailleurs fort intéressant, d’assister à ce genre de séance de « brain-storming », où l’on traduit des désirs subconscients en signes visuels précis, le plus connu étant la forme en V dans les affiches mettant en scène des femmes (deux doigts ouverts sur une épaule nue, par exemple).
Voilà donc le message qui fait dresser les féministes sur leurs ergots, flamberge au vent, outrées que la publicité utilise une fois de plus impunément le corps des femmes (donc elles ont bel et bien identifié le pubis) pour vendre des produits ? Elle est là, la bêtise féministe. D’abord faire de la publicité à une publicité, bien sûr. Ensuite, monter en épingle un message somme toute bien anodin. Enfin, se tromper de cible.
Qu’y a-t-il dans ce message ? Une pute qui vend ses charmes, un point c’est tout. « Tu viens, chéri ? », c’est du racolage actif. Mais que fait la police ? Mais que fait SARKOZY, serait-on en droit de demander ? Mais des racolages comme ça, c’est à chaque instant, partout qu'on en voit. S’en prendre à cette pub-là, parmi cent mille autres, ce n’est rien d’autre, finalement, qu’une lubie.
Le problème ? C'est le problème que les féministes ont avec le désir masculin. Mais quel homme n'a pas un problème avec son propre désir ? Peut-être les féministes doctrinaires ont-elles un problème avec le désir féminin ? Peut-être, finalement et en fin de compte, les féministes doctrinaires ont-elles un problème avec le désir? En soi ?
Tout le monde a un problème avec le désir. Le féminisme constitue une des techniques pour y parvenir. Ce n'est pas donné à tout le monde, d'exprimer ça par un symptôme.
L’obsession victimaire d’un certain féminisme fait oublier à ces dames que la publicité est par nature perverse. Par nature, la publicité pervertit les signes, elle fait feu de tout bois pour attiser le désir (le premier étant sexuel), qu’elle met en scène dans des formes, couleurs, etc. qui objectivent en termes visuels les phénomènes qui se produisent à l’intérieur de la bouilloire humaine.
Il faut bien se convaincre que, pour vivre, la publicité fait les poubelles. Que la publicité se nourrit exclusivement des déchets de la civilisation. Des crottes de l'imaginaire humain. Que la publicité est l'inverse de la civilisation, puisque son boulot est de sublimer de vulgaires objets, de simples marchandises.
C’est en soi que la publicité serait à dénoncer. Et les hommes devraient autant s’insurger que les femmes. Ce n’est pas pour rien que, dès les années 1960, la revue Hara-Kiri (dont l'équipe était constituée d'hommes, presque exclusivement) clamait à tous les vents : « La publicité nous prend pour des cons. La publicité nous rend cons ». J’ajoute qu’elle n’a peut-être pas tort de le faire, vu les performances de notre système éducatif. Passons.
MARIE DARRIEUSSECQ a donc perdu une belle occasion de se taire. Franchement, vous voulez que je vous dise ? Dans la publicité Jura, il n’y a pas de quoi fouetter une chatte, fût-ce dans le cadre d’une Pospolite Castigatrice, réunie, conformément aux statuts, par le Vice-Curateur du Collège de ’Pataphysique (n'oublions pas l'apostrophe, obligatoire depuis Faustroll).
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, féminisme, sexisme, marie darrieussecq, truismes, marcel proust, à la recherche du temps perdu, la pléiade, franz kafka, camille laurens, paul otchakovsky-laurens, dominique strauss-kahn, publicité, sexe, jura, sarkozy, hara-kiri, collège de pataphysique
vendredi, 03 février 2012
LE FLEAU DU DROIT DE VOTE (2)
Les tribulations d’un bulletin de vote français.
On est donc en période électorale. Il importe d’avoir des lectures « citoyennes ». La Journée d’un scrutateur, ça s’appelle. Si vous ne l’avez pas encore lu et que vous avez une petite heure à perdre, la petite heure ne sera pas perdue, promis. ITALO CALVINO, entre quelques chefs-d’œuvre, a écrit ce bijou de tout petit bouquin (une centaine de pages) sur les mœurs « civiques » en démocratie.

ITALO CALVINO, 'PATAPHYSICIEN EMERITE
Comment, en démocratie, les gens au pouvoir s’arrangent pour le garder, y compris en faisant voter quelques vieux décatis hébergés dans les hôpitaux, quelques aliénés de l’asile, quelques vieilles bonnes sœurs grabataires, toutes bonnes gens dont la main est soigneusement guidée vers le bon bulletin de vote. Il faut voir les gars balader l’urne d’hospice en maison de retraite et les vieux de leur grabat jusqu’à l’urne. Livre réjouissant et lugubre.
Ce n’est pas en France, je n’apprends rien à personne, qu’on verrait s’étaler pareilles turpitudes. La France est – tout le monde en est d’accord – au-dessus de ces miasmes de bas étage. Bon, c’est vrai qu’aux élections municipales de 2008 à Perpignan, un certain GEORGES GARCIA, président d’un bureau de vote, a été vu avec plein de bulletins de vote dans ses poches et ses chaussettes. Simple anicroche. Billevesée.
D’ailleurs, qu’on se rassure : il a été dûment condamné – avec sursis, faut pas exagérer. Le maire sortant, JEAN-PAUL ALDUY, a été, quant à lui, confirmé dans sa réélection (il a démissionné en 2009). Ce n’est pas l’existence de quelques brebis galeuses qui vont autoriser quelque obscur blogueur pamphlétaire vindicatif – réactionnaire vaguement gauchiste (ou l'inverse) –, éventuellement doté au surplus de tendances paranoïaques, à s’en prendre au troupeau électoral dans son entier. Que cela soit dit une bonne fois pour toutes : le troupeau électoral français est fondamentalement sain.
On me fait remarquer dans mon oreillette que JEAN TIBERI, autrefois maire de Paris, a inventé (sans s'attribuer la paternité de l'invention, par modestie sans doute) l'électeur fantôme, plus souvent appelé « faux électeur ». Oh, rien de bien grave : juste il demandait à un réseau d'amis de s'inscrire sur la liste électorale de son 5ème arrondissement de Paris, même et surtout s'ils habitaient ailleurs.

LA, ON N'EST PAS LOIN D'UN TRIBUNAL
ON LUI DONNERAIT LE BON DIEU
A BOIRE AVEC UNE PAILLE
TOUT LE SECRET EST DANS LA BRECHE
Les soirs d'élection, ces témoignages d'amitié et de solidarité lui donnaient un bon matelas d'avance sur ses rivaux, n'est-ce pas, Mme LYNE COHEN-SOLAL ? A propos de laquelle j'ai cru voir mentionner dans les journaux, il y a quelque temps, quelques turpitudes commises en compagnie de M. JACQUES MELLICK, rendu célèbre dans les années 1990, à côté d'un certain BERNARD TAPIE, le monde judiciaire n'est pas si petit.
Il aurait même tendance à s'étendre, si on le laissait faire. Mais nous le disons bien haut et bien fort : nous ne nous laisserons pas faire ! Nous ne laisserons pas la dent mauvaise de la calomnie rouler impunément, avec la semelle immonde de ses intentions ténébreuses, sur nos réputations immaculées ! Nous ne laisserons pas la langue de vipère de la subversion et de la haine fouler au pied la poutre faîtière de notre intégrité sans faille (merci, monsieur le maire de Champignac).
Mais baste ! Simples anicroches ! Billevesées !
De toute façon, en France, pays de vieille démocratie, paraît-il, les camps opposés s’observent avec tant d’attention jalouse, les soirs d’élection, lors du dépouillement, que, si quelqu’un veut frauder, c’est excessivement difficile, c’est immédiatement rendu public, c’est donc rarissime, vu que les adversaires se tiennent mutuellement en joue, même si c’est courtoisement fait.
A la place du démocrate blanchi sous le harnois qui est en train de me lire, je garderais quand même un œil fixé, pour les prochaines législatives, sur la façon dont sont « gérés » les électeurs appelés « Français de l’étranger ». NICOLAS SARKOZY et ses sbires veillent sur eux comme sur du lait qui ne va pas tarder à bouillir.
Ils ont bien onze sièges de députés à pourvoir, ce qui n’est pas négligeable du tout (les curieux peuvent aller voir (http://www.politiquemania.com/forum/2012-legislatives-f31/les-circonscriptions-des-francais-etablis-hors-france-t469.html). Cela fait 90.909 électeurs pour un député. La moyenne nationale tourne autour de 70.000. Qui est avantagé a priori ? Et qui, a posteriori ?
Qui se souvient de CHARLES PASQUA et de ses merveilleux redécoupages à la petite scie (ça c'est pour les lecteurs de La Vie mode d'emploi, de GEORGES PEREC) de toutes les circonscriptions de députés ? Personne n'a jamais fait mieux que CHARLES PASQUA pour biaiser le résultat du suffrage universel. Finalement, c'est lui, THE ARTIST.

LE MAÎTRE DANS L'ART DE LA DECOUPE ELECTORALE.
(UN REMARQUABLE IMPUNI)
Revenons aux formalités. Je ne sais pas si vous avez participé à des dépouillements, mais rien n’est à la fois aussi fastidieux (ouvrir l’enveloppe, dire le nom, cocher au crayon chaque voix dans la colonne qui lui revient) et aussi électrique (en cas d’enjeu particulier, de basculement possible, de résultat spécialement serré, …).
Le fastidieux, c'est pour les petites mains consciencieuses, les citoyens ordinaires et bénévoles. Ceux qui y croient. L'électrique, c'est pour le chef shooté à l'adrénaline (mais, hmmmmm ! c'est si bon, l'adrénaline !) qui appelle pour la dix-huitième fois alors qu'on n'en est qu'à 52 % du dépouillement complet.
Je signale, en passant, dans le cadre électoral, la curiosité de l’emploi du mot « dépouillement », qui signifie au départ « priver quelqu’un de ses vêtements » (Dictionnaire historique d’ALAIN REY). Certains citeraient aussitôt l’expression « déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Pas moi. Cela n'a aucun rapport et n'a aucun sens. On a sa dignité.
Le problème, en France, ce n’est évidemment plus de conquérir le droit de vote. Tous les bébés français sont nés avec la cuillère électorale en argent dans la bouche. Ce serait plutôt de le reconquérir. C’est comme les règles de la politesse : quand on a oublié que ça existe, on ne sait plus à quoi ça servait. Et on le jette. Moi, je m'abstiens parce que j'ai perdu le Nord démocratique et républicain.
Quand un individu fait irruption sur cette terre, c’est compréhensible et humain, il a tendance à considérer tous les éléments de son paysage comme des parties de la Nature éternelle. Comme des évidences et des points de départ. C'est donné. Et le bébé français, avec sa cuillère en argent dans la bouche, il se rend pas compte.
Et il a tendance à voir les individus un peu plus âgés que lui comme des croulants faisant partie des meubles, des murs et des galeries d’ancêtres, voire des PPH (Passera Pas l’Hiver), qui ont fait leur temps, tu comprends, ils datent de l’époque où le téléphone servait seulement à téléphoner. Ce qu’on se marre.
Aux yeux des jeunots, les un peu plus anciens qu’eux prennent des airs paléontologiques. « Dégage » est désormais leur cri de ralliement. Le bulletin de vote fait partie de ce décor poussiéreux qu’ils éternuent.
Le problème électoral …
Ah zut, mon manquier m'avise à l'instant que j’ai un découvert à mon compte en manque de mots, juste maintenant. Bon, je réapprovisionne, et vous avez la suite.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre, les tribulations d’un bulletin de vote en Afrique et ailleurs.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit de vote, la journée d'un scrutateur, italo calvino, élection présidentielle, politique, société, démocratie, citoyen, civisme, perpignan 2008, jean tiberi, fraude électorale, bernard tapie, nicolas sarkozy, françois hollande, parti socialiste, ump, dépouillement, dictionnaire historique, alain rey, france, collège de pataphysique, georges perec, la vie mode d'emploi, charles pasqua, circonscription électorale