jeudi, 15 septembre 2022
CEUX QUI ONT LA SOLUTION
Je sais pas vous, mais il y a quelque chose, dans le paysage de notre monde mal barré, qui me fait toujours autant rire, braire et m'apitoyer, dans la façon dont "certains" (en français : des intellos) évoquent les problèmes, les situations et même les événements. A les écouter, ces braves gens, il suffirait de prendre au sérieux leurs propos et appliquer les recettes qu'ils mettent sur la table, pour que les problèmes se résolvent et que les situations s'éclaircissent. A cet effet, ils disposent d'un « Sésame, ouvre-toi ! » dans l'immémoriale expression IL FAUT.
Je me souviens que le journal Le Monde a publié dans ses pages, dans les années 1970, toute une série de dessins d'un nommé Konk, une série intitulée "Faukon, Yaka et Pitucé" (pas besoin de traduire), où il se moquait de ces gouvernants de comptoirs qui détiennent, après quelques apéros, les clés de la bonne gouvernance du pays. La collaboration n'a pas duré trop longtemps, car assez vite on a vu Konk aller mouvoir ses nageoires dans les eaux sales voisines du Front National de Jean-Marie Le Pen, voire dans diverses cellules et officines un peu plus "musclées". Au Monde, on a dit : "Pas de ça, Lisette". On le comprend.
Reste que je demeure abasourdi quand, dans les pages du même Monde, il m'arrive encore de tomber sur des titres contenant la formule sacramentelle autant que passe-partout : il faut. Ces titres, on les trouve en général dans les pages "Débats" du journal. Alors bien sûr ce sont des collectifs, des trios, des tandems ou des individus qui profèrent l'expression fatidique et qui n'engagent nullement la responsabilité du quotidien.
Tous les titres qui figurent dans la petite rafale ci-dessous sont tirés de numéros récents, témoignant de l'étonnante santé d'une formule dont je subodore qu'elle ne doit sa survie qu'à l'indéracinable dose d'espoir qui, chez les humains, signifie l'impossibilité absolue (ou presque) de renoncer à envisager le futur en fermant la porte au nez des lendemains qui chantent. « Il faut subir ce qu'on ne peut empêcher », dit quelque part Jorge Luis Borgès. C'est exactement là que l'homme commence à rêver. C'est là qu'on franchit la frontière de l'imagination. La formule "il faut", c'est empêcher la porte des possibles de se refermer.
A cet égard, j'aime particulièrement les articles de fond produits par des journalistes sérieux et si possible chevronnés, et construits comme des dissertations normales ou comme des notes de synthèse, vous savez : 1 - constat ; 2 - causes ; 3 - perspectives. La troisième partie doit faire la preuve que la situation n'est pas désespérée. Ensuite, le rédacteur est invité à faire preuve d'ingéniosité pour éviter le grossier "il faut". Car la langue française abonde en ressources diverses et en moyens astucieux de tourner autour du "il faut".
En général, j'admire de tels articles aussi longtemps qu'ils décrivent le problème dans tous ses aspects et qu'ils entreprennent d'expliquer l'origine de ce problème : la virtuosité du journaliste peut se donner libre cours. Et puis vient la troisième partie, et patatras ! le cousu de fil blanc apparaît en pleine lumière. L'auteur de l'article y va de ses solutions, de ses propositions, de ses hypothèses, des mesures et des décisions à prendre. Mais il aura beau mettre en œuvre tout son talent pour costumer et grimer le "il faut" sous toutes sortes de fards et de fonds de teint, il butera immanquablement sur le mur du "comment on fait ?". Autrement dit : comment on passe du virtuel au concret ?
La petite suite que je présente ci-dessous n'est qu'un modeste échantillon (été 2022) des manifestations du pouvoir du "il faut" dans les cerveaux de ceux dont le métier est de penser.
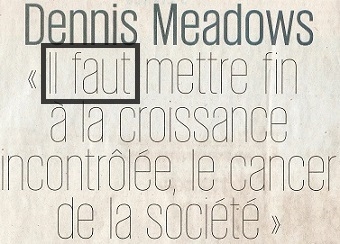
Ouais, t'as bien raison, mais tu peux nous dire comment on fait, monsieur le savant ?
***

Le Système ? Ouais, l'idée est bonne. Reste plus qu'à nous dire
COMMENT ON FAIT,
crâne de piaf !!!
***

Ouais, tout le monde va se mettre autour de la table, comme un gros tas de chouettes copains ! On va dire ça à l'Egypte, au Soudan et à l'Ethiopie pour le partage des eaux du Nil. On dira ça à la Turquie, à la Syrie et à l'Irak pour le partage des eaux du Tigre et de l'Euphrate. On dira ça ...
***

Ah, l'implication des citoyens, un beau cheval de retour ! Allez, on vous fera de splendides "Conventions Citoyennes" ! Monsieur Macron aura plein la bouche de beaux discours ! On appellera ça "concertation", et au bout du compte, personne ne sera satisfait.
***

Celui-ci, je le trouve particulièrement réjouissant : il me fait penser à une "évaluation à l'entrée en seconde" dont j'ai eu à connaître jadis. Parmi les 32 items des "objectifs" (on ne jurait alors que par la "pédagogie par objectifs"), le premier stipulait cette commination impérieuse et porteuse de tout le programme élaboré par la cohorte des crânes d'œuf qui préside depuis cinquante ans aux destinées de l'Education Nationale, pour le plus grand malheur de celle-ci et de la France : « MAÎTRISER L'ORTHOGRAPHE ». Il aurait fallu demander sa recette au crâne d'œuf. Dans le cas présent, je m'interroge : l'auteur peut-il me citer une période où l'humanité fut gardienne de la planète ("redevenir") ?
***
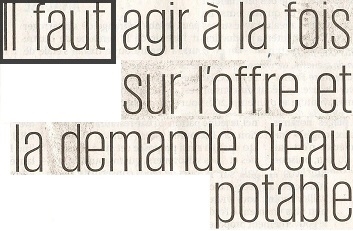
Traduction : attendez-vous à des restrictions !
***
Günther Anders est un philosophe. Il est l'auteur, entre autres, d'un ouvrage qui m'a profondément marqué : L'Obsolescence de l'homme, dans lequel il propose le concept de "honte prométhéenne" qui, à mon avis, résume et condense tout le problème des relations entre l'homme et la technique. "Prométhée", c'est l'audace, l'énergie, la créativité, l'inventivité phénoménales dont est capable l'humanité. "Honte", parce que l'homme se rend compte qu'il a donné naissance à des forces sur lesquelles il n'a plus aucune prise (exemple de la bombe atomique). Des forces incommensurables à sa petitesse : les Lilliputiens ont fabriqué Gulliver. Ils ont créé un "Golem".
Dans son bouquin, il évoque la figure d'Ernst Bloch, autre figure de la philosophie germanique, auteur, entre autres, de Le Principe espérance., mais c'est pour lui faire un reproche : « Il n'a pas eu le courage de cesser d'espérer, ne serait-ce qu'un moment ». Si Günther Anders avait été haut fonctionnaire obligé de rédiger une note de synthèse pour un ministre, nul doute qu'il aurait soigné les parties 1 - constat et 2 - analyse des causes, et qu'il aurait arrêté là son texte.
Pour lui, toutes les solutions partielles sont des illusions, voire des impostures. Pour lui, tous les "il faut" qui tentent d'aménager tel ou tel aspect du problème, et non de s'attaquer à la racine de celui-ci, sont autant de mensonges. Pour lui, c'est tout l'édifice de notre civilisation fondée sur la confiance aveugle en les bienfaits de la technique qui est une erreur à la base. Günther Anders reste un des seuls (le seul ?) à ne pas nous beurrer la tartine et à refuser de toujours "finir sur une note d'espoir".
CESSER D'ESPÉRER. Autrement dit : arrêter de rêver tout éveillé. Autrement dit : du tragique en philosophie. C'est ça que ça veut dire, "regarder la réalité en face".
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, journalistes, konk, front national, jean-marie le pen, emmanuel macron, président de la république, convention citoyenne, dennis meadows, joëlle zask, günther anders, l'obsolescence de l'homme, ernst bloch, le principe espérance, honte prométhéenne
mercredi, 19 juin 2019
ROMAIN GARY : CHARGE D'ÂME
 Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.
Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.
Marc Mathieu est la quintessence du physicien d’envergure einsteinienne, et il est reconnu comme tel par ses pairs : il passe son temps à chercher, et il trouve tellement qu’il constitue à lui tout seul la pointe avancée de toute la physique mondiale, l’explorateur ultime des confins du possible. Toute l’équipe du laboratoire où il travaille (le Cercle Erasme) est guidée par le « mot d’ordre » de Mao Tsé Toung : « L’énergie spirituelle doit être transformée en énergie matérielle » (p.39).
Marc Mathieu, ainsi que ses collaborateurs, prend cette phrase au pied de la lettre. Et bien que le savant ait un peu de mépris pour son collègue Chavez ("profiteur, exploiteur, applicateur" et un peu épais), c'est bien lui, Mathieu, malgré qu'il en ait, qui fera de ses recherches une réalité concrète, sur la base de : « ce qui peut être réalisé doit être réalisé » (p.133), où l'on reconnaît la philosophie intraitable de Günther Anders dans L'Obsolescence de l'homme. Déjà, page 60 : « On pouvait, à présent, et donc on devait aller plus loin » (Günther Anders : « –, on considère ce qui est possible comme absolument obligatoire, ce qui peut être fait comme devant absolument être fait », Editions Fario, p.17). La recherche fondamentale, la recherche pure ne travaille pas dans des abstractions définitives, et débouche toujours sur le monde réel, pour le meilleur et pour le pire. Jamais, dans toute l'histoire humaine, une grande découverte n'a été utilisée seulement pour le Bien : Satan est le complément nécessaire de Dieu.
Ici, il s’agit très concrètement de récupérer le souffle (« l’âme ») des gens au moment où ils meurent pour en faire le carburant révolutionnaire (« carburant avancé ») des moteurs et des machines. C’est d’ailleurs ce qui arrive à Albert, le chauffeur du laboratoire qui, en mourant, vient alimenter, grâce à un dispositif spécial, le moteur de la voiture de fonction. Le pauvre Albert le fait d’abord à contrecœur (le moteur hoquette), puis il s’y fait, et le moteur tourne rond. Malheureusement, le dispositif n'est en mesure de capter les "âmes" que dans un rayon de soixante-quinze mètres.
Marc Mathieu est français, quoique guère patriote : tout le fruit de ses découvertes, il le transmet aussitôt aux Américains et aux Russes, alors en pleine guerre froide. Toutes sortes de services secrets gravitent autour de lui en permanence, à l’affût de la moindre velléité de choisir un camp plutôt qu’un autre. Certains de ses collègues ne l'aiment pas, tel le cynique Kaplan : « C'est le genre de démagogue qui passe son temps à protester contre les conséquences de ses propres découvertes » (p.236).
Mais un collègue de Mathieu était porteur de la même idée : « Valenti, quant à lui, se laissait aller à un désespoir lyrique et passait ses journées, comme la plupart des savants, à signer des manifestes de protestation contre les conséquences pratiques de ses propres découvertes » (p.91). Message adressé à l'hypocrisie des optimistes qui pensent, contre toute raison, que "la technique est neutre, tout dépend de l'utilisation qui en est faite". Je pense au mot de Bossuet : « Dieu méprise les hommes qui méprisent les effets dont ils chérissent les causes ».
Marc Mathieu vit en compagnie d’une femme, May, qui le comble physiquement, précisément parce que, pense-t-il, elle est restée une créature primitive, presque animale, incapable d’accéder aux sphères intellectuelles les plus subtiles, où il se meut quant à lui, avec aisance : « Mathieu s’était dit mille fois que s’il trouvait un jour une femme incapable de le comprendre, ils pourraient être vraiment heureux ensemble. Le bonheur à deux exige une qualité très rare d’ignorance, d’incompréhension réciproque, pour que l’image merveilleuse que chacun avait inventée de l’autre demeure intacte, comme aux premiers instants » (p.62). Sans même évoquer l’idée de l’amour, Gary en fournit une condition éblouissante, qui fait penser, quoique sur une tout autre toile de fond, aux relations entre les sexes dans l’univers houellebecquien.
Au début de l’action, Marc Mathieu est sur la piste d’une énergie totalement nouvelle, de loin plus puissante et infiniment moins coûteuse que l’énergie nucléaire, dont il pressent qu’elle pourrait fournir l’arme absolue, une arme aux dimensions et aux effets quasi-divins, en même temps qu’une source d’énergie quasi-gratuite : l’âme des hommes.
Pour le moment, il bute sur une difficulté qui empêche de rendre la chose opérante : « Sur le tableau noir, les formules couraient dans tous les sens, mais c’était de l’art pour l’art, une pure jouissance esthétique. Elles ne menaient nulle part, n’ouvraient aucun chemin dans les terres vierges. Le souffle demeurait invisible. Le "craquage", c’est-à-dire la désintégration contrôlée indispensable à l’exploitation rationnelle, continuait à se dérober. La maudite unité refusait de se soumettre. Une sorte d’irréductibilité première, absolue. Il manquait une idée » (p.112).
Aussitôt que May, par peur ou scrupule, a rendu visite à l’ambassade américaine pour tenir les « alliés » au courant des dernières avancées, le colonel Starr est dépêché auprès du savant pour le sonder, le « conseiller », et s’il le faut, mais à la toute dernière extrémité, le tuer. Starr est un excellent espion, mais il est aussi et d’abord un tueur. Il arrivera à May, à l’occasion, d’aller voir aussi les Russes. On voit que les relations entre la femme et le savant ne sont pas évidentes, mais Marc Mathieu, tout entier absorbé dans la quête de son Graal, est bien au-delà des basses contingences terrestres.
Mais un jour, le colonel Starr vient le voir pour l’avertir que, s’il ne choisit pas à l’instant « le bon camp » (on devine lequel), il prend le risque d’être liquidé : son cerveau est devenu une menace pour l’équilibre mondial. Lui et ses supérieurs en sont convaincus : « Vous êtes parvenu à désintégrer le souffle, professeur ».
Il l’invite donc à continuer ses recherches en Californie, un avion est là qui attend. Le savant ose lui répondre : « A propos, pour votre information personnelle, colonel, j’ai fait mieux que désintégrer l’élément. "J’ai fait un pas au-delà" ». Après cette déclaration énigmatique et menaçante, Marc Mathieu et May disparaissent de la circulation, après avoir échappé à l’explosion d’une bombe, quelque part en Italie (le savant éloigne aussitôt la voiture, de crainte que l'âme de May soit "absorbée"). Où peuvent-ils bien avoir trouvé refuge, se demandent Américains et Russes ?
Leurs satellites-espions ne tardent pas à repérer l’étrange construction et la rapide extension d’une installation industrielle quelque part au nord de Tirana, dans « la vallée des Aigles ». Marc Mathieu a donc offert ses services à Imir Djuma, le terrible dictateur qui règne sur l’Albanie, qui a bien entendu accueilli le savant à bras ouverts. Mathieu a fait ce choix parce que la société albanaise est militarisée, disciplinée et formatée de la façon la plus pure, et que cette pureté est une condition expresse de la réussite de l’entreprise.
Ça n'empêche pas le savant de croiser le Christ, dans une scène de pure loufoquerie (« Evidemment que je vous connais. Avec vous et les autres ... Comment déjà ? Oppenheimer, Fermi, Niels Bohr, Sakharov, Teller ... Avec vous, c'est devenu scientifique. – Quoi ? Qu'est-ce qui est devenu scientifique ? – La Crucifixion. » (p.224-225). Mine de rien, Romain Gary lance une belle charge contre la science. Dans La Fête de l'insignifiance (Gallimard 2014), Milan Kundera place, me semble-t-il, une scène aussi loufoque sous une statue du jardin du Luxembourg, avec l'apparition de Staline et consort.
Ici se met en place un jeu qui relève à la fois de la farce et de la géopolitique. L’auteur trouve le ton qu’il fallait pour nourrir l’échange des dirigeants les plus puissants de la planète (USA, URSS, Chine) : il y a de quoi rire. Mais eux ne rigolent pas : ils décident de mettre en place un commando multinational qui devra, grâce à une machine spéciale à transporter sur place, réduire à néant la menace de disparition totale que fait peser sur la population mondiale la mise en route des installations albanaises.
L’usine a commencé à fonctionner. Les Albanais ont construit à proximité toute une série d’asiles où le pays rassemble tous les vieillards, pour que leur mort ne soit pas inutile à la nation, mais vienne alimenter l’usine en énergie : à l’instant fatidique, un collecteur judicieusement placé transmet l’âme du défunt à l’accumulateur central.
Le récit de l’opération de commando proprement dite est digne du film d’action, mais une fois le but atteint, il part un peu dans tous les sens, et le passage de la frontière avec la Yougoslavie donne tant soit peu dans le baroque. May et Marc Mathieu y trouvent la mort, pour le plus grand bienfait du moteur qui se remet en marche pour mener les survivants en lieu sûr.
Au total, un livre qui se lit avec grand plaisir, mais à coup sûr pas le meilleur de Romain Gary. Peut-être l'argument est-il trop tiré par les cheveux. Prenons-le pour une fable, mais qui n’arrive pas à se prendre assez constamment au sérieux. L'idée centrale tourne autour de l’hybris humaine, cette folie qui consiste à vouloir toujours repousser les limites, au mépris même de toute raison : « Le génie scientifique sonnait le glas de la démocratie, parce que seul le génie pouvait contrôler le génie. Et cela voulait dire que les peuples étaient à la merci d'une élite » (p.264).
La déraison humaine est correctement synthétisée dans cette formule qu’on trouve à la toute fin de la première partie : « Si jamais le monde est détruit, ce sera par un créateur » (p.143). Là, Gary pense peut-être à la bombe H. Charge d'âme est précisément une charge, moins contre la science en elle-même (quoique ...) que contre la sacralité dont la modernité habille la recherche scientifique, et contre les dégâts que son usage inconsidéré risque de commettre : « En quelques minutes, toute la litanie écologique se déversa sur ses lèvres. L'empoisonnement chimique des fleuves, mers et océans, la destruction de la faune, la mort des grandes forêts, des sources d'oxygène, l'élévation de la température du globe par suite de l'activité industrielle, qui menaçait la vie sur terre ...» (p.123). On est en 1977 !!! Franchement, y a-t-il quelque chose à enlever ou à corriger ? Romain Gary, écologiste visionnaire !
Car le message est limpide, quelque chose comme "l’humanité, à force d’outrepasser son humble mesure finira par se détruire elle-même", mais rendu plus ou moins inoffensif par l’ironie qui affleure en bien des points (par exemple dans la discussion entre le président américain et le patron de l'URSS). Romain Gary est-il ici très sérieux ? Au moment de la publication, il n'a plus rien à démontrer (il se suicide trois ans après), et il semble ici se moquer de donner à son roman à thèse la cohérence d'une forme achevée.
Comme si Charge d'âme était un roman testamentaire.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : une coquille marrante page 275 : « ... certains accumulateurs étaient utilisés comme tours de gué ; ... ».
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, romain gary, romain gary charge d'âme, éditions gallimard, collection pléiade, mao tsé toung, michel houellebecq, bombe atomique, écologie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, günther anders, l'obsolescence de l'homme
ROMAIN GARY : CHARGE D'ÂME
 Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.
Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.
Marc Mathieu est la quintessence du physicien d’envergure einsteinienne, et il est reconnu comme tel par ses pairs : il passe son temps à chercher, et il trouve tellement qu’il constitue à lui tout seul la pointe avancée de toute la physique mondiale, l’explorateur ultime des confins du possible. Toute l’équipe du laboratoire où il travaille (le Cercle Erasme) est guidée par le « mot d’ordre » de Mao Tsé Toung : « L’énergie spirituelle doit être transformée en énergie matérielle » (p.39).
Marc Mathieu, ainsi que ses collaborateurs, prend cette phrase au pied de la lettre. Et bien que le savant ait un peu de mépris pour son collègue Chavez ("profiteur, exploiteur, applicateur" et un peu épais), c'est bien lui, Mathieu, malgré qu'il en ait, qui fera de ses recherches une réalité concrète, sur la base de : « ce qui peut être réalisé doit être réalisé » (p.133), où l'on reconnaît la philosophie intraitable de Günther Anders dans L'Obsolescence de l'homme. Déjà, page 60 : « On pouvait, à présent, et donc on devait aller plus loin » (Günther Anders : « –, on considère ce qui est possible comme absolument obligatoire, ce qui peut être fait comme devant absolument être fait », Editions Fario, p.17). La recherche fondamentale, la recherche pure ne travaille pas dans des abstractions définitives, et débouche toujours sur le monde réel, pour le meilleur et pour le pire. Jamais, dans toute l'histoire humaine, une grande découverte n'a été utilisée seulement pour le Bien : Satan est le complément nécessaire de Dieu.
Ici, il s’agit très concrètement de récupérer le souffle (« l’âme ») des gens au moment où ils meurent pour en faire le carburant révolutionnaire (« carburant avancé ») des moteurs et des machines. C’est d’ailleurs ce qui arrive à Albert, le chauffeur du laboratoire qui, en mourant, vient alimenter, grâce à un dispositif spécial, le moteur de la voiture de fonction. Le pauvre Albert le fait d’abord à contrecœur (le moteur hoquette), puis il s’y fait, et le moteur tourne rond. Malheureusement, le dispositif n'est en mesure de capter les "âmes" que dans un rayon de soixante-quinze mètres.
Marc Mathieu est français, quoique guère patriote : tout le fruit de ses découvertes, il le transmet aussitôt aux Américains et aux Russes, alors en pleine guerre froide. Toutes sortes de services secrets gravitent autour de lui en permanence, à l’affût de la moindre velléité de choisir un camp plutôt qu’un autre. Certains de ses collègues ne l'aiment pas, tel le cynique Kaplan : « C'est le genre de démagogue qui passe son temps à protester contre les conséquences de ses propres découvertes » (p.236).
Mais un collègue de Mathieu était porteur de la même idée : « Valenti, quant à lui, se laissait aller à un désespoir lyrique et passait ses journées, comme la plupart des savants, à signer des manifestes de protestation contre les conséquences pratiques de ses propres découvertes » (p.91). Message adressé à l'hypocrisie des optimistes qui pensent, contre toute raison, que "la technique est neutre, tout dépend de l'utilisation qui en est faite". Je pense au mot de Bossuet : « Dieu méprise les hommes qui méprisent les effets dont ils chérissent les causes ».
Marc Mathieu vit en compagnie d’une femme, May, qui le comble physiquement, précisément parce que, pense-t-il, elle est restée une créature primitive, presque animale, incapable d’accéder aux sphères intellectuelles les plus subtiles, où il se meut quant à lui, avec aisance : « Mathieu s’était dit mille fois que s’il trouvait un jour une femme incapable de le comprendre, ils pourraient être vraiment heureux ensemble. Le bonheur à deux exige une qualité très rare d’ignorance, d’incompréhension réciproque, pour que l’image merveilleuse que chacun avait inventée de l’autre demeure intacte, comme aux premiers instants » (p.62). Sans même évoquer l’idée de l’amour, Gary en fournit une condition éblouissante, qui fait penser, quoique sur une tout autre toile de fond, aux relations entre les sexes dans l’univers houellebecquien.
Au début de l’action, Marc Mathieu est sur la piste d’une énergie totalement nouvelle, de loin plus puissante et infiniment moins coûteuse que l’énergie nucléaire, dont il pressent qu’elle pourrait fournir l’arme absolue, une arme aux dimensions et aux effets quasi-divins, en même temps qu’une source d’énergie quasi-gratuite : l’âme des hommes.
Pour le moment, il bute sur une difficulté qui empêche de rendre la chose opérante : « Sur le tableau noir, les formules couraient dans tous les sens, mais c’était de l’art pour l’art, une pure jouissance esthétique. Elles ne menaient nulle part, n’ouvraient aucun chemin dans les terres vierges. Le souffle demeurait invisible. Le "craquage", c’est-à-dire la désintégration contrôlée indispensable à l’exploitation rationnelle, continuait à se dérober. La maudite unité refusait de se soumettre. Une sorte d’irréductibilité première, absolue. Il manquait une idée » (p.112).
Aussitôt que May, par peur ou scrupule, a rendu visite à l’ambassade américaine pour tenir les « alliés » au courant des dernières avancées, le colonel Starr est dépêché auprès du savant pour le sonder, le « conseiller », et s’il le faut, mais à la toute dernière extrémité, le tuer. Starr est un excellent espion, mais il est aussi et d’abord un tueur. Il arrivera à May, à l’occasion, d’aller voir aussi les Russes. On voit que les relations entre la femme et le savant ne sont pas évidentes, mais Marc Mathieu, tout entier absorbé dans la quête de son Graal, est bien au-delà des basses contingences terrestres.
Mais un jour, le colonel Starr vient le voir pour l’avertir que, s’il ne choisit pas à l’instant « le bon camp » (on devine lequel), il prend le risque d’être liquidé : son cerveau est devenu une menace pour l’équilibre mondial. Lui et ses supérieurs en sont convaincus : « Vous êtes parvenu à désintégrer le souffle, professeur ».
Il l’invite donc à continuer ses recherches en Californie, un avion est là qui attend. Le savant ose lui répondre : « A propos, pour votre information personnelle, colonel, j’ai fait mieux que désintégrer l’élément. "J’ai fait un pas au-delà" ». Après cette déclaration énigmatique et menaçante, Marc Mathieu et May disparaissent de la circulation, après avoir échappé à l’explosion d’une bombe, quelque part en Italie (le savant éloigne aussitôt la voiture, de crainte que l'âme de May soit "absorbée"). Où peuvent-ils bien avoir trouvé refuge, se demandent Américains et Russes ?
Leurs satellites-espions ne tardent pas à repérer l’étrange construction et la rapide extension d’une installation industrielle quelque part au nord de Tirana, dans « la vallée des Aigles ». Marc Mathieu a donc offert ses services à Imir Djuma, le terrible dictateur qui règne sur l’Albanie, qui a bien entendu accueilli le savant à bras ouverts. Mathieu a fait ce choix parce que la société albanaise est militarisée, disciplinée et formatée de la façon la plus pure, et que cette pureté est une condition expresse de la réussite de l’entreprise.
Ça n'empêche pas le savant de croiser le Christ, dans une scène de pure loufoquerie (« Evidemment que je vous connais. Avec vous et les autres ... Comment déjà ? Oppenheimer, Fermi, Niels Bohr, Sakharov, Teller ... Avec vous, c'est devenu scientifique. – Quoi ? Qu'est-ce qui est devenu scientifique ? – La Crucifixion. » (p.224-225). Mine de rien, Romain Gary lance une belle charge contre la science. Dans La Fête de l'insignifiance (Gallimard 2014), Milan Kundera place, me semble-t-il, une scène aussi loufoque sous une statue du jardin du Luxembourg, avec l'apparition de Staline et consort.
Ici se met en place un jeu qui relève à la fois de la farce et de la géopolitique. L’auteur trouve le ton qu’il fallait pour nourrir l’échange des dirigeants les plus puissants de la planète (USA, URSS, Chine) : il y a de quoi rire. Mais eux ne rigolent pas : ils décident de mettre en place un commando multinational qui devra, grâce à une machine spéciale à transporter sur place, réduire à néant la menace de disparition totale que fait peser sur la population mondiale la mise en route des installations albanaises.
L’usine a commencé à fonctionner. Les Albanais ont construit à proximité toute une série d’asiles où le pays rassemble tous les vieillards, pour que leur mort ne soit pas inutile à la nation, mais vienne alimenter l’usine en énergie : à l’instant fatidique, un collecteur judicieusement placé transmet l’âme du défunt à l’accumulateur central.
Le récit de l’opération de commando proprement dite est digne du film d’action, mais une fois le but atteint, il part un peu dans tous les sens, et le passage de la frontière avec la Yougoslavie donne tant soit peu dans le baroque. May et Marc Mathieu y trouvent la mort, pour le plus grand bienfait du moteur qui se remet en marche pour mener les survivants en lieu sûr.
Au total, un livre qui se lit avec grand plaisir, mais à coup sûr pas le meilleur de Romain Gary. Peut-être l'argument est-il trop tiré par les cheveux. Prenons-le pour une fable, mais qui n’arrive pas à se prendre assez constamment au sérieux. L'idée centrale tourne autour de l’hybris humaine, cette folie qui consiste à vouloir toujours repousser les limites, au mépris même de toute raison : « Le génie scientifique sonnait le glas de la démocratie, parce que seul le génie pouvait contrôler le génie. Et cela voulait dire que les peuples étaient à la merci d'une élite » (p.264).
La déraison humaine est correctement synthétisée dans cette formule qu’on trouve à la toute fin de la première partie : « Si jamais le monde est détruit, ce sera par un créateur » (p.143). Là, Gary pense peut-être à la bombe H. Charge d'âme est précisément une charge, moins contre la science en elle-même (quoique ...) que contre la sacralité dont la modernité habille la recherche scientifique, et contre les dégâts que son usage inconsidéré risque de commettre : « En quelques minutes, toute la litanie écologique se déversa sur ses lèvres. L'empoisonnement chimique des fleuves, mers et océans, la destruction de la faune, la mort des grandes forêts, des sources d'oxygène, l'élévation de la température du globe par suite de l'activité industrielle, qui menaçait la vie sur terre ...» (p.123). On est en 1977 !!! Franchement, y a-t-il quelque chose à enlever ou à corriger ? Romain Gary, écologiste visionnaire !
Car le message est limpide, quelque chose comme "l’humanité, à force d’outrepasser son humble mesure finira par se détruire elle-même", mais rendu plus ou moins inoffensif par l’ironie qui affleure en bien des points (par exemple dans la discussion entre le président américain et le patron de l'URSS). Romain Gary est-il ici très sérieux ? Au moment de la publication, il n'a plus rien à démontrer (il se suicide trois ans après), et il semble ici se moquer de donner à son roman à thèse la cohérence d'une forme achevée.
Comme si Charge d'âme était un roman testamentaire.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : une coquille marrante page 275 : « ... certains accumulateurs étaient utilisés comme tours de gué ; ... ».
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, romain gary, romain gary charge d'âme, éditions gallimard, collection pléiade, mao tsé toung, michel houellebecq, bombe atomique, écologie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, günther anders, l'obsolescence de l'homme
mardi, 12 février 2019
J'AI LU SÉROTONINE 1
1 - La toile de fond.
J’ai donc lu Sérotonine de Michel Houellebecq. Je me garderai de faire l’éloge de l’auteur et de son roman. Je me garderai aussi de raconter l’histoire qu’on y trouve, au demeurant assez mince, où le scénario ressemble assez à l’idée qu’on se fait d'une « marche au supplice », mais dans un état proche de l'hébétude (je crois que c'est dans Ennemis publics (2008) qu'on trouve ce mot sous la plume de l'auteur pour qualifier sa propre attitude). Aujourd'hui, je me contenterai de dire, aussi directement que possible, les réflexions que m’inspire la lecture de ce livre.
Ce n’est pas forcément facile. D’abord la question du style. Bien des « gens autorisés » lui reprochent sa platitude, sans se rendre compte que cette platitude correspond en tout point au projet littéraire : un style volontairement décharné au milieu et famélique sur les bords, sans belles phrases, sans substance charnue, l’image exacte du « moi » de Florent-Claude Labrouste, le protagoniste. De toute façon, Houellebecq a répondu par avance à toute critique de son style dans sa Lettre à Lakis Proguidis (1997) : « Pour tenir le coup, je me suis souvent répété cette phrase de Schopenhauer : "La première – et pratiquement la seule – condition d’un bon style, c’est d’avoir quelque chose à dire." ». « Quelque chose à dire » ! Pour ça, on peut lui faire confiance.
Ce projet, quel est-il ? Je ne suis pas dans la tête de celui qui l’a conçu et réalisé, mais il ne me semble pas absurde de le formuler ainsi : « Description méticuleuse de la loque intérieure que la civilisation occidentale, matérialiste et consommationniste, a faite de l’individu ». Une loque intérieure, le sac vide de la peau de Saint Barthélémy, qui fut écorché, comme on sait. Voilà l'individu occidental tel que Houellebecq nous le montre, à travers le personnage de Florent-Claude Labrouste.

Visible sur le mur du fond de la Sixtine.
Je n’ai pas réussi à retrouver dans quel texte Houellebecq émet explicitement cette idée de l'inanité infligée par la civilisation technique à l'individu moderne, mais il me semble bien que. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, à la lecture de Sérotonine, j’ai retrouvé l’impression produite par Extension du domaine de la lutte, où le personnage, éprouvant la liquéfaction de ses raisons de vivre, fait face à ce vide.
Comment s’y est prise notre civilisation pour aboutir à ce paysage intérieur dévasté ? C’est la question cruciale que posent les romans de Houellebecq en général, et celui-ci en particulier.
J’essaie de comprendre depuis longtemps comment cette civilisation, qui a façonné le monde d'aujourd'hui de façon ineffaçable (non, pas de jugement de valeur : un fait), a pu aboutir à cette façon de désastre humain. C'est sûr, notre romancier est loin d’être le premier ni le seul à faire ce constat. Mais il est certainement le seul à donner à celui-ci une forme littéraire aussi achevée, aussi pertinente.
Oui, comment en est-on arrivé là ? A cette question, du point de vue qui est le mien au fond de mon terrier, je réponds qu’il y a d’abord la production des objets, renforcée plus tard par leur promotion, au moyen de la publicité, cette arme de décervelage massif : la marchandise s’est imposée en tant que « bien » dans nos représentations du monde, disant au « moi » de l'individu : "Ôte-toi de là que j'm'y mette". Houellebecq le dit : « ... la publicité vise à vaporiser le sujet pour le transformer en fantôme obéissant du devenir » (Approches du désarroi, 1992). Comment fonctionne l'image publicitaire ? C'est tout simple : en conduisant l'énergie du désir vers un objet marchand. Le désir humain réduit à la marchandise. De ce point de vue, tout ce qui est humain est transformé en marchandise.
De « moyen » qu’elle était, la marchandise, élevée à la dignité de « fin » par la publicité, a acquis, grâce à celle-ci, une aura, un surcroît de dignité, une intensité d'« être » supplémentaire, quoique fantomatique. Elle a progressivement gagné du terrain dans nos imaginaires, occupant de plus en plus de place dans nos désirs, les dirigeant toujours davantage vers le monde des objets et se substituant à d’autres désirs, qui venaient auparavant de l’intérieur. La publicité est même devenue un objet d’étude à part entière, jusqu’au sein de l’université, c’est vous dire que la moisissure a gagné le centre du cerveau.
Et puis sont arrivés les moyens de communication de masse. Après le téléphone, première intrusion du monde extérieur dans l'univers domestique et première « connexion », il y eut d’abord la radio, dont l’écoute, dans le premier 20ème siècle, nous est presque présentée comme religieuse, la famille réunie communiant autour du « poste ».

C’est précisément contre l’irruption de la radio dans le cercle familial que s’insurge violemment le philosophe Günther Anders dans L’Obsolescence de l’homme, au motif qu’elle capte toute l’énergie d’attention que son absence permettait de consacrer à ses proches. Elle capte l’oreille de l’auditeur, c’est-à-dire qu’elle le rend captif et le détourne de sa propre existence. Le chant des sirènes, quoi.
La radio est, selon Anders, un intrus, un parasite, une interférence qui s’interpose indûment comme un écran entre les personnes qui vivent sous le même toit, induisant une forme de relâchement dans leurs relations. Il n’a pas complètement tort, même si l’appareil en question s’est fondu dans le paysage avec le temps, au point que tout le monde vit avec et que son absence paraît presque inconvenante.
Quant à la télévision, c'est pire, car si l’effet de la radio n’est pas niable, mais somme toute limité, l’évidence est encore plus éclatante s’agissant du petit écran, et son effet encore plus dévastateur : la fascination produite sur les gens présents dans la pièce est telle que les regards sont irrésistiblement attirés par l’image animée, et plus personne ne s’adresse à son voisin. Bon, c’est vrai, je me rappelle des soirées chez M. Bachelard, à Tence, quand la télé était encore rare (et en NB) : l’ambiance était souvent déchaînée lors des premiers Interville (Guy Lux, Léon Zitrone, Simone Garnier).
Même chose pour le Tournoi des 5 nations regardé en famille et commenté par Roger Couderc (« Allez les petits ! ») ou, en 1990, au camping de Mamaia, sur la Mer Noire, où cinquante personnes et plus se rassemblaient le soir venu devant la lucarne allumée. Cela ne change rien au diagnostic : la télé impose son ordre aux individus, comme la flamme attire les phalènes, faisant de chaque téléspectateur une solitude à côté des autres solitudes. La télé emporte dans son nulle part, morceau par morceau, la vie intérieure de l'individu, pour la remplacer par une foule innombrable de fantômes. L'individu moderne est habité par des fantômes qui, dans le miroir, ont tellement pris son aspect qu'il les prend pour lui-même.
Le stade provisoirement ultime de ce processus de dépossession de soi par les moyens de communication de masse est évidemment atteint par le déferlement récent du smartphone sur le pauvre monde. Chacun emporte avec lui, dans tous ses mouvements, sa radio, sa télé, son téléphone, sa machine à écrire. Et sous ce volume restreint et maniable, il emporte tout son « moi », qu'il a « externalisé » (essayez de l'en priver, pour voir !). Et beaucoup d’utilisateurs tiennent ce « moi » à la main en toute circonstance, prêts à répondre dans l’instant au moindre stimulus. Le plus renversant dans l'affaire, c'est l'ahurissant degré de consentement des individus à la chose, au motif diabolique que « ça peut rendre bien des services ». L'innovation technologique, c'est Ève tendant la pomme à Adam. C'est Faust tenté par Méphisto.
Par-dessus tout ça, la faculté de se connecter avec la planète entière dès qu’on le veut : grâce à cet outil, l’individu ressemble à l’araignée qui, au centre de sa toile, semble exercer un pouvoir absolu sur son entourage immédiat (fût-il au bout du monde), sauf que si ça lui donne l’impression de vivre intensément l’instant présent (ne rien manquer de ce qui se dit, se sait, se raconte, ...), il n’a jamais été aussi réellement seul.
Pas de plus flagrante image de solitude que celle de passagers du bus ou du métro concentrés sur ce qui se passe sur leurs écrans personnels : l’individu est réduit à lui seul, et les autres, bien concrets dans leur chair et leurs os, bien palpitants de vie, ont disparu. Le smartphone a réinventé l’onanisme social, cette "délectation morose". Comment une quelconque société digne de ce nom pourrait-elle survivre en tant que société dans ce contexte ? Un jour viendra peut-être (on peut rêver) où les individus se rendront compte que, loin d'être des araignées au centre de leur toile, ils sont la mouche qui vient se prendre dans les filets tissés par d'autres gourmands arthropodes.
Ainsi, étape après étape, la civilisation technique a trouvé des moyens de plus en plus sophistiqués de s'introduire dans la conscience, dans la mémoire, dans les affects, dans les goûts, dans les choix des individus, pour remplacer ce qui tenait autrefois à leur "personnalité propre" par une personnalité d'emprunt, largement virtuelle, largement fabriquée par une instance extérieure, et beaucoup plus docile aux exigences du système. Et avec le siphonnage des données personnelles par facebook et consort, le système n'a pas fini de vider l'individu de son « moi ». Houellebecq le dit (Approches du désarroi) : « Les techniques d'apprentissage du changement popularisées par les ateliers "New Age" se donnent pour objectif de créer des individus indéfiniment mutables, débarrassés de toute rigidité intellectuelle ou émotionnelle ». Les gens ne savent plus où se trouve leur désir : ils ont perdu la source d'eux-mêmes.
C’est cette invasion progressive du moi par des sollicitations extérieures, dotées de toutes les apparences de la proximité, de la vie et de la familiarité, qui fait dire à Georges Bernanos (je crois bien que c’est dans La France contre les robots, 1944) que la civilisation technique est « une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure » : dépossédé de lui-même, l’individu ne s’appartient plus, il appartient corps et âme à toutes les réquisitions qui ne cessent de le convoquer hors de lui, en provenance du monde extérieur (fil twitter, facebook, telegram, instagram, amstramgram, …). Il ne peut plus être dans l’action : il est paralysé dans la réaction à ce qui vient du dehors.
Le moi individuel s’en trouve fragmenté en autant de petits bouts que de sollicitations reçues. Car le pire, c’est que ces petits bouts, en s’accumulant, ont fini par former une foule fantomatique qui s’agite à l’intérieur et qui, en le remplissant d’artefacts, lui a refaçonné un « moi » presque complet (et constamment renouvelé par un flux permanent, parfois obsessionnel), un « moi » exogène sur lequel l’individu a de moins en moins de prise (et je ne parle pas de la relation au temps : il peut oublier son texto d'il y a dix minutes, seul le « réseau » n’oubliera rien de ce qu’il y a laissé). Dans ces conditions, peut-on encore parler de volonté ? De libre-arbitre ? Dans l’expression du « désir », impossible de savoir quelle est la part du « moi » authentique et la part de propagande ingurgitée. C'est peut-être pour ça que Michel Houellebecq se méfie du désir : « Si l'on considère que le désir est mauvais, ce qui est mon cas ... » (Entretien avec Christian Authier, 2002).
C’est si vrai que la crise des gilets jaunes a mis en lumière l’illusion de susciter une relation humaine au moyen de « l’ouverture » électronique sur le monde : combien de fois n’a-t-on pas entendu parler, au cours des reportages sur les ronds-points, d’une forme neuve de « socialisation », certains allant même jusqu’à déclarer qu’ils avaient trouvé une espèce de « famille » ? Preuve que la vraie socialisation passe par la relation interpersonnelle directe. Un « réseau », ça vous bombarde de propagandes diverses ou d’éructations haineuses : c’est bon pour fixer des rendez-vous, pas pour se faire d’improbables « amis ».
Alors Houellebecq, dans tout ça ? Eh bien selon moi, avec Sérotonine, on est en plein dans ce paysage, perdu au milieu de nulle part, seul. La plus forte impression d’ensemble qui se dégage du livre est vraiment le sentiment d’une solitude irréparable et définitive, une solitude dense, massive et compacte, qui s’épaissit à mesure que le moi du personnage se met à flotter et à se diluer dans l’air, de plus en plus évanescent. Je connais peu d'écrivains capables de traduire en littérature avec une telle justesse le sort commun fait par le monde réel à l'individu ordinaire. Il faut beaucoup de compassion envers l'espèce humaine pour donner une forme littéraire aussi accomplie au désespoir. Je peux me tromper, mais je persiste à penser que Michel Houellebecq appartient à cette espèce d'hommes qui ont nourri un espoir infini dans l'avenir de l'humanité, et qui se sont cassé le nez sur la réalité. Peut-être son ambition est-elle de traduire en littérature l'absolu de la DÉCEPTION.
Tel est, selon moi, le paysage humain qui sert de territoire aux personnages de Michel Houellebecq, et en l’occurrence à Florent-Claude Labrouste.
Tout ça pour dire à quel point Sérotonine parle du monde tel qu'il est, et à quel point il entre en résonance avec l'idée que je m'en fais.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : Prochainement, quelque chose de plus consistant sur le livre lui-même.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, sérotonine, florent-claude labrouste, éditions flammarion, georges bernanos, la france contre les robots, twitter, facebook, instagram, smartphone, lettre à lakis proguidis, interventions 2, extension du domaine de la lutet, approches du désarroi, günther anders, l'obsolescence de l'homme, adam et ève, faust et méphisto
jeudi, 17 janvier 2019
HOUELLEBECQ
Je recycle aujourd'hui, en une seule fois, deux billets écrits en 2011 sur deux livres de Michel Houellebecq, au moment où je venais enfin de comprendre, grâce à La Carte et le territoire, l'importance de ses romans. Pourquoi "importance" ? Après tout ce temps, je crois y voir une figuration assez exacte de ce qui achemine la civilisation occidentale vers sa déchéance actuelle et sa destruction prochaine. Le système communiste a implosé, comme on sait, c'est-à-dire qu'il s'est effondré de l'intérieur, sous le poids de sa propre sénilité. Et je me demande si le même destin ne guette pas le système capitaliste, aujourd'hui encore tout fringant et triomphant, mais travaillé de l'intérieur par des forces que nul n'est capable de comprendre dans leur globalité et leurs interactions. J'ai beaucoup élagué tout ce qui m'est apparu superflu à la relecture (digressions, etc). J'ai laissé tout le reste. Je dois reconnaître que je n'ai guère développé le commentaire sur Plateforme. Un signe ? Mais de quoi ?


J’ai mis beaucoup de temps avant d’ouvrir un livre de Michel Houellebecq. Ce qui me repoussait, je crois l’avoir dit ici, c’est la controverse : il y a quelque chose de si futilement médiatique dans la présence éphémère du parfum de quelques noms dans l’air du temps, que je tenais celui-ci pour tout à fait artificiel, voire carrément illusoire, comme c’est le cas de la plupart des effervescences télévisuelles. Je suis devenu excessivement méfiant. En l’occurrence, j’avais tort.
J’ai donc commencé la lecture de Michel Houellebecq quand son dernier roman, La Carte et le territoire, fut placé, un peu par hasard, à proximité immédiate de ma main. J’ai dit grand bien du livre dans ce blog. J’en ai maintenant accroché deux autres à mon tableau de chasse : Les Particules élémentaires et Plateforme. Conclusion, vous allez me demander ? Voilà : je ne sais pas si on a à faire à un « grand » écrivain, je ne sais pas si ce sont des « chefs d’œuvre », comme les critiques patentés en décèlent à foison au fil des semaines. Je veux juste dire que ce sont des livres qui se situent au centre du paysage, pour qui espère comprendre quelque chose à la marche du monde actuel.
Donc, je ne sais pas si Michel Houellebecq est le digne successeur de Balzac et Proust. Ce que je sais, c’est qu’il travaille sur le monde qu’il a sous les yeux, qu’il dit quelque chose du monde tel qu’il est, et qu’il développe sur celui-ci un point de vue, une analyse, une proposition d’éclairage précise, une grille de lecture, si l’on veut.
C’est un romancier qui a pris position par rapport à la « civilisation occidentale », et qui a ceci de bien, s’il parle de lui, de le faire à distance respectable, hors de portée de tir de son propre nombril (malgré les apparences) et des ravages courants que celui-ci commet dans les rangs des « écrivains » français.
On peut trouver le point de vue développé par Michel Houellebecq d’une noirceur exécrable : pour résumer, grâce à la civilisation actuelle, exportée par l’Europe, moulinée avec la sauce techniquante, massifiante et consommante de l’Amérique triomphante, le monde actuel court à sa perte et, d’une certaine façon, est déjà perdu.
L’auteur met-il pour autant ses pas dans ceux de Philippe Muray, comme je l’ai suggéré ? Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que Philippe Muray a développé dès les années 1980 un regard analogue sur la réalité, d’une acuité de plus en plus grande, et un regard de plus en plus pessimiste.
Avant lui, plusieurs auteurs se sont inquiétés de l’évolution de notre monde : Günther Anders (L’Obsolescence de l’homme), Lewis Mumford (Les Transformations de l’homme), Hannah Arendt (La Crise de la culture), Christopher Lasch (La Culture du narcissisme), Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique), Guy Debord (La Société du spectacle), et quelques autres.
Pardon pour l’étalage, mais c’est parce qu’il y a un peu de tous ces regards dans les romans de Michel Houellebecq, tout au moins les trois que j’ai lus (publiés en 1998, 2001 et 2010, ce qui révèle quand même une certaine constance). La « patte » de Philippe Muray, c’est l’attention portée à un aspect particulier de la crise moderne : l’humanité est devenue peu à peu superflue, submergée par des objets techniques, des gadgets qui sont devenus pour elle si « naturels », mais en même temps si dominateurs, qu’elle est progressivement devenue une vulgaire prothèse de ses propres inventions. Philippe Muray le synthétise dans la notion de fête, dans l’abolition de tout ce qui permettait la différenciation (en particulier entre les sexes), dans le nivellement de toutes les « valeurs », et dans l'instauration unilatérale du règne de la positivité en tout, autrement dit de l'Empire du Bien (un des titres des Essais, éd. Les Belles lettres, 1991).
Les Particules élémentaires est un roman qui raconte quelle histoire, en fin de compte ? Janine Ceccaldi, une fille aux capacités intellectuelles hors du commun, épouse Serge Clément, qui entrevoit déjà (on est dans les années 1950) les immenses possibilités de la chirurgie esthétique. Puis elle rencontre Marc Djerzinski, homme talentueux qui œuvre dans le cinéma. Elle divorce pour l’épouser. De ces deux unions naîtront deux demi-frères : Bruno Clément et Michel Djerzinski.
Il y a donc l’histoire de Janine en pointillé. L’histoire d’Annabelle, qui a failli vivre une « belle histoire d’amour » avec Michel. L’histoire des ratages de Bruno qui, en compagnie de Christiane ou sans elle, hantera divers lieux où il espère connaître quelque aventure sexuelle.
A travers le personnage un peu pathétique de Janine, la mère, qui se fait appeler Jane, se formule une description somme toute caustique de l’ère baba-cool : délaissant les deux pères de ses enfants (et ses deux enfants par la même occasion), elle suit un genre de gourou, Francesco Di Meola, qui, s’étant fait pas mal d’argent, abandonne la Californie et Big Sur, où il a rencontré les dieux et les diables de la contre-culture, y compris l’imposteur Carlos Castaneda, celui qui était entiché de son sorcier yaqui, Don Juan Matus, dont il vendit les bobards à des millions d’exemplaires (mais ça, ce n’est pas dans le livre de Michel Houellebecq). Di Meola achète une propriété en Provence.
Janine-Jane (la mère) a baigné dans le jus contre-culturel, mais ce jus a tourné, ou alors il a aigri. Le bilan de son existence est « nettement plus catastrophique ». Et la mère des deux frangins aura une triste fin, dans une maison du village de Saorge, où vivent encore quelques illuminés post-soixante-huitards, dont « Hippie-le-Gris » et « Hippie-le-Noir », que Bruno appelle Ducon.
La scène est curieuse. Bruno est sous traitement de lithium pour raisons psychiatriques.
« Michel observa la créature brunâtre, tassée au fond de son lit, qui les suivit du regard alors qu’ils pénétraient dans la pièce. » Quant à Bruno, tout ce qu’il arrive à dire : « Tu n’es qu’une vieille pute… émit-il d’un ton didactique. Tu mérites de crever. ». « T’as voulu être incinérée ? Poursuivit Bruno avec verve. A la bonne heure, tu seras incinérée. Je mettrai ce qui restera de toi dans un pot, et tous les matins, au réveil, je pisserai sur tes cendres. »
Il y a souvent des problèmes, chez Michel Houellebecq, avec la transmission et avec la filiation. Un moment vaguement hallucinant, où Bruno se met à entonner à pleine voix "Elle va mourir la mamma", tout en insultant à qui mieux-mieux les hippies qui, d'après le testament maternel, vont hériter de la maison.
Face à Bruno, qui débloque sévèrement, le littéraire raté et hors du coup, Michel Houellebecq fait de Michel, en dehors d’un errant affectif quasiment indifférent à tout ce qui est humain, un biologiste à la pointe du « progrès », disons-le, une sorte de génie : son « testament » de chercheur s’intitule Prolégomènes à la réplication parfaite. Michel ne veut pas être emmerdé par les tribulations humaines ordinaires. Peut-être est-ce ce qui guide ses recherches.
Car ce testament s'avère porteur de tout l'avenir scientifique de l'humanité. Chacune de ses propositions révolutionnaires en sera plus tard dûment et scientifiquement prouvée. Autrement dit, le point culminant de son travail ouvre la voie à l’admission du clonage humain comme fondement institutionnel de l’humanité, ce qui débarrasse l'ancienne humanité (la nôtre) de tout le poids sentimental qui l'écrase.
Le livre évoque, depuis un moment du futur, l’extinction de la vieille race humaine. « On est même surpris de voir avec quelle douceur, quelle résignation, et peut-être quel secret soulagement les humains ont consenti à leur propre disparition. » [16 janvier : cela me fait penser à Soumission et à l'évidence tranquille avec laquelle l'islam s'impose en France en 2022.] On perçoit en positif cette post-humanité, qui adresse in fine sa gratitude à l’humanité archaïque : « Cette espèce aussi qui, pour la première fois de l’histoire du monde, sut envisager la possibilité de son propre dépassement ; et qui, quelques années plus tard, sut mettre ce dépassement en pratique ».
On est alors quelque part, dans ce regard rétrospectif, à la fin du 21ème siècle. Et la post-humanité rend alors hommage à l’humanité (la nôtre), qui fut si défectueuse, mais si touchante aussi. Glaçant, et très fort. Quand on ferme le livre, on se prend à espérer que c’est de la science-fiction. Mais ce n’est pas sûr.
La Carte et le territoire offrait une perspective analogue sur la disparition programmée de l’humanité, à travers l’œuvre en mouvement de Jed Martin, présenté comme un grand artiste de son temps. Plateforme nous plonge dans la décadence sexuelle de l'Occident en général et de l’Europe vieillissante en particulier. Le personnage principal, qui se nomme là encore Michel, est un obscur fonctionnaire aux Affaires Culturelles, un statut social négligeable. Au début du livre, Michel, qui vient de perdre son père, participe à un voyage organisé en Thaïlande. Il passe bien sûr par des « salons de massage ». Valérie fait partie du groupe, un groupe triste, hétérogène, et bête, avec ça !
Revenu à Paris, il démarre une relation vraiment amoureuse avec Valérie, qui travaille dans une entreprise de tourisme, sous la direction de Jean-Yves. Lui et Valérie, professionnellement, sont complémentaires. Ils gagnent confortablement leur vie. Une opportunité les propulse à la tête des villages Eldorador.
C’est dans un village de Cuba que Michel suggère à Jean-Yves, pour rétablir la situation de la société, de faire de ses villages des destinations pour un tourisme, disons … « de charme ». Tout se goupille à merveille, et l’entreprise est florissante, mais ces salauds d’islamistes feront tout capoter, avec à la clé l’insurrection de tout le féminisme français contre l’esclavage dégradant et le tourisme sexuel.
C’est sûr, l’humanité de Michel Houellebecq n’est pas belle à voir. Au fond, autant vaut qu’elle disparaisse, n’est-ce pas ? J'ai l'impression que les romans de Michel Houellebecq sont des applications romanesques pratiques de la pensée de Günther Anders (L'obsolescence de l'homme), de Hannah Arendt et de Guy Debord. Et le pire, c'est que ces romans paraissent être à peine de la science-fiction. Ce sont, et c'est Philippe Muray qui le dit à propos des Particules élémentaires, des romans de la fin. Très juste.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, les particules élémentaires, plateforme, la carte et le territoire, günther anders, l'obsolescence de l'homme, hannah arendt, la crise de la culture, christopher lasch, la culture du narcissisme, jacques ellul, guy debord, la société du spectacle, philippe muray, festivus festivus, l'empire du bien
vendredi, 02 novembre 2018
CLIMAT : L’ACTUALITÉ ENFONCE LE CLOU
Dans la série "Des nouvelles de l'état du monde" (N°68).
Et puis voilà, c'est au tour du vénérable et renommé WWF de tirer la sonnette d'alarme : d'après l'ONG "militante" (c'est ce qu'on dit), ce sont 40% des vertébrés qui ont d'ores et déjà disparu de la surface de la Terre depuis les années 1970. Je me dis juste qu'ils ont mis un sacré bout de temps à s'en apercevoir : l'information figurait en toutes lettres (en plus grave) dans le célèbre article du Monde (vous vous rappelez, 15.000 scientifiques, etc.) daté du 14 novembre 2017 !

Cinquante semaines pour assimiler la chose, il faut le faire. Un cri d'alarme qui laisse définitivement rêveur sur l'efficacité supposée des cris d'alarme. On se dit en effet qu'il ne sert à rien de crier si c'est juste pour occuper un créneau d'information parmi la multitude des créneaux d'information. Un clou chasse l'autre.
***
Et puis c'est au tour de l'OMS de dénoncer la surmortalité des enfants du fait de la pollution : 600.000 par an. Je me souviens en effet des trajets forcés le long de l'avenue du Châter à Francheville à pousser la poussette sous la gueule des énormes pots d'échappement des poids lourds interdits de tunnel de Fourvière, et qui empruntaient cet itinéraire de déviation. Rien d'étonnant à ce que les enfants soient les premières victimes. Les gaz d'échappement des moteurs de camions, je crois que c'est à Sobibor que les nazis s'en servaient : il ne fallait pas longtemps, dans le fourgon spécialement branché, pour obtenir le résultat attendu.
Bon, on se dit qu'à l'air libre, les vents dispersent mieux les miasmes que dans ces atmosphères confinées. On se rassure comme on peut : comme dit Günther Anders, l'humanité n'a plus besoin de Hitler pour s'autodétruire : « Bref, le monde des instruments nous met au pas d'une façon plus dictatoriale, plus irrésistible et plus inévitable que la terreur ou la supposée vision du monde d'un dictateur ne pourrait jamais le faire, n'a jamais pu le faire. Aujourd'hui, Hitler et Staline sont inutiles » (L'Obsolescence de l'homme, II, éditions Fario, 2011, p.204, chapitre "L'obsolescence du conformisme, 1958").
Je n'invente rien et ce n'est pas moi qui le dis : aujourd'hui, Hitler et Staline sont inutiles. La folie technique qui saisit plus que jamais l'humanité a pris le relais pour faire le même job. Sous l’œil vigilant du Comité d'Ethique. Moi, ça fait longtemps que je suis convaincu qu'Hitler et Staline ne sont pas des monstres ou des aberrations rendues possibles dans des systèmes devenus fous. Je suis au contraire convaincu qu'Hitler et Staline sont des aboutissements logiques, qu'ils ont été produits par une conjonction de facteurs où l'appétit de pouvoir et la puissance technique jouent les premiers rôles.
Et que notre "morale" moralisatrice a inscrit dans ses "valeurs sacrées" bien des "trouvailles" de l'un et de l'autre, mais qu'elle les a habillées (nommées) autrement, pour pouvoir continuer à condamner ces épouvantails comme figures de l'horreur absolue (une preuve flagrante dans l'eugénisme, que la médecine actuelle pratique sans états d'âme : combien d'anormaux arrivent aujourd'hui à terme ? Je pose juste la question.).
Et cela permet de comprendre pourquoi sont arrivés au pouvoir, à la demande du corps électoral, plusieurs Hitler au petit pied (Bolsonaro étant le dernier en date) désireux de se débarrasser au plus tôt des garanties qu'offre l'état de droit. Le "populisme" porté démocratiquement au pouvoir est un aboutissement logique : ce qu'on appelle "populisme" est lui aussi le produit d'une conjonction de facteurs au centre desquels on peut placer le mépris de toutes les élites pour le "peuple" concret et la tyrannie exercée par l'économie triomphante.
***
Et puis c'est au tour de France Culture de dénoncer l'action des lobbies, mardi 30 octobre, dans l'émission "La grande table" (animée par l'implacable douceur d'Olivia Gesbert avec ses questions doucereuses et très exactement conformes à l'air du temps). Stéphane Horel, "journaliste indépendante d'investigation et documentariste" vient de publier Lobbytomie. Comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie (La Découverte, 2018, après Happycratie, de je ne sais plus qui, ça devient une mode. Lobbytomie, le titre est sans doute choisi par l'éditeur : je ne dis pas bravo, je préfère le sérieux à l'expression choc).
La dame a eu une grosse demi-heure pour exposer en détail une petite partie des petites et grosses ignominies que les "groupes de pression" commettent – en usant de moyens considérables – dans la discrétion feutrée des couloirs, des antichambres et des cabinets pour qu'aucun dommage ne soit causé aux énormes profits des grosses et très grosses entreprises. Quelles que soient les conséquences sur l'air, l'eau et les sols, et accessoirement la santé des populations.
Je reprocherai juste à madame Horel de ne pas citer une seule fois le nom de Naomi Oreskes qui, avec Erik Conway, avait publié en 2012 une bible irremplaçable, au titre limpide quant à lui, sur le même sujet : Les Marchands de doute, qui jetait une lumière crue, entre bien d'autres réalités scandaleuses, sur les pratiques douteuses de certains "scientifiques" capables de vendre (cher) leur signature pour entretenir la controverse, même sur des questions recueillant un large consensus de la communauté scientifique sérieuse. Le doute profite à l'empoisonneur. Et entretenir sciemment le doute contre toute évidence pour éviter ou retarder les décisions désagréables est un métier à temps plein et grassement payé.
N'a-t-on pas entendu très récemment (ces derniers jours) le nouveau ministre de l'agriculture demander à tous les opposants au glyphosate d'apporter la preuve de la nocivité des pesticides ? Pensez-vous qu'il oserait demander aux industriels de la chimie agricole, avant d'autoriser leurs produits, de prouver leur innocuité ? Que nenni, voyons ! Ne rêvons pas.
***
Quoi qu'il en soit, depuis quelque temps, les choses s'accélèrent et tout le monde semble s'y mettre. Tout au moins en France. D'un côté, je me dis que c'est plutôt bon signe ("coquelicots", "marches pour le climat", ...). D'un autre côté ...
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wwf, world wildlife fund, ong, biodiversité, disparition des vertébrés, journal le monde, 15.000 scientifiques, oms, günther anders, l'obsolescence de l'homme, france culture, lobbies, émission la grande table, olivia gesbert, stéphane horel, lobbytomie, happycratie, éditions la décrouverte, naomi oreskes erik conway, les marchands de doute, sobibor, avenue du châter, francheville 69340, francheville rhône
jeudi, 01 novembre 2018
CLIMAT : CESSER D’ESPÉRER
Dans la série "Des nouvelles de l'état du monde" (N°67).
« Ce n'est donc pas parce qu'elle est une découverte de la physique — même si elle l'est aussi — que l'énergie nucléaire est le symbole de la troisième révolution industrielle, mais parce que son effet possible ou réel est de nature métaphysique, ce qu'on ne peut dire d'aucun autre effet antérieur ayant une cause humaine. Je qualifie de "métaphysique" et non d'"épochal" l'effet de l'énergie nucléaire parce que l'adjectif "épochal" suppose encore comme une évidence la continuation de l'histoire et l'avènement de nouvelles époques, une supposition qui ne nous est justement plus permise à nous, hommes d'aujourd'hui. L'époque des changements d'époque est passée depuis 1945. Nous ne vivons plus à présent une époque de transition précédant d'autres époques, mais un "délai" tout au long duquel notre être ne sera plus qu'un "être-juste-encore". L'obsolescence d'Ernst Bloch, qui s'est opposé au simple fait de prendre en compte l'événement Hiroshima, a consisté dans sa croyance — aboutissant presque à une forme d'indolence — selon laquelle nous continuons à vivre dans un "pas-encore", c'est-à-dire dans une "pré-histoire" précédant l'authenticité. Il n'a pas eu le courage de cesser d'espérer [c'est moi qui souligne], ne serait-ce qu'un moment. Peu importe qu'elle se termine maintenant ou qu'elle dure encore, notre époque est et restera la dernière, parce que la dangereuse situation dans laquelle nous nous somme mis avec notre spectaculaire produit, qui est devenu le signe de Caïn de notre existence, ne peut plus prendre fin — si ce n'est pas l'avènement de la fin elle-même.
Cette troisième révolution est donc la dernière. »

Günther Anders, L'Obsolescence de l'homme, II, Editions Fario, 2011, p. 20-21.
Introduction : les trois révolutions industrielles, 1979.
Note : Ernst Bloch est un philosophe allemand, défenseur de la notion d'utopie, dont l'oeuvre principale est la somme intitulée Le Principe espérance. Mais Ernst Bloch n'avait pas la même grille de lecture que Günther Anders : le concept de "honte prométhéenne" (l'homme invente un objet prodigieux qui produit l'humiliation "métaphysique" de son inventeur) est totalement étranger à ce qui anime Ernst Bloch, indéfectible optimiste. Moralité : la négation du Mal conduit inexorablement à la catastrophe.
***
Le texte cité ci-dessus a donc été publié en 1979 (il y aura quarante ans dans pas longtemps). D'accord, la citation peut indisposer à cause de son ton vaguement prophétique. D'accord, Günther Anders fait de l'atome une quasi-transcendance qui peut aujourd'hui sembler excessive. D'accord, insouciants et heureux dans notre confort, nous laissons ronronner les centrales nucléaires comme un bon gros chat, nous chevauchons l'énergie atomique (« Nous faisons cuire des œufs au plat sur le soleil », s'exclame un témoin de Tchernobyl dans La Supplication (p.186) de Svetlana Alexievitch) et nous vivons tranquillement à proximité de ses usines de production, alors que se sont produits les "accidents" de Fukushima, Tchernobyl, Three Mile Island, Windscale, en attendant mieux.
Mais ajoutez à l'énergie nucléaire les déforestations massives. Ajoutez le changement climatique bientôt irréversible. Ajoutez la tyrannie technique que l'économie toute-puissante fait régner sur la marche du monde. Ajoutez la pollution de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons et des aliments que nous ingurgitons par des milliers de substances chimiques de synthèse incontrôlées. Alors peut-être admettrez-vous, avec Günther Anders, que notre époque est vraiment la dernière. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, il n'y eut un tel cumul de facteurs de destruction.
C'est la situation produite par cette conjonction de facteurs qui FORCERA l'humanité à changer de mode de vie. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et probablement du sang.
Note : un commentateur récent (anonyme) me reproche de dire du mal des gens qui s'efforcent de "rendre le monde un peu plus vivable" (ce sont ses mots). D'abord, je ne dis pas du mal des personnes, mais je ne supporte plus les discours lénifiants et consolateurs qui ne font qu'anesthésier la vigilance. Ensuite, je n'ai rien contre les bonnes intentions et les bonnes volontés, je m'insurge seulement contre l'aveuglement de ceux qui refusent de voir que le monde se rend de jour en jour plus invivable, et que ce n'est pas le "bon cœur" des populations qui le sauvera (vous savez, le vieux refrain : « Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain »).
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : écologie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, bombe atomique, hiroshima, nagasaki, fin du monde, éditions fario, fukushima, tchernobyl, svetlana alexievitch, la supplication alexievitch, philosophie
lundi, 15 octobre 2018
CLIMAT : LA RECETTE MIRACLE !
Dans la série "Des nouvelles de l'état du monde" (N°64).
Car il faudrait effectivement un miracle pour échapper à la malédiction. J'entendais un brave jeune homme, un "youtubeur" qui a lancé une initiative citoyenne, consistant à encourager la population à multiplier, dans sa vie quotidienne, les "gestes écoresponsables". C'est gentil, ça part d'une bonne intention, ça ne fait pas de mal, et il y croit sûrement. Le problème, il est là : ce jeune homme croit au miracle. Et ça ou croiser les doigts pour conjurer le mauvais sort, c'est kif-kif.
Il faudrait qu'il se fasse enfin à l'idée réaliste que le geste individuel, si ça vous satisfait individuellement (mettant fin à la "dissonance cognitive"), n'a jamais été (et ne sera jamais) en mesure de modifier en quoi que ce soit la marche de tout ce qui fonctionne comme système. Se prétendre capable d'attaquer un système, c'est être sûr d'être en mesure de détruire toutes les interactions, jusqu'aux plus infimes, entre les innombrables éléments qui constituent ce système. Révérence et salut d'avance au génie de celui qui sera capable de cette haute performance : tant que les interactions fonctionnent, le système peut dormir tranquille.
Croire que les "gestes écoresponsables" peuvent mettre fin au réchauffement climatique, c'est croire au Père Noël. Pour cela, il y a une recette et pas deux : arrêter les moteurs. Tous les moteurs. Le problème, c'est qu'elle est miraculeuse : elle ne se produira pas. Il faudrait changer de civilisation.
J'en vois une jolie preuve dans la conversion assez rapide de toute l'industrie automobile à la voiture électrique, désormais présentée comme une nouveauté extraordinaire. Une vraie planche de salut pour un système à bout de souffle. C'est du moins la fable aimablement colportée par les médias, tous complaisants propagandistes de la voiture électrique. Quel sera l'effet de la voiture électrique ? Elle aura pour seul effet de purifier l'air des malheureux citadins. On respirera sûrement mieux dans les villes. Mais l'électricité, il faudra bien la produire, non ? Par combien la production d'électricité doit-elle être multipliée pour rejoindre dans la réalité l'efficience du moteur à explosion, source majeure des gaz à effet de serre ?
Le problème reste entier et sera simplement déplacé : c'est bien l'énergivoracité de l'humanité actuelle et future qui constitue la part essentielle de ce qui fait le réchauffement climatique. Mais en quel siècle les sources renouvelables d'énergie se seront-elles complètement substituées au charbon, au pétrole, au gaz, aux pétroles et gaz de schiste ? Pendant ce temps, beaucoup de pays et de responsables politiques (et de lobbies) dans le monde parient sur le nucléaire, et alors là, pardon, mais le problème s'aggrave diablement, quoique d'une autre façon. L'humanité consomme chaque année davantage d'énergie : c'est une maladie grave à laquelle nous sommes asservis.
Quand on voit le désarroi des gens qui, pour une raison quelconque (tempête ou autre), tombent en panne de courant, il y a quelque chose de fascinant (et même de jouissif d'une certaine manière) à imaginer ce qui se passerait le jour où le monde entier serait brusquement plongé dans le noir quand l'électricité cesserait de l'alimenter. Le jour où l'alimentation de la planète en énergie serait soudain coupée.
La question essentielle est :
QUI A (VRAIMENT) ENVIE D'ARRÊTER ?
(Avec toutes les conséquences que cela implique.)
Certainement pas les cadres dirigeants des plus grandes entreprises qui dominent le marché mondial et qui gouvernent la réalité du monde aujourd'hui.
Certainement pas les actionnaires qui attendent toujours de meilleurs "retours sur investissement".
Certainement pas les "fonds de pension" richissimes qui exigent des taux de profit de 10% par an, voire plus.
Certainement pas les chefs d'Etat ou de gouvernement qui lèchent le cul de leurs électeurs dans le sens du poil parce qu'ils préparent la prochaine échéance.
Certainement pas les populations du monde dont la vie quotidienne se heurte à toutes sortes de difficultés économiques ou politiques et qui n'ont qu'une idée en tête : se soustraire dans l'immédiat aux cruautés de la réalité et, éventuellement quand on a les moyens, rejoindre les Eldorados européens ou américains dans l'espoir de ramasser quelques miettes de notre "bonheur" matériel.
Et je ne parle pas des masses de gens qui se voient, dans les pays au seuil de la prospérité, tout près d'acquérir quelques biens "modernes" qui, aux yeux des "nantis" que nous sommes, font depuis lurette partie du paysage. Ils ont notre façon de vivre dans leur ligne de mire (et au nom de quoi leur en dénierait-on le droit ?).
Certainement pas les populations des pays "avancés" qui ont acquis une certaine sécurité économique et refusent mordicus de voir régresser les standards de vie matérielle qui sont devenus les leurs. Il se trouve que j'appartiens à cette catégorie des gens ordinaires, et que je pense comme eux : pour quelle raison faudrait-il que je me laisse dépouiller des avantages concrets que me procure la société présente ? Je ne suis pas membre de la classe des nantis, et je suis obligé, comme pas mal de gens, de surveiller mon compte en banque à partir du 15 du mois. Ce qu'elles réclament aux responsables politiques, les populations, c'est de quoi se loger, s'habiller et se nourrir (et plus si possible). Bref : du travail.
Les scientifiques ? Ils restent dans leur rôle : ils dressent le constat. Alarmant pour qui est sensible à cette alarme, mais désespérément neutre et sans effet concret notable. Les scientifiques sont lucides, mais concrètement désarmés : ils n'ont que la parole, et qui les écoute vraiment ?
Les militants ? Les convertis ? Je dis juste : combien de divisions ?
La "société civile" ? L'expression me fait rire (jaune). Que ce soient les "Marches pour le climat" ou les rendez-vous mensuels de "Nous voulons des coquelicots", un peu de lucidité suffit à mesurer le poids réel insignifiant de ces mouvements (pour l'instant purement français, même si) dans les prochaines décisions politiques, décisions elles-mêmes de quel poids dans le "concert des nations" ? Regardons le poids de l'îlot "petite France" dans l'archipel européen, et puis regardons le poids de l'île européenne dans la marche du monde : rien de tel pour rabattre les ambitions.
Le "développement durable" ? Arrêtez de plaisanter. La "croissance durable" ? L'expression est une contradiction dans les termes. Le rarissime économiste conscient des enjeux ne cesse de polir ce beau concept, "croissance durable" : il ment. Ou alors il n'a rien compris : il veut donner à l'écologie une place dans son programme, alors qu'en réalité, le programme tout entier, ça devrait être l'écologie. Vouloir de la croissance pour donner du travail à tout le monde, c'est exactement ce qu'attend le réchauffement climatique pour croître et embellir. Vouloir d'une part de la croissance, du travail et de la production, et d'autre part prétendre qu'on peut quand même lutter contre le réchauffement, c'est vouloir tout et son contraire.
J'en ai plus que marre d'entendre seriner à longueur d'appels alarmistes, par de doctes personnes, les refrains commençant par "IL FAUT". Ce "il faut" s'adresse à qui, en définitive ? Comme on dit au théâtre, c'est "à la cantonade". C'est-à-dire à personne et à tout le monde. Or ce tout le monde-là, il est conscient qu'il faudrait "limiter le réchauffement climatique". C'est vrai : tout le monde a de bonnes intentions et personne n'a envie que la situation empire. Mais qui en tire les conséquences concrètes sur sa propre existence ? PERSONNE (ou si peu). Personne n'a l'intention de changer de mode de vie. Personne n'envisage de se restreindre.
J'en tire la conclusion que personne n'a l'envie ou la possibilité, et encore moins la volonté d'arrêter le réchauffement climatique. Parce que personne ne veut perdre quoi que ce soit de ce qui fait partie de son existence. Tout au plus, dans le meilleur des cas, envisage-t-on de "faire un geste pour le climat", pourvu qu'il soit maintenu soigneusement dans les marges et ne modifie pas trop le principal des façons de vivre. Si des hommes politiques sont conscients de cela, on comprend pourquoi ils pincent la corde écologique avec tant de précautions et de généralités verbales, et le plus souvent en actionnant l'étouffoir. Pour arrêter, il faudrait une majorité mondiale de gens d'accord pour se dépouiller eux-mêmes.
IL FAUDRAIT UN MIRACLE, ET IL N'Y A PAS DE MIRACLE.
Non, le règne de la civilisation matérialiste se révèle aujourd'hui pour ce qu'il est : une arme de destruction massive de la notion même de civilisation. Je ne suis pas "pessimiste", mais je déteste me raconter des fables, et je déteste les bonimenteurs qui me dorent la pilule et me racontent des bobards. Je ne suis pas comme Ernst Bloch : Günther Anders, dans L'Obsolescence de l'homme, ce livre intransigeant et terrible (parfois injuste), lui en voulait beaucoup, parce qu'il « n'avait pas le courage de cesser d'espérer ». Je suis une des innombrables souris concrètes enfantées pas la montagne productiviste, je n'échapperai pas au sort commun, je vois l'impasse et j'y vais, ni plus ni moins que tout le monde.
Désolé de plomber l'ambiance.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, ernst bloch, günther anders, l'obsolescence de l'homme;défense de l'environnement, réchauffement climatique, youtube
mardi, 08 mai 2018
LE MONDE DANS UN SALE ÉTAT
 4 juin 2016
4 juin 2016
1
Je ne sais pas si Paul Jorion[1] a raison quand il parle d’un « effondrement général » de l’économie, de l’extinction prochaine de l’espèce humaine et de son remplacement par une civilisation de robots indéfiniment capables de s’auto-engendrer et de s’auto-régénérer. Sans être aussi radical et visionnaire, je me dis malgré tout que la planète va très mal, et que l’espèce qui la peuple, la mange et y excrète les résidus de sa digestion, est dans un sale état.
Beaucoup des lectures qui sont les miennes depuis quelques années maintenant vont dans le même sens. Pour ne parler que des deux ans écoulés, qu’il s’agisse
1 - du fonctionnement de l’économie et de la finance mondiales (Bernard Maris[2], Thomas Piketty[3], Paul Jorion[4], Alain Supiot[5], Gabriel Zucman[6]) ;
2 - de la criminalité internationale (Jean de Maillard[7], Roberto Saviano[8]) ;
3 - des restrictions de plus en plus sévères apportées aux règles de l’état de droit depuis le 11 septembre 2001 (Mireille Delmas-Marty[9]) ;
4 - de la destruction de la nature (Susan George[10], Naomi Oreskes[11], Fabrice Nicolino[12], Pablo Servigne[13], Svetlana Alexievitch[14]) ;
5 - de l’état moral et intellectuel des populations et des conditions faites à l’existence humaine dans le monde de la technique triomphante (Hannah Arendt[15], Jacques Ellul[16], Günther Anders[17], Mario Vargas Llosa[18], Guy Debord[19], Philippe Muray[20], Jean-Claude Michéa[21], Christopher Lasch[22]),
[Aujourd'hui (8 mai 2018), j'ajouterais la littérature, avec évidemment Michel Houellebecq en tête de gondole, mais aussi la bande dessinée : j'ai été frappé récemment par l'unité d'inspiration qui réunit Boucq (Bouncer 10 et 11) ;

Derrière son drôle de masque, la dame à l'arrière-plan, dirige un clan d'amazones impitoyables, qui capturent toutes sortes d'hommes pour qu'ils les fécondent, et pour leur couper la tête juste après l'acte. Et ce n'est que l'une des nombreuses joyeusetés rencontrées.
Hermann (Duke 2) ;

Yves Swolfs (Lonesome 1) ;

et d'autres dans un déluge de sang, de violence, de cruauté gratuite et de bassesse dont j'ai bien peur que, sous le couvert de la fiction et du western, ils nous décrivent, avec un luxe de détails parfois à la limite de la complaisance, ce que certains philosophes et sociologues appellent un très actuel "grand réensauvagement du monde". La représentation de plus en plus insupportable et violente d'un monde fictif (je pense aussi à certains jeux vidéos) n'est-elle pas un reflet imaginaire d'une réalité que nos consciences affolées refusent de voir sous nos yeux ?]
quand on met tout ça bout à bout (et ça commence à faire masse, comme on peut le voir en bas de page), on ne peut qu'admettre l’incroyable convergence des constats, analyses et jugements, explicites ou non, que tous ces auteurs, chacun dans sa spécialité, font entendre comme dans un chœur chantant à l’unisson : l’humanité actuelle est dans de sales draps. Pour être franc, j’ai quant à moi peu d’espoir.
D’un côté, c’est vrai, on observe, partout dans le monde, une pullulation d’initiatives personnelles, « venues de la société civile », qui proposent, qui essaient, qui agissent, qui construisent. Mais de l’autre, regardez un peu ce qui se dresse : la silhouette d’un colosse qui tient sous son emprise les lois, la force, le pouvoir, et un colosse à l’insatiable appétit. On dira que je suis un pessimiste, un défaitiste, un lâche, un paresseux ou ce qu’on voudra pourvu que ce soit du larvaire. J’assume et je persiste. Je signale que Paul Jorion travaille en ce moment à son prochain ouvrage. Son titre ? Toujours d’un bel optimisme sur l’avenir de l’espèce humaine : Qui étions-nous ?
Car il n’a échappé à personne que ce flagrant déséquilibre des forces en présence n’incite pas à l’optimisme. Que peuvent faire des forces dispersées, éminemment hétérogènes et sans aucun lien entre elles ? En appeler à la « convergence des luttes », comme on l’a entendu à satiété autour de « Nuit Debout » ?
[8 mai 2018. Tiens, c'est curieux, voilà qu'on entend depuis des semaines et des semaines la même rengaine de l'appel à la convergence des luttes. C'est un mantra, comme certains disent aujourd'hui : une formule magique. Ce qu'on observe dans certains cercles contestataires, c'est plutôt la convergence des magiciens, sorciers, faiseurs-de-pluie et autres envoûteurs : ils dansent déjà en rond en lançant les guirlandes de leurs grandes idées et des incantations incantatoires autour du futur feu de joie qu'ils allumeront un de ces jours dans les salons dorés des lieux de pouvoir. Eux-mêmes y croient-ils ?]
Allons donc ! Je l’ai dit, les forces adverses sont, elles, puissamment organisées, dotées de ressources quasiment inépuisables, infiltrées jusqu’au cœur des centres de décision pour les influencer ou les corrompre, et défendues par une armada de juristes et de « think tanks ».
Et surtout, elles finissent par former un réseau serré de relations d’intérêts croisés et d’interactions qui fait système, comme une forteresse protégée par de puissantes murailles : dans un système, quand une partie est attaquée, c’est tout le système qui se défend. Regardez le temps et les trésors d’énergie et de persévérance qu’il a fallu pour asseoir l’autorité du GIEC, ce consortium de milliers de savants et de chercheurs du monde entier, et que le changement climatique ne fasse plus question pour une majorité de gens raisonnables. Et encore ! Cela n’a pas découragé les « climato-sceptiques » de persister à semer les graines du doute.
C’est qu’il s’agit avant tout de veiller sur le magot, n’est-ce pas, protéger la poule aux œufs d’or et préserver l’intégrité du fromage dans lequel les gros rats sont installés.
Voilà ce que je dis, moi.
[1] - Le Dernier qui s’en va éteint la lumière, Fayard, 2016.
[2] - Houellebecq économiste.
[3] - Le Capital au 21ème siècle.
[4] - Penser l’économie avec Keynes.
[5] - La Gouvernance par les nombres.
[6] - La Richesse cachée des nations.
[7] - Le Rapport censuré.
[8] - Extra-pure.
[9] - Liberté et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, 2010.
[10] - Les Usurpateurs.
[11] - N.O. & Patrick Conway, Les Marchands de doute.
[12] - Un Empoisonnement universel.
[13] - P.Servigne. & Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer.
[14] - La Supplication.
[15] - La Crise de la culture.
[16] - Le Système technicien, Le Bluff technologique.
[17] - L’Obsolescence de l’homme.
[18] - La Civilisation du spectacle.
[19] - Commentaire sur La Société du spectacle.
[20] - L’Empire du Bien, Après l’Histoire, Festivus festivus, …
[21] - L’Empire du moindre mal.
[22] - La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé.
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabrice nicolino, lettre à un paysan sur le vaste merdier, paul jorion, bernard maris, thomas piketty, alain supiot, gabriel zucman, jean de maillard, roberto saviano, mireille delmas-marty, susan george, naomi oreskes, pablo servigne, hannah arendt, jacques ellul, günther anders, mario vargas llosa, guy debord, philippe muray, jean-claude michéa, christopher lasch, houellebecq économiste, les marchands de doute, l'obsolescence de l'homme, la société du spectacle, festivus festivus, bande dessinée, hermann duke, boucq bouncer, yves swolfs lonesome, michel houellebecq
lundi, 02 avril 2018
DOCTEUR, COMMENT VA LE MONDE ?
27 février 2018
Des nouvelles de l’état du monde (19).
(Voir ici billet 18.)
Nous en étions ici : le monde va de mieux en mieux, disent les indécrottables optimistes ; le monde va vers sa perte, soutiennent les insupportables pessimistes. Pour en finir avec cette lutte fratricide et savoir une fois pour toutes qui a tort et qui a raison, en homme de l’art consciencieux, nous prenons quelques températures et quelques tensions à droite et à gauche, dans l’espoir que l’ensemble des données sera un indicateur fiable.
Nous étions donc en présence d’un patient : le monde. C’est au nombre des alertes qu’on évaluera son état de santé, c’est à l’intensité de l’effort humanitaire qu’on mesure la violence qui s’abat sur le monde, c’est à l’intensité du bruit qu’elles produisent qu’on mesurera l’étendue de la prise de conscience, et c’est à la vitesse dont les trajectoires s’infléchissent et dont les corrections s’effectuent que l’on supputera les chances de guérison. Aujourd’hui, on parle de l’état de santé physique de la planète.
2 – Le symptôme planétaire.
Oui, bien sûr, il y a le réchauffement climatique. On sait. On sait tout, en fait. Et c’est ça qui effraie le plus : le pire, avec le réchauffement, c’est qu’on sait tout, et que ça ne sert à rien. Oui, on nous bassine avec le réchauffement, mais il n’y a pas besoin d’avoir vu Al Gore sur scène, dans son film Une Vérité qui dérange, actionner son élévateur de chantier pour mettre en évidence la radicale rupture de pente de la courbe montrant l’augmentation vertigineuse (en rythme géologique) de la courbe des températures moyennes.
Le réchauffement, aujourd’hui, on est largement au courant : il suffit de regarder ce que sont devenus en quelques dizaines d’années, rien que chez nous, le glacier d’Argentière, la Mer de glace, le glacier des Bossons, le glacier de Taconnaz. Et puis la banquise. Et puis le Groenland. Et puis les glaciers de l’Himalaya. Et puis l’Antarctique. Et puis les Maldiviens, à qui il arrive d'avoir de l’eau jusqu’aux genoux. Oui, on sait que des centaines de millions de gens habitant dans les régions littorales du globe seront chassés de chez eux : devinez l’ailleurs où ils essaieront d’aller vivre mieux.
Le réchauffement, aujourd’hui, on sait aussi que c’est l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes extrêmes : ici des sécheresses toujours pires que les précédentes, là des inondations de plus en plus catastrophiques, ailleurs des cyclones, ouragans ou typhons de plus en plus dévastateurs, jusque sous des latitudes jamais vues auparavant (l’Irlande à la fin de 2017). Chez nous, espèces animales et végétales migrent vers le nord. Un effet secondaire parmi d’autres : certains vins de la vallée du Rhône se mettent à titrer couramment 14,5°, et l’on a commencé à planter des vignes au sud de l’Angleterre ! Le réchauffement, ça se voit à l’œil nu !
Des cris d’alarme, oh ça, il y en a eu ! Mais encore aujourd’hui, on peut appeler ça « Vox clamans in deserto » : il y en a eu, des Bernard Charbonneau, des Jacques Ellul, des Günther Anders, pour alerter sur les dégâts humains, sociaux et environnementaux qu’entraîne la civilisation technicienne, mais ces voix ont crié dans le désert. Les Amis de la Terre, La Gueule ouverte, tous ceux qui voulaient vivre autrement, on les prenait en général pour des agités du bocal, des illuminés, des communautaristes barbus retournés à la terre, des antinucléaires fanatiques, des Larzaciens antimilitaristes. Quarante ans après, on sait qu’ils avaient raison, les allumés !
Et s’il n’y avait que le réchauffement, ce serait moins pire. Mais on sait aussi, depuis Chirac, que « les emmerdes, ça vole en escadrille ». Parce que la « civilisation technicienne » forme un système cohérent, dont les divers aspects, qui n’ont en apparence aucun lien entre eux (je dis à ma main droite d'ignorer ce que fait ma main gauche, et pareil pour les pieds, les narines, les oreilles, les yeux, ...), s’entendent comme larrons en foire pour produire des effets qui, loin de se contrarier, agissent de concert.
C’en est au point qu’on pourrait voir (rétrospectivement) dans toute l’histoire de notre si belle « civilisation technicienne » la simple histoire d'une destruction méthodique : à partir du moment où le propre, l’essence, le fondement, j’allais dire le destin de la civilisation s’incarne dans la technique, au point de s'y résumer, la limite de l’effort humain est abolie et les folies de l’homme peuvent alors se donner libre cours. Vue comme ça, l’histoire du « Progrès technique » après la révolution industrielle, c’est celle de la mise en œuvre d’une malédiction collective. L’histoire d’un suicide massivement consenti.
Ce n'est pas complètement faux : tant que la vitesse à laquelle on peut se déplacer n’est pas en mesure de dépasser celle du pas de l’homme ou du cheval (le vent sur mer), une nécessité absolue s’impose au monde, que nul génie de la technique n’a enfreinte depuis les origines. L’avènement du moteur (à vapeur, à pétrole, à ce qu'on veut) fait croire à l’humanité qu’elle est tout d’un coup entièrement et définitivement débarrassée de cette basse et humiliante contingence qui entravait ses ambitions. Comme dit l'autre, "Passées les bornes, y a plus de limites".
L’accélération constante de la vitesse à laquelle on se déplace abolit la frontière qui définit les limites de l’homme. Le moteur – multiplicateur de puissance – libère l’humanité de sa dépendance des forces naturelles. Avec le moteur, l’humanité n’en a plus rien à faire, de la nature. Le moteur, et avec lui l’alimentation en énergie, est une arme de destruction massive. L'homme se croit tout-puissant et fabrique une source d'énergie (le nucléaire) dont les dangers potentiels dépassent toutes les pauvres parades qu'il pourrait inventer pour en limiter les dégâts (Tchernobyl, Fukushima, et bientôt le site de Bure et ses réserves de radiations pour quelques milliers d'années à venir).
La différence avec toutes les époques qui ont précédé l'avènement de la société industrielle (vers 1750) est nette. Car si les activités humaines – mettons depuis le néolithique – provoquaient des nuisances, celles-ci (mégisseries, tanneries, ...), circonscrites dans un périmètre limité, n’avaient rien à voir avec ce qu’a apporté la production industrielle de biens destinés à satisfaire les besoins.
La notion de « besoin » elle-même s’est trouvée chamboulée : puisqu’on est capable de produire plus que le nécessaire (c’est-à-dire trop), grâce au moteur et à l’énergie, il est désormais nécessaire d’écouler la marchandise excédentaire, éveiller de nouveaux désirs, inventer des besoins. C’est le rôle de la publicité : susciter une consommation qui puisse justifier la production de biens en masse. Il faut se poser la question : « Qu’est-ce qu’on pourrait inventer qui puisse être vendu en masse aux masses ? ». Une façon de lancer la course désespérée à l’innovation la plus innovante.
Une société de gavés en même temps qu’une société de frustrés, puisque la limite du désir se situe toujours (un peu ou très) au-delà de l’envisageable. Même pas besoin de s’appesantir sur la marchandisation de tout, l’accumulation du capital et autres fadaises liées à la matérialisation infinie de la civilisation ou aux appétits de richesse : le franchissement indéfini des limites est inscrit dans la motorisation de l’espèce humaine. La saturation de l’espace disponible de la planète est inscrite dans la première révolution industrielle et dans la course à la production.
Tous les êtres et toutes les choses doivent être mis à contribution pour la grande marche vers le plus. Tout ce qui entrave l’augmentation et la croissance doit être combattu par tous les moyens. Tout ce qui permet de gagner en temps, en argent et en efficacité économique doit être privilégié. Tout ce qui est humain doit devenir fonctionnel, productif et lucratif, pour que l’humanité puisse un jour ressembler à la parfaite machine à produire. Tout ce qui est la Terre doit cracher des richesses.
Jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Il n'y a pas très longtemps (Le Monde, 14 novembre 2017), les scientifiques se sont mis à quinze mille (15.000) pour sonner le tocsin de l'urgence. 15.000 personnes qui savent de quoi elles parlent ont poussé un cri : il y a urgence !

En 2011, les éditions La Découverte (+ Arte éditions) publiaient Notre Poison quotidien, de Marie-Monique Robin, celle-là même dont un documentaire célèbre ferraillait contre la firme tentaculaire Monsanto. L'auteur énumère dans son livre bourré d'informations tout ce que les industriels de la chimie s'entendent pour injecter dans ce que nous mangeons, végétal ou animal.

En octobre 2017, François Jarrige et Thomas Le Roux vont plus loin (si l'on peut dire) : dans La Contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel, ils disent (en très gros) que ce que nous appelons "pollution" n'est pas séparable de la mise en place de la production industrielle. Ils n'y vont pas de main morte, intitulant leur troisième partie "Démesure et pollution : un siècle toxique (1914-1973)".

C'est toute notre civilisation technique qui est dans l'erreur.
Voilà où nous en sommes : ça crie "Au fou !" de tous les côtés, et ça ne sert à rien. On sait tout. Tous ceux qui veulent savoir savent. Malheureusement, ceux qui savent n'ont aucun moyen d'action, et ceux qui pourraient faire ne veulent rien faire.
Alors docteur, comment va le malade ? Quel diagnostic au sujet du symptôme planétaire ?
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, l'état du monde, optimistes pessimistes, réchauffement climatique, pollution, écologistes, al gore une vérité qui dérange, fonte des glaciers, himalaya, glace groenland, banquise, phénomènes extrêmes, bernard charbonneau, jacques ellul, günther anders, les amis de la terre, la gueule ouverte pierre fournier, vox clamans in deserto, tchernobyl, fukushima, enfouissement déchets nucléaires, journal le monde, 15.000 scientifiques, marie-monique robin, le monde selon monsanto, notre poison quotidien, éditions la découverte, françois jarrige, thomas le roux, jarrige la contamination du monde
jeudi, 29 mars 2018
L’HUMANITÉ EN PRIÈRE 4
19 novembre 2017
Des nouvelles de l'état du monde (8).

4/4
PRIONS !
Ce qui manque à tous ces beaux et grands rêveurs ? Oh pas grand-chose, presque rien : juste l'exercice du pouvoir ! Eh oui, ceux qui veulent que ça change ne peuvent rien, à part rêver, vouloir et crier. Quant à ceux dont on croit et espère qu’ils peuvent quelque chose, ils sont ligotés par tant de liens qu’eux non plus ne peuvent pas grand-chose, à part pérorer lors de conférences internationales. On voit ce qu’il en est de la COP 21 deux ans après : il a suffi qu’un Américain halluciné s’en retire pour que tout se mette à pédaler dans la semoule. Aux dernières nouvelles, on se reverra en 2018 en Pologne pour la COP 24, pour analyser où l'on en est de la production de CO2. On a raison, il faut prendre son temps, rien ne presse, y a pas le feu. C'est peut-être ça, après tout, "avoir la vie devant soi" ?
« QUE FAIRE ? » J’ai envie de dire à Paul Jorion : « Cesse de rêver, Paul ! ». Je ne peux plus entendre tous les « y a qu'à », les « il faut », les « on devrait », les « il est grand temps de », autant d'exhortations incantatoires dont les « penseurs », patentés ou non, gargarisent très volontiers le gosier de leurs raisonnements conclusifs. C'est fou, le nombre de gens qui ont besoin de se rassurer à tout prix à coups d'exhortations solennelles. C'est fou, le nombre de mouches du coche qui se rêvent en cochers. « Arrêtez de faire semblant » : oui, arrêtez d’alimenter dans les masses la machine à espérer. Rendez-leur plutôt le sens du tragique, que les promesses du « Progrès » technique et matériel leur ont fait perdre.
Apprenez-leur que, dans tout ce que fait l'homme, en particulier les objets techniques produits par son génie particulier, il y a quelque chose qui le dépasse et lui échappe, une part irréductible de son action sur laquelle il n'a pas de prise. Les hommes font l'histoire, mais ne savent pas grand-chose de l'histoire qu'ils font ou des conséquences à moyen ou long terme de leurs actions. Pour ce qui est de détruire, l'humanité s'est rendue aussi capable que la "Nature" en colère (énergie nucléaire, industrie chimique, en attendant mieux). Rendez aux humains, si ce n’est pas déjà trop tard, le sens des limites. Rendez-les à leur finitude, à leur précarité.
Cessez de chanter pour eux le culte du surhomme à qui rien n'est impossible, pourvu qu'il en ait la volonté et qu'il s'en remette avec une entière confiance aux outils magiques que d'ingénieux ingénieurs confectionnent pour le plus grand bien de certains comptes en banque. En l’état actuel des choses, seul un bon gros désespoir générateur de colère me semble en mesure de faire bouger le monde. De faire trembler d'un joli "Big One" la surface du globe. Le résultat ne serait peut-être pas bien joli, mais pas pire que les suites de l’illusion qui alimente l’attente de « lendemains qui chantent » : gare, quand ils déchanteront ! Je n'aime pas la violence, mais je la vois venir.
« QUE FAIRE ? » Les 15.000 scientifiques, dans leur solennel « Avertissement à l’humanité », ne font pas autre chose que rêver, quand ils proclament qu'ils veulent mettre les décideurs en face de leurs responsabilités. Ils annoncent fièrement qu’ « il est possible de vaincre n’importe quelle opposition, aussi acharnée soit-elle, et d’obliger les dirigeants politiques à agir ». C’est très beau. Seulement ils y voient une condition préalable : « Grâce à un raz de marée d’initiatives organisées à la base ». Ah bon ! Mais c'est toujours la même question qui se pose : ton "raz de marée d'initiatives", COMMENT ON FAIT, TOTO ? Le pékin de base aura beau se dire : « Vivement le raz de marée ! », l'indécrottable individu, s'il ne se laisse pas embarquer à son tour dans le rêve, aura bien du mal à se voir en costume de raz de marée (voir plus haut "ensemble tout devient possible" et "convergence des luttes"). Il faudrait déjà qu'il se sente partie prenante d'un sort commun, ce qui est loin d'être acquis. A propos de "sort commun", c'est curieux que plus personne ne parle depuis fort longtemps de « l'espèce humaine » (Robert Antelme, 1957, ci-contre).
« QUE FAIRE ? » L'avertissement des scientifiques propose ensuite une liste de treize préconisations parfaitement sensées, numérotées de "a" à "m". Je retiens, entre autres, qu’il convient de stopper « la conversion des forêts, prairies et autres habitats originels », restaurer les écosystèmes endémiques, « ré-ensauvager des régions », « adopter des instruments politiques adéquats », « réduire le gaspillage alimentaire », « réduire le taux de fécondité » humaine, réorienter nos régimes alimentaires, sensibiliser les enfants, etc. Là encore, c'est très beau, mais j’arrête : on peut l’attendre longtemps, le raz de marée. "Adopter des instruments politiques adéquats" : mais de quelle planète débarquent-ils ? Encore une fois : comment on fait ? On a compris : il y a dans le monde, en plus de gens sérieux comme Paul Jorion, 15.000 scientifiques tout aussi sérieux, qui sont prêts à faire un vœu chaque fois qu’ils voient une étoile filante et à y croire dur comme fer. Tous ces gens ont une vraie foi chevillée au corps. On a compris : le texte publié dans Le Monde est juste une PRIÈRE à réciter à genoux. A se demander si ce sont bien des scientifiques.

« QUE FAIRE ? », alors ? Comme le proclament les flyers des médiums guérisseurs de nos boîtes aux lettres, « il n’y a pas de problèmes sans solutions ». Malheureusement, à l'image des "sorciers" africains qui font chez nous commerce de leur art, tous ces braves scientifiques ont chopé la sale manie, inventée par les bureaucrates, d'appliquer à tous les sujets l'immuable schéma « constat-causes-solutions » appris sur les bancs de l’ENA, quand ils rédigent leurs sacro-saintes « notes de synthèse » à l'usage des décideurs. La méthode n’est pas inutile, mais vouloir à toute force positiver pour finir sur une perspective optimiste (« à chaque problème sa solution ») a quelque chose de pathétique. Et si, après tout, il y avait des problèmes sans solutions ? Car les scientifiques posent sur l'état de la planète un diagnostic exact et rigoureux, c'est vrai ; ils en pointent les causes avec une perspicacité inattaquable, c'est vrai ; mais ils fracassent immanquablement le nez de leurs "Solutions" sur la muraille de la réalité du monde tel qu'il va. Parce que, s'il y a des solutions, elles sont entre les mains de la décision des politiques, et accessoirement des populations qui les élisent.
Or, dans le cas présent, les solutions sont connues et archi-connues de tous (la première de toutes, qui conditionne toutes les autres, est de cesser de rechercher la croissance à tout prix), et tout le monde sait qu'elles resteront lettres mortes, et que personne n'aura le courage héroïque qu'il faudrait pour les mettre en œuvre. Quelle abnégation il faudrait pour un renoncement général aux "bienfaits" du "progrès" (car dans le fond du fond, c'est de cela qu'il s'agit, et qu'on ne me parle pas de "développement durable", cette imposture caractérisée qui n'envisage que de reculer l'échéance) ! Et ce n'est pas seulement à cause d'un « manque de volonté politique », cette ritournelle que les médias ressassent, sur fond d'actions et d' « associations » militantes. Produire à tout prix et faire consommer à tout prix, voilà sur quel socle est bâti le monde actuel dans son intégralité (ou presque) : qui peut rayer cette réalité d'un trait de plume ?
« QUE FAIRE ? » Manque de volonté politique ? Bien sûr ! Par exemple, les responsables européens, en instaurant la règle de l'unanimité pour toutes les grandes décisions qui risqueraient d'en chatouiller quelques-uns, ont clairement décidé de ne rien faire. Eh oui, c'est parce que, les solutions connues et archi-connues, personne n'en veut. L'exemple des paradis fiscaux ("Paradise papers") montre à hurler que ceux-ci sont si structurellement inscrits dans l'intestin et dans les moindres neurones de l'économie mondiale, et que tous les acteurs, légaux ou non, en ont tellement besoin, qu'il est absolument inenvisageable de songer à les supprimer. Non, personne ne veut des solutions. Car le manque de volonté au plus haut niveau est fort bien secondé par les volontés populaires — encore plus que dans les pays nantis — dans les pays qui aspirent à vivre mieux sur le plan matériel. Résultat : personne n'est en mesure, même avec la plus féroce volonté du monde, de maîtriser la machine globale, parce que tout le monde veut qu'elle continue à fonctionner.
Ce "Système" d'une force incommensurable à la nôtre, bien que l'homme l'ait élaboré collectivement, reste presque indifférent à toute volonté particulière (cause de la "honte prométhéenne" selon Günther Anders) : la machine s'est largement affranchie de l'humanité pour rouler pour son propre compte et avancer vers son accomplissement, dans lequel le sort de celle-ci a autant de poids qu'une virgule. La mondialisation, cette invention de forces disparates mais mues par une même logique puissante, échappe à tout le monde, à commencer par ceux qui l'ont voulue, qui n'y voyaient que l'occasion unique et inespérée de développer toujours davantage leurs affaires. Le but des acteurs principaux : ne pas se faire éjecter de la course, ne pas se faire écraser, et pour cela : avancer obstinément dans la même direction, en calculant au mieux les opportunités. De quoi accélérer l'accomplissement.
« QUE FAIRE ? » Non, messieurs, tout le monde sait ce qu’il faut faire, et si les décideurs ne le font pas, c’est d’abord qu’ils ne veulent abandonner aucune de leurs prérogatives, aucune parcelle de leur pouvoir, aucune part de leur gâteau, aucun symbole de leur prestige. C’est ensuite que les populations elles-mêmes, soit tiennent au relatif confort acquis et à leur manière de consommer (leur infinitésimale part du gâteau), soit n'ont qu'un seul but : acquérir les mêmes choses, que leur montrent les médias mondialisés et dont ils sont encore injustement privés. Et l'on sait que les opinions publiques (c'est-à-dire les échantillons représentatifs des populations, augmentés des dérisoires "leaders d'opinion" qui tartinent leurs éditoriaux dans toutes sortes de médias), consultées par sondages, tiennent les décideurs par le bulletin de vote
Le décideur un peu démocratique qui ne se plierait pas à ces exigences populaires (somme toute humainement compréhensibles) serait vite éjecté de la scène publique. Ceux qui veulent « changer radicalement de mode de vie » pour sauver ce qui peut l’être sont une infime poignée, héroïque si l’on veut, mais sans poids. Et je crains fort que le bruit qu’ils s’efforcent de faire ne suffise pas à compenser leur insignifiance en termes de pouvoir.
A mon tour de poser la question "QUE FAIRE ?". J'y réponds : jouissons à notre gré de ce qui nous reste.
Si je traduis en Desproges, il faut comprendre : « Vivons heureux en attendant la mort ». Ce n'est pas déraisonnable.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 15000 scientifiques, environnement, écologie, journal le monde, paul jorion, robert antelme l'espèce humaine, günther anders
mardi, 27 mars 2018
L’HUMANITÉ EN PRIÈRE 2
17 novembre 2017
Des nouvelles de l'état du monde (6).
Ceci n'est que la moitié supérieure de la "Une" du Monde du mardi 14 novembre 2017. Rien que la moitié, mais toute la moitié.
2/4
SOLUTIONS : LES RÊVES ET LA RÉALITÉ
N’en déplaise aux 15.000-scientifiques-issus-de-184-pays, si l’humanité finit par bouffer tout le fromage planétaire, ce ne sera, au fond, que pure logique : la logique du monde occidental, riche, vorace et en moyenne bien portant, étendue à tous ceux qui en étaient écartés. Autrement dit, la logique d’une disparition programmée : un occident qui n'a pour projet que de substituer, partout dans le monde, notre économie de gaspillage à la traditionnelle et raisonnable - mais aléatoire - économie de subsistance. Car ils sont bien gentils, les 15.000 scientifiques, mais qu’est-ce qu’ils proposent pour éviter le désastre ?
Ils proposent le même genre de solutions que Gabriel Zucman pour la finance folle (La Richesse cachée des nations), que Paul Jorion pour le capitalisme (Se Débarrasser du capitalisme …), et que tous ceux qui, dans le dernier chapitre de leurs ouvrages critiques, tentent régulièrement de répondre à la question « QUE FAIRE ? » et nous tendent la guirlande fleurie de leurs propositions : il faut bien finir une critique sur du positif, n'est-ce pas. Ouvrir sur un avenir meilleur. Fournir des perspectives. Proposer des "solutions". Car il est convenu, entre gens civilisés, de ne pas donner prise à la contre-attaque : « C'est bien joli, vous critiquez, vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez à la place ? ».
Mais cette contre-attaque, c'est juste pour intimider grossièrement l'adversaire : comme s'il fallait forcément, avant toute dénonciation de quoi que ce soit, concevoir et élaborer un modèle complet de remplacement clé en main. Un moyen classique de faire taire les mauvais coucheurs, quoi : selon les historiens, pour accomplir la Révolution française, ça a pris minimum cinq ans (Robespierre, 9 thermidor), maximum une centaine (III° République). En 1789, le scénario n'était pas écrit, c'est le moins qu'on puisse dire, et les Etats Généraux ont bien été précédés par l'exposé de doléances, que je sache. Il faut laisser à l'histoire le temps de se faire. Quand quelque chose est critiquable, il faut commencer par dire ce qui ne va pas, non ? Ce n'est pas parce que vous trouvez que quelque chose cloche que vous ne pourrez ouvrir le bec qu'après avoir mis tout un nouveau "Contrat social" noir sur blanc, non ?
Mais, en général bons princes, les critiques se plient à la convention. Ce n'est peut-être pas ce qu'ils font de mieux, mais c'est parce qu'ils pensent que, s'il est possible de faire quelque chose, on ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Et qu'on ne peut pas rester là-devant les bras ballants et les deux pieds dans le même sabot. Louable volontarisme, où l'on reconnaît la morale d'un Théodore Monod : « Le peu qu'on peut faire, il faut le faire ». Il ajoutait : « Sans illusions ». Il y a de l'héroïsme dans ce "sans illusions". Hommage, classique et obligatoire, à l'énergie de l'optimisme et à l'inépuisable inventivité de l'homme. Quant aux propositions, disons-le, elles sont toutes frappées du sceau du bon sens (qualité « fleur-de-coin ») et d’une raison de roc, mais elles sont toutes carrément mirobolantes, de la cave au grenier et du sol au plafond. Eh oui, ce serait si simple ! Au comptoir, ça se dit : « Y a qu'à ! ». A l'université, on dit : « Il faut ! », et en général : « D'urgence ! » (ou variantes variées : « Il est impératif », « Il est du devoir d'un responsable », etc.).
« QUE FAIRE ? » Tout le monde a des idées sur ce qu’il faudrait faire pour que le monde tourne plus rond. Mieux : tout le monde sait ce qu’il faut faire, même et surtout les premiers responsables de la situation, qui savent tellement à quoi s'en tenir qu'ils ont déjà pris leurs précautions pour se mettre à l'abri en cas de. Qu'est-ce qu'il propose, Zucman ? Des sanctions contre la finance folle, des tarifs douaniers, un cadastre financier mondial, un impôt sur le capital, un impôt sur les sociétés, … Tout ça est bel et bon ("rien que du bon", aurait dit le Gotlib de Superdupont allant sauver la nouille française), mais en attendant que ça tombe, le financier fou se cure la dent creuse en souriant. Tiens, au moment des "Paradise papers", ça ne vous fait pas drôle de réentendre Sarkozy, en 2009 je crois, proclamer que "les paradis fiscaux, c'est fini !" ?
Jorion, lui, voudrait que le capitalisme tienne compte de l’environnement, accepte le principe d’une régulation, cultive une véritable « science » économique, cesse de favoriser la concentration de la richesse, etc. Là encore, "rien que du bon", mais autrement dit : il faudrait que les capitalistes cessent de capitaliser : les capitalistes, eux, un rien narquois, attendent Jorion tranquillement. Car, malheureusement, et c'est toujours la même chose pour les solutions, Zucman et Jorion oublient de nous dire comment on fait. C'est un peu embêtant. Oui, je sais, ce qui compte, c'est d'agir, et si possible d'agir en nombre. Ouais ! J'ai pratiqué ça, il fut un temps. Mais il y a une différence entre agir au sommet, agir à la base et exhorter "à la cantonade" les troupes éventuelles (pour les "galvaniser", n'en doutons pas, la galvanisation est un procédé qui a bonne presse).
Je note, à propos de l'efficacité des actions parties de la base, qu'il a fallu un mort à Sivens pour que le projet de barrage consente à se laisser modifier (pas "supprimer", notez bien). Rendement de ces fameuses "actions parties de la base" : zéro virgule miettes. Car s'il faut des morts pour faire avancer la cause de la planète, il va falloir que les défenseurs de l'environnement acquièrent sans tarder une mentalité de martyr. Si la mort de Rémi Fraisse est un « accident », à quand les djihadistes de l'écologie prêts au sacrifice de leur vie ? Qui est "prêt à mourir pour que vive la planète" ?
« QUE FAIRE ? » Paul Jorion, l’homme qui passe pour un devin depuis qu’il a prédit l’effondrement financier lors des « subprimes » de 2007-2008, va jusqu’à découper son avant-dernier livre (Vers un Nouveau monde, Renaissance du livre, 2017, le dernier vient de paraître, ça ne traîne pas) en « 1) Le monde tel qu’il est », « 2) Le monde tel qu’il devrait être ». "Le monde tel qu'il devrait être" : on nage en plein rêve ! Ce livre, qui voudrait être une plate-forme politique, n’est rien d’autre que l'espoir plein de lui-même d’un adolescent bien informé. Le genre d'idéalisme compact qu'on a à dix-huit ans. C'est pourtant le même Jorion qui déclarait encore il y a peu que les puissants accepteront de faire quelque chose pour sauver le monde, mais seulement si ça leur rapporte. Allez comprendre.
Il est vrai que Paul Jorion avoue une grande faille dans son raisonnement en ce qu’il est un admirateur ahurissant de la technique, cette preuve de la prodigieuse créativité et de l'ingéniosité humaines. Selon lui, la technique est totalement neutre, et ses effets bénéfiques ou néfastes dépendent exclusivement de l’usage qui en est fait. C'est manifestement faux : plus la technique est puissante et sophistiquée, plus les sociétés humaines en subissent les effets en profondeur. Si c'est ça, être neutre ! A l'exemple de Macron ("ni droite ni gauche"), Jorion plaide pour le "ni Bien ni Mal" en matière de technique.
Certes, le Mal n’est pas dans les choses (disons : dans la Nature), on est d'accord, mais il existe, à l’égal du Bien, dans toutes les fabrications humaines, avant même leur fabrication, potentiellement : dès la conception, l’objet recèle le meilleur et le pire des intentions humaines, en ce qu’il rendra tous ses usages possibles, positifs comme négatifs. Je n'irai pas jusqu'à affirmer, comme Günther Anders, que, "parce que c'est possible, cela doit être fait" (je cite de mémoire), mais on sait à quoi on peut s'attendre en matière d'intentions humaines.
Je crois, quant à moi, que si l'on a les bienfaits de la technique, il faut aussi, comme on fait dans les livres de compte (dépenses / recettes), en compter simultanément les méfaits, et cesser de parler bêtement, par exemple, de « destruction créatrice », célèbre niaiserie de Schumpeter, qui repose sur la conception opiomaniaque de l'irrésistible avancée de l'humanité vers le Bien. Comme tout le monde, j'aime le Bien. Mais quant au Mal, contrairement à beaucoup, je crois qu'il est vital de le reconnaître et de le nommer là où il est : en nous. Nous le côtoyons ici et maintenant. Où que nous allions, nous le portons en nous. En matière de technique, il n'y a pas de bienfaits sans des méfaits équivalents. Schumpeter pensait que les premiers compensaient largement les seconds, ce qui justifiait le sacrifice de l'existant au nom de la "croissance économique". Cela aussi, c'est manifestement faux. Ce qui est curieux, c'est que, face à chaque merveilleux apport de la technique, personne ne pose la question de savoir ce que cet apport nous enlève, et même dont il nous prive peut-être. C'est le point aveugle de l'estampille flamboyante du « Progrès ».
Mon théorème implicite ? Dès le moment que vous disposez d'une technique, vous pouvez être sûr que tous ses usages seront mis en œuvre, les meilleurs comme les plus funestes. Les "Docteur Folamour" sont des humains comme vous et moi : impossible de les retrancher. L'ivraie pousse toujours au milieu du bon grain. Axe du Bien et Axe du Mal sont des fatrasies nées dans des cerveaux malades et vénéneux. Je crois infiniment plus juste et plus subtile l'image du Tao : il y a du Mal dans le Bien et réciproquement (peu importe ici ce que veulent vraiment dire "yin" et "yang"). Cette idée s'applique particulièrement bien à tout ce que produit le génie technique des hommes.
Excellente raison, de mon point de vue, pour considérer ce génie technique avec méfiance et en peser toutes les "trouvailles" avant d'estimer qu'elles répondent à des "besoins" effectifs. Tous les vrais besoins des hommes sont comblés dès aujourd'hui si l'homme le décide. Les nouveautés actuelles surfent sur le fait que beaucoup de gens (une minorité globale quand même) attendent fiévreusement la nouveauté de demain, au simple motif qu'ils ont de quoi vivre. Ils sont juste assez riches pour ne pas trop s'en faire, mais plus oisifs ou intérieurement démunis, donc ils s'ennuient, regardent la télévision et ne savent pas quoi faire de leur existence, dont ils pressentent qu'elle est devenue plus ou moins superflue et vide de sens. Ils passent beaucoup de temps à consommer de la raison de vivre.
Car il n'y a pas de raison pour que les raisons-de-vivre ne deviennent pas des marchandises comme toutes les autres marchandises. Les raisons de vivre pullulent dans les supermarchés du désir. Avec des durées de vie extrêmement variables : de l'extrême précarité d'une chaussette à l'imputrescibilité de l'âme, c'est au choix de chacun. Quand ils en ont usé une, la plupart des gens attendent avec impatience qu'on leur propose la suivante, si possible rutilante et pas trop chère. C'est pourquoi on les appelle des "consommateurs". Rares sont ceux qui préfèrent l'indélébile à l'effaçable.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 15000 scientifiques, avertissement à l'humanité, défense de l'environnement, écologie, écologistes, gabriel zucman la richesse cachée des nations, paul jorion se débarrasser du capitalisme, journal le monde, stéphane foucart, que faire, jorion vers un nouveau monde, nicolas sarkozy, ensemble tout devient possible, günther anders, l'obsolescence de l'homme, georges friedmann, théodore monod, georges brassens, yin yang, taoïsme, tao
mardi, 25 avril 2017
CHRONIQUES DE PAUL JORION
 2/2
2/2
Mais si Paul Jorion ne tient pas le discours aveugle que je dénonçais hier, il n'en reste pas moins, à sa façon, un optimiste indécrottable, car il ne se résigne pas à subir, et demeure, envers et contre tout, comme on dit, une "force de proposition". Il pense en effet qu’on peut encore inverser un cours des choses qui, selon moi, a bien des aspects irrémédiables.
C'est cet optimiste qui ne cesse pourtant de répéter, dans ses interventions, que les gens qui font le système économique actuel n'accepteront de faire quelque chose pour sauver la planète qu'à la seule condition que ça leur rapportera quelque chose. Contre cet aveuglement, Jorion croit aux vertus de l'action individuelle et de l'action de groupe. Bien lui en fasse : pourquoi pas, après tout ? Je crois que c'est se faire bien des illusions sur le pouvoir de l'individu "acteur", dont se gargarisent bien des sociologues de l'école "moderne".
Il suffit pour s'en rendre compte d'examiner les propositions de Paul Jorion, dans le dernier chapitre (Que faire ?), qui sont les suivantes : 1 – Faire du respect de l’environnement une donnée économique. 2 – Restaurer la régulation. 3 – Rétablir une authentique science économique. 4 – Faire de l’Etat providence une fin en soi. 5 – Casser la machine à concentrer la richesse. 5 – Envisager autrement la question du travail et de l’emploi. 6 – Donner tout son rôle à l’opinion publique. 7 – Faire du socialisme (non stalinien) un objectif à atteindre.
Autant dire un programme révolutionnaire, qui prend carrément de front les tenants du système qui, de leur côté, ont tous les moyens en main pour s'y opposer. L’environnement ? En plus du réchauffement climatique, comptons sur la déforestation, l’acidification des océans, l’empoisonnement des hommes par toutes sortes de substances chimiques mutagènes, etc. La régulation ? Pour vaincre toutes les résistances, on verra dans 50 ou 100 ans. La science économique ? Il faudrait commencer par déboulonner les doctrines libérales qui font autorité dans l’Université et dans tous les « think tanks » possibles et imaginables (appelons ça la "pensée dominante", voire la "pensée unique"). L’Etat providence ? Qui aujourd’hui, à part Jorion et quelques autres "économistes atterrés", ne tire pas dessus à boulets rouges ? Interdire la concentration de la richesse ? Je crois que les « versements d’intérêts », les « dividendes » et les « bonus extravagants » (p. 223) ont encore de très beaux jours devant eux.
Bref, on dira que je ne vois que les obstacles, que je suis défaitiste, et tout ça. Soit, mais qu’on me montre, par exemple, les progrès accomplis en Europe pour lutter contre la concurrence salariale ou fiscale entre les pays qui la composent, ou contre la généralisation de l'emploi du glyphosate ou des néonicotinoïdes dans l'agriculture. L’Irlande avec son impôt dérisoire sur les sociétés, le Luxembourg avec ses « rescrits fiscaux », la Bulgarie avec ses travailleurs détachés « low cost », on n’en finirait pas d’énumérer les maux de l'ultralibéralisme économique qui déferlent sur le continent, et qui font de chacun des pays un rival, voire un adversaire de tous les autres. Quel beau modèle d'"Union", en vérité !
La raison du pessimisme qui me fait trouver chimérique le dernier chapitre du livre de Paul Jorion tient peut-être à un tempérament, mais elle tient aussi à quelques lectures (Jacques Ellul, Günther Anders - qui assume les yeux ouverts le renoncement à tout espoir, entre autres). J'avais eu la même impression en lisant La Richesse cachée des nations, de Gabriel Zucman : diagnostic impeccable sur le mal et sur ses causes, propositions et solutions totalement irréalistes. C'est le cas de tous ceux qui, dans le troisième temps de leur raisonnement (vous savez : constat / causes / solutions), commencent à balancer par paquets entiers les "il faut", "on doit" et autres formules comminatoires et vaines. Il y a là du Don Quichotte. Car la raison de mon pessimisme tient encore au regard que je porte sur le rapport des forces en présence et à la conception que je me suis faite, à tort ou à raison, de la notion de système.
En particulier, je me dis qu’un système (défini comme réseau serré d'interactions, de relations étroites et d’interdépendances multiples) a le plus grand mal à se critiquer lui-même, et encore plus à se corriger lui-même. Il suffit de voir la façon dont le système capitaliste a proprement digéré toutes les critiques qui lui ont été faites depuis ses origines, et annihilé tous les efforts faits, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour l'inciter ou le contraindre à changer. La plasticité de ce système semble sans limite : il s'adapte à tout, il avale tous ses contradicteurs, tous ses opposants, et même tous ses ennemis. Il s'est sans cesse renforcé des attaques de ses adversaires, et a jusqu'ici fait son miel de tous les pollens destructeurs envoyés contre lui comme des missiles.
Pour prendre un exemple minuscule qui illustre la chose à merveille, je pense à la micro-controverse qui eut lieu (en 1996) entre Pierre Bourdieu et le journaliste Daniel Schneidermann, qui l’avait invité à son émission télé Arrêt sur image. On peut dire que la télévision est une sorte de quintessence de la "société spectaculaire-marchande". A ce titre, l’émission ayant bien frustré le sociologue, il écrivit pour Le Monde diplomatique un article intitulé "Peut-on critiquer la télévision à la télévision ?", dans lequel il développait une argumentation serrée et pertinente. La réplique du journaliste, dans le numéro suivant, avait été assez basse pour s’en prendre à la personne même de Bourdieu, allant même jusqu'à insinuer, si je me souviens bien, que le sociologue est habité par le fantasme suggéré par la deuxième syllabe de son nom.
Conclusion : la télévision est un système, lui-même puissant instrument entre les mains du capitalisme, et en tant que tel, elle n’a rien à craindre de qui que ce soit pour continuer à exister. Elle digère tout, puisqu'elle transforme tout ce qui passe par elle en pur spectacle. Accepter d'aller sur un un plateau de télé, c'est devenir par le fait même un rouage du système. C'est apporter sa caution à son organisation (jusqu'à Poutou gardant le sourire pendant que Ruquier et son équipe se foutent de sa gueule ; on peut préférer Dupont-Aignan, n'acceptant l'invitation de telle chaîne que pour pouvoir, tel Maurice Clavel en son temps ("Messieurs les censeurs, bonsoir !"), faire son éclat en quittant le plateau brutalement, mais pour quel bénéfice réel ?).
Tiens, à propos de spectacle, je pense aussi à Guy Debord qui, après avoir voulu détruire en la mettant à nu la dite « société spectaculaire-marchande » dans ses œuvres, à commencer par La Société du spectacle, son maître livre, a laissé des archives que l’Etat français à intégrées sans aucun mal à ses collections institutionnelles au titre de « trésor national ». Ces paradoxes ne sont qu’apparents : tout ce qui fait système est invulnérable aux initiatives individuelles les plus « antisystèmes », et celui-ci se montre en mesure d'augmenter ses propres forces en faisant siennes jusqu'à la substance et à la dynamique de ses plus féroces opposants.
Cela ne m’empêche pas de saluer bien bas la combativité de Paul Jorion. Je ne sais plus qui (Albert Jacquard ?) a dit : « On ne peut pas changer le monde, mais le peu qu’on peut faire, le tout petit peu qu’on peut faire, il faut le faire ». C’est avoir la foi chevillée au corps. Et j’avoue que je n’aimerais pas voir le jour où Paul Jorion baissera les bras.
Cet homme éclaire le chemin.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, capitalisme, paul jorion, se débarrasser du capitalisme est une question de survie, éditions fayard, jacques ellul, günther anders, pierre bourdieu, daniel schneidermann, arrêt sur image, dupont-aignan, philippe oputou, laurent ruquier, guy debord, debord la société du spectacle
vendredi, 07 avril 2017
PAUL JORION ET LA TECHNIQUE
 J'ai commencé la lecture de Se Débarrasser du capitalisme est une question de survie, de Paul Jorion, l'anthropologue-financier-spécialiste de l'intelligence artificielle qui a immiscé ses diverses grandes aptitudes et ses compétences éminentes en plein cœur du territoire sacré de la tribu des arriérés mentaux qui persistent à se gonfler d'importance avec le titre soi-disant honorifique d' "économistes".
J'ai commencé la lecture de Se Débarrasser du capitalisme est une question de survie, de Paul Jorion, l'anthropologue-financier-spécialiste de l'intelligence artificielle qui a immiscé ses diverses grandes aptitudes et ses compétences éminentes en plein cœur du territoire sacré de la tribu des arriérés mentaux qui persistent à se gonfler d'importance avec le titre soi-disant honorifique d' "économistes".
Ces prétendus "économistes" persistent, contre toute vraisemblance, à présenter l'économie comme une "science exacte" : c'est une des plus belles impostures intellectuelles qui aient jamais réussi à s'installer dans les institutions humaines, dont tout le corps argumentatif n'a pour but que de légitimer "scientifiquement" l'appropriation du bien de tous par quelques-uns. Tout ce que dit Jorion de cette confiscation est juste.
Là où je m'éloigne des propos de cet homme à l'intelligence hypothético-déductive très au-dessus de la mienne et aux connaissances infiniment plus diversifiées, c'est quand il dit que "la technique est neutre". Cela me surprend de sa part. A mon avis, rien n'est plus faux. Il adopte le raisonnement de tous ceux qui disent également que "la science est neutre", et qui professent que "tout dépend de l'usage qui en est fait".
Günther Anders dit pourtant, parlant de la technique, et je suis d'accord : « Ce qui peut être fait doit être fait. », autrement dit : si l'on veut le bienfait de l'innovation, il faut en accepter, même à son corps défendant, le méfait, comme par exemple avec l'énergie nucléaire : aucun progrès ne se fait sans une perte ou une menace symétrique.
La médecine pourrait aussi servir d'exemple : capable de sauver bien des vies mais, pour cela, responsable de la "bombe" démographique que ses grands principes et son efficacité ont fait exploser. On ne voit pas comment la technique pourrait échapper à ça : le Mal est le partenaire nécessaire du Bien. L'un ne saurait aller sans l'autre. La technique véhicule, à égalité, le Bien et le Mal, comme toutes les inventions humaines, car ce n'est pas l'invention, mais l'intention qui compte. Passons.
A la page 30 de son dernier livre, Paul Jorion cite les noms de quelques grands contempteurs de la technique, dans l'essence de laquelle ils voient incarnée une forme du Mal : « En ce sens, je me distingue de penseurs comme Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Günther Anders, etc., pour qui la technique est précisément tout sauf neutre ». Ayant lu divers ouvrages de ces trois auteurs, je me dis que c'est eux qui ont raison, et que Paul Jorion commet ici un erreur. Car il pense que la technique est au service exclusif d'une préoccupation humaine fondamentale : éviter les efforts auxquels l'homme peut échapper, grâce à son ingéniosité. En résumé : se faciliter la vie (confort, etc.). C'est évidemment vrai, mais.
Mais je crois qu'il n'est pas pertinent pour autant de placer la science et la technique dans un ciel éthéré où le savoir et l'ingéniosité régneraient en divinités tutélaires, rayonnantes et indifférentes à leur environnement. Car la science et la technique apparaissent dans un univers déjà constitué. Appelons ça, faute de mieux, "organisation sociale". Les découvertes, inventions et innovations atterrissent dans une société toute structurée, selon un certain ordre ou, pour mieux dire, une hiérarchie sociale donnée.
Paul Jorion étant, à la base, anthropologue, il ne devrait pas être imperméable au fait que la moindre innovation technique est nécessairement mise en service en fonction de la répartition des pouvoirs dans la société où elle apparaît, en particulier dans un temps de propriété intellectuelle, de brevetabilité des moindres trouvailles, et où le service Recherche et Développement (R&D) de toutes les entreprises de pointe attire comme un aimant l'argent des entrepreneurs soucieux de conquérir de nouveaux marchés et des investisseurs avides de futurs profits.
La technique, dans le monde qui est le nôtre, est indissolublement liée à l'économie capitaliste. C'en est au point que la jonction de la technique et de l'argent a fini, après deux siècles, par constituer la colonne vertébrale de notre civilisation. La technique est désormais inséparable de l'argent, donc de ceux qui le détiennent. Or, et ce n'est pas Jorion qui dira le contraire, le pouvoir, aujourd'hui, est moins entre les mains des instances politiques que dans celles des instances directoriales des grands groupes transnationaux.
Encore ce matin, j'ai entendu je ne sais plus quel candidat à la présidentielle considérer que son rôle, s'il était élu, serait de tout faire pour que la France s'adapte en urgence aux mutations technologiques qu'on voit à l'œuvre dans le monde. Traduction : courir après l'inventivité des bureaux R&D, dont les GAFA (Google, etc.) actuels et futurs tiennent les leviers. Ce qui veut dire rester dans l'urgence permanente, et implique autant de bouleversements de la société qu'il y aura d'innovations, sans jamais prendre le temps de réfléchir aux conséquences.
S'il en est ainsi, le pouvoir politique n'a pas fini de courir après le pouvoir économique et le pouvoir financier, ni la société tout entière d'en être le jouet. Et la technique n'a pas fini de façonner notre monde et notre vie à son gré, et à celui des gens qui la financent et qui en promeuvent la marchandisation (la vogue actuelle est aux "objets connectés" : achetez, braves gens, et le pire, c'est que les gens y vont).
J'ai du mal à comprendre la conception de Jorion, qui fait de la technique un en-soi admirable, qui prouve sans cesse, selon lui, la fertilité du génie humain, mais qu'il isole de la situation concrète dans laquelle elle se manifeste. En particulier, il semble faire comme si la technique était indépendante des rapports de pouvoir. Un paradoxe, quand on sait qu'il soutient, au grand dam des "économistes" orthodoxes, que les prix se fixent moins en fonction de l'ajustement miraculeux d'une offre et d'une demande que de rapports de forces.
Sans aller jusqu'à parler comme Günther Anders (voir citation plus haut), je crois que la technique, pas plus que la science, n'est neutre. C'est bien à cause de notre technique que tant de sociétés et de cultures primitives (sans "", au diable les précautions oratoires ou lévi-straussiennes) ont été modifiées en profondeur, puis désorganisées, au point de disparaître. Ce qui montre au passage que la technique et les usages qui en sont faits sont inséparables : ce qui peut être fait sera fait.
La technique n'est pas seulement une manifestation du génie propre de l'homme : faite aussi pour amplifier l'efficacité du geste, elle amplifie du même coup le pouvoir de celui qui l'accomplit et, plus encore, de celui au service de qui le geste s'accomplit. Là où Günther Anders me semble plus proche de la vérité que ne l'est Jorion, c'est quand il soutient que l'homme, au XX° siècle, est devenu un apprenti-sorcier en mettant au point des inventions totalement incommensurables avec ses capacités cognitives, irrémédiablement limitées. J'ajoute que tout se passe comme si l'homme avait fait de la technique une espèce radicalement nouvelle de transcendance, aussi radicalement insaisissable que Dieu.
Tout se passe en effet comme si la technique s'était autonomisée, avait pris la clé des champs, échappé à tout contrôle et roulait pour son propre compte : n'est-on pas en train de mettre au point des machines capables d'apprendre par elles-mêmes ? La pulvérisation du champ de la connaissance en une infinité de domaines et de disciplines toujours plus "pointus" interdit désormais qu'une quelconque vue d'ensemble puisse en être donnée : chaque spécialité poursuit sa recherche sans se soucier en rien de ce que font toutes les autres, et personne ne se soucie d'opérer la synthèse de ce puzzle de plus en plus inintelligible. Personne ne songe à dresser la cartographie du savoir humain, dans sa multiplicité et sa globalité, d'une façon qui permette de donner un sens à cette totalité. Qui peut dès lors se targuer de comprendre quoi que ce soit au monde actuel ? Le monde tel qu'il se fait échappe même aux plus puissants : que comprend Donald Trump au monde tel qu'il est ?
Soutenir la neutralité de la technique me semble juste une aberration. Paul Jorion dit (toujours p.30) : « Je vois plutôt le développement technique comme le prolongement du processus biologique », et plus loin : « Au fond, la technique était inscrite dans le biologique ». J'avoue : là, je ne comprends pas. Mystère et boule de gomme. Et je me dis que l'analogie est toujours une dangereuse figure de rhétorique, puisqu'elle se fonde sur l'adage "Tout est dans tout, et réciproquement".
La volonté de Paul Jorion, dans Se Débarrasser ..., d'en appeler à un changement radical me voit partagé entre, d'un côté, le plaisir de constater chez lui une combativité inentamée et la certitude que le rapport des forces en présence fait irrésistiblement pencher la balance en faveur du système en place. Son projet est de promouvoir un "socialisme authentique" (= non stalinien). Autrement dit : une révolution. J'ai le malheur de ne pas croire un instant à cette hypothèse.
Car si un "système" est l'ensemble des interactions qui induisent un réseau d'interdépendances entre les éléments qui le constituent, ce système est d'autant plus intouchable qu'il est vaste et complexe. Or il suffit d'observer le fonctionnement de l'Europe (non démocratique) à 27 membres pour se rendre compte que, plus on est nombreux à décider, plus la décision est paralysée. Plus les acteurs du système sont nombreux, plus ils gaspillent de l'énergie à négocier des compromis, presque toujours forcément des accouchements de souris. Les possibilités d'agir sur la marche du monde pour en corriger la trajectoire en fonction d'une volonté politique sont de jour en jour plus limitées. J'en conclus que, dans un contexte de mondialisation effrénée et de dérégulation des échanges de toutes sortes, la planète ne peut qu'accoucher d'un être aussi paralytique que l'est l'ONU depuis lurette.
Pendant cette paralysie de l' "Entente politique mondiale", soyons sûrs que les acteurs économiques particuliers (GAFA, actionnaires, bureaux de R&D, etc.), non seulement ne restent pas inactifs, mais continuent à agir, à accroître leur puissance, à grossir, au travers de "fusions-acquisitions" toujours plus gigantesques (Bayer bouffant Monsanto dernièrement), à étendre leurs réseaux, à renforcer l' "effet-système" de leurs liens multiples et, finalement, à rendre impossible le moindre mouvement de l'un des éléments du système par rapport aux autres, pris qu'il est dans les rets d'un filet dont aucun regard ne peut mesurer les dimensions. Toute "révolution", fût-elle pacifique, devient de jour en jour plus impensable.
Il suffit, pour se convaincre de l'inégalité dans le rapport de forces, de suivre un peu les tergiversations et contorsions funambulesques auxquelles la Commission européenne nous a habitués, à propos, entre autres, du glyphosate, face à la puissance de feu des lobbies industriels.
Paul Jorion refuse de rendre les armes et d'avouer la défaite : attitude noble. Un baroud d'honneur, alors ? Cela ressemblera tout au plus à la mort héroïque de la Légion étrangère à Camerone en avril 1863. On pourra toujours commémorer la bataille. Je ne dis pas qu'il a tort mais, comme dit le cardinal de Retz, nous verrons ce qu'il en est à la fin "par l'événement". Mais quel mémorialiste racontera l'histoire de Paul Jorion en guerre contre l'usurpation du pouvoir de l'argent sur le sort de l'humanité ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul jorion, se débarrasser du capitalisme est une question de survie, le dernier qui s'en va éteint la lumière, günther anders, jacques ellul, bernard charbonneau, l'obsolescence de l'homme, le système technicien ellul, r&d, recherche et développement, gafa, google, apple, facebook, amazon, france, politique, société, philosophie, europe, commission européenne, bayer monsanto, glyphosate, ogm, cardinal de retz
mercredi, 29 mars 2017
OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE ?
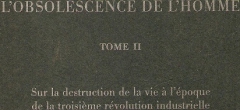 GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME
(Tome II, éditions Fario, 2011).
Introduction : les trois révolutions industrielles (1979)
Collage de citations, épisode II.
(Voir présentation hier.)
Aujourd’hui, les pays technocratiques ne sont plus unis par une même foi [judéo-chrétienne]. Au contraire, c’est l’athéisme (à vrai dire rarement exprimé mais pourtant très répandu) qui est la base des sciences physiques et naturelles (malgré les déclarations de foi occasionnelles de certains physiciens), et qui unit désormais ces pays.
La quatrième "révolution" contenue à l’intérieur de la troisième révolution – c’est d’elle que je vais traiter maintenant – est la tendance à rendre l’homme superflu, aussi absurde que cette formule puisse sembler. Elle cherche à remplacer le travail de l’homme par l’automatisme d’instruments ; à réaliser un état dans lequel on ne peut pas dire que personne n’est requis, mais seulement le moins de travailleurs possible, car il s’agit bien entendu d’un processus asymptotique.
L’une des caractéristiques essentielles de la phase de la révolution industrielle appelée "rationalisation" tient au fait qu’elle liquide l’homme en tant qu’homo faber ; au fait qu’elle provoque une situation dans laquelle le travail devient jour après jour plus rare et plus inhabituel ; une situation dans laquelle ce dernier, loin de continuer à valoir comme une malédiction – sur ce point la Bible a aujourd’hui complètement tort – finira par être revendiqué comme un droit et un privilège réservé à une élite chaque jour plus réduite.
Le temps libre, c’est-à-dire le non-travail, sera au contraire ressenti comme une malédiction. Et à la place de la célèbre sentence biblique (Genèse, 3, 17), il faudra alors dire : "Tu devras caler ton derrière dans un fauteuil et rester bouche bée devant la télévision toute ta vie !".
La machine est redevenue une concurrente et une ennemie. Mais la crise n’est pas seulement de retour : cette fois-ci, elle est incomparablement plus dangereuse qu’autrefois. Et cela, non seulement parce que ceux qu’elle touche aujourd’hui et ceux qu’elle touchera demain ne sont pas une minorité, mais surtout parce que, cette fois, il n’y aura plus de refuge. "Où, dans quel espace vide, dans quels espaces de travail encore inexistants, et qui ne seront d’ailleurs jamais produits, pourront bien être neutralisées les masses dont on n’aura plus besoin ?" – la question reste ouverte.
Les quelques privilégiés qui auront encore le droit de travailler n’échapperont pas non plus à ce destin, même pas pendant leurs heures de travail. On les privera, eux aussi, de la chance de réaliser leur désir de travail et de prendre du plaisir à travailler, puisqu’ils devront se contenter du rôle de "bergers des automates" : ils exerceront des activités qui ne se distinguent plus de l’inactivité que parce qu’elles sont rémunérées.
Cette irrésistible évolution en direction de la "vie vide", qui a débuté il y a juste un demi-siècle à l’époque de la mise au chômage du monde, et a trouvé son "terme" sanglant dans le national-socialisme, est l’une des caractéristiques principales de la troisième révolution industrielle dont il est question dans ce deuxième tome. Puisqu’à l’époque des médias électroniques il n’existe plus d’endroit où l’on pourrait ne pas être informé ou plutôt désinformé, ou encore, pour être plus précis, plus d’endroit où l’on pourrait échapper à la contrainte d’être informé, puisqu’il n’existe plus aucune province, il n’existe donc plus d’endroit où l’on n’a pas les oreilles saturées des bavardages sur la "perte de sens" des philosophes ordinaires, des psychanalystes, des prêcheurs des ondes ou encore des "cassettes automatiques de consolation" à écouter par téléphone.
Le monde est considéré comme une mine à exploiter. Nous ne sommes pas tenus d’exploiter tout ce qui est exploitable mais aussi de découvrir l’exploitabilité "cachée" en toute chose (et même dans l’homme). La tâche de la science actuelle ne consiste dès lors plus à découvrir l’essence secrète et donc cachée du monde ou des choses, ou encore les lois auxquelles ils obéissent, mais à découvrir le possible usage qu’ils dissimulent. L’hypothèse métaphysique (elle-même habituellement tenue secrète) des recherches actuelles est donc qu’il n’y a rien qui ne soit exploitable.
Tout cela est écrit en 1979. Certaines assertions me semblent stupéfiantes de clairvoyance.
On comprend ici, entre autres, le désespoir que recouvre sans le dire la proposition du "revenu universel". Ce qui est sûr, c'est que c'est la "civilisation" elle-même qui sera menacée par l'existence de masses énormes de populations condamnées à l'inoccupation. Il s'agira bien, comme dit Anders, de les "neutraliser". Faisons confiance à l'humanité, qui a démontré, au cours du XX° siècle, qu'elle connaît quelques moyens radicaux. On trouve déjà, dans Les Origines du totalitarisme (Hannah Arendt, 1951), l'expression "populations superflues". On peut craindre que la Terre soit amenée à porter de plus en plus d'hommes qui ne servent à rien : l'humanité surnuméraire. On a une idée de ce qui risque d'arriver, en regardant ce qui se passe en tout petit, par exemple, à Mayotte ou en Guyane où une natalité galopante jointe à l'absence structurelle de travail fait du désœuvrement de foules de jeunes la cause de bien des troubles. Que se passera-t-il quand il viendra à l'idée des masses de gens inoccupés que leur avenir n'est pas au programme des puissants ?
Dans L'Obsolescence de l'homme, Günther Anders, contrairement au reproche qu'il fait à Ernst Bloch, montre qu'il a "le courage de cesser d'espérer". J'ai comme l'impression que le philosophe ne croit guère au pouvoir de l'action (politique) ni à la possibilité de modifier le cours des choses. Parce que, pour lui, le mal est fait et que, selon toute probabilité, il est irrémédiable. A transmettre à Paul Jorion.
mardi, 28 mars 2017
OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE ?
 GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME
(Tome II, éditions Fario, 2011).
Le texte qui suit n’est pas un texte, mais un collage de citations picorées, dans un scrupuleux ordre chronologique d'entrée en scène, dans la petite vingtaine de pages de l’introduction de L’Obsolescence de l’homme (tome II), intitulée « Les trois révolutions industrielles ». Le texte a été écrit en 1979, soit il y a près de quarante ans. Dire qu’Anders est un penseur radical est un euphémisme. Le bouquin aligne l'examen de vingt-huit "obsolescences" (des apparences aux machines et à la méchanceté, en passant par les idéologies, l'anthropologie philosophique et l'histoire) repérées par l'auteur et dûment analysées de la fin des années 1950 à 1979 (il est mort en 1992, à l'âge de quatre-vingt-dix ans). Il s'agit de restituer à l'humain d'aujourd'hui l'abjection de l'état dans lequel l'avancement de la technique l'a plongé en lui faisant croire que là étaient son génie, sa dignité et son avenir. La mission que s'assigne Anders est celle d'arracher le masque : celui dont s'affuble la future extinction de l'humanité, sous le nom de "progrès technique".
Mais dire qu’il annonce la catastrophe finale qui doit détruire l’humanité, comme me le disait quelqu’un récemment, c’est n’avoir pas compris le sens de sa démarche. Günther Anders n’annonce rien : il ne fait que décrire à sa façon le monde tout à fait présent qui est le sien.
Son interprétation des faits, en particulier tout ce qu’il dit de l’emprise de la technique et des machines sur notre vie, ne fait aucune concession à un quelconque optimisme. Il le dit lui-même, il n’y a pas d’issue : ce qu’il reproche à Ernst Bloch, c’est précisément qu’ « il n’a pas eu le courage de cesser d’espérer » : phrase extraordinaire et, on le comprend, inacceptable.
Il a fait de l’exagération du trait une méthode parfaitement assumée (on trouve ça dans le tome I). Est-ce que cela disqualifie toute sa démarche ? Je n’en crois rien : trop d’éléments de son analyse trouvent quarante ans après leur confirmation dans notre réalité. Qu’on en juge par ce qui suit. Pour que tout cela reste un peu digeste, j’ai divisé ma petite sélection des propos en deux épisodes. On notera en passant quelques remarques (clonage, cassettes, ...) qui datent le temps où le texte fut écrit.
Episode I.
C’est une caractéristique de la situation actuelle que la légion des machines existantes tende finalement à constituer une seule mégamachine et ainsi, à fonder le "totalitarisme du monde des choses."
Ce ne sont pas à proprement parler les produits eux-mêmes qui jouent le rôle de moyens de production, mais l’acte même de consommer – un fait véritablement honteux, puisque notre rôle, à nous les hommes, se limite dès lors à veiller, en consommant des produits (que nous devons encore, par-dessus le marché, payer) à ce que la production suive son cours.
Ce qui peut être fait doit être fait. C’est de la technique que viennent les impératifs moraux d’aujourd’hui ; et ceux-ci ridiculisent les postulats moraux de nos aïeux, pas seulement ceux de l’éthique individuelle, mais aussi ceux de l’éthique sociale.
Puisqu’il en va ainsi, nous vivons – depuis trente ans déjà – dans une époque où nous travaillons en permanence à la production de notre disparition.
L’obsolescence d’Ernst Bloch, qui s’est opposé au simple fait de prendre en compte l’événement Hiroshima, a consisté dans sa croyance – aboutissant presque à une forme d’indolence – selon laquelle nous continuons à vivre dans un "pas-encore", c’est-à-dire dans une "pré-histoire" précédant l’authenticité. Il n’a pas eu le courage de cesser d’espérer, ne serait-ce qu’un moment. Peu importe qu’elle se termine maintenant ou qu’elle dure encore, notre époque est et restera la dernière, parce que la dangereuse situation dans laquelle nous nous sommes mis avec notre spectaculaire produit, qui est ainsi devenu le signe de Caïn de notre existence, ne peut plus prendre fin – si ce n’est pas l’avènement de la fin elle-même.
Je pense à deux d’entre eux [deux bouleversements] : au fait monstrueux que l’homme est pu se transformer en homo creator et à celui, pas moins inouï, qu’il ait pu se transformer lui-même en matière première, c’est-à-dire en homo materia.
Il existe maintenant des processus et des éléments de la nature qui n’existeraient pas si nous ne les avions pas créés.
La transformation de l’homme en matière première a commencé à Auschwitz.
Je ne sais pas si l’on a déjà cloné des gènes humains. Mais comme nous savons que l’impératif actuel est : "Ce qu’on peut faire, on doit le faire", ou : "Ce qui est faisable est obligatoire", ce qui n’est pour l’instant encore qu’une possibilité est déjà là aujourd’hui comme un présage qui nous coupe le souffle.
Note : Ernst Bloch (1885-1977), philosophe allemand, a écrit, entre autres, Le Principe espérance.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, modernité, günther anders, l'obsolescence de l'homme, progrès technique
vendredi, 13 janvier 2017
REVENU UNIVERSEL : L'AVEU
LE TRAVAIL NE REVIENDRA PAS
On entend ça sur toutes les ondes : le revenu universel est le dernier hochet à la mode, que se disputent et dont débattent gravement de savants économistes. Tel ou tel politicien (hier soir lors du débat la "Belle Alliance Populaire" (!), alias "la Primaire de la gauche", Benoît Hamon, mais aussi Yannick Jadot, …) en mal de programme électoral propose même de l’instaurer. A quel niveau doit-il être fixé, 500, 700 ou 900 euros par mois ? Trois cents milliards ou quatre cents ? Qui va payer ? Doit-il être donné de façon inconditionnelle ou sous condition de ressource ? Est-ce un bien ou un mal ? Est-ce une incitation à la paresse ? Serait-ce une défaite ou une victoire de la civilisation ?
Je laisse les débatteurs s’écharper : mon propos est ailleurs. Car l’irruption de ce thème sur les scènes politique, économique et médiatique (même si certains trouvent des précurseurs dans les autrefois) débarque comme la révélation d’une vérité qu’aucun responsable n’ose encore formuler explicitement : le seul fait que puisse être proposé sans rire de donner aux gens de l’argent sans rien attendre d’eux en échange révèle quelque chose qui est au cœur du monde contemporain. En un mot, c’est un aveu.
L’aveu de quoi, demandera-t-on ? C’est tout simple, c’est ce que j’affirmais crânement le 6 juin 2016 : non, le travail ne reviendra pas. Il est parti en Chine et ailleurs avec nos usines et nos machines. Si des patrons, des économistes, des hommes politiques en sont arrivés à faire la proposition du revenu universel, c’est qu’ils le savent et qu’ils n’ont même aucun doute à ce sujet. Et ceux qui voient une foutaise dans la proposition, ceux qui espèrent les relocalisations des entreprises, ceux qui promettent le retour de la « croissance » pour vaincre le chômage, ceux-là sont tout simplement des menteurs.
Si Mario Draghi, directeur de la Banque Centrale Européenne, a pu émettre (en 2016) sans se faire traiter de malade mental la suggestion (à moitié sérieuse quand même) de jeter des masses d’argent par hélicoptère sur les populations européennes, c’est qu’il le sait, lui aussi.
Tout ce beau monde sait parfaitement que, si un jour des tâches de production sont rapatriées sur notre territoire, ce sera sous forme de travail robotisé et qu’en lieu et place d’usines où des centaines, voire des milliers d’humains gagnaient leur vie (ci-dessous Renault, l’île Seguin, la sortie, « Il ne faut pas désespérer Billancourt », c’était il y a combien de siècles ?), il y aura bientôt des unités de production où les machines travailleront toutes seules, surveillées par une poignée de gens observant des cadrans et payés pour veiller au grain. La foule des autres ne servira plus à rien.

Tout ce beau monde sait que le travail ne reviendra pas. Et si des hauts responsables de collectivités humaines, des gens sérieux, proposent aujourd’hui de payer les gens à ne rien faire, j’y vois, en même temps qu’une certitude, une résignation, voire un désespoir. Car cela doit être une épreuve intellectuelle et morale insoutenable que d’avoir à renoncer au travail, ce pilier des sociétés humaines depuis des millénaires, un pilier qu’on croyait éternel et inébranlable, puisque c’est autour de lui que les sociétés dites évoluées ont construit leur existence.
Cette révolution anthropologique ébranle les vérités qui structurent les individus et les sociétés sous toutes les latitudes depuis Mathusalem. La cause en est donc connue : la numérisation, l’automatisation, la robotisation, l’intelligence artificielle, l’avènement de machines capables d’apprendre en cours de fonctionnement grâce au « deep learning ».
La technique n’aura bientôt plus besoin de l’homme. Et c’est l’homme qui se lance avec enthousiasme dans la réalisation de ce projet ! Oui, l'homme est un loup pour l'homme (Plaute). Il ne fait plus le poids, et c’est lui qui, non content d’avoir fait la bombe atomique, a inventé ce monde totalement artificiel qui le dépasse, le détrône et, pour finir, ne va pas tarder à le chasser : une autre belle bombe en perspective !
Pourtant, il n'a pas manqué de Philippulus le Prophète pour annoncer le pire. Günther Anders l’a bien dit dans L’Obsolescence de l’homme (II) : plus la machine acquiert de compétences, plus le travailleur devient un simple spectateur, et même un serviteur de la machine. Paul Jorion ne prend même pas la peine d'étayer ce qui est pour lui une certitude, et tient pour acquise la perspective de l’extinction de l’humanité (Le Dernier qui s’en va éteint la lumière). Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, combien d’autres … (voir mon billet du 4 juin 2016). Tous prophètes de malheur, sauf que Philippulus retourne à l'asile, alors que le système se contente de répondre aux autres : « Cause toujours ».
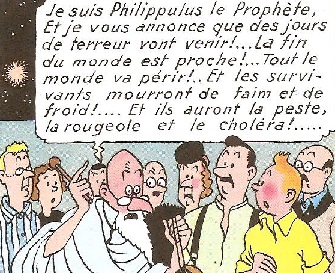
Quant aux oisifs définitifs, aux chômeurs à vie payés pour rester chez eux, à cette humanité rendue superflue par le « Progrès » technique, comment vont-ils pouvoir tuer les masses de temps libre qu’ils auront à l’horizon ? On dit souvent que les gens cherchent un bon boulot, c’est-à-dire un job qui les motive et les intéresse. Plus rarement entend-on formuler l’idée que s’il y a un travail, c’est parce qu’il remplit une fonction sociale, qu'il a une utilité sociale.
En travaillant, on a (au moins en théorie : un métier est plus qu'un travail, qui est plus qu'un boulot, qui est plus qu'un emploi, qui est lui-même plus qu'un job, sans parler des « bullshit jobs », les "boulots-bouse-de-vache" ou "boulots de merde") l’impression de se rendre utile. Le job ("AVS") qui consiste à servir de béquille aux très vieilles personnes, est-ce un métier ? Celui qui le fait se sent peut-être utile. Piètre consolation, car en général, le sentiment éprouvé par les chômeurs de longue durée est un sentiment de profonde inutilité.
A quoi je sers, se demandent-ils avec raison ? S'ils se sentent inutiles, c'est qu’ils sont de fait socialement inutiles. Pas besoin d’être psy pour savoir que c’est difficilement supportable, surtout dans la durée. L'humanité jetable. D'où l'utilité du concept de déchet utilisé par le sociologue Sigmund Baumann (qui vient de mourir) pour qualifier le statut de l'humain obligé de quitter sa maison et son pays pour des contrées, croit-il, moins menacées, mais aussi le statut de l'homme-consommateur, devenu déchet liquide à force de consommer.
Une société sans travail (ne parlons pas de ceux qui sont à découvert le 10 du mois), même dotée du revenu universel (payée pour vivre en grève illimitée !), a de bonne chance de devenir une cocotte-minute. Quelle soupape de sécurité va-t-on bien pouvoir mettre au point pour éviter l’explosion de la bombe ? Que faire pour éviter que les masses d'oisifs à perpétuité descendent dans la rue pour tout casser ?
Le Festivus festivus de Philippe Muray sera-t-il envoyé aux oubliettes par l'invasion du divertissement, non plus comme parenthèse ou échappatoire comme il le dénonçait, mais comme principe organisateur conditionnant tout notre mode de vie ? Faudra-t-il multiplier à l’infini les animations, les spectacles, les "événements", les écrans, les jeux vidéo, les casques de réalité virtuelle pour que les populations se tiennent tranquilles, et acceptent de ne pas mettre la société à feu et à sang ? Est-ce sous la forme de « société du divertissement obligatoire et permanent » que les concepteurs de la « société des loisirs » imaginaient celle-ci ?
Qu’est-ce que ça peut donner comme musique, un concert de bouches inutiles ?
« Non, je crois que la façon la plus sûre de tuer un homme,
C’est de l’empêcher de travailler en lui donnant de l’argent. »
C'est Félix Leclerc qui dit ça ("100.000 façons de tuer un homme
"). A transmettre aux promoteurs du revenu universel. J'aimerais pouvoir penser qu'il a tort. J'aimerais.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élection présidentielle, france, politique, société, manuel valls, arnaud montebourg, vincent peillon, sylvia pinel, benoît hamon, yannick jadot, primaire de la gauche, revenu universel, revenu de base, délocalisations, relocalisation, mario draghi, banque centrale européenne, renault billancourt, numérisation, automatisation, robotisation, intelligence artificielle, deep learning, philippulus le prophète, tintin, hergé, l'étoile mystérieuse, günther anders, l'obsolescence de l'homme, paul jorion, le dernier qui s'en va éteint la lumière, jacques ellul, bernard charbonneau, félix leclerc, belle alliance populaire, bce, cent mille façons de tuer un homme, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, plaute, bullshit jobs, philippe muray, festivus festivus, sigmund baumann
lundi, 16 mai 2016
TCHERNOBYL ET APRÈS
LA SUPPLICATION,
de SVETLANA ALEXIEVITCH
PRIX NOBEL DE LITTERATURE
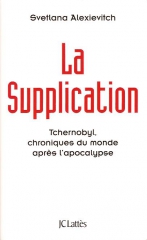 1/3
1/3
Si, avec La Fin de l’homme rouge (Lattès, 1998, voir ici 6 et 7 mai), Svetlana Alexievitch avait fait une sorte de terrible bilan du passé communiste de la Russie (bien que beaucoup de témoignages soient bien ancrés dans le paysage tout à fait présent de la « nouvelle » Russie, celle de Poutine, si peu reluisante et charitable au petit peuple), avec La Supplication, elle dessine le tableau de l’horreur absolue qui s’est installée pour des centaines d’années, depuis le 26 avril 1986, dans la région de Tchernobyl.
La Biélorussie a été frappée plus durement que l’Ukraine par l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl : deux millions des citoyens (sur dix que compte le pays) vivaient dans le rayon d’action du nuage qui s’en est échappé. Le lecteur du livre, je vous assure, ne sort pas indemne d’une telle épreuve. Merci aux âmes bien trempées de la partager. Et que les âmes plus sensibles veuillent bien me pardonner. D'ailleurs, l’auteur nous prévient : la catastrophe n’est pas derrière nous, mais devant : « Plus d’une fois, j’ai eu l’impression de noter le futur » (p.35). Froid dans le dos, si on regarde la vérité bien en face.
[Les quelques photos qui parsèment ces billets sont entre autres du photographe Paul Fusco, dont j'ai montré ici quelques autres clichés le 28 avril dernier. Par ailleurs, je signale que je n'ai pas cherché ce qui pouvait bien différencier les rems des curies, les curies des röntgens, les röntgens des becquerels.]

Et je pense à ce qui attend peut-être un jour les habitants de la région lyonnaise, qui vivent à quarante kilomètres à vol d’oiseau de la centrale de Saint-Vulbas. Mais non, voyons, vous ne risquez rien, on vous dit ! On est en France, on est sérieux. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai tendance à ne plus faire confiance aux discours rassurants des thuriféraires du nucléaire (on se rappelle l'inénarrable professeur Pellerin, avec l'énormité fabuleuse de son mensonge au sujet d'un nuage radioactif resté bloqué à la frontière française, sans doute grâce à nos valeureux douaniers et à leurs "petits bras musclés").
Or, en l’état actuel des choses, on est obligé de faire confiance aux concepteurs, aux ingénieurs, aux techniciens, aux constructeurs : ils tiennent nos vies entre leurs mains. On est obligé de croire sur parole une poignée de gens qui détient en son pouvoir le sort de combien de millions d'autres ? Pour devenir antinucléaire, lisez La Supplication de Svetlana Alexievitch. Remarquez, je l’étais déjà bien avant. L’énergie nucléaire est une démence lancée à fond les ballons parmi les hommes.

La méthode de l’auteur n’a pas varié : de longs entretiens avec toutes sortes de témoins du déroulement de la catastrophe et de ses conséquences à long terme. La différence avec son livre sur le système soviétique et celui qui lui a succédé crève les yeux. On peut dire que la société communiste (et après) était simplement inhumaine, et que la cause en était directement humaine. Alors que Tchernobyl a obligé les hommes à affronter une force incommensurable aux capacités de l’homme.
Car tout ce qui s’est passé après le 26 avril dépasse l’entendement, est totalement inimaginable. L’homme est tout simplement enterré vif : « Le train roule à toute vitesse, mais en guise de machinistes, il est conduit par des cochers de diligence » (p.187), dit Alexandre Revalski, historien, qui ajoute, soudain poète : « Les roues des charrettes s’enlisent dans la boue, mais nous tenons l’oiseau de feu dans nos mains. (…) Voilà de la superbe : nous allons cuire des œufs au plats sur le soleil » (p.186).

Quant à Valentin Alexeïevitch Borissevitch, physicien, voici ce qu’il dit : « L’homme se détache de la Terre … Il manipule d’autres catégories temporelles et pas seulement la Terre, mais d’autres mondes. L’Apocalypse … L’hiver nucléaire … » (p.194). Un photographe : « Or Tchernobyl est une ouverture sur l’infini » (p.206). Comment l’homme pourrait-il être à la hauteur d’une invention qui outrepasse si absolument ses capacités ? Une enseignante constate : « Mais nous avons toujours vécu dans l’horreur et nous savons vivre dans l’horreur. C’est notre milieu naturel » (p.155).
C’est de la même démesure, celle aussi qu’honnissaient les Grecs de l’antiquité, que parle Günther Anders, à propos de la bombe atomique, dans L’Obsolescence de l’homme. Chez les Grecs, l'ubris (ὕϐρις) était châtiée par les dieux, parce qu'ils avaient le sens du sacré. La science a réussi au vingtième siècle à ressusciter une forme de sacré : la terreur que la bombe H a répandue parmi les hommes en est un signe, peut-être une preuve.

Et les consignes draconiennes de sécurité qui règnent sur les centrales nucléaires n'ont-elles pas à voir avec le sacré ? Celles-ci ne sont-elles pas gardées comme des temples, ces enceintes où l'on n'était autorisé à pénétrer qu'en observant un strict rituel de gestes et de comportements, sous peine de sacrilège ? Et les châtiments dont l'atome a déjà puni l'humanité (Hiroshima, Nagasaki, Three Miles Island, Tchernobyl, Fukushima, ...) ne sont-ils pas infligés par une divinité ?
Il y a de la transcendance dans l'atome, cet infiniment petit au potentiel infiniment grand, au service duquel se sont mis de modestes humains en blouse blanche. L'atome est un dieu implacable, fabriqué de toutes pièces par ses adorateurs. De plus, il est interdit de le toucher, d'entrer en contact avec lui : il est incommensurable. De plus, il est indestructible, puisqu'il faudrait l'enfouir au cœur de la Terre pour que l'homme échappe à son action. Et encore, ce n'est pas sûr : la Terre, comme toute la Nature, recèle aussi bien la Vie que la Mort.
La Supplication s’ouvre et se referme sur les témoignages de deux femmes de « liquidateurs ». Le premier est proprement insoutenable. Le mari, qui est pompier, est appelé sur les lieux dans la nuit du 26 au 27. Il y va en chemise, sans chapeau : « Ferme les lucarnes et recouche-toi. Il y a un incendie à la centrale. Je serai vite de retour » (p.11). Il a mis deux semaines à mourir dans d’atroces souffrances (« En quatorze jours, l’homme meurt… »). La femme raconte : « Les selles vingt-cinq à trente fois pas jour ... Avec du sang et des mucosités ... La peau des bras et des jambes se fissurait ... Tout le corps se couvrait d'ampoules ... Quand il remuait la tête, des touffes de cheveux restaient sur l'oreiller » (p.22). Plus loin : « Il avait également fallu couper l'uniforme, car il était impossible de le lui enfiler, il n'avait plus de cors solide ... Il n'était plus qu'une énorme plaie » (p.26).
Et elle, elle ne voit même pas les hideuses transformations physiques de son mari, elle ne voit que l’homme qu’elle aime plus que tout au monde, elle ne le quitte que pour dormir un peu, bien qu’on lui dise et répète que : « Ce n’est plus un homme, mais un réacteur » (p.24). Peu après, elle accouche d’une fille saine, sauf qu’elle a une cirrhose (« Vingt-huit röntgens dans le foie »), une malformation cardiaque, et qu’elle mourra à l’âge de quatre heures.
La femme, qui veut rester anonyme, termine ainsi son témoignage : « Mais moi, je vous ai parlé d’amour … De comment j’aimais » (p.31). Le dernier chapitre n’ajoute rien à cet enfer vécu, à part le fait que, intervenu plus tard sur le site, le mari met un an à mourir. Le chapitre initial et le final sont tous deux intitulés « Une voix solitaire ».
Une autre femme, qui habite Khoïniki (non loin de la centrale), raconte : « Ma fille m’a dit récemment : "Maman, si j’accouche d’un bébé difforme,je l’aimerai quand même". Vous vous rendez compte ? Elle est en terminale et elle a déjà des idées pareilles. Ses copines aussi, elles pensent toutes à cela … Un garçon est né chez des amis à nous. Il était tellement attendu ! Vous pensez, le premier enfant d’un couple jeune et beau ! Mais le bébé a une énorme fente en guise de bouche et pas d’oreilles … » (p.208-209).
Certains disent que l’homme s’adapte à toutes les situations. Je n’y croyais pas, mais après tout, c’est peut-être vrai.
Non, ce n'est pas vrai.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, svetlana alexievitch, prix nobel de littérature, alexievitch, la fin de l'homme rouge, la supplication alexievitch, éditions jean-claude lattès, vladimir pourine, tchernobyl, biélorussie, ukraine, paul fusco chernobyl legacy, centrale bugey saint-vulbas, centrales nucléaires, énergie nucléaire, günther anders, l'obsolescence de l'homme, pripiat
jeudi, 21 janvier 2016
NÉO-RÉAC ET FIER DE L’ÊTRE
Double page « Débats » dans Le Monde daté 19 janvier : « Les néoréacs ont-ils gagné ? ». Ah, que l’intention est belle et noble ! Nicolas Truong, journaliste, fait précéder son article de présentation du « chapeau » suivant : « Le succès d’audience politique et l’hégémonie médiatique des antimodernes ou des néoconservateurs est-il le signe d’une dérive droitière en France ou provient-il de leur capacité à nommer le mal qui ronge nos sociétés ? ». L’alternative proposée a un air d’honnêteté à première vue. A ceci près que je m’étonne de l’expression "audience politique" : je ne savais pas que Finkielkraut, Onfray ou Zemmour (portraiturés en la compagnie bizarre de Patrick Buisson) avaient été nommés conseillers de nos plus hauts responsables politiques, dont ils ne pensent en général pas beaucoup de bien.
Quant à "hégémonie médiatique", je suis très mal placé pour en juger, dépourvu que je suis de cet appareil qu’on appelle « télévision », pour un motif que je persiste à estimer crucial, déterminant, vital, prépondérant, bref : capital. Comme Günther Anders et Guy Debord, je pense en effet qu’avec le poste de télévision installé en bonne place au salon, est juridiquement constitué le délit d’atteinte à la liberté individuelle. Je ne suis donc pas en mesure d’évaluer la force de l’emprise des « néoréacs » sur les plateaux. Contrairement à Philippe Sollers, qui osait dénier à Louis Althusser la qualité de "penseur" du seul fait qu'il n'avait pas la télévision, je crois qu'il est plus facile de continuer à penser quand on n'est pas encombré de cet objet intrusif. Je préfère m'en remettre au concept de "spectacle", élaboré par Guy Debord (voir mon billet du 18 janvier).
A voir l'armée des boucliers qui se lèvent dès qu’un de ces individus suspects ouvre la bouche, j'ai plutôt l'impression que le mot d’ordre est très généralement de faire taire les "néoréacs" sous le déluge des réactions scandalisées. On peut faire confiance au chœur des flics de la pensée pour veiller comme des vestales vigilantes sur le consensus moral, moralisant et moralisateur, dans lequel ils s’efforcent de bétonner toute l’époque, à coups de glapissements. Voir par exemple la façon dont Michel Onfray, qui a été récemment vomi par les cent bouches de la déesse dont parle Georges Brassens dans "Trompettes de la renommée" (« Pour faire parler un peu la déesse aux cent bouches, Faut-il qu'une femme célèbre, une étoile, une star, Vienne prendre entre mes bras la place de ma guitare »), s'est senti obligé de fermer sa page fesse-bouc et son « fil twitter ».
La haine de ces sentinelles de la "Nouvelle Vertu" pour ceux qui commettent des infractions à l’ordre qu’ils veulent faire régner a quelque chose de stupéfiant, et pour tout dire d’incompréhensible. Dans ses pages « Débats », Le Monde se garde bien entendu de trancher, et Nicolas Truong veille soigneusement à ne pas déroger à la sacro-sainte règle de neutralité, qui maintient la ligne du journal dans un juste-milieu de bon aloi, équidistant des extrêmes. Inattaquable.
Enfin, quand je dis "soigneusement", j’exagère. Certes, Nicolas Truong donne la parole à Alain Finkielkraut, et son interview peut donner une impression d’impartialité. Mais il ouvre dans le même temps les colonnes du journal à deux guerriers de la "Nouvelle Vertu" : l’historien Daniel Lindenberg et la sociologue Gisèle Sapiro, qui font jaillir, du haut des chaires universitaires où ils vaticinent, le venin capable de renvoyer l’ennemi déclaré dans le néant dont il n’aurait jamais dû sortir. Comptez : un neutre, un pour, deux contre. Le combat était inégal avant même la publication.
Le point commun, dans l’argumentation de ces deux mercenaires, c’est de ranger les intellectuels « néoréacs » parmi les responsables de la montée de l’extrême-droite : Sapiro fait référence au mouvement allemand « Pegida », Lindenberg à l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson. Lindenberg accuse même les « néoréacs » de véhiculer « une authentique rhétorique d’extrême-droite », quand Sapiro fait mine de s'alarmer de leur succès médiatique « alors que le FN est en pleine ascension ». L’intention, au moins, est claire : disqualifier l’adversaire en le faisant complice de supposés fascistes. Finkielkraut faisant le jeu de Marine Le Pen, l'hypothèse est tellement courge que je ne la discute même pas.
Ce qui apparaît de façon lumineuse, en tout cas, c’est la dissymétrie entre les argumentaires des uns et de l’autre. Alain Finkielkraut porte un regard sur l'ensemble de l'époque : « Je cherche seulement à penser le présent selon ses propres termes. Je le dépouille ainsi des oripeaux dont le revêt la prétendue vigilance et je suis traité de néoréac parce que je dis : "Le roi est nu" ». Finkielkraut mène une analyse du monde tel qu’il va. Il se contente de dire, à la suite de Guy Debord et de Philippe Muray, que le monde et l'humanité vont très mal. Il a quitté les rangs des choristes de l’Empire du Bien, c’est ce que ceux-ci ne lui pardonnent pas.
Car la dissymétrie est là : autant Finkielkraut parle du monde, autant Sapiro et Lindenberg parlent de Finkielkraut. Je veux dire que, si l'un parle du monde, les autres parlent de la personne qui a parlé. Quand celle-ci développe une argumentation « ad rem », ceux-là se déchaînent « ad personam ». Le coup classique : quand un argument t'embarrasse, il suffit d'attaquer la personne qui l'a proféré. Dans la plupart des cas, ça marche, devant les badauds.
Daniel Schneidermann avait utilisé la même ficelle, en son temps, dans Le Monde diplomatique (mai 1996) contre Pierre Bourdieu (que je n'aime pourtant guère), en réponse à l’article où celui-ci tirait les conclusions de son passage dans son émission Arrêt sur images, article intitulé « Peut-on critiquer la télévision à la télévision ? ». Schneidermann, dont j’estime le travail par ailleurs, n’avait pas aimé du tout, et s’en était pris à son invité en l’accusant, entre autres, en jouant sur son nom, de se prendre pour Dieu, si je me souviens bien. J'avais trouvé ça assez bas.
En gros, les « néoréacs » posent un diagnostic sévère sur l’état actuel du monde, alors que leurs accusateurs insultent les personnes qui osent un tel diagnostic. Coup classique, certes, mais infâme. Nicolas Truong pose d’ailleurs la question : « … et si ces néoconservateurs avaient raison ? ». Passons sur les qualifications d' "antimodernes" et de "néoconservateurs", bien qu'il y eût eu à dire. Eh oui, pendant que le sale gosse Alain Finkielkraut est le seul à dire que le roi est nu, alors que la foule des courtisans fait semblant de s’extasier sur la somptuosité de ses vêtements transparents, Daniel Lindenberg et Gisèle Sapiro intiment l’ordre au sale gosse de se taire : il ne faudrait pas, en disant la vérité, désespérer le peuple, on ne sait pas ce dont il serait capable. Cela pourrait créer du désordre.
Cela n’empêche pas Gisèle Sapiro d’avouer sa niaiserie profonde. Devinez comment elle conclut sa diatribe imbécile. Tout simplement en posant la question qu’elle n’aurait jamais dû oser poser. Car après avoir déversé son venin, voici ce qu’elle écrit : « Ils "passent" bien à la télévision ou à la radio. Cela contribue-t-il à expliquer ce qui n’en demeure pas moins un mystère, à savoir, pourquoi ils suscitent un tel intérêt auprès du public ? ». C'est un aveu de défaite, en même temps que d'incompétence fielleuse. Traduction : si le gars a du succès, la teneur de ses propos n'y est pour rien, c'est juste parce qu'il est télégénique.
Traduction bis : pourquoi les gens en redemandent, de ces salauds de « néoréacs », au lieu de nous écouter religieusement, nous qui savons ("de toilette", réplique Boby Lapointe) dire les mots qu'il faut pour rassurer ? Daniel Lindenberg et Gisèle Sapiro ne sont pas des menteurs professionnels. Ils haïssent seulement les porteurs de vérités désagréables. Et le "public" représente à leurs yeux un insondable mystère. J’imagine que leur gagne-pain est lié à la conviction qu’ils affichent dans l’entreprise systémique de dénégation du réel. Sapiro n'est pas près de se faire écouter du peuple. Non, je ne crois pas, contrairement à ce que nous serinent les sondages, que les gens "ont peur", "sont angoissés", et tout ça. J'ai plutôt l'impression que les gens se disent, jour après jour : quel sale monde que le monde qui s'annonce ! Et tous ces guignols qui font semblant de le trouver radieux !
Car Sapiro avoue ici, ingénument, son ignorance de l’essentiel, à savoir ce qu’attendent les gens. Ce qu’ils attendent ? Que ceux qui causent dans le poste leur disent enfin la vérité sur le monde réel. Oui, monsieur Truong, ils attendent des responsables un peu de courage, celui qu’il faut pour « nommer le mal qui ronge nos sociétés », comme vous écrivez. "Nommer le mal" ! Et je peux vous dire que ce mal s’appelle le Mensonge. Et les gens n’en peuvent plus : si on ne leur donne pas la vérité, c’est normal qu’ils préfèrent mettre la tête sous l’aile et s’abstenir aux élections. Leur taux d’abstention est proportionnel au mensonge que les pouvoirs leur servent jusqu'à la nausée. Qui ose aujourd'hui "nommer le mal" ? Je ne vois que les « néoréacs ».
Car la vérité du monde aujourd’hui n’est pas belle à voir. Economie ? Le travail manuel remplacé par des robots, le travail intellectuel remplacé par des logiciels et des algorithmes : c'est promettre la fin du travail et le chômage de masse à perpétuité. Finances ? Soixante-deux bonshommes possèdent autant à eux seuls que la moitié de l’humanité. Politique ? Extinction des idées et des projets, omniprésence de la soif quasi-mafieuse de pouvoir. Ecologie ? Sale temps pour la planète. Et je laisse de côté les migrants, l’islam, Daech, la violence, les guerres en cours, les guerres à venir, …. Franchement, il est dans quel état, le monde ? Ceux qui causent dans le poste ne sont visiblement pas de ce monde-là. Ils doivent péter de trouille en envisageant le jour où les yeux des foules s'ouvriront.
Car il faut rester optimiste, se cramponner au "tout va bien, nous avons les choses bien en main". Alors exterminons les oiseaux de mauvais augure. Mettons à mort le messager porteur de mauvaise nouvelle. A la lanterne, les lanceurs d’alerte. On peut compter sur Daniel Lindenberg et Gisèle Sapiro pour leur passer le nœud coulant.
Je ne remercie pas Le Monde d'avoir donné la parole à deux faussaires, tout en faisant mine d'apporter sa contribution à un grand "débat de société". Qui peut encore croire que c'est le discours des « néoréacs » qui domine toute la scène intellectuelle ? Le Monde apporte ici la preuve du contraire.
La réponse à la question du début, c'est : les « néoréacs » ont perdu. Et ce n'est pas une bonne nouvelle.
Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, débats de société, alain finkielkraut, éric zemmour, michel onfray, günther anders, guy debord, nicolas truong, daniel lindenberg, gisèle sapiro, nicolas sarkozy, patrick buisson, philippe muray, l'empire du bien, daniel schneidermann, le monde diplomatique, pierre bourdieu, sociologie, arrêt sur images, boby lapointe, lanceurs d'alerte, georges brassens
vendredi, 11 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 6/9

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS
ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
6/9
Du triomphe de la Dissonance (ou "Le siècle du Divorce").
Car le 20ème siècle, encore plus que le 19ème, est celui où plus personne ne sait. Celui qui casse toutes les grandes machines à produire des points de repère intellectuels, moraux, sociaux, affectifs, religieux, politiques, idéologiques, psychiques. Celui qui disloque les machines à produire un SENS qui puisse servir d'assise à l'existence des gens. Celui qui m’a amené pour finir, dans un souci de préservation, à cesser de me vivre comme un contemporain de mon époque. Le siècle où je suis né a fini par me décider à me raccrocher à quelques rochers surnageant encore dans un océan de destructions, quelques îlots esthétiques où il semble encore possible de respirer malgré les conditions que fait le monde des hommes à l'humanité. Comme dit le grand Pierre Rabih : « On ne peut pas renoncer à la beauté ».
Le 20ème siècle est celui qui ne sait plus grand-chose de l’humanité. Bien des formes d’art qu’il a fait naître ignorent superbement l’humain. La beauté ? N'en parlez surtout pas en présence de Catherine Millet ou de Catherine Francblin, qui sont aux manettes de la revue Art press, cette manufacture de la "modernité" ultra-chic et à la pointe de toutes les avant-gardes. La beauté, c'est un critère ringard et archaïque. Et finalement, je crois qu’il est là et nulle part ailleurs, le grief radical que j’adresse à Marcel Duchamp et à toute son innombrable progéniture.
Encore pourrais-je moi-même, à bon droit, soutenir l’idée que cet inaugurateur de la destruction esthétique n’a fait que transposer dans le domaine de l’art ce qu’il voyait se produire sous ses yeux dans la réalité : Dada (auquel Duchamp a participé de très loin et "en esprit") est né en février 1916, c’est-à-dire en pleine guerre, plus précisément au moment du déclenchement de la grande boucherie de Verdun (où Falkenhayn avait promis de "saigner l'armée française"). Un symbole ? Le 20ème siècle comme assassin de l'idée de la beauté ?
Mais on rétorquerait à aussi bon droit que les premières œuvres plus ou moins ouvertement atonales (rompant avec les notions de tonalité, de mélodie et d'harmonie qui prévalaient jusque-là), datent d'avant ce premier carnage planétaire (le dernier Liszt, Scriabine). Je répliquerais au contradicteur que la guerre de 14-18 n’est pas sortie de nulle part, et que des prodromes de plus en plus nets (montée des nationalismes, rivalités impérialistes, entre autres) étaient perceptibles bien avant le 4 août 1914. Ce n'est pas pour rien que l'époque a produit dans le même temps le cubisme, la musique atonale, le dadaïsme et la guerre : ces choses-là sont vendues en "pack". Et c'est bien le problème : c'est à prendre ou à laisser. Mais était-il possible de "laisser" ?
En musique, l’indifférenciation radicale des douze sons de la gamme, puis plus tard l'extension de la notion de son musical à toutes les matières sonores possibles et imaginables, et l'élévation de tous les bruits à la dignité d'objets musicaux (Pierre Schaeffer a écrit Traité des objets musicaux, et puis ce fut la litanie : sons d’origine électronique, moyens portatifs d’enregistrement, et échantillonner, et couper-coller, et bidouiller, et métisser, et ...), tout ça pourrait être considéré comme autant d'oracles : en parallèle, plus le monde sonore (créé par l'homme) devenait dissonant, plus il annonçait à l’humanité que le 20ème siècle serait le grand siècle de la Dissonance généralisée et des conditions dissonantes de la vie.
Les conditions capables de rendre concevable et possible une éventuelle « Harmonie » ont disparu. La Dysharmonie règne en maîtresse. Et qu'on ne me raconte pas de fable à propos d'une improbable « Harmonie Nouvelle », à laquelle il faudrait que le bon peuple se fasse et s'habitue, bon gré mal gré. Trop de musiques du 20ème siècle sont, restent et demeureront inhabitables. Nous sommes les enfants de la Dissonance, de la Discorde, de la Distorsion, de la Dysharmonie, ... Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que la planète, la nature et les océans subissent les amères conséquences d'un siècle à ce point déprédateur.
La Dissonance est devenue la Norme dans la vie en même temps que dans les arts. La Dissonance, cette forme de Divorce qui demeurait l'exception auparavant (une dissonance finissait par une "résolution", c'est-à-dire un accord consonant), s'est ainsi banalisée et généralisée dans la peinture, dans la musique, dans la vie des gens mariés, dans la relation des hommes avec leurs semblables, dans leur relation avec la nature, etc. Le divorce est devenu le grand mode de vie, une modalité durable de l'être cassé en deux (en combien de morceaux ?). On a tenté de faire croire aux gens qu'on peut s'habituer à tout. Mais non : on ne s'habitue pas à tout. Nul ne peut habiter une maison qui le détruit. De quoi pleurer jusqu'à la fin des temps. Pour échapper à cette violence, une seule issue : divorcer de l'époque.
C'est ce genre de divorce qu'ont magistralement incarné quelques grandes figures de la pensée et de la littérature : Jacques Ellul, Günther Anders, Guy Debord, Philippe Muray, Michel Houellebecq, ... (le cas de Hannah Arendt, beaucoup moins en rupture, est différent). C'est l'unique raison que je vois à la détestation, que dis-je : à l'aversion, à l'exécration, à l'abomination dont ces dissidents font l'objet dans les milieux du consensus mou, de l'hypocrisie caritative, de la doxa, de la police de la pensée et du terrorisme intellectuel (quoique Debord ait récemment fait l'objet d'une récupération d'Etat : ses archives sont désormais un "Trésor national"). Cette pensée et cette littérature ont-elles infléchi la trajectoire d'une minute d'angle ? Je vous laisse répondre : c'est trop évident. Mais que peut la Culture ? Que peut la Littérature ? Que peut la Pensée ? Vous avez quatre heures pour rendre copie blanche.
Le monde pictural lui-même n’a pas attendu la guerre de 14-18 pour se détraquer : que faire, face à l'académisme, au conformisme pompier (Bouguereau, Couture, Meissonnier, Detaille, Laurens, Gervex, …) : obéir aux suggestions de Corot, de Rosa Bonheur, d’Eugène Boudin ? Une certitude émerge : il faut inventer pour exister. Claude Monet, qui se met à diviser les couleurs pures, à les juxtaposer, à rendre problématique la représentation du monde, pousse sur ce terreau, et tous les suivants, jusqu’à Seurat et Van Rysselberghe. Bientôt fauvisme, cubisme, suprématisme, surréalisme. Ces désintégrations successives disent un chose : à quoi bon l’art, quand le message porté par l’époque est la dissonance, la fragmentation, voire la négation de la réalité visible, bientôt suivies par la destruction des hommes à l’échelle industrielle ? Que reste-t-il à espérer du monde en train de se faire ?
Heureusement, les lois de l’inertie étant ce qu’elles sont, ce désespoir radical mettra un peu de temps à manifester sa radicalité (quoique ... Céline ...). La négativité côtoiera pendant quelque temps l’optimisme qui rend possible la création. Le cas du surréalisme est particulièrement riche d'enseignement. « Révolution » pour ses premiers promoteurs, puis mis « au service de la Révolution », on peut dire que, avant de rentrer dans le rang et de faire simplement de l'art "comme tout le monde", il a effectivement mis le bazar dans la culture, dans l'art et dans les esprits de son temps (en gros de 1924 à l'après-guerre, je compte pour rien les suiveurs, les suivistes, les petits curés, les "post-", les "épi-", les "para-", les prosélytes, les mouches à m...iel et les apôtres).
Avec le recul du temps, qu'en est-il ? Qu'ont-ils fait, en définitive, André Breton, ses séides et sa meute de courtisans (lire le méconnu Odile de Raymond Queneau à ce sujet, où le "pape du surréalisme" est dépeint sous les traits du pompeux Anglarès qui, entre parenthèses, passe beaucoup de temps, dans le livre, à boire des bières en compagnie de ses suiveurs), avec leur « automatisme psychique pur », leurs « rêves éveillés », leur « changer la vie, a dit Rimbaud, transformer le monde, a dit Marx, ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un » ?
D'un côté, ils ont permis à l'époque de croire qu'elle disposait encore de ressources jusque-là insoupçonnées, dans le sous-sol du psychisme. Une planche de salut inespérée. Si l'on veut bien comparer avec les gaz et pétroles de schistes, solution désespérée pour soi-disant remédier au « Peak Oil », le surréalisme apparaît comme l'ultime possibilité de croire que l'art disposait encore d'une réserve de nouveaux moyens d'expression. En amenant au jour tout un attirail d'images, d'objets et d'assemblages, les surréalistes ont pu donner l'illusion d'un gisement inépuisable de nouveaux papiers peints à apposer sur les murs de plus en plus craquelés de notre univers désolé.
De l'autre côté, ils ont fourni à la propagande, au bourrage de crâne, à l'endoctrinement, en un mot : à la publicité (alors en plein épanouissement : Edward Bernays et consort), un carburant aux effets puissants : une masse de thèmes nouveaux et surprenants, exploitables ad libitum. Ils ont permis à la bientôt sacro- sainte marchandise de prendre possession des esprits, et de se mettre à briller d'un éclat aveuglant à l'horizon de toutes les populations du monde. Magritte, en particulier, avec ses confusions en gros sabots (paradoxes visuels, premier plan / arrière-plan, calembours picturaux, jeux signifiant / signifié, etc...), reste une mine d'or pour bien des "créatifs" d'agences publicitaires.
sainte marchandise de prendre possession des esprits, et de se mettre à briller d'un éclat aveuglant à l'horizon de toutes les populations du monde. Magritte, en particulier, avec ses confusions en gros sabots (paradoxes visuels, premier plan / arrière-plan, calembours picturaux, jeux signifiant / signifié, etc...), reste une mine d'or pour bien des "créatifs" d'agences publicitaires.
En réalité, le surréalisme est la tentative désespérée d'une humanité poussée dans la nasse par un siècle fou, de trouver une issue de secours. Et l'on ne peut que constater les dégâts : plus la réalité s'est craquelée sous les coups totalitaires des camps de la mort, des procès de Moscou et de la "Bombe" (Allemands + Russes + Américains, ça fait du monde), puis sous les coups plus insidieux de la marchandisation progressive de tout, plus ce recours au monde intérieur, au monde de l'inconscient et de l'imaginaire apparaît comme un dernier refuge avant écrasement. Comme une impasse et un cul-de-sac. Un sac en plastique pour y mettre la tête jusqu'à ... On se félicite, rétrospectivement, de ce qu'André Breton ait été tout à fait insensible à la musique. Quels dégâts n'aurait-il pas commis ? Remarquez que d'autres s'en sont chargés, qui ne se réclamaient pas du surréalisme.
Le surréalisme a momentanément rassuré le monde de l'art en lui fournissant, pendant un temps, une sorte de trésor de substances nutritives de substitution (le surréalisme est au monde de l'art ce que la méthadone est à l'héroïne), en même temps que l'illusion de possibilités infinies de développement. En réalité, avec le surréalisme, le monde de l'art raclait ses fonds de tiroirs. Asséchait ses derniers marécages avant le désert. Achevait ce qu'avait commencé Alphonse Daudet avec son personnage principal, dans L'Homme à la cervelle d'or : se vider la tête.
Car ce qui est curieux ici, c’est de constater que plus le surréalisme met le paquet sur le renouvellement des images et ce ressourcement superficiel de l’imaginaire, plus la réalité concrète prend le chemin inverse, celui du sordide et de l’invivable. Au fond, les formes héritées du surréalisme constituent une sorte de dénégation générale de la réalité. Une dissociation d'ordre publicitaire (la dissonance métaphorique, qui prend des airs de coalescence : une femme nue pour vendre un yaourt, mettre du désir dans une marchandise, ...), qu’on observe pareillement dans l’évolution des discours politiques : plus la réalité fout le camp, plus le discours doit faire semblant de restaurer le désir en affirmant la maîtrise du politique sur le réel. En France, les politiciens incantatoires s'entendent à merveille pour nous en offrir des preuves éclatantes.
A partir de là, art et réalité ont pu diverger "à plein tube". "Artistes" et "responsables", de plus en plus déconnectés du réel, ont commencé à faire comme si. Comme si le monde ancien se perpétuait, pendant que la réalité foutait le camp, échappant à tout le monde. Comme si l’on pouvait continuer impunément à soutenir dans les mots un modèle déjà quasiment effondré dans la réalité. Tout le monde a fait semblant (faire semblant : un des sens du mot « Spectacle » dans le vocabulaire de Guy Debord). La Dissonance a gagné. Le Divorce est consommé.
Il y a donc beaucoup d’artistes (il faut bien vivre) qui se sont alors faits les simples greffiers du désastre, dont ils se sont contentés d’enregistrer, inlassablement, les signes. Ils ont tiré un trait définitif sur l’homme. Ils ont pris acte. Ils ont tourné la page, sans joie (quoique …), mais sans regret. Ils ont meublé ce désert enfin débarrassé de l’humain, nouveau territoire de l’art, des objets les plus divers surgis de leur fantaisie, de leurs caprices, de leurs humeurs, du hasard, des occasions. Ils ont inventé la gratuité, la futilité, la vanité du geste artistique, de même que je ne sais plus quel personnage de Gide médite je ne sais plus quel meurtre pour prouver que l’ « acte gratuit », ça existe. Ils ont introduit la destruction et le déchet dans l’acte créateur (toujours l’ultralibéral Schumpeter, avec sa "destruction créatrice"). D’où, entre beaucoup d’autres, la machine à caca ("Cloaca") de Wim Delvoye, façon de déclarer : « On est dans une belle merde ». Mais la merde peut-elle être belle ? Comme l’écrit quelque part Beckett : « Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste plus qu’à chanter ». C’est à cette vision du monde (« Weltanschauung ») que je ne peux me résoudre. 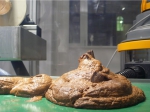
 Quand on a fait caca, on peut dire qu'on a "coulé un bronze", mais aucun être humain n'est en mesure de chier le "Persée" de Benvenuto Cellini. La Cloaca de Wim Delvoye en est une preuve répugnante.
Quand on a fait caca, on peut dire qu'on a "coulé un bronze", mais aucun être humain n'est en mesure de chier le "Persée" de Benvenuto Cellini. La Cloaca de Wim Delvoye en est une preuve répugnante.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, peinture, marcel duchamp, dada, dadaïsme, bataille de verdun, guerre 14-18, falkenhayn, franz liszt, scriabine, musique atonale, dodécaphonisme, musique sérielle, cubisme, pierre schaeffer traité des objets musicaux, dissonance, jacques ellul, günther anders, guy debord, philippe muray, michel houellebecq, pompiérisme, peintres pompiers, bouguereau, couture, meissonnier, detaille, gervex, corot, rosa bonheur, eugène boudin, claude monet, impressionnisme, divisionnisme, van rysselberghe, fauvisme, surréalisme, louis ferdinand céline, odile raymond queneau, edward bernays, publicité, magritte peintre, alphonse daudet l'homme à la cervelle d'or, wim delvoye cloaca, pierre rabih, revue art press, catherine millet, catherine francblin
jeudi, 10 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 5/9

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS
ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
5/9
Du siècle de la haine.
Comme dit Günther Anders, l’homme, cédant à la tentation de l’ « ὕϐρις » (hubris = démesure) contenue dans la maîtrise de moyens techniques toujours plus puissants, a fini par fabriquer un monde dont il a perdu la maîtrise. Un monde incommensurable avec les moyens proprement et pauvrement humains. Un monde qui a échappé à l'emprise humaine, qui me fait penser au cheval fou lancé sur le marché des Deux Cavaliers de l’orage de Jean Giono, qui détruit tout sur son passage, et que seul le poing formidable de Marceau Jason, d’un seul coup définitif, parvient à stopper en lui brisant le crâne.
Mais existe-t-il un Marceau Jason, pour arrêter le siècle fou ? Restera sans doute le poing dans la gueule. Le 20ème siècle, j’ai enfin commencé à le voir sous son vrai visage : le siècle qui éprouve de la haine pour l’homme. Le siècle de la déshumanisation du monde et de la fin de l’individu, d’émergence pourtant bien récente. Ce que raconte déjà Céline en 1932 dans le Voyage ..., lorsque Bardamu se fait embaucher chez Ford (« Nous n'avons pas besoin d'imaginatifs dans notre usine. C'est de chimpanzés que nous avons besoin »).
Le siècle de la défaite de l’humanité face aux moyens et aux innovations techniques aussi proliférants que la cellule cancéreuse. Le siècle de la défaite aussi face à la marchandisation de tout, y compris du vivant. Le siècle de la défaite, enfin, face à toutes sortes de volontés avides d’exercer le pouvoir sur les semblables. 1) Triomphe de la technique ; 2) triomphe de l’économie ; 3) volonté de pouvoir, le tout a formé, dans une osmose tout à fait logique, un triumvirat de haines conjointes pour combattre l’humanité de l’homme. Pour combattre le sens de la vie.
La technique (alias "l'innovation") à tout prix, le profit à tout prix, le pouvoir à tout prix : voilà la trilogie infernale qui meut le 20ème siècle, le premier qui a montré ce dont est capable l’industrie quand elle est mise au service de la guerre et de la mort, le « grand siècle » des suicides successifs de l’humanité en tant qu’espèce. Quand la machine est lancée et tant qu’elle a du carburant, il n’y a pas de raison qu’elle s’arrête. Le 20ème siècle est un attentat aveugle.
Le 20ème siècle est un long attentat-suicide. Le 20ème siècle est un crime contre l'humanité. Que voulez-vous qu'il fasse, l'art, dans ces conditions ? Ceux qui attendent de la "Culture" un quelconque salut sont des menteurs, ou bien ils font semblant. L'art, la culture, il faut s'en convaincre, n'ont aucun pouvoir : l'art et la culture sont toujours des effets, jamais des causes. Ils n'ont aucune chance de modifier directement la réalité. Surtout au moment où ils sont réduits à n'être que des produits de consommation. Dans l'histoire de l'humanité, l'art a toujours été "en plus", un luxe, après que les besoins vitaux avaient été comblés. L'art et la culture ont toujours été produits dans des collectivités humaines assez prospères pour se considérer comme abouties. Quand la civilisation se dégrade, on ne comprendrait pas que la Culture ne suive pas le mouvement.
Je me suis demandé de quoi pesaient, face à ce champ de ruine, les trésors d’imagination et d’inventivité, l’incessante et considérable créativité dont l’homme a fait preuve au cours de ce siècle damné. Cela vaut-il vraiment la peine, si ça débouche sur des calamités à chaque fois pires que les précédentes ? Un drôle de siècle, en vérité, où l’on a de plus en plus TROUVÉ, tout en sachant de moins en moins ce que l’on GAGNAIT à ces trouvailles (si, mais quoi d’autre, à part le confort, la facilité, l’oisiveté ?). Et en prenant soin d’ignorer ou d’occulter ce qu’on y PERDAIT (la nature, la société, ...). Malheureux ceux qui croient qu’on peut ainsi gagner quelque chose sans perdre ailleurs l'équivalent. Trouver toujours du nouveau est devenu un but en soi. Un Graal matérialiste. Une Dulcinée attendant toutes sortes de Don Quichotte, dans son Toboso crasseux.
Comme dit Baudelaire dans le dernier vers du dernier poème des Fleurs du Mal : « Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau ». Ce slogan devenu l’emblème de la modernité oublie cependant que la 8ème et dernière section du poème où il est inséré (« Le Voyage ») est tout entière placée sous une brutale invocation, puisqu’elle commence ainsi : « Ô Mort, vieux capitaine, … ».
Cette invocation prémonitoire à la mort jette une lumière terrible sur notre obsession de plus en plus effrénée de la nouveauté, de l’innovation permanente, qui est en réalité comme un tsunami silencieux, mais de tous les instants, jeté sur nos points de repère et nos institutions. Ah, les prosternés devant l’idole du « Monde qui change », qu’ils sont pitoyables et dangereux, ces amoureux de la mort !
Voilà qui devrait nous amener à réfléchir et à y regarder à deux fois, au lieu de nous précipiter comme des moutons carnassiers sur la moindre nouveauté (voir ce qui s’est passé dernièrement, lors de la sortie de l’iPhone 6 d’Apple).
Et puis je me suis demandé de quoi pesait, face aux puissants acteurs et facteurs de la catastrophe, le fourmillement des bonnes volontés qui se portaient au secours des malheureux, des démunis, des victimes. Et quand j’ai vu le rapport des forces en présence, je me suis dit que tout ce dévouement avait quelque chose de pathétique, comme un brave cœur qui aurait l’idée de se mettre à vider l’océan avec une petite cuillère au moment précis où la marée monte. J'ai pensé à ça en écoutant, dans l'émission Terre à Terre du 5 décembre, Martin Pigeon parler à Ruth Stégassy de son action - pathétique de faiblesse - contre l'influence omniprésente et presque toute-puissante des lobbies au cœur des institutions européennes, dans le bocal bruxellois.
Alors, l’art, dans ce sombre panorama ? Dans quel état voulez-vous qu’il soit, l’art ? Que voulez-vous qu’il fasse, l’art ? Libérer ? Faire découvrir ? Embellir ? Décrire ? Rassurer ? Transporter ? Elever ? Fouler aux pieds ? Exprimer ? Provoquer ? Enseigner ? Transgresser ? Transmettre ? Décorer ? Railler ? Enrichir l’imaginaire ? Contester ? Consoler ? Materner ? Faire la morale ? Faire passer un bon moment ? Symboliser ? Former la jeunesse ? Distraire ? Corriger la réalité ? Eveiller le sens esthétique ? Occulter ? Choquer ? Nier ? Faire oublier ? Travailler à l’édification des foules ? (pour la préface de Pierre et Jean, de Maupassant, voir billet d'hier).
Voilà, vous avez compris : l’art au 20ème siècle, c’est devenu tout ça à la fois, un véhicule à l’image de son époque : méchant, aveugle et fou. L’époque a, comme on dit, « pété un câble », fracassant toutes les boussoles. L’art a donc, à son tour, forcément, « pété un câble », obligeant les artistes à perdre le nord, à « débloquer », à ne plus savoir où ils se trouvent, perdus au fond d’une fourmilière étendue aux dimensions du monde.
Beaucoup d'entre eux se sont mis avec enthousiasme à cette nouvelle tâche qu’on leur assignait : « pédaler dans la choucroute » (on peut remplacer le plat alsacien, au choix, par l'ingrédient principal du couscous ou par le petit pot de lait fermenté inventé par les Bulgares).
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, drapeau tricolore, art contemporain, musique contemporaine, günther anders, jean giono, deux cavaliers de l'orage, marceau jason, louis-ferdinand céline, voyage au bout de la nuit, bardamu, baudelaire, les fleurs du mal, le voyage, ô mort vieux capitaine, tsunami, émission terre à terre france culture, ruth stégassy, martin pigeon
mercredi, 09 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 4/9

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS
ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
4/9
De pouvoir (ou non) supporter la laideur.
Héritier fidèle, viscéral et obstiné de ces Lumières-là, je demeure un fervent partisan de la liberté en tout, mais, soit dit une fois pour toutes, une liberté régulée. Une liberté contenue dans des bornes. Une liberté qui accepte de se restreindre. Tout n’est pas permis à l’homme, qu’il soit un individu, une collectivité, une société, un Etat, une entreprise. Tous les désirs n'ont pas à être réalisés au prétexte que c'est techniquement possible, que l'occasion s'en présente ou parce que, « après tout, j'y ai droit ».
Même Dieu en personne n'a pas le droit de tout faire, contrairement à ce que serine le Coran (par exemple : « Décide-t-Il d'une chose ? Il Lui suffit de dire : "Sois", et elle est », sourate XL, verset 68). L’individu est doté de liberté, de désirs et de conscience, oui, entièrement d’accord, mais il est aussi socialisé, je veux dire conscient de ses limites et de ses responsabilités à l'égard de ce qui rend sa vie possible, car il reste conscient qu'il n'est rien sans son lien avec le corps social : ça lui confère des droits, mais sûrement pas rien que des ou tous les droits. Je ne suis peut-être pas qualifié pour énumérer les caractères de ce qui fait une civilisation, mais j'ai l'impression d'en avoir dessiné ci-dessus quelques traits caractéristiques.
Autant le dirigisme et l'autoritarisme (quand un autoproclamé se met à parler à l'impératif) sont faits pour maintenir l'individu dans la sujétion, la frustration, la peur et l'immaturité, autant la permissivité, le laxisme, la dérégulation à tout va, qu’il s’agisse d’un individu, d’un Etat, de l'économie ou d’une entreprise, sont des facteurs de déliaison, de morcellement de l'entité collective, d’atomisation des individus, de désagrégation du « corps social » en une infinité d'unités autonomes. Oui, pour qu’il y ait société, il y a des limites à ne pas franchir.
Je dis cela en pensant à tous les fanatiques de la « transgression dérangeante », les adeptes de l’infraction innovante, de la provocation révolutionnaire et de l'outrage rédempteur, les casseurs de normes et de frontières et autres conformistes de l’anticonformisme, je veux dire ceux qui occupent en masse le haut du pavé de tous les terrains culturels subventionnés, de la danse au théâtre, en passant par l’opéra, la musique, la peinture et tout le reste. Toutes ces quilles que la boule impitoyable de Philippe Muray (il les traitait fort pertinemment de « Mutins de Panurge », cette formule géniale) n'a malheureusement pas réussi à abattre. Le pouvait-elle ?
Au surplus, j'ajoute que si je sais que l'intention prioritaire de l'artiste est par-dessus tout de me "déranger", de me provoquer ou de me choquer, je discerne la visée manipulatrice : pas de ça, Lisette ! Fous le camp ! Pauvre artiste en vérité qui se donne pour seul programme de modifier son public (c'était ce que voulait déjà Antonin Artaud, avec son "théâtre de la cruauté", Les Cenci et tout ça ... On a vu comment il a fini. Dire qu'il fascinait les élites culturelles !).
Pauvre artiste, qui se soucie moins de ce qu'il met dans son œuvre que de l'effet qu'elle produira : l'œuvre en question est ravalée au rang de simple instrument de pouvoir. Mégalomanie de l'artiste à la mode (c'était quand, déjà : « Sega, c'est plus fort que toi » ?), ivresse de puissance et, en définitive, un pauvre illusionniste qui s'exténue à chercher sans cesse de nouveaux « tours de magie » pour des gogos qui applaudissent, trop heureux d'y croire un moment, avant de retomber dans la grisaille interminable « d'un quotidien désespérant » (Brassens, "Les Passantes"). Après tout, ça leur aura "changé les idées" !
Je préfère que l'artiste ait le désir, l'énergie et le savoir-faire de créer à mon intention une forme qui me laisse libre de l'apprécier à ma guise. C'est ce que formule Maupassant dans la préface à son roman Pierre et Jean : « En somme, le public est composé de groupes nombreux qui nous crient : "Consolez-moi. Amusez-moi. Attristez-moi. Attendrissez-moi. Faites-moi rêver. Faites-moi rire. Faites-moi frémir. Faites-moi pleurer. Faites-moi penser." – Seuls, quelques esprits d'élite demandent à l'artiste : "Faites-moi quelque chose de beau, dans la forme qui vous conviendra le mieux, suivant votre tempérament" ». C'est parler d'or.
Voilà un programme qu'il est bon, nom de Zeus ! Je vois bien la contradiction : faut-il que l'artiste se retire dans son laboratoire pour peaufiner son grand œuvre sans se soucier de sa réception ? Faut-il qu'il cherche à plaire, à impressionner, en pensant à un public précis sur la plasticité et la réceptivité duquel il sait qu'il peut compter ? Il y a dilemme : y a-t-il pour autant incompatibilité ? J'essaie de répondre à la question dans un très prochain billet.
Vouloir agir sur le spectateur, c'est une intention de bas étage, de bas-côté, et même de bas-fond (au point que : « ... à peine si j'ose Le dire tellement c'est bas », Tonton Georges, "L'Hécatombe"). La création d'une forme, c'est une autre paire de manches. Les "transgresseurs" sont finalement des pauvres types, des médiocres, des minables destinés à disparaître au moment même de leur épiphanie.
Pour revenir à l'atomisation du corps social, je signale accessoirement que faire des individus autant d’entités autonomes, dégagées de tout apparentement est une visée propre à ce qu’on appelle le totalitarisme. Si on n’y est pas encore, on n’en est pas loin. Le totalitarisme, tout soft, invisible et sournois qu’il soit, dont est imprégnée à son insu notre démocratie (acharnée à nier et refouler cet inconscient-là) ; la frénésie et l’enthousiasme technicistes qui ont fait de l’innovation le seul idéal social encore agissant ; l’ultralibéralisme économique qui instaure la compétition comme seul horizon collectif et la marchandise comme unique accomplissement individuel, voilà, en gros, les trois facettes de notre condition humaine qui ont fini par se fondre dans mon esprit en un tout où l’humanité de l’homme n’a plus sa place. Inutile de le cacher : c’est une vision pessimiste.
Le pire, c’est que ce sont toutes les conditions de la vie collective qui me sont alors apparues comme affreuses. Ceci est assez difficile à exprimer en termes clairs : j’ai eu l’impression (fondée ou erronée, va savoir ...) d’acquérir progressivement une vue globale de la situation imposée à l’humanité par la « modernité ». J’ai acquis la conviction que les formes de ce qu’on appelle depuis plus de soixante ans l’ « art contemporain » ne sont pas une excroissance anormale de leur époque mais, au contraire, leur corollaire absolument logique. La même logique qui fait que l'arbre produit son fruit, et que l'Allemagne en crise produit Hitler. Eh oui, la difformité et l'aberration sont elles aussi produites, et ne sortent pas de nulle part.
Qui adhère avec enthousiasme à l’époque, est logiquement gourmand d’art contemporain, de musique contemporaine. Qui est rebuté par l’art contemporain, en toute logique, devrait diriger sa vindicte contre l’époque dont celui-ci est issu. J’ai mis du temps, mais j’ai fini par y venir. C’est alors que le processus de désaliénation (désintoxication si l’on veut) a pu s’enclencher : qui n’aime pas l’époque ne saurait aimer l’art qu’elle produit. Le lien de cause à effet est indéniable. Moi, je croyais aimer l’art de mon temps parce que je voulais être de mon temps. C’était décidé, il le fallait.
L’art contemporain découle de son époque. Tout ce qui apparaît minable dans l’art contemporain découle logiquement du minable de l’époque qui le produit. Ce n’est pas l’art qui pèche : c’est l’époque. Nous avons l’art que notre époque a mérité. Quand la laideur triomphe, c’est que l’époque désire la laideur : le vert « plug anal » géant de Paul McCarthy en pleine place Vendôme, précisément la place de Paris où sont fabriqués et exposés parmi les plus beaux, les plus précieux bijoux du monde, est logiquement produit par l’époque qui l’a vu naître. Les extrêmes – le sublime et la merde – se tiennent par la barbichette (que le sublime qui n'a jamais tiré la barbichette du merdique avance d'un pas, tiens, il va voir !). Quand il y a neuf « zéros » après le « un » de la fortune, la merde et le diamant se valent. On croit deviner que c'est en toute logique que le bouchon d'anus (sens de "plug") de M. McCarthy suscite l'émoi "esthétique" de la dame qui porte la présente bague (à propos de bague, cf. l'autrement élégante histoire de "L'anneau de Hans Carvel", qu'on trouve chez Rabelais, Tiers Livre, 26, qui donne une recette infaillible à tous les maris qui ne supportent pas l'idée que leur épouse les fasse un jour cocus).
laideur triomphe, c’est que l’époque désire la laideur : le vert « plug anal » géant de Paul McCarthy en pleine place Vendôme, précisément la place de Paris où sont fabriqués et exposés parmi les plus beaux, les plus précieux bijoux du monde, est logiquement produit par l’époque qui l’a vu naître. Les extrêmes – le sublime et la merde – se tiennent par la barbichette (que le sublime qui n'a jamais tiré la barbichette du merdique avance d'un pas, tiens, il va voir !). Quand il y a neuf « zéros » après le « un » de la fortune, la merde et le diamant se valent. On croit deviner que c'est en toute logique que le bouchon d'anus (sens de "plug") de M. McCarthy suscite l'émoi "esthétique" de la dame qui porte la présente bague (à propos de bague, cf. l'autrement élégante histoire de "L'anneau de Hans Carvel", qu'on trouve chez Rabelais, Tiers Livre, 26, qui donne une recette infaillible à tous les maris qui ne supportent pas l'idée que leur épouse les fasse un jour cocus).
 Paul McCarthy est l’humble serviteur de son temps : son œuvre est le revers infâme de la médaille dont la maison Van Cleef & Arpels (ci-contre) décore si luxueusement l’avers. Paul McCarthy est un artiste rationnel : il ne fait que tirer les conclusions qu’on lui demande de tirer. Son message ? "Parlant par respect", comme dit Nizier du Puitspelu dans son très lyonnais Littré de la Grand’Côte, quand il définit des mots et expressions "grossiers" : « Vous l’avez dans le cul ».
Paul McCarthy est l’humble serviteur de son temps : son œuvre est le revers infâme de la médaille dont la maison Van Cleef & Arpels (ci-contre) décore si luxueusement l’avers. Paul McCarthy est un artiste rationnel : il ne fait que tirer les conclusions qu’on lui demande de tirer. Son message ? "Parlant par respect", comme dit Nizier du Puitspelu dans son très lyonnais Littré de la Grand’Côte, quand il définit des mots et expressions "grossiers" : « Vous l’avez dans le cul ».
Mais si l’on admet que c’est l’époque qui produit cet art déféqué, c’est moins l’art qui est à dénoncer que l’époque qui l’a vu et fait naître, tout entière. De fait, ce n’est pas seulement l’art contemporain, la musique contemporaine, c’est le 20ème siècle dans son entier qui m’est devenu monstrueux. J’ai compris que Günther Anders avait raison : au 20ème siècle, l’humanité a commencé à méticuleusement édifier la laideur d'un monde d’une dimension telle que nulle force humaine n’était plus en mesure d'en comprendre le sens, encore moins d’en contrôler la trajectoire, et encore moins d'y vivre heureux.
Et le raisonnement qu’il tient à propos de la bombe atomique s’applique à tous les autres aspects du « Système » mis en place : c’est le bateau Terre qui, faute de pilote, est devenu ivre.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : siècle des lumières, liberté égalité fraternité, france, dieu, allah, coran, islam, maupassant, préface pierre et jean, georges brassens, totalitarisme, hitler, paul mccarthy, mccarthy plug anal, place vendôme, van cleef & arpels, lyon, nizier du puitspelu, littré de la grand'côte, l'obsolescence de l'homme, brassens l'hécatombe, brassens les passantes, élections régionales, jean-pierre masseret, politique, günther anders
mardi, 08 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 3/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
3/9
De l'importance de la lecture.
Ce qui est sûr, c’est que l’art contemporain, la musique contemporaine, la poésie contemporaine (en ai-je bouffé, des manuscrits indigestes, futiles, vaporeux ou dérisoires, au comité de lecture où je siégeais !), tout cela est tombé de moi comme autant de peaux mortes. De ce naufrage, ont surnagé les œuvres de quelques peintres, de rares compositeurs, d’une poignée de poètes élus. Comme un rat qui veut sauver sa peau, j’ai quitté le navire ultramoderne. J'ai déserté les avant-gardes. C’est d’un autre rivage que je me suis mis à regarder ce Titanic culturel qui s’enfonçait toujours plus loin dans des eaux de plus en plus imbuvables.
Comment expliquer ce revirement brutal ? Bien malin qui le dira. Pour mon compte, j’ai encore du mal. Je cherche. Le vrai de la chose, je crois, est qu’un beau jour, j'ai dû me poser la grande question : je me suis demandé pourquoi, tout bien considéré, je me sentais obligé de m’intéresser à tout ce qui se faisait de nouveau.
Mais surtout, le vrai du vrai de la chose, c’est que j’ai fait (bien tardivement) quelques lectures qui ont arraché les peaux de saucisson qui me couvraient les yeux quand je regardais les acquis du 20ème siècle comme autant de conquêtes victorieuses et de promesses d'avenir radieux. J’ai fini par mettre bout à bout un riche ensemble homogène d’événements, de situations, de manifestations, d’analyses allant tous dans le même sens : un désastre généralisé. C’est alors que le tableau de ce même siècle m’est apparu dans toute la cohérence compacte de son horreur, depuis la guerre de 14-18 jusqu’à l’exploitation et à la consommation effrénées des hommes et de la planète, jusqu'à l’humanité transformée en marchandises, en passant par quelques bombes, quelques génocides, quelques empoisonnements industriels.
 Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
A tort ou à raison, j’ai conclu de cette lecture décisive qu’Hitler et Staline, loin d’être les épouvantails, les effigies monstrueuses et retranchées de l’humanité normale qui en ont été dessinées, n’ont fait que pousser à bout la logique à la fois rationnelle et délirante du monde dans lequel ils vivaient pour la plier au fantasme dément de leur toute-puissance. Hitler et Staline, loin d’être des monstres à jamais hors de l’humanité, furent des hommes ordinaires (la « Banalité du Mal » dont parle Hannah Arendt à propos du procès Eichmann). Il n'y a pas de pommes s'il n'y a pas de pommier. Ils se contentèrent de pousser jusqu’à l’absurde et jusqu’à la terreur la logique d’un système sur lequel repose, encore et toujours, le monde dans lequel nous vivons.
Hitler et Staline (Pol Pot, …) ne sont pas des exceptions ou des aberrations : ils sont des points d’aboutissement. Et le monde actuel, muni de toutes ses machines d’influence et de propagande, loin de se démarquer radicalement de ces systèmes honnis qu’il lui est arrivé de qualifier d’ « Empire du Mal », en est une continuation qui n’a eu pour talent que de rendre l’horreur indolore, invisible et, pour certains, souhaitable.
Un exemple ? L’élimination à la naissance des nouveau-nés mal formés : Hitler, qui voulait refabriquer une race pure, appelait ça l’eugénisme. Les « civilisés » que nous sommes sont convenus que c’était une horreur absolue. Et pourtant, pour eux (pour nous), c’est devenu évident et « naturel ». C’est juste devenu un « bienfait » de la technique : permettre de les éliminer en les empêchant de naître, ce qui revient strictement au même. C’est ainsi que, dans quelques pays où la naissance d’une fille est une calamité, l’échographie prénatale a impunément semé ses ravages.
 D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système
D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
Je citerai une troisième facette de ladite évolution : une réflexion tirée d’ouvrages d’économistes, parmi lesquels ceux du regretté Bernard Maris (à  commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
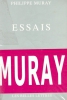 J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
Mais je dois reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
 Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude
Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
L'Histoire (le Pouvoir, la Politique), la Technique, l'Economie, donc : la trinité qui fait peur.
Restent les Lumières originelles : étonnamment et bien que je ne sache pas si le résultat est très cohérent, au profond de moi, elles résistent encore et toujours à l'envahisseur. Sans doute parce qu'en elles je vois encore de l'espoir et du possible.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, avant-garde, titanic, hannah arendt, les origines du totalitarisme, nazisme, staline, hitler, totalitarisme, stalinisme, banalité du mal, jacques ellul, le système technicien, le bluff technologique, günther anders, l'obsolescence de l'homme, bernard maris, charlie hebdo, antimanuel d'économie, jean-marc sylvestre, ultralibéralisme, philippe muray, l'empire du bien, exorcismes spirituels, éditions les belles lettres, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, une paire de bottes vaut shakespeare, éditions gallimard, george orwell essais articles lettres, jean-claude michéa, l'enseignement de l'ignorance, le moi assiégé, christopher lasch, la culture du narcissisme, michel houellebecq, la carte et le territoire, éditions l'encyclopédie des nuisances
jeudi, 24 septembre 2015
L'HOMME OBSOLÈTE
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 4
Sur la bombe et les causes de notre aveuglement face à l’Apocalypse
La remarque la plus étonnante – la plus amusante si l’on veut – qu’on trouve dans ce dernier essai composant L’Obsolescence de l’homme, se trouve p. 283. C’est le titre du §8 : « L’assassin n’est pas seul coupable ; celui qui est appelé à mourir l’est aussi ». Il se trouve que j’étais en train de lire Maigret et le clochard. Les hasards de l’existence … On lit en effet au chapitre IV ce petit dialogue entre M. et Mme Maigret : « – Les criminologistes, en particulier les criminologistes américains, ont une théorie à ce sujet, et elle n’est peut-être pas aussi excessive qu’elle en a l’air … – Quelle théorie ? – Que, sur dix crime, il y en a au moins huit où la victime partage dans une large mesure la responsabilité de l’assassin ». Le rapprochement s’arrête évidemment à cette coïncidence.
Günther Anders analyse ici les implications et significations de la bombe atomique. Il reprend une idée exprimée dans Sur la Honte prométhéenne : « Nous lançons le bouchon plus loin que nous ne pouvons voir avec notre courte vue » (p.315). Autrement dit, nous agissons sans nous préoccuper des conséquences de nos actes, et nous inventons des choses qui finissent par nous dépasser, voire se retourner contre nous.
Je me contenterai de picorer ici des réflexions qui m’ont semblé intéressantes. D’abord cette idée que, aujourd’hui, « c’est nous qui sommes l’infini », qui dit assez bien ce que la bombe, fruit de l’ingéniosité humaine, a d’incommensurable avec l’existence humaine : nous éprouvons désormais « la nostalgie d’un monde où nous nous sentions bien dans notre finitude ».
Faust est mort, dit l’auteur, précisément parce qu’il est le dernier à se plaindre de sa « finitude ». Je ne sais plus où, dans le Second Faust, le personnage s’adresse à Méphisto : « Voilà ce que j’ai conçu. Aide-moi à le réaliser ». Notons au passage qu’aux yeux de Goethe, c’est la technique en soi qui a quelque chose de diabolique, puisque c’est Méphisto qui l’incarne.
Une autre idée importante, je l’ai rencontrée récemment dans la lecture de La Gouvernance par les nombres d’Alain Supiot (cf. ici, 9 et 10/09) : ce dernier appelle « principe d’hétéronomie » l’instance d’autorité qui, surplombant et ordonnant les activités des hommes, s’impose à tous. Or ce principe, dans une civilisation dominée par la technique, tend à devenir invisible, conférant alors au processus lui-même une autorité d’autant plus inflexible qu’elle n’émane pas d’une personne. Ce qui fait que la finalité de la tâche échappe totalement à celui qui l’accomplit, avec pour corollaire : « Personne ne peut plus être personnellement tenu pour responsable de ce qu’il fait » (p.321).
C’est aussi dans le présent essai qu’on trouve le chapitre intitulé « L’homme est plus petit que lui-même ». Je ne reviens pas en détail sur cette idée formidable, qui développe d’une certaine manière les grands mythes modernes suscités par la créature du Dr Frankenstein (Mary Shelley) ou par le Golem (Gustav Meyrink) : l’homme, en déléguant sa puissance à la technique, a donné naissance à une créature qui lui échappe de plus en plus. Avec pour conséquence de multiplier les risques pour l’humanité : « Ce qui signifie que, dans ce domaine, personne n’est compétent et que l’apocalypse est donc, par essence, entre les mains d’incompétents » (p.301). Autrement dit, l’humanité a construit un avion pour lequel il n’existe pas de pilote.
Je signale une expression qui m’a aussitôt fait penser à Hannah Arendt : « cette horrible insignifiance de l’horreur » (p.304).
Pour terminer, ce passage (l'auteur vient d'évoquer Les Frères Karamazov) : « Accepter que le monde qui, la veille encore, avait un sens exclusivement religieux devienne l’affaire de la "physique" ; reconnaître, en lieu et place de Dieu, du Christ et des saints, "une loi sans législateur", une loi non sanctionnée, sans autre caution que sa seule existence, une loi absurde, une loi ne planant plus, « implacablement », au-dessus de la nature, bref la « loi naturelle » – ces nouvelles exigences imposées à l’homme de l’époque, il lui était tout simplement impossible de s’y plier » (p.333). Le « Système technicien » (Jacques Ellul) s’est autonomisé. L’homme se contente de suivre la logique de ce système, de se mettre à son service pour qu’il se développe encore et toujours et, pour finir, de lui obéir aveuglément.
Au total, un livre qui secoue pas mal de cocotiers.
Voilà ce que je dis, moi.
FIN
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer, maigret, georges simenon, maigret et le clochard, la banalité du mal, goethe, méphisto faust, alain supiot
mercredi, 23 septembre 2015
L'HOMME OBSOLÈTE
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 3
Le Monde comme fantôme et comme matrice
Le monde qu’analyse cet essai est celui de la médiatisation triomphante de tout. Günther Anders parle seulement de la radio et de la télévision, mais je suis sûr qu’il ne verrait aucun obstacle à étendre ses analyses aux médias qu’une frénésie d’innovation technique a inventés depuis son essai (1956). Aujourd’hui, tout le monde est « connecté », au point qu’être privé de « réseau » peut occasionner de graves perturbations psychologiques.
Il commence par nier la valeur de l’argument habituel des défenseurs de la technique face à ceux qui s’indignent de certains « dommages collatéraux » : ce n’est pas la technique qui est mauvaise, ce sont les usages qu’on en fait (air connu). Cet argument rebattu fait semblant d’ignorer que « les inventions relèvent du domaine des faits, des faits marquants. En parler comme s’il s’agissait de "moyens" – quelles que soient les fins auxquelles nous les faisons servir – ne change rien à l’affaire » (p.118).
Notre existence, dit-il, ne se découpe pas en deux moitiés séparées qui seraient les « fins » d’une part, les « moyens » d’autre part. L’ « individu », par définition, ne peut être coupé en deux (cf. le jugement de Salomon). L’argument n’a l’air de rien, mais il est puissant. Conclusion, il est vain de se demander si c’est la technique qui est mauvaise en soi, ou les usages qui en sont faits ensuite : une poêle sert à griller des patates, elle peut servir à assommer le voisin qui fait du bruit à deux heures du matin.
Pour qui est familiarisé avec les critiques lancées contre la télévision dans la dernière partie du 20ème siècle, le propos de Günther Anders compose un paysage connu. Les Situationnistes en particulier, à commencer par Guy Debord, ont constamment passé dans leur moulinette virulente la « société spectaculaire-marchande ». Il n’est d’ailleurs pas impossible que Debord (La Société du spectacle date de 1967) ait picoré dans l’essai d’Anders (paru en 1956).
Si les films, marchandises standardisées, amènent encore les masses à se réunir dans des salles pour assister collectivement à la projection, la télévision semble livrer le monde à domicile. Pour décrire l’effet produit par ce changement, Anders a cette expression géniale : « Le type de l’ "ermite de masse" était né ». « Ermite de masse » est une trouvaille, chacun étant chez soi, en quelque sorte, « ensemble seul ».
On peut ne pas être d’accord avec l’auteur quand il met exactement sur le même plan radio et télévision, car la réception d’images visuelles change pas mal de choses. Le point commun réside dans l’action de médiatisation : l’écran de télévision, et dans une moindre mesure le poste de radio, littéralement, « font écran » entre le spectateur et la réalité concrète du monde, qui du coup n’est plus l’occasion d’une expérience individuelle par laquelle chacun teste sa capacité d’action sur celle-ci.
L’auteur le dit : le monde, qui est servi « à domicile », n’est plus que le « fantôme » de lui-même : « Maintenant, ils sont assis à des millions d’exemplaires, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas pour fuit le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde "en effigie" ». L’exagération ne peut toutefois s’empêcher de ressurgir : « Chaque consommateur est un travailleur à domicile non rémunéré [il faudrait même dire "payant"] qui contribue à la production de l’homme de masse ». Mais on a bien compris l’idée.
Autrement intéressante est l’idée que radio et télévision induisent l’établissement, entre la source et le récepteur (entre les animateurs du spectacle et les auditeurs et téléspectateurs) une « familiarité » pour le moins étrange, qui semble tisser entre eux des liens de proximité immédiate, du seul fait que ces voix semblent s’édresser à eux personnellement. On pense ici à tout ce que peuvent déclarer de charge affective et d’identification les consommateurs quand ils s’adressent aux animateurs par oral ou par écrit. De plus, ces liens apparents entraînent une relative déréalisation des proximités concrètes (exemple p. 148-149). Ces liens sont en réalité une grande imposture qui fait que l’ « individu devient un "dividu" » (p.157). C’est bien trouvé.
Anders évoque aussi l’espèce d’ubiquité que produit le média et la schizophrénie artificiellement produite qui en découle. S’il voyait aujourd’hui avec quelle attention fascinée passants, clients de terrasses de bistrots et passagers du métro fixent l’écran de leur téléphone, même marchant ou en compagnie, il serait encore plus catastrophé par le monde que les hommes ont continué à fabriquer.
Faisant semblant d’être ici (puisqu’ils « communiquent » et sont « connectés ») et faisant semblant d’être ailleurs (pour les mêmes raisons !), ils constituent une sorte d’humanité « Canada dry », cette boisson qui « ressemble à de l’alcool, mais ce n’est pas de l’alcool ». Voilà : ça ressemble à de l’humanité, mais ce n’est pas de l’humanité. L’incessante innovation technique au service de la marchandise tient l’humanité en laisse.
Je n’insiste pas sur le conditionnement du désir, en amont de la manifestation d’une volonté et d’une liberté, pour orienter celui-ci sur des marchandises. Je n’insiste pas sur le caractère impérieux, voire vaguement totalitaire, de cette façon d’imposer une représentation du monde (une idéologie) : « Que ma représentation soit votre monde » (p. 195), façon plus sophistiquée que celle qu’Hitler utilisait pour formater les esprits. Günther Anders suggère que le règne de la radio et de la télévision produit un autre totalitarisme.
L’essai Le monde comme fantôme et comme matrice (titre pastichant Schopenauer), par sa radicalité dans l’analyse de la radio et de la télévision, indique assez que son auteur n’attend rien de bon de l’évolution future de l’humanité et du sort que l’avenir, sous l’emprise de la technique, lui réserve.
Il serait désespéré que ça ne m’étonnerait pas. Sa réflexion, qui remonte à plus d’un demi-siècle, n’a en tout cas rien perdu de sa force.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer



