jeudi, 29 mars 2018
L’HUMANITÉ EN PRIÈRE 4
19 novembre 2017
Des nouvelles de l'état du monde (8).

4/4
PRIONS !
Ce qui manque à tous ces beaux et grands rêveurs ? Oh pas grand-chose, presque rien : juste l'exercice du pouvoir ! Eh oui, ceux qui veulent que ça change ne peuvent rien, à part rêver, vouloir et crier. Quant à ceux dont on croit et espère qu’ils peuvent quelque chose, ils sont ligotés par tant de liens qu’eux non plus ne peuvent pas grand-chose, à part pérorer lors de conférences internationales. On voit ce qu’il en est de la COP 21 deux ans après : il a suffi qu’un Américain halluciné s’en retire pour que tout se mette à pédaler dans la semoule. Aux dernières nouvelles, on se reverra en 2018 en Pologne pour la COP 24, pour analyser où l'on en est de la production de CO2. On a raison, il faut prendre son temps, rien ne presse, y a pas le feu. C'est peut-être ça, après tout, "avoir la vie devant soi" ?
« QUE FAIRE ? » J’ai envie de dire à Paul Jorion : « Cesse de rêver, Paul ! ». Je ne peux plus entendre tous les « y a qu'à », les « il faut », les « on devrait », les « il est grand temps de », autant d'exhortations incantatoires dont les « penseurs », patentés ou non, gargarisent très volontiers le gosier de leurs raisonnements conclusifs. C'est fou, le nombre de gens qui ont besoin de se rassurer à tout prix à coups d'exhortations solennelles. C'est fou, le nombre de mouches du coche qui se rêvent en cochers. « Arrêtez de faire semblant » : oui, arrêtez d’alimenter dans les masses la machine à espérer. Rendez-leur plutôt le sens du tragique, que les promesses du « Progrès » technique et matériel leur ont fait perdre.
Apprenez-leur que, dans tout ce que fait l'homme, en particulier les objets techniques produits par son génie particulier, il y a quelque chose qui le dépasse et lui échappe, une part irréductible de son action sur laquelle il n'a pas de prise. Les hommes font l'histoire, mais ne savent pas grand-chose de l'histoire qu'ils font ou des conséquences à moyen ou long terme de leurs actions. Pour ce qui est de détruire, l'humanité s'est rendue aussi capable que la "Nature" en colère (énergie nucléaire, industrie chimique, en attendant mieux). Rendez aux humains, si ce n’est pas déjà trop tard, le sens des limites. Rendez-les à leur finitude, à leur précarité.
Cessez de chanter pour eux le culte du surhomme à qui rien n'est impossible, pourvu qu'il en ait la volonté et qu'il s'en remette avec une entière confiance aux outils magiques que d'ingénieux ingénieurs confectionnent pour le plus grand bien de certains comptes en banque. En l’état actuel des choses, seul un bon gros désespoir générateur de colère me semble en mesure de faire bouger le monde. De faire trembler d'un joli "Big One" la surface du globe. Le résultat ne serait peut-être pas bien joli, mais pas pire que les suites de l’illusion qui alimente l’attente de « lendemains qui chantent » : gare, quand ils déchanteront ! Je n'aime pas la violence, mais je la vois venir.
« QUE FAIRE ? » Les 15.000 scientifiques, dans leur solennel « Avertissement à l’humanité », ne font pas autre chose que rêver, quand ils proclament qu'ils veulent mettre les décideurs en face de leurs responsabilités. Ils annoncent fièrement qu’ « il est possible de vaincre n’importe quelle opposition, aussi acharnée soit-elle, et d’obliger les dirigeants politiques à agir ». C’est très beau. Seulement ils y voient une condition préalable : « Grâce à un raz de marée d’initiatives organisées à la base ». Ah bon ! Mais c'est toujours la même question qui se pose : ton "raz de marée d'initiatives", COMMENT ON FAIT, TOTO ? Le pékin de base aura beau se dire : « Vivement le raz de marée ! », l'indécrottable individu, s'il ne se laisse pas embarquer à son tour dans le rêve, aura bien du mal à se voir en costume de raz de marée (voir plus haut "ensemble tout devient possible" et "convergence des luttes"). Il faudrait déjà qu'il se sente partie prenante d'un sort commun, ce qui est loin d'être acquis. A propos de "sort commun", c'est curieux que plus personne ne parle depuis fort longtemps de « l'espèce humaine » (Robert Antelme, 1957, ci-contre).
« QUE FAIRE ? » L'avertissement des scientifiques propose ensuite une liste de treize préconisations parfaitement sensées, numérotées de "a" à "m". Je retiens, entre autres, qu’il convient de stopper « la conversion des forêts, prairies et autres habitats originels », restaurer les écosystèmes endémiques, « ré-ensauvager des régions », « adopter des instruments politiques adéquats », « réduire le gaspillage alimentaire », « réduire le taux de fécondité » humaine, réorienter nos régimes alimentaires, sensibiliser les enfants, etc. Là encore, c'est très beau, mais j’arrête : on peut l’attendre longtemps, le raz de marée. "Adopter des instruments politiques adéquats" : mais de quelle planète débarquent-ils ? Encore une fois : comment on fait ? On a compris : il y a dans le monde, en plus de gens sérieux comme Paul Jorion, 15.000 scientifiques tout aussi sérieux, qui sont prêts à faire un vœu chaque fois qu’ils voient une étoile filante et à y croire dur comme fer. Tous ces gens ont une vraie foi chevillée au corps. On a compris : le texte publié dans Le Monde est juste une PRIÈRE à réciter à genoux. A se demander si ce sont bien des scientifiques.

« QUE FAIRE ? », alors ? Comme le proclament les flyers des médiums guérisseurs de nos boîtes aux lettres, « il n’y a pas de problèmes sans solutions ». Malheureusement, à l'image des "sorciers" africains qui font chez nous commerce de leur art, tous ces braves scientifiques ont chopé la sale manie, inventée par les bureaucrates, d'appliquer à tous les sujets l'immuable schéma « constat-causes-solutions » appris sur les bancs de l’ENA, quand ils rédigent leurs sacro-saintes « notes de synthèse » à l'usage des décideurs. La méthode n’est pas inutile, mais vouloir à toute force positiver pour finir sur une perspective optimiste (« à chaque problème sa solution ») a quelque chose de pathétique. Et si, après tout, il y avait des problèmes sans solutions ? Car les scientifiques posent sur l'état de la planète un diagnostic exact et rigoureux, c'est vrai ; ils en pointent les causes avec une perspicacité inattaquable, c'est vrai ; mais ils fracassent immanquablement le nez de leurs "Solutions" sur la muraille de la réalité du monde tel qu'il va. Parce que, s'il y a des solutions, elles sont entre les mains de la décision des politiques, et accessoirement des populations qui les élisent.
Or, dans le cas présent, les solutions sont connues et archi-connues de tous (la première de toutes, qui conditionne toutes les autres, est de cesser de rechercher la croissance à tout prix), et tout le monde sait qu'elles resteront lettres mortes, et que personne n'aura le courage héroïque qu'il faudrait pour les mettre en œuvre. Quelle abnégation il faudrait pour un renoncement général aux "bienfaits" du "progrès" (car dans le fond du fond, c'est de cela qu'il s'agit, et qu'on ne me parle pas de "développement durable", cette imposture caractérisée qui n'envisage que de reculer l'échéance) ! Et ce n'est pas seulement à cause d'un « manque de volonté politique », cette ritournelle que les médias ressassent, sur fond d'actions et d' « associations » militantes. Produire à tout prix et faire consommer à tout prix, voilà sur quel socle est bâti le monde actuel dans son intégralité (ou presque) : qui peut rayer cette réalité d'un trait de plume ?
« QUE FAIRE ? » Manque de volonté politique ? Bien sûr ! Par exemple, les responsables européens, en instaurant la règle de l'unanimité pour toutes les grandes décisions qui risqueraient d'en chatouiller quelques-uns, ont clairement décidé de ne rien faire. Eh oui, c'est parce que, les solutions connues et archi-connues, personne n'en veut. L'exemple des paradis fiscaux ("Paradise papers") montre à hurler que ceux-ci sont si structurellement inscrits dans l'intestin et dans les moindres neurones de l'économie mondiale, et que tous les acteurs, légaux ou non, en ont tellement besoin, qu'il est absolument inenvisageable de songer à les supprimer. Non, personne ne veut des solutions. Car le manque de volonté au plus haut niveau est fort bien secondé par les volontés populaires — encore plus que dans les pays nantis — dans les pays qui aspirent à vivre mieux sur le plan matériel. Résultat : personne n'est en mesure, même avec la plus féroce volonté du monde, de maîtriser la machine globale, parce que tout le monde veut qu'elle continue à fonctionner.
Ce "Système" d'une force incommensurable à la nôtre, bien que l'homme l'ait élaboré collectivement, reste presque indifférent à toute volonté particulière (cause de la "honte prométhéenne" selon Günther Anders) : la machine s'est largement affranchie de l'humanité pour rouler pour son propre compte et avancer vers son accomplissement, dans lequel le sort de celle-ci a autant de poids qu'une virgule. La mondialisation, cette invention de forces disparates mais mues par une même logique puissante, échappe à tout le monde, à commencer par ceux qui l'ont voulue, qui n'y voyaient que l'occasion unique et inespérée de développer toujours davantage leurs affaires. Le but des acteurs principaux : ne pas se faire éjecter de la course, ne pas se faire écraser, et pour cela : avancer obstinément dans la même direction, en calculant au mieux les opportunités. De quoi accélérer l'accomplissement.
« QUE FAIRE ? » Non, messieurs, tout le monde sait ce qu’il faut faire, et si les décideurs ne le font pas, c’est d’abord qu’ils ne veulent abandonner aucune de leurs prérogatives, aucune parcelle de leur pouvoir, aucune part de leur gâteau, aucun symbole de leur prestige. C’est ensuite que les populations elles-mêmes, soit tiennent au relatif confort acquis et à leur manière de consommer (leur infinitésimale part du gâteau), soit n'ont qu'un seul but : acquérir les mêmes choses, que leur montrent les médias mondialisés et dont ils sont encore injustement privés. Et l'on sait que les opinions publiques (c'est-à-dire les échantillons représentatifs des populations, augmentés des dérisoires "leaders d'opinion" qui tartinent leurs éditoriaux dans toutes sortes de médias), consultées par sondages, tiennent les décideurs par le bulletin de vote
Le décideur un peu démocratique qui ne se plierait pas à ces exigences populaires (somme toute humainement compréhensibles) serait vite éjecté de la scène publique. Ceux qui veulent « changer radicalement de mode de vie » pour sauver ce qui peut l’être sont une infime poignée, héroïque si l’on veut, mais sans poids. Et je crains fort que le bruit qu’ils s’efforcent de faire ne suffise pas à compenser leur insignifiance en termes de pouvoir.
A mon tour de poser la question "QUE FAIRE ?". J'y réponds : jouissons à notre gré de ce qui nous reste.
Si je traduis en Desproges, il faut comprendre : « Vivons heureux en attendant la mort ». Ce n'est pas déraisonnable.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 15000 scientifiques, environnement, écologie, journal le monde, paul jorion, robert antelme l'espèce humaine, günther anders
mardi, 19 avril 2016
I WILL SURVIVE
CHRISTOPHER LASCH : LE MOI ASSIÉGÉ
Quelques réflexions après lecture. Attention : la lecture de ce billet est déconseillée aux personnes à tendance dépressive : Le Moi assiégé est un livre démoralisant, ... et indispensable pour comprendre un aspect non négligeable et peu reluisant des conditions qui sont faites aux gens qui vivent dans le monde moderne (cf. Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne).
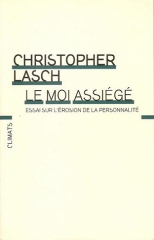 Une autre idée pas drôle du tout, développée par Christopher Lasch dans Le Moi assiégé tourne autour de la notion de « survivalisme ». Vous avez dit Survivalisme ? C’est quoi, cette bête ? La première approximation qui me vient à l’esprit est contenue dans deux titres de films, qui disent bien, à mon avis, ce que la notion veut dire : Vivre pour vivre (Claude Lelouch, 1967) et La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989, je ne parle que des titres, pas des films). Voilà : la vie sans dimension, sans horizon, quasiment réduite aux fonctions animales, l’homme s’éprouvant comme une sorte de bête traquée qui n’a qu’une idée en tête : durer : « … renforce la tournure d’esprit qui considère la préservation de la vie comme une fin en soi » (p.76).
Une autre idée pas drôle du tout, développée par Christopher Lasch dans Le Moi assiégé tourne autour de la notion de « survivalisme ». Vous avez dit Survivalisme ? C’est quoi, cette bête ? La première approximation qui me vient à l’esprit est contenue dans deux titres de films, qui disent bien, à mon avis, ce que la notion veut dire : Vivre pour vivre (Claude Lelouch, 1967) et La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989, je ne parle que des titres, pas des films). Voilà : la vie sans dimension, sans horizon, quasiment réduite aux fonctions animales, l’homme s’éprouvant comme une sorte de bête traquée qui n’a qu’une idée en tête : durer : « … renforce la tournure d’esprit qui considère la préservation de la vie comme une fin en soi » (p.76).
Gloria Gaynor, c'est juste pour mettre un peu de baume sur la plaie.
C’est une obsession particulièrement américaine : « Elle trouve son obsession la plus caractéristique et insidieuse, son expression ultime, dans l’illusion de guerres nucléaires que l’on pourrait remporter ; mais elle ne s’épuise aucunement dans l’anticipation de calamités ahurissantes » (p.57). Il parle sans doute de ces citoyens qui ont assez de moyens pour se doter de bunkers souterrains dans leurs jardins et de réserves de survie pour une durée suffisante en vue de ressortir à l’air libre sans risquer la mort, dans on ne sait combien de temps.
Je ne suis pas sûr que l’Américain moyen soit en possession de ces moyens. Mais la mentalité qui va avec, qu’on ait les moyens ou pas, s’est répandue ailleurs qu’aux USA, quoiqu’avec retard, en même temps que la culture spécifiquement américaine conquérait les esprits un peu partout. Car cette mentalité a gagné le monde (des vertus du "soft power") : qu'on le veuille ou non, le monde est grosso modo américanisé. L'Amérique a universalisé beaucoup de ses problématiques propres, même si celles-ci sont plus ou moins forcées de s'adapter aux cultures locales pour coller au terrain et avoir une chance de prendre racine (pour vendre les produits qui vont avec).
Il ne s’agit donc pas que de moyens : c’est toute une mentalité qui s’est ainsi organisée autour de la nécessité de se préparer à survivre à des conditions extrêmes faites à l’existence de l’humanité ordinaire. L’une des conséquences de la montée du survivalisme, c’est la disparition dans les mentalités de toute possibilité de consacrer son existence à la réalisation d’idéaux quels qu’ils soient, pour lesquels on serait capable d’aller jusqu’au « sacrifice personnel ». Tout ce qui ressemble à de l’héroïsme apparaît comme étrange ou incongru, voire anormal.
Or, avoir un idéal, quel qu’il soit, permet de donner un sens à sa vie (à tort ou à raison, on y croit). Le dilemme est le suivant : dans les conditions qui sont faites à toutes les populations par le système industriel et la société marchande, faut-il se contenter de survivre par tous les moyens, ou doit-on chercher à donner un sens à la présence humaine sur terre ? L’homme ne se considère plus comme un « agent moral » (doté de volonté et de rationalité), mais comme la « victime » d'un système impitoyable qui le domine et l'exploite : « … la protestation politique dégénère en apitoiement sur soi » (p.75).
Le plus effrayant dans le survivalisme, par la folie qu’il y a à faire certains rapprochements, c’est que ses partisans vont chercher dans l’histoire du 20ème siècle des points de comparaison pour qualifier le sort que la société moderne fait aux hommes et pour justifier leur théorie. C’est dans ce but qu’ils s’appuient sur l’exemple des camps de concentration et des camps de la mort, malgré l’énormité du culot et la disproportion flagrante des situations en nombre de victimes et en atrocités subies.
Christopher Lasch se réfère ici à Hannah Arendt, qui pense que les totalitarismes du 20ème siècle, hitlérisme et stalinisme, représentent « une solution, certes irrationnelle, aux problèmes non résolus de la société industrielle » (p.106), problèmes au premier rang desquels se situe la production par la dite société d’une part toujours plus grande de « populations superflues ». Que faut-il faire de l'hitlérisme et du stalinisme ? Des repoussoirs ? Des préfigurations ?
Faut-il, à la suite d’Arendt, considérer le génocide des juifs par Hitler comme un fait radicalement sans précédent ? On perd alors « la faculté de la mettre en perspective » historique pour établir des comparaisons et des correspondances possibles. Faut-il au contraire englober le génocide des juifs dans une problématique plus vaste qui permettrait d’évaluer « la culture et la politique modernes » ? On masque alors « son horreur particulière » (p.103), tout à fait spécifique du sort fait aux juifs sous le régime hitlérien.
On le voit, la question est difficile à trancher. Quand je vois le sort fait aux aliments destinés aux hommes dans les système de la production agricole industrielle, quand je vois le sort fait aux animaux destinés à l'alimentation des hommes dans la production industrielle des animaux comestibles, j'ai tendance à me dire que la structure même qui a permis aux camps de la mort d'exister a été grosso modo transplantée de l'univers nazi dans l'univers capitaliste, sans que la signification intime et profonde de la structure en soit bouleversée.
J’ai personnellement du mal à perdre de vue que l’uniformisation actuelle du monde sous la bannière de la production industrielle généralisée de la totalité de ce dont nous avons besoin pour vivre, rend les produits comme les hommes insignifiants, interchangeables, et par suite, jetables : les camps de la mort, pour aberrants, odieux et innommables qu’ils soient, n'étaient d’une certaine manière que l’application du même principe, sauf que, cette fois, c’est de la mort que l’industrie rendue folle s’était mise à produire.
L’horreur en moins, le sort de l’humanité en devient-il pour autant plus enviable ? L’idolâtrie et le culte fasciné dont l’innovation technologique (dernièrement, la puce qui rend possible au tétraplégique des gestes de la main, demain l’humanité « augmentée ») est aujourd’hui l’objet a tendance à m’apparaître comme le symptôme inquiétant d’un mal moral délétère (irréversible ?), qui voit l’homme se réjouir d’être bientôt débarrassé du fardeau de la liberté et de la volonté, et de pouvoir bientôt s’en remettre aux machines du souci d’exister.
Christopher Lasch, dans Le Moi assiégé, ne s’aventure pas aussi loin ni sur un terrain aussi risqué : c'est moi qui parle ici. Il semble trancher le dilemme en laissant la parole aux survivants des camps eux-mêmes : « Ce sont les survivants qui voient leur expérience comme une lutte non pas pour survivre mais pour rester humains » (p.129). Rester humain ? Je pense à l'inoubliable L'espèce humaine, du grand et bien oublié Robert Antelme. Rester humain, c'est tout de même tout autre chose que survivre !
Si tel est bien le cas, quand le personnage principal du film Pasqualino (Lina Wertmüller, 1976), un petit truand minable qui survivra au camp grâce à sa débrouillardise et sa totale absence de scrupules, suscitera l’admiration des foules, Lasch semble pointer ce qui différencie radicalement l’expérience réelle rapportée par les survivants des camps, et la dérision de toute valeur dans l’exaltation d’un personnage moralement infinitésimal, voire répugnant.
Car si les foules se reconnaissent en lui, une triste perspective s’ouvre, qui en dit long sur la valeur du mot "valeur", que tant d'authentiques salopards au pouvoir ont en permanence à la bouche, alors qu'ils savent que c'est l'insignifiance et la dérision qui nous guettent.
On les comprend : eux aussi, ils veulent "survivre".
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MES CHANSONS, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christopher lasch, le moi assiégé, survivalisme, lelouch vivre pour vivre, tavernier la vie et rien d'autre, claude lelouch, bertrand tavernier, hannah arendt, amérique, usa, états-unis, condition de l'homme moderne, juifs, camps de la mort, auschwitz, camps de concentration, adolf hitler, staline, lina wertmüller pasqualino, robert antelme l'espèce humaine, gloria gaynor, i will survive, génocide, la destruction des juifs d'europe

