samedi, 30 avril 2016
CHRISTOPHER LASCH ET L'ARCON
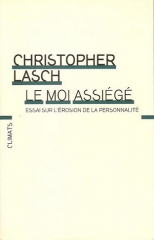 2
2
Alors maintenant, comment Christopher Lasch analyse-t-il l’évolution des pratiques picturales après 1950 ?
« Les équipements d’enregistrement modernes monopolisent la représentation de la réalité, mais ils brouillent également la distinction entre réalité et illusion, entre le monde subjectif et celui des objets, gênant par là même les artistes lorsqu’il s’agit de se réfugier dans le fait brut du moi, comme le disait Roth. Pas plus le moi que son environnement n’est plus un fait brut. » Christopher Lasch, Le Moi assiégé, p. 135. On a déjà croisé une telle idée. On sait qu'elle vient de Guy Debord et de sa Société du spectacle : tout au long de notre existence, toutes nos perceptions (enfin, la plupart) nous parviennent aujourd'hui médiatisées sur un écran où se projettent des images élaborées par d’autres instances que nous-mêmes. Nous n'avons plus d'expérience directe du monde.
« L’artiste romantique projetait des mots et des images dans le vide, en espérant imposer l’ordre au chaos. L’artiste postmoderne et postromantique les voit comme des instruments de surveillance et de contrôle. » C’est l’écrivain William Burroughs qui inspire ici Lasch.
Mais surveillance et contrôle ont été rendus possibles par la généralisation des sciences dites « humaines », au premier rang desquelles on trouve bien sûr la psychologie et la sociologie : « L’observation scientifique et sociologique abolit le sujet en faisant de lui le "sujet" d’expériences censées faire apparaître sa réaction à divers stimuli, ses préférences et ses fantasmes privés. Sur la foi de ses découvertes, la science construit un profil composite des besoins humains sur lesquels elle pourra baser un système (envahissant bien que pas ouvertement oppressif) de régulations comportementales » (p.141). "Régulations comportementales" ? On ne peut être plus clair, me semble-t-il, sur le processus d'asservissement des individus par un système devenu complètement anonyme, du fait que tout ce qui sert à connaître l'homme (les sciences humaines) fournira plus tard des outils perfectionnés pour le contrôler.
L’auteur puise la substance de ce raisonnement chez l’Anglais J.G. Ballard. La préoccupation que ce dernier exprime dans ses romans n’est autre que le processus d’onirisation de la vie, qui résulte de la « saturation de l’environnement par les images et l’effacement consécutif du sujet », tel qu’on peut en voir la manifestation dans le travail d’artistes comme Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Jasper Johns, Robert Morris.


Que ce soient une vignette de BD (Lichtenstein), une aiguille et son fil ou une pince à linge (Oldenburg), l’agrandissement démesuré (x 1000 ou 10000, pour le moins) de l’objet lui fait perdre sa matérialité utilitaire et le coupe de toute réalité concrète. Ce qui fait perdre toute possibilité pour l'œuvre d'art de signifier quoi que ce soit. Sans parler de l'infinie dérision dont de telles œuvres sont porteuses. Il se produit le même phénomène de déréalisation dans la multiplication de la boîte de Campbell Soup ou du portrait de Marylin (Warhol). Il est désormais admis que l’ « œuvre d’art » vole de ses propres ailes, loin de toute basse réalité, offrant au gré des caprices de l’artiste tel objet trivial à l’adoration des foules. On peut voir là une forme de prosternation devant le dérisoire : Clement Greenberg « croyait quant à lui que l’art ne devait jamais tenter de renvoyer à quoi que ce soit en dehors de lui-même ».
Un tel courant a pour conséquence (c’est peut-être le but poursuivi par ces artistes) de dépersonnaliser l’œuvre d’art et d’éliminer la subjectivité (Sol Lewitt), tendant à « brouiller la frontière entre illusion et réalité ». Cette conception de la création artistique procède évidemment des coups inauguraux que Marcel Duchamp, en son temps, a portés au statut de l’artiste. On traitait André Breton de "Pape du surréalisme". Duchamp peut à bon droit être qualifié d' "Empereur du ready-made". Refusant de signer des « chefs-d’œuvre » au bas desquels il serait fier d’apposer sa signature, Duchamp voulut en finir avec la « confiscation » de la créativité par les seuls individus « créatifs ». Idée a priori généreuse et démocratique.
Mais c'est du flan, une vaste blague, une farce grotesque et un désastre général, en vérité, car on sait ce qu’il en est advenu : non seulement le monopole n’a pas été mis à bas, mais il est à présent accaparé, non par des créateurs authentiques, mais par des individus qui se contentent de commercialiser une « idée » artistique, si possible spectaculaire (le bleu de Klein, l’outre-noir de Soulages, la Campbell Soup de Warhol), quand ce n’est pas par de vulgaires hommes d’affaires (Jeff Koons était courtier en matières premières à Wall Street, avant d'être embauché dans la domesticité au service du milliardaire François Pinault).
Il est bien loin, le temps où la société demandait à l’artiste d’administrer la preuve de son savoir-faire et de sa maîtrise technique dans l’art de peindre. Aujourd’hui, tout individu (je ne dis pas "artiste", car tout le monde est concerné par l’appel) un peu astucieux devient une start-up potentiellement dotée d’un bel avenir commercial : sois assez ingénieux pour créer toi-même ton propre « créneau ». Il ne s’agit certes pas du même savoir-faire.
Christopher Lasch se réfère à un essai du philosophe allemand Walter Benjamin, suicidé en 1940 à la frontière franco-espagnole, L’Œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique. Qui dit production en série dit forcément société industrielle, société de consommation, société de masse. Chaque tendance de l’art contemporain va s’inscrire dans un « créneau » précis, celui qui lui est dévolu sur le marché d’une consommation donnée. Que cela s’appelle « minimal art », « systemic painting », « optical art », « process art », « earth art » ou conceptualisme, tous participent de ce mouvement de déconstruction (de « démystification »). Et chacun, bien rangé dans sa case, occupe le « segment de marché » qu’il a réussi à s’ouvrir.
Christopher Lasch conclut logiquement à la « fusion du moi et du non-moi », sorte d’indifférenciation des moi, des êtres et des choses, un monde où les distinctions sont abolies, « un monde où tout est interchangeable ». C’en est au point que « la survie de l’art, comme de toute autre chose, est devenue problématique », au motif « que l’affaiblissement de la distinction entre le moi et son environnement – développement fidèlement consigné par l’art moderne jusque dans son refus de devenir figuratif – rend le concept même de réalité, ainsi que celui du moi, de plus en plus indéfendable » (p.155).
Ce qui arrive arrive, ce qui existe existe, ce qui est là est là, c’est tout : il n’y a plus rien sous la surface des choses, toute substance, tout contenu sont révocables, l’unité de la personne est pulvérisée (« Puisque l’individu semble être programmé par des agences extérieures – ou peut-être par sa propre imagination exaltée – il ne peut être tenu pour responsable de ses actes »), l’insignifiance triomphe. Il n'y a plus que de pures apparences : images fabriquées par des gens de métier, et déconnectées de tout contenu humain réel. L'homme en personne devient virtuel.
Les artistes de la fin du 20ème siècle commentent leurs propres œuvres et le « geste » qui les y a conduits comme s’ils inventaient un nouveau monde. Mais c’est une simple grimace. N’est pas Christophe Colomb qui veut.
Au total, Christopher Lasch, en regardant l’évolution de l’art contemporain, semble contempler un champ de ruines. Difficile, je crois, d’aller plus loin dans la dénonciation de l’impasse où se sont engouffrés les artistes depuis cinquante ans et plus.
Plus radical que Christopher Lasch, tu meurs.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : christopher lasch, le moi assiégé, narcissisme, éditions climats, art contemporain, william burroughs, jg ballard, robert rauschenberg, andy warhol, roy lichtenstein, claes oldenburg, jasper johns, robert morris, clement greenberg, marcel duchamp, ready-made, campbell soup, outre-noir soulages, bleu klein, jeff koons, françois pinault, walter benjamin, pop art, op art, art conceptuel, andré breton, surréalisme, sol lewitt, guy debord, la société du spectacle
vendredi, 29 avril 2016
CHRISTOPHER LASCH ET L'ARCON
1
Je reviens une dernière fois sur Le Moi assiégé, de Christopher Lasch (voir 16 et 19 avril), pour voir un peu ce qu’il pense de l’art contemporain. C’est un sujet qui me tient à cœur. Il regroupe différents courants et tendances sous l’appellation d’ « esthétique minimaliste » (le titre original du livre est The Minimal Self). Et on peut dire que, même s’il ne porte pas trop de jugements de valeur, on comprend que toute son analyse aboutit à une conclusion simple : tout ce qu’on appelle art contemporain est dans un sale état. Et il ne faut pas chercher l'origine de cette situation ailleurs que dans la civilisation, elle-même dans un sale état.
On comprend que les optimistes qui croient dur comme fer dans les vertus progressistes et émancipatrices du Progrès, de l’innovation technologique et autres contes de fées, évitent tant que faire se peut de lire les livres de Christopher Lasch : le tableau qu’il dresse du monde qui est le nôtre n’a en effet rien à voir avec celui dont ils s’ingénient à faire la promotion, jour après jour, et sur lequel leur pinceau suave dessine toutes les promesses mirifiques dont ils nous assurent que le monde futur les comblera au-delà même de nos espérances.
La lecture de Christopher Lasch, à cet égard, est profondément démoralisante. Pan après pan, il ôte en effet le resplendissant habit de lumière dont les promoteurs de l’avenir radieux revêtent des illusions avant d’en refourguer le « grand récit » aux foules, priées de croire que le monde s’achemine sans faiblir vers toujours plus de mieux (Jacques Higelin le chantait : « Aujourd’hui peut-être, Demain ça sera vachement mieux », dans "Alertez les bébés", 1976). Sur la question, tout le monde devrait avoir lu Le Seul et vrai paradis : nul doute que le mythe du Progrès en prendrait un sale coup derrière les oreilles.
Le monde de l’art ne pouvait évidemment pas rester à l’abri des bouleversements, des chambardements et autres destructions qui ont fait du 20ème siècle celui de la guerre militaire, politique et économique, bien que les critères auxquels se conformaient les artistes eussent déjà connu quelque bouleversement quand la 1ère guerre mondial s’est déclenchée. C’est sans doute pourquoi Christopher Lasch intitule la partie de son ouvrage où il aborde la question de la création artistique « L’esthétique minimaliste : art et littérature à l’époque de l’extrême ».
L’idée d’extrême est cruciale à ses yeux : « L’art contemporain est un art de l’extrême non pas parce qu’il prend des situations extrêmes comme sujets – encore qu’une grande partie de l’art contemporain le fasse – mais parce que l’expérience de l’extrême menace jusqu’à la possibilité même d’une interprétation de la réalité par l’imagination » (p.132). Bien d’accord avec l’auteur, qui ajoute juste après : « Le seul art qui semble adapté à une telle époque (à en juger par l’histoire récente de l’expérimentation artistique) est un anti-art, ou art minimal », dont la caractéristique première n’est pas forcément le minimal comme style, mais la « restriction drastique de son champ de vision ».
Par exemple, Anaïs Tondeur (on peut cliquer pour voir les images) a accompagné de son travail les recherches de Michael Marder sur les indéniables mutations génétiques qui touchent la flore autour de la centrale de Tchernobyl, en plaçant sur du papier photosensible des plantes irradiées de la région (on appelle ça des rayogrammes). Elle intitule ça « Tchernobyl’s herbarium ». Si ce n’est pas une restriction drastique du champ de vision de l’art, ça ….
L’artiste contemporain fait le choix de l’ordinaire, de l’effacement de sa propre personnalité et, en décontextualisant radicalement l’objet, supprime toute relation qu’il entretient dans la réalité avec les autres objets. Appelons ça le parachutage arbitraire de l’inouï dans l’œuvre. L'artiste contemporain a réhabilité l' "acte gratuit". L’artiste, au surplus, en s’affirmant comme pleinement original, prétend ne se placer sous l’égide d’aucun maître, d’aucune école : seul son bon plaisir le guide.
De plus, de quelle réalité parle-t-on ? Est-ce celle dont nous aurions une expérience directe, et qu’on appelle « le monde » ? On peut de moins en moins répondre par l’affirmative, tant notre relation avec elle passe par la vision que nous en fabriquent à chaque instant toutes sortes de médias. On reconnaît là une idée directement inspirée de Guy Debord et de sa « société du spectacle », concept dont Christopher Lasch est un familier, même s’il n’en fait pas état ici.
L’iPhonisation des hommes enferme en effet les esprits dans des murs immatériels, sur lesquels une « réalité » de plus en plus « virtuelle » projette l’image (la représentation) trompeuse d’un monde qui semble se plier au moindre de nos désirs. Pur fantasme infantile, évidemment, enraciné dans le narcissisme triomphant de l'époque : l'impression de toute-puissance qui précède, dans le psychisme, l'horrible séparation avec la mère. La séparation qui rend l'individu autonome.
Par ailleurs, selon lui, l’homme est devenu une simple entité statistique, dont la substance proprement individuelle et les motivations profondes, dûment et indûment scrutées en permanence au moyen d’outils sophistiqués, finissent par former l’image d’un être global, collectif et abstrait, censé représenter les tendances dominantes dans une société donnée : « Les médias font un effort sérieux pour nous dire qui nous sommes ». Magnifique formule. Comme dit Souchon : « Dérision de nous dérisoires » ("Foule sentimentale").
Sondages et enquêtes d’opinion dessinent et sculptent un ectoplasme d’identité collective, que ses promoteurs tentent de cautionner à coups de fables et de loufoqueries, au premier rang desquelles une prétendue scientificité dont ils s'efforcent d'habiller leur activité mercantile. A ce compte-là, pour savoir qui je suis, je n’ai plus à m’interroger à partir de ma vie intérieure : il faut seulement que j’ouvre le journal ou que je regarde la télé. Les médias inventent et fabriquent jour après jour un individu statistique, supposé tenir lieu de ciment social, voire national. Mais qui, accessoirement, a pour effet de devenir une norme impérieuse, à laquelle les individus de chair et de sang sont, sans que ce soit dit, invités vivement invités à se conformer.
On a compris l’imposture.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christopher lasch, the minimal self, le moi assiégé, jacques higelin, alertez les bébés, lasch le seul et vrai paradis, anaïs tondeur tchernobyl, art contemporain, guy debord, la société du spectacle, alain souchon, foule sentimentale
mardi, 19 avril 2016
I WILL SURVIVE
CHRISTOPHER LASCH : LE MOI ASSIÉGÉ
Quelques réflexions après lecture. Attention : la lecture de ce billet est déconseillée aux personnes à tendance dépressive : Le Moi assiégé est un livre démoralisant, ... et indispensable pour comprendre un aspect non négligeable et peu reluisant des conditions qui sont faites aux gens qui vivent dans le monde moderne (cf. Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne).
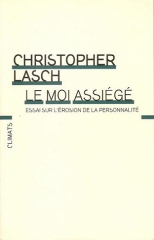 Une autre idée pas drôle du tout, développée par Christopher Lasch dans Le Moi assiégé tourne autour de la notion de « survivalisme ». Vous avez dit Survivalisme ? C’est quoi, cette bête ? La première approximation qui me vient à l’esprit est contenue dans deux titres de films, qui disent bien, à mon avis, ce que la notion veut dire : Vivre pour vivre (Claude Lelouch, 1967) et La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989, je ne parle que des titres, pas des films). Voilà : la vie sans dimension, sans horizon, quasiment réduite aux fonctions animales, l’homme s’éprouvant comme une sorte de bête traquée qui n’a qu’une idée en tête : durer : « … renforce la tournure d’esprit qui considère la préservation de la vie comme une fin en soi » (p.76).
Une autre idée pas drôle du tout, développée par Christopher Lasch dans Le Moi assiégé tourne autour de la notion de « survivalisme ». Vous avez dit Survivalisme ? C’est quoi, cette bête ? La première approximation qui me vient à l’esprit est contenue dans deux titres de films, qui disent bien, à mon avis, ce que la notion veut dire : Vivre pour vivre (Claude Lelouch, 1967) et La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989, je ne parle que des titres, pas des films). Voilà : la vie sans dimension, sans horizon, quasiment réduite aux fonctions animales, l’homme s’éprouvant comme une sorte de bête traquée qui n’a qu’une idée en tête : durer : « … renforce la tournure d’esprit qui considère la préservation de la vie comme une fin en soi » (p.76).
Gloria Gaynor, c'est juste pour mettre un peu de baume sur la plaie.
C’est une obsession particulièrement américaine : « Elle trouve son obsession la plus caractéristique et insidieuse, son expression ultime, dans l’illusion de guerres nucléaires que l’on pourrait remporter ; mais elle ne s’épuise aucunement dans l’anticipation de calamités ahurissantes » (p.57). Il parle sans doute de ces citoyens qui ont assez de moyens pour se doter de bunkers souterrains dans leurs jardins et de réserves de survie pour une durée suffisante en vue de ressortir à l’air libre sans risquer la mort, dans on ne sait combien de temps.
Je ne suis pas sûr que l’Américain moyen soit en possession de ces moyens. Mais la mentalité qui va avec, qu’on ait les moyens ou pas, s’est répandue ailleurs qu’aux USA, quoiqu’avec retard, en même temps que la culture spécifiquement américaine conquérait les esprits un peu partout. Car cette mentalité a gagné le monde (des vertus du "soft power") : qu'on le veuille ou non, le monde est grosso modo américanisé. L'Amérique a universalisé beaucoup de ses problématiques propres, même si celles-ci sont plus ou moins forcées de s'adapter aux cultures locales pour coller au terrain et avoir une chance de prendre racine (pour vendre les produits qui vont avec).
Il ne s’agit donc pas que de moyens : c’est toute une mentalité qui s’est ainsi organisée autour de la nécessité de se préparer à survivre à des conditions extrêmes faites à l’existence de l’humanité ordinaire. L’une des conséquences de la montée du survivalisme, c’est la disparition dans les mentalités de toute possibilité de consacrer son existence à la réalisation d’idéaux quels qu’ils soient, pour lesquels on serait capable d’aller jusqu’au « sacrifice personnel ». Tout ce qui ressemble à de l’héroïsme apparaît comme étrange ou incongru, voire anormal.
Or, avoir un idéal, quel qu’il soit, permet de donner un sens à sa vie (à tort ou à raison, on y croit). Le dilemme est le suivant : dans les conditions qui sont faites à toutes les populations par le système industriel et la société marchande, faut-il se contenter de survivre par tous les moyens, ou doit-on chercher à donner un sens à la présence humaine sur terre ? L’homme ne se considère plus comme un « agent moral » (doté de volonté et de rationalité), mais comme la « victime » d'un système impitoyable qui le domine et l'exploite : « … la protestation politique dégénère en apitoiement sur soi » (p.75).
Le plus effrayant dans le survivalisme, par la folie qu’il y a à faire certains rapprochements, c’est que ses partisans vont chercher dans l’histoire du 20ème siècle des points de comparaison pour qualifier le sort que la société moderne fait aux hommes et pour justifier leur théorie. C’est dans ce but qu’ils s’appuient sur l’exemple des camps de concentration et des camps de la mort, malgré l’énormité du culot et la disproportion flagrante des situations en nombre de victimes et en atrocités subies.
Christopher Lasch se réfère ici à Hannah Arendt, qui pense que les totalitarismes du 20ème siècle, hitlérisme et stalinisme, représentent « une solution, certes irrationnelle, aux problèmes non résolus de la société industrielle » (p.106), problèmes au premier rang desquels se situe la production par la dite société d’une part toujours plus grande de « populations superflues ». Que faut-il faire de l'hitlérisme et du stalinisme ? Des repoussoirs ? Des préfigurations ?
Faut-il, à la suite d’Arendt, considérer le génocide des juifs par Hitler comme un fait radicalement sans précédent ? On perd alors « la faculté de la mettre en perspective » historique pour établir des comparaisons et des correspondances possibles. Faut-il au contraire englober le génocide des juifs dans une problématique plus vaste qui permettrait d’évaluer « la culture et la politique modernes » ? On masque alors « son horreur particulière » (p.103), tout à fait spécifique du sort fait aux juifs sous le régime hitlérien.
On le voit, la question est difficile à trancher. Quand je vois le sort fait aux aliments destinés aux hommes dans les système de la production agricole industrielle, quand je vois le sort fait aux animaux destinés à l'alimentation des hommes dans la production industrielle des animaux comestibles, j'ai tendance à me dire que la structure même qui a permis aux camps de la mort d'exister a été grosso modo transplantée de l'univers nazi dans l'univers capitaliste, sans que la signification intime et profonde de la structure en soit bouleversée.
J’ai personnellement du mal à perdre de vue que l’uniformisation actuelle du monde sous la bannière de la production industrielle généralisée de la totalité de ce dont nous avons besoin pour vivre, rend les produits comme les hommes insignifiants, interchangeables, et par suite, jetables : les camps de la mort, pour aberrants, odieux et innommables qu’ils soient, n'étaient d’une certaine manière que l’application du même principe, sauf que, cette fois, c’est de la mort que l’industrie rendue folle s’était mise à produire.
L’horreur en moins, le sort de l’humanité en devient-il pour autant plus enviable ? L’idolâtrie et le culte fasciné dont l’innovation technologique (dernièrement, la puce qui rend possible au tétraplégique des gestes de la main, demain l’humanité « augmentée ») est aujourd’hui l’objet a tendance à m’apparaître comme le symptôme inquiétant d’un mal moral délétère (irréversible ?), qui voit l’homme se réjouir d’être bientôt débarrassé du fardeau de la liberté et de la volonté, et de pouvoir bientôt s’en remettre aux machines du souci d’exister.
Christopher Lasch, dans Le Moi assiégé, ne s’aventure pas aussi loin ni sur un terrain aussi risqué : c'est moi qui parle ici. Il semble trancher le dilemme en laissant la parole aux survivants des camps eux-mêmes : « Ce sont les survivants qui voient leur expérience comme une lutte non pas pour survivre mais pour rester humains » (p.129). Rester humain ? Je pense à l'inoubliable L'espèce humaine, du grand et bien oublié Robert Antelme. Rester humain, c'est tout de même tout autre chose que survivre !
Si tel est bien le cas, quand le personnage principal du film Pasqualino (Lina Wertmüller, 1976), un petit truand minable qui survivra au camp grâce à sa débrouillardise et sa totale absence de scrupules, suscitera l’admiration des foules, Lasch semble pointer ce qui différencie radicalement l’expérience réelle rapportée par les survivants des camps, et la dérision de toute valeur dans l’exaltation d’un personnage moralement infinitésimal, voire répugnant.
Car si les foules se reconnaissent en lui, une triste perspective s’ouvre, qui en dit long sur la valeur du mot "valeur", que tant d'authentiques salopards au pouvoir ont en permanence à la bouche, alors qu'ils savent que c'est l'insignifiance et la dérision qui nous guettent.
On les comprend : eux aussi, ils veulent "survivre".
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MES CHANSONS, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christopher lasch, le moi assiégé, survivalisme, lelouch vivre pour vivre, tavernier la vie et rien d'autre, claude lelouch, bertrand tavernier, hannah arendt, amérique, usa, états-unis, condition de l'homme moderne, juifs, camps de la mort, auschwitz, camps de concentration, adolf hitler, staline, lina wertmüller pasqualino, robert antelme l'espèce humaine, gloria gaynor, i will survive, génocide, la destruction des juifs d'europe
samedi, 16 avril 2016
CHRISTOPHER LASCH ET GUY DEBORD
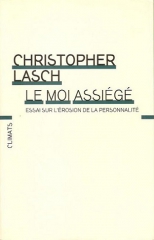 Quelques réflexions après lecture de Le Moi assiégé, "essai sur l'érosion de la personnalité", de Christopher Lasch.
Quelques réflexions après lecture de Le Moi assiégé, "essai sur l'érosion de la personnalité", de Christopher Lasch.
Pour mettre du baume au cœur.
Il est bon d’avoir lu, au moins une fois dans sa vie, un livre de Christopher Lasch, observateur intransigeant de la civilisation occidentale en général, mais principalement de la façon dont elle évolue aux Etats-Unis. A cet égard, La Culture du narcissisme (Climats, 2000, écrit en 1979), que je suis en train de relire, fait un excellent point de repère et de départ, même si c'est un peu « consistant ».
La méthode de Christopher Lasch est impeccable : il fait le tour complet d’une documentation impressionnante et passe au crible tout ce qui a été dit par d’autres du sujet qui le préoccupe. Il énumère les points de vue qu’il estime erronés et s’efforce de corriger les idées fausses que des gens sûrement sérieux véhiculent et colportent.
Dans Le Moi assiégé (« essai sur l’érosion de la personnalité », Climats, 2008, écrit en 1984), que je viens de relire avec intérêt, il revient, pour l’approfondir, sur la notion de narcissisme. Le sous-titre dit assez sur quelle hypothèse il s’efforce de fonder son ouvrage. C’est une idée qu’on croise dans les bouquins de Michel Houellebecq, de façon explicite dans un de ses volumes d'Interventions. Une idée qui se veut un constat. Une idée qui, si elle s'avère, a des implications qui peuvent effrayer.
Dans une société vouée à la catastrophe humaine que constituent la marchandise, son spectacle et sa consommation, assailli constamment par des armées d’images, l’individu ne parvient plus à se constituer un « moi » par ses propres moyens, un « moi » qui lui appartienne en propre, après avoir fait sa propre expérience directe du monde et de la réalité. Le système de la communication publicitaire - à tendance tant soit peu totalitaire -, qui a gagné un terrain considérable pour organiser les relations sociales à tous les niveaux, occupe désormais une place prépondérante, en lieu et place de ce que Freud appelle le Moi.
Ne pas oublier qu'Edward Bernays, l'un des grands inventeurs de la publicité moderne, était le double neveu de l'inventeur de la psychanalyse, discipline dans laquelle il a abondamment puisé pour mettre au point la machine publicitaire : on va puiser dans le bric-à-brac du secret des motivations les figures, motifs et arguments qui, brandis ensuite comme un miroir devant le nez du citoyen devenu consommateur, vont orienter son désir vers la marchandise à vendre.
Pour resituer la chose, il ne faut pas oublier que le livre de Lasch est publié en 1984. Je veux dire par là qu'il n'est pas impossible qu'une question d'ordre générationnel se pose, car l'idée dit peut-être davantage à des gens de mon âge qu'à des générations plus neuves, vu que les conditions concrètes de l'existence n'avaient pas encore été aussi radicalement transformées qu'elles ne l'ont été depuis une trentaine d'années.
Quoi qu'il en soit, l'idée du spectacle marchand comme programme général d'existence avait été largement diffusée en leur temps par les situationnistes en général, et Guy Debord en particulier. Une idée le plus souvent incomprise, du fait d’une interprétation tout à fait étriquée, donc fausse, de la notion de « spectacle », que je reformulerais ici de la façon suivante : « création, entre l’homme et le monde, d’une réalité entièrement artificielle autour de la marchandise érigée en objet de désir par les moyens de la propagande ».
Il s’ensuit que la personne a été en quelque sorte vidée d’elle-même, comme si un écran s’était interposé entre sa conscience et son moi. Dépossédée de ce qu’elle serait devenue si elle avait été soumise aux seules influences héritées de la tradition, elle ne s’appartient plus, fabriquée des pièces et des morceaux d’images conçues par d’autres et introduites en elle de l’extérieur. Autrement dit, comme elle a du mal à distinguer ce qui vient d’elle et ce qu’elle ingurgite de l’extérieur, la personne ne sait plus à qui elle a à faire quand elle dit « je ». « L’anxiété actuelle au sujet de l’ "identité" reflète une partie de cette difficulté à définir les frontières de l’individualité » (p.15).
J’ajoute, pour enfoncer le clou, que la personne, quand elle dit « je », croit sincèrement qu’elle parle en son propre nom, alors qu’elle exprime un « moi » qui lui a été pour une grande part inculqué à son insu : la société du capitalisme spectaculaire-marchand (Debord) a façonné des semblants de personnes, des fantômes persuadés qu’ils existent de façon pleine et entière : des artefacts, des zombies. L’idée est pour le moins radicale.
Ce qui change, par rapport à la situation précédente, c'est que nous sommes ici dans l'exécution d'un projet parfaitement concerté, généralisé, et prévu pour produire les effets qu'il produit. Ce que fait, dans un autre domaine, le génie génétique par rapport, par exemple, à la méthode de nature purement empirique de sélection et d'appariement de deux races de chiens par les éleveurs, en fonction des qualités attendues de la nouvelle race envisagée (flair, endurance, dressabilité, puissance, potentiel agressif, etc.). Si la grille de lecture de Christopher Lasch est la bonne, cela veut dire en effet que les populations embarquées dans ce système ne sont plus désormais en mesure de porter ce qui s’appelle une « civilisation ». Et, accessoirement, que le système qui est le nôtre a quelque chose à voir avec le totalitarisme.
Cela veut dire que le système spectaculaire-marchand débarrasse l’individu du fardeau de la civilisation, puisqu’il il le débarrasse du fardeau de lui-même, en le transformant en simple spectateur et client, consommateur de biens et de services. En poussant un peu, on pourrait considérer que le système spectaculaire-marchand fait disparaître jusqu’à la possibilité de la civilisation, en transformant tout ce qui appartient au passé en simple objet muséal, ou en simple marchandise destinée à des touristes venus errer dans l'hypermarché global pour consommer les traces d’un passé mort, et dénué pour eux de signification présente.
Charmante perspective.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, christopher lasch, le moi assiégé, éditions climats, psychologie, psychanalyse, narcissisme, michel houellebecq, guy debord, la société du spectacle, spectaculaire-marchand, houellebecq interventions, edward bernays
mercredi, 30 mars 2016
JEAN-CLAUDE MICHÉA ANTILIBÉRAL
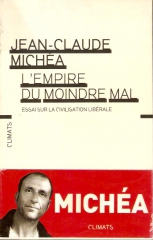 Je viens de relire L’Empire du moindre mal (Climats, 2007) de Jean-Claude Michéa, le professeur de philosophie de Montpellier, l’auteur de l’excellent L’Enseignement de l’ignorance (Climats, 1999), à qui l’on doit de pouvoir lire en français un auteur aussi important que l’Américain Christopher Lasch (La Culture du narcissisme, Le Seul et vrai paradis, Le Moi assiégé, …). Michéa s’est aussi intéressé à George Orwell (G.O. anarchiste tory, G.O. éducateur).
Je viens de relire L’Empire du moindre mal (Climats, 2007) de Jean-Claude Michéa, le professeur de philosophie de Montpellier, l’auteur de l’excellent L’Enseignement de l’ignorance (Climats, 1999), à qui l’on doit de pouvoir lire en français un auteur aussi important que l’Américain Christopher Lasch (La Culture du narcissisme, Le Seul et vrai paradis, Le Moi assiégé, …). Michéa s’est aussi intéressé à George Orwell (G.O. anarchiste tory, G.O. éducateur).
Avec l’ouvrage présent, Michéa a écrit un bon livre, malgré ce que j’estime être un défaut, mais que l’auteur cultive avec soin comme un plaisir : farcir son texte de ce qu’il appelle des « scolies » (un scoliaste était un commentateur), qui apparaissent comme autant de digressions, comme il y a, dans la grotte de Rouffignac, plusieurs « diverticules » à partir de la galerie principale. Bon, ces notes sont regroupées en fin de chapitre, mais elles n’empêchent pas, hélas, la présence de notes en bas des pages. Passons : le texte proprement dit est assez intéressant pour faire oublier cette ombre au tableau.
Jean-Claude Michéa étudie dans ce bouquin les principes qui sous-tendent la conception libérale de la civilisation (il dit « civilisation libérale »). J’ai bien du mal, pour ma part, à entrer dans des problématiques philosophiques. Ou plutôt, peut-être, dans la formulation philosophique d’une problématique. Je ne suis décidément pas philosophe, tout au moins dans un sens canonique, scolaire, universitaire, bref : conceptuel.
Je me console en grappillant, en picorant dans mes lectures de quoi alimenter mes réflexions et plus souvent, soyons honnête, confirmer mes convictions (argumenter dans un débat vise moins à convaincre autrui qu'on a raison qu'à renforcer ses propres convictions). Qu'on n'attende donc pas ici un compte rendu en forme du livre de Michéa : j'y ai pioché, sans vergogne, ce qui m'intéressait, pas plus. Je ne me rappelais plus où j’avais trouvé l'idée comme quoi on observe une étrange contradiction dans le champ des idées politiques : je me demandais pourquoi les « libéraux » économiques étaient forcément classés à droite, alors qu’on rangeait à gauche les « libéraux » sociétaux.
Que je le veuille ou non, je me retrouve en effet très loin, tout là-bas à droite, quand on parle de mariage homosexuel, de « minorités visibles », de repentance à l’égard des anciens peuples colonisés, de contrition sur l'île de Gorée en mémoire des esclaves de la « traite atlantique », de tolérance à l’égard du voile islamique, et de tout ce qui « milite » pour des « causes » (antiracisme, féminisme, etc.), alors qu’en matière d’économie et de politique, on me cataloguera très loin sur la gauche, au seul motif que je crois en un idéal de justice sociale, de lutte contre les inégalités (à ne surtout pas confondre avec toutes les « revendications d’égalité ») et de redistribution des richesses, dans la lignée des analyses de Thomas Piketty dans Le Capital au XXI° siècle.
J’essayais d’expliquer ce drôle de paradoxe ici même le 4 mai 2015. En cherchant le principe unificateur à même de surmonter la contradiction ci-dessus, j’en arrivais à la conclusion que j’étais nettement antilibéral. Une trouvaille ! Et ce qui résout la dissonance apparente, c'est que, selon moi, le fait de vivre en société interdit de se croire tout permis, qu’on soit un chef d’entreprise, un financier ou un individu lambda, ou qu’on soit arabe, noir, homosexuel, handicapé, femme ou normal.
Tout n’est pas permis, que ce soit dans le monde de l’entreprise, du travail, de la finance, ou dans le monde des mœurs, des coutumes, des comportements. Pour tout dire, le désir, quel qu'il soit, ne légitime pas n'importe quoi. Il est incroyable que certains, du seul fait qu'ils désirent quelque chose, revendiquent cette chose comme un "droit", sous prétexte d' "égalité". Il faut des limites à l'entrepreneur, de même que l'individu est contenu dans une peau. Pourtant, selon les catégories communes, je reste quand même à la fois "progressiste" et "conservateur". Comment se fait-ce ?
En fait, j’ai trouvé, en relisant Michéa, où cet apparent paradoxe figurait : dans les premières pages de L’Empire du moindre mal. Je cite tout le paragraphe : « Mais parler de "logique libérale" implique également que, par-delà la multiplicité des auteurs et les nombreuses différences qui les opposent sur tel ou tel point, il est possible de traiter le libéralisme comme un courant dont les principes non seulement peuvent, mais, en fin de compte, doivent être philosophiquement unifiés. C’est évidemment ce point que de nombreux lecteurs hésiteront à concéder. Car si tel est bien le cas, cela rend beaucoup plus difficile l’opération habituelle de ceux qui, à l’image d’une grande partie de la gauche et de l’extrême-gauche contemporaines, s’emploient à opposer radicalement le libéralisme politique et culturel (défini comme l’avancée illimitée des droits et la libéralisation permanente des mœurs) et le libéralisme économique – les développements émancipateurs du premier étant fondamentalement indépendants des nuisances du second » (p.15-16). Bon sang, mais c’est bien sûr ! Ah ça c’est vrai que la gauche sociétale en prend pour son grade. A raison.
Pour moi, s'il n’y avait qu’un paragraphe à garder de tout le livre, ce serait celui-là. C’est vrai, ensuite, l’auteur entre dans des analyses subtiles et documentées et s’efforce d’appuyer sa thèse sur une argumentation probante, mais l’essentiel est dit. Je dirais presque que ça me suffit. Le reste ne fait que confirmer ce qu’on sait déjà : pour le libéralisme, surtout dans sa version fanatique, intégriste et débridée, il n’y a pas d’universaux, à l’exception, du strict point de vue de l’individu (qui est par nature égoïste), de son intérêt à lui.
Partant de là, il ne faut pas que des lois à valeur universelle viennent entraver le libre jeu de la poursuite de son intérêt par chacun : « L’autorité du Droit libéral n’est, en effet, légitime, on l’a vu, que parce qu’elle se borne à arbitrer le mouvement brownien des libertés concurrentes, sans jamais faire appel à d’autres critères que les exigences de la liberté elle-même ; lesquelles se résument, pour l’essentiel, à la seule nécessité de ne pas nuire à autrui » (p.38). Michéa, au fond, est d’accord avec Alain Supiot (La Gouvernance par les nombres), qui dit que le système actuel tend irrésistiblement à substituer à des Lois surplombantes auxquelles tout le monde serait indistinctement soumis, la généralisation du Contrat, dans lequel tout litige serait réglé, mettons, par un « Tribunal arbitral ». Car les libertés étant "concurrentes", il faut un arbitre.
Jean-Claude Michéa ajoute que la société libérale fait une confiance absolue, d’une part au Marché, d’autre part au Droit, qui « suffisent par eux-mêmes à engendrer toutes les dispositions culturelles indispensables à l’intégration communautaire des individus » p.135). Ce qu’elle cherche à établir, c’est « un ordre humain efficace » (ibid., je souligne).
Il résume ainsi la vie en société selon les tenants de la civilisation libérale : l’aptitude des individus, « pour l’essentiel, à conclure des affaires et à respecter des contrats » (ibid.). Dans un tel système, il ne faut pas s’étonner de voir saper l’ordre patriarcal, puisque sont discréditées « toutes les références à une loi symbolique » (p.173). Fini les Vérités universelles, place aux « parties contractantes ».
Enfin un bon terrain libéral, où l’on verra s’appliquer la célèbre citation de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ». La morale finale de la civilisation libérale est : liberté pour les loups.
Cette société est produite, disons-le, par une vision protestante de l’humanité, vision éminemment pessimiste : l'humanité sans perspective autre que réduite aux échanges marchands. Michéa parle même d’une « anthropologie désespérée » (p.197). Ah oui, Philippe Muray a bien raison de dire que "le protestantisme est une idée catholique devenue folle".
Paul Jorion (voir ici deux derniers jours) a raison d’être pessimiste au sujet de l’avenir de l’humanité. Oui, définitivement sans doute, comme Jean-Claude Michéa, je suis un antilibéral.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude michéa, l'empire du moindre mal, société, civilisation, l'enseignement de l'ignorance, éditions climats, christopher lasch, la culture du narcissisme, le seul et vrai paradis, le moi assiégé, ultralibéralisme, thomas piketty, le capital au 21° siècle, alain supiot, la gouvernance par les nombres, lacordaire, philippe muray, paul jorion
mardi, 08 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 3/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
3/9
De l'importance de la lecture.
Ce qui est sûr, c’est que l’art contemporain, la musique contemporaine, la poésie contemporaine (en ai-je bouffé, des manuscrits indigestes, futiles, vaporeux ou dérisoires, au comité de lecture où je siégeais !), tout cela est tombé de moi comme autant de peaux mortes. De ce naufrage, ont surnagé les œuvres de quelques peintres, de rares compositeurs, d’une poignée de poètes élus. Comme un rat qui veut sauver sa peau, j’ai quitté le navire ultramoderne. J'ai déserté les avant-gardes. C’est d’un autre rivage que je me suis mis à regarder ce Titanic culturel qui s’enfonçait toujours plus loin dans des eaux de plus en plus imbuvables.
Comment expliquer ce revirement brutal ? Bien malin qui le dira. Pour mon compte, j’ai encore du mal. Je cherche. Le vrai de la chose, je crois, est qu’un beau jour, j'ai dû me poser la grande question : je me suis demandé pourquoi, tout bien considéré, je me sentais obligé de m’intéresser à tout ce qui se faisait de nouveau.
Mais surtout, le vrai du vrai de la chose, c’est que j’ai fait (bien tardivement) quelques lectures qui ont arraché les peaux de saucisson qui me couvraient les yeux quand je regardais les acquis du 20ème siècle comme autant de conquêtes victorieuses et de promesses d'avenir radieux. J’ai fini par mettre bout à bout un riche ensemble homogène d’événements, de situations, de manifestations, d’analyses allant tous dans le même sens : un désastre généralisé. C’est alors que le tableau de ce même siècle m’est apparu dans toute la cohérence compacte de son horreur, depuis la guerre de 14-18 jusqu’à l’exploitation et à la consommation effrénées des hommes et de la planète, jusqu'à l’humanité transformée en marchandises, en passant par quelques bombes, quelques génocides, quelques empoisonnements industriels.
 Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
A tort ou à raison, j’ai conclu de cette lecture décisive qu’Hitler et Staline, loin d’être les épouvantails, les effigies monstrueuses et retranchées de l’humanité normale qui en ont été dessinées, n’ont fait que pousser à bout la logique à la fois rationnelle et délirante du monde dans lequel ils vivaient pour la plier au fantasme dément de leur toute-puissance. Hitler et Staline, loin d’être des monstres à jamais hors de l’humanité, furent des hommes ordinaires (la « Banalité du Mal » dont parle Hannah Arendt à propos du procès Eichmann). Il n'y a pas de pommes s'il n'y a pas de pommier. Ils se contentèrent de pousser jusqu’à l’absurde et jusqu’à la terreur la logique d’un système sur lequel repose, encore et toujours, le monde dans lequel nous vivons.
Hitler et Staline (Pol Pot, …) ne sont pas des exceptions ou des aberrations : ils sont des points d’aboutissement. Et le monde actuel, muni de toutes ses machines d’influence et de propagande, loin de se démarquer radicalement de ces systèmes honnis qu’il lui est arrivé de qualifier d’ « Empire du Mal », en est une continuation qui n’a eu pour talent que de rendre l’horreur indolore, invisible et, pour certains, souhaitable.
Un exemple ? L’élimination à la naissance des nouveau-nés mal formés : Hitler, qui voulait refabriquer une race pure, appelait ça l’eugénisme. Les « civilisés » que nous sommes sont convenus que c’était une horreur absolue. Et pourtant, pour eux (pour nous), c’est devenu évident et « naturel ». C’est juste devenu un « bienfait » de la technique : permettre de les éliminer en les empêchant de naître, ce qui revient strictement au même. C’est ainsi que, dans quelques pays où la naissance d’une fille est une calamité, l’échographie prénatale a impunément semé ses ravages.
 D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système
D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
Je citerai une troisième facette de ladite évolution : une réflexion tirée d’ouvrages d’économistes, parmi lesquels ceux du regretté Bernard Maris (à  commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
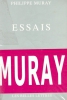 J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
Mais je dois reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
 Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude
Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
L'Histoire (le Pouvoir, la Politique), la Technique, l'Economie, donc : la trinité qui fait peur.
Restent les Lumières originelles : étonnamment et bien que je ne sache pas si le résultat est très cohérent, au profond de moi, elles résistent encore et toujours à l'envahisseur. Sans doute parce qu'en elles je vois encore de l'espoir et du possible.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, avant-garde, titanic, hannah arendt, les origines du totalitarisme, nazisme, staline, hitler, totalitarisme, stalinisme, banalité du mal, jacques ellul, le système technicien, le bluff technologique, günther anders, l'obsolescence de l'homme, bernard maris, charlie hebdo, antimanuel d'économie, jean-marc sylvestre, ultralibéralisme, philippe muray, l'empire du bien, exorcismes spirituels, éditions les belles lettres, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, une paire de bottes vaut shakespeare, éditions gallimard, george orwell essais articles lettres, jean-claude michéa, l'enseignement de l'ignorance, le moi assiégé, christopher lasch, la culture du narcissisme, michel houellebecq, la carte et le territoire, éditions l'encyclopédie des nuisances

