jeudi, 17 janvier 2019
HOUELLEBECQ
Je recycle aujourd'hui, en une seule fois, deux billets écrits en 2011 sur deux livres de Michel Houellebecq, au moment où je venais enfin de comprendre, grâce à La Carte et le territoire, l'importance de ses romans. Pourquoi "importance" ? Après tout ce temps, je crois y voir une figuration assez exacte de ce qui achemine la civilisation occidentale vers sa déchéance actuelle et sa destruction prochaine. Le système communiste a implosé, comme on sait, c'est-à-dire qu'il s'est effondré de l'intérieur, sous le poids de sa propre sénilité. Et je me demande si le même destin ne guette pas le système capitaliste, aujourd'hui encore tout fringant et triomphant, mais travaillé de l'intérieur par des forces que nul n'est capable de comprendre dans leur globalité et leurs interactions. J'ai beaucoup élagué tout ce qui m'est apparu superflu à la relecture (digressions, etc). J'ai laissé tout le reste. Je dois reconnaître que je n'ai guère développé le commentaire sur Plateforme. Un signe ? Mais de quoi ?


J’ai mis beaucoup de temps avant d’ouvrir un livre de Michel Houellebecq. Ce qui me repoussait, je crois l’avoir dit ici, c’est la controverse : il y a quelque chose de si futilement médiatique dans la présence éphémère du parfum de quelques noms dans l’air du temps, que je tenais celui-ci pour tout à fait artificiel, voire carrément illusoire, comme c’est le cas de la plupart des effervescences télévisuelles. Je suis devenu excessivement méfiant. En l’occurrence, j’avais tort.
J’ai donc commencé la lecture de Michel Houellebecq quand son dernier roman, La Carte et le territoire, fut placé, un peu par hasard, à proximité immédiate de ma main. J’ai dit grand bien du livre dans ce blog. J’en ai maintenant accroché deux autres à mon tableau de chasse : Les Particules élémentaires et Plateforme. Conclusion, vous allez me demander ? Voilà : je ne sais pas si on a à faire à un « grand » écrivain, je ne sais pas si ce sont des « chefs d’œuvre », comme les critiques patentés en décèlent à foison au fil des semaines. Je veux juste dire que ce sont des livres qui se situent au centre du paysage, pour qui espère comprendre quelque chose à la marche du monde actuel.
Donc, je ne sais pas si Michel Houellebecq est le digne successeur de Balzac et Proust. Ce que je sais, c’est qu’il travaille sur le monde qu’il a sous les yeux, qu’il dit quelque chose du monde tel qu’il est, et qu’il développe sur celui-ci un point de vue, une analyse, une proposition d’éclairage précise, une grille de lecture, si l’on veut.
C’est un romancier qui a pris position par rapport à la « civilisation occidentale », et qui a ceci de bien, s’il parle de lui, de le faire à distance respectable, hors de portée de tir de son propre nombril (malgré les apparences) et des ravages courants que celui-ci commet dans les rangs des « écrivains » français.
On peut trouver le point de vue développé par Michel Houellebecq d’une noirceur exécrable : pour résumer, grâce à la civilisation actuelle, exportée par l’Europe, moulinée avec la sauce techniquante, massifiante et consommante de l’Amérique triomphante, le monde actuel court à sa perte et, d’une certaine façon, est déjà perdu.
L’auteur met-il pour autant ses pas dans ceux de Philippe Muray, comme je l’ai suggéré ? Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que Philippe Muray a développé dès les années 1980 un regard analogue sur la réalité, d’une acuité de plus en plus grande, et un regard de plus en plus pessimiste.
Avant lui, plusieurs auteurs se sont inquiétés de l’évolution de notre monde : Günther Anders (L’Obsolescence de l’homme), Lewis Mumford (Les Transformations de l’homme), Hannah Arendt (La Crise de la culture), Christopher Lasch (La Culture du narcissisme), Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique), Guy Debord (La Société du spectacle), et quelques autres.
Pardon pour l’étalage, mais c’est parce qu’il y a un peu de tous ces regards dans les romans de Michel Houellebecq, tout au moins les trois que j’ai lus (publiés en 1998, 2001 et 2010, ce qui révèle quand même une certaine constance). La « patte » de Philippe Muray, c’est l’attention portée à un aspect particulier de la crise moderne : l’humanité est devenue peu à peu superflue, submergée par des objets techniques, des gadgets qui sont devenus pour elle si « naturels », mais en même temps si dominateurs, qu’elle est progressivement devenue une vulgaire prothèse de ses propres inventions. Philippe Muray le synthétise dans la notion de fête, dans l’abolition de tout ce qui permettait la différenciation (en particulier entre les sexes), dans le nivellement de toutes les « valeurs », et dans l'instauration unilatérale du règne de la positivité en tout, autrement dit de l'Empire du Bien (un des titres des Essais, éd. Les Belles lettres, 1991).
Les Particules élémentaires est un roman qui raconte quelle histoire, en fin de compte ? Janine Ceccaldi, une fille aux capacités intellectuelles hors du commun, épouse Serge Clément, qui entrevoit déjà (on est dans les années 1950) les immenses possibilités de la chirurgie esthétique. Puis elle rencontre Marc Djerzinski, homme talentueux qui œuvre dans le cinéma. Elle divorce pour l’épouser. De ces deux unions naîtront deux demi-frères : Bruno Clément et Michel Djerzinski.
Il y a donc l’histoire de Janine en pointillé. L’histoire d’Annabelle, qui a failli vivre une « belle histoire d’amour » avec Michel. L’histoire des ratages de Bruno qui, en compagnie de Christiane ou sans elle, hantera divers lieux où il espère connaître quelque aventure sexuelle.
A travers le personnage un peu pathétique de Janine, la mère, qui se fait appeler Jane, se formule une description somme toute caustique de l’ère baba-cool : délaissant les deux pères de ses enfants (et ses deux enfants par la même occasion), elle suit un genre de gourou, Francesco Di Meola, qui, s’étant fait pas mal d’argent, abandonne la Californie et Big Sur, où il a rencontré les dieux et les diables de la contre-culture, y compris l’imposteur Carlos Castaneda, celui qui était entiché de son sorcier yaqui, Don Juan Matus, dont il vendit les bobards à des millions d’exemplaires (mais ça, ce n’est pas dans le livre de Michel Houellebecq). Di Meola achète une propriété en Provence.
Janine-Jane (la mère) a baigné dans le jus contre-culturel, mais ce jus a tourné, ou alors il a aigri. Le bilan de son existence est « nettement plus catastrophique ». Et la mère des deux frangins aura une triste fin, dans une maison du village de Saorge, où vivent encore quelques illuminés post-soixante-huitards, dont « Hippie-le-Gris » et « Hippie-le-Noir », que Bruno appelle Ducon.
La scène est curieuse. Bruno est sous traitement de lithium pour raisons psychiatriques.
« Michel observa la créature brunâtre, tassée au fond de son lit, qui les suivit du regard alors qu’ils pénétraient dans la pièce. » Quant à Bruno, tout ce qu’il arrive à dire : « Tu n’es qu’une vieille pute… émit-il d’un ton didactique. Tu mérites de crever. ». « T’as voulu être incinérée ? Poursuivit Bruno avec verve. A la bonne heure, tu seras incinérée. Je mettrai ce qui restera de toi dans un pot, et tous les matins, au réveil, je pisserai sur tes cendres. »
Il y a souvent des problèmes, chez Michel Houellebecq, avec la transmission et avec la filiation. Un moment vaguement hallucinant, où Bruno se met à entonner à pleine voix "Elle va mourir la mamma", tout en insultant à qui mieux-mieux les hippies qui, d'après le testament maternel, vont hériter de la maison.
Face à Bruno, qui débloque sévèrement, le littéraire raté et hors du coup, Michel Houellebecq fait de Michel, en dehors d’un errant affectif quasiment indifférent à tout ce qui est humain, un biologiste à la pointe du « progrès », disons-le, une sorte de génie : son « testament » de chercheur s’intitule Prolégomènes à la réplication parfaite. Michel ne veut pas être emmerdé par les tribulations humaines ordinaires. Peut-être est-ce ce qui guide ses recherches.
Car ce testament s'avère porteur de tout l'avenir scientifique de l'humanité. Chacune de ses propositions révolutionnaires en sera plus tard dûment et scientifiquement prouvée. Autrement dit, le point culminant de son travail ouvre la voie à l’admission du clonage humain comme fondement institutionnel de l’humanité, ce qui débarrasse l'ancienne humanité (la nôtre) de tout le poids sentimental qui l'écrase.
Le livre évoque, depuis un moment du futur, l’extinction de la vieille race humaine. « On est même surpris de voir avec quelle douceur, quelle résignation, et peut-être quel secret soulagement les humains ont consenti à leur propre disparition. » [16 janvier : cela me fait penser à Soumission et à l'évidence tranquille avec laquelle l'islam s'impose en France en 2022.] On perçoit en positif cette post-humanité, qui adresse in fine sa gratitude à l’humanité archaïque : « Cette espèce aussi qui, pour la première fois de l’histoire du monde, sut envisager la possibilité de son propre dépassement ; et qui, quelques années plus tard, sut mettre ce dépassement en pratique ».
On est alors quelque part, dans ce regard rétrospectif, à la fin du 21ème siècle. Et la post-humanité rend alors hommage à l’humanité (la nôtre), qui fut si défectueuse, mais si touchante aussi. Glaçant, et très fort. Quand on ferme le livre, on se prend à espérer que c’est de la science-fiction. Mais ce n’est pas sûr.
La Carte et le territoire offrait une perspective analogue sur la disparition programmée de l’humanité, à travers l’œuvre en mouvement de Jed Martin, présenté comme un grand artiste de son temps. Plateforme nous plonge dans la décadence sexuelle de l'Occident en général et de l’Europe vieillissante en particulier. Le personnage principal, qui se nomme là encore Michel, est un obscur fonctionnaire aux Affaires Culturelles, un statut social négligeable. Au début du livre, Michel, qui vient de perdre son père, participe à un voyage organisé en Thaïlande. Il passe bien sûr par des « salons de massage ». Valérie fait partie du groupe, un groupe triste, hétérogène, et bête, avec ça !
Revenu à Paris, il démarre une relation vraiment amoureuse avec Valérie, qui travaille dans une entreprise de tourisme, sous la direction de Jean-Yves. Lui et Valérie, professionnellement, sont complémentaires. Ils gagnent confortablement leur vie. Une opportunité les propulse à la tête des villages Eldorador.
C’est dans un village de Cuba que Michel suggère à Jean-Yves, pour rétablir la situation de la société, de faire de ses villages des destinations pour un tourisme, disons … « de charme ». Tout se goupille à merveille, et l’entreprise est florissante, mais ces salauds d’islamistes feront tout capoter, avec à la clé l’insurrection de tout le féminisme français contre l’esclavage dégradant et le tourisme sexuel.
C’est sûr, l’humanité de Michel Houellebecq n’est pas belle à voir. Au fond, autant vaut qu’elle disparaisse, n’est-ce pas ? J'ai l'impression que les romans de Michel Houellebecq sont des applications romanesques pratiques de la pensée de Günther Anders (L'obsolescence de l'homme), de Hannah Arendt et de Guy Debord. Et le pire, c'est que ces romans paraissent être à peine de la science-fiction. Ce sont, et c'est Philippe Muray qui le dit à propos des Particules élémentaires, des romans de la fin. Très juste.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, les particules élémentaires, plateforme, la carte et le territoire, günther anders, l'obsolescence de l'homme, hannah arendt, la crise de la culture, christopher lasch, la culture du narcissisme, jacques ellul, guy debord, la société du spectacle, philippe muray, festivus festivus, l'empire du bien
mardi, 08 mai 2018
LE MONDE DANS UN SALE ÉTAT
 4 juin 2016
4 juin 2016
1
Je ne sais pas si Paul Jorion[1] a raison quand il parle d’un « effondrement général » de l’économie, de l’extinction prochaine de l’espèce humaine et de son remplacement par une civilisation de robots indéfiniment capables de s’auto-engendrer et de s’auto-régénérer. Sans être aussi radical et visionnaire, je me dis malgré tout que la planète va très mal, et que l’espèce qui la peuple, la mange et y excrète les résidus de sa digestion, est dans un sale état.
Beaucoup des lectures qui sont les miennes depuis quelques années maintenant vont dans le même sens. Pour ne parler que des deux ans écoulés, qu’il s’agisse
1 - du fonctionnement de l’économie et de la finance mondiales (Bernard Maris[2], Thomas Piketty[3], Paul Jorion[4], Alain Supiot[5], Gabriel Zucman[6]) ;
2 - de la criminalité internationale (Jean de Maillard[7], Roberto Saviano[8]) ;
3 - des restrictions de plus en plus sévères apportées aux règles de l’état de droit depuis le 11 septembre 2001 (Mireille Delmas-Marty[9]) ;
4 - de la destruction de la nature (Susan George[10], Naomi Oreskes[11], Fabrice Nicolino[12], Pablo Servigne[13], Svetlana Alexievitch[14]) ;
5 - de l’état moral et intellectuel des populations et des conditions faites à l’existence humaine dans le monde de la technique triomphante (Hannah Arendt[15], Jacques Ellul[16], Günther Anders[17], Mario Vargas Llosa[18], Guy Debord[19], Philippe Muray[20], Jean-Claude Michéa[21], Christopher Lasch[22]),
[Aujourd'hui (8 mai 2018), j'ajouterais la littérature, avec évidemment Michel Houellebecq en tête de gondole, mais aussi la bande dessinée : j'ai été frappé récemment par l'unité d'inspiration qui réunit Boucq (Bouncer 10 et 11) ;

Derrière son drôle de masque, la dame à l'arrière-plan, dirige un clan d'amazones impitoyables, qui capturent toutes sortes d'hommes pour qu'ils les fécondent, et pour leur couper la tête juste après l'acte. Et ce n'est que l'une des nombreuses joyeusetés rencontrées.
Hermann (Duke 2) ;

Yves Swolfs (Lonesome 1) ;

et d'autres dans un déluge de sang, de violence, de cruauté gratuite et de bassesse dont j'ai bien peur que, sous le couvert de la fiction et du western, ils nous décrivent, avec un luxe de détails parfois à la limite de la complaisance, ce que certains philosophes et sociologues appellent un très actuel "grand réensauvagement du monde". La représentation de plus en plus insupportable et violente d'un monde fictif (je pense aussi à certains jeux vidéos) n'est-elle pas un reflet imaginaire d'une réalité que nos consciences affolées refusent de voir sous nos yeux ?]
quand on met tout ça bout à bout (et ça commence à faire masse, comme on peut le voir en bas de page), on ne peut qu'admettre l’incroyable convergence des constats, analyses et jugements, explicites ou non, que tous ces auteurs, chacun dans sa spécialité, font entendre comme dans un chœur chantant à l’unisson : l’humanité actuelle est dans de sales draps. Pour être franc, j’ai quant à moi peu d’espoir.
D’un côté, c’est vrai, on observe, partout dans le monde, une pullulation d’initiatives personnelles, « venues de la société civile », qui proposent, qui essaient, qui agissent, qui construisent. Mais de l’autre, regardez un peu ce qui se dresse : la silhouette d’un colosse qui tient sous son emprise les lois, la force, le pouvoir, et un colosse à l’insatiable appétit. On dira que je suis un pessimiste, un défaitiste, un lâche, un paresseux ou ce qu’on voudra pourvu que ce soit du larvaire. J’assume et je persiste. Je signale que Paul Jorion travaille en ce moment à son prochain ouvrage. Son titre ? Toujours d’un bel optimisme sur l’avenir de l’espèce humaine : Qui étions-nous ?
Car il n’a échappé à personne que ce flagrant déséquilibre des forces en présence n’incite pas à l’optimisme. Que peuvent faire des forces dispersées, éminemment hétérogènes et sans aucun lien entre elles ? En appeler à la « convergence des luttes », comme on l’a entendu à satiété autour de « Nuit Debout » ?
[8 mai 2018. Tiens, c'est curieux, voilà qu'on entend depuis des semaines et des semaines la même rengaine de l'appel à la convergence des luttes. C'est un mantra, comme certains disent aujourd'hui : une formule magique. Ce qu'on observe dans certains cercles contestataires, c'est plutôt la convergence des magiciens, sorciers, faiseurs-de-pluie et autres envoûteurs : ils dansent déjà en rond en lançant les guirlandes de leurs grandes idées et des incantations incantatoires autour du futur feu de joie qu'ils allumeront un de ces jours dans les salons dorés des lieux de pouvoir. Eux-mêmes y croient-ils ?]
Allons donc ! Je l’ai dit, les forces adverses sont, elles, puissamment organisées, dotées de ressources quasiment inépuisables, infiltrées jusqu’au cœur des centres de décision pour les influencer ou les corrompre, et défendues par une armada de juristes et de « think tanks ».
Et surtout, elles finissent par former un réseau serré de relations d’intérêts croisés et d’interactions qui fait système, comme une forteresse protégée par de puissantes murailles : dans un système, quand une partie est attaquée, c’est tout le système qui se défend. Regardez le temps et les trésors d’énergie et de persévérance qu’il a fallu pour asseoir l’autorité du GIEC, ce consortium de milliers de savants et de chercheurs du monde entier, et que le changement climatique ne fasse plus question pour une majorité de gens raisonnables. Et encore ! Cela n’a pas découragé les « climato-sceptiques » de persister à semer les graines du doute.
C’est qu’il s’agit avant tout de veiller sur le magot, n’est-ce pas, protéger la poule aux œufs d’or et préserver l’intégrité du fromage dans lequel les gros rats sont installés.
Voilà ce que je dis, moi.
[1] - Le Dernier qui s’en va éteint la lumière, Fayard, 2016.
[2] - Houellebecq économiste.
[3] - Le Capital au 21ème siècle.
[4] - Penser l’économie avec Keynes.
[5] - La Gouvernance par les nombres.
[6] - La Richesse cachée des nations.
[7] - Le Rapport censuré.
[8] - Extra-pure.
[9] - Liberté et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, 2010.
[10] - Les Usurpateurs.
[11] - N.O. & Patrick Conway, Les Marchands de doute.
[12] - Un Empoisonnement universel.
[13] - P.Servigne. & Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer.
[14] - La Supplication.
[15] - La Crise de la culture.
[16] - Le Système technicien, Le Bluff technologique.
[17] - L’Obsolescence de l’homme.
[18] - La Civilisation du spectacle.
[19] - Commentaire sur La Société du spectacle.
[20] - L’Empire du Bien, Après l’Histoire, Festivus festivus, …
[21] - L’Empire du moindre mal.
[22] - La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé.
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabrice nicolino, lettre à un paysan sur le vaste merdier, paul jorion, bernard maris, thomas piketty, alain supiot, gabriel zucman, jean de maillard, roberto saviano, mireille delmas-marty, susan george, naomi oreskes, pablo servigne, hannah arendt, jacques ellul, günther anders, mario vargas llosa, guy debord, philippe muray, jean-claude michéa, christopher lasch, houellebecq économiste, les marchands de doute, l'obsolescence de l'homme, la société du spectacle, festivus festivus, bande dessinée, hermann duke, boucq bouncer, yves swolfs lonesome, michel houellebecq
mercredi, 15 février 2017
C’EST QUOI, UN « GRAND RÉCIT » ?
1/2
Il est devenu de bon ton, chez les politistes, politologues, éditorialistes, journalistes et autres commentateurs, de sommer les hommes politiques de proposer aux Français un « Grand Récit », expression qui ne signifie rien d'autre que leur capacité à leur laisser entrevoir un projet collectif et un objectif à atteindre qui permette de mobiliser et de souder les énergies. De toutes ces bouches savantes, sur le même sujet, tombent d'autres formules stylistiquement aussi choisies et délectables que « vision permettant une reprise en main de l’avenir », ou « horizon d’attente ».
J’aime à la folie les politistes et toute la cohorte des doctes qui s’érigent en « conseillers » (peut-être dans l’espoir de le devenir officiellement contre due rétribution auprès d’un responsable). Comme dit le proverbe : « Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». Tous ces gens qui forment le chœur des pleureuses, en même temps que le distillat ultime de l’inutilité et de l'insignifiance, ne me font même pas rire, parce qu’ils font semblant.
Tous ces gens improductifs (mais parasites médiatiquement omniprésents) font en effet, pour ne pas tuer la poule qui les nourrit (les engraisse), comme s’ils ne savaient pas que le monde tel qu’il est a fini par rendre vain toute espèce de « Grand Récit » possible. Tout juste quelques funambules de la politique proposent-ils de temps en temps un « petit récit » : Montebourg et sa « démondialisation » (ça ne fait pas de mal), Le Pen et sa promesse de « sortir de l’euro » (ça fait mal, car ça frappe l'imagination) et, dernièrement, Hamon et sa désopilante boutade du « revenu universel » (ça en fait rêver quelques-uns). Sûrement quelques autres encore, et sûrement d’une très belle eau.
Le « Grand Récit » à la française est mort et enterré. J’en veux pour preuve, entre autres, le pavé pondu récemment par une équipe de 122 historiens sous la direction de l’historien Patrick Boucheron et sous le titre d’Histoire mondiale de la France (rien de moins !). Après la dilution de l’identité française dans la pâte informe de l’Europe, la dissolution de l’Histoire de France dans l’Histoire du monde.
Même pas besoin de lire le commentaire assassin publié par Alain Finkielkraut dans Le Figaro à l’occasion de la publication pour savoir ce que les historiens en général, et ceux-ci en particulier, font du « Grand Récit » : ils le dépècent, ils l’éviscèrent, ils le mettent en charpie jusqu’à ce qu’il ait rendu l’âme, après avoir commencé par dénoncer ce qu’il peut contenir de « mythique » (« nos ancêtres les Gaulois » étant la cible la plus facile : il fallait les entendre se gausser de Sarkozy quand il a cru pouvoir oser la chose).
Un exemple de mise à mort est offert par le traitement qui a été fait des « récits » qui constituaient la culture des tribus primitives, pardon : des « peuples premiers ». D’innombrables sociétés humaines se désignaient en effet elles-mêmes d’un mot qui voulait dire « les êtres humains », et qualifiaient tout ce qui n’était pas eux de « chiures de mouches », « cloportes » et autres appellations avantageuses, quoique « politiquement incorrectes ».
Tous les peuples du monde furent « racistes » (au sens vulgaire et galvaudé). Et ceux qui ne le sont pas restés aujourd’hui sont non seulement une rareté, mais encore une pure hypothèse. Et chaque peuple a scellé sa cohésion en se racontant sa propre histoire, en laquelle chacun des membres croyait. Car un « Grand Récit » n’a que faire de savoir ou de vérité à son propos, encore moins de science : la croyance suffit largement. La croyance seule fait adhérer. Il ne semble pas possible de faire reposer l'adhésion à un projet collectif sur quelque chose qui soit de l'ordre du seul savoir.
Le même traitement fut appliqué par les historiens, ethnologues et anthropologues au discours que tenaient, « au temps des colonies », les prétentieux occidentaux qui, disaient-ils, « apportaient la civilisation » aux primitifs qui en étaient à leurs yeux démunis. De quel droit la puissance technique conférait-elle à notre civilisation une supériorité sur toutes les autres ? Il fallait en finir avec l’arrogance impudente de l’occidental. La tâche fut menée à bien par les sciences humaines. L’Histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron et consort parachève la besogne.
Je me rappelle avoir entendu, lors d’un débat radiophonique autour de « l’histoire qu’il faut enseigner aux petits Français », l’un des participants bondir sur le micro lorsqu’un autre lança qu’il était impératif d’enseigner l’ « histoire chronologique de la France ». Il s’étranglait : « Quoi, vous voudriez revenir à "nos ancêtres les Gaulois" ?! ». Inutile en effet de demander à un historien d’aujourd’hui, un historien « moderne », de cautionner quelque « roman national » que ce soit. Soyons sérieux : soyons scientifiques. C’est pourtant bien ce mythe des Gaulois, tété par tous les Français avec le lait de leur mère qui, en leur donnant un "bien national commun", a fait le succès de la série Astérix. Passons.
Quand l’ « Histoire de France » a été ainsi déconsidérée et ravalée au rang de « roman national », l’enseignement de l’histoire a cessé d’être républicain pour devenir scientifique. L'histoire a cessé d'être un projet de formation du citoyen. L’histoire, au nom de la science, a renoncé à enseigner ce qui risquait de nourrir une « conscience nationale ». En abolissant l’idéologie véhiculée par le « roman national », l’Education nationale a évacué le bien commun qui jusque-là tissait dans toute la durée scolaire un lien entre les Français. On a mis au rebut ce résidu de mission sous le nom d’ « instruction civique » (objective, n’est-ce pas !). On a juste remplacé l’idéologie nationale par l’idéologie "scientifique".
Dans ces conditions, comment pourrait-on attirer les Français au moyen d’un quelconque « Grand Récit » ? L’histoire de France, avilie en « roman national », qu’était-ce d’autre en effet que cette grande fiction qui cimentait la quasi-intégralité de la population française ? Et qu’est-ce qu’un « Grand Récit », sinon une grande fiction à visée unificatrice ?
Il y a des jours et des occasions où l’on devrait maudire la « science » (ou plutôt ce qui se prétend tel). Au fait, c'est Guy Debord qui, dans Commentaires sur la société du spectacle, évoque « ... la prolifération cancéreuse des pseudo-sciences dites "de l'homme" », Quarto-Gallimard, p.1616).
C'était donc ça !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologue, politiste, stéphane rozès, éditorialiste, journalistes, france, politique, société, grand récit, horizon d'attente, arnaud montebourg, marine le pen, front national, benoît hamon, revenu universel, patrick boucheron, histoire mondiale de la france, alain finkielkraut, journal le figaro, histoire de france, nicolas sarkozy, nos ancêtres les gaulois, astérix, éducation nationale, guy debord, la société du spectacle, commentaires sur la société du spectacle, éditions gallimard
samedi, 30 avril 2016
CHRISTOPHER LASCH ET L'ARCON
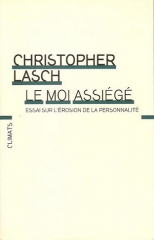 2
2
Alors maintenant, comment Christopher Lasch analyse-t-il l’évolution des pratiques picturales après 1950 ?
« Les équipements d’enregistrement modernes monopolisent la représentation de la réalité, mais ils brouillent également la distinction entre réalité et illusion, entre le monde subjectif et celui des objets, gênant par là même les artistes lorsqu’il s’agit de se réfugier dans le fait brut du moi, comme le disait Roth. Pas plus le moi que son environnement n’est plus un fait brut. » Christopher Lasch, Le Moi assiégé, p. 135. On a déjà croisé une telle idée. On sait qu'elle vient de Guy Debord et de sa Société du spectacle : tout au long de notre existence, toutes nos perceptions (enfin, la plupart) nous parviennent aujourd'hui médiatisées sur un écran où se projettent des images élaborées par d’autres instances que nous-mêmes. Nous n'avons plus d'expérience directe du monde.
« L’artiste romantique projetait des mots et des images dans le vide, en espérant imposer l’ordre au chaos. L’artiste postmoderne et postromantique les voit comme des instruments de surveillance et de contrôle. » C’est l’écrivain William Burroughs qui inspire ici Lasch.
Mais surveillance et contrôle ont été rendus possibles par la généralisation des sciences dites « humaines », au premier rang desquelles on trouve bien sûr la psychologie et la sociologie : « L’observation scientifique et sociologique abolit le sujet en faisant de lui le "sujet" d’expériences censées faire apparaître sa réaction à divers stimuli, ses préférences et ses fantasmes privés. Sur la foi de ses découvertes, la science construit un profil composite des besoins humains sur lesquels elle pourra baser un système (envahissant bien que pas ouvertement oppressif) de régulations comportementales » (p.141). "Régulations comportementales" ? On ne peut être plus clair, me semble-t-il, sur le processus d'asservissement des individus par un système devenu complètement anonyme, du fait que tout ce qui sert à connaître l'homme (les sciences humaines) fournira plus tard des outils perfectionnés pour le contrôler.
L’auteur puise la substance de ce raisonnement chez l’Anglais J.G. Ballard. La préoccupation que ce dernier exprime dans ses romans n’est autre que le processus d’onirisation de la vie, qui résulte de la « saturation de l’environnement par les images et l’effacement consécutif du sujet », tel qu’on peut en voir la manifestation dans le travail d’artistes comme Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Jasper Johns, Robert Morris.


Que ce soient une vignette de BD (Lichtenstein), une aiguille et son fil ou une pince à linge (Oldenburg), l’agrandissement démesuré (x 1000 ou 10000, pour le moins) de l’objet lui fait perdre sa matérialité utilitaire et le coupe de toute réalité concrète. Ce qui fait perdre toute possibilité pour l'œuvre d'art de signifier quoi que ce soit. Sans parler de l'infinie dérision dont de telles œuvres sont porteuses. Il se produit le même phénomène de déréalisation dans la multiplication de la boîte de Campbell Soup ou du portrait de Marylin (Warhol). Il est désormais admis que l’ « œuvre d’art » vole de ses propres ailes, loin de toute basse réalité, offrant au gré des caprices de l’artiste tel objet trivial à l’adoration des foules. On peut voir là une forme de prosternation devant le dérisoire : Clement Greenberg « croyait quant à lui que l’art ne devait jamais tenter de renvoyer à quoi que ce soit en dehors de lui-même ».
Un tel courant a pour conséquence (c’est peut-être le but poursuivi par ces artistes) de dépersonnaliser l’œuvre d’art et d’éliminer la subjectivité (Sol Lewitt), tendant à « brouiller la frontière entre illusion et réalité ». Cette conception de la création artistique procède évidemment des coups inauguraux que Marcel Duchamp, en son temps, a portés au statut de l’artiste. On traitait André Breton de "Pape du surréalisme". Duchamp peut à bon droit être qualifié d' "Empereur du ready-made". Refusant de signer des « chefs-d’œuvre » au bas desquels il serait fier d’apposer sa signature, Duchamp voulut en finir avec la « confiscation » de la créativité par les seuls individus « créatifs ». Idée a priori généreuse et démocratique.
Mais c'est du flan, une vaste blague, une farce grotesque et un désastre général, en vérité, car on sait ce qu’il en est advenu : non seulement le monopole n’a pas été mis à bas, mais il est à présent accaparé, non par des créateurs authentiques, mais par des individus qui se contentent de commercialiser une « idée » artistique, si possible spectaculaire (le bleu de Klein, l’outre-noir de Soulages, la Campbell Soup de Warhol), quand ce n’est pas par de vulgaires hommes d’affaires (Jeff Koons était courtier en matières premières à Wall Street, avant d'être embauché dans la domesticité au service du milliardaire François Pinault).
Il est bien loin, le temps où la société demandait à l’artiste d’administrer la preuve de son savoir-faire et de sa maîtrise technique dans l’art de peindre. Aujourd’hui, tout individu (je ne dis pas "artiste", car tout le monde est concerné par l’appel) un peu astucieux devient une start-up potentiellement dotée d’un bel avenir commercial : sois assez ingénieux pour créer toi-même ton propre « créneau ». Il ne s’agit certes pas du même savoir-faire.
Christopher Lasch se réfère à un essai du philosophe allemand Walter Benjamin, suicidé en 1940 à la frontière franco-espagnole, L’Œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique. Qui dit production en série dit forcément société industrielle, société de consommation, société de masse. Chaque tendance de l’art contemporain va s’inscrire dans un « créneau » précis, celui qui lui est dévolu sur le marché d’une consommation donnée. Que cela s’appelle « minimal art », « systemic painting », « optical art », « process art », « earth art » ou conceptualisme, tous participent de ce mouvement de déconstruction (de « démystification »). Et chacun, bien rangé dans sa case, occupe le « segment de marché » qu’il a réussi à s’ouvrir.
Christopher Lasch conclut logiquement à la « fusion du moi et du non-moi », sorte d’indifférenciation des moi, des êtres et des choses, un monde où les distinctions sont abolies, « un monde où tout est interchangeable ». C’en est au point que « la survie de l’art, comme de toute autre chose, est devenue problématique », au motif « que l’affaiblissement de la distinction entre le moi et son environnement – développement fidèlement consigné par l’art moderne jusque dans son refus de devenir figuratif – rend le concept même de réalité, ainsi que celui du moi, de plus en plus indéfendable » (p.155).
Ce qui arrive arrive, ce qui existe existe, ce qui est là est là, c’est tout : il n’y a plus rien sous la surface des choses, toute substance, tout contenu sont révocables, l’unité de la personne est pulvérisée (« Puisque l’individu semble être programmé par des agences extérieures – ou peut-être par sa propre imagination exaltée – il ne peut être tenu pour responsable de ses actes »), l’insignifiance triomphe. Il n'y a plus que de pures apparences : images fabriquées par des gens de métier, et déconnectées de tout contenu humain réel. L'homme en personne devient virtuel.
Les artistes de la fin du 20ème siècle commentent leurs propres œuvres et le « geste » qui les y a conduits comme s’ils inventaient un nouveau monde. Mais c’est une simple grimace. N’est pas Christophe Colomb qui veut.
Au total, Christopher Lasch, en regardant l’évolution de l’art contemporain, semble contempler un champ de ruines. Difficile, je crois, d’aller plus loin dans la dénonciation de l’impasse où se sont engouffrés les artistes depuis cinquante ans et plus.
Plus radical que Christopher Lasch, tu meurs.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : christopher lasch, le moi assiégé, narcissisme, éditions climats, art contemporain, william burroughs, jg ballard, robert rauschenberg, andy warhol, roy lichtenstein, claes oldenburg, jasper johns, robert morris, clement greenberg, marcel duchamp, ready-made, campbell soup, outre-noir soulages, bleu klein, jeff koons, françois pinault, walter benjamin, pop art, op art, art conceptuel, andré breton, surréalisme, sol lewitt, guy debord, la société du spectacle
vendredi, 29 avril 2016
CHRISTOPHER LASCH ET L'ARCON
1
Je reviens une dernière fois sur Le Moi assiégé, de Christopher Lasch (voir 16 et 19 avril), pour voir un peu ce qu’il pense de l’art contemporain. C’est un sujet qui me tient à cœur. Il regroupe différents courants et tendances sous l’appellation d’ « esthétique minimaliste » (le titre original du livre est The Minimal Self). Et on peut dire que, même s’il ne porte pas trop de jugements de valeur, on comprend que toute son analyse aboutit à une conclusion simple : tout ce qu’on appelle art contemporain est dans un sale état. Et il ne faut pas chercher l'origine de cette situation ailleurs que dans la civilisation, elle-même dans un sale état.
On comprend que les optimistes qui croient dur comme fer dans les vertus progressistes et émancipatrices du Progrès, de l’innovation technologique et autres contes de fées, évitent tant que faire se peut de lire les livres de Christopher Lasch : le tableau qu’il dresse du monde qui est le nôtre n’a en effet rien à voir avec celui dont ils s’ingénient à faire la promotion, jour après jour, et sur lequel leur pinceau suave dessine toutes les promesses mirifiques dont ils nous assurent que le monde futur les comblera au-delà même de nos espérances.
La lecture de Christopher Lasch, à cet égard, est profondément démoralisante. Pan après pan, il ôte en effet le resplendissant habit de lumière dont les promoteurs de l’avenir radieux revêtent des illusions avant d’en refourguer le « grand récit » aux foules, priées de croire que le monde s’achemine sans faiblir vers toujours plus de mieux (Jacques Higelin le chantait : « Aujourd’hui peut-être, Demain ça sera vachement mieux », dans "Alertez les bébés", 1976). Sur la question, tout le monde devrait avoir lu Le Seul et vrai paradis : nul doute que le mythe du Progrès en prendrait un sale coup derrière les oreilles.
Le monde de l’art ne pouvait évidemment pas rester à l’abri des bouleversements, des chambardements et autres destructions qui ont fait du 20ème siècle celui de la guerre militaire, politique et économique, bien que les critères auxquels se conformaient les artistes eussent déjà connu quelque bouleversement quand la 1ère guerre mondial s’est déclenchée. C’est sans doute pourquoi Christopher Lasch intitule la partie de son ouvrage où il aborde la question de la création artistique « L’esthétique minimaliste : art et littérature à l’époque de l’extrême ».
L’idée d’extrême est cruciale à ses yeux : « L’art contemporain est un art de l’extrême non pas parce qu’il prend des situations extrêmes comme sujets – encore qu’une grande partie de l’art contemporain le fasse – mais parce que l’expérience de l’extrême menace jusqu’à la possibilité même d’une interprétation de la réalité par l’imagination » (p.132). Bien d’accord avec l’auteur, qui ajoute juste après : « Le seul art qui semble adapté à une telle époque (à en juger par l’histoire récente de l’expérimentation artistique) est un anti-art, ou art minimal », dont la caractéristique première n’est pas forcément le minimal comme style, mais la « restriction drastique de son champ de vision ».
Par exemple, Anaïs Tondeur (on peut cliquer pour voir les images) a accompagné de son travail les recherches de Michael Marder sur les indéniables mutations génétiques qui touchent la flore autour de la centrale de Tchernobyl, en plaçant sur du papier photosensible des plantes irradiées de la région (on appelle ça des rayogrammes). Elle intitule ça « Tchernobyl’s herbarium ». Si ce n’est pas une restriction drastique du champ de vision de l’art, ça ….
L’artiste contemporain fait le choix de l’ordinaire, de l’effacement de sa propre personnalité et, en décontextualisant radicalement l’objet, supprime toute relation qu’il entretient dans la réalité avec les autres objets. Appelons ça le parachutage arbitraire de l’inouï dans l’œuvre. L'artiste contemporain a réhabilité l' "acte gratuit". L’artiste, au surplus, en s’affirmant comme pleinement original, prétend ne se placer sous l’égide d’aucun maître, d’aucune école : seul son bon plaisir le guide.
De plus, de quelle réalité parle-t-on ? Est-ce celle dont nous aurions une expérience directe, et qu’on appelle « le monde » ? On peut de moins en moins répondre par l’affirmative, tant notre relation avec elle passe par la vision que nous en fabriquent à chaque instant toutes sortes de médias. On reconnaît là une idée directement inspirée de Guy Debord et de sa « société du spectacle », concept dont Christopher Lasch est un familier, même s’il n’en fait pas état ici.
L’iPhonisation des hommes enferme en effet les esprits dans des murs immatériels, sur lesquels une « réalité » de plus en plus « virtuelle » projette l’image (la représentation) trompeuse d’un monde qui semble se plier au moindre de nos désirs. Pur fantasme infantile, évidemment, enraciné dans le narcissisme triomphant de l'époque : l'impression de toute-puissance qui précède, dans le psychisme, l'horrible séparation avec la mère. La séparation qui rend l'individu autonome.
Par ailleurs, selon lui, l’homme est devenu une simple entité statistique, dont la substance proprement individuelle et les motivations profondes, dûment et indûment scrutées en permanence au moyen d’outils sophistiqués, finissent par former l’image d’un être global, collectif et abstrait, censé représenter les tendances dominantes dans une société donnée : « Les médias font un effort sérieux pour nous dire qui nous sommes ». Magnifique formule. Comme dit Souchon : « Dérision de nous dérisoires » ("Foule sentimentale").
Sondages et enquêtes d’opinion dessinent et sculptent un ectoplasme d’identité collective, que ses promoteurs tentent de cautionner à coups de fables et de loufoqueries, au premier rang desquelles une prétendue scientificité dont ils s'efforcent d'habiller leur activité mercantile. A ce compte-là, pour savoir qui je suis, je n’ai plus à m’interroger à partir de ma vie intérieure : il faut seulement que j’ouvre le journal ou que je regarde la télé. Les médias inventent et fabriquent jour après jour un individu statistique, supposé tenir lieu de ciment social, voire national. Mais qui, accessoirement, a pour effet de devenir une norme impérieuse, à laquelle les individus de chair et de sang sont, sans que ce soit dit, invités vivement invités à se conformer.
On a compris l’imposture.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christopher lasch, the minimal self, le moi assiégé, jacques higelin, alertez les bébés, lasch le seul et vrai paradis, anaïs tondeur tchernobyl, art contemporain, guy debord, la société du spectacle, alain souchon, foule sentimentale
samedi, 16 avril 2016
CHRISTOPHER LASCH ET GUY DEBORD
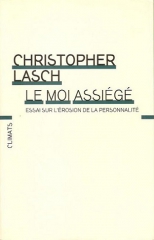 Quelques réflexions après lecture de Le Moi assiégé, "essai sur l'érosion de la personnalité", de Christopher Lasch.
Quelques réflexions après lecture de Le Moi assiégé, "essai sur l'érosion de la personnalité", de Christopher Lasch.
Pour mettre du baume au cœur.
Il est bon d’avoir lu, au moins une fois dans sa vie, un livre de Christopher Lasch, observateur intransigeant de la civilisation occidentale en général, mais principalement de la façon dont elle évolue aux Etats-Unis. A cet égard, La Culture du narcissisme (Climats, 2000, écrit en 1979), que je suis en train de relire, fait un excellent point de repère et de départ, même si c'est un peu « consistant ».
La méthode de Christopher Lasch est impeccable : il fait le tour complet d’une documentation impressionnante et passe au crible tout ce qui a été dit par d’autres du sujet qui le préoccupe. Il énumère les points de vue qu’il estime erronés et s’efforce de corriger les idées fausses que des gens sûrement sérieux véhiculent et colportent.
Dans Le Moi assiégé (« essai sur l’érosion de la personnalité », Climats, 2008, écrit en 1984), que je viens de relire avec intérêt, il revient, pour l’approfondir, sur la notion de narcissisme. Le sous-titre dit assez sur quelle hypothèse il s’efforce de fonder son ouvrage. C’est une idée qu’on croise dans les bouquins de Michel Houellebecq, de façon explicite dans un de ses volumes d'Interventions. Une idée qui se veut un constat. Une idée qui, si elle s'avère, a des implications qui peuvent effrayer.
Dans une société vouée à la catastrophe humaine que constituent la marchandise, son spectacle et sa consommation, assailli constamment par des armées d’images, l’individu ne parvient plus à se constituer un « moi » par ses propres moyens, un « moi » qui lui appartienne en propre, après avoir fait sa propre expérience directe du monde et de la réalité. Le système de la communication publicitaire - à tendance tant soit peu totalitaire -, qui a gagné un terrain considérable pour organiser les relations sociales à tous les niveaux, occupe désormais une place prépondérante, en lieu et place de ce que Freud appelle le Moi.
Ne pas oublier qu'Edward Bernays, l'un des grands inventeurs de la publicité moderne, était le double neveu de l'inventeur de la psychanalyse, discipline dans laquelle il a abondamment puisé pour mettre au point la machine publicitaire : on va puiser dans le bric-à-brac du secret des motivations les figures, motifs et arguments qui, brandis ensuite comme un miroir devant le nez du citoyen devenu consommateur, vont orienter son désir vers la marchandise à vendre.
Pour resituer la chose, il ne faut pas oublier que le livre de Lasch est publié en 1984. Je veux dire par là qu'il n'est pas impossible qu'une question d'ordre générationnel se pose, car l'idée dit peut-être davantage à des gens de mon âge qu'à des générations plus neuves, vu que les conditions concrètes de l'existence n'avaient pas encore été aussi radicalement transformées qu'elles ne l'ont été depuis une trentaine d'années.
Quoi qu'il en soit, l'idée du spectacle marchand comme programme général d'existence avait été largement diffusée en leur temps par les situationnistes en général, et Guy Debord en particulier. Une idée le plus souvent incomprise, du fait d’une interprétation tout à fait étriquée, donc fausse, de la notion de « spectacle », que je reformulerais ici de la façon suivante : « création, entre l’homme et le monde, d’une réalité entièrement artificielle autour de la marchandise érigée en objet de désir par les moyens de la propagande ».
Il s’ensuit que la personne a été en quelque sorte vidée d’elle-même, comme si un écran s’était interposé entre sa conscience et son moi. Dépossédée de ce qu’elle serait devenue si elle avait été soumise aux seules influences héritées de la tradition, elle ne s’appartient plus, fabriquée des pièces et des morceaux d’images conçues par d’autres et introduites en elle de l’extérieur. Autrement dit, comme elle a du mal à distinguer ce qui vient d’elle et ce qu’elle ingurgite de l’extérieur, la personne ne sait plus à qui elle a à faire quand elle dit « je ». « L’anxiété actuelle au sujet de l’ "identité" reflète une partie de cette difficulté à définir les frontières de l’individualité » (p.15).
J’ajoute, pour enfoncer le clou, que la personne, quand elle dit « je », croit sincèrement qu’elle parle en son propre nom, alors qu’elle exprime un « moi » qui lui a été pour une grande part inculqué à son insu : la société du capitalisme spectaculaire-marchand (Debord) a façonné des semblants de personnes, des fantômes persuadés qu’ils existent de façon pleine et entière : des artefacts, des zombies. L’idée est pour le moins radicale.
Ce qui change, par rapport à la situation précédente, c'est que nous sommes ici dans l'exécution d'un projet parfaitement concerté, généralisé, et prévu pour produire les effets qu'il produit. Ce que fait, dans un autre domaine, le génie génétique par rapport, par exemple, à la méthode de nature purement empirique de sélection et d'appariement de deux races de chiens par les éleveurs, en fonction des qualités attendues de la nouvelle race envisagée (flair, endurance, dressabilité, puissance, potentiel agressif, etc.). Si la grille de lecture de Christopher Lasch est la bonne, cela veut dire en effet que les populations embarquées dans ce système ne sont plus désormais en mesure de porter ce qui s’appelle une « civilisation ». Et, accessoirement, que le système qui est le nôtre a quelque chose à voir avec le totalitarisme.
Cela veut dire que le système spectaculaire-marchand débarrasse l’individu du fardeau de la civilisation, puisqu’il il le débarrasse du fardeau de lui-même, en le transformant en simple spectateur et client, consommateur de biens et de services. En poussant un peu, on pourrait considérer que le système spectaculaire-marchand fait disparaître jusqu’à la possibilité de la civilisation, en transformant tout ce qui appartient au passé en simple objet muséal, ou en simple marchandise destinée à des touristes venus errer dans l'hypermarché global pour consommer les traces d’un passé mort, et dénué pour eux de signification présente.
Charmante perspective.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, christopher lasch, le moi assiégé, éditions climats, psychologie, psychanalyse, narcissisme, michel houellebecq, guy debord, la société du spectacle, spectaculaire-marchand, houellebecq interventions, edward bernays
lundi, 18 janvier 2016
ACTUALITÉ DE GUY DEBORD
Dans son Journal de 1988, Philippe Muray cite à plusieurs reprises l’ouvrage de Guy Debord paru cette année-là : Commentaires sur La Société du spectacle. Cela m’a donné envie d’y retourner pour jeter un œil. On sait que La Société du spectacle date de 1967. Les Commentaires examinent ce qu’il en est advenu de cette société vingt ans après. Et l’on peut dire que le constat fait frémir. Ajoutons que Debord se contente, précisément, de constater : « Les présents commentaires ne se soucient pas de moraliser. Ils n’envisagent pas davantage ce qui est souhaitable, ou seulement préférable. Ils s’en tiendront à ce qui est » (Guy Debord, Œuvres, Gallimard/Quarto, p. 1595).
On peut dire que l’évolution irrésistible du système, dont il faisait déjà une critique radicale, a comblé toutes les attentes que l’auteur avait placées en elle, et même au-delà. D’après ce que j’ai pu en comprendre, le « spectacle », dans le vocabulaire de Debord, n'a pas grand-chose à voir avec les maisons de théâtre, de cinéma ou d’opéra. Je me rappelle une émission de Bernard Pivot consacrée à La Société du spectacle, où ce grand couillon de Franz-Olivier Giesbert faisait l'énorme contresens habituel de tout confondre. Le malentendu demeure profond.
Pour reformuler dans mes propres termes ce que je pense avoir compris de ce concept de « spectacle », je dirai que c’est très généralement l’instauration d’une relation de plus en plus impossible entre les hommes et le monde, une relation non plus immédiate, comme depuis des millénaires, c’est-à-dire où rien ne vient s’interposer entre l’individu et le monde, mais médiate. Une relation désormais induite par une représentation artificielle (le "spectacle" ?), elle-même produite en dehors, puis introduite à l'intérieur de l’esprit par une instance tierce.
Le « spectacle », c’est cette représentation (ce discours, ce pouvoir) qui s’impose pour faire écran entre l’individu et le monde. Qui prépare et canalise en amont l’expérience que l’individu peut avoir du monde. Qui formate sa perception. Ce discours fonctionne comme un conditionnement préalable de l’esprit, dont le résultat est illustré par ce « proverbe africain » : « Le touriste ne voit que ce qu’il sait », qu’on pourrait traduire ainsi : « L’individu ne consiste désormais qu'en ce qu’on lui a précédemment inculqué ». Le système a inventé l'homme-ectoplasme.
On pourrait même dire que l’individu, dans sa mémoire et dans ses affects, n’est plus composé que des éléments dont on l'a fabriqué : il ne s’appartient plus. Il voit, entend, réfléchit, avec les yeux, les oreilles et le cerveau qu’on lui a greffés sans qu'il s'en aperçoive. Le sommet du grand art dans la fabrication de l’ "Homme Nouveau", dont rêvèrent Hitler et Staline, mais de façon combien fruste et grossière ! La principale caractéristique du discours ainsi médiatisé qui préside à cet endoctrinement et qui façonne la façon dont l’individu va percevoir et expérimenter le monde, est d’émaner d’un Pouvoir. Etant entendu que les « médias » ne sont qu’un aspect particulier, le plus visible, du système élaboré par et pour le maintien de ce Pouvoir : il faut deviner l'énorme masse de glace de l'iceberg systémique qui se cache sous la surface.
Autrement dit, tout ce qui descend du « spectacle » en direction de « la plèbe des spectateurs », « ce sont des ordres ». Et l’individu n’a d’autre choix que d’obtempérer, obéir, se soumettre, puisque le monde est ainsi fait, n'est-ce pas. Puisqu’il est convaincu d’avance qu’il serait vain d’essayer de le changer. Puisque l’idée même que cela fût possible, qu’on le pût ou qu’on le dût ne lui effleurerait jamais l’esprit.
Mais dans ses Commentaires, Debord ajoute une nouvelle forme de « pouvoir spectaculaire » aux deux que le précédent ouvrage avait mises au jour. Il y parlait de la « concentrée », brillamment illustrée au cours du 20ème siècle par les grandes aventures hitlérienne et stalinienne. Il y parlait de la « diffuse », portée par la civilisation américaine, qui avilit l’idéal de Liberté en le réduisant à la médiocre « liberté de choix », c’est-à-dire une liberté dégénérée, une liberté de basse-cour.
En 1988, pour compléter le tableau, il définit un pouvoir « spectaculaire intégré », qui est une combinaison des deux autres, et qu'il voit déjà partie à la conquête du monde. Le « spectaculaire intégré » emprunte au « concentré » l’autoritarisme, mais en le dissimulant : « … le centre directeur en est devenu occulte … » (on pense au "gouvernement invisible" appelé de ses vœux par le grand-prêtre de la publicité contemporaine, Edward Bernays : comment se révolterait-on contre une "Société Anonyme" ? A qui, en effet, pourrait-on s'en prendre nommément ?) ; et au « diffus » le formatage généralisé des comportements et des choses : « Car le sens final du spectaculaire intégré, c’est qu’il s’est intégré dans la réalité même à mesure qu’il en parlait ; et qu’il la reconstruisait comme il en parlait ».
L’effet magistral ainsi obtenu est l’escamotage pur et simple de la réalité, le monde concret, les choses enfin, comment qu’on les nomme. Le dur sur lequel je me cogne. Les épines des églantiers qu’il ne faut pas hésiter à affronter bravement si l’on tient vraiment à la confiture succulente qui en découlera après un processus compliqué : tout salaire mérite sa peine. Maintenant, l'artifice absolu est devenu le monde dans lequel nous vivons tous les jours, incluant jusqu'à nos mots, nos images et nos existences. J’avais lu, à publication, Le Crime parfait, de Jean Baudrillard, qui décrivait la même mise à mort, quoiqu’en termes différents (vocabulaire, syntaxe et perspective, j'avoue que j'ai un peu oublié).
Et Guy Debord ajoute, pour parfaire le triptyque de ses « pouvoirs spectaculaires » : « Quand le spectaculaire était concentré la plus grande part de la société périphérique lui échappait ; et quand il était diffus, une faible part ; aujourd’hui rien ». Traduction proposée : en régime dictatorial, il suffit de se maintenir en dessous de la couverture radar pour rester à peu près peinard. En régime capitaliste à l’américaine, on a du mal à échapper à la marchandise et à son cortège de servitudes.
Mais alors là, en régime de « spectaculaire intégré » (déjà en 1988), impossible d’échapper aux griffes propagandistes de Moloch-Baal et au formatage et au conditionnement précis qu’il fait subir à tous ceux qui entrent sur la planète, planète qui leur apparaîtra forcément sous les traits du « monde tel qu’il est ». Et là, quel Michel Foucault, quel Jacques Derrida, quel Gilles Deleuze, ces champions de la "Déconstruction" de tout ce qui faisait notre civilisation, déconstruiront, mais à l'envers, leurs représentations pour leur dévoiler la vérité ?
Ils seront tenus dans la complète ignorance du nombre et de la qualité des opérations successives d’usinage dont ils seront le résultat. Ils auront beau être fils de leur mère, ils ne sauront jamais de quel processus ils sont l’aboutissement. Ils seront ce qu’on leur aura dit qu’ils sont et préparés à être. A moins de s’appeler Winston Smith (dans 1984 de George Orwell).
En fait, je ne voulais pas, en me lançant dans ce billet, brasser toutes ces matières. Je voulais seulement partager avec quelques lecteurs un paragraphe qui a littéralement explosé sous mes pas quand je suis passé dessus. Se souvenir, avant de le lire, qu’il fut publié en 1988 (le livre sort en mai, l’attentat de Lockerbie se situe en décembre). C’est vrai, on parlait déjà de terrorisme (OLP, FPLP, FPDLP, et leurs frères, leurs cousins, leurs conjoints, leurs alliés, …). Mais dites-moi si ce paragraphe ne sonne pas étrangement.
« Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi, le terrorisme. Elle veut en effet être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. L’histoire du terrorisme est écrite par l’Etat ; elle est donc éducative. Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que, par rapport à ce terrorisme, tout le reste devra leur sembler plutôt acceptable, en tout cas plus rationnel et plus démocratique. »
Dites, je ne sais pas vous, mais moi, j’aimerais savoir ce qu’il buvait comme café pour lire dans ce marc extralucide. Car derrière « tout le reste », j’entends toute l’entreprise actuelle de Hollande et consort pour amoindrir le poids du pouvoir judiciaire et pour accroître celui de l’administration policière de la vie collective.
J’ai peur pour l’état de droit.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe muray, muray journal intime, muray ultima necat, éditions belles lettres, littérature, guy debord, la société du spectacle, commentaires sur la société du spectacle, gallimard quarto, philosophie, société, système capitaliste, situationnistes, hitler, staline, totalitarisme, michel foucault, jacques derrida, gilles deleuze, 1984 george orwell, terrorisme, françois hollande, état d'urgence, état policier, politique, franz-olivier giesbert
jeudi, 24 septembre 2015
L'HOMME OBSOLÈTE
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 4
Sur la bombe et les causes de notre aveuglement face à l’Apocalypse
La remarque la plus étonnante – la plus amusante si l’on veut – qu’on trouve dans ce dernier essai composant L’Obsolescence de l’homme, se trouve p. 283. C’est le titre du §8 : « L’assassin n’est pas seul coupable ; celui qui est appelé à mourir l’est aussi ». Il se trouve que j’étais en train de lire Maigret et le clochard. Les hasards de l’existence … On lit en effet au chapitre IV ce petit dialogue entre M. et Mme Maigret : « – Les criminologistes, en particulier les criminologistes américains, ont une théorie à ce sujet, et elle n’est peut-être pas aussi excessive qu’elle en a l’air … – Quelle théorie ? – Que, sur dix crime, il y en a au moins huit où la victime partage dans une large mesure la responsabilité de l’assassin ». Le rapprochement s’arrête évidemment à cette coïncidence.
Günther Anders analyse ici les implications et significations de la bombe atomique. Il reprend une idée exprimée dans Sur la Honte prométhéenne : « Nous lançons le bouchon plus loin que nous ne pouvons voir avec notre courte vue » (p.315). Autrement dit, nous agissons sans nous préoccuper des conséquences de nos actes, et nous inventons des choses qui finissent par nous dépasser, voire se retourner contre nous.
Je me contenterai de picorer ici des réflexions qui m’ont semblé intéressantes. D’abord cette idée que, aujourd’hui, « c’est nous qui sommes l’infini », qui dit assez bien ce que la bombe, fruit de l’ingéniosité humaine, a d’incommensurable avec l’existence humaine : nous éprouvons désormais « la nostalgie d’un monde où nous nous sentions bien dans notre finitude ».
Faust est mort, dit l’auteur, précisément parce qu’il est le dernier à se plaindre de sa « finitude ». Je ne sais plus où, dans le Second Faust, le personnage s’adresse à Méphisto : « Voilà ce que j’ai conçu. Aide-moi à le réaliser ». Notons au passage qu’aux yeux de Goethe, c’est la technique en soi qui a quelque chose de diabolique, puisque c’est Méphisto qui l’incarne.
Une autre idée importante, je l’ai rencontrée récemment dans la lecture de La Gouvernance par les nombres d’Alain Supiot (cf. ici, 9 et 10/09) : ce dernier appelle « principe d’hétéronomie » l’instance d’autorité qui, surplombant et ordonnant les activités des hommes, s’impose à tous. Or ce principe, dans une civilisation dominée par la technique, tend à devenir invisible, conférant alors au processus lui-même une autorité d’autant plus inflexible qu’elle n’émane pas d’une personne. Ce qui fait que la finalité de la tâche échappe totalement à celui qui l’accomplit, avec pour corollaire : « Personne ne peut plus être personnellement tenu pour responsable de ce qu’il fait » (p.321).
C’est aussi dans le présent essai qu’on trouve le chapitre intitulé « L’homme est plus petit que lui-même ». Je ne reviens pas en détail sur cette idée formidable, qui développe d’une certaine manière les grands mythes modernes suscités par la créature du Dr Frankenstein (Mary Shelley) ou par le Golem (Gustav Meyrink) : l’homme, en déléguant sa puissance à la technique, a donné naissance à une créature qui lui échappe de plus en plus. Avec pour conséquence de multiplier les risques pour l’humanité : « Ce qui signifie que, dans ce domaine, personne n’est compétent et que l’apocalypse est donc, par essence, entre les mains d’incompétents » (p.301). Autrement dit, l’humanité a construit un avion pour lequel il n’existe pas de pilote.
Je signale une expression qui m’a aussitôt fait penser à Hannah Arendt : « cette horrible insignifiance de l’horreur » (p.304).
Pour terminer, ce passage (l'auteur vient d'évoquer Les Frères Karamazov) : « Accepter que le monde qui, la veille encore, avait un sens exclusivement religieux devienne l’affaire de la "physique" ; reconnaître, en lieu et place de Dieu, du Christ et des saints, "une loi sans législateur", une loi non sanctionnée, sans autre caution que sa seule existence, une loi absurde, une loi ne planant plus, « implacablement », au-dessus de la nature, bref la « loi naturelle » – ces nouvelles exigences imposées à l’homme de l’époque, il lui était tout simplement impossible de s’y plier » (p.333). Le « Système technicien » (Jacques Ellul) s’est autonomisé. L’homme se contente de suivre la logique de ce système, de se mettre à son service pour qu’il se développe encore et toujours et, pour finir, de lui obéir aveuglément.
Au total, un livre qui secoue pas mal de cocotiers.
Voilà ce que je dis, moi.
FIN
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer, maigret, georges simenon, maigret et le clochard, la banalité du mal, goethe, méphisto faust, alain supiot
mercredi, 23 septembre 2015
L'HOMME OBSOLÈTE
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 3
Le Monde comme fantôme et comme matrice
Le monde qu’analyse cet essai est celui de la médiatisation triomphante de tout. Günther Anders parle seulement de la radio et de la télévision, mais je suis sûr qu’il ne verrait aucun obstacle à étendre ses analyses aux médias qu’une frénésie d’innovation technique a inventés depuis son essai (1956). Aujourd’hui, tout le monde est « connecté », au point qu’être privé de « réseau » peut occasionner de graves perturbations psychologiques.
Il commence par nier la valeur de l’argument habituel des défenseurs de la technique face à ceux qui s’indignent de certains « dommages collatéraux » : ce n’est pas la technique qui est mauvaise, ce sont les usages qu’on en fait (air connu). Cet argument rebattu fait semblant d’ignorer que « les inventions relèvent du domaine des faits, des faits marquants. En parler comme s’il s’agissait de "moyens" – quelles que soient les fins auxquelles nous les faisons servir – ne change rien à l’affaire » (p.118).
Notre existence, dit-il, ne se découpe pas en deux moitiés séparées qui seraient les « fins » d’une part, les « moyens » d’autre part. L’ « individu », par définition, ne peut être coupé en deux (cf. le jugement de Salomon). L’argument n’a l’air de rien, mais il est puissant. Conclusion, il est vain de se demander si c’est la technique qui est mauvaise en soi, ou les usages qui en sont faits ensuite : une poêle sert à griller des patates, elle peut servir à assommer le voisin qui fait du bruit à deux heures du matin.
Pour qui est familiarisé avec les critiques lancées contre la télévision dans la dernière partie du 20ème siècle, le propos de Günther Anders compose un paysage connu. Les Situationnistes en particulier, à commencer par Guy Debord, ont constamment passé dans leur moulinette virulente la « société spectaculaire-marchande ». Il n’est d’ailleurs pas impossible que Debord (La Société du spectacle date de 1967) ait picoré dans l’essai d’Anders (paru en 1956).
Si les films, marchandises standardisées, amènent encore les masses à se réunir dans des salles pour assister collectivement à la projection, la télévision semble livrer le monde à domicile. Pour décrire l’effet produit par ce changement, Anders a cette expression géniale : « Le type de l’ "ermite de masse" était né ». « Ermite de masse » est une trouvaille, chacun étant chez soi, en quelque sorte, « ensemble seul ».
On peut ne pas être d’accord avec l’auteur quand il met exactement sur le même plan radio et télévision, car la réception d’images visuelles change pas mal de choses. Le point commun réside dans l’action de médiatisation : l’écran de télévision, et dans une moindre mesure le poste de radio, littéralement, « font écran » entre le spectateur et la réalité concrète du monde, qui du coup n’est plus l’occasion d’une expérience individuelle par laquelle chacun teste sa capacité d’action sur celle-ci.
L’auteur le dit : le monde, qui est servi « à domicile », n’est plus que le « fantôme » de lui-même : « Maintenant, ils sont assis à des millions d’exemplaires, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas pour fuit le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde "en effigie" ». L’exagération ne peut toutefois s’empêcher de ressurgir : « Chaque consommateur est un travailleur à domicile non rémunéré [il faudrait même dire "payant"] qui contribue à la production de l’homme de masse ». Mais on a bien compris l’idée.
Autrement intéressante est l’idée que radio et télévision induisent l’établissement, entre la source et le récepteur (entre les animateurs du spectacle et les auditeurs et téléspectateurs) une « familiarité » pour le moins étrange, qui semble tisser entre eux des liens de proximité immédiate, du seul fait que ces voix semblent s’édresser à eux personnellement. On pense ici à tout ce que peuvent déclarer de charge affective et d’identification les consommateurs quand ils s’adressent aux animateurs par oral ou par écrit. De plus, ces liens apparents entraînent une relative déréalisation des proximités concrètes (exemple p. 148-149). Ces liens sont en réalité une grande imposture qui fait que l’ « individu devient un "dividu" » (p.157). C’est bien trouvé.
Anders évoque aussi l’espèce d’ubiquité que produit le média et la schizophrénie artificiellement produite qui en découle. S’il voyait aujourd’hui avec quelle attention fascinée passants, clients de terrasses de bistrots et passagers du métro fixent l’écran de leur téléphone, même marchant ou en compagnie, il serait encore plus catastrophé par le monde que les hommes ont continué à fabriquer.
Faisant semblant d’être ici (puisqu’ils « communiquent » et sont « connectés ») et faisant semblant d’être ailleurs (pour les mêmes raisons !), ils constituent une sorte d’humanité « Canada dry », cette boisson qui « ressemble à de l’alcool, mais ce n’est pas de l’alcool ». Voilà : ça ressemble à de l’humanité, mais ce n’est pas de l’humanité. L’incessante innovation technique au service de la marchandise tient l’humanité en laisse.
Je n’insiste pas sur le conditionnement du désir, en amont de la manifestation d’une volonté et d’une liberté, pour orienter celui-ci sur des marchandises. Je n’insiste pas sur le caractère impérieux, voire vaguement totalitaire, de cette façon d’imposer une représentation du monde (une idéologie) : « Que ma représentation soit votre monde » (p. 195), façon plus sophistiquée que celle qu’Hitler utilisait pour formater les esprits. Günther Anders suggère que le règne de la radio et de la télévision produit un autre totalitarisme.
L’essai Le monde comme fantôme et comme matrice (titre pastichant Schopenauer), par sa radicalité dans l’analyse de la radio et de la télévision, indique assez que son auteur n’attend rien de bon de l’évolution future de l’humanité et du sort que l’avenir, sous l’emprise de la technique, lui réserve.
Il serait désespéré que ça ne m’étonnerait pas. Sa réflexion, qui remonte à plus d’un demi-siècle, n’a en tout cas rien perdu de sa force.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer
samedi, 19 septembre 2015
MARIO VARGAS LLOSA
 Le prix Nobel de littérature 2010, Mario Vargas Llosa, vient de publier (Gallimard, 2015) La Civilisation du spectacle. D’un prix Nobel, on est en droit d’attendre un message de haute volée. Grosse déception, donc. Autant le dire tout de suite : il aurait mieux fait de ne pas. Alléché par le titre, j'ai vite déchanté.
Le prix Nobel de littérature 2010, Mario Vargas Llosa, vient de publier (Gallimard, 2015) La Civilisation du spectacle. D’un prix Nobel, on est en droit d’attendre un message de haute volée. Grosse déception, donc. Autant le dire tout de suite : il aurait mieux fait de ne pas. Alléché par le titre, j'ai vite déchanté.
Il a beau inscrire son propos, dans le chapitre introductif, dans la lignée d’une ribambelle d'auteurs dénonçant le règne de la marchandise, la transformation du monde en spectacle et des gens en consommateurs (T.S. Eliot, George Steiner, Guy Debord, Gilles Lipovetsky, Frédéric Martel – il oublie Alain Finkielkraut et sa mémorable Défaite de la pensée), son livre au titre ambitieux ne tient pas debout. C'est au mieux le livre d'un vieux notable universellement respecté, à qui un adulateur a demandé, à la fin du banquet, d'émettre un jugement sur notre époque et notre monde tels qu'il les voit.
La thèse est facile à formuler : le monde actuel, en privilégiant le loisir, le divertissement et la consommation, a assassiné la culture. L’un des problèmes vient justement de ce dernier terme. L’auteur en tient visiblement pour la « haute culture » (sous-entendu : classique, traditionnelle, la culture par laquelle l’homme tend à s’élever au-dessus de lui-même). C’est précisément ce qui n’est pas à lui reprocher.
Il lui oppose la « culture-monde » : « La culture-monde, au lieu de promouvoir l’individu, le crétinise, en le privant de lucidité et de libre-arbitre, et l’amène à réagir devant la "culture" régnante de façon conditionnée et grégaire, comme les chiens de Pavlov à la clochette qui annonce le repas » (p.28). On est évidemment d’accord avec lui : la culture est structurée selon une échelle de valeurs. La marchandisation de tout tire tout vers le bas en mettant sur le même plan une paire de bottes et l'œuvre de Shakespeare (Alain Finkielkraut, La Défaite de la pensée, Gallimard, 1987, p.136).
Il existe, malgré tout ce que peut proclamer la culture « mainstream » (titre du livre du susnommé Frédéric Martel), une hiérarchie dans la culture, qui sait différencier la démarche qui prône un effort constant et une exigence de la part de celui qui se cultive, et la démarche qui se borne à des produits culturels de consommation courante véhiculés par la publicité, faits pour suivre les modes et disparaître sitôt absorbés.
Vargas Llosa raisonne en aristocrate : « La quantité aux dépens de la qualité. Ce critère, auquel tendent les pires démagogies dans le domaine politique, a eu ici des conséquences imprévues, comme la disparition de la haute culture, forcément minoritaire par la complexité et parfois l’hermétisme de ses clés et codes, et la massification de l’idée même de culture » (p.35). Jusque-là, je suis prêt à approuver l’auteur.
Qu’est-ce que je reproche à ce livre ? D’abord de brasser des idées tant soit peu rebattues. D’enfoncer des portes ouvertes. De nous donner à renifler des parfums flottant dans l’air du temps. D’énoncer trop souvent des banalités. De produire un ingrédient voulu original, mais constitué surtout du tout-venant intellectuel. Il arrive comme les carabiniers quand il dénonce – après tant d’autres – l’irruption de la « frivolité » dans les domaines les plus sérieux de l’existence des hommes et de la vie des sociétés.
Mais ce que je reproche surtout à ce livre, en dehors de la superficialité des analyses, c’est le joyeux mélange qu’il opère des notions et des perspectives. Autrement dit : son manque d’unité. Cela donne une impression d’hétérogène et de disparate. Autant j’abonde quand il s’en prend aux « déconstructionnistes » de la culture (Foucault, Derrida, …) qui, en critiquant la notion de pouvoir, ont sapé à la base le principe d’autorité, autant je trouve incongru le chapitre sur la « disparition de l’érotisme ». Je concède cependant que la dénonciation des « ateliers de masturbation » mis en place en 2009 dans les collèges d’Estrémadure a quelque chose de réjouissant.
Et encore plus étrange celui où, tout en s’affirmant athée, il prend contre toute raison la défense de la plus extrême liberté religieuse, en mettant strictement sur le même plan les sectes (Moon, scientologie, …) et toutes les croyances et religions reconnues et officielles : « Les sectes, à cet égard, sont utiles et devraient être non seulement respectées, mais encouragées » (p.197). Il se félicite que les sectes « procurent un équilibre et un ordre à ceux qui se sentent déconcertés, solitaires, inquiets dans le monde d’aujourd’hui ». Pour le moins surprenant, n’est-il pas ?
Ajoutons pour compléter le tableau que les six chapitres et la « Réflexion finale » sont entrelardés d’une petite dizaine de textes intitulés « Pierre de touche » (pourquoi ?) – en fait, des articles déjà publiés dans le journal El País, illustrant telle ou telle partie du raisonnement. Quant au chapitre conclusif, inclus dans la « Réflexion finale », il reproduit le discours que l’auteur à prononcé en 1996 après s’être vu décerner le « Prix de la Paix » par les éditeurs et libraires allemands. Le discours du patriarche à la fin du banquet organisé en son honneur.
L’image que je garde du livre dans sa totalité : banal, consensuel et mal foutu, où l'on trouve à la fois du très juste, mais qui court les rues, et du n'importe quoi.
Quant au titre, qu’on me pardonne, il est au mieux une promesse non tenue, au pire une imposture prétentieuse.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, prix nobel de littérature, mario vargas llosa, la civilisation du spectacle, guy debord, la société du spectacle, éditions gallimard, ts eliot, george steiner, alain finkielkraut, gilles lipovetsky, frédéric martel mainstream, la défaite de la pensée, secte moon, scientologie, l ron hubbard
samedi, 05 juillet 2014
L'ECLAT ET LA BLANCHEUR
La vie, naguère, était dictée par le décalogue, l’opinion des voisins, les snobismes locaux et les ouvrages de la baronne Staffe. Elle laissait assez de place à l’homme pour se livrer, par le moyen de quelque gymkhana exécuté entre ces tabous, à la vertu, au dévouement, à l’adultère mondain, au dressage des bassets, à l’assassinat des caissières, au trépas sur les champs de bataille, bref pour avoir une âme immortelle et en faire un usage grandiose et personnel. L’homme avait le droit d’être sublime ou sordide. Sa vie était un jeu dramatique et passionnant.
Adieu ces libertés et ces exaltations ! L’homme a perdu le loisir charmant de falsifier un testament, de lire Montaigne ou de tuer des petites filles. Il ne s’agit plus aujourd’hui que d’obtenir la blancheur Cerfeuil, de sourire Kibrille et de vivre Marie-Chose. On n’a plus le temps que d’être un client. Et d’obéir aux magazines. La conduite de l’homme est dictée par le réfrigérateur Machin, le bloc-évier, la poubelle à pédale. Il est vaincu par ses conquêtes. C’est le bagnard de l’appareil électroménager.
Son cerveau a été savamment remplacé par le prospectus publicitaire. Il pense Kimousse, Kiastik, Kipenspourvou. Sa vie se résume dans un bulletin de commandes. Elle a le style du jargon de prestige des périodiques et des marchands de « cités heureuses ». La femme n’a plus qu’à se laisser guider.
*****
 Je ne mets toujours pas les guillemets, qui s'imposent théoriquement. Ces lignes d'Alexandre Vialatte, parues dans La Montagne le 18 février 1968, sont toujours tirées de Profitons de l'ornithorynque (Julliard, 1991).
Je ne mets toujours pas les guillemets, qui s'imposent théoriquement. Ces lignes d'Alexandre Vialatte, parues dans La Montagne le 18 février 1968, sont toujours tirées de Profitons de l'ornithorynque (Julliard, 1991).
Eh oui, on n'a plus le temps que d'être un client.
Pour dire que Vialatte n'avait rien à apprendre de Guy Debord, des intellectuels en général et des situationnistes en particulier. Il n'avait rien à apprendre des révolutionnaires : il se contentait de regarder. Sans se raconter d'histoires. Et sans brandir l'étendard compliqué et systématique de la théorie. La « société du spectacle », Vialatte, il sait ce que c'est. Je respecte Guy Debord. J'admire Alexandre Vialatte. Au motif que, si Guy Debord a raison, c'est Alexandre Vialatte qui dit vrai. Même Günther Anders, qui ne dit pas autre chose, est plus compliqué.
intellectuels en général et des situationnistes en particulier. Il n'avait rien à apprendre des révolutionnaires : il se contentait de regarder. Sans se raconter d'histoires. Et sans brandir l'étendard compliqué et systématique de la théorie. La « société du spectacle », Vialatte, il sait ce que c'est. Je respecte Guy Debord. J'admire Alexandre Vialatte. Au motif que, si Guy Debord a raison, c'est Alexandre Vialatte qui dit vrai. Même Günther Anders, qui ne dit pas autre chose, est plus compliqué.
Cela fait une différence. Je veux dire entre celui qui se pose en penseur, contempteur et réformateur du monde, et celui qui se contente de vivre la vie qui lui a été donnée, qu'il essaie de comprendre, sans pour autant la disséquer, en se contentant de la vivre le plus plaisamment possible, et d'en exprimer dans un français impeccable la « substantificque mouelle » coulée de sa propre expérience. Sans s'en laisser conter par les baratineurs, bonimenteurs et autres camelots : humain, simplement humain.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, france, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, profitons de l'ornithorynque, guy debord, la société du spectacle
jeudi, 05 juin 2014
ADIEU AU LANGAGE
Je commence à être inquiet : c’est la deuxième fois que je vais au cinéma cette année. Ça commence à faire beaucoup. Cette fois, c’était pour voir le « dernier Godard » : Adieu au langage.

Si je ne vais guère au cinéma, c’est que je ne veux plus qu’on me « raconte des histoires », j'attends qu’on me dise quelque chose, à la rigueur qu'on le fasse à travers un récit : roman, film ou autre.
Qu'on me dise quelque chose de consistant du monde tel qu'il est, tel qu'il va. Ou plutôt tel qu'il va mal.
J'avais déjà rencontré ça dans les Maigret que j'ai lus. Avec Adieu au langage, je n'ai pas été déçu ! Il ne m'étonne pas du tout que les fonctionnaires à bout de souffle (salut Godard !) du Masque et la Plume (sauf Lalanne) aient été rebutés et aient envoyé le film à la poubelle. Un signe annonciateur : Jérôme Garcin l'avait placé en dernière position dans son énumération du début, ce qui garantissait qu'il fût expédié en un quart de seconde. Ces spécialistes autoproclamés du cinéma sont aussi fatigués que rebutants.
Moi, le pur « entertainment » à l’américaine, cette farcissure qui vous boulotte les boyaux de la tête façon hamburger, merci, très peu pour moi. J’ai assez donné. Et le fait que « les séries », amerloques ou autres, aient acquis une existence autonome, pour être parfois érigées en œuvres véritables, me laisse halluciné.
On voudrait visser les gens devant leur télé 24/24, 7/7 qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Pire : il m’épastrouille que des foules innombrables se pressent pour en acquérir les coffrets de DVD bien complets de toutes leurs « saisons », pour se les repasser quand elles sont au chaud et à l'abri.
En observant ce phénomène, j’entends un seul message (voix suave d'hôtesse d'aéroport) : « Cessez de vivre votre vie, laissez ce soin à l'armée des scénaristes qui vont vous la raconter bien mieux que vous ne ferez jamais en existant vous-même dans la réalité, vous ne serez jamais aussi pleins, jamais aussi intenses, car vous êtes pauvres et vides ». Se passionner pour les séries américaines, c'est accepter de dormir sa vie. En payant pour ça.
Ça me rappelle une histoire dessinée par le grand Gébé : l’histoire d’un type dont on filme la vie de sa naissance à ses quarante ans et qui, à son quarantième anniversaire, s’enferme pour toujours dans une salle de projection pour se repasser, pendant les quarante ans qui lui restent à vivre, le film de ce qu’il a été, accompli, vécu jusqu’au moment où il a décidé de se regarder vivre. C’était de longues années avant The Truman show (1997), l’assez bon (ne soyons pas chien) film de Peter Weir.
Guy Debord a réalisé quelques films. Le plus célèbre (si l’on peut dire) s’intitule In girum imus nocte et consumimur igni (« nous marchons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu »), titre qui, comme on le sait, constitue un intéressant palindrome, pour une fois plein de sens, pas comme l’énorme palindrome écrit par Georges Perec, simple tour de force dans un jeu de langage : virtuose et desséché. Quand il devient une pure combinatoire, le langage a perdu son humanité.

LE COFFRET DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES COMPLETES DE GUY DEBORD
Les films de Guy Debord ne sont pas des films. Je veux dire qu’ils ne sont pas faits pour être vus par des spectateurs. Je veux dire des spectateurs normaux, qui attendent douillettement qu’on leur raconte une histoire, comme on fait aux enfants pour les endormir le soir. Les films de Guy Debord sont des manifestes politiques.
Car Guy Debord s'en prend précisément à la substitution généralisée des images à la vraie vie, vous savez, celle qui se construit dans la confrontation à des réalités et non à des artefacts. Or l'artefact (le « spectacle », dit pour aller vite) est devenu le monde. Les films de Guy Debord sont des applications radicales de La Société du spectacle, livre de haute densité et de haute teneur en alcool intellectuel, où l’auteur déshabille jusqu’à l’os le système dans lequel l’époque nous fait vivre.
Adieu au langage, le dernier film de Jean-Luc Godard, emprunte à Debord quelques « trucs » de cinéma (genre « cartons », écran noir, nombreux cuts de la bande-son …). Mais ce que Godard injecte dans son film, j’ai d’abord l’impression que c’est TOUT le manifeste de La Société du spectacle. De Debord, Godard reprend, à température de fusion, la radicalité. A cet égard, Adieu au langage est un film horriblement méchant. Et, à cet égard, incompréhensible de la plupart.
Comme l’écriture de Céline dans Mort à crédit, ce film est un défi au spectateur : « T’es pas cap de rester dans la salle jusqu’au bout », qu’il dit, Godard (je cite d'inspiration). L’autre Godard, Henri, celui qui parle de Céline, en est convaincu : l’écrivain Céline fait tout pour repousser le lecteur tout en se débrouillant pour qu'il ne puisse pas le lâcher. Eh bien, de même, Jean-Luc Godard, le cinéaste, fait ici tout ce qu’il faut pour se faire haïr de celui qui regarde, tout en le rivant à son fauteuil pendant 70 minutes : à ce point de densité, pas besoin de faire long.
Adieu au langage, si vous en êtes resté au linéaire du récit à la papa, c’est d’abord que vous n’êtes pas « moderne » : James Joyce, Claude Simon, William Burroughs et quelques autres ont arpenté et balisé le chemin dès longtemps en littérature. Ensuite, c'est que le film n’est pas pour vous. Il flanque mal au cœur à ceux qui ont l’estomac fragile. Il met les yeux à l’épreuve, avec un usage bizarre de la 3D, bizarre en ce qu’il n’est pas constant. Il met à l’épreuve la comprenette, qui essaie de saisir un fil conducteur, s’il existe.
S’il y a une ligne narrative, Godard s’est débrouillé pour nous la livrer hachée menu. C’est d’ailleurs rigolo comme les choses se présentent : je viens de lire le dernier Henri Godard (A Travers Céline, la littérature), puis le dernier Kundera (La Fête de l’insignifiance), et j’enchaîne sur le dernier opus du Suisse (Adieu au langage).
Céline réduisait ses phrases en miettes bourrées de points d’exclamation et de suspension. Le récit de Kundera repose sur une logique apparemment foutraque. Quant à Godard, il juxtapose (on parle de montage) des images pour pulvériser la notion d’enchaînement. Dans ces trois cas de cinglés, il faut s’accrocher.

Mais trêve de considérations oiseuses. Adieu au langage ne nous raconte pas une histoire, il nous dit quelque chose, et ce n’est pas réjouissant. Il nous parle en effet du monde tel qu’il est, du monde en morceaux, tel qu’il va mal, tel qu’il dégoûte, jusqu’à l’écœurement et l’envie de vomir, les individus lucides, au nombre desquels regrette d'avoir à se compter Jean-Luc Godard. Adieu au langage colle littéralement à la réalité du monde d'aujourd'hui, puisqu'il se présente comme une continuité pulvérisée.
Vouloir être lucide aujourd’hui, c’est accepter de voir que l’humanité s'achemine vers sa perte. Mais ne pas vouloir pour autant s'en laisser transformer en statue de glace.
Heureusement, on peut encore fermer régulièrement toutes les écoutilles. Se faire du bien. Célébrer la beauté des femmes. Boire une bouteille de Chusclan 2011. Se plonger dans la lecture de Nostromo. Se réjouir entre amis. Rouvrir Les Fleurs du Mal, Les Amours jaunes... Déclarer son amour. Des trucs qui n'ont rien à voir avec la marche du monde. Exister, quoi.
Et puis retourner voir Adieu au langage. Excellent programme.
Voilà ce que je dis, moi.

