dimanche, 18 janvier 2026
VOUS AVEZ DIT "VASSAUX" ???
J'ai lu ou entendu plusieurs ravis de la crèche (je veux parler de gens a priori très informés qui exercent des responsabilités plus ou moins lourdes) déclarer — parfois avec des trémolos — que l'Europe doit veiller, face aux divers revirements et rodomontades caractériels du président Trump et aux nouvelles menaces géo-stratégiques qui pèsent sur le monde en général et sur l'Europe en particulier, à ne pas se laisser "vassaliser" par les Etats-Unis.
Je le dis sans ambages : tous ces gens intelligents, puissants et bardés de diplômes ou de fric sont de purs pignoufs de bazar qui racontent des salades ou qui n'ont rien compris parce que ça les arrange. La vérité, c'est que la France, tout comme l'ancienne Europe de l'Ouest et l'actuelle "Communauté" européenne (qui a de moins en moins d'existence, soit dit en passant), constitue le ban et l'arrière-ban du "Grand Suzerain Américain".
Mais oui, enfin ! Une fois pour toutes, l'Europe est depuis longtemps la vassale de la puissante Amérique !!! On nous dit que le célébrissime "Plan Marshall" a sauvé l'Europe des griffes communistes. C'est probablement vrai. Mais il faudrait, chaque fois que la chose est évoquée, préciser que cette aide massive et magistrale était accordée de façon conditionnelle !
Quelles étaient ces conditions ? Eh bien tout simplement, l'Europe, pour remercier le bienfaiteur américain, était — libéralement mais avec une force irrésistible de persuasion — invitée en échange à dépenser aux Etats-Unis les sommes faramineuses que les Etats-Unis lui avaient si généreusement procurées. Et les pays européens ne s'en sont pas privés, en important à qui mieux mieux un tas invraisemblable de choses très concrètes (toutes sortes de machines domestiques conçues et fabriquées pour "libérer la femme" et lui permettre de tomber dans le servage professionnel). Et la France, vieille patrie agricole de la civilisation européenne, a fait de l'agriculture française une usine entièrement mécanisée, remembrée (ah, Edgar Pisani) et finalement rentable. Eh ben, c'est ça qui compte, non ?
Mais rassurez-vous : les choses concrètes n'étaient pas toutes seules. Car les Américains, en matière de "way of life", avaient inventé, avec l'aide considérable de la morale protestante, une interminable procession d'images plaisantes, de sons nouveaux et entraînants, d'objectifs, de principes et de valeurs immatériels hautement désirables, en un mot : tout un idéal de vie, le point ultime du bonheur possible. Le serf, le vilain, et même le hobereau européens avaient un nouveau but, qu'ils pouvaient conquérir à force de travail, de mérite, mais par-dessus tout à force d'acceptation aveugle de ce modèle indépassable.
C'est ainsi que la civilisation européenne tout entière s'est mise à la remorque d'un mode de vie que cinq planètes Terre suffiraient à peine à satisfaire. Tout ce qui était proprement français est devenu franchouillard en un tournemain, voué à s'effacer derrière Sa Majesté le Progrès. Régis Debray, dans son livre Civilisation (Gallimard, 2017), actait de façon lumineuse et probante « comment nous sommes devenus américains » (sous-titre).
De son côté, Jean-Pierre Le Goff, en racontant dans le détail le quotidien de la France dans laquelle il a grandi de 1950 à 1968 (La France d'hier, Stock, 2018), dessinait les traits d'un pays que la plupart des Français d'aujourd'hui qualifieraient d'épouvantablement ringarde, obsolète, rétrograde, quasi-archéologique. Il est vrai que Jean-Marie Colombani, au lendemain du 11 septembre 2001, les avait précédés, dans un éditorial resté célèbre : « Nous sommes tous américains ».
Bref, la vassalisation n'est plus en cours de réalisation, elle est acquise depuis longtemps. Le Grand Remplacement redouté par Renaud Camus et ses coreligionnaires a déjà un lieu. La cause est entendue. Ce n'est pas pour rien qu'on entend encore régulièrement dans les médias entonner les refrains selon lesquels « la France est en retard » (une marotte de journalistes) ou « des avancées qui mettront dix ans à traverser l'Atlantique ».
L’anti-américanisme était considéré comme une injure disqualifiante, et les velléités de résistance de De Gaulle à toutes sortes de pression américanophiles n’eurent guère de suite. Et je ne parle pas de l’enthousiasme aveugle des pays européens pour ce qu’ils prenaient pour le « Parapluie Américain ». En fait de parapluie, la guerre froide a installé dans presque tous les pays européens, à l'exception notable de la France (merci Charlot !), dans le confort trompeur d'une sécurité purement promise, mais surtout les a entraînés dans la spirale d'un désarmement militaire qui se révèle aujourd'hui catastrophique. Il n'y a pas à tortiller de l'arrière-train en se gargarisant de notre grandeur passée : en matière de défense, ce sont les Américains qui détiennent les clés du coffre de la sécurité européenne.
Que reste-t-il aujourd'hui de proprement FRANÇAIS en France, cette France vassalisée depuis lurette, cette France dont le destin ne lui appartient plus ? Même la langue que nous parlons s'est travestie, au point que j'ai l'impression ici d'écrire une langue comprise par une minorité vieillissante et promise à la disparition.
11:54 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, politique, europe, états-unis, vassalisation, france vassale, communauté européenne, europe de l'ouest, plan marshall, union soviétique, communisme, american way of life, régis debray, jean-pierre le goff, debray civilisation, éditions gallimard, le goff la france d'hier, éditons stock, 11 septembre 2001, jean-marie colombani, nous sommes tous américains, grand remplacement, renaud camus, journalistes
vendredi, 18 décembre 2020
MODIANO, L'ETERNEL RETOUR
Manifeste de la Littérature Évasive.
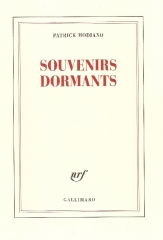 Aujourd'hui 16 décembre 2020, je viens de lire Souvenirs dormants, de Patrick Modiano (Gallimard, 2017). Bon, vous allez penser que je ne suis pas pressé, et vous aurez raison. D'autant plus que ça fait exactement un an jour pour jour (16 décembre 2019) que j'ai acheté le bouquin (2€) au rayon "livres" de la "grande surface" des Sans Abri du quartier de Vaise (on trouve ça rue Berjon). C'est donc à l'occasion de son premier anniversaire sur mes rayons que j'ai lu ce Modiano-là.
Aujourd'hui 16 décembre 2020, je viens de lire Souvenirs dormants, de Patrick Modiano (Gallimard, 2017). Bon, vous allez penser que je ne suis pas pressé, et vous aurez raison. D'autant plus que ça fait exactement un an jour pour jour (16 décembre 2019) que j'ai acheté le bouquin (2€) au rayon "livres" de la "grande surface" des Sans Abri du quartier de Vaise (on trouve ça rue Berjon). C'est donc à l'occasion de son premier anniversaire sur mes rayons que j'ai lu ce Modiano-là.
Je ne vais pas trop m'appesantir sur l'analyse, voire le résumé de Souvenirs dormants. D'abord, peut-on résumer semblable récit, fait de morceaux, de fragments et de pièces de puzzle ? Quoi qu'il en soit, mon commentaire est d'ores et déjà plus copieux que celui par lequel j'avais littéralement "expédié" Encre sympathique lors de sa parution. J'avoue avoir été un peu brutal. Mon avis n'a cependant pas radicalement changé : entre le "je-ne-sais-quoi" et le "presque-rien" que l'auteur apporte sur la table de son lecteur, mon cœur a cessé de balancer, je reste sur ma faim.
Ce roman (mais est-ce un roman ?) ressemble à ce qu’on a appelé « Nouvelle Cuisine » dans les années 1980 : trois haricots liés en botte, quatre dés de viande, deux crottes de purées de légumes, quelques traînées de vinaigre balsamique et de faux safran. On sortait de table avec l’envie de se taper un bon « jambon-beurre » à la première boulangerie du coin.
J'ai cessé de recourir au plan de Paris pour y retracer les errances du narrateur au gré des hôtels, des mansardes et des restaurants. Souvenirs dormants, dans ses tout juste 100 pages écrites, nous livre le nom des artères par charrettes entières, tout en se permettant quelques excursions en Haute-Savoie, au sujet d'un collège où l'on ne le verra jamais, et en particulier sur le plateau d'Assy, à cause d'une certaine Irène qu'on ne rencontrera jamais. La mémoire défaillante, le réel qui n'y subsiste que par bribes, si cela peut faire système, constituent le domaine où ne cesse de se mouvoir Modiano, avec la maladresse de l'albatros atterri par erreur sur le pont d'un navire inhospitalier.
D'ailleurs les verra-t-on vraiment, les autres personnages ? A peine quelques silhouettes entrevues au fond de l'ombre du soir dans une brume épaisse. Ces quelques pages sont jalonnées de plusieurs noms de femmes : par ordre d'apparition et sans compter Irène, déjà nommée, Mireille Ourousov, Geneviève Dalame, Madeleine Péraud et Madame Hubersen qui a peur de rentrer chez elle le soir à cause de sa collection de masques d'Afrique et d'Océanie, et qui préfère entraîner le narrateur, un peu contre son gré mais, jusqu'à Versailles où il n'a rien à faire.
On ose à peine dire que Geneviève Dalame sert de fil conducteur, tant ses évocations sont offertes en pointillé, et au total on saura fort peu de choses de la dame, que le narrateur retrouve donc de temps en temps, après des intervalles de plusieurs années (de six à vingt). On apprendra quand même en cours de route qu'elle a vécu un temps dans un immeuble cossu avec son petit garçon. A peine rencontre-t-on le frère de Geneviève : venu des Vosges, cet homme louche a fait un peu de prison et porte un blouson fatigué doublé de faux léopard.
Tout le récit (rien n'indique que ce soit un "roman") semble répugner à l'action : à peine un coup de poing dans le visage d'un ami du frère déjà évoqué pour échapper à on ne sait quel traquenard. Le reste baigne comme à l'accoutumée dans la ouate de déplacements plus ou moins erratiques, cotonneux et sans but. Ah si, une autre "action" : une fille appelle au secours le narrateur, parce qu’elle a tué un certain Ludo F., de trois coups de revolver partis tout seuls. On ne saura rien des données du problème : le revolver et son étui en daim finiront au fond d'une poubelle, et la police, en dehors du mort, n'identifiera aucun acteur de l'affaire.
« Il m’a demandé "ce que je faisais dans la vie" et je lui ai répondu de manière évasive » (p.24). « Mais à cette époque, j’avais la certitude qu’elle ne me répondrait pas ou bien que ses réponses seraient évasives » (p.54). Je me demande si Patrick Modiano n’a pas inventé la « littérature évasive ». C’est sûrement un choix, et mûrement réfléchi. Mais cette culture acharnée du fuyant finit par ressembler à un tic (ou à un T.O.C. : Trouble Obsessionnel Compulsif). Sérieusement, je me demande si le rétrécissement de l'inspiration de l'écrivain autour de ses quelques "fondamentaux" n'en réduit pas par là-même la portée.
Le problème posé par ce genre de littérature, c’est qu’elle risque de ne pas laisser plus de traces dans la mémoire du lecteur que le nuage n’en laisse dans le ciel.
Voilà ce que je dis, moi.
Note ajoutée le 19 décembre :
Je suis impardonnable : je n'ai pas mentionné un détail en apparence dérisoire, mais qui a son importance néanmoins. On trouve dans Souvenirs dormants ce passage : « Mais, en sortant de l'immeuble, je ne voyais plus vraiment la raison d'être triste. Pour quelques mois encore ou, qui sait ?, quelques années, malgré la fuite du temps et les disparitions successives des gens et des choses, il y avait un point fixe : Geneviève Dalame. Pierre. Rue de Quatrefages. Au numéro 5. » (p.56-57). J'ai souligné "rue de Quatrefages", parce que l'expression m'a sauté au visage. D'abord parce que c'est la rue où emménagent Jérôme et Sylvie dans le roman très connu Les Choses de Georges Perec, qui leur attribue le n°7, sans doute par pur goût du "clinamen" : « Ils trouvèrent à louer, au numéro 7 de la rue de Quatrefages, en face de la Mosquée, tout près du Jardin des Plantes, un petit appartement de deux pièces qui donnait sur un joli jardin » (Julliard, 1965). Ensuite parce que Georges Perec, en compagnie de Paulette, la femme qui partageait alors sa vie, acheta en 1960 un petit appartement dans la même rue : « Le numéro 5 de la rue de Quatrefages était une adresse idéale » (David Bellos, Georges Perec, une vie dans les mots, Seuil, 1994, p.251 : admirable biographie de l'auteur). Je doute fort que le hasard soit pour quelque chose dans ce détail du livre de Modiano.
Dernier point, mais c'est vraiment pour chinoiser : on lit page 94 de Souvenirs dormants : « Un jour, j'ai eu l'intuition que cette cause datait d'avant ma naissance et que le remords s'était propagé le long d'un cordon Bickford ». Ou je dis une bêtise, ou le "cordon Bickford" appartient à la catégorie non des "mèches", mais des "cordons détonants" : la mèche ne se consume pas progressivement, mais provoque illico l'explosion à la distance de cordon déroulée.
jeudi, 18 juin 2020
L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 3
 Qui est « L’Absente » ?
Qui est « L’Absente » ?
L’iris de Suse, cette fleur qui n’est pas une fleur mais un os improbable dans le squelette d’un improbable rongeur ("rat d'Amérique"), n’est pas la seule énigme que pose ce grand [le dernier] livre de Jean Giono. Les commentateurs se disputent aussi au sujet du personnage de « l’Absente » et de sa "signification" profonde dans l’ordonnancement du roman. Je dis tout de suite que je n'apporte aucune réponse à ce genre de question. Mon propos est seulement de replonger dans ce roman pour mettre un peu d'ordre dans mes impressions de lecture, une lecture longuement réitérée.
Tringlot, le bandit en fuite, croise le chemin de l'Absente à la page 100 de l’édition "blanche" de Gallimard : « Il suivait un petit chemin entre des haies quand, à un détour, il se trouva en face d’une femme. Elle était au milieu du chemin, debout, immobile, le regard lointain. Tringlot la salua. Elle ne répondit pas ; elle ne manifesta même pas qu’elle le voyait ; or, Tringlot fut obligé de la contourner pour passer et de la frôler (le chemin était étroit). Elle était jeune et jolie ». Voilà, les présentations sont faites. Le lecteur ne saura rien des traits de son visage, rien de sa taille, rien de sa silhouette et presque rien de sa tenue vestimentaire. Pire : dépourvue de nom et de prénom, elle n'a pas d'identité. Elle est quelqu'un en négatif si l'on veut. Et pourtant qu'est-ce qu'elle existe !
Une fois revenu à l’alpage, quand Tringlot lui raconte sa rencontre avec l’Absente, Louiset le met au courant de toute l’histoire, de l’origine jusqu’à l’incroyable et grandiose mariage avec Murataure sous les auspices de la baronne : « Tout le monde connaissait l’Absente ; c’est la nièce des Curnier. Ils ont un bistrot à la croisée des chemins, au-dessous de Châteauneuf. Cette nièce, orpheline, totalement absente, dans les nuages, on a cru longtemps qu’elle était muette. "Non, avait dit le docteur, elle n’est pas sourde ; elle a même l’ouïe fine, donc elle doit parler." On a tout essayé. On lui a tiré peut-être trois paroles, c’est le bout du monde. Elle n’est pas sur terre ; totalement absente de tout, de la France et de l’étranger » (p.102). Ajoutons que sa vie au bistrot ne fut pas drôle et qu’elle y a subi toutes sortes d’avanies, jusqu’à être vendue à un rémouleur qui l’a « retournée » à ses parents bistrotiers : « Inutilisable, a-t-il dit, verrouillée. A la bonne vôtre, mes enfants.[…] Macache bono, c’est en tôle » (p.102). Bref, elle en a vu des vertes et des pas mûres.
Et voilà que le beau Murataure, petit frère d’Anaïs, cette armoire à glace qui tient la forge familiale, Murataure qui possède la seule automobile de la vallée, voilà qu’il se met dans l’idée d’épouser l’Absente ! Il faut dire que la baronne le fait tourner en bourrique. Il a cru que "ça y était" quand elle a déclaré en public, juste après la mort de son mari, qu’elle voulait danser avec lui et personne d'autre. Elle a embauché le piston de Laugier (qu'on devait entendre dans toute la vallée) et valsé toute la nuit comme une furieuse avec le forgeron pour mieux, à partir de ce jour, lui rabattre son caquet chaque fois qu’il s’approchait d’elle la bouche en cœur. Elle s'y entend, cette femme de « trois sous de poivre », pour faire marcher son monde.
Ne comprenant rien à ce revirement brutal, Murataure finit par décider d’épouser l’Absente. Mais contre toute attente, la baronne applaudit l’idée, remuant même ciel et terre pour donner à la noce le lustre et la magnificence qu’elle mérite. Cela ne saurait mettre un terme à l’incompréhensible passion qui dévorera en fin de compte, après la chute de mille mètres de l’automobile, le couple improbable de la baronne et du forgeron. Casagrande pense qu’ « elle ne cherchait qu’une porte de sortie » (p.227) : « Nous enterrerons comme il se doit ce petit chapeau et sa plume, pour sa crânerie. Nous allons lui faire un cercueil à sa convenance ; il recevra l’eau bénite de toutes les églises et il ira dormir dans le caveau de famille. Il l’a bien mérité » (p.224). Une toque et sa plume : ça vous a tout de suite une autre gueule que "L’Enterrement d’une feuille morte", non ? Une belle farce au nez du monde, d'Anaïs Murataure, du corps ecclésiastique.
L’Absente se retrouve donc veuve, sans avoir jamais été « touchée » par son mari. Heureusement, Tringlot veille. Depuis sa première rencontre, il n’a pas cessé de penser à elle. Je dirai qu’il ne pouvait en être autrement, car si l’Absente a fui le monde social normal, lui aussi est engagé dans un drôle de parcours de fuite. Ayant quitté la bande en emportant le magot, sa première préoccupation est bien concrète : échapper à la poursuite dans laquelle se sont lancés le "Cachou" et les "Clefs" pour récupérer l’énorme butin. Et dans un premier temps, se joindre à la transhumance emmenée par Louiset lui paraît une excellente opportunité à saisir pour s’évanouir dans la nature.
C’est ce qu’il pense quand, après avoir modifié complètement son apparence vestimentaire, il reçoit le chapeau promis par Louiset : « (Il tira un chapeau de sa musette.) Je te donne ce que je t’avais promis. Et attention : c’est un vétéran ; il m’a déjà fait cinq campagnes.
Le chapeau était parfait. « Je suis en train de disparaître, se dit Tringlot (il tâta sa barbe au menton) comme un morceau de sucre dans du café bouillant. La mort attrape d’abord ceux qui courent ; je ne cours plus ; je traîne les pieds. Je vais peut-être à trois à l’heure, sous mon chapeau et ma barbe, et sous la corporation (qui m’aurait dit que je conduirais des moutons ?) caché sous la montagne » (p.48). Si l’on peut dire, en cherchant à "disparaître", Tringlot se met aux abonnés absents. C’est dès le départ qu’il cherche à s’absenter. Sans même avoir croisé le chemin de la femme ainsi nommée, il voudrait bien se changer en « Absent ». Giono note : « Il tenait à l’invisibilité » (p.194). Ils sont quasiment faits l’un pour l’autre. C’est un destin. C’est une hypothèse.
Alexandre, qui se fait casser la gueule à chaque passage à Mons, a « une sorte de mazurka dans le crâne ». Le « Cachou » et les « Clefs » ? « La mazurka dans le crâne, zéro pour la question. Et zéro pour la montagne. S’ils voyaient un truc comme ça (dans lequel je suis en plein comme un poisson dans l’eau) ah ! là là, ça leur foutrait les foies ! Je comptais aller loin, mais ici, c’est autre chose que loin, c’est ailleurs » (p.49). Voilà exactement où ils se retrouvent : l’Absente est « ailleurs » ? Eh bien lui aussi.
Ce qui est fascinant, dans L’Iris de Suse, c’est que tous les personnages principaux sont voués au cheminement. Louiset, malade, achèvera son parcours de vivant. Casagrande quittera la vallée définitivement. Alexandre enlèvera enfin la nonne de ses amours au couvent des Présentines. La baronne et son Murataure finiront en beauté dans le précipice et le brasier de la voiture. Tringlot, lui, achève un parcours d’accomplissement en trouvant enfin son point fixe (paradoxal) en la personne de l’Absente, qui n’a ni consistance ni apparence, mais qui acquiert, du fait de son Absence même, une présence incomparable. [Commentaire : mais où va-t-il chercher tout ça ?]
On arrive à une scène curieuse, proche du dénouement, dans laquelle il semble se décider à prendre sa décision finale. Cela se passe à l’église de Villard. Suivant la baronne à l’intérieur, il tombe sur une petite "réunion" de celle-ci avec Anaïs Murataure en présence de l’Absente. Après un manège de comédie où intervient la chaisière (« maquerelle de sacristie ») : « Tringlot passa un moment de bonheur parfait. (…) seule, l’Absente apparaissait hors du commun et hors d’atteinte » (p.202).
Casagrande, que Tringlot retrouve ensuite, ne saura rien de tout ça, mais le bandit, une fois au lit bien au chaud (« Tout de suite il s’écarquilla dans la chaleur ») cogite longuement autour de cette femme qui l’obsède. Il imagine toutes sortes de scénarios autour des différentes manières dont se présente son avenir. Il craint pour elle les « moqueries » et autres « regards sales », voire pire, qu’elle soit une « proie » : « Elle ne comprendrait pas, elle souffrirait, sans raccroc, comme une épave » (p.203).
Il la voit tour à tour se perdre dans la nature, se faire abandonner par son mari (ce qui arrive bientôt après, d'ailleurs), mourir de faim ou tout simplement vieillir (après tout, il est possible qu’il ne se passe rien d’embêtant), etc. Et cet étrange et long monologue, où Tringlot se met à la place de l'Absente dans toutes les situations possibles, se conclut encore plus étrangement : « A moins que … puisqu’on est en train de tout admettre, elle restera peut-être la dernière, seule, riche, assiégée, toujours Absente. Alors il faudrait être là, à côté d’elle (il faudra) et la tuer, gentiment » (p.206). Alors ça, je suis dépassé. Qu’en tirent les commentateurs ?
C’est peut-être Casagrande qui devine le fin mot : « Elle va surtout gêner le bonheur général, répondit Casagrande. Tous ces bourgeois de Calais que vous avez vus en grand uniforme, au garde-à-vous, et le petit doigt sur la couture du pantalon répétaient depuis longtemps un tableau vivant. Ils viennent de le présenter enfin devant le public et ils ont reçu le premier prix de composition. Comment voulez-vous qu’ils puissent tolérer désormais, dans leur troupe, quelqu’un qui ne compose absolument pas et qui ne composera jamais ? Pour le moment, Anaïs se roule dans la farine, mais attendons (…) » (p.226-7). L'Absente ne compose pas, elle ne joue aucun rôle : elle EST elle-même, un bloc à prendre ou à laisser. Les autres ne le supporteront pas.
Soit dit en passant, c’est à se demander si Giono, en élaborant le personnage de l’Absente, ne s’est pas souvenu de Bartleby, cette inoubliable création d’Herman Melville, humain à la limite de l’humain et qui finit par mourir de son attitude extrême. Mais l’Absente ne se donne même pas la peine de son lancinant et fascinant refrain : « I would prefer not to » (on n'oublie pas que Giono a écrit un Pour Saluer Melville). Elle est plus intransigeante, elle ne peut pas faire autrement. L'Absente est une Totalité.
Toute cette expérience étalée sur de nombreux mois amène Tringlot à changer radicalement d’existence : il se convertit à l’Absente. Et il met dans la balance tous les arguments sonnants et trébuchants qu’il traîne comme des casseroles : à Villard, il tremble encore quand il croit voir dans la foule le « borsalino violine » qui fait que « son cœur cogna contre ses côtes ». La décision qu’il prend le débarrassera de ses poursuivants : il va s’éloigner de la vallée en train, mais de telle manière qu’une araignée dans sa toile n’y retrouverait ni ses petits ni ses mouches.
Il emprunte toutes les plus petites lignes pour s’éloigner de son nouveau point d'ancrage et arriver au « bout du monde » après avoir suivi un itinéraire inextricable. Une fois à Notre-Dame-du-Bec (Seine-Maritime), il écrit à ses anciens « parrains » (M. Victor et M. Gaston) une lettre identique par laquelle il leur restitue ce butin tiré de tant de larcins criminels, en leur décrivant dans le moindre détail la manipulation qui leur rendra le trésor.
L’extraordinaire de L’Iris de Suse est presque tout entier (pour moi) dans la répétition de deux toutes petites phrases prononcées par Tringlot : « Je suis comblé. Maintenant j’ai tout » (pp.156 et 244). La première fois qu’il dit ça, Tringlot vient en effet de réussir à ouvrir la cachette au trésor fabuleux qui dort dans les entrailles de « La Sambuque », derrière la troisième marche avant le palier (c’est l’histoire du « joint exquis »), un soir de bourrasque qui étouffe tous les bruits intempestifs qui risqueraient de le faire prendre. Et la deuxième fois qu’il les prononce, il est enfin arrivé à bon port, à sa destination finale, prêt à défendre l’Absente contre toutes les avanies possibles. Il est en sécurité, et il peut enfin penser à protéger l’objet de son désir sans autres arrière-pensées.
Jamais, je crois (Balzac ? quoique), je n’ai lu un roman où les personnages principaux apparaissent dans une épaisseur vibrante qui les fait aussi puissamment exister dans l’esprit du lecteur, alors même que l'auteur dédaigne de les décrire, que ce soit par le physique ou par la psychologie : en dehors des moments où Tringlot se repasse le film de sa vie de brigandage (mais ce sont après tout des monologues intérieurs), les personnages de L'Iris de Suse sont tout de parole et d'action. De présence, et quelle !
Voilà ce que je dis, moi.
On peut trouver mes précédents billets sur le livre au 2 juin et au 5 juin.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, tringlot, l'absenterat d'amérique
vendredi, 05 juin 2020
L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 2
2
L’Iris de Suse, qu’est-ce que c’est ?
La réponse à cette question figure pages 212-213 de l’édition « Blanche » de Gallimard du livre de Jean Giono qui porte ce titre. Casagrande, un jour où il profite de son séjour en alpage (il vient examiner et soigner Louiset) pour herboriser dans la montagne, il rapporte dans sa poche un drôle de petit rongeur avec lequel il a, dit-il, « conclu un pacte » (p.138), bien qu’il échoue à l’identifier (ça ressemble à une gerboise, mais seulement à première vue – moi, j'ai vu une gerbille au col Agnel, Queyras).
La grande marotte de Casagrande, dans sa solitude du château de Quelte, c’est la reconstitution minutieuse de squelettes d’animaux. Oiseaux de jour ou de nuit (dont monsieur Hiou, le hibou centenaire du grenier), mammifères carnassiers ou non, tout y passe. Il lie les os, du plus gros au plus minuscule, au moyen de « fil d’archal » (laiton). Il a appelé « rat d’Amérique » le petit rongeur de la montagne, et ça l’occupe beaucoup : « Casagrande s’obstina des jours et des jours, le nez baissé sur le rat d’Amérique ».
Mais, de même que Giono lui-même, qui semble se mettre humblement à l'écoute de ce que ses personnages ont à dire, je préfère laisser carrément la parole à Casagrande (« Je parle beaucoup. J'aime parler », dit-il p.134), même si l’auteur ne s'absente pas complètement, tant le passage entier semble porter l’espèce de clé qui ouvre l’espèce de serrure qui permet d'entrevoir ce qu'il y a derrière la porte secrète du livre :
« On peut dire que je l’ai aimé ce petit animal unique en son genre ; et je lui convenais. Il fourrait son museau sous mon aisselle comme dans sa tanière. Ses petites dents, je les ai toutes dans une enveloppe de carte de visite. Oh ! certains de ses os étaient encore plus minuscules, notamment les tarses et les métatarses. Il me les confiait gentiment ; je les faisais rouler sous mes doigts ; je les comptais. A un moment, j’ai même cru qu’il n’avait que six osselets à la patte antérieure droite, eh bien ! non, tout décortiqué maintenant, je sais qu’il en avait sept ; le septième était un peu érodé ou aplati, c’est pourquoi je ne le sentais pas à la palpation. Non, il est bien complet, ou, plutôt, dans quelques jours, quand je l’aurai remonté, il sera complet. Il était dodu comme une caille. Je lui offrais des noisettes, même carrément du lard. J’ai été obligé de faire fondre toute sa graisse, de la réduire à petit feu, enfin de la passer à l’étamine. J’avais peur de perdre le plus petit de ses os imperceptibles. Tenez : qu’est-ce que c’est celui-là ? Il faut le regarder à la loupe. Ah ! c’est l’os qu’on appelle l’Iris de Suse, en grec : Teleios, ce qui veut dire : "celui qui met la dernière main à tout ce qui s’accomplit", une expression heureuse qu’on ne saurait rendre que par une périphrase. Regardez-moi ça ! Une périphrase ? Et il n’est pas plus gros qu’un grain de sel. Ça sert à quoi ? Mystère, on ne l’a jamais su ; ça ne sert à rien ; en principe sa nécessité nous échappe, dit-on. En tout cas il existe : le voilà au bout de ma pince. Je vais le placer où il doit être, comme l’a voulu Dieu-le-Père, un très vieux Dieu, vieux comme les rues. Voilà, il est caché derrière le maxillaire supérieur. On ne le voit pas, on ne le soupçonne pas, on ne le soupçonnera jamais mais, s’il n’y était pas, il ne serait pas complet. Je ne le sentirais pas complet.
Ce petit salaud, je l’ai cajolé à l’extrême, il peut le dire ! Sa peau ? Je l’ai tournée et retournée comme un gant. Sa chair ? Je l’ai détachée pièce à pièce, jusque dans tous les contours osseux. Ses articulations ? J’aurais pu me servir de ses tendons en guise de fil d’archal. J’ai été attentif à tout, absolument tout. On ne peut rien me reprocher ; mieux : je ne peux rien me reprocher. Ses os ont été lavés et relavés, poncés, huilés, séchés et maintenant reconstruits. Il est devenu un résumé clair et précis ; comme je vous le disais : une sorte de Grande Ourse, d’étoile polaire ».
Pardon pour la longueur, mais je crois que ça valait la peine. Je me demande si le mot important qui organise tout le passage n’est pas « résumé ». Je me rappelle ce passage de Un Roi sans divertissement où Giono prend un détour pour décrire la curieuse relation qui s'est établie entre les gens du village et le capitaine : tout le village, faute de pouvoir exprimer son amitié au capitaine Langlois (29 février en cliquant) trop distant, a reporté sur le cheval de celui-ci sa recherche d'un peu de familiarité : un passage qui sert en quelque sorte de résumé allégorique à ce qui ne peut être exprimé trop directement.
Même chose ici, me semble-t-il, quoiqu’avec une portée « métaphysique » supérieure, quelque chose qui n’est « pas plus gros qu’un grain de sel », et qui ne vise rien de moins que « l’étoile polaire ». C’est au moins aussi ambitieux que Des Canyons aux étoiles d’Olivier Messiaen, ou que « du brin d’herbe au cosmos sans lâcher le fil » de Gébé (L’An 01, p.41). Pensez, un squelette de rien du tout, "unique en son genre", qui met dans le même sac infinitésimal l’infiniment petit et l’infiniment grand, grâce à un os improbable blotti derrière le maxillaire supérieur et dont personne ne sait à quoi il sert, même un mathématicien de la trempe de Cédric Villani n’y comprendrait goutte. Voilà ce que c’est, un « résumé clair et précis ». Et maintenant circulez, nous dit Giono.
Un résumé de quoi, se demandera-t-on ? Casagrande se prend-il pour Dieu ? L’Iris de Suse est-il une métaphore de Dieu ? Le poids de l'impondérable ? La mesure de l'incommensurable ? Le débat fait rage et les interprétations prolifèrent. Visiblement, l'énigme chatouille les imaginaires. D’autant que Jean Giono s'amuse à inventer des voies de garage, affirmant par exemple dans le "prière d’insérer" (et non une "préface", comme le dit Monique Saigal dans une revue savante) de l’édition originale que ce n’est pas une fleur, mais « un crochet de lapis-lazuli qui fermait les portes de bronze du palais d’Artaxerxès ». Mais malgré ce que dit Giono au lecteur pour mieux le fourvoyer, on sait que l’Iris de Suse est une vraie fleur, dûment répertoriée, comme on le voit, par exemple ci-dessous, sur le blog d’Olivier Ricomini (merci à J.-J. Faivre pour le tuyau et au père Ricomini pour l'image).
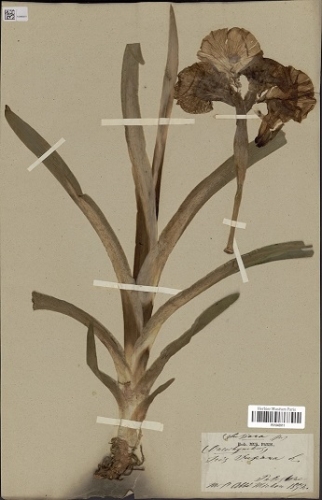
Iris Susiana, collecté par l'abbé Michon en Palestine en 1852, coll. du Muséum National d'Histoire Naturelle.
J’imagine que les mânes de Jean Giono – qui était rusé – se frottent les mains en ricanant, ravies du tour pendable qu'elles ont joué à la postérité, en particulier aux intellectuels qui continuent à se pencher avec gravité sur la question, et à disséquer le problème en hochant et se grattant la tête, à coups de théorie du zéro et autres abstractions oiseuses (voir, entre autres, la notice Pléiade écrite par madame Luce Ricatte, pp. 1020 à 1052 – 32 pages en tous petits caractères : il faut digérer – du vol. VI ; j'ai aussi vu un truc pas triste sur un site "French Review", ou quelque chose d'approchant : je préfère oublier).
S'il y a des abstractions dans l'œuvre de Jean Giono, elles sont diantrement vivantes : il n'est pas un abstracteur. Et ce sont ces "Absentes"-là qui me ravissent, à cause des vibrations.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, casagrande, éditions gallimard, grande ourse, olivier messiaen, des canyons aux étoiles, gébé, l'an 01, cédric villani, imfiniment grand, infiniment petit, mathématiques, olivier ricomini, iris susiana, mnhn, muséum national d'histoire naturelle, j.j. faivre, monique saigal, french review
samedi, 29 février 2020
UN ROI SANS DIVERTISSEMENT
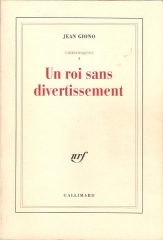 UN PORTRAIT DU CAPITAINE LANGLOIS ?
UN PORTRAIT DU CAPITAINE LANGLOIS ?
Je viens de relire, une fois de plus (je n’ai pas compté combien), Un Roi sans divertissement, de Jean Giono (Gallimard, 1947). Ce roman fait partie de mes rares élus de prédilection dans lesquels je me replonge régulièrement. J’ignore pour quelle obscure raison. Peut-être est-ce parce qu’il se dégage du capitaine Langlois, la figure de proue de l’intrigue, des traînées d’interrogations puissantes, alimentées par la langue fruitée, charnue, pleine d’ellipses et de surprises artistement façonnée par l’auteur. Une langue qui, par-dessus le marché, effleure un essentiel obscur, une sorte de bloc de granit, qu’elle fait pressentir avec une certaine volupté sensorielle, mais qu’elle laisse pour finir absolument impénétrable.
Je crois précisément que l’incroyable force du livre tient à ce qu’il est en soi une question sans réponse. Giono prend un malin plaisir à n’apporter aucun élément qui permettrait au lecteur de se faire une idée, même approximative, de ce qui meut le personnage principal. Les personnages vivent, parlent, agissent fortement, mais jamais l’auteur n’ouvre la porte au lecteur sur leur vie intérieure, sur leur « psychologie », comme s’il n’en savait pas davantage que celui-ci sur les motivations profondes et qu’il ne faisait que lui rapporter ce qu’il a vu ou ce qu’on lui a dit.
Je souhaite d’ailleurs bien du plaisir à ceux qui se hasarderaient à donner à ce personnage et à ce roman une signification précise. Par exemple, j’ignore sur quels éléments du livre le rédacteur de la notice du Nouveau Dictionnaire des Œuvres (Bouquins-Laffont) s’appuie pour déclarer : « Langlois est un homme supérieur qui s’ennuie de façon existentielle ». Dans Les Récits de la demi-brigade (relire La Belle hôtesse), Langlois n’est pas davantage un homme supérieur que dans Un Roi … Il est un militaire, un gendarme, un homme d’action, je veux dire un homme dont l’existence est faite des actions concrètes qu’il est en mesure d’accomplir pour, en obéissant aux ordres, conserver en l’état l’ordre du monde et mettre fin aux méfaits des malfaisants qui le narguent. Même s’il sait en toute conscience qu’il y a des désordres auxquels un capitaine de gendarmerie ne saurait mettre fin (cf. Noël, dans Les Récits …).
S’il finit par se faire sauter le caisson à coups de dynamite, est-ce, comme dit le même commentateur : « pour ne pas céder à la tentation de tuer – en particulier de tuer Delphine » ? Est-ce parce que, lorsqu’il a fait part de sa décision de se marier à la tenancière du café du village : « par jalousie, la vieille Saucisse, connaisseuse », lui a procuré une femme pas assez ardente ? Ce monsieur en sait plus que moi. Était-ce vraiment une femme, même ardente, qu'il aurait fallu à Langlois ? Je n'en sais rien.
Ce qui est sûr, c’est que le capitaine (puis commandant) Langlois, après avoir réglé deux affaires énormes de façon expéditive et spectaculaire (M. V. et le grand loup, même topo : deux coups de pistolet en plein dedans : « Langlois s'avance ; le loup se dresse sur ses pattes. Ils sont face à face à cinq pas. Paix !
Le loup regarde le sang du chien sur la neige. Il a l'air aussi endormi que nous.
Langlois lui tira deux coups de pistolets dans le ventre ; des deux mains ; en même temps.
Ainsi donc, tout ça, pour en arriver encore une fois à ces deux coups de pistolet tirés à la diable, après un petit conciliabule muet entre l'expéditeur et l'encaisseur de mort subite ! »), puis démissionné de l’armée pour s’installer dans le village (jamais nommé : Lalley (Isère), selon le Dictionnaire cité plus haut), ne sait plus vers quel horizon diriger ses pas. Il a éliminé le Mal à deux reprises et rétabli la sécurité dans un village attaqué dans son intimité : et maintenant, quoi ? Le « bongalove » ? Le labyrinthe ? Delphine ? Le cigare du soir au bout du jardin ? Mystère. J’en reste résolument au point d’interrogation : un grand roman sur l’énigme de la vie humaine. Quelle raison de vivre faut-il se donner ? Il y a de la métaphysique là-dedans.
La question me suffit : elle est en elle-même une réponse. Que dit Jean Giono de son personnage ? « Voilà comment il était. Il ne disait rien. Il ne bronchait pas, il ne regardait rien, il ne faisait pas attention à vous et, d’un mot, il vous faisait comprendre qu’il savait tout. Et il avait ainsi remède à tout » (p.211 de la collection « blanche » de Gallimard).
Mais Giono a peut-être laissé des indices de ce qu’il a mis dans Langlois en racontant comment son cheval a conquis une place à part dans la vie du village. Ne sachant pas comment le militaire l’appelait, les habitants ont fini par le surnommer « Langlois ». Un drôle de cheval en vérité. Son portrait commence page 85 de la même édition : « Par contre, on devint très familier avec le cheval ».
« Et comme, d’après ce que je vous ai dit, on n’eut guère l’occasion de manifester cette sympathie à l’homme, on la manifesta au cheval. D’autant que c’était un cheval qui faisait tout pour faciliter les choses ». On peut se reporter, par exemple, au début du récit Angelo, pour se convaincre que Giono et le cheval, c’est une histoire d’amour fondée sur une connaissance mutuelle profonde : « Soudain, par on ne sait quel prestige des jambes (…) il fit que le cheval, accroupi comme un chat, se détendit et s’envola par-dessus la barrière » (Gallimard, coll. Biblos, p.6). Le douanier français en reste éberlué.
« Langlois », tout comme Langlois (sans guillemets), a un caractère indépendant : « C’était un cheval noir et qui savait rire. D’habitude, les chevaux ne savent pas rire et on a toujours l’impression qu’ils vont mordre. Celui-là prévenait d’abord d’un clin d’œil et son rire se formait d’abord dans son œil de façon très incontestable. Si bien que, lorsque le rire gagnait les dents, il n’y avait pas de malentendu. La porte de son écurie était toujours ouverte. Il n’était jamais attaché ».
Et ça continue : « S’il reconnaissait quelqu’un qui lui plaisait plus particulièrement il l’appelait d’un ou deux hennissements très mesurés, semblables à des roucoulements de colombe. Et, si celui-là, alors, levait les yeux et lui disait un mot gentil (ce qui était toujours le cas) le cheval s’approchait de lui à pas aimables, très cocasses, très volontairement cocasses, casseurs de sucre et un peu dansants, pour venir poser la tête sur son épaule ».
Bon je ne vais pas abuser de la citation, je veux juste suggérer que, pour avoir une idée (en creux, en biais, en filigrane) du monde intérieur du capitaine Langlois, on peut lire et relire ces quelques pages formidables (85-89), et surtout le paragraphe qui clôt le passage : « Il [le cheval] n’avait qu’un défaut : il était sévère avec les bêtes. Il ne riait jamais, il ne roucoulait pas, ni à un autre cheval ni à une jument. Il ne les regardait même pas. Il les côtoyait, impassible, pour venir vers nous. Il aimait au-dessus de sa condition ». Il aimait au-dessus de sa condition ! Tout est dit : tout Langlois n’est-il pas dans cette phrase ? Dans ce paragraphe ? On peut comparer avec les quelques lignes de la page 211 (« ... il ne regardait rien, il ne faisait pas attention à vous ...») citées plus haut.
Il est possible qu’à la prochaine lecture du roman, mon attention soit attirée par d’autres éléments. Pour cette fois, je m’en tiens à ce personnage du cheval, finalement fugitif, et à cette idée que son portrait n’est pas là par hasard.
Quel roman admirable ! Il faut sans cesse relire.
Voilà ce que je dis, moi.
Note 1 : le prochain dans mon collimateur, c'est L'Iris de Suse (1970), dernier roman de Jean Giono, mon préféré, mon favori, que je considère comme indépassable. C'est sûr, pas de la même trempe : dans l'un, l'histoire d'une rédemption, dans l'autre, une course à l'abîme. Dans l'un, Tringlot le hors-la-loi devient un homme ordinaire (la dernière réplique : « Je suis comblé. Maintenant j'ai tout, se dit-il »). Dans l'autre, Langlois fait le chemin inverse : « On est en contrebande, dit-il. En plus de ça, qu'il me dit, il y a des lois, Frédéric. Les lois de paperasse, je m'en torche, tu le vois, mais les lois humaines, je les respecte » (Un Roi ..., p.76).
Note 2 : la chaîne France Culture diffuse en ce moment un feuilleton intitulé Un Roi sans divertissement (10 épisodes). Je ne suis pas allé écouter ce que ça donnait. Ici le premier épisode.
Note 3 : ci-dessous, un fragment de la carte Michelin n°77 : on est dans le sud de l'Isère, tout près de la Drôme et des Hautes-Alpes, non loin du Vercors et du Grand Veymont. C'est là que tout se passe.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, un roi sans divertissement, éditions gallimard, capitaine langlois, giono les récits de la demi-brigade, robert laffont nouveau dictionnaire des oeuvres, la belle hôtesse, l'iris de suse
vendredi, 28 février 2020
GÉRARD PHILIPE ET JÉRÔME GARCIN
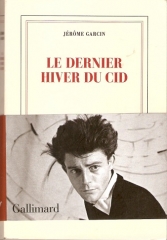 Je viens de lire Le Dernier hiver du Cid, de Jérôme Garcin (Gallimard, 2019). Le journaliste, en écrivant ce livre en hommage au célébrissime acteur Gérard Philipe (mort avant son trente-septième anniversaire) accomplit visiblement un devoir. Mais c’est autant devant la gloire du comédien qu’il s’incline que devant le souvenir de la dépouille du père de son épouse, Anne-Marie, née Philipe, qui avait presque cinq ans à la mort de celui-ci.
Je viens de lire Le Dernier hiver du Cid, de Jérôme Garcin (Gallimard, 2019). Le journaliste, en écrivant ce livre en hommage au célébrissime acteur Gérard Philipe (mort avant son trente-septième anniversaire) accomplit visiblement un devoir. Mais c’est autant devant la gloire du comédien qu’il s’incline que devant le souvenir de la dépouille du père de son épouse, Anne-Marie, née Philipe, qui avait presque cinq ans à la mort de celui-ci.
L’auteur, en vingt-neuf courts chapitres, choisit de raconter les tout derniers temps de l’existence de Gérard Philipe. Disons-le d’entrée : ce livre m’a souvent agacé. D'abord, pourquoi le titre parle-t-il d’ « hiver » ? Gérard Philipe est mort le 25 novembre 1959, c’est-à-dire au cours de l’automne.
Pour moi, c’est une coquetterie, de même que l'usage du mot « Cid » : Jérôme Garcin – et c’est tout à fait intentionnel et systématique – opère tout au long du livre un amalgame permanent entre la personne (Gérard le fils, le mari, le père, l'ami, ...), bouillonnante, exaltée, infatigable, et les personnages (le Prince de Hombourg, Perdican, Ripois, Fanfan la Tulipe ...) que l’acteur a fait vivre sur les scènes de théâtre et sur les écrans de cinéma, à commencer par le plus illustre : Rodrigue.
Pour dire quel acteur exceptionnel il était, le cinéaste Christian-Jaque dit drôlement : « Il jouait si bien que même le cheval croyait qu'il savait monter » (p.16, à propos de Fanfan). Il n'est donc pas question de contester le génie théâtral.
Mais pour ce qui est du livre, le fait que l'acteur a été enterré vêtu du lourd costume qu’il portait dans Le Cid de Corneille n'est pas une raison suffisante pour se permettre de fondre l'homme dans ses rôles. Certes, bien qu’il ait joué des dizaines de rôles au cinéma, au théâtre ou au disque, c’est indéniable, pour toute une génération (et plus d’une), le Cid n'eut pas d'autre visage que celui de Gérard Philipe. Garcin n’est donc pas le seul à identifier personne et personnage. Mais est-ce une raison pour écrire : « Perdican aime suer et se salir dans le mortier et la poussière blanche des gravats » (p.27) ; « Vilar parti, Perdican s’endort » (p.143) ? Qu’est-ce qui lui prend, ailleurs, d’écrire « le Cid va se coucher » (je n'ai pas retrouvé le passage) ? Je me permets de trouver le procédé un peu niais.
Cette volonté de tisser ensemble l’homme et la fonction est certes un choix, mais discutable. Pour moi, c’est plutôt une mauvaise idée qu’un hommage. Il y a là une confusion qui m’a heurté à la lecture. Bon, je relativise en me disant que c'est précisément ce que bien d’autres trouveront formidable. J’ai également été agacé par quelques facéties d’écriture, qui m’apparaissent moins comme des clins d’œil que comme des grimaces : « les tournées, les tournages, le tournis » (p.178) ; « il vogue sur une Méditerranée amniotique » (p.89).
Ailleurs, il parle de « fourbures » (p.87), mot qui appartient au vocabulaire vétérinaire, ce qui n’est pas gentil pour les adultes et les enfants dont il est question : « C’est, pense-t-elle, la vertu des maladies, elles métamorphosent les adultes triomphants en enfants tremblants, dont les mamans font disparaître, avec de longues caresses sur le front chaud, la fièvre, les fourbures, et l’apeurement ». C’est ici l’amateur de cheval qui parle : « Congestion et inflammation du pied des ongulés » (Larousse).
Et il ne peut pas s’empêcher d’oser un zeugma carrément insoutenable de grotesque (« il sourit sous cape et sous son drap blanc » (p.95), sans doute venu de la diarrhée de zeugmas qui a encombré un temps son émission Le Masque et la plume. Enfin, où a-t-il pêché que les poilus étaient équipés d’une "gibecière" : « passés directement du collège à la tranchée, troquant le cartable contre la gibecière » (p.70) ? Bon, plus grand monde ne sait aujourd’hui ce que fut la « giberne » des soldats, mais ce n’est pas une raison : ça reste très bête.
Alors, ce livre, finalement ? Je dirai juste que, en dehors de quelques pages réellement sensibles autour de l’agonie et de la mort du grand comédien, Le Dernier hiver du Cid est un livre dispensable et futile. Je vois surtout à l'œuvre l'insupportable dolorisme larmoyant imposé par l'air du temps, ainsi que la traque inlassable des émotions et affects des lecteurs, ces pestes qui infestent notre époque.
La splendeur intacte de Gérard Philipe n'avait nul besoin de la besogne faussement votive de Jérôme Garcin (né en 1956), même au prétexte qu'il est son gendre post mortem. Jérôme Garcin est un bon journaliste, c'est du moins la rumeur qui court. Est-il un écrivain ? C'est selon moi beaucoup moins sûr.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, gérard philipe, anne philipe, théâtre, le masque et la plume, garcin le dernier hiver du cid, france inter, zeugma, figures de style, éditions gallimard, corneille le cid, rodrigue et chimène, littérature française
jeudi, 04 juillet 2019
OÙ C'EST, LA « FRANCE » ?


Je veux juste, dans ce petit billet, présenter brièvement deux ouvrages parus en 2017 et 2018, dont le face-à-face m’a paru tout à fait instructif dans la France d’aujourd’hui.
J’avais du mal à dire quoi que ce soit, séparément, de ces deux livres que j’avais lus à peu de distance, Jean-Pierre Le Goff signant un récit autobiographique pour dresser un portrait sociologique de La France du 20ème siècle de 1950 jusqu’à 1968 (Stock, 2018), alors que dans Civilisation (Gallimard, 2017), Régis Debray montre, de façon tout à fait convaincante (il s'appuie sur un maximum de faits concrets), comment les Américains, en gagnant la guerre contre Hitler en 1945, ont certes sauvé l’Europe de l’ouest, mais pour en faire une colonie en même temps qu'un marché lucratif et un glacis protecteur contre l'URSS.
Debray aurait pu ajouter en marge que la stratégie « bloc-contre-bloc » a produit le même résultat en Europe de l’est sous la coupe de la dite URSS : car, si le « Pacte de Varsovie » n’a disparu que parce que la « maison-mère » s’est effondrée, le principe était le même. On observe d’ailleurs que plusieurs ex-pays de l’est ont encore du mal à monter franchement dans le train lancé par l’Union européenne, et qu’ils gardent un pied en dehors sur nombre de sujets.
J'avais donc du mal à considérer chaque livre en lui-même, et puis un jour, je me suis dit qu'en fait, ils parlaient de la même chose. Effectivement, La France d’hier et Civilisation se complètent à peu près parfaitement, même si leurs perspectives ne sont pas du tout les mêmes. Ils nous montrent les deux faces de la même médaille : pendant que Jean-Pierre Le Goff, nous raconte par le menu ce qui fut sa vie quotidienne en France, « Récit d’un monde adolescent. Des années 1950 à Mai 68 » (sous-titre de son livre), Régis Debray décrit avec précision le processus qui a fait de la France une sorte de protectorat américain (sous-titre : « Comment nous sommes devenus américains »).
Sur l’avers, une France d’autrefois qui vous a de ces airs obsolètes, vieillots, ringards et arriérés que ça fait pitié ; sur le revers, la France qui l’a remplacée, une France pimpante, dynamique et "moderne" qui, disons-le avec l’auteur, n’est plus la France : une France américanisée en largeur et en profondeur. Et cette France-là sera toujours EN RETARD aux yeux des adorateurs de l'horizon américain.
Dans la France qui ne se raconte pas d’histoires, même pour rire, aucun « village peuplé d’irréductibles Gaulois » ne « résiste encore et toujours à l’envahisseur ». Sur le territoire français réel, toutes les localités ressemblent au village de Sérum, dont le chef Aplusbégalix, une grosse brute qui fait penser aux "collabos" d'une certaine époque, est fier d’adopter les coutumes du colonisateur (dans Le Combat des chefs). Demandez-vous pourquoi Macron, se plaint d'un peuple de "Gaulois réfractaires" : plus vite il aura fini de nous américaniser, plus il sera content. Macron rêve de 67.000.000 d'Aplusbégalix.

Un Gaulois qui n'est ni "irréductible", ni "réfractaire". Le geste du bras droit est peut-être romain, mais pas que.
Le portrait par Goscinny des Gaulois « irréductibles, courageux, teigneux, têtus, ripailleurs, batailleurs et rigolards » est d’une veulerie complaisante et commerciale. Même si beaucoup de Français adorent, quand ils sont accoudés au bar, déclarer comme Obélix : « Ils sont fous ces Romains » (c’est l’ « anti-américanisme » dont certains Français accusent d’autres Français pour les faire taire), la réalité prouve à chaque instant que la France évoquée par Jean-Pierre Le Goff a été balayée par l’irrésistible vent venu d’outre-Atlantique, dont parle Régis Debray.
Je suis d’autant plus sensible au travail de Jean-Pierre Le Goff que la vie quotidienne qu’il raconte est exactement la même que la mienne, à quelques détails près : né en 1947, famille pauvre, son père était pêcheur dans le Cotentin, excellent élève, etc. Pas le même CV, mais des points de repère globalement si semblables qu’à certains moments de ma lecture, j’avais l’impression qu’il me racontait ma vie. Drôle d’impression en vérité.
Et je suis d’autant plus sensible à la lecture historique opérée par Régis Debray que ça fait très longtemps que j’en ai ras le bol de me faire traiter d’ « anti-américain » dès que je commence à émettre quelques critiques sur l'écrasant « abus de position dominante » exercé par les Etats-Unis pour éjecter les anciennes spécificités de la France (produits, culture, vision du monde, …) et les remplacer par du « made in USA ».
Renaud Camus, un "pestiféré" chez les bonnes âmes, a peut-être raison de parler de « Grand Remplacement » en parlant des Maghrébins et Africains. Mais pourquoi ne parle-t-il pas de l'autre « Grand Remplacement » ? Celui qui l'a beaucoup plus lourdement précédé, avec l'adhésion enthousiaste des Français ? Pourquoi ne montre-t-il pas que ce qui faisait l'identité spécifique de la France a laissé la place à quelque chose de nouveau, une « France américaine » qui n'a plus grand-chose à voir ?
Architecture et urbanisme, façons de se nourrir (Mc Donald), musiques (jazz, rock, country, rap, ...), innovations technologiques, visibilité des « minorités », industrialisation de l'agriculture, cinéma (western, polar, dessin animé, ...), etc. : qu'est-ce qui, dans le pays actuel, n'est pas importé plus ou moins directement des Etats-Unis ? On entend très régulièrement des journalistes fascinés évoquer une "innovation" née sur le territoire américain, et annoncer sans honte son débarquement prochain en France.
Il s’agit en fait d’un composé impur dans lequel on trouve, certes, quelques îlots de résistance (lutte contre le franglais, patriotisme économique ou idéologique, drapeau, souverainisme, … : un vrai « village gaulois », ma parole !), mais nageant au milieu d’un océan d’emprunts, voire de plagiats, surfant sur la vague d’un grégarisme servile, et dont Régis Debray dresse la liste interminable sur un ton fataliste de vieux sage résigné (« Il faut subir ce qu’on ne peut empêcher », lit-on dans une nouvelle de Jorge Luis Borgès). L’étiquette France est toujours collée sur la bouteille, mais la piquette vient de Californie (oui, je sais, mais qui les a aidés à faire des vins buvables ?).
La tonalité des deux ouvrages est à peu près la même : Le Goff et Debray font, chacun de son côté, un constat, coloré d’une fleur nostalgique chez le premier, d'un paquet de regrets impuissants chez le second. Le Goff nous peint, dans une foule de détails concrets, une foule de façons de vivre qui apparaissent de nos jours essentiellement ringardes (= archaïques, arriérées, démodées, dépassées, obsolètes, périmées, rétrogrades, vieillottes, …) : une France dans laquelle le passé et la tradition jouaient encore leur rôle de forces agissantes.
Debray, de son côté, nous met sous le nez tout ce qui, dans notre vie quotidienne, nous semble absolument naturel et français d’origine, alors même que cela porte la marque du vainqueur de 1945, et nous rappelle les faits et les dates qui, avant même la deuxième guerre mondiale, auraient pu apparaître comme des signes annonciateurs de la future mutation. Par exemple, il signale que la reconnaissance de la suzeraineté américaine sur l'industrie de la photo et du cinéma date de 1925 et 1926 (p.86).
Deux livres qui, en proposant deux aperçus totalement différents, nous disent à peu près la même chose : il n'y a plus grand-chose de spécifiquement "français" dans la France d’aujourd’hui. Et ça vous étonne, vous, qu'il faille être facho pour être patriote et se réclamer du drapeau tricolore ? Et ça vous étonne, vous, qu'il faille aimer le football pour avoir envie de chanter la Marseillaise ? (ajouté le 6 juillet)
Voilà ce que je dis, moi.
09:02 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre le goff, la france d'hier, régis debray, debray civilisation, éditions stock, éditions gallimard, amérique, usa, urss, états-unis d'amérique, europe, deuxième guerre mondiale, pacte de varsovie, europe de l'est, guerre froide, union européenne, anti-américanisme, astérix le gaulois, goscinny et uderzo, astérix le combat des chefs, irréductibles gaulois, emmanuel macron, france, société, sociologie
mercredi, 19 juin 2019
ROMAIN GARY : CHARGE D'ÂME
 Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.
Je viens de lire un livre de Romain Gary, dont les « romans et récits » viennent d’entrer dans la Pléiade. Celui-ci n’y a pas été repris, peut-être avec raison. Le roman s’intitule Charge d’âme (Gallimard, 1977). Drôle de livre, en vérité, qui veillait sur un rayon oublié de ma bibliothèque. Honnêtement, je ne sais pas comment il est arrivé là. Je l’ai ouvert un peu par hasard. Drôle de livre : j’hésite entre la leçon, la fable et la farce. L’argument, si on le prend au pied de la lettre, est proprement abracadabrant, avec un petit air de démonstration didactique au début.
Marc Mathieu est la quintessence du physicien d’envergure einsteinienne, et il est reconnu comme tel par ses pairs : il passe son temps à chercher, et il trouve tellement qu’il constitue à lui tout seul la pointe avancée de toute la physique mondiale, l’explorateur ultime des confins du possible. Toute l’équipe du laboratoire où il travaille (le Cercle Erasme) est guidée par le « mot d’ordre » de Mao Tsé Toung : « L’énergie spirituelle doit être transformée en énergie matérielle » (p.39).
Marc Mathieu, ainsi que ses collaborateurs, prend cette phrase au pied de la lettre. Et bien que le savant ait un peu de mépris pour son collègue Chavez ("profiteur, exploiteur, applicateur" et un peu épais), c'est bien lui, Mathieu, malgré qu'il en ait, qui fera de ses recherches une réalité concrète, sur la base de : « ce qui peut être réalisé doit être réalisé » (p.133), où l'on reconnaît la philosophie intraitable de Günther Anders dans L'Obsolescence de l'homme. Déjà, page 60 : « On pouvait, à présent, et donc on devait aller plus loin » (Günther Anders : « –, on considère ce qui est possible comme absolument obligatoire, ce qui peut être fait comme devant absolument être fait », Editions Fario, p.17). La recherche fondamentale, la recherche pure ne travaille pas dans des abstractions définitives, et débouche toujours sur le monde réel, pour le meilleur et pour le pire. Jamais, dans toute l'histoire humaine, une grande découverte n'a été utilisée seulement pour le Bien : Satan est le complément nécessaire de Dieu.
Ici, il s’agit très concrètement de récupérer le souffle (« l’âme ») des gens au moment où ils meurent pour en faire le carburant révolutionnaire (« carburant avancé ») des moteurs et des machines. C’est d’ailleurs ce qui arrive à Albert, le chauffeur du laboratoire qui, en mourant, vient alimenter, grâce à un dispositif spécial, le moteur de la voiture de fonction. Le pauvre Albert le fait d’abord à contrecœur (le moteur hoquette), puis il s’y fait, et le moteur tourne rond. Malheureusement, le dispositif n'est en mesure de capter les "âmes" que dans un rayon de soixante-quinze mètres.
Marc Mathieu est français, quoique guère patriote : tout le fruit de ses découvertes, il le transmet aussitôt aux Américains et aux Russes, alors en pleine guerre froide. Toutes sortes de services secrets gravitent autour de lui en permanence, à l’affût de la moindre velléité de choisir un camp plutôt qu’un autre. Certains de ses collègues ne l'aiment pas, tel le cynique Kaplan : « C'est le genre de démagogue qui passe son temps à protester contre les conséquences de ses propres découvertes » (p.236).
Mais un collègue de Mathieu était porteur de la même idée : « Valenti, quant à lui, se laissait aller à un désespoir lyrique et passait ses journées, comme la plupart des savants, à signer des manifestes de protestation contre les conséquences pratiques de ses propres découvertes » (p.91). Message adressé à l'hypocrisie des optimistes qui pensent, contre toute raison, que "la technique est neutre, tout dépend de l'utilisation qui en est faite". Je pense au mot de Bossuet : « Dieu méprise les hommes qui méprisent les effets dont ils chérissent les causes ».
Marc Mathieu vit en compagnie d’une femme, May, qui le comble physiquement, précisément parce que, pense-t-il, elle est restée une créature primitive, presque animale, incapable d’accéder aux sphères intellectuelles les plus subtiles, où il se meut quant à lui, avec aisance : « Mathieu s’était dit mille fois que s’il trouvait un jour une femme incapable de le comprendre, ils pourraient être vraiment heureux ensemble. Le bonheur à deux exige une qualité très rare d’ignorance, d’incompréhension réciproque, pour que l’image merveilleuse que chacun avait inventée de l’autre demeure intacte, comme aux premiers instants » (p.62). Sans même évoquer l’idée de l’amour, Gary en fournit une condition éblouissante, qui fait penser, quoique sur une tout autre toile de fond, aux relations entre les sexes dans l’univers houellebecquien.
Au début de l’action, Marc Mathieu est sur la piste d’une énergie totalement nouvelle, de loin plus puissante et infiniment moins coûteuse que l’énergie nucléaire, dont il pressent qu’elle pourrait fournir l’arme absolue, une arme aux dimensions et aux effets quasi-divins, en même temps qu’une source d’énergie quasi-gratuite : l’âme des hommes.
Pour le moment, il bute sur une difficulté qui empêche de rendre la chose opérante : « Sur le tableau noir, les formules couraient dans tous les sens, mais c’était de l’art pour l’art, une pure jouissance esthétique. Elles ne menaient nulle part, n’ouvraient aucun chemin dans les terres vierges. Le souffle demeurait invisible. Le "craquage", c’est-à-dire la désintégration contrôlée indispensable à l’exploitation rationnelle, continuait à se dérober. La maudite unité refusait de se soumettre. Une sorte d’irréductibilité première, absolue. Il manquait une idée » (p.112).
Aussitôt que May, par peur ou scrupule, a rendu visite à l’ambassade américaine pour tenir les « alliés » au courant des dernières avancées, le colonel Starr est dépêché auprès du savant pour le sonder, le « conseiller », et s’il le faut, mais à la toute dernière extrémité, le tuer. Starr est un excellent espion, mais il est aussi et d’abord un tueur. Il arrivera à May, à l’occasion, d’aller voir aussi les Russes. On voit que les relations entre la femme et le savant ne sont pas évidentes, mais Marc Mathieu, tout entier absorbé dans la quête de son Graal, est bien au-delà des basses contingences terrestres.
Mais un jour, le colonel Starr vient le voir pour l’avertir que, s’il ne choisit pas à l’instant « le bon camp » (on devine lequel), il prend le risque d’être liquidé : son cerveau est devenu une menace pour l’équilibre mondial. Lui et ses supérieurs en sont convaincus : « Vous êtes parvenu à désintégrer le souffle, professeur ».
Il l’invite donc à continuer ses recherches en Californie, un avion est là qui attend. Le savant ose lui répondre : « A propos, pour votre information personnelle, colonel, j’ai fait mieux que désintégrer l’élément. "J’ai fait un pas au-delà" ». Après cette déclaration énigmatique et menaçante, Marc Mathieu et May disparaissent de la circulation, après avoir échappé à l’explosion d’une bombe, quelque part en Italie (le savant éloigne aussitôt la voiture, de crainte que l'âme de May soit "absorbée"). Où peuvent-ils bien avoir trouvé refuge, se demandent Américains et Russes ?
Leurs satellites-espions ne tardent pas à repérer l’étrange construction et la rapide extension d’une installation industrielle quelque part au nord de Tirana, dans « la vallée des Aigles ». Marc Mathieu a donc offert ses services à Imir Djuma, le terrible dictateur qui règne sur l’Albanie, qui a bien entendu accueilli le savant à bras ouverts. Mathieu a fait ce choix parce que la société albanaise est militarisée, disciplinée et formatée de la façon la plus pure, et que cette pureté est une condition expresse de la réussite de l’entreprise.
Ça n'empêche pas le savant de croiser le Christ, dans une scène de pure loufoquerie (« Evidemment que je vous connais. Avec vous et les autres ... Comment déjà ? Oppenheimer, Fermi, Niels Bohr, Sakharov, Teller ... Avec vous, c'est devenu scientifique. – Quoi ? Qu'est-ce qui est devenu scientifique ? – La Crucifixion. » (p.224-225). Mine de rien, Romain Gary lance une belle charge contre la science. Dans La Fête de l'insignifiance (Gallimard 2014), Milan Kundera place, me semble-t-il, une scène aussi loufoque sous une statue du jardin du Luxembourg, avec l'apparition de Staline et consort.
Ici se met en place un jeu qui relève à la fois de la farce et de la géopolitique. L’auteur trouve le ton qu’il fallait pour nourrir l’échange des dirigeants les plus puissants de la planète (USA, URSS, Chine) : il y a de quoi rire. Mais eux ne rigolent pas : ils décident de mettre en place un commando multinational qui devra, grâce à une machine spéciale à transporter sur place, réduire à néant la menace de disparition totale que fait peser sur la population mondiale la mise en route des installations albanaises.
L’usine a commencé à fonctionner. Les Albanais ont construit à proximité toute une série d’asiles où le pays rassemble tous les vieillards, pour que leur mort ne soit pas inutile à la nation, mais vienne alimenter l’usine en énergie : à l’instant fatidique, un collecteur judicieusement placé transmet l’âme du défunt à l’accumulateur central.
Le récit de l’opération de commando proprement dite est digne du film d’action, mais une fois le but atteint, il part un peu dans tous les sens, et le passage de la frontière avec la Yougoslavie donne tant soit peu dans le baroque. May et Marc Mathieu y trouvent la mort, pour le plus grand bienfait du moteur qui se remet en marche pour mener les survivants en lieu sûr.
Au total, un livre qui se lit avec grand plaisir, mais à coup sûr pas le meilleur de Romain Gary. Peut-être l'argument est-il trop tiré par les cheveux. Prenons-le pour une fable, mais qui n’arrive pas à se prendre assez constamment au sérieux. L'idée centrale tourne autour de l’hybris humaine, cette folie qui consiste à vouloir toujours repousser les limites, au mépris même de toute raison : « Le génie scientifique sonnait le glas de la démocratie, parce que seul le génie pouvait contrôler le génie. Et cela voulait dire que les peuples étaient à la merci d'une élite » (p.264).
La déraison humaine est correctement synthétisée dans cette formule qu’on trouve à la toute fin de la première partie : « Si jamais le monde est détruit, ce sera par un créateur » (p.143). Là, Gary pense peut-être à la bombe H. Charge d'âme est précisément une charge, moins contre la science en elle-même (quoique ...) que contre la sacralité dont la modernité habille la recherche scientifique, et contre les dégâts que son usage inconsidéré risque de commettre : « En quelques minutes, toute la litanie écologique se déversa sur ses lèvres. L'empoisonnement chimique des fleuves, mers et océans, la destruction de la faune, la mort des grandes forêts, des sources d'oxygène, l'élévation de la température du globe par suite de l'activité industrielle, qui menaçait la vie sur terre ...» (p.123). On est en 1977 !!! Franchement, y a-t-il quelque chose à enlever ou à corriger ? Romain Gary, écologiste visionnaire !
Car le message est limpide, quelque chose comme "l’humanité, à force d’outrepasser son humble mesure finira par se détruire elle-même", mais rendu plus ou moins inoffensif par l’ironie qui affleure en bien des points (par exemple dans la discussion entre le président américain et le patron de l'URSS). Romain Gary est-il ici très sérieux ? Au moment de la publication, il n'a plus rien à démontrer (il se suicide trois ans après), et il semble ici se moquer de donner à son roman à thèse la cohérence d'une forme achevée.
Comme si Charge d'âme était un roman testamentaire.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : une coquille marrante page 275 : « ... certains accumulateurs étaient utilisés comme tours de gué ; ... ».
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, romain gary, romain gary charge d'âme, éditions gallimard, collection pléiade, mao tsé toung, michel houellebecq, bombe atomique, écologie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, günther anders, l'obsolescence de l'homme
jeudi, 14 juin 2018
CABU CHEZ PHILIPPE LANÇON
2 CABU CHEZ PHILIPPE LANÇON
« En 2004, après avoir appris sa mort, j'écris sur lui [le batteur de jazz Elvin Jones] une chronique dans Charlie. Cabu se souvient, de son côté, des circonstances où il a vu le batteur, en plein air, au festival de Châteauvallon. Il me le raconte et j'insère son souvenir dans ma chronique : « Soudain l'orage éclate. Il est violent. Les musiciens et le gros du public, tout le monde disparaît comme dans La Symphonie des Adieux ; tout le monde, sauf Jones. Déchaîné, démesuré, battant la mesure d'outre-tombe, le géant aux mains d'acier anime les peaux et les cuivres parmi les éclairs, seul comme un dieu oublié, un dieu oriental aux mille bras. L'orage semble créé pour lui, par lui. Il se fond dedans. Il a cinquante ans, le tonnerre demeure. » C'était en 1977. Vingt-sept ans plus tard, Cabu en fait un dessin qui, posé à côté de ma chronique, lui donne une valeur qu'elle n'a pas, qu'elle n'aurait pas en tout cas sans lui : être "illustré" par Cabu, en partculier sur le jazz, ou plutôt accompagner par écrit l'un de ses dessins, me fait alors rejoindre une adolescence heureuse, celle où je découvrais en même temps que Céline, Cavanna, Coltrane et Cabu. C'est à peu près comme si, écrivant en 1905 un roman se déroulant dans le monde des danseuses, les illustrations du livre étaient faites par Degas.
Si Elvin Jones n'était pas mort, je n'aurais pas écrit cette chronique. Si je n'avais pas écrit cette chronique, Cabu n'aurait pas fait ce dessin. Si Cabu n'avait pas fait ce dessin, je ne me serais pas arrêté pour lui montrer ce matin-là le livre de jazz qui me l'avait rappelé. Si je ne m'étais pas arrêté pour le lui montrer, je serais sorti deux minutes plus tôt et je serais tombé à l'entrée dans l'escalier, j'ai cent fois refait le calcul, sur les deux tueurs. Ils m'auraient sans doute tiré une ou plusieurs balles dans la tête et j'aurais rejoint les autres Palinure, mes compagnons, sur le rivage aux gens cruels et dans le seul enfer existant : celui où l'on ne vit plus.
J'ai posé le livre de jazz sur la table de conférence et j'ai dit à Cabu : "Tiens, je voulais te montrer quelque chose ..." Il m'a fallu un peu de temps pour trouver la photo que je cherchais. Comme j'étais pressé, j'ai pensé que j'aurais dû marquer la page ; mais comment aurais-je pu le faire, puisque je ne savais pas, trente minutes avant, que j'allais la lui montrer. Je ne savais pas s'il serait présent ce jour-là – même s'il ratait rarement la conférence du mercredi : Cabu avait dessiné une infinité de cancres, mais c'était un bon élève.
La photo d'Elvin Jones date de 1964 et s'étale sur les pages 152-153. C'est un gros plan. Il allume une cigarette de la main droite, énorme et fine à la fois, qui tient les deux baguettes en croix. Il porte une élégante chemise à carreaux fins, légèrement ouverte. Les manches ne sont pas relevées. Les yeux clos, il tire sur la cigarette. La moitié du visage, puissant et anguleux, est prise dans le triangle supérieur dessiné par les deux baguettes, comme dans les formes d'un tableau cubiste. La photo a été faite pendant une session d'enregistrement d'un disque de Wayne Shorter, "Night Dreamer". Cabu l'a trouvée aussi belle que moi. J'étais heureux de la lui montrer. Le jazz était au bout du compte ce qui me rapprochait le plus de lui. Quant au livre, il le connaissait déjà. »
Philippe Lançon, Le Lambeau, Gallimard, 2018, pp. 72-74.
Cabu en 2005 sur la chaîne KTO (une petite heure d'entretien simple et sympathique). Note à l'intention de l'intervieweuse : ce n'est pas Isabelle Cabut qui a fondé La Gueule ouverte, madame, c'est le grand Pierre Fournier. En revanche, elle a quelque chose à voir avec la fusion de La Gueule ouverte et Combat non-violent, intervenue au bout d'une vingtaine de numéros de la revue de Fournier, mort après deux ou trois numéros.
Note : Palinure est le pilote de la flotte d’Énée dans l’Énéide.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe lançon, le lambeau philippe lançon, cabu, charlie hebdo, éditions gallimard, jazz, elvin jones, attentat charlie, frères kouachi, cavanna, wayne shorter, pierre fournier, la gueule ouverte, isabelle cabut, combat non-violent
mercredi, 13 juin 2018
PHILIPPE LANÇON : "LE LAMBEAU"
1
Quand la presse s'est mise à parler de Le Lambeau, le livre de Philippe Lançon (Gallimard, 2018), je me suis dit que je ne le lirais pas. J'étais déterminé à ne pas le lire. Impossible pour moi, me disais-je, de me replonger dans le massacre du 7 janvier 2015, qui m'avait laissé dans un état de déshérence tel que j'avais l'impression de vivre en France ce que le 11 septembre 2001 a été pour les Américains. Je savais qu'il avait survécu, mais dans un état difficile à vivre. J'imaginais tout le morbide qui pouvait suinter des pages de son bouquin, et je craignais le pire pour ce qui est du récit.
Et puis un jour j'ai entendu le bonhomme parler à la radio. Et sa façon de raconter et de se raconter a fait que j'ai changé d'avis. Je me suis dit : un gars qui revient de si loin et qui a fait un tel travail sur lui-même mérite mon estime. J'ai acheté le livre. Malheureusement, je suis un très vieux lecteur de Charlie Hebdo, et en tant que tel, je ne peux pas oublier le frisson physique d'horreur qui m'a saisi quand la rumeur, puis l'information exacte, a répandu la stupeur dans tout le pays. J'étais un lecteur ravi d'Hara Kiri Hebdo. J'avais embrayé illico sur la suite quand la guillotine gaulliste avait fait taire cet encombrant trublion qui osait manquer de respect au Général. La première équipe du journal, c'était un peu ma famille d'élection : Cavanna, Choron, Wolinski, Cabu, Reiser, Gébé et toute la compagnie, c'était Byzance ! Le feu d'artifice hebdomadaire. Ce premier Charlie Hebdo, quand il a commencé à devenir une institution, a perdu à la fois sa saveur et ses lecteurs. Et puis l'époque était en train de changer.
Philippe Lançon était le petit jeunot d'une équipe de "vieux" qui ressemblait à ce premier modèle, mais qui avait déjà changé, sous les coups de Philippe Val et de son âme damnée, l'avocat Malka, dans la deuxième mouture de Charlie Hebdo (1992, si je me souviens bien). Le livre de Philippe Lançon est terrible et j'ai beaucoup de mal à avancer dans ma lecture à un rythme normal. Il a fallu que je surmonte un obstacle qui ressemble à l'horreur pour franchir les chapitres 4 ("L'attentat") et 5 ("Entre les morts"). Plusieurs fois, j'ai refermé le livre : non, je ne pouvais pas. Ou alors à très petites doses.
Le chapitre suivant, qui raconte les instants qui suivent le carnage, m'a fait penser à un passage des Croix de bois, lorsque le bataillon est ramené à l'arrière du front après des épreuves qui laissent muet de la même stupeur. Le chef ordonne à ces hommes boueux, en lambeaux et au bout du rouleau de marcher au pas pour la traversée d'un village. Ils se redressent, commencent à frapper le sol du talon en cadence et c'est avec des éclairs de fierté dans le regard qu'ils passent au milieu de la haie formée par les villageois. Et c'est là que ça se passe, car c'est dans le regard de ces villageois que les soldats fourbus mesurent la profondeur de l'enfer dont ils viennent de sortir, lorsque les femmes éclatent en sanglots en murmurant "Les pauvres gars". L'enfer qui sépare les combattants du front du reste des vivants ordinaires.
Lançon ne pensait pas être un combattant du front. Et pourtant. Les deux premiers individus à pénétrer dans la salle de rédaction jonchée de cadavres sont des femmes. D'abord Sigolène, qui aperçoit Philippe Lançon appuyé contre le mur : c'est une "gueule cassée". Ensuite Coco, qui s'en veut à mort parce que c'est elle qui, sous la menace des armes, a ouvert aux tueurs. La réaction des deux femmes est la même : comme les villageoises de 1915, elles pleurent.
Sigolène (Vinson), je me rappelle avoir lu je ne sais plus où le récit de son incroyable face-à-face avec l'un des frères Kouachi, qui finit par l'épargner en criant à l'autre : « On ne tue pas les femmes ! » (c'est trop tard pour Elsa Cayat). Lançon, lui, vient de franchir la frontière qui le sépare désormais des vivants ordinaires : il a sous les yeux la cervelle qui émerge du crâne de Bernard Maris. Il n'est pas mort, mais il n'est plus un vivant comme les autres. Étendu sur un brancard, le blessé entend un "géant" en uniforme s'exclamer en voyant la façon dont il est amoché : « Ça, c'est blessure de guerre ! ».
Oui, monsieur Lançon, votre intervention à la radio m'a convaincu : je lirai jusqu'au bout votre livre terrible, quoi qu'il m'en coûte. Je vous dois bien ça.
Note : j'ai hésité, et j'ai finalement renoncé à inscrire cette note dans la catégorie "Littérature". Je ne sais toujours pas si j'ai bien fait.
lundi, 12 juin 2017
L'EUROPE MISE A LA QUESTION
 La fusion de tous les pays européens en un seul bloc continental unifié est-elle possible ? Il est permis d’en douter fortement. D’abord en jetant un coup d’œil sur l’histoire qui a façonné le continent.
La fusion de tous les pays européens en un seul bloc continental unifié est-elle possible ? Il est permis d’en douter fortement. D’abord en jetant un coup d’œil sur l’histoire qui a façonné le continent.
Au fur et à mesure que j'avance dans la lecture des Mémoires de Saint-Simon, je suis frappé par l’énergie déployée par les souverains (Angleterre, Autriche, France, Etats italiens, Savoie, Lorraine, Espagne, Hollande, …) à se disputer des territoires, des couronnes royales, et même des chapeaux de cardinaux, à rivaliser de puissance et animer des querelles de préséance, je me dis que l’Europe est irréductiblement composée de nations trop nettement individuées pour disparaître dans une instance plus vaste qui les subsumerait toutes et en laquelle chacune pourrait à bon droit se reconnaître.
Et ne parlons pas des affrontements qui ont ensanglanté le continent au cours des deux derniers siècles. Tout ce qui façonne ce qu'il faut bien appeler l'identité des peuples s'appelle l'histoire, et ce n'est pas le trait de plume que voudraient bien tirer sur celle-ci les signataires de tous les traités européens qui peut effacer cette réalité ni changer les peuples à volonté.
En même temps que les différences de langues et de coutumes, ces rivalités, querelles et autres guerres ont accentué tous ce qui forme les traits par lesquels les peuples européens se distinguent les uns des autres (on ne devient soi-même qu’en s’opposant, aux parents, au chef, au prof, aux autres, etc. : penser, c’est dire non, disait le philosophe Alain), produisant autant d’identités nettement marquées, voire irréductibles, donc difficilement fusibles les unes dans les autres.
Et ce n’est pas la lecture de L’Ombre des aïeux, du Serbe Slobodan Selenić (Gallimard, 1999, en 1985 dans la langue originale), qui incitera à croire encore possible l’édification d’une Europe unie. Dans ce remarquable roman, à travers les relations complexes des deux protagonistes, Stevan le Serbe et Elizabeth l’Anglaise (qui se partagent inégalement la narration), l’auteur aborde, parmi une multitude de sujets, l’impossibilité pour les nations d’Europe de perdre une identité en perdant une souveraineté qui bien souvent leur a coûté si cher à conquérir : leur mariage donne naissance à un garçon – Mihajlo pour son père, Michael pour sa mère – qui, pris entre les deux cultures, ne parviendra jamais à trouver un socle assez solide pour fonder son existence et son identité. Il en mourra. L’action se déroule sur plusieurs décennies à partir des années 1920, si l’on excepte les éléments remontant à l’enfance de Stevan.
Le premier dépaysé, dans l’histoire, est Stevan, qui achève à Bristol ses études de droit. Elizabeth lui a littéralement tapé dans l’œil, avec sa grande allure et sa chevelure flamboyante de rousse. Lui est plutôt du genre timide, mais elle ne semble pas effarouchée par ses travaux d’approche. Mieux, sous son aspect tellement « british », fait de réserve et de distance dans la conversation, elle répond à ses avances, au point qu’il ose la demander en mariage, allant même jusqu’à l’amener dans la petite chambre qu’il occupe dans une pension de la ville, pour « faire vraiment connaissance ». Il découvre à cette occasion qu’Elizabeth, sous des dehors froids, cache un tempérament de feu, presque déraisonnable.
Stevan est, par tempérament, un être tant soit peu torturé : élevé seul entre son père Milutin, ancien commerçant cossu, et Nanka, la vieille servante analphabète venue de la Serbie profonde et imprégnée de la tradition populaire, il s’inquiète, à l’occasion de son séjour anglais, de constater qu’il pourrait trahir la culture authentiquement serbe qui lui a été fidèlement transmise, et il s'en sent vaguement coupable.
L'auteur, par son personnage de Stevan, étudie en profondeur ce qui se passe dans l'esprit et dans la personnalité d'un homme confronté à une telle division de son propre moi. Dans son cas particulier, d'ailleurs, ce qui se passe à la longue illustre le poids des atavismes : lancé dans des travaux universitaires qui doivent lui assurer un rayonnement intellectuel, il se laisse peu à peu gagner par la nature lymphatique, et même paresseuse du peuple serbe. Le message est clair : si le processus d'acculturation ne va pas à son terme, le long passé historique et traditionnel reprend le pouvoir.
Car il découvre en Angleterre un peuple imprégné d’une culture radicalement autre, fait de coutumes et de rituels extrêmement codifiés, pour ne pas dire rigides, à l’opposé de ceux, primitifs, voire archaïques, en usage dans le peuple serbe : « Tout à coup, je n’avais plus du tout honte de mon pays inculte, perdu dans l’isolement, encore marqué de traits orientaux ; tout à coup, je découvrais, dans la gravité avec laquelle mon peuple affamé considérait la vie, une noblesse humaine et morale plus élevée que la frivolité douillette de celui qui, autour de moi, prenait, depuis des centaines d’années, son thé "at five o’clock", avait depuis huit siècles ses universités et une famille royale qui, dès le seizième siècle, avait résolu ses conflits dynastiques, à l’opposé de ce qui se faisait chez nous ».
Un soir de réunion du groupe, en évoquant son pays, par provocation, il va jusqu’à raconter le cas du berger Milomilj qui, « par une froide journée de novembre », est pieds nus pour garder son troupeau dans la montagne. Et quand le père et le fils s’étonnent de cela, il répond : « Y’a qu’à attendre un peu, avait répondu Milomilj, jusqu’à ce que la première vache bouse. Alors, c’est le paradis : les pieds dans la bouse chaude, y’a rien de meilleur ; la chaleur te monte jusqu’aux oreilles ». Précisons que l’anecdote se situe aux alentours de 1925. On imagine la stupeur des Anglais, mais aussi le vague mépris qu’ils éprouvent pour un peuple aussi arriéré.
Mais Stevan, au moins, retourne dans son pays une fois terminées ses études, en emmenant Elizabeth, désormais son épouse. Et c’est au tour de celle-ci d’éprouver la cruauté qu’il y a dans une telle transplantation en terre étrangère, à plus forte raison sachant que c’est définitif, et que, entre les deux nations, il ne s’agit pas de petites différences : la Serbie est carrément un autre monde, où apparaissent alors encore les traces très visibles (et souvent misérables) de l’empire ottoman. Et pourtant, elle fait des efforts inouïs pour s’adapter, par exemple en essayant d’apprendre le serbe, sans jamais arriver à le maîtriser totalement. Et puis, avec sa chevelure rousse, comment pourrait-elle passer inaperçue et se fondre dans la masse ?
Le pire, peut-être, est que, avec les meilleures intentions du monde, elle se fait un point d’honneur d’élever son Michael-Mihajlo selon les préceptes qu’elle a elle-même reçus. Pendant les premières années, le jeune garçon laisse entrevoir des aptitudes exceptionnelles, maîtrisant très tôt les deux langues et passant sans heurts de l’une à l’autre, lisant très tôt Shakespeare, enfin bref, montrant tous les caractères de l’enfant docile et surdoué.
Et puis un jour tout change. Les parents, de jour en jour plus effarés, voient leur fils s’éloigner d’eux. Ils constatent que le compréhensible besoin de s’intégrer dans le « groupe des pairs » (comme disent les psychosociologues) amène Mihajlo à délaisser d’abord l’anglais pour le serbe, puis à imposer le respect à son groupe – qui le traite encore d’Anglais – en relevant un défi lancé par les autres (ramener une des pastèques qui flottent en nombre sur le Danube). Pour s’intégrer, il faut choisir, or choisir, c’est éliminer. Mihajlo choisit ses camarades, bien que n'ayant pas trop d'estime pour eux, plus rustauds et rustiques.
Au sortir de la guerre, alors que se livrent les derniers combats contre les Allemands, juste avant que ne s’installe le régime communiste de Tito, Mihajlo rejoint un groupe de partisans, dont il impose la présence à ses parents, au motif qu’ils possèdent une table assez vaste pour confectionner à l'aise les banderoles des manifestations, au grand dam des parquets et tapis, aimablement souillés par les chaussures crottées.
Les relations du jeune homme avec ses parents deviennent tous les jours plus exécrables. Il va jusqu’à se mettre en colère contre sa mère, qui lui a donné les mêmes cheveux rouges qui le distinguent de tous les autres Serbes. Il n’hésite même pas à l’agonir des injures les plus violentes. Que peuvent les pauvres parents face à de telles explosions ?
Un jour, cependant, Stevan, n’en pouvant plus, éclate contre son fils et lui lance : « I wish you were dead » (je voudrais que tu sois mort). Le point de non-retour est dépassé. Mihajlo, sans rien dire, s’engage dans les troupes envoyées sur le front, soit pour échapper à un milieu devenu pour lui haïssable, soit pour exécuter inconsciemment la malédiction de son père. Peut-être les deux. Ce qui devait arriver arrive. Est-ce le père qui a renié son fils ? L’inverse ? Quoi qu’il en soit, la rupture entre les générations est consommée. Le fil de la transmission est cassé.
Inutile de dire que la lecture de ce livre – qui n’est qu’un roman, mais la seule science exacte n’est-elle pas la littérature (c’était Jean Calloud qui l’affirmait) ? – a été une belle occasion pour moi de m’interroger sur l’état actuel des relations entre les pays européens et sur les conséquences de l’entreprise de marche forcée des peuples européens vers « une ténébreuse et profonde unité » (en réalité purement et simplement réduite à la marchandise et à l’argent), qui fait allègrement fi de tout ce qui sépare ou éloigne les unes des autres chacune de ses entités élémentaires.
De tels arrangements mercantiles et de tels dénis de démocratie ne peuvent produire que des Donald Trump.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature serbe, slobodan selenic, selenic l'ombre des aïeux, mémoires de saint-simon, europe, construction européenne, éditions gallimard, donald trump, populisme
lundi, 22 mai 2017
GEORGES PEREC DANS LA PLÉIADE
 A peine apprends-je que Georges Perec entre dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) que voilà le coffret de deux volumes installé sur mes rayons. Et qui plus est accompagné de l’Album de l’année de la collection, consacré à Perec par un de ses plus grands connaisseurs, c’est-à-dire par l'excellent et Lyonnais Claude Burgelin.
A peine apprends-je que Georges Perec entre dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard) que voilà le coffret de deux volumes installé sur mes rayons. Et qui plus est accompagné de l’Album de l’année de la collection, consacré à Perec par un de ses plus grands connaisseurs, c’est-à-dire par l'excellent et Lyonnais Claude Burgelin.
Je ne dis pas "connaisseur" par hasard : non content d’avoir côtoyé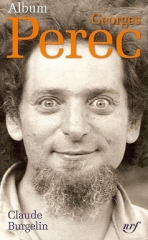 l’homme et l’écrivain, il en a donné, en 1988, une biographie littéraire (Georges Perec, Seuil, coll. Les contemporains). On lit même, dans l’extraordinaire biographie que David Bellos a consacrée à Perec (Seuil, 1994), que Burgelin est compté dans le cercle des « vieux amis de Perec » (p.712). On peut compter sur lui pour faire partager au lecteur la connaissance, précise et chaleureuse, qu’il a de l’homme et de l’écrivain, tant par le choix des documents que par le propos qu’il tient.
l’homme et l’écrivain, il en a donné, en 1988, une biographie littéraire (Georges Perec, Seuil, coll. Les contemporains). On lit même, dans l’extraordinaire biographie que David Bellos a consacrée à Perec (Seuil, 1994), que Burgelin est compté dans le cercle des « vieux amis de Perec » (p.712). On peut compter sur lui pour faire partager au lecteur la connaissance, précise et chaleureuse, qu’il a de l’homme et de l’écrivain, tant par le choix des documents que par le propos qu’il tient.
Les deux volumes (n°623 et 624) sont sobrement présentés sous l’appellation d’ « Œuvres », pour la raison que la diversité des tâches auxquelles s’est livré Perec au cours de sa brève existence (il est mort à quarante-six ans) mettrait la collection de prestige de l’éditeur en infraction à sa vocation presque (il y a quelques exceptions, comme Henri Michaux) exclusivement littéraire. Il a en effet donné des jeux à la revue Ça m’intéresse, des mots croisés, etc.
Et je ne parle pas du – qu’on me pardonne – fatras des publications posthumes : on dirait que, à l’instar des bouts de nappe en papier signées ou griffonnées par Picasso précieusement conservés dans le restaurant, il fallait absolument immortaliser le moindre brimborion qui porte la trace du grand homme. Je ne suis pas sûr qu’il faille absolument ennoblir par la publication ce que Perec lui-même appelait « l’infra-ordinaire », mais bon. Son œuvre proprement littéraire est déjà assez placée sous le signe du disparate qu’il n’y a peut-être pas à vouloir à tout prix inclure dans d’improbables « Œuvres complètes » jusqu’au plus petit souvenir laissé par l’homme, si grand qu’on puisse le considérer.
Personnellement, si je suis touché par W ou le souvenir d’enfance ou Je me Souviens, intéressé par Les Choses, amusé par les performances lexicales de La Disparition ou la désinvolture osée de Les Revenentes, immergé dans la matière océanique de La Vie mode d’emploi, je reste sceptique devant la virtuosité des « onzains hétérogrammatiques », et la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien me laisse indifférent : inventorier les plus minuscules faits (y compris chaque passage de bus) observés depuis le Café de la Mairie ou le Tabac de la place Saint-Sulpice, pourquoi pas, mais sans moi. Même si je passe à côté d'un aspect (l' « infra-ordinaire ») pour lequel Perec lui-même manifestait un grand intérêt.
 Il y a, dans Les Choses (1965), une formidable « enquête de motivation » sur une future néo-bourgeoisie, faite de gens instruits et frustrés, Jérôme et Sylvie, qui participent à la naissance et à l’essor des premières entreprises de sondages d'opinion – si ce sont des « instituts », c’est au même titre que ces endroits qu’on appelle « instituts de beauté » –, goûtent à l’extrême les belles choses qu’ils sont hors d’état de s’offrir (mais à la fin, « ils auront leur canapé Chesterfield »). Ce n'est qu'en 1970 que Jean Baudrillard, philosophe quoique pataphysicien, publie La Société de consommation : il y a déjà quelque temps que la fascination des futures « classes moyennes » pour les objets et pour l'habileté diabolique avec laquelle ils sont vantés (la publicité) fait des ravages.
Il y a, dans Les Choses (1965), une formidable « enquête de motivation » sur une future néo-bourgeoisie, faite de gens instruits et frustrés, Jérôme et Sylvie, qui participent à la naissance et à l’essor des premières entreprises de sondages d'opinion – si ce sont des « instituts », c’est au même titre que ces endroits qu’on appelle « instituts de beauté » –, goûtent à l’extrême les belles choses qu’ils sont hors d’état de s’offrir (mais à la fin, « ils auront leur canapé Chesterfield »). Ce n'est qu'en 1970 que Jean Baudrillard, philosophe quoique pataphysicien, publie La Société de consommation : il y a déjà quelque temps que la fascination des futures « classes moyennes » pour les objets et pour l'habileté diabolique avec laquelle ils sont vantés (la publicité) fait des ravages.
Il y a, dans La Vie Mode d’emploi, les mille et une aventures d’une foule d’individus d’extractions variées, aux trajectoires imprévisibles, plus ou moins rectilignes ou sinusoïdales, et en particulier, en plein centre, la relation si étroite, si distante et si étrange entre le richissime Bartlebooth et Winckler, cet artisan machiavélique qui se vengera d’on ne sait trop quoi en rendant impossible l’achèvement d’un puzzle qui aura raison du cœur du milliardaire. Livre étourdissant et fascinant.
d’extractions variées, aux trajectoires imprévisibles, plus ou moins rectilignes ou sinusoïdales, et en particulier, en plein centre, la relation si étroite, si distante et si étrange entre le richissime Bartlebooth et Winckler, cet artisan machiavélique qui se vengera d’on ne sait trop quoi en rendant impossible l’achèvement d’un puzzle qui aura raison du cœur du milliardaire. Livre étourdissant et fascinant.
 Il y a, dans Je me Souviens, la référence à un monde où je me reconnais en grande partie, un monde qui, pour l’essentiel, fut le mien : question de génération, certainement, mais pas seulement. Roland Brasseur a beau documenter soigneusement (Je me Souviens de Je me Souviens, Le Castor astral, 1998, sous-titré « notes pour Je me souviens de Georges Perec à l’usage des générations oublieuses ») les 479 + 1 souvenirs consignés dans le livre de Georges Perec, qui parmi les jeunes aurait la curiosité d’aller y jeter un œil ?
Il y a, dans Je me Souviens, la référence à un monde où je me reconnais en grande partie, un monde qui, pour l’essentiel, fut le mien : question de génération, certainement, mais pas seulement. Roland Brasseur a beau documenter soigneusement (Je me Souviens de Je me Souviens, Le Castor astral, 1998, sous-titré « notes pour Je me souviens de Georges Perec à l’usage des générations oublieuses ») les 479 + 1 souvenirs consignés dans le livre de Georges Perec, qui parmi les jeunes aurait la curiosité d’aller y jeter un œil ?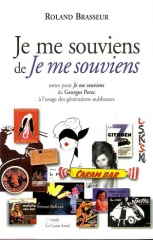
Quand j’ai la curiosité d’ouvrir l’album de famille qui rassemble des photos de gens qui m’ont précédé il y a un siècle et demi, j’ai beau savoir que mon existence a quelque chose à voir avec la leur, ma mémoire n'est ici qu'une page blanche. Si le livre de Perec s’était intitulé Traces pour archéologues à venir, Brasseur aurait été le premier de ces derniers. Et peut-être le dernier.
Quant à W ou le Souvenir d’enfance, il touche le lecteur de façon très indirecte, je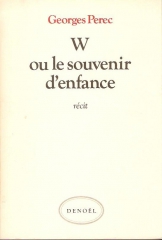 dirai : par l’effet que produit la cohabitation de deux univers « violemment clivés », pour reprendre des termes de Claude Burgelin, l’un désespérément vide pour cause d’absence à sa propre vie (« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »), mais désespérément et patiemment reconstitué, comme fait Bartlebooth (« I would prefer not to », serine le Bartleby de Herman Melville, un autre grand absent) avec les puzzles de Winckler ; l’autre, concentrationnaire et impitoyable, où l’auteur imagine un ailleurs utopique, mais un ailleurs qui a concrètement existé, et dont sa mère n’est pas revenue.
dirai : par l’effet que produit la cohabitation de deux univers « violemment clivés », pour reprendre des termes de Claude Burgelin, l’un désespérément vide pour cause d’absence à sa propre vie (« Je n’ai pas de souvenirs d’enfance »), mais désespérément et patiemment reconstitué, comme fait Bartlebooth (« I would prefer not to », serine le Bartleby de Herman Melville, un autre grand absent) avec les puzzles de Winckler ; l’autre, concentrationnaire et impitoyable, où l’auteur imagine un ailleurs utopique, mais un ailleurs qui a concrètement existé, et dont sa mère n’est pas revenue.
 Pour entrer dans l’univers extraordinairement polymorphe, voire éclaté de l’œuvre créée par Georges Perec, je ne peux cependant que recommander de passer par la biographie de David Bellos (Seuil, sous-titré « une vie dans les mots »). J’en avais parlé ici le 14 février 2016. La lecture de ce monument - un grand roman, pour ainsi dire - avait bouleversé ma perception de l’homme et de l’œuvre, en même temps qu’elle me bouleversait personnellement.
Pour entrer dans l’univers extraordinairement polymorphe, voire éclaté de l’œuvre créée par Georges Perec, je ne peux cependant que recommander de passer par la biographie de David Bellos (Seuil, sous-titré « une vie dans les mots »). J’en avais parlé ici le 14 février 2016. La lecture de ce monument - un grand roman, pour ainsi dire - avait bouleversé ma perception de l’homme et de l’œuvre, en même temps qu’elle me bouleversait personnellement.
Je garderai mes réticences à l’égard de tout ce qu’il y a eu d’expérimental, voire d’excessivement « cérébral » dans les multiples activités du cerveau fertile de l’auteur, mais je ne peux oublier la substance vivante et vibrante dont est constitué l’ensemble de son œuvre.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, littérature française, georges perec, pléiade gallimard, collection de la pléiade, éditions gallimard, éditions du seuil, claude burgelin, perec les choses, w ou le souvenir d'enfance, perec l'infra-ordinaire, perec la disparition, perec les revenentes, tentative d'épuisement d'un lieu parisien, la vie mode d'emploi, perec je me souviens, perec jérôme et sylvie, jean baudrillard, baudrillard la société de consommation, canapé chesterfield, roland brasseur je me souviens de je me souviens, david bellos, bellos georges perec une vie dans les mots, bartleby, i would prefer not to
mercredi, 15 février 2017
C’EST QUOI, UN « GRAND RÉCIT » ?
1/2
Il est devenu de bon ton, chez les politistes, politologues, éditorialistes, journalistes et autres commentateurs, de sommer les hommes politiques de proposer aux Français un « Grand Récit », expression qui ne signifie rien d'autre que leur capacité à leur laisser entrevoir un projet collectif et un objectif à atteindre qui permette de mobiliser et de souder les énergies. De toutes ces bouches savantes, sur le même sujet, tombent d'autres formules stylistiquement aussi choisies et délectables que « vision permettant une reprise en main de l’avenir », ou « horizon d’attente ».
J’aime à la folie les politistes et toute la cohorte des doctes qui s’érigent en « conseillers » (peut-être dans l’espoir de le devenir officiellement contre due rétribution auprès d’un responsable). Comme dit le proverbe : « Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». Tous ces gens qui forment le chœur des pleureuses, en même temps que le distillat ultime de l’inutilité et de l'insignifiance, ne me font même pas rire, parce qu’ils font semblant.
Tous ces gens improductifs (mais parasites médiatiquement omniprésents) font en effet, pour ne pas tuer la poule qui les nourrit (les engraisse), comme s’ils ne savaient pas que le monde tel qu’il est a fini par rendre vain toute espèce de « Grand Récit » possible. Tout juste quelques funambules de la politique proposent-ils de temps en temps un « petit récit » : Montebourg et sa « démondialisation » (ça ne fait pas de mal), Le Pen et sa promesse de « sortir de l’euro » (ça fait mal, car ça frappe l'imagination) et, dernièrement, Hamon et sa désopilante boutade du « revenu universel » (ça en fait rêver quelques-uns). Sûrement quelques autres encore, et sûrement d’une très belle eau.
Le « Grand Récit » à la française est mort et enterré. J’en veux pour preuve, entre autres, le pavé pondu récemment par une équipe de 122 historiens sous la direction de l’historien Patrick Boucheron et sous le titre d’Histoire mondiale de la France (rien de moins !). Après la dilution de l’identité française dans la pâte informe de l’Europe, la dissolution de l’Histoire de France dans l’Histoire du monde.
Même pas besoin de lire le commentaire assassin publié par Alain Finkielkraut dans Le Figaro à l’occasion de la publication pour savoir ce que les historiens en général, et ceux-ci en particulier, font du « Grand Récit » : ils le dépècent, ils l’éviscèrent, ils le mettent en charpie jusqu’à ce qu’il ait rendu l’âme, après avoir commencé par dénoncer ce qu’il peut contenir de « mythique » (« nos ancêtres les Gaulois » étant la cible la plus facile : il fallait les entendre se gausser de Sarkozy quand il a cru pouvoir oser la chose).
Un exemple de mise à mort est offert par le traitement qui a été fait des « récits » qui constituaient la culture des tribus primitives, pardon : des « peuples premiers ». D’innombrables sociétés humaines se désignaient en effet elles-mêmes d’un mot qui voulait dire « les êtres humains », et qualifiaient tout ce qui n’était pas eux de « chiures de mouches », « cloportes » et autres appellations avantageuses, quoique « politiquement incorrectes ».
Tous les peuples du monde furent « racistes » (au sens vulgaire et galvaudé). Et ceux qui ne le sont pas restés aujourd’hui sont non seulement une rareté, mais encore une pure hypothèse. Et chaque peuple a scellé sa cohésion en se racontant sa propre histoire, en laquelle chacun des membres croyait. Car un « Grand Récit » n’a que faire de savoir ou de vérité à son propos, encore moins de science : la croyance suffit largement. La croyance seule fait adhérer. Il ne semble pas possible de faire reposer l'adhésion à un projet collectif sur quelque chose qui soit de l'ordre du seul savoir.
Le même traitement fut appliqué par les historiens, ethnologues et anthropologues au discours que tenaient, « au temps des colonies », les prétentieux occidentaux qui, disaient-ils, « apportaient la civilisation » aux primitifs qui en étaient à leurs yeux démunis. De quel droit la puissance technique conférait-elle à notre civilisation une supériorité sur toutes les autres ? Il fallait en finir avec l’arrogance impudente de l’occidental. La tâche fut menée à bien par les sciences humaines. L’Histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron et consort parachève la besogne.
Je me rappelle avoir entendu, lors d’un débat radiophonique autour de « l’histoire qu’il faut enseigner aux petits Français », l’un des participants bondir sur le micro lorsqu’un autre lança qu’il était impératif d’enseigner l’ « histoire chronologique de la France ». Il s’étranglait : « Quoi, vous voudriez revenir à "nos ancêtres les Gaulois" ?! ». Inutile en effet de demander à un historien d’aujourd’hui, un historien « moderne », de cautionner quelque « roman national » que ce soit. Soyons sérieux : soyons scientifiques. C’est pourtant bien ce mythe des Gaulois, tété par tous les Français avec le lait de leur mère qui, en leur donnant un "bien national commun", a fait le succès de la série Astérix. Passons.
Quand l’ « Histoire de France » a été ainsi déconsidérée et ravalée au rang de « roman national », l’enseignement de l’histoire a cessé d’être républicain pour devenir scientifique. L'histoire a cessé d'être un projet de formation du citoyen. L’histoire, au nom de la science, a renoncé à enseigner ce qui risquait de nourrir une « conscience nationale ». En abolissant l’idéologie véhiculée par le « roman national », l’Education nationale a évacué le bien commun qui jusque-là tissait dans toute la durée scolaire un lien entre les Français. On a mis au rebut ce résidu de mission sous le nom d’ « instruction civique » (objective, n’est-ce pas !). On a juste remplacé l’idéologie nationale par l’idéologie "scientifique".
Dans ces conditions, comment pourrait-on attirer les Français au moyen d’un quelconque « Grand Récit » ? L’histoire de France, avilie en « roman national », qu’était-ce d’autre en effet que cette grande fiction qui cimentait la quasi-intégralité de la population française ? Et qu’est-ce qu’un « Grand Récit », sinon une grande fiction à visée unificatrice ?
Il y a des jours et des occasions où l’on devrait maudire la « science » (ou plutôt ce qui se prétend tel). Au fait, c'est Guy Debord qui, dans Commentaires sur la société du spectacle, évoque « ... la prolifération cancéreuse des pseudo-sciences dites "de l'homme" », Quarto-Gallimard, p.1616).
C'était donc ça !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologue, politiste, stéphane rozès, éditorialiste, journalistes, france, politique, société, grand récit, horizon d'attente, arnaud montebourg, marine le pen, front national, benoît hamon, revenu universel, patrick boucheron, histoire mondiale de la france, alain finkielkraut, journal le figaro, histoire de france, nicolas sarkozy, nos ancêtres les gaulois, astérix, éducation nationale, guy debord, la société du spectacle, commentaires sur la société du spectacle, éditions gallimard
mardi, 27 décembre 2016
PATRON, REMETTEZ-NOUS ÇA !
Islam, Coran, Mahomet : allez, patron, remettez-nous ça ! C'est ma tournée !
Mahmoud Hussein est le pseudonyme du tandem formé par les franco-égyptiens Bahgat El Nadi-Adel Rifaat. Pascal Galinier, dans Le Monde daté 24-26 décembre 2016, rend compte de leur dernier essai paru : Les Musulmans au défi de Daech (Gallimard). Mahmoud Hussein s'efforce, essai après essai, de promouvoir un islam qui admettrait enfin la nécessité de porter un regard critique sur le texte sacré du Coran. Tout le problème que pose l'islam dans le monde actuel vient de là, depuis que, il y a environ 1.000 ans, interdiction a été faite aux docteurs de la foi de toute glose, de toute démarche exégétique, de toute herméneutique qui soumettrait le texte même du livre à la critique. Depuis, c'est un commandement : "Touche pas à mon Coran !".
Or, Pascal Galinier dit une chose que tous les défenseurs de la "liberté religieuse" à tout prix devraient longuement méditer, ruminer, malaxer : « Le Livre saint est un texte hermétique pour le commun des mortels, donc sujet à d'infinies interprétations, chacun y piochant ce qu'il veut - à commencer par l'EI ». Merci monsieur Galinier, merci pour le mot "hermétique". Car le Coran, il m'a fallu faire un énorme effort, il y a exactement un an, pour arriver au bout de sa lecture. J'ai écrit un billet ici même (28 décembre 2015) pour rendre compte de cette lecture, qui n'avait aucune prétention savante, et même qui se revendiquait celle d'un pékin moyen, d'un citoyen français ordinaire qui veut en avoir le cœur net sur les salades qu'on lui sert à longueur de journée, et qui livre les impressions qu'il en a retirées. J'en ai tiré la conclusion que si Mahomet avait voulu plonger l'humanité dans l'angoisse en la lançant dans la construction d'une sorte de tour de Babel pour la jeter dans d'interminables dissensions, il ne s'y serait pas pris autrement.
Car la caractéristique principale de ce texte du Coran est l'effet ahurissant de pulvérisation du sens qu'il produit. Je pense à Robert Musil, dont le casse-tête (ordre des chapitres finaux, achèvement de la rédaction de certains chapitres) de la fin de vie empêche à tout jamais les lecteurs de se faire une idée définitive de son chef d'œuvre, L'Homme sans qualités, même s'il s'en faut de pas tant que ça finalement, et que le résultat en fait une oeuvre, certes, terriblement complexe, mais qu'on peut dire à bon droit, sinon achevée, du moins "constituée".
Le Coran, c'est le même genre de casse-tête, mais porté à la puissance 10 ou 20. D'un bout à l'autre, c'est un invraisemblable assemblage de bribes et de lambeaux de phrases, un fouillis inextricable juxtaposant d'innombrables miettes et fragments disjoints, une improbable collection de pièces et de morceaux hétéroclites réunis à la diable. Dans le Coran, le discontinu règne en maître souverain. Impossible pour un esprit rationnel et soucieux de construction logique de s'y retrouver. La Bible, à cet égard, fait figure de traité scientifique abouti.
Pour les continuateurs du "guerrier-prophète" (attention : oxymore !) qui se sont donné pour tâche de mettre en forme ce salmigondis (le calife Uthman, ...), et de mettre un peu d'ordre (? ! ?) dans ce capharnaüm, il existait un seul et unique moyen de remédier à cette absence quasi-totale de lisibilité, de cohérence et d'unité : la répétition des formules, le rabâchage des sommations, la réitération des interdictions, la rengaine des menaces. Autre curiosité : le Coran n'est pas composé : on démarre très simplement de la plus longue sourate pour aller à la plus courte. Avis aux braves intellectuels qui fustigent la pensée binaire et le manichéisme (forcément simpliste) : le Coran est une illustration parfaite, une caricature de tout ce que la pensée humaine peut produire de plus effréné en fait de binarisme et de manichéisme.
C'est cet infâme bric-à-brac simpliste, totalisant et, tout compte fait, totalitaire, que les élèves des écoles coraniques sont sommés d'ingurgiter par cœur (700 pages in-quarto !!). C'est cet inimaginable patchwork qu'un milliard et demi d'individus considèrent aujourd'hui comme sacré, au point de faire mourir ceux qu'on soupçonne de lui avoir manqué de respect. Pour moi, pour avoir jugé sur pièce, cette vénération est rigoureusement incompréhensible. C'est peut-être aussi cette vénération superstitieuse qui, en terre autrefois chrétienne, fait de l'islam un corps de doctrine définitivement inassimilable. Si l'Europe existe encore.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que le texte du Coran est tellement hermétique, tellement peu intelligible que le lecteur, même un peu averti, est contraint de s'en remettre à la compétence supposée de "spécialistes" pour ce qui est de la compréhension du message. Le croyant sincère est contraint de faire confiance à quelqu'un que la société lui présente comme une autorité. Pas de lecture autorisée du Coran sans recours à une autorité spécialement habilitée à délivrer des avis autorisés.
Car, si tous les Européens admettent depuis deux ou trois siècles la liberté de conscience, il faut savoir qu'il n'y a pas de liberté de conscience en terre d'islam. Le Coran est un instrument entre les mains des gens qui sont au pouvoir ou qui veulent le conquérir. Le Coran est à leur service pour faire régner l'ordre : "soumettez-vous" est en fin de compte la formule d'une sommation qui pourrait résumer l'intégralité du "livre sacré". Il ne viendrait à l'esprit d'aucun musulman d'apostropher Mahomet et de lui enjoindre de répondre à la sommation : "Prouve-le !". Comme le dit le journaliste dans son article, le texte du Coran est « sujet à d'infinies interprétations ». Et malheureusement, ce ne sont pas les gens savants qui manquent. Le problème avec l'interprétation, c'est que plus il y a d'interprètes, plus il y a de versions différentes.
Or il n'y a rien de plus difficile que de mettre d'accord deux interprètes. Je n'insiste pas sur la gravité du vieux problème du conflit des interprétations (cf. Paul Ricœur). Rien que le mot "djihad", comment faut-il le traduire ? Désigne-t-il la guerre armée contre les infidèles ? Signifie-t-il la violence que l'individu est invité à se faire dans un but d'ascèse morale ? Si vous sacralisez le texte, dites-vous déjà que la métaphore vous est interdite, et que le sens littéral s'impose à vous, sous peine de. Même à mille quatre cent et quelques années de distance. Remarquez, les créationnistes américains sont bien persuadés que le monde a été créé en six jours. Alors ...
J'insisterai davantage sur la suite de la phrase de Pascal Galinier : « ... chacun y piochant ce qu'il veut ». Malek Chebel, spécialiste s'il en est, le disait déjà : « L'islam est une auberge espagnole ». C'est en effet moins sur la façon dont il faut comprendre telle ou telle phrase (encore que ...) que s'étripent les interprètes, que sur les éléments du texte sur lesquels l'accent est mis : de même que dans la Bible, on trouve dans le Coran, tour à tour et successivement, des appels à la paix et des prêches de chef de guerre. Au fond, le choix par l'interprète de ses priorités de lecture est un révélateur de ses intentions préalables.
Pour les musulmans évolués, pour l'immense majorité des musulmans que nous croisons tous les jours, le Coran est une référence. Pour les salafistes, les Frères musulmans, les wahabites, les tyrans de l'Etat islamique - et, en France, les femmes voilées -, le Coran est une arme de conquête massive.
Notre problème, en France et ailleurs, c'est qu'ils ont tous raison.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : islam, musulmans, le coran, mahomet, france, société, politique, religion, journal le monde, pascal galinier, malek chebel, mahmoud hussein, les musulmans au défi de daech, éditions gallimard, robert musil, l'homme sans qualités
dimanche, 06 mars 2016
À PROPOS DE RAYMOND QUENEAU
 MODESTES CONSIDÉRATIONS SUR LA MODERNITÉ
MODESTES CONSIDÉRATIONS SUR LA MODERNITÉ
Résumé : on aura compris que ce que certains adorent encore sous le nom de "modernité" ou de "modernisme" me court depuis lurette sur le haricot. Il va de soi que la biographie de Raymond Queneau apparaîtra légitimement comme un simple prétexte à quelques réflexions oiseuses. Et inactuelles. Et dont je ne méconnais pas l'épaisseur du trait qui a servi à les écrire.
2/2
Comme les peintres du 20ème siècle ont élevé la matière, la forme et les outils à la dignité d’œuvres picturales, comme les musiciens ont élevé tous les sons possibles, y compris les bruits (chasse d'eau, aspirateur, ...), à la dignité de matériau musical, les littérateurs soucieux de toujours se tenir à l’avant-garde des mouvements d'avant-garde ont écrit des œuvres où ils font du matériau langagier l’objet de leur travail, dans un superbe effort d'objectivation.
Lécureur enfonce le clou, à propos des J.A.R. (jeunes auteurs réunis) : « Cependant, ils ont tous en commun ce désir, cet instinct, cette volonté de "démythisation" de notre société, qui les situe face à ceux qui voudraient abusivement exploiter de prétendus mythes, qui ne sont que des préjugés éculés et de superstitieuses survivances » (p.404). La messe est dite : la llittérature doit s’engager sous l’étendard du rationnel à tout crin. De l'intelligence comme valeur suprême. La croyance doit se savoir croyance, c'est-à-dire s'abolir. Pas de salut hors de ce credo impérieux. Retour aux combats des philosophes du dix-huitième siècle. Le nouveau diable s'appelle "mythe", "grand récit" ou ce qu'on veut. Sans prétendre militer pour la réhabilitation des superstitions, on peut se demander qui nous gardera des dégâts induits par les mésusages de la Raison.
Car le 20ème siècle, à travers ses théories picturales, musicales et littéraires, offre trois cas de fétichisme de la matière et de divinisation de l'Intelligence Rationnelle : après tout, pourquoi les outils patiemment mis au point par des millénaires d’histoire humaine (c'est-à-dire de "mythisation", de fantasmes, d'imagination, de "projections psychiques", bref : de délire lyrique) n’auraient-ils pas le droit d’être à leur tour promus au rang des œuvres d’art ? La technique, y a que ça de vrai. J’en suis venu à me demander, quant à moi, ce que peut avoir à dire un artiste qui ne parle pas du monde, mais qui commente ce qu'il fait. Ce que peut signifier cette promotion sur le devant de la scène, cette starisation des outils, moyens et autres instruments et supports au panthéon des valeurs esthétiques : la civilisation, confrontée à sa propre vacuité, a-t-elle encore quelque chose à dire?
C’est en tout cas la conclusion à laquelle Jean Dubuffet arrive, s’agissant du Collège de ’Pataphysique : « "Les réunions (remarquablement masculines) du Collège de ’Pataphysique ont quelque chose de vain, écrivait-il, de vacueux, mais tout l’édifice entier de la ’Pataphysique apparaît quelquefois fondé sur la "Vacuité". Il s’en sépara le 28 octobre suivant » (p.478). Dubuffet évoque la question dans Bâtons rompus (Minuit, 1986). Maintenant, on n’est pas obligé de le suivre dans ses « retours aux sources de l’art » (art brut, dessins d’enfant, etc.) et dans sa doxa : « Tout fait art ». Je ne sais pas au juste, finalement, ce que Dubuffet reprochait au Collège.
La civilisation, exténuée des efforts accomplis pour dominer le monde (avec les joyeusetés et autres beaux résultats offerts par le 20ème siècle), avait vidé les caves et les greniers de son imaginaire. N’ayant plus rien dans ses réserves pour dire le monde (qu’elle avait fini de dévorer), elle s’est retournée sur elle-même, dans un éperdu mouvement de questionnement et d’introspection narcissiques et culpabilisés (d'où la croissance proliférante des "sciences humaines").
Poussée dans ses retranchements, n’ayant plus rien à dire, elle a commencé à se regarder, à s'examiner, à se disséquer, à se "déconstruire". Elle s’est tournée vers ses propres moyens techniques, ses propres outils, ses propres façons de travailler et de vivre pour se donner l’impression que non, ce n’en était pas fini de ses ressources créatives. Elle s’est mise à se regarder vivre. Et les littérateurs se sont mis à se regarder écrire, les peintres à se regarder peindre, les musiciens à se regarder composer. Le concept s'est suffi à lui-même, délogeant l'imaginaire de son lopin, renvoyé à la préhistoire de l'art. Dans un retour réflexif sur elle-même, la civilisation a fait subir au sentiment qu’elle avait de sa validité et de sa légitimité une remise en question de tous ses paramètres, qui a quelque chose à voir avec l’Inquisition : quelle autre civilisation que la nôtre s'est dit, un jour : je suis un péché ?
Les travaux de l’Oulipo, selon moi, illustrent assez bien l’épuisement des ressources imaginaires de l’Occident, puisque ses fondateurs (Le Lionnais et Queneau) avaient l’intention d’explorer les moyens de fabriquer de la littérature en puisant dans les ressources offertes par les mathématiques (ils étaient tous deux mathématiciens). Condorcet le révolutionnaire aurait été enchanté de cette perspective, lui qui avait dans ses cartons des projets d'application des principes mathématiques à l'organisation sociale. A quoi son malheureux suicide nous a-t-il permis d'échapper ! La "déesse Raison" ! Il ne faut pas exagérer !
On comprend d’ailleurs que Perec se soit senti comme chez lui dans les rangs oulipiens, puisque, de son côté, il avait essayé de mettre au point une telle machine, qu’il avait baptisée PALF (Production Automatique de Littérature Française). Et qui a demandé à Claude Berge, mathématicien, des conseils alors qu'il préparait La Vie mode d'emploi. Mais lui, il avait assez à dire pour donner vie à des machines structurales.
Franchement, qui peut prendre vraiment au sérieux le pari stupide de 100.000.000.000.000 de poèmes, livre qui doit poser quelques légers problèmes de fabrication (voir ci-dessous), et qui repose en plus sur une imposture : « Ce petit ouvrage permet à tout un chacun de composer à volonté cent mille milliards de sonnets » ? "Composer" ? Eh, menteur, qui les a écrits, les vers ? Un livre assez couillon, finalement. Aussi bête, en fin de compte, que ces "livres dont vous êtes le héros", où on fait croire au lecteur qu'il a le choix (la même gaminerie existe dans des partitions musicales !). Un défi, si l'on veut, une performance technique à la rigueur, mais une récréation de vieil érudit retourné au bac à sable, du genre : attention les yeux ! Vous allez voir ce que vous allez voir. Je ne comprends pas la béatitude de ceux qui admirent ça.

Ce bouquin, pour moi, tient du canular. Du jeu spéculatif, à la grande rigueur.
Maintenant, tout ce qui précède ne m’empêche pas de reconnaître le caractère exceptionnel de l’individu nommé Raymond Queneau. Il faudrait être idiot pour lui dénier ses multiples mérites, à commencer par la nature profondément encyclopédique de son intelligence, ce qui l’a amené à jouer un rôle éminent, et même central, dans l’existence des éditions Gallimard. Lécureur parle de sa « boulimie intellectuelle », qu’il juge « phénoménale » (p.343). Je suis évidemment d'accord. Sa curiosité tous azimuts, son énergie inlassable l’ont mis en contact avec d’innombrables interlocuteurs. En plus, quoiqu’amateur, il n’était pas mauvais peintre. J’ai du mal à le suivre dans ses goûts : Jean Hélion est-il un artiste à ce point inoubliable, lui qui est allé de la figuration à l'abstraction et retour, quoiqu'à contretemps des modes ?
Au total, je ne peux m’empêcher de comparer les biographies de Perec et de Queneau, que j’ai lues à la file. Et je vais vous dire, autant la première m’a donné envie de me replonger dans les œuvres de leur auteur, autant la seconde me renforce dans ma décision de regarder les livres de l'écrivain en me contentant de leur dos, sur le rayon.
Pour moi, tout le travail de Raymond Queneau illustre bien les malheurs qui affligent la littérature au 20ème siècle, une littérature exténuée, qui a cessé de croire en elle-même, en la légitimité intrinsèque de l'imaginaire (la "mythisation") qu'elle propose et instaure. Une littérature entrée dans l’ère du doute et du soupçon généralisés.
En attendant l’ « Ère du vide » (titre d'un livre de Gilles Lipovetsky). Et les « déconstructeurs » : l'intelligence déconstruit les mythes qui ont fondé nos sociétés, les stéréotypes et les éventuels préjugés qu'ils ont produits. Tout ça pour quoi ? A force d'intelligence, à force d'intellectualité, à force de se déconstruire, à force de contrôler la validité de son ticket de transport dans le train de l'existence et de la construction sociale, l'être humain est en train de se rendre compte que, au bout de la déconstruction, quand il a fait le tour du caractère artificiel et arbitraire de tous ses édifices culturels, il ne reste en lui que le vide.
En matière d'humanité, il ne saurait y avoir de Vérité : il n'y a que des choix, des décisions, des créations, des contextes, des situations. Il y a les principes ; et puis il y a la vie. Toute institution humaine est arbitraire (tiens, Queneau, l'orthographe, par exemple !). C'est vrai, après tout : pourquoi ainsi et pas autrement ? Pourquoi ceci plutôt que cela ? Mais l'humanité n'est pas un hypermarché. Il faut se poser des questions, c'est sûr, mais bon, il faut aussi se reposer. Car sous cet angle, tout ce qui est humain peut être déconstruit et passé à la moulinette.
Je pense à la phrase d'Archimède : « Donnez-moi un point fixe et je soulève l'univers ». Il demandait l'impossible : il n'y a pas de point fixe dans l'univers. Pourtant l'homme a besoin de fixer, et de se fixer. Or, les "vérités" auxquelles il s'attache ont besoin de la durée pour s'établir. Ce décalage est une infirmité : il faut le reconnaître. Et puis comme on dit : "il faut faire avec". L'esprit de l'homme tend à éterniser l'instant. C'est pour ça qu'il a un passé. C'est aussi pour ça qu'il s'est fabriqué des dieux.
Une société relativement rationnelle se donne les moyens d'y voir clair. Une société absolument rationnelle se propose de tirer la vie au cordeau, c'est-à-dire de la rendre invivable. Il faudrait penser à protéger, à sauver ce que Hermann Broch appelle le « résidu irrationnel », ce reste qui échappera toujours à la connaissance scientifique. Pour notre bonheur. Ce "résidu" s'appelle la liberté.
L'imaginaire (les mythes, etc.), c'est la vie qui nous dit à l'oreille : quelque chose plutôt que rien. La vie qui nous dit : cette chose plutôt qu'une autre. Tant pis : on ne peut pas tout rationaliser : vivre, c'est aussi choisir, donc éliminer. C'est entendu : ce que nous sommes collectivement résulte d'une convention : une "identité". C'est entendu : une identité n'est pas une Vérité. Notre identité est conventionnelle. Nos institutions sont conventionnelles. Et les religions. Et les cultures. Et les mœurs. Et les habits. Et ..., et ..., et ...
Pour pasticher la plus grande niaiserie en vigueur chez les promoteurs de la "modernité" : « On ne naît pas humain : on le devient ». Tu l'as dit, bouffie (et le "e" n'est pas une coquille) !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, raymond queneau, éditions gallimard, musique contemporaine, dubuffet, art brut, collège de pataphysique, dubuffet bâtons rompus, oulipo, georges perec, cent mille milliards de poèmes, condorcet, michel lécureur queneau, peintre jean hélion, l'ère du vide, gilles lipovetsky, hermann broch, art contemporain
mardi, 08 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 3/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
3/9
De l'importance de la lecture.
Ce qui est sûr, c’est que l’art contemporain, la musique contemporaine, la poésie contemporaine (en ai-je bouffé, des manuscrits indigestes, futiles, vaporeux ou dérisoires, au comité de lecture où je siégeais !), tout cela est tombé de moi comme autant de peaux mortes. De ce naufrage, ont surnagé les œuvres de quelques peintres, de rares compositeurs, d’une poignée de poètes élus. Comme un rat qui veut sauver sa peau, j’ai quitté le navire ultramoderne. J'ai déserté les avant-gardes. C’est d’un autre rivage que je me suis mis à regarder ce Titanic culturel qui s’enfonçait toujours plus loin dans des eaux de plus en plus imbuvables.
Comment expliquer ce revirement brutal ? Bien malin qui le dira. Pour mon compte, j’ai encore du mal. Je cherche. Le vrai de la chose, je crois, est qu’un beau jour, j'ai dû me poser la grande question : je me suis demandé pourquoi, tout bien considéré, je me sentais obligé de m’intéresser à tout ce qui se faisait de nouveau.
Mais surtout, le vrai du vrai de la chose, c’est que j’ai fait (bien tardivement) quelques lectures qui ont arraché les peaux de saucisson qui me couvraient les yeux quand je regardais les acquis du 20ème siècle comme autant de conquêtes victorieuses et de promesses d'avenir radieux. J’ai fini par mettre bout à bout un riche ensemble homogène d’événements, de situations, de manifestations, d’analyses allant tous dans le même sens : un désastre généralisé. C’est alors que le tableau de ce même siècle m’est apparu dans toute la cohérence compacte de son horreur, depuis la guerre de 14-18 jusqu’à l’exploitation et à la consommation effrénées des hommes et de la planète, jusqu'à l’humanité transformée en marchandises, en passant par quelques bombes, quelques génocides, quelques empoisonnements industriels.
 Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
A tort ou à raison, j’ai conclu de cette lecture décisive qu’Hitler et Staline, loin d’être les épouvantails, les effigies monstrueuses et retranchées de l’humanité normale qui en ont été dessinées, n’ont fait que pousser à bout la logique à la fois rationnelle et délirante du monde dans lequel ils vivaient pour la plier au fantasme dément de leur toute-puissance. Hitler et Staline, loin d’être des monstres à jamais hors de l’humanité, furent des hommes ordinaires (la « Banalité du Mal » dont parle Hannah Arendt à propos du procès Eichmann). Il n'y a pas de pommes s'il n'y a pas de pommier. Ils se contentèrent de pousser jusqu’à l’absurde et jusqu’à la terreur la logique d’un système sur lequel repose, encore et toujours, le monde dans lequel nous vivons.
Hitler et Staline (Pol Pot, …) ne sont pas des exceptions ou des aberrations : ils sont des points d’aboutissement. Et le monde actuel, muni de toutes ses machines d’influence et de propagande, loin de se démarquer radicalement de ces systèmes honnis qu’il lui est arrivé de qualifier d’ « Empire du Mal », en est une continuation qui n’a eu pour talent que de rendre l’horreur indolore, invisible et, pour certains, souhaitable.
Un exemple ? L’élimination à la naissance des nouveau-nés mal formés : Hitler, qui voulait refabriquer une race pure, appelait ça l’eugénisme. Les « civilisés » que nous sommes sont convenus que c’était une horreur absolue. Et pourtant, pour eux (pour nous), c’est devenu évident et « naturel ». C’est juste devenu un « bienfait » de la technique : permettre de les éliminer en les empêchant de naître, ce qui revient strictement au même. C’est ainsi que, dans quelques pays où la naissance d’une fille est une calamité, l’échographie prénatale a impunément semé ses ravages.
 D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système
D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
Je citerai une troisième facette de ladite évolution : une réflexion tirée d’ouvrages d’économistes, parmi lesquels ceux du regretté Bernard Maris (à  commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
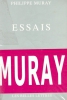 J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
Mais je dois reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
 Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude
Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
L'Histoire (le Pouvoir, la Politique), la Technique, l'Economie, donc : la trinité qui fait peur.
Restent les Lumières originelles : étonnamment et bien que je ne sache pas si le résultat est très cohérent, au profond de moi, elles résistent encore et toujours à l'envahisseur. Sans doute parce qu'en elles je vois encore de l'espoir et du possible.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, avant-garde, titanic, hannah arendt, les origines du totalitarisme, nazisme, staline, hitler, totalitarisme, stalinisme, banalité du mal, jacques ellul, le système technicien, le bluff technologique, günther anders, l'obsolescence de l'homme, bernard maris, charlie hebdo, antimanuel d'économie, jean-marc sylvestre, ultralibéralisme, philippe muray, l'empire du bien, exorcismes spirituels, éditions les belles lettres, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, une paire de bottes vaut shakespeare, éditions gallimard, george orwell essais articles lettres, jean-claude michéa, l'enseignement de l'ignorance, le moi assiégé, christopher lasch, la culture du narcissisme, michel houellebecq, la carte et le territoire, éditions l'encyclopédie des nuisances
samedi, 19 septembre 2015
MARIO VARGAS LLOSA
 Le prix Nobel de littérature 2010, Mario Vargas Llosa, vient de publier (Gallimard, 2015) La Civilisation du spectacle. D’un prix Nobel, on est en droit d’attendre un message de haute volée. Grosse déception, donc. Autant le dire tout de suite : il aurait mieux fait de ne pas. Alléché par le titre, j'ai vite déchanté.
Le prix Nobel de littérature 2010, Mario Vargas Llosa, vient de publier (Gallimard, 2015) La Civilisation du spectacle. D’un prix Nobel, on est en droit d’attendre un message de haute volée. Grosse déception, donc. Autant le dire tout de suite : il aurait mieux fait de ne pas. Alléché par le titre, j'ai vite déchanté.
Il a beau inscrire son propos, dans le chapitre introductif, dans la lignée d’une ribambelle d'auteurs dénonçant le règne de la marchandise, la transformation du monde en spectacle et des gens en consommateurs (T.S. Eliot, George Steiner, Guy Debord, Gilles Lipovetsky, Frédéric Martel – il oublie Alain Finkielkraut et sa mémorable Défaite de la pensée), son livre au titre ambitieux ne tient pas debout. C'est au mieux le livre d'un vieux notable universellement respecté, à qui un adulateur a demandé, à la fin du banquet, d'émettre un jugement sur notre époque et notre monde tels qu'il les voit.
La thèse est facile à formuler : le monde actuel, en privilégiant le loisir, le divertissement et la consommation, a assassiné la culture. L’un des problèmes vient justement de ce dernier terme. L’auteur en tient visiblement pour la « haute culture » (sous-entendu : classique, traditionnelle, la culture par laquelle l’homme tend à s’élever au-dessus de lui-même). C’est précisément ce qui n’est pas à lui reprocher.
Il lui oppose la « culture-monde » : « La culture-monde, au lieu de promouvoir l’individu, le crétinise, en le privant de lucidité et de libre-arbitre, et l’amène à réagir devant la "culture" régnante de façon conditionnée et grégaire, comme les chiens de Pavlov à la clochette qui annonce le repas » (p.28). On est évidemment d’accord avec lui : la culture est structurée selon une échelle de valeurs. La marchandisation de tout tire tout vers le bas en mettant sur le même plan une paire de bottes et l'œuvre de Shakespeare (Alain Finkielkraut, La Défaite de la pensée, Gallimard, 1987, p.136).
Il existe, malgré tout ce que peut proclamer la culture « mainstream » (titre du livre du susnommé Frédéric Martel), une hiérarchie dans la culture, qui sait différencier la démarche qui prône un effort constant et une exigence de la part de celui qui se cultive, et la démarche qui se borne à des produits culturels de consommation courante véhiculés par la publicité, faits pour suivre les modes et disparaître sitôt absorbés.
Vargas Llosa raisonne en aristocrate : « La quantité aux dépens de la qualité. Ce critère, auquel tendent les pires démagogies dans le domaine politique, a eu ici des conséquences imprévues, comme la disparition de la haute culture, forcément minoritaire par la complexité et parfois l’hermétisme de ses clés et codes, et la massification de l’idée même de culture » (p.35). Jusque-là, je suis prêt à approuver l’auteur.
Qu’est-ce que je reproche à ce livre ? D’abord de brasser des idées tant soit peu rebattues. D’enfoncer des portes ouvertes. De nous donner à renifler des parfums flottant dans l’air du temps. D’énoncer trop souvent des banalités. De produire un ingrédient voulu original, mais constitué surtout du tout-venant intellectuel. Il arrive comme les carabiniers quand il dénonce – après tant d’autres – l’irruption de la « frivolité » dans les domaines les plus sérieux de l’existence des hommes et de la vie des sociétés.
Mais ce que je reproche surtout à ce livre, en dehors de la superficialité des analyses, c’est le joyeux mélange qu’il opère des notions et des perspectives. Autrement dit : son manque d’unité. Cela donne une impression d’hétérogène et de disparate. Autant j’abonde quand il s’en prend aux « déconstructionnistes » de la culture (Foucault, Derrida, …) qui, en critiquant la notion de pouvoir, ont sapé à la base le principe d’autorité, autant je trouve incongru le chapitre sur la « disparition de l’érotisme ». Je concède cependant que la dénonciation des « ateliers de masturbation » mis en place en 2009 dans les collèges d’Estrémadure a quelque chose de réjouissant.
Et encore plus étrange celui où, tout en s’affirmant athée, il prend contre toute raison la défense de la plus extrême liberté religieuse, en mettant strictement sur le même plan les sectes (Moon, scientologie, …) et toutes les croyances et religions reconnues et officielles : « Les sectes, à cet égard, sont utiles et devraient être non seulement respectées, mais encouragées » (p.197). Il se félicite que les sectes « procurent un équilibre et un ordre à ceux qui se sentent déconcertés, solitaires, inquiets dans le monde d’aujourd’hui ». Pour le moins surprenant, n’est-il pas ?
Ajoutons pour compléter le tableau que les six chapitres et la « Réflexion finale » sont entrelardés d’une petite dizaine de textes intitulés « Pierre de touche » (pourquoi ?) – en fait, des articles déjà publiés dans le journal El País, illustrant telle ou telle partie du raisonnement. Quant au chapitre conclusif, inclus dans la « Réflexion finale », il reproduit le discours que l’auteur à prononcé en 1996 après s’être vu décerner le « Prix de la Paix » par les éditeurs et libraires allemands. Le discours du patriarche à la fin du banquet organisé en son honneur.
L’image que je garde du livre dans sa totalité : banal, consensuel et mal foutu, où l'on trouve à la fois du très juste, mais qui court les rues, et du n'importe quoi.
Quant au titre, qu’on me pardonne, il est au mieux une promesse non tenue, au pire une imposture prétentieuse.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, prix nobel de littérature, mario vargas llosa, la civilisation du spectacle, guy debord, la société du spectacle, éditions gallimard, ts eliot, george steiner, alain finkielkraut, gilles lipovetsky, frédéric martel mainstream, la défaite de la pensée, secte moon, scientologie, l ron hubbard
samedi, 27 juin 2015
L'ISLAM NE PEUT AIMER LA FRANCE
2/2
J'en étais à énumérer les branches du sunnisme, d'après Gouverner au nom d'Allah, de Boualem Sansal. J'observe, avant de poursuivre, que les médias véhiculent davantage d'informations sur les divers courants de l'islam (nul n'ignore aujourd'hui, s'il se tient au courant, les termes "wahabite", "salafiste", "djihad", "halal" et compagnie) que les vieux chrétiens du continent n'en connaissent sur les multiples courants et débats qui traversaient la vieille religion européenne.
nom d'Allah, de Boualem Sansal. J'observe, avant de poursuivre, que les médias véhiculent davantage d'informations sur les divers courants de l'islam (nul n'ignore aujourd'hui, s'il se tient au courant, les termes "wahabite", "salafiste", "djihad", "halal" et compagnie) que les vieux chrétiens du continent n'en connaissent sur les multiples courants et débats qui traversaient la vieille religion européenne.
Je rappelle juste que cette chose désormais enterrée (ou à peu près) s'appelait le christianisme. C'est de ce tissu que nous sommes faits, que nous ayons ou non la foi. Et quand on cite le pape ou le Vatican, c'est pour en dénoncer le conservatisme. Car on le sait : les Etats musulmans, de leur côté, sont les grands progressistes de la modernité. Rendez-vous compte : les femmes seront peut-être autorisées à conduire des voitures dans trois ou quatre décennies. En terre islamique, le Progrès fonce à toute allure. Traduction : comme ils sont riches, ils peuvent tout s'acheter, à commencer par les clubs de foot, et par voie de conséquence, les consciences et les identités qui vont avec.
Grâce aux médias, le quidam français en sait aujourd'hui beaucoup sur l'islam. On ne lui laisse rien ignorer du ramadan, de l'aïd el kébir, de l'aïd el fitr. Pessah, Soukkot, Yom kippour, etc. viennent juste après. Bons derniers : l'Assomption, l'Ascension, l'Annonciation. Le quidam ne se dit pas, apparemment, que, après avoir eu tant de mal à se débarrasser des curés, il ne va pas se laisser emmerder par des curés d'un nouveau genre, mais tout aussi problématiques (ça se reconnaît souvent à la soutane). La soutane islamique (hébraïque ?) sera-t-elle l'avenir de l'Europe ? Tolérance, solidarité, acceptation de l'autre, on vous dit. Sinon, vous êtes des salauds et des fachos.
Cela dit, il faut être convaincu que le gouvernement français, quoi qu'il arrive, demeurera intraitable et intransigeant sur le respect de la laïcité. Farpaitement ! Ouais !
En attendant, l'injure faite aux incroyants, agnostiques, athées, est constante, permanente et massive. Et je n'ai pas encore porté plainte ! Qu'est-ce que je suis tolérant !
*****
Le malékisme prêche un islam orthodoxe austère, très ritualiste (20 % des sunnites). Le hanafisme, plus libéral et rationaliste, est la branche la plus nombreuse aujourd’hui, répandue en Inde, Bangladesh, Chine. Le chafiisme, répandu en Egypte, Indonésie, Malaisie, Philippines, impose l’excision des filles. Le hanbalisme est une école de pensée rigoriste très conservatrice, développée au Proche Orient, en particulier l’Arabie Saoudite, où un certain Abdel Wahab a encore durci la doctrine, donnant le wahabisme qu’on voit à l’œuvre, militairement et politiquement. Voilà pour les sunnites.
Quant à ce qui se passe chez les chiites, un « courant complexe, à la fois rationaliste, spiritualiste et ésotérique », c’est pire que le sunnisme : il « se divise en quatre branches se divisant elles-mêmes en de nombreuses écoles et sectes dissidentes ». Le pape lui-même n’y retrouverait pas son bénitier. Il y a les duodécimains (ou jafarites). Il y a les zaïdites (« exclusivement dans les montagnes du nord-ouest du Yemen »). Il y a les ismaéliens, parmi les nombreuses branches desquels on trouve les hétérodoxes druzes (Liban), qui rejettent la charia et croient en la métempsycose. Il y a enfin les ghoulâts, parmi lesquels la secte alaouite de Bachar El Assad. Ouf, ne jetez plus rien dans le panier de crabes.
Je ne vous embarque pas dans les subtilités du soufisme, qui est organisé en confréries, parfois autarciques. Pour les sunnites et chiites les soufis ne sont pas des musulmans (mais que faire, si eux-mêmes se prétendent musulmans ?). Ils sont censés ne pas se mêler de politique, mais il me semble avoir entendu ici ou là des informations contredisant cette thèse. Le kharidjisme existe dans le sultanat d’Oman. Ce courant dissident ancien, qui conteste sunnisme et chiisme, subsiste dans quelques « poches ». J’arrête là.
Tout ça pour dire quoi ? Que l’islam, en dehors du Coran et des cinq piliers, est un immense et profond chaudron où bouillonnent et cohabitent (quand elles ne cherchent pas à s'éliminer mutuellement) une infinité de sauces musulmanes. Comment s’y retrouver ? Selon moi, c’est très simple : est musulman tout homme qui se revendique musulman, quels que soient son catéchisme, son obédience, ses références territoriales, et surtout quelle que soit la lecture qu’il fait du Coran.
Tous les musulmans, y compris les frères Kouachi et Amédy Coulibaly, y compris ceux qui, avec Daech, prêchent l'islam à coups de bulldozer, de kalachnikov ou de cimeterre (ou pire), ils sont tous musulmans. Un seul sac, je fais. C'est épouvantablement simpliste et caricatural, mais je crois que ça permet de clarifier le problème de l'islam : si tu admets l'islam, tu admets tous les islams. L'islam, c'est simple, tu ne peux pas le scinder comme le christianisme (catholiques / protestants, pour rester en Europe), car il consiste en un seul morceau, mais fait d'une multitude de morceaux. Il n'y a pas les bons et les mauvais musulmans. Il y a les musulmans, point barre.
Tous ceux qui se confessent musulmans sont musulmans. Quels que soient les préceptes, les sourates, les versets qu’ils préfèrent. Et quelle que soit l’interprétation qu’ils donnent à tout ça et le rapport qu’ils entretiennent avec le texte (littéral, métaphorique, allégorique, poétique, mystique, ...). Violent ou pacifique, totalitaire ou humaniste, mangeant du porc ou faisant vomir sa petite sœur de cinq ans qui vient d'avaler une lichette de jambon (je l'ai vu), un musulman est d'abord et essentiellement musulman. C'est la dominante identitaire.
Qu’il sorte du chapeau la boule blanche de la paix ou la boule noire de la guerre, c’est toujours l’islam : un bloc compact à prendre dans son entier, en même temps qu’un tas de sable dont les grains échappent des mains de qui veut le saisir. De toute façon, le Coran, c'est comme la langue d'Esope : la meilleure et la pire des choses. Car il y a tout, dans le Coran : du pacifisme le plus héroïque au bellicisme le plus haineux (ne pas oublier que Mahomet fut un chef de guerre).
L'islam est impénétrable, parce qu'il est tout à la fois d'une compacité inentamable et d'un émiettement infini. C'est ce qui fait sa force : il est à la fois extrêmement simple (cinq piliers, cinq prières, Coran) et extrêmement mosaïqué. C’est le paradoxe infernal qui dépasse tous les responsables politiques de France et d’Europe (et tout homme de bon sens) : tout à la fois un bloc de marbre et une infinité de grains de sable dans le sablier, sans aucun lien entre eux ("Ah mais ce n'est pas mon islam !", entendu à satiété dans la bouche des musulmans "intégrés", après les attentats du 7 janvier). A moins de se convertir, aucun occidental n'est en mesure de comprendre l'islam. L'islam ne se comprend pas : il se vit, ou on le rejette.

Une altérité radicale est radicalement inassimilable.
Seul le respect, à condition de réciprocité, ...
Ce que je retiens, c’est qu’aucune religion n’est plus plastique que la musulmane : elle est bonne à tout, elle s’adapte à toutes les situations. Toujours, partout où elle s’est implantée, elle a introduit ses racines dans le sol. Avec une facilité surprenante, puisqu'elle ne fait pas appel à la conscience individuelle (ni examen de conscience, ni directeur de conscience, ni confesseur, ...).
Toujours, partout où elle n’a pas réussi à s’implanter, c’est parce qu’une croyance fortement constituée s’est opposée à elle, souvent par les armes. Si l’islam s’implante en France, c’est sans doute que, vidée d’une bonne partie de sa substance, celle-ci n’a plus grand-chose à lui opposer. Ce qui est sûr, c’est que l’islam n’a rien à enseigner à la France.
La France a, semble-t-il, cessé de croire en elle-même. Imaginez ce qu’il reste d’humanisme et de Lumières. Imaginez ce qu’il reste de combat identitaire, immédiatement affecté de la hideuse mention "Extrême Droite". C'est curieux : on n'a plus le droit de se revendiquer "Français". Jour après jour, on cherche à nous persuader que, dans l'appellation "Français", il y a un peu de tout, c'est-à-dire de n'importe quoi. Tiens, L'Express publie un dossier, c'est peut-être un signe ? Et tout le monde comprend ce qui se passe, quand des "Français" sifflent la Marseillaise ou brûlent le drapeau tricolore. Mais on n'a pas le droit de le dire. Et l'on fait semblant de s'étonner du nombre des volontaires qui partent pour la Syrie, l'Irak, Daech et le Djihad.
Imaginez maintenant, par-dessus tout ça, la revendication musulmane. Touillez le tout : vous avez la conclusion tirée par Houellebecq dans son roman Soumission (paru le 6 janvier 2015, la veille de ... ) : l'élection d'un président musulman à la tête de la "République Française". C’est pour ça qu’il a fait scandale : « Le premier qui dit la vérité … ».
Finissez sans moi : quelque chose me coupe l'appétit.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, politique, religion, gouverner au nom d'allah, boualem sansal, éditions gallimard, islam, musulmans, sunnites, chiites, fondamentalisme, djihad, alaouites, pape françois, bachar el assad, soufis, coran, frères kouachi, amédy coulibaly, daech, catholliques, protestants
jeudi, 18 juin 2015
L'ANARCHIE DES VALEURS 1
1/2
 Je ne suis pas philosophe, dieu merci. Pour être franc, j'ai du mal à prendre au sérieux les discours et les débats qui ont pour objet d'organiser le monde des abstractions. J'ai un esprit épouvantablement concret. Prosaïque. Terrestre. Pour vous dire, quand j’ai ouvert Anthropologie philosophique, de Bernard Grœthuysen, et que j’ai compris, après plusieurs lectures de la page 11 (sur 284), que je n’aurais toujours rien compris à ce que me dégoisait le monsieur, même si j’insistais, j’ai évidemment refermé le bouquin. Définitivement, dois-je préciser.
Je ne suis pas philosophe, dieu merci. Pour être franc, j'ai du mal à prendre au sérieux les discours et les débats qui ont pour objet d'organiser le monde des abstractions. J'ai un esprit épouvantablement concret. Prosaïque. Terrestre. Pour vous dire, quand j’ai ouvert Anthropologie philosophique, de Bernard Grœthuysen, et que j’ai compris, après plusieurs lectures de la page 11 (sur 284), que je n’aurais toujours rien compris à ce que me dégoisait le monsieur, même si j’insistais, j’ai évidemment refermé le bouquin. Définitivement, dois-je préciser.
C'est un souvenir cuisant. Vaguement humiliant, même. C'est peut-être un handicap. Si c'est le cas, je dis : pitié pour les handicapés ! Je ne vois pas pourquoi je me gênerais. Je me suis fait ma religion : il y a deux sortes de savants. Oui, je sais, on va me ressortir l’histoire de De Gaulle disant à Malraux : « Il y a deux sortes de gens … », et puis, voyant s’allumer l’œil de son ministre, il complète et conclut : « … ceux qui pensent qu’il y a deux sortes de gens, et les autres ».
Désolé, je le répète, il y a deux sortes de savants : ceux qui parlent pour tout le monde, et ceux qui parlent entre eux. Par exemple, en psychanalyse, il y a Jacques Lacan, et puis il y a Didier Anzieu. Avec l’un, on reste entre spécialistes pointus. Avec l’autre, on est entre égaux (pas vraiment, mais quand il me parle, je comprends d’abord qu’il s’adresse à moi).
Je trouve pitoyable, voire méprisable, tout humain qui use du langage pour faire croire qu'il connaît des choses que tout un chacun serait infoutu de comprendre. Ce genre de pouvoir n'impressionne que ceux qui y croient. A cet égard, je suis un mécréant de l'espèce la plus incorrigible : je m'efforce de parler comme tout le monde, en offensant le moins possible la langue française. Je considère comme bien à plaindre celui qui éprouve le besoin d'intellectualiser et de créer des concepts abstrus (si possible innovants) pour avoir l'impression d'exister enfin. Et se donner l'apparence de comprendre le monde.
Chez les musiciens contemporains, c’est la même chose : il y a les très savants, qui considèrent mes oreilles comme des poubelles assez bonnes pour digérer ou recycler les déchets de leurs savants concepts (Nono, Berio, Boulez, Pauset, Stockhausen, Cage, …), et puis il y a ceux qui admettent que mes oreilles méritent quelques égards et un minimum de courtoisie, en plus du savoir-faire (Messiaen, Britten, Hersant, Grisey, Bryars, Kancheli, Pärt, …). C’est une philosophie de l’existence. C'est même un humanisme.
Tenez, l’autre jour, j’entendais Cédric Villani (qui arbore une cravate aussi impressionnante que sa médaille Fields), en tournée de promo pour l’album de bande dessinée qu’il vient de publier avec le formidable dessinateur Baudoin, Les Rêveurs lunaires (Gallimard / Grasset), sous-titré « Quatre génies qui ont changé l’histoire ». Villani est de ceux qui veulent, non pas faire de la « vulgarisation », mais réconcilier la science avec le grand public en faisant entrevoir à celui-ci les raisons de l’importance historique de certains chercheurs.
Paul Valadier, l’auteur de L’Anarchie des valeurs (Albin Michel, 1997), est de ceux qui s’adressent à tout le monde. C’est vrai qu’il a été formé pour ça : jésuite, il fut longtemps directeur de la revue de l’ordre, qui porte un titre aussi modeste que terriblement ambitieux, Etudes. Je connaissais un peu Jean Mambrino, poète, qui tenait pour la revue la rubrique de l’actualité poétique et théâtrale.
Dans L’Anarchie des valeurs, la langue n’a rien à voir avec quelque jargon technique. Valadier applique ce principe oratoire formulé jadis par le génial Chaïm Perelman (ne pas oublier Lucie Olbrechts-Tyteca) dans son Traité de l’argumentation (éditions de l'université de Bruxelles, 1988, pour la nouvelle édition) : s’adresser à un « auditoire universel » (I, § 7), pour virtuel qu’il soit. L' « auditoire universel » ! Quelle prétention ! Mais quel espoir ! Car il s’agit en définitive de faire de la connaissance acquise un objet socialisé. Un « Bien Commun », en quelque sorte, que tout un chacun soit en mesure de s’approprier pour peu qu’il en fasse l’effort.
Pourtant, le sujet de Valadier n’est pas évident : comment établir des valeurs ? Sur la base de quoi a-t-on le droit de fonder des jugements (de valeur) ? Ces « valeurs » que les responsables politiques, mais aussi les grandes entreprises, brandissent comme des étendards (je me souviens du panneau d’affichage dans le hall du siège de Mérial, à Gerland, qui trompetait fièrement « Nos Valeurs », et qui les énumérait). Hollande s’est particulièrement illustré dans ce domaine après le 7 janvier.
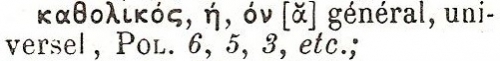
Si tout un chacun peut revendiquer ses valeurs, c’est la confusion. C’est l’anarchie, comme le dit le titre du livre. Le temps est fini où une religion pouvait, sans être contredite, s’intituler « catholique », c’est-à-dire « universelle », et imposer les valeurs constituant la Vérité révélée qu’elle voulait répandre (« propager » serait plus juste : on parle bien de « propagation de la foi »).
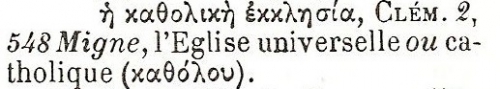
A cet égard, reconnaissons qu’elle a mis de l’eau dans son vin de messe, par la force des choses. Il faudra bien que l’Islam descende aussi de son piédestal de « Seul authentique détenteur de la Vérité révélée », même si ça n’en prend pas le chemin.
Maintenant qu’est réalisé l’inventaire exhaustif des sociétés humaines, des cultures, des croyances, des systèmes sociaux, la question se pose de savoir sur quelle base unique de valeurs pourrait s’amorcer un accord général de l’humanité entière. Autant le dire tout de suite : ce n’est pas simple, nul n’ayant l’autorité requise pour imposer à qui que ce soit sa manière de voir les choses et d’interpréter le monde.
Je n’ai pas envie de m’attarder sur les analyses et les références que livre Paul Valadier. C’est très savant et très documenté, il a beaucoup lu, beaucoup compris, c’est très subtil et très nuancé : le monsieur montre qu’il n’est pas sorti de nulle part, vu qu’il donne des gages incontestables de la connaissance qu’il a des enjeux de la discussion.
Moi qui suis le rustaud du service de com’, je vais vous dire, toutes ces références me font l’effet de « validation du permis de conduire » : Paul Valadier, bien qu’il sache qu’on connaît sa science de la chose, tient à montrer qu’il n’est pas philosophe pour du beurre et qu’il s’y connaît (il est jésuite). Et ça défile : Lefort, Boudon, Nietzsche, Hobbes, Marx, Dognin, Freud, Mauss, Proust, Lévi-Strauss, Saint-Exupéry, par ordre d’entrée en scène. Pardon, j’oubliais Kant (et quelques autres). Et l’on n’a fait que les quarante premières pages ! C’est le vice universitaire, sur lequel est fondé le rapport de la civilisation avec la connaissance : prouver qu’on sait de quoi on cause.
C'est aussi l'un des aspects rebutants de ce que l'on a appelé la scolastique.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, littérature, paul valadier, compagnie de jésus, jésuites, l'anarchie des valeurs, bernard groethuysen, anthropologie philosophique, relativisme, de gaulle, malraux, jacques lacan, didier anzieu, musique contemporaine, boulez, stockhausen, berio, messiaen, brittent, philippe hersant, gérard grisey, gavin bryars, cédric villani, edmond baudoin, les rêveurs lunaires, éditions gallimard, éditions grasset, revue études, éditions albin michel, chaïm perelman, traité de l'argumentation, mérial, gerland, catholique, église catholique, islam, claude lefort, raymond boudon, nietzsche, hobbes, karl marx, lévi-strauss, freud, marcel proust, christianisme
vendredi, 08 mai 2015
COCAÏNE ÜBER ALLES !
 Petit florilège de propos tenus par Roberto Saviano dans Extra pure (Gallimard, 2014).
Petit florilège de propos tenus par Roberto Saviano dans Extra pure (Gallimard, 2014).
Il tissa des liens avec certains parrains de Guadalajara, obtint le contrôle des aéroports et des pistes clandestines, corrompit José de Jesús Gutiérrez Rebollo, chef de l’Institut national pour la lutte contre la drogue qui, avec ses hommes, devint son bras armé, profitant de son solide réseau d’informateurs pour faire place nette des ennemis et des concurrents en échange de pots-de-vin de millionnaires. (p. 67)
***
La photo du corps de Barbas circule sur Internet : son pantalon est baissé afin qu’on voie son slip, et son tee-shirt remonté laisse apparaître un torse nu couvert d’amulettes et de billets de banque, pesos et dollars. C’est l’humiliation finale de l’ennemi. Les militaires nieront avoir touché le corps, mais il y a fort à parier que les techniques d’humiliation si chères aux nouveaux cartels comme les Zetas et les Beltrán Leyva eux-mêmes contaminent peu à peu les hommes payés pour y mettre fin. Armée et narcos de plus en plus semblables. (p. 72)
***
Les autorités américaines sont parvenues à fixer droit dans les yeux le cartel de Sinaloa et ce qu’elles ont vu, c’est une multinationale avec des liens et des ramifications partout dans le monde avec, au sein de son conseil d’administration, des supermanagers qui ont des relations dans tous les coins de la planète. (p. 74)
***
De nouvelles bourgeoisies mafieuses gèrent aujourd’hui le trafic de coke. (p. 102)
***
« Les Serbes. Méticuleux, impitoyables. Des bourreaux appliqués.
– Foutaises. Les Tchétchènes. Ils ont des lames si bien aiguisées qu’on se retrouve à terre, vidé de son sang, avant d’avoir compris ce qui se passait.
– Des amateurs à côté des Libériens. Ils t’arrachent le cœur alors que tu es encore en vie et ils le mangent.
(…)
– Et les Albanais ? Ils ne se contentent pas de te buter, toi. Non, ils s’occupent aussi des générations à venir. Ils balaient tout. Pour toujours.
– Les Roumains te mettent un sac sur la tête, ils t’attachent les poignets au cou et ils laissent le temps faire son œuvre.
– Les Croates te clouent les pieds, et tout ce que tu peux faire, c’est espérer que la mort arrivera le plus vite possible ». (p. 108)
***
Le résultat, c’est qu’après des années de politique de la terre brûlée, au sens littéral, la cocaïne colombienne représente encore plus de la moitié de toute celle consommées dans le monde. (p. 193)
***
Quand le chef d’un gang colombien explique pourquoi les AUC acceptent de négocier avec le gouvernement : « Pour la première fois, un gouvernement veut renforcer la démocratie et les institutions. Nous avons toujours réclamé la présence de l’Etat et fait appel à sa responsabilité. Nous avons pris les armes parce qu’il n’exerçait pas cette responsabilité. Nous avons dû nous substituer à lui dans les régions dont nous avons eu le contrôle territorial et où nous avons exercé une autorité de fait ». A la fois vrai et singulièrement culotté, évidemment. (p. 201)
***
Dans les hautes sphères colombiennes, on faisait des affaires et on collaborait avec les paramilitaires. Procureurs, hommes politiques, policiers, généraux de l’armée : certains pour avoir une part du gâteau sur le marché de la cocaïne, D’autres pour s’assurer votes et soutiens. (p. 204)
***
C’est lui qui l’arrose d’argent à blanchir au plus vite dans les Caraïbes : six cent soixante et onze millions huit cent mille lires plus cinquante mille dollars, puis deux tranches de trois cent quatre-vingt-dix-huit millions trois cent cinquante mille lires et trois cent soixante-neuf millions quatre cent cinquante mille lires, le tout en l’espace d’un an et demi. (p. 274)
***
C’est pourquoi les prêts interbancaires ont systématiquement été financés par l’argent provenant du trafic de drogue et par d’autres activités illégales. Certaines banques ne doivent leur salut qu’à cet argent. Une grande partie des trois cent cinquante-deux milliards de narcodollars estimés a été absorbée par l’économie légale et donc parfaitement blanchie.
Trois cent cinquante-deux milliards de dollars : les gains du narcotrafic représentent plus d’un tiers de ce qu’a perdu le système bancaire en 2009, comme l’a dénoncé le FMI, et ce n’est que la partie émergée ou perceptible de l’iceberg vers lequel nous nous dirigeons. (p. 302-304)
***
New York et Londres sont aujourd’hui les deux plus grandes blanchisseries d’argent sale du monde. Ce ne sont plus les paradis fiscaux, les îles Caïmans ou l’île de Man, mais la City et Wall Street. (p. 304)
***
L’ironie a voulu que le coup dur soit venu précisément du pays le plus renommé pour sa vieille tradition de secret bancaire, la Suisse, où les poursuites judiciaires contre Salinas [frère d’un ancien président du Mexique : tiens donc !] se sont prolongées pendant de nombreuses années. Elles ont également continué après que Carla Del Ponte fut devenue procureur du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie à La Haye, se consacrant aux crimes de Slobodan Milosevic, et elles se sont conclues par un procès au cours duquel le juge suisse a établi que les structures de l’Etat mexicain protégeaient le trafic de drogue et que l’argent ne pouvait avoir des origines légales. (p. 311-312)
***
La mafia russe a émergé grâce à des hommes en mesure d’exploiter avec intelligence et férocité les nouvelles possibilités qui s’offraient, mais aussi parce qu’ils ont derrière eux une histoire faite de structures et de règles leur permettant de régner sur le Grand Désordre. Après des années passées à naviguer dans les égouts criminels du monde entier, je peux affirmer que c’est toujours ce qui favorise le développement des mafias : la vacance du pouvoir, la faiblesse, la corruption d’un Etat qui a en face de lui une organisation proposant et incarnant l’ordre. (p. 320)
***
Les "vory" [chefs mafieux en Russie] repéraient ce à quoi le peuple n’avait pas droit au nom du communisme et apportaient chez les dirigeants du Parti les bienfaits du « sale capitalisme ». Ainsi s’est forgée entre la nomenklatura et la criminalité organisée une alliance destinée à avoir d’énormes répercussions. (p. 322)
***
En Amérique latine et en particulier dans les Caraïbes, les Russes ont trouvé des Etats aussi faibles que ceux qui ont permis l’ascension de la Mafija : corruption, délinquance omniprésente, système bancaire perméable, juges complices. (p. 344)
***
Voilà ce qu’il dit, Roberto Saviano.
Note : Le Monde daté 8 mai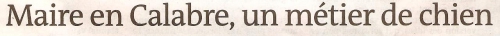 (c'est aujourd'hui) confirme (p. 14).
(c'est aujourd'hui) confirme (p. 14).
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : trafic de drogue, narcotrafiquants, roberto saviano, gomorra, extra pure, éditions gallimard, mafia, n'dranghetta, camorra napolitaine, mafias serbes, mafias tchétchènes, cartel de sinaloa, cartel de guadalajara, mafias, mafias albanaises, cartels colombiens, cocaïne, blanchiment d'argent sale
jeudi, 07 mai 2015
COCAÏNE ÜBER ALLES !
 Quand il a publié Gomorra (en 2006, Gallimard, 2007), Roberto Saviano ne se rendait pas compte qu’il commettait une sorte de suicide. S’il dédie Extra pure (Gallimard, 2014) « à tous les carabiniers qui ont assuré [sa] protection rapprochée », c’est parce que, depuis bientôt dix ans, tous les clans de la « Camorra » qui sévissent à Naples et dans toute la Campanie se sont juré de l’assassiner. Qu’il ne compte pas trop sur Extra pure pour arranger ses affaires. Au contraire.
Quand il a publié Gomorra (en 2006, Gallimard, 2007), Roberto Saviano ne se rendait pas compte qu’il commettait une sorte de suicide. S’il dédie Extra pure (Gallimard, 2014) « à tous les carabiniers qui ont assuré [sa] protection rapprochée », c’est parce que, depuis bientôt dix ans, tous les clans de la « Camorra » qui sévissent à Naples et dans toute la Campanie se sont juré de l’assassiner. Qu’il ne compte pas trop sur Extra pure pour arranger ses affaires. Au contraire.
Qu’est-ce qu’ils lui ont fait, les mafieux de la terre entière, pour qu’il vienne les embêter comme ça, à mettre toutes leurs combines en plein vent, sur la place publique. Et non content d’asticoter les hyènes et chacals qui règnent sur Naples et alentour, voilà qu’il remet ça, mais dans les grandes dimensions.
Dans Extra pure, voilà donc qu’il se farcit, dans l’ordre et successivement : 1 – les pires gangs qui ont fait de l’Etat mexicain un arbre pourri des racines à la cime ; 2 – les pires cartels (et milices paramilitaires) qui ont fait de la Colombie un champ de bataille dévasté ; 3 – les pires « mafijas » parties de Russie à l’assaut du monde ; 4 – les pires clans de la N’dranghetta calabraise qui, depuis l’Italie, ont tissé leurs réseaux commerciaux de la Ruhr à l’Australie ; 5 – les pires filières africaines qui ont ouvert à la coke sud-américaine des autoroutes vers l’Europe.
Il a même un mot de commisération pour les enfants de chœur de la pauvre Camorra napolitaine, qui apparaît sur la photo comme le cousin disgracié de la famille, après être apparue comme dangereuse, infaillible et toute-puissante dans Gomorra. C’en est touchant. Peut-être qu’il est déçu que les premiers gangsters dont il a fait ses ennemis soient aujourd’hui relégués dans les profondeurs du classement criminel international.
pauvre Camorra napolitaine, qui apparaît sur la photo comme le cousin disgracié de la famille, après être apparue comme dangereuse, infaillible et toute-puissante dans Gomorra. C’en est touchant. Peut-être qu’il est déçu que les premiers gangsters dont il a fait ses ennemis soient aujourd’hui relégués dans les profondeurs du classement criminel international.
Cela dit, je ne suis pas sûr que son livre serve à grand-chose : y aura-t-il une prise de conscience des gouvernements du monde ? S’entendront-ils pour éradiquer le commerce de cocaïne ? L’auteur lui-même sait que non : il le dit quelque part vers la fin. Il sait qu’Extra pure est un coup d’épée dans l’eau. Un de plus. Je crois qu’il est lucide. Donc désespéré. Pour ne pas désespérer, il faut croire. Roberto Saviano ne croit pas : il sait. Les gouvernements aussi, ils savent. Mais ils ne veulent pas. On pourrait peut-être au moins leur demander pourquoi ?
Par-dessus le marché, il n’a pas choisi la facilité. D'abord l'épaisseur des 450 pages. Et puis aussi, question de style et de choix de narration. Il lui arrive trop souvent, en plein chapitre, de changer de sujet pour y revenir un peu plus loin. C’est le cas p. 391, où il abandonne soudain le « mulet » Mamadou pour énumérer les pays qui ont fait de l’Afrique un « continent blanc » (blanc de la neige qu’on devine, bien sûr), et revenir à Mamadou une fois l’énumération achevée.
Cela fait un livre à l'exposition lourdingue, souvent difficile à suivre, à cause du touffu de l’exposé. Ça m'étonnerait que ça fasse un best-seller. C'est dommage, vraiment. Avec un livre plus clair, plus "pédagogique", l'auteur aurait peut-être été plus efficace. Je regrette qu'il manifeste ici quelques prétentions littéraires. J'ai même cru, au début, qu'il se prenait pour un écrivain. J'aurais préféré un documentaire sec.
Et puis il y a aussi l’aspect « Litanie des Saints » (ou plutôt « Litanies de Satan », extension imprévue du titre de Baudelaire) : quand on a fini les chapitres consacrés au Mexique, on a passé en revue une kyrielle de noms de parrains, une ribambelle de noms de gangs, un chapelet de nom de lieux, une cascade de morts, de cruautés, de têtes coupées et de tortures toutes plus atroces les unes que les autres. On a envie de crier grâce. N’en jetez plus. Cela donne une impression si glauque et dangereuse du Mexique, que je finis par me demander si la réalité en est vraiment descendue à un tel degré de pourriture.
On a l’impression que la drogue fait couler tellement d’argent dans les poches des « Narcos », que les gangs peuvent acheter les services de n’importe qui, à tous les niveaux des hiérarchies officielles : responsables politiques, administratifs, économiques, militaires et policiers. L’armée et la police semblent si gravement gangrenées, les bandits sont si bien organisés et informés que très peu d’opérations dirigées contre eux réussissent, et même que certaines apparaissent comme secrètement téléguidées par un gang rival pour éliminer un concurrent.
C’est un livre qui fout la trouille, qui donne l'impression d'être passé derrière le rideau de la réalité du monde : non contents de semer la mort violente, la corruption des pouvoirs, en plus de l’addiction des clientèles à la coke, les narcotrafiquants arrivent à « blanchir » des sommes d’argent tellement astronomiques pour les réinjecter dans l’économie légale, qu’il semble désormais tout à fait impossible pour les polices financières du monde entier de faire la différence entre l’argent propre et le sale.
Saviano, évoquant la crise financière de 2007/8, affirme même que la masse d’argent sale a sauvé quelques banques de la faillite. Le juge Jean de Maillard (voir mon billet du 9 mars) et les services « Tracfin » de toutes les polices peuvent toujours courir après les responsables du marché de la drogue mondialisée, les gangs sont organisés de façon tellement souple et ingénieuse, que ce ne sera jamais qu’une toute petite partie du trafic (la « partie émergée de l’iceberg », dit l’auteur, des circuits d'approvisionnement en coke et des circuits financiers de blanchiment) qui sera stoppée et saisie. Je veux bien le croire.
La drogue aujourd’hui, à commencer par la cocaïne, qui arrive en tête du hit parade, fait l’objet d’un commerce qui repose sur une organisation digne des entreprises transnationales les plus performantes et réactives. Certains mafiosi ont l’envergure des plus grands capitaines d’industrie. L’auteur évoque par exemple la figure de Mogilevic, « le Brainy Don », « le parrain au QI stratosphérique » (p. 314), génial organisateur.
Tous les « métiers » de la grande entreprise sont représentés dans les gangs de la drogue par des gens talentueux, toutes les qualités des plus grands entrepreneurs sont présentes chez les personnels de ces multinationales criminelles : le sens de l’organisation, le flair dans le repérage des marchés potentiels, le sens des affaires, l’ingéniosité financière, une adaptabilité presque infinie et immédiate des circuits. Sans parler des chimistes de haut niveau qui s'occupent de toutes les phases de la transformation des feuilles de coca en poudre blanche, capables d'obtenir un produit pur à 95 %.
La structure de ce marché mondial est donc exactement calquée sur le modèle en vigueur dans l’économie capitaliste. Mieux : l’intrication de l’économie légale et de l’économie criminelle est telle qu’on ne saurait lutter contre la seconde sans nuire gravement à la première. Saviano le dit : « J'essaie de comprendre [Mogilevic] jusque dans le moindre détail, pour me démontrer avant tout à moi-même à quel point le monde des affaires est lié à celui de la criminalité » (p. 314).
Si je mets bout à bout quelques lectures récentes a) sur le fonctionnement dément et destructeur du capitalisme actuel ; b) sur l’effacement de la frontière entre économie légale et économie criminelle ; c) sur l’affaiblissement dramatique des puissances étatiques face aux forces qui veulent privatiser le monde (hommes, bêtes et choses) à leur profit ; d) sur l’étau policier qui se resserre autour de l’Etat de droit et de l’individu, je me dis que ça commence à faire beaucoup pour une seule humanité, et que bientôt, on ne pourra plus dire, comme le fait quelqu'un de bien connu : « On n’est vraiment bien que sur notre bonne vieille terre ». 

Voilà ce que je dis, moi.
Note : demain, quelques morceaux choisis dans le bouquin pour illustrer le présent billet.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roberto saviano, gomorra, extrapure, éditions gallimard, drogue, mafia, cosa nostra, camorra napolitaine, n'dranghetta calabraise, cartels mexicains, cartel de medellin, cartel de cali, baudellalire litanies de satan, narcotrafiquants, jean de maillard, le rapport censuré, capitaine haddock, tintin, on a marché sur la lune, bande dessinée, hergé
dimanche, 22 mars 2015
ENCORE MODIANO
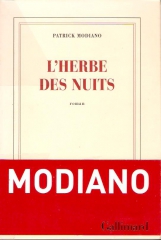 J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.
J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.
Si j'ai tardé à l'évoquer, c'est que mon intérêt pour Modiano, s'il ne s'était pas tout à fait éteint, peut-être avait-il tiédi. L'attribution du Nobel a, disons, réchauffé ma curiosité. Je ne regrette jamais d'avoir lu un livre, même quand j'en sors frustré. Quand j'arrête la lecture en cours de route, c'est que le livre m'a mis en colère, ou alors m'est tombé sur l'ongle incarné (trop lourd, sans doute : je parle du "poids" du livre).
Les prix littéraires, soit dit entre nous, je n’en pense rien, tant la valeur d’un livre ou d’un écrivain me semble incommensurable à sa reconnaissance officielle par une assemblée pontificale, quelle qu’elle soit. Un rite d'autocélébration, en quelque sorte. Une ambiance du genre « Bienvenue au club ! ».
De toute façon, ce qu'on appelle "Grand Prix", vous savez, ces récompenses célébrant les "talents", surtout quand on navigue en milieu littéraire, poétique ou artistique (en gros, ce qu'on appelle les "Affaires Culturelles"), ne sont que des moyens pour une classe dominante de faire passer, en direction des classes dominées, un message du genre : « Vous voyez bien, quand on veut, on peut y arriver ! ». En même temps que ça renforce la légitimité de l'ordre établi (fonction réelle de l'arrosage saisonnier à la Légion d'honneur). Avec ça, je passerai peut-être pour un bolchevique.
Quand on veut, on peut ! Voilà bien un refrain que je hais, un refrain qui sent son moralisme archéo-chrétien, et même pas très catholique. Machine à culpabiliser. Parlez-en au chômeur du coin, qui se heurte aux portes closes de la raréfaction du travail et à qui des Sarkozy viennent faire la leçon : si tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas ! C'est de ta faute ! Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même ! On va te couper les vivres !
Conclusion, en effet : quand on n'y arrive pas, c'est qu'on ne le mérite pas. Modiano, au Nobel, rachète heureusement sa soumission à ce protocole "chez les puissants" par une maladresse existentielle à peu près pathologique, qui ressemble d'assez près à sa littérature, preuve d'une sincérité impossible, je crois, à contrefaire. Si c'était "joué", il serait vraiment très salaud. Parce que, franchement, l'expression « une maladresse existentielle pathologique », ça ressemble d'assez près à une analyse littéraire de l'oeuvre de Patrick Modiano, vous ne trouvez pas ?
Patrick Modiano ressemble juste à l’idée que je me fais du véritable écrivain : celui qui est capable de créer un univers reconnaissable à quelques traits, de la même manière qu'on sait, après deux mesures, qu’on entend « du Chopin » ou, à la translucidité d'une main d'enfant devant la flamme d'une bougie, que l’on contemple « un Georges de La Tour ».
Ce n’est pas une raison pour avaler tous les titres de l’écrivain en file indienne. Pour Chopin, c'est la même chose : pas besoin d'aligner sur la platine les 12 CD de l'intégrale chronologique des œuvres pour piano seul de Frédéric Chopin par Abdel Rahman El Bacha. On sait déjà.
La seule expérience que j’ai faite de cette « méthode », ce fut avec l’œuvre de Henri Bosco, qui, en dehors de deux ou trois titres, n’a plus de secrets pour moi. Pardon : "la seule", c'est inexact : j'ai aussi fait ça avec les Rougon-Macquart (ce qui, entre parenthèses, m'a guéri de la Zola-rziose).
J’ai fait une tentative semblable avec un recueil d’ouvrages de Françoise Sagan (collection Bouquins) : j’ai calé au bout du cinquième, à cause, je crois, de l’atmosphère raréfiée de bocal à poissons rouges, de l'espèce des nantis à l'existence futile, dans laquelle elle plonge le lecteur. Ne pas confondre l'oeuvre littéraire avec le feuilleton. Après tout, il y a peut-être du feuilletoniste chez Modiano. Je dis peut-être une grossièreté ? Tant pis.
Je ne désespère pas de me remettre à la lecture chronologique de La Comédie humaine, abandonnée elle aussi, mais au bout d’une trentaine de titres tout de même. Balzac, c'est autre chose, il dépasse de loin la somme des recettes successives qu'il met en oeuvre. Et je reviens, bien entendu, assez régulièrement, à Simenon, entre autres à ses « Maigret », après avoir éclusé une trentaine également de ces derniers.
Je ne conseille par conséquent à personne de procéder de cette manière avec les romans de Patrick Modiano. Je n’userai pas du poncif de la « petite musique » qui sert d’échappatoire au « critique littéraire » qui n’a pas envie de se fouler pour entrer dans des considérations un peu précises et sérieuses. Il se trouve cependant qu’en ouvrant L’Herbe des nuits peu de temps après avoir lu Pour que tu ne te Perdes pas …, j’ai eu la curieuse impression de lire un décalque de celui-ci.
Même petit carnet rempli de notes diverses. Même ribambelle de noms, de dates, d’adresses, de numéros de téléphone, de lieux de rendez-vous, dont beaucoup ne disent plus rien au narrateur, perdus dans le brouillard d’un passé qu’il cherche à ressaisir, mais il a bien du mal, le pauvre, avec tout le temps qui a passé. Même genre de personnage féminin énigmatique (« Dannie »), à l’identité fuyante.
Même milieu interlope où cette femme évolue, au milieu de noms d’hommes un peu louches : un « Aghamouri », agent secret qui fait semblant d’être étudiant, un « Paul Chastagnier » qui donne au narrateur des « conseils d’ami ». Un « Unic Hôtel », quelque part à Montparnasse, dans le hall duquel ces hommes se retrouvent.
Peu importe au fond la succession des faits dont le livre se fait un argumentaire en quelque sorte obligé. Les récits que Modiano élabore dans ses romans n’ont rien d’événementiel. Non, pas de rebondissements, rien de spectaculaire, pas de tragédie grandiose. L’amateur de ce genre de littérature ne le trouvera pas ici.
L’étoffe dont sont tissés les livres de Modiano est de nature différente. Si je voulais résumer les impressions que me laisse L’Herbe des nuits, je commencerais par dire : une littérature d’état d’âme ; une littérature de climat. L’état d’âme d’un homme qui a été « mal jeté dans la vie » (j’ai connu un Benoît Vauzel  dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.
dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.
Du narrateur lui-même, d’ailleurs, on n’apprendra que des bribes, livrées parcimonieusement, par intermittence. Le narrateur en personne est un peu fuyant, c’est certain : il ne tient pas à laisser de traces derrière lui. Et puis, il semble fatigué, ce narrateur, dépressif peut-être ? C’est bien lui qui dit : « Mais, je n’y peux rien, en ce temps-là j’étais aussi sensible qu’aujourd’hui aux gens et aux choses qui sont sur le point de disparaître » (p. 89).
Dans L’Herbe des nuits, comme dans beaucoup de livres de Modiano, tout le monde pose beaucoup de questions. Quasiment aucune d’entre elles ne reçoit de réponse. Ici, il faut la convocation du narrateur par un certain Langlais, quai de Gesvres, pour qu’il réponde à des questions. On comprend que c'est un policier. Dans les livres de Modiano, j’ai l’impression que, quand ce n’est pas la police qui pose les questions, celles-ci ne reçoivent jamais de réponse. Et encore … Mais je me dis qu'après tout, la police ne pose jamais les bonnes questions.
Car il y a ce détour par la surprenante amitié de Langlais pour Jean, le narrateur, pour accéder à la clé de certains mystères. Pas tous, qu’on se rassure. Et même loin de là. « Dannie » a-t-elle finalement commis un crime ? La personne qui a reçu « deux balles perdues » a-t-elle, dans le passé, été victime d’une erreur de manipulation ou d’une intention claire ? Personne n’est en mesure de répondre. Même la police échoue à faire toute la lumière sur certaines petites choses finalement triviales de la réalité.
L’univers mental dans lequel se débattent désespérément, roman après roman, les héros de Patrick Modiano, est un univers à jamais flottant. Un univers où personne ne répond aux questions, en particulier à la question « Pourquoi ? ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature française, patrick modiano, l'herbe des nuits, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, prix nobel de littérature, éditions gallimard, collection blanche, affaires culturelles, nicolas sarkozy, abdel rahman el bacha, émile zola, henri bosco, rougon-macquart, françoise sagan, collection bouquins, la comédie humaine, honoré de balzac, georges simenon, commissaire maigret, benoît vauzel mal jeté dans la vie
samedi, 14 mars 2015
YANNICK HAENEL, C'EST QUOI ?
1/2
 J’ai acheté puis lu Je Cherche l’Italie après avoir entendu Yannick Haenel en parler lors d’une interview radiophonique. Tewfik Hakem avait fait un parallèle entre cet ouvrage et l’univers houellebecquien. L’interview avait mis l’accent sur un aspect de la démarche : Haenel est allé vivre à Florence en emmenant femme et enfant, pendant trois ans. L’auteur décrivait la catastrophe dans laquelle la « modernité » économique, personnifiée dans cette verrue obscène qui a nom Berlusconi, avait plongé l’Italie. Le discours attirait mon attention.
J’ai acheté puis lu Je Cherche l’Italie après avoir entendu Yannick Haenel en parler lors d’une interview radiophonique. Tewfik Hakem avait fait un parallèle entre cet ouvrage et l’univers houellebecquien. L’interview avait mis l’accent sur un aspect de la démarche : Haenel est allé vivre à Florence en emmenant femme et enfant, pendant trois ans. L’auteur décrivait la catastrophe dans laquelle la « modernité » économique, personnifiée dans cette verrue obscène qui a nom Berlusconi, avait plongé l’Italie. Le discours attirait mon attention.
A l’entendre, au cours de son séjour, il n’avait pas rencontré d’Italiens : seulement des Sénégalais, qui refusaient de parler le français qu’ils connaissent, et ne s’exprimaient qu’en italien. A l’entendre, son livre était majoritairement consacré au tableau apocalyptique qu’il dressait de l’Etat italien et de sa décomposition, et du sort misérable dans lequel vivaient les dits Sénégalais, exposés aux cruautés des mafias qui les exploitaient et les terrorisaient. C’est cela qui avait motivé mon achat : je m’attendais à lire l’œuvre d’un cousin de Houellebecq, et apprendre des choses sur l’état du monde.
Quelques pages m’ont suffi pour déchanter. Il m’a donc fallu un rien d’obstination pour achever ma lecture : je tenais à ne pas avoir claqué pour rien 17,5 €. Autant rentabiliser. Heureusement, le livre est léger (à peine 200 pages), mais léger à tous les sens du terme. Futile comme un fétu qui fuit au vent mauvais qui l'emporte, pareil à la feuille morte. En un mot : un livre inutile. La parenté supposée avec Michel Houellebecq est une pure postulation imaginaire. Une maldonne. Une imposture.
D’ailleurs, au cours de l’interview, Yannick Haenel a tenu à se démarquer de ce cousinage hasardeux et encombrant. Pour lui, la littérature de Houellebecq est marquée par une détestable haine de soi et du monde. Autant dire, à ce stade, que Yannick Haenel ignore ce que peut (doit ?) être la grande littérature, syndrome largement partagé par les poissons et les grenouilles qui s’ébattent dans le marigot littéraire parisien. Yannick Haenel est l’un des innombrables descendants de « La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf ».
Qu’en est-il des Sénégalais italiens, dans Je Cherche l’Italie ? On en croise un, très vaguement, aux pages 12 et 13 : « Le jeune Noir était sénégalais, il venait de l’île de Gorée ». Ah, l’île de Gorée, Obama demandant pardon au continent africain pour le honteux trafic d’êtres humains à travers l’Atlantique ! Quel symbole !
Et puis le jeune Noir refait une apparition aux pages 119 à 121, où l’on apprend que son prénom, Issa, est le nom arabe de Jésus. Au total, trois pages de texte. Un point c’est tout. Autrement dit une crotte de mouche. La réalité sordide dans laquelle est plongée l’Italie fait l’objet de quelques flashs, allusions et incidentes, trop courts cependant pour former un sujet à part entière. Encore moins former le sujet du livre. L’interview radio faisait une publicité mensongère. Comme souvent, quand un auteur est doué oralement pour vendre sa camelote. Bien fait pour moi. Ça m’apprendra. Peut-être.
Bon, alors de quoi parle-t-il, ce bouquin ? Eh bien c’est très simple : Yannick Haenel parle de Yannick Haenel. C’est un truc très à la mode dans le marigot littéraire parisien : Christine Angot parle de Christine Angot ; Emmanuel Carrère parle d’Emmanuel Carrère…. Alors pourquoi pas lui, n’est-ce pas ? Qu’ont-ils donc tous, à faire étalage de leur moi ? De leur agenda ? De leurs petites réflexions sur eux-mêmes et le sens de la vie ?
Mais attention, Yannick Haenel ne parle pas de lui-même comme s'il était n’importe qui. Yannick Haenel n’est pas le premier venu, il faut que ça se sache. Cet homme est tellement plein de lui-même que toute sa prose exsude son moi comme s’il en pleuvait. Il arrose la compagnie de l’onction de soi-même, plus fort que Dassault n’achète ses électeurs. Il faut que le lecteur sache qu’il est en face d’un intelligent, qui fait profession d’intelligence et de culture : Yannick Haenel en personne.
Et puis il faut aussi qu’on sache que l’auteur est en très bonne et très auguste compagnie. C’est ainsi que le lecteur est invité à assister à un déluge : c’est, de la première à la dernière page, une cataracte, une avalanche de noms propres, de références, toutes plus savantes les unes que les autres. Une ribambelle de noms propres assez connus pour être incontestables, assez haut placés pour inspirer le respect. Une forêt d’oriflammes brandis comme des slogans. Attention les yeux ! Yannick Haenel vous en met plein la vue.
Vous ne savez plus où donner de la tête : entre les références à Nietzsche et les commentaires sur Georges Bataille (omniprésent tout au long des pages, pensez, il lit chacun des douze volumes de ses Œuvres complètes (Gallimard, des gros pavés) dans l’ordre chronologique), l’auteur vous assène : « Je lis Hegel, Bataille, Kojève » (p. 73). Ici, ce sera un « dropping » de Rimbaud, là un miasme de Maurice Blanchot, ailleurs une crotte de Guy Debord, plus loin, quelques relents de La Divine Comédie, etc.
Cette toile de fond de noms propres à grosse réputation, je vais vous dire, c’est juste fait pour intimider, exactement comme les hooligans se servent des signes d’une violence possible pour se rendre maîtres du terrain. Là, ce n’est plus dans la vue, c’est dans les gencives, car Hegel, il faut vraiment vouloir : quel héroïsme, quand même, ce garçon. Essayez seulement la « Préface » à La Phénoménologie de l’Esprit. Mais mon esprit épais et rustique est rétif à la philosophie, du moins ainsi entendue. Question d'altitude, sans doute.
Et puis, une bonne projection de postillons de noms propres à prestige dans la figure de l'interlocuteur, au fond, pas de meilleur moyen pour ne pas entrer dans le détail des problématiques propres à chacun. "Je lis Hegel", c'est comme un cuistot qui vous dit "ça mitonne", mais se garde bien de soulever le couvercle pour vous faire renifler la réalité de sa tambouille. Ça évite de fatiguer le lecteur, en même temps que ça le muselle. Je me rappelle quelques prestations et articles d’un certain Philippe Sollers, où celui-ci, tel un Larousse des noms propres, semait pareillement à tout vent les références savantes, pour dire que, n’est-ce pas …
C’est peut-être un hasard (mais j’en doute) si Je Cherche l’Italie est publié dans la collection « L’infini », dirigée par … Philippe Sollers. Toujours côté noms propres : « Qu’est-ce qui échappe au capitalisme ? L’amour ? La poésie ? Lacan disait : la sainteté » (p. 89). Et toc : voilà pour Lacan. Et puis avec le Sénégalais : « Comment s’appellent tes dieux ? – Chrétien de Troyes, Dante, Kafka ».
Yannick Haenel a mis toute la culture européenne et chrétienne dans son grand sac. Du moins, en affiche-t-il un concentré des signes prestigieux de la culture. En porte-t-il la chose ? On n'est pas forcé de le croire.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yannick haenel, je cherche l'italie, éditions gallimard, collection l'infini, philippe sollers, france culture, tewfik hakem, un autre jour est possible, michel houellebecq, silvio berlusconi, italie, mafia, littérature française, île de gorée, christine angot, emmanuel carrère, serge dassault, georges bataille, hegel, kojève, guy debord, la phénoménologie de l'esprit, jacques lacan
mardi, 12 août 2014
LE LIEVRE DE PATAGONIE 1/4
Claude Lanzmann : Le Lièvre de Patagonie (Gallimard, 2009).

Pour parler franchement, je n’avais pas du tout l’intention de lire Le Lièvre de Patagonie, de Claude Lanzmann. Mais les circonstances en ont décidé autrement. Il se trouve que, passant un matin devant la vitrine du « Livre à Lili », rue Belfort, je l’ai vu bien en évidence, et au prix imbattable de trois euros, s’il vous plaît, au lieu de vingt-cinq vendu neuf. Comme dit le futur "parrain", dans Le Parrain 2 : on me faisait une offre que je ne pouvais refuser. Pas le pistolet sur la tempe, quand même. Neuf, le bouquin l’était, je suis prêt à parier qu'il n’avait jamais été ouvert. Je n’ai pas hésité trois secondes. Je n’ai pas regretté mes trois euros.
J’avais un préjugé : les apparitions médiatiques controversées, tonitruantes et péremptoires de l’auteur m’avaient fait fuir. J’avais eu en son temps un préjugé analogue à l’égard de Michel Houellebecq qui, en suscitant des "pour" enthousiastes et des "contre" furibards qui s'étripaient en place publique, m’avait rebuté, avant que je franchisse le pas un jour avec Les Particules élémentaires, livre qui m’avait convaincu que son auteur était un authentique et excellent romancier. Du genre qui a tout compris de la société où il vit et de celle qui s’annonce. Et puis qui sait l'écrire pour le faire passer. Et qui, à cet égard tout au moins, me fait penser à Balzac.
Pareil pour Lanzmann : le personnage public, qui ne se privait pas d’intervenir avec véhémence quand on parlait des Juifs ou d’Israël, m’avait fait fermer les écoutilles. Quand la rumeur publique dépasse un certain nombre de décibels médiatiques, je n'y suis plus pour personne, je me mets aux abonnés absents. En plus, quand j’ai ouvert le bouquin, je dois dire que je n’ai pas été encouragé.
Le personnage, encore lui, a quelque chose d’assez déplaisant : que m’importe à moi, qu’un haut gradé de la chasse israélienne propose à monsieur Lanzmann de faire un tour sur le siège passager d’un F16 ? Et que monsieur Lanzmann, pourtant âgé de soixante ans, en sorte frais comme l’œil et sans avoir rempli de vomi le sac fourni à cet effet, mais de respect l’officier ébahi, sous les applaudissements du tarmac entier ?
Que m’importe que Claude Lanzmann ait fait ceci, cela, et encore ça et ça et ça ? Rien à faire du fatras biographique, où l’auteur « en installe » complaisamment. Mais c’est vrai que ça me saoule très généralement, le déluge de « vies des autres » dont les médias nous submergent. Car il n'y a pas de vie exemplaire. Au point que je me demande pourquoi l'on nous bombarde de confitures biographiques en nappes denses sur des tartines épaisses comme ça.
Ce ne sont que « portraits » dans Libération et Le Monde, ce ne sont que « talk shows » radiophoniques, où un animateur complaisant (Marcel Quillé-Véré sur France Musique, entre autres) déroule le tapis devant l’invité, avec une dévotion plus ou moins fabriquée, en vue de lui faire raconter les mille péripéties de son existence évidemment passionnante. Je ne parle pas de la télévision, qui passe son temps à étaler des vies intimes, ni du genre « biopic », qui envahit le cinéma des rangs serrés de toutes ses Edith Piaf, de tous ses Ray Charles et de tous ses Truman Capote.
Le récit de leur petite vie par de petits comédiens, de l'écriture de leur premier roman par des premiers romanciers, du couronnement de leur œuvre quand il s'agit de Jean d'Ormesson (notez que son dernier est toujours le couronnement de son œuvre), ou même de leur grande carrière par de grands pianistes, à qui l’on demande de raconter par le menu comment ils ont fait pour arriver là, ça finit par saturer l’espace. Et ne dit strictement rien de l'œuvre pour laquelle ces VRP de leur propre image sont en « tournée de promo ». Et rien, à plus forte raison, de ce qui en restera.
Je suis même d’avis que cette inflation de « vies des autres » dans les médias a pour effet de tenir en respect, d’intimider les gens genre « monsieur tout le monde », à la masse desquels j'appartiens, mais dont il ne viendrait l’idée à aucun journaliste de solliciter une interview approfondie. Selon les journalistes et les directeurs d'antenne, il y a les vies intéressantes, et puis il y a toutes les autres, qui s'appellent "la plupart". Ou encore mieux : « La foule des anonymes ». Tout ça a pour effet de convaincre tous les « monsieur tout le monde » que la vie qu’ils vivent, non, ce n’est pas ça, « la vraie vie ». On les a convaincus que la vraie vie, c'est quand ils ont pu se voir à la télé. Comme une preuve officielle.
A force de voir que tant de gens ont « réussi leur vie », puisqu’on leur fait l’honneur de leur demander de la raconter à un public ébloui, chacun n’est-il pas tenté de se dire que la sienne est ratée ? De se dire que tant qu'il n'a pas raconté sa vie à la télé, il n'existe pas ?
A force de s’intéresser à la « vie des autres » (tout au moins ce qu’ils en montrent ou en disent), pour un peu, on oublierait qu’on a une seule vie à vivre pour son propre compte, et qu’il n’y a personne pour la vivre à notre place. Et que la télévision a été inventée pour nous faire oublier cette tragédie. Avec soi-même, on est constamment "en direct". Et il n'y a pas de "rewind". Revenons à nos moutons.
Dès l’avant-propos du bouquin de Lanzmann, on est prévenu : « Il est vrai, on m’a dit mille fois, de mille côtés, que je devais à tout prix écrire ma vie, qu’elle était assez riche, multiple et unique pour mériter d’être rapportée ». Que ce soit clair : tout le monde s'y est mis, à genoux : « Claude, allez, raconte ta vie ! ». Monsieur Lanzmann a cédé à des instances plus fortes que lui qui, à force d’insister, sont venues à bout de sa réticence à parler de lui-même. Sans ça vous pensez bien que …
Et attention les yeux : « J’en étais d’accord, j’en avais le désir, mais après l’effort colossal de la réalisation de Shoah, je n’étais pas sûr d’avoir la force de m’attaquer à un travail de si grande ampleur, de le vouloir vraiment ». Il est d'accord pour considérer sa propre vie comme infiniment digne d'intérêt. Et elle est d'une "si grande ampleur" ! Qu’on comprenne bien : monsieur Lanzmann n’a jamais été effleuré par le doute, ce qui ne me prépare pas à éprouver une grande sympathie pour lui. La force de son moi est incommensurable. Heureusement, le monsieur n'est pas du tout porté au narcissisme. C'est un qualité essentielle du livre : pas d'étalage.
Pourtant on pourrait le croire quand il affirme : « Je me tiens pour un voyant ...» (p. 285). Heureusement, son hommage à Moby Dick de Melville (p. 254) m'avait prévenu en sa faveur. Mais on comprendra peut-être que le bonhomme puisse susciter des réactions pour le moins "contrastées", génial pour les uns, insupportable pour les autres. Pour moi, c'est les deux à tour de rôle.
Voilà ce que je dis, moi.

