mardi, 02 juin 2020
L'IRIS DE SUSE, FORCÉMENT 1
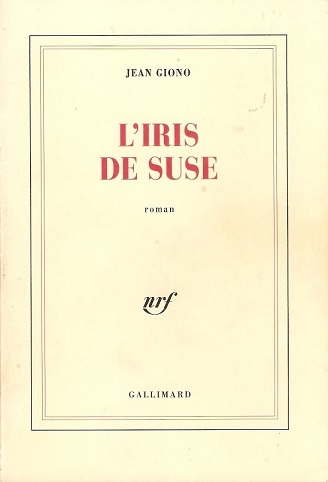
1
J’émerge de la lecture de L’Iris de Suse, dernier roman de Jean Giono, paru en 1970, l’année de sa mort. Le bonheur, comme à chaque fois. Je ne peux pas encore le réciter par cœur, mais je ne désespère pas d’y parvenir un jour. Je viens régulièrement me ressourcer dans ce livre extraordinaire, que je tiens, si la chose a une quelconque signification, pour supérieur à Un Roi sans divertissement. Si je devais choisir un seul livre de Giono, j’élirais sans hésiter L’Iris de Suse : je l'ouvre comme je rentre chez moi.
Pour parler franchement, je n’ai pas d’idée bien claire sur les raisons de cette espèce de passion, et je ne sais pas si j’ai très envie de les disséquer méthodiquement. Je ne sais d'ailleurs pas si je saurais en parler avec un minimum de pertinence. J’ai juste envie d’en conduire une petite causette informelle, au gré de l’humeur et du vent. Je commencerai par les figures incontournables qui donnent au récit son étonnante densité.
Trois hommes occupent le premier plan. Par ordre d’apparition : Tringlot, Louiset, Casagrande. Trois hommes qui ont fouillé la vie de fond en comble et de la cave au grenier et qui ont rapporté de l’aventure trois expériences profondes, très différentes par les circonstances mais fondamentalement identiques en humanité. Trois hommes également imperméables aux fioritures verbales et qui, spontanément et sans bavardage, savent qu’ils sont en phase et qu’ils parlent d’égal à égal, quelque différentes que soient leurs conditions respectives. Trois figures romanesques qui existent puissamment.
Tringlot, c’est l’anti-Capitaine Langlois (Un Roi sans divertissement, Les Récits de la demi-brigade). La trajectoire de l’impeccable capitaine est à peu près celle d’un surhomme qui aurait tout compris de l’existence humaine et de ses misères, et qui se rendrait compte qu’il a beau mettre bon ordre aux malheurs du monde à sa façon expéditive, il fait partie de la commune espèce humaine, ni plus ni moins que le dernier des individus. D’où le cigare fourré à la dynamite. L’histoire de Langlois est celle d'un échec et d’une déception. Voilà ce qui arrive aux amateurs d’absolu : plutôt mourir que renoncer à régner.
Tringlot, lui, c’est un « enfant trouvé ». Il a fait son service dans « le train des équipages ». Et il l’a achevé au bagne militaire de Biribi à casser plein de cailloux. Devenu membre d’une bande de pilleurs de fermes et d’assassins, il fausse compagnie à tous ces complices dangereux en s’appropriant un beau magot, dont un fameux paquet de billets de mille qu’il garde au fond de son sac. Au début, Tringlot est un marginal, un exclu, un fuyard qui craint la vengeance de ses complices. A la fin, Tringlot est devenu un citoyen ordinaire, parfaitement fondu dans le paysage : magie-magie.
Ce que raconte si l’on veut L’Iris de Suse, c’est l’histoire immorale de la rédemption d’un dangereux rebut de la société, déjà coupable de multiples méfaits parfois sanglants, par la grâce de quelques rencontres dues au hasard, puis par le simple enchaînement des faits (enfin quand je dis « simple » …). Pour échapper aux vindicatifs qui le traquent (« monsieur Victor », alias "les clefs", et « monsieur Gaston », alias "les cachous", qui veulent récupérer le butin à tout prix), Tringlot s’engage par hasard dans une vallée des Basses-Alpes.
C’est aussi par hasard qu’il croise la route du berger Louiset, un type qui a de la bouteille dans le métier de berger, qui conduit une grosse transhumance (6000 moutons) vers un coin perdu sous la montagne du Jocond (une vieille connaissance, maintenant), et qui en connaît un rayon sur l’existence humaine. Mais voilà, Louiset souffre, et pas qu’un peu. Tringlot lui vient en aide comme si c’était un camarade, ce qui requinque Louiset pendant un temps et agrège l’ancien bagnard à l’équipe. Voilà Tringlot berger pour quelques mois d’estive (et d'esquive).
Arrivé aux alpages, Louiset demande à Tringlot d’aller à Quelte quérir les services de Casagrande, un homme de science profonde qui lui dira à quoi s’en tenir au sujet de son mal. Quelte, c’est le château des excentriques, où vivent une baronne veuve et fantasque, qui monte à l'occasion la garde devant le château un sabre de cavalerie à la main, et un vieux "philosophe" imprégné de toutes sortes de savoirs et qui passe beaucoup de temps à reconstituer le squelette de toutes sortes de bêtes, occupation dont il dit faire commerce.
Tringlot, Louiset, Casagrande : voilà établi le trépied de bronze sur lequel repose à mon avis tout l’édifice de L’Iris de Suse. Des « caractères » bien trempés. Le point commun de ces trois hommes, c’est qu’ils ne se racontent pas d’histoires, parce que chacun sait que les autres savent. Ils se sont mutuellement jaugés au premier contact. Tout au plus font-ils silence sur ce qu’ils pressentent ou ne veulent pas dire.
Cela fait toute la différence avec les personnages du deuxième rang : le point commun à Alexandre, second berger, Murataure le forgeron et petit frère d’Anaïs, et la baronne de Quelte, cousine de Casagrande, c’est précisément que ceux-ci se racontent des histoires. Tringlot demande à Louiset, au sujet d'Alexandre : « Qu'est-ce qu'il cherche ? – Ce qu'il n'a pas ; comme tout le monde » (p.37). Puis au sujet de la baronne : « Alors qu'est-ce qu'elle cherche ? – Midi à quatorze heures » (p.80).
Cela ne manque jamais : chaque fois qu’Alexandre monte aux alpages, il faut qu’il aille se faire casser la figure dans une ruelle au pied du mur du couvent des Présentines, au-dessus de Mons, et chaque fois on le ramasse dans les orties, bien amoché. Pourquoi persiste-t-il contre toute raison ? Motus, on ne saura rien, surtout de la bouche d’Alexandre.
De même, on ne saura jamais rien de l’énigmatique et scandaleuse passion qui unit jusque dans la mort la baronne Jeanne de Quelte (« deux grains de poivre ») et le forgeron Murataure, un « chic type » (dixit Louiset) qui possède la seule automobile de la vallée (on est en 1904, mais ça n'empêche pas Giono de voir une "Trèfle" de 1923) : on ne retrouvera de leurs corps qu’un "morceau de charbon" et une toque à plume de faisan. Anaïs fera enterrer les restes humains en grande pompe, et Casagrande fera fabriquer pour la toque un cercueil « pas plus grand qu’un coffret à bijoux » et rameutera « le ban et l’arrière-ban du clergé de la montagne » pour faire entrer ce "cercueil" dans le tombeau familial de la chapelle attenante au château.
Chacun de ces six personnages charrie dans son sillage toute une histoire sur laquelle Giono nous livre à peine quelques bribes. Tout juste apprend-on que Louiset est un vétéran de la transhumance et que Casagrande est un immigré italien qui a échoué au château de Quelte sans trop savoir pourquoi là et pas ailleurs à cause d’une vague parenté avec un baron qui s’y est suicidé.
Les monologues intérieurs de Tringlot nous en apprennent davantage sur le personnage qui forme l’armature centrale du roman, dont la boussole se formule : « La Mort n’attrape que ceux qui courent », qui lui sert à la fois de refrain, de morale et de stratégie de survie. Mais L’Iris de Suse flirte avec l’amoralisme le plus franc : Tringlot, ce criminel endurci, est d’emblée sympathique au lecteur. Et la sympathie carrément spontanée qu’il inspire à Louiset et Casagrande n’est pas faite pour atténuer le potentiel positif dont toute la narration nimbe le parcours de ce personnage non conventionnel.
Je l’ai dit : ce livre raconte une rédemption, et cette rédemption, on l’entrevoit au moment où Tringlot, qui remonte un soir de neige vers le château de Quelte sans trop savoir ce qu’il va y chercher, aperçoit soudain, immobile et perdue, debout sur un tertre, l’Absente. L’Absente ? Une trouvaille géniale de Jean Giono. Pensez, un personnage qui n’a ni être, ni visage, ni substance. A peine une silhouette, qui est là sans être là. A peine une silhouette entrevue à travers les flocons d’une tempête de neige. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Tringlot est saisi d'une étonnante colère. Murataure, qui est le mari sur le papier (elle ne se laisse jamais toucher), l’a cherchée partout en voiture et l’embarque.
Alexandre annonce un soir à Quelte la mort de Louiset, et le cocher de la "patache" qui ramène Tringlot lui apprend que Casagrande a quitté le château « avec armes et bagages ». L’Absente de L’Iris de Suse est devenue le but ultime de l’ancien bagnard, qui va, dès lors, se débrouiller pour acquérir enfin la panoplie – costume et statut – de la normalité, de la respectabilité.
Pour cela il doit se débarrasser du fardeau qui lui vaut la haine de ses anciens complices : l'énorme butin accumulé dans « la Sambuque », qu'il a fort habilement soustrait à la bande (première apparition de l'incroyable formule finale : « Je suis comblé. Maintenant j'ai tout ») et qu'il a très ingénieusement dissimulé dans une cache ménagée par ses soins dans « la ferme Longagne ». Arrivé au bout du monde (Notre-Dame-du-Bec) après une trajectoire ferroviaire compliquée à plaisir, il écrit la même lettre à "monsieur Victor" et à "monsieur Gaston" et leur explique comment faire jouer le mécanisme. Ainsi allégé de tout cet or, il peut retourner à Saint-Georges (« ... j'arrive à toute vitesse. Qu'on se méfie ! »).
Il sera le bourrelier de la vallée, mais il sera surtout le défenseur de l’Absente contre les malveillants, à commencer par sa belle-sœur Anaïs : « "Je suis comblé. Maintenant j’ai tout", se dit-il.
Désormais, elle serait protégée contre vents et marées et elle ne savait même pas qu’il était tout pour elle. »
Ce sont les derniers mots.
Peut-être à suivre. Question : au fait, pourquoi L'Iris de Suse ?
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, l'iris de suse, un roi sans divertissement, capitaine langlois
samedi, 29 février 2020
UN ROI SANS DIVERTISSEMENT
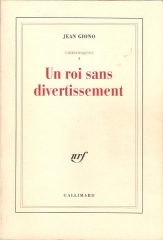 UN PORTRAIT DU CAPITAINE LANGLOIS ?
UN PORTRAIT DU CAPITAINE LANGLOIS ?
Je viens de relire, une fois de plus (je n’ai pas compté combien), Un Roi sans divertissement, de Jean Giono (Gallimard, 1947). Ce roman fait partie de mes rares élus de prédilection dans lesquels je me replonge régulièrement. J’ignore pour quelle obscure raison. Peut-être est-ce parce qu’il se dégage du capitaine Langlois, la figure de proue de l’intrigue, des traînées d’interrogations puissantes, alimentées par la langue fruitée, charnue, pleine d’ellipses et de surprises artistement façonnée par l’auteur. Une langue qui, par-dessus le marché, effleure un essentiel obscur, une sorte de bloc de granit, qu’elle fait pressentir avec une certaine volupté sensorielle, mais qu’elle laisse pour finir absolument impénétrable.
Je crois précisément que l’incroyable force du livre tient à ce qu’il est en soi une question sans réponse. Giono prend un malin plaisir à n’apporter aucun élément qui permettrait au lecteur de se faire une idée, même approximative, de ce qui meut le personnage principal. Les personnages vivent, parlent, agissent fortement, mais jamais l’auteur n’ouvre la porte au lecteur sur leur vie intérieure, sur leur « psychologie », comme s’il n’en savait pas davantage que celui-ci sur les motivations profondes et qu’il ne faisait que lui rapporter ce qu’il a vu ou ce qu’on lui a dit.
Je souhaite d’ailleurs bien du plaisir à ceux qui se hasarderaient à donner à ce personnage et à ce roman une signification précise. Par exemple, j’ignore sur quels éléments du livre le rédacteur de la notice du Nouveau Dictionnaire des Œuvres (Bouquins-Laffont) s’appuie pour déclarer : « Langlois est un homme supérieur qui s’ennuie de façon existentielle ». Dans Les Récits de la demi-brigade (relire La Belle hôtesse), Langlois n’est pas davantage un homme supérieur que dans Un Roi … Il est un militaire, un gendarme, un homme d’action, je veux dire un homme dont l’existence est faite des actions concrètes qu’il est en mesure d’accomplir pour, en obéissant aux ordres, conserver en l’état l’ordre du monde et mettre fin aux méfaits des malfaisants qui le narguent. Même s’il sait en toute conscience qu’il y a des désordres auxquels un capitaine de gendarmerie ne saurait mettre fin (cf. Noël, dans Les Récits …).
S’il finit par se faire sauter le caisson à coups de dynamite, est-ce, comme dit le même commentateur : « pour ne pas céder à la tentation de tuer – en particulier de tuer Delphine » ? Est-ce parce que, lorsqu’il a fait part de sa décision de se marier à la tenancière du café du village : « par jalousie, la vieille Saucisse, connaisseuse », lui a procuré une femme pas assez ardente ? Ce monsieur en sait plus que moi. Était-ce vraiment une femme, même ardente, qu'il aurait fallu à Langlois ? Je n'en sais rien.
Ce qui est sûr, c’est que le capitaine (puis commandant) Langlois, après avoir réglé deux affaires énormes de façon expéditive et spectaculaire (M. V. et le grand loup, même topo : deux coups de pistolet en plein dedans : « Langlois s'avance ; le loup se dresse sur ses pattes. Ils sont face à face à cinq pas. Paix !
Le loup regarde le sang du chien sur la neige. Il a l'air aussi endormi que nous.
Langlois lui tira deux coups de pistolets dans le ventre ; des deux mains ; en même temps.
Ainsi donc, tout ça, pour en arriver encore une fois à ces deux coups de pistolet tirés à la diable, après un petit conciliabule muet entre l'expéditeur et l'encaisseur de mort subite ! »), puis démissionné de l’armée pour s’installer dans le village (jamais nommé : Lalley (Isère), selon le Dictionnaire cité plus haut), ne sait plus vers quel horizon diriger ses pas. Il a éliminé le Mal à deux reprises et rétabli la sécurité dans un village attaqué dans son intimité : et maintenant, quoi ? Le « bongalove » ? Le labyrinthe ? Delphine ? Le cigare du soir au bout du jardin ? Mystère. J’en reste résolument au point d’interrogation : un grand roman sur l’énigme de la vie humaine. Quelle raison de vivre faut-il se donner ? Il y a de la métaphysique là-dedans.
La question me suffit : elle est en elle-même une réponse. Que dit Jean Giono de son personnage ? « Voilà comment il était. Il ne disait rien. Il ne bronchait pas, il ne regardait rien, il ne faisait pas attention à vous et, d’un mot, il vous faisait comprendre qu’il savait tout. Et il avait ainsi remède à tout » (p.211 de la collection « blanche » de Gallimard).
Mais Giono a peut-être laissé des indices de ce qu’il a mis dans Langlois en racontant comment son cheval a conquis une place à part dans la vie du village. Ne sachant pas comment le militaire l’appelait, les habitants ont fini par le surnommer « Langlois ». Un drôle de cheval en vérité. Son portrait commence page 85 de la même édition : « Par contre, on devint très familier avec le cheval ».
« Et comme, d’après ce que je vous ai dit, on n’eut guère l’occasion de manifester cette sympathie à l’homme, on la manifesta au cheval. D’autant que c’était un cheval qui faisait tout pour faciliter les choses ». On peut se reporter, par exemple, au début du récit Angelo, pour se convaincre que Giono et le cheval, c’est une histoire d’amour fondée sur une connaissance mutuelle profonde : « Soudain, par on ne sait quel prestige des jambes (…) il fit que le cheval, accroupi comme un chat, se détendit et s’envola par-dessus la barrière » (Gallimard, coll. Biblos, p.6). Le douanier français en reste éberlué.
« Langlois », tout comme Langlois (sans guillemets), a un caractère indépendant : « C’était un cheval noir et qui savait rire. D’habitude, les chevaux ne savent pas rire et on a toujours l’impression qu’ils vont mordre. Celui-là prévenait d’abord d’un clin d’œil et son rire se formait d’abord dans son œil de façon très incontestable. Si bien que, lorsque le rire gagnait les dents, il n’y avait pas de malentendu. La porte de son écurie était toujours ouverte. Il n’était jamais attaché ».
Et ça continue : « S’il reconnaissait quelqu’un qui lui plaisait plus particulièrement il l’appelait d’un ou deux hennissements très mesurés, semblables à des roucoulements de colombe. Et, si celui-là, alors, levait les yeux et lui disait un mot gentil (ce qui était toujours le cas) le cheval s’approchait de lui à pas aimables, très cocasses, très volontairement cocasses, casseurs de sucre et un peu dansants, pour venir poser la tête sur son épaule ».
Bon je ne vais pas abuser de la citation, je veux juste suggérer que, pour avoir une idée (en creux, en biais, en filigrane) du monde intérieur du capitaine Langlois, on peut lire et relire ces quelques pages formidables (85-89), et surtout le paragraphe qui clôt le passage : « Il [le cheval] n’avait qu’un défaut : il était sévère avec les bêtes. Il ne riait jamais, il ne roucoulait pas, ni à un autre cheval ni à une jument. Il ne les regardait même pas. Il les côtoyait, impassible, pour venir vers nous. Il aimait au-dessus de sa condition ». Il aimait au-dessus de sa condition ! Tout est dit : tout Langlois n’est-il pas dans cette phrase ? Dans ce paragraphe ? On peut comparer avec les quelques lignes de la page 211 (« ... il ne regardait rien, il ne faisait pas attention à vous ...») citées plus haut.
Il est possible qu’à la prochaine lecture du roman, mon attention soit attirée par d’autres éléments. Pour cette fois, je m’en tiens à ce personnage du cheval, finalement fugitif, et à cette idée que son portrait n’est pas là par hasard.
Quel roman admirable ! Il faut sans cesse relire.
Voilà ce que je dis, moi.
Note 1 : le prochain dans mon collimateur, c'est L'Iris de Suse (1970), dernier roman de Jean Giono, mon préféré, mon favori, que je considère comme indépassable. C'est sûr, pas de la même trempe : dans l'un, l'histoire d'une rédemption, dans l'autre, une course à l'abîme. Dans l'un, Tringlot le hors-la-loi devient un homme ordinaire (la dernière réplique : « Je suis comblé. Maintenant j'ai tout, se dit-il »). Dans l'autre, Langlois fait le chemin inverse : « On est en contrebande, dit-il. En plus de ça, qu'il me dit, il y a des lois, Frédéric. Les lois de paperasse, je m'en torche, tu le vois, mais les lois humaines, je les respecte » (Un Roi ..., p.76).
Note 2 : la chaîne France Culture diffuse en ce moment un feuilleton intitulé Un Roi sans divertissement (10 épisodes). Je ne suis pas allé écouter ce que ça donnait. Ici le premier épisode.
Note 3 : ci-dessous, un fragment de la carte Michelin n°77 : on est dans le sud de l'Isère, tout près de la Drôme et des Hautes-Alpes, non loin du Vercors et du Grand Veymont. C'est là que tout se passe.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, jean giono, un roi sans divertissement, éditions gallimard, capitaine langlois, giono les récits de la demi-brigade, robert laffont nouveau dictionnaire des oeuvres, la belle hôtesse, l'iris de suse
vendredi, 02 mars 2012
PÊLE-MÊLE D'UN CARNET DE LECTURE (7)
L’Alchimiste, de PAULO COELHO

LE SOURIRE SATISFAIT
DE L'HOMME D'AFFAIRES QUI A REUSSI
C'est tout simplement un roman de secte, en tout cas de mentalité sectaire, conte infantile, écrit de façon relâchée : initiation à la vérité de soi, à un ailleurs que le héros finit par trouver, comme son trésor, en or bien réel, d’ailleurs, ce qui contredit toute la quête. C’est mystico-machin, avec un vocabulaire de pseudo-initié, avec des majuscules pour les concepts comme Aventure Personnelle, avec la présence du Maître, et doté de pouvoirs avec ça, et des épreuves à franchir. Bref… Ce qui est bien, heureusement, c’est qu’on n’a pas à se torcher quand on a fini. Quoique ...

Les Contrefeux de l’amour, d’ALGERNON CHARLES SWINBURNE

Roman par lettres. La redoutable Lady Midhurst tisse la toile du conformisme conjugal victorien : les sentiments des individus risquent de déranger l’ordre et de ternir les réputations. Patiemment, le venin fera son œuvre et l’ordre sera maintenu. Les ébauches d’adultères (les feux) seront effacées. Excellent.
Risibles amours, de MILAN KUNDERA

Très fort, stylistiquement et techniquement. Humainement, c’est moins sûr. Constante distance ironique et jugements de l’auteur sur ses personnages (on pense à Stendhal, mais ici en plus ironique). Ils sont des marionnettes. Sans doute volontairement, mais j’ai du mal. Grande hauteur de vue par ailleurs. Impression qu’on est dans l’essentiel (comédie humaine). Amoralisme. Il y a la loi qui reste en façade : les cellules communistes, grotesques par ailleurs. Pour le reste, tout le monde ment sur l’essentiel. Sauf peut-être Edouard, qui fait au dernier chapitre son initiation à l’âge adulte en perdant le sens de ce qu’est l’amour : il baise sa petite amie si chrétienne, et en même temps la directrice laide de son école.
Un Roi sans divertissement, de JEAN GIONO
Autour du gendarme, le capitaine Langlois, ancien de Napoléon, vit et gravite la société d’un petit village, où, chaque année, un membre de la communauté est tué. Le capitaine, dont on a déjà rencontré le caractère spécial dans Les Récits de la demi-brigade, finit par trouver le meurtrier, et le tue sans autre forme de procès, en lâchant simultanément les coups de ses deux pistolets. Puis c’est un loup qui menace. Tout le monde est terrifié. Le capitaine Langlois organise un grande chasse pour le rabattre vers le Jocond, au pied d’une muraille où le capitaine l’exécute de la même manière : deux coups de pistolets à bout portant.
Puis le capitaine se met en tête de se marier, déniche une femme, et finit par fumer un soir, non pas son cigare, mais une cartouche de dynamite, qui lui emporte la tête. Le personnage est évidemment fascinant, non pas tellement par son aspect héroïque que par l’impression de tout comprendre des gens et des choses qui l’entourent. Les faits semblent arriver comme simples résultats de cette interprétation. Grégoire est présenté comme celui qui sait tout. Récits et dialogues pleins d’ellipses. On ne traîne pas. Mais ce n'est pas fait pour un lecteur paresseux.
Deux Cavaliers de l’orage, de JEAN GIONO
Deux frères, Marceau et Ange « mon cadet » Jason, qui s’aiment. Vingt ans de différence. Marceau est un hercule, si si, c'est vrai : il tue un cheval en folie, qui sème la terreur dans un ville de la région, d’un seul coup de poing qui fracasse le crâne de la bête. L’histoire finit par se répandre. Un lutteur professionnel, « Clé des cœurs », le provoque et se fait battre. Il battra encore deux professionnels.
Il sauve ensuite la vie de « mon cadet » en empêchant, avec une petite tête d’oignon, les membranes de se constituer au fond de la gorge de son frère et de l’asphyxier : c’est la diphtérie ? Mais ça finit mal : « mon cadet » le provoque en combat et domine son frère aîné, qui le tuera à coups de serpe dans les tripes, pour aller ensuite mourir quelque part dans la montagne. « Il est mort de la vie qui a refusé d’aller plus loin ».
Ça me fait penser au terrible Jour avant le lendemain, de JØRN RIEL, quand la grand-mère repêche in extremis son petit-fils, devenu rapidement tout bleu, car il est tombé dans l'eau de l'Arctique. Elle s'écrie affolée : « Pas comme ça ! Pas comme ça ! ». Elle le ramène à la vie en le frottant vigoureusement. Mais c'est elle qui ira un soir, pendant qu'il dort, faire tomber la "porte" de la grotte, pour que le froid glacial pénètre jusqu'à eux. Les hommes de la tribu les ont, croit-elle, oubliés, alors qu'ils ont été juste massacrés par des blancs.
Le Chasseur Zéro, de PASCALE ROZE

Qu’est-ce qui m’a pris d’ouvrir ce livre, qui est lamentable et d’une affreuse nullité, mais qui a obtenu le prix Goncourt 1996 ? Il faut le faire. Dans ce livre, il n’y a rien, mais rien. Le vide. Pour moi c’est un effroyable nanar littéraire. Incroyable que le jury fasse encore à ce point illusion. Plus plat, tu meurs. Et qu’on ne me dise pas que l’effet de platitude est voulu, recherché. Caca. Tirons la chasse d'eau.

Le Tableau du maître flamand, d’ARTURO PEREZ REVERTE
Un bon livre d’énigme. L’antiquaire esthète et pédé, ami de la jeune restauratrice de tableaux, est l’assassin (quelques crimes abominables). Un bon rouage de mystère, mais pas de suspense. Quelques bons caractères. Un bon dépaysement dans la fin du moyen âge. C’est très documenté. L’antiquaire est atteint du sida et veut de toute façon mourir. Il aime bien la jeune femme, un peu comme un “oncle”. Sur le plan littéraire, c’est d’une platitude affreuse. Tout repose sur la mécanique. Aucun style, sinon policier, ne doit détourner l’attention de la mécanique.
Le Maître d’escrime, ARTURO PEREZ REVERTE

Nettement plus satisfaisant, sur un plan esthétique, que Le Tableau du maître flamand. Je crois que c’est dans la forme générale, en particulier, cette quête du coup parfait par le maître, et qui aboutit précisément à la fin : un fleuret, certes, mais moucheté, et contre l’épée nue de l’ancienne élève, qui oblige le maître à se surpasser et à trouver le coup qui s’enfonce dans le crâne à travers l’œil.
Cette quête qui trouve un aboutissement esthétique aussi net et gratuit donne une unité à l’ensemble. Alors que le « tableau », dans sa conclusion, défait quelque chose : il est de l’ordre de la défaite (perte des illusions de l’héroïne sur son protecteur et ami). Il y a donc plus de maturité dans le « tableau » que dans « le maître ». Au moins psychologiquement. Le combat final du maître est un petit bijou littéraire.
Le seul qui dépasse ce récit est le combat de Bussy d’Amboise (ah, les « gants de buffleterie » !), dans je ne sais plus quel roman d’Alexandre Dumas, peut-être La Dame de Montsoreau, contre 14 adversaires qu’il tue méthodiquement. Mais il est à terre, et cherche à fuir. Arrive le Duc d’Anjou, le commanditaire du guet-apens : est-ce lui ou son compagnon qui donne le coup de pistolet fatal ? Et encore, il me semble que Bussy combat en tenant son épée à même la lame.
Chez PEREZ REVERTE, le maître finit par trouver la combinaison des gestes qui lui permettent d’enfoncer brutalement la pointe mouchetée du fleuret, à travers l’œil, et jusqu'au cerveau de la fille, son ancienne élève, devenue spadassine stipendiée.
Comme quoi, ne fait pas qui veut de la bonne, de la vraie littérature.
Voilà ce que je dis, moi.
* Si je n'ai pas mis de photo de JEAN GIONO, c'est tout simplement qu'avec JEAN GIONO, le livre n'a plus besoin de l'image de son auteur pour exister en personne.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paulo coelho, l'alchimiste, littérature, ac swinburne, les contrefeux de l'amour, milan kundera, risibles amours, jean giono, deux cavaliers de l'orage, un roi sans divertissement, pascale roze, le chasseur zéro, prix goncourt, arturo perez reverte, le tableau du maître flamand, le maître d'escrime

