dimanche, 22 mars 2015
ENCORE MODIANO
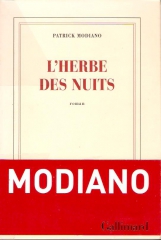 J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.
J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.
Si j'ai tardé à l'évoquer, c'est que mon intérêt pour Modiano, s'il ne s'était pas tout à fait éteint, peut-être avait-il tiédi. L'attribution du Nobel a, disons, réchauffé ma curiosité. Je ne regrette jamais d'avoir lu un livre, même quand j'en sors frustré. Quand j'arrête la lecture en cours de route, c'est que le livre m'a mis en colère, ou alors m'est tombé sur l'ongle incarné (trop lourd, sans doute : je parle du "poids" du livre).
Les prix littéraires, soit dit entre nous, je n’en pense rien, tant la valeur d’un livre ou d’un écrivain me semble incommensurable à sa reconnaissance officielle par une assemblée pontificale, quelle qu’elle soit. Un rite d'autocélébration, en quelque sorte. Une ambiance du genre « Bienvenue au club ! ».
De toute façon, ce qu'on appelle "Grand Prix", vous savez, ces récompenses célébrant les "talents", surtout quand on navigue en milieu littéraire, poétique ou artistique (en gros, ce qu'on appelle les "Affaires Culturelles"), ne sont que des moyens pour une classe dominante de faire passer, en direction des classes dominées, un message du genre : « Vous voyez bien, quand on veut, on peut y arriver ! ». En même temps que ça renforce la légitimité de l'ordre établi (fonction réelle de l'arrosage saisonnier à la Légion d'honneur). Avec ça, je passerai peut-être pour un bolchevique.
Quand on veut, on peut ! Voilà bien un refrain que je hais, un refrain qui sent son moralisme archéo-chrétien, et même pas très catholique. Machine à culpabiliser. Parlez-en au chômeur du coin, qui se heurte aux portes closes de la raréfaction du travail et à qui des Sarkozy viennent faire la leçon : si tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas ! C'est de ta faute ! Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même ! On va te couper les vivres !
Conclusion, en effet : quand on n'y arrive pas, c'est qu'on ne le mérite pas. Modiano, au Nobel, rachète heureusement sa soumission à ce protocole "chez les puissants" par une maladresse existentielle à peu près pathologique, qui ressemble d'assez près à sa littérature, preuve d'une sincérité impossible, je crois, à contrefaire. Si c'était "joué", il serait vraiment très salaud. Parce que, franchement, l'expression « une maladresse existentielle pathologique », ça ressemble d'assez près à une analyse littéraire de l'oeuvre de Patrick Modiano, vous ne trouvez pas ?
Patrick Modiano ressemble juste à l’idée que je me fais du véritable écrivain : celui qui est capable de créer un univers reconnaissable à quelques traits, de la même manière qu'on sait, après deux mesures, qu’on entend « du Chopin » ou, à la translucidité d'une main d'enfant devant la flamme d'une bougie, que l’on contemple « un Georges de La Tour ».
Ce n’est pas une raison pour avaler tous les titres de l’écrivain en file indienne. Pour Chopin, c'est la même chose : pas besoin d'aligner sur la platine les 12 CD de l'intégrale chronologique des œuvres pour piano seul de Frédéric Chopin par Abdel Rahman El Bacha. On sait déjà.
La seule expérience que j’ai faite de cette « méthode », ce fut avec l’œuvre de Henri Bosco, qui, en dehors de deux ou trois titres, n’a plus de secrets pour moi. Pardon : "la seule", c'est inexact : j'ai aussi fait ça avec les Rougon-Macquart (ce qui, entre parenthèses, m'a guéri de la Zola-rziose).
J’ai fait une tentative semblable avec un recueil d’ouvrages de Françoise Sagan (collection Bouquins) : j’ai calé au bout du cinquième, à cause, je crois, de l’atmosphère raréfiée de bocal à poissons rouges, de l'espèce des nantis à l'existence futile, dans laquelle elle plonge le lecteur. Ne pas confondre l'oeuvre littéraire avec le feuilleton. Après tout, il y a peut-être du feuilletoniste chez Modiano. Je dis peut-être une grossièreté ? Tant pis.
Je ne désespère pas de me remettre à la lecture chronologique de La Comédie humaine, abandonnée elle aussi, mais au bout d’une trentaine de titres tout de même. Balzac, c'est autre chose, il dépasse de loin la somme des recettes successives qu'il met en oeuvre. Et je reviens, bien entendu, assez régulièrement, à Simenon, entre autres à ses « Maigret », après avoir éclusé une trentaine également de ces derniers.
Je ne conseille par conséquent à personne de procéder de cette manière avec les romans de Patrick Modiano. Je n’userai pas du poncif de la « petite musique » qui sert d’échappatoire au « critique littéraire » qui n’a pas envie de se fouler pour entrer dans des considérations un peu précises et sérieuses. Il se trouve cependant qu’en ouvrant L’Herbe des nuits peu de temps après avoir lu Pour que tu ne te Perdes pas …, j’ai eu la curieuse impression de lire un décalque de celui-ci.
Même petit carnet rempli de notes diverses. Même ribambelle de noms, de dates, d’adresses, de numéros de téléphone, de lieux de rendez-vous, dont beaucoup ne disent plus rien au narrateur, perdus dans le brouillard d’un passé qu’il cherche à ressaisir, mais il a bien du mal, le pauvre, avec tout le temps qui a passé. Même genre de personnage féminin énigmatique (« Dannie »), à l’identité fuyante.
Même milieu interlope où cette femme évolue, au milieu de noms d’hommes un peu louches : un « Aghamouri », agent secret qui fait semblant d’être étudiant, un « Paul Chastagnier » qui donne au narrateur des « conseils d’ami ». Un « Unic Hôtel », quelque part à Montparnasse, dans le hall duquel ces hommes se retrouvent.
Peu importe au fond la succession des faits dont le livre se fait un argumentaire en quelque sorte obligé. Les récits que Modiano élabore dans ses romans n’ont rien d’événementiel. Non, pas de rebondissements, rien de spectaculaire, pas de tragédie grandiose. L’amateur de ce genre de littérature ne le trouvera pas ici.
L’étoffe dont sont tissés les livres de Modiano est de nature différente. Si je voulais résumer les impressions que me laisse L’Herbe des nuits, je commencerais par dire : une littérature d’état d’âme ; une littérature de climat. L’état d’âme d’un homme qui a été « mal jeté dans la vie » (j’ai connu un Benoît Vauzel  dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.
dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.
Du narrateur lui-même, d’ailleurs, on n’apprendra que des bribes, livrées parcimonieusement, par intermittence. Le narrateur en personne est un peu fuyant, c’est certain : il ne tient pas à laisser de traces derrière lui. Et puis, il semble fatigué, ce narrateur, dépressif peut-être ? C’est bien lui qui dit : « Mais, je n’y peux rien, en ce temps-là j’étais aussi sensible qu’aujourd’hui aux gens et aux choses qui sont sur le point de disparaître » (p. 89).
Dans L’Herbe des nuits, comme dans beaucoup de livres de Modiano, tout le monde pose beaucoup de questions. Quasiment aucune d’entre elles ne reçoit de réponse. Ici, il faut la convocation du narrateur par un certain Langlais, quai de Gesvres, pour qu’il réponde à des questions. On comprend que c'est un policier. Dans les livres de Modiano, j’ai l’impression que, quand ce n’est pas la police qui pose les questions, celles-ci ne reçoivent jamais de réponse. Et encore … Mais je me dis qu'après tout, la police ne pose jamais les bonnes questions.
Car il y a ce détour par la surprenante amitié de Langlais pour Jean, le narrateur, pour accéder à la clé de certains mystères. Pas tous, qu’on se rassure. Et même loin de là. « Dannie » a-t-elle finalement commis un crime ? La personne qui a reçu « deux balles perdues » a-t-elle, dans le passé, été victime d’une erreur de manipulation ou d’une intention claire ? Personne n’est en mesure de répondre. Même la police échoue à faire toute la lumière sur certaines petites choses finalement triviales de la réalité.
L’univers mental dans lequel se débattent désespérément, roman après roman, les héros de Patrick Modiano, est un univers à jamais flottant. Un univers où personne ne répond aux questions, en particulier à la question « Pourquoi ? ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature française, patrick modiano, l'herbe des nuits, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, prix nobel de littérature, éditions gallimard, collection blanche, affaires culturelles, nicolas sarkozy, abdel rahman el bacha, émile zola, henri bosco, rougon-macquart, françoise sagan, collection bouquins, la comédie humaine, honoré de balzac, georges simenon, commissaire maigret, benoît vauzel mal jeté dans la vie
vendredi, 07 février 2014
24 BALZAC : ADIEU (1830)
Il y a quelque temps (« quelque temps » est une expression très pratique, du fait du brouillard compact qu’elle répand sur le sentiment de l’écoulement du temps), j’ai fait l’erreur d’acheter, un volume de la collection « Bouquins » (Robert Laffont, 29 euros). Sous le nom de l’auteur, imprimé en très gros caractères, cette mention : « Œuvres ». Sont rassemblés dans ce volume quinze livres de Françoise Sagan. L’erreur, elle est là, dans le nom de l’auteur. Je n’aurais pas dû.
Studieusement, j’ai lu les cinq premiers titres (Bonjour tristesse, Un Certain sourire, Dans un mois dans un an, Château en Suède, Aimez-vous Brahms ...), à la file et dans la foulée. Au milieu du sixième (Les Merveilleux nuages), j’en ai eu tout d’un coup assez, j’ai refermé. Je ne l’ai plus jamais rouvert. Ce verre de tisane dans lequel trempe l’âme exténuée de quelques personnages blasés, je m’en suis débarrassé en le vidant moralement dans le pot du Ficus Benjamina. Apparemment, ça ne lui a fait ni chaud ni froid : il a continué comme avant à se déplumer de ses feuilles. C’est une image.
Tout ça pour dire que Sagan est restée pour moi une sorte de sirop fade, l’image d’un univers délavé où les protagonistes se regardent mutuellement vivre dans leurs désillusions, où tout le monde en a assez de la réalité de la vie. Un univers en bout de course, où l’individu est limité à lui-même, et où la personne qui lui fait face a pour mission de renouveler le reflet de lui-même où il se complaît, mission jamais accomplie, espoir toujours déçu.
Tout ça pour dire que ça ronronne et que ça tourne en rond. Tout ça pour dire que Françoise Sagan est l’écrivain d’un seul sujet. Tout ça pour dire que Sagan épluche dans les moindres détails l’existence de gens peu intéressants, de gens sans projets, le plus souvent désœuvrés, souvent débarrassés de tout souci matériel, et qui ne savent pas quoi faire de leur existence inutile.
Des gens que le simple fait de vivre semble en soi ennuyer prodigieusement. J’ai donc abandonné. J’ai peut-être eu tort, allez savoir. Je n’ai pas envie d’explorer plus avant. Dans la littérature française d'après-guerre, Sagan est un peu l'étalon-or de ce qui est devenu dans nos années plus récentes le fin du fin de l' « écriture du moi » : l'abominable et autosatisfaite « auto-fiction ».
Je ne sais pas pourquoi, en train de lire des œuvres de Balzac, je suis parti sur Françoise Sagan. Le plaisir du contraste, peut-être. Mais c’est vrai aussi que, après la douzaine de romans et nouvelles du grand homme que je viens de lire, essayant de situer le lieu où se produit l’intensité que j’ai trouvée à retourner à des livres qui, soit dit pour résumer, ont amplement contribué à structurer et façonner ma sensibilité, je viens de repenser à ces œuvrettes de celle qui fut l’auteur "prodige" de Bonjour tristesse (autour de 18 ans, ce qui est en soi un aveu).
Ce titre de Françoise Sagan, épèle mot à mot et lettre à lettre le programme de toute son œuvre, enfin pour la partie que je peux en connaître, c’est-à-dire l’initiale. C’est carrément idiot, je sais, de mettre en présence Sagan face à Balzac, elle aurait bien rigolé, je pense. Mais je prends mes idées comme elles se présentent, et là, c’est Sagan qui s’est présentée. Allez comprendre.
Par rapport au vaste monde qui respire profondément, qui avale gloutonnement la vie et qui jouit à chaque instant de ce qu'il a devant les yeux et dans l'oreille, les œuvres de Françoise Sagan me semblent aussi étroites que les parois de verre du bocal où agonise le poisson rouge.
Je viens donc de lire Adieu. Balzac a écrit ça en 1830. Très curieux, très surprenant. Par l’organisation du récit, par le thème. Le récit s’ouvre sur une scène de chasse, où les deux amis, messieurs de Sucy et d’Albon, reviennent bredouilles après avoir parcouru beaucoup trop de kilomètres, d’Albon suant et pestant du fait de son embonpoint nettement plus remarquable que son ami, qui semble au contraire efflanqué comme Rossinante, tout en montrant la vigueur de l’ancien militaire qu’il est. Mais son visage porte la marque d’un grave souci, qui semble le ravager de l’intérieur. Cette entame ne laisse rien augurer du reste.
Car les deux amis ont hâte de trouver avant la nuit le gîte et le couvert. Le hasard fait qu’ils passent devant les grilles d’un domaine qui semble à l’abandon. C’est l’ancien couvent des « Bons-Hommes », comprennent-ils en entendant les grognements plus ou moins articulés par une femme plus ou moins restée dans l’animalité, du nom de Geneviève.
Déjà surpris par la scène, ils aperçoivent au loin une autre femme, qui grimpe aux arbres, saute, fait mille cabrioles. Elle a visiblement perdu la raison. Appelée par « Geneviève », elle s’approche de la grille et, en voyant les deux hommes, elle prononce le mot qui ouvre sur le drame : « Adieu ! ». D’Albon, très étonné, se tourne alors vers de Sucy, mais c’est pour le voir évanoui sur le sol.
Appelant à l’aide, il voit s’approcher obligeamment la voiture de M. et Mme de Grandville, ses voisins, qui le laissent volontiers en disposer pour ramener son ami au château. On a appris que la femme s’appelle la comtesse de Vandières, que de Sucy a semble-t-il reconnue, pour être une certaine Stéphanie. Son âme s’est soudain violemment déchirée.
Quand de Sucy est rétabli, il prie son ami de courir aux Bons-Hommes pour s’enquérir de tout ce qui concerne la comtesse. Il est accueilli par l’oncle de la dame, médecin de son état, qui le fait entrer et, apprenant l’existence de Philippe de Sucy, lui raconte l’histoire terrible et lamentable que la comtesse et lui ont vécue sur la Bérésina (sic) au moment de la retraite de Russie.
La suite au prochain numéro.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeux olympiques, sotchi, vladimir poutine, littérature française, honoré de balzac, adieu, la comédie humaine, françoise sagan, bonjour tristesse, un certain sourire, dans un mois dans un an, château en suède, aimez-vous brahms, les merveilleux nuages

