dimanche, 20 décembre 2015
FRANCE : UN FOSSILE POLITIQUE

1
A quoi bon revenir, une fois de plus, sur l’état de la vie politique en France ? Si ça servait à quelque chose, il y a longtemps que la situation se serait améliorée. Or les commentaires judicieux, les analyses pertinentes et les diagnostics alarmants sont tombés comme à Gravelotte, aux dernières élections. Donc, disons-le, ça ne sert à rien. Eh bien tant pis : ce n’est pas une raison pour ne pas en parler. Le constat est terrible. Beaucoup d’analystes, français ou non, le disent : le système politique français est à bout de souffle. Ce vieillard cacochyme n’aura pas la force de sortir du bourbier pour se régénérer et repartir sur de nouvelles cannes. Là, c'est le fauteuil roulant. Electrique et autodirectionnel à radar si possible.
Le symptôme de cette maladie en phase terminale s’appelle, on l’a deviné, « Front National ». J’ai bien dit : symptôme. Le Front National n’est rien d’autre que la sorte d’éruption cutanée qui signale que la personne développe une scarlatine (ou une autre selon préférence) : si l’on ne soigne pas l’organisme, nulle chance d’endiguer l'invasion de points rouges provoquée par l’éruption. Pour « combattre le Front National », il faut soigner la France. Hélas, ce qui est à craindre, dans la circonstance, c’est le « désert médical ».
Je reviens donc sur la prospérité électorale du Front National, cette incroyable prospérité qui fait lever un vent de panique sur les « partis de gouvernement » ; cette épouvantable prospérité qui fait croire au monde entier que la France est le terrain d’une atroce « montée de l’extrême-droite » (pas d'affolement quand même : 15,06% des inscrits au 2° tour, pour le "premier parti de France", ils n'ont pas intérêt à la ramener, le PS ne fait guère mieux, avec 16%). Tous les mages, Valls en tête, qui nous serinent l’antienne « Il faut combattre le Front National » ne sont que de cyniques salopards qui ne cherchent qu’à détourner l’attention de l’essentiel : il urge de soigner la France.
Mais y a-t-il seulement un (bon) médecin dans la salle ? Etant entendu que le bon médecin est celui qui pose le bon diagnostic. Je ne sais pas si j’aurais fait un bon médecin, mais là, ça crève les yeux : le Front National est un « Golem », ce mannequin de terre sur lequel le magicien trace sa formule cabalistique en hébreu (je pense évidemment au maître livre de Gustav Meyrink). Le Front National ne serait pas sorti de l’inexistence s’il n’avait pas été fabriqué de toutes pièces par le système politique dont il est la créature : comme le Golem, il fait aujourd’hui mine d’échapper à la volonté de ses créateurs.
Je le redis, le Front National est cette baudruche ridicule, dont le raisonnement et la doctrine politiques, qui tiennent à peu de choses près sur un confetti, s’apparentent fort au crachat à la gueule, mais une baudruche devenue un véritable épouvantail à la suite de tortueux calculs politiciens, mais aussi et surtout, de l’incompétence cumulée de décideurs incapables de saisir et de maîtriser les réalités du monde actuel, c’est-à-dire de résoudre les problèmes qui surgissent (faire en sorte, par exemple, que le travail ne foute pas le camp, s'il n'est pas déjà trop tard) ; d’ambitieux sans envergure qui ont vu s’ouvrir devant eux la perspective d’une carrière prometteuse ; de médiocres tâcherons avides de mordre dans le fromage national en y exerçant des pouvoirs de « petits chefs » (en attendant mieux) ; de fonctionnaires incapables d’envisager un horizon politique un peu noble, incapables de faire abstraction de la prochaine échéance électorale pour se forger le corps d’une doctrine d’action à long terme dépassant leur pauvre petite personne.
Incapables de proposer même l’embryon d’une pensée politique un peu formée, tous ces charlots pourraient figurer dans la version modernisée du très glauque et grenouillant Son Excellence Eugène Rougon (Emile Zola, faut-il préciser). Sans cette désespérante médiocrité de gens qui prouvent tous les jours qu’ils se rabattent sur les mots faute de se montrer capables de changer les choses, le Front National en serait resté aux 4 ou 6% dont devait se contenter le vieux Le Pen, avant que Mitterrand lui ouvre, pour ses propres calculs, la porte de l’ascenseur. Bref, le Front National, en plus d'être nourri par les difficultés de plus en plus insolubles auxquelles se heurte toute une population de gens ordinaires, est l'enfant difforme de la médiocrité d'un personnel politique erratique, abâtardi et fonctionnant "en bande organisée".
Ma conviction est que le Front National est la version caricaturale exacerbée des partis qu’il dénonce : un calque, un clone, une créature de l’ « établissement » que le vieux Le Pen faisait semblant de combattre. Ma conviction est que le Front National prospère sur le fumier qu’est devenue la vie politique en France, depuis, disons, Giscard d’Estaing. Ma conviction est que tous les grands dirigeants qui lui ont succédé ont rapetissé la France. Ma conviction est que, sans l’insigne insignifiance des « hommes politiques » français poussés sur le fumier politique, le Front National serait resté une crotte de bique. J’arrête là les anaphores : j’aurais trop honte de tomber dans les « Moi Président … ».
Ce n’est donc pas, j’en suis convaincu, la corruption qui mine la vie politique française. Je n’en dirais pas autant si la France s’appelait le Mexique, l’Espagne ou le Brésil. Luis Barcenas, le trésorier du PP espagnol, est au cœur d’un énorme scandale financier. Au Mexique, la collusion objective entre le monde politique, certaines forces de l’ordre et les gros bonnets et cartels du narcotrafic est telle qu’on se demande si l’on peut encore parler d’un « État ». Quant au Brésil, le scandale « Pétrobras » fait suffisamment de bruit dans nos médias pour qu’il soit utile d’insister.
Et je ne parle pas de certains pays africains, de la Russie, de la Roumanie, etc.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, front national, jean-marie le pen, bleu marine, marine le pen, parti socialiste, ump, parti les républicains, françois hollande, nicolas sarkozy, manuel valls, le golem, gustav meyrink, émile zola, son excellence eugène rougon, rougon-macquart, giscard d'estaing, hollande moi président, pétrobras, luis barcenas, élection présidentielle
vendredi, 02 octobre 2015
SIMENON : QUELQUES MAIGRET
J’ai dit du mal de Maigret et de son inventeur, le docteur (ou commissaire, je ne sais plus) Georges Simenon. Et pourtant, paradoxe apparent, je les ai bien lus, ces dix-huit ou dix-neuf épisodes. Ça veut bien dire que je ne déteste pas tant que ça. Et c’est vrai. Je n’aurais pas dû en lire autant à la file, sans doute.
* La Patience de Maigret (Epalinges (Vaud), mars 1965)
Je me souviens d’avoir fait le pari, il fut un temps, d’avaler en file indienne les vingt épisodes de la série des Rougon-Macquart : ça m’a radicalement vacciné et définitivement guéri de l’ « émilezolite ». A force de lecture, le fil blanc des trucs, procédés, manies devient une véritable corde : j’avais l’impression de la sentir se resserrer sur mon cou.
* Maigret et le voleur paresseux (Noland (Vaud), janvier 1961)
L’esprit de système qui guidait l’auteur, l’aspect théorique et doctrinal de sa démarche me sont apparus en pleine lumière. L’avantage de la chose, c’est que j’ai décidé dès ce moment de fuir Emile Zola, et du même mouvement, tout ce qui pouvait ressembler à un roman à thèse. La littérature « à message », disons-le, est mauvaise, la plupart du temps.
* Maigret et les braves gens (Noland (Vaud), septembre 1961)
Je m'étais livré au même gavage avec les œuvres de Henri Bosco, mais là, rien à voir : si l’on repère quelques thèmes obsessionnels (l'ombre, le mystère pressenti, une obscure menace, ...), l’ensemble est somme toute bigarré, mais aussi et surtout, authentique, sincère, dépourvu de toute idée préconçue, de toute doctrine préalable. Chaque ouvrage était en quelque sorte le compte rendu d’une vraie recherche personnelle (Un Rameau de la nuit, Le Sanglier, ...), malgré ce que l’arrière-fond cosmique, païen, mystique, parfois illuminé pouvait parfois avoir d’horripilant (L'Antiquaire, Le Récif, ...).
* Maigret et le client du samedi (Noland (Vaud), février 1962)
Revenons à Simenon et, en particulier à Maigret. Je disais donc que l’auteur est un paresseux, qui s’épargne l’effort de creuser une idée quand elle est bonne. J’ai comparé avec ce qu’est Serge Gainsbourg dans le domaine de la chanson et de la variété, et je persiste : l’ensemble de ses chansons regorge d’idées formidables par leur originalité et leur diversité, mais il n’a jamais cherché à leur donner de l’ampleur en creusant ou développant la forme. Conforté par le succès, il s’est contenté d’aller à la facilité offerte par le contexte marchand et médiatique dans lequel il évoluait. Je me refuse à entrer dans la mythologie dont d’autres se sont complus à entourer, j’allais dire à nimber le personnage.
* Maigret et les témoins récalcitrants (Noland, Vaud, octobre 1958)
Simenon, c’est un peu la même chose : le succès, la facilité. Chaque aventure de son commissaire divisionnaire dépasse rarement les cent cinquante pages. Et de même que les chansons de Gainsbourg, Maigret n’est rien d’autre qu’un produit à consommer, à écouler sur un marché qui, à force de succès, s’est créé pour le voir s’écouler. On me dira ce qu’on voudra, sept jours pour écrire et quatre jours (voir illustration hier) pour réviser un chef d’œuvre, ça fait un tout petit peu léger. Les Maigret ne sont pas des chefs d'œuvre. On a la littérature qu'on mérite.
* Une Confidence de Maigret (Noland, Vaud, mai 1959)
On me dira que Le Père Goriot fut écrit en trois jours au château de Saché (dans la petite chambre, tout en haut), mais je rétorque que, et d’une, pour les trois jours, je demande à voir, et de deux, le bouquin de Balzac est d’une tout autre dimension romanesque et humaine : Rastignac, Vauquer, Vautrin, Goriot existent pleinement, alors que Maigret est un personnage « en creux », un personnage « en négatif ».
* Maigret aux Assises (Noland, Vaud, novembre 1959)
Il est vide. Il n’existe que comme une fonction. Une somme d'habitudes, si l'on veut. Le lecteur n’en a rien à faire de sa psychologie, de son histoire personnelle, de la façon dont son existence s’est construite. Comme Tintin, Maigret est un personnage « une fois pour toutes », monolithique, disons-le : un stéréotype. Dès son apparition, Maigret est un gros flic spongieux de toute éternité.
* Maigret et les vieillards (Noland, Vaud, juin 1960)
On me dira : mais pourquoi le lire, s’il en est ainsi ? Eh bien c’est très simple : il m’a été donné d’hériter la collection complète publiée autrefois par les éditions Rencontre, et je n’ai qu’à donner un coup de pioche dans le gisement pour en voir surgir un, prêt à l’emploi. Vingt-huit tomes de Maigret, soit quatre-vingt-trois romans (j’ai à ce jour parcouru la petite moitié du trajet, quant à la seconde, on verra à la prochaine crise de flemme) auxquels s’ajoutent trois volumes de nouvelles. Je n’ai encore ouvert aucun des quarante-quatre volumes d’ « autres » romans.
* Maigret s’amuse (Golden Gate, Cannes (Alpes-Maritimes, septembre 1956)
Et puis, il y a une autre raison : j’ai fait dans les temps récents quelques lectures que je qualifierai volontiers d’exigeantes, voire austères (Piketty, Jorion, Günther Anders,...), et que la contention, fût-elle intellectuelle, est possible, à condition que l’esprit sorte de temps à autre en récréation, comme on descend taper dans un ballon dans la cour de l’école après la classe.
* Maigret voyage (Noland Vaud, août 1957)
Alors oui, un Simenon fait figure de passe-temps, comme une tranche de détente entre deux tranches de stress. Une récréation.
* Les Scrupules de Maigret (Noland, Vaud, décembre 1957)
Un pis-aller. Un "faute-de-mieux". Et pourquoi pas, une solution de facilité.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, littérature française, commissaire maigret, georges simenon, émile zola, rougon-macquart, henri bosco, bosco l'antiquaire, bosco le récif, serge gainsbourg, le père goriot, honoré de balzac, château de saché, rastignac, vautrin, tintin, thomas piketty, maigret s'amuse, maigret voyage, maigret et les vieillards, maigret aux assises, une confidence de maigret, maigret et les témoins récalcitrants, maigret et le client du samedi, maigret et les braves gens, maigret et le voleur paresseux, la patience de maigret
dimanche, 22 mars 2015
ENCORE MODIANO
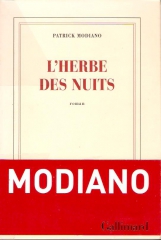 J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.
J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.
Si j'ai tardé à l'évoquer, c'est que mon intérêt pour Modiano, s'il ne s'était pas tout à fait éteint, peut-être avait-il tiédi. L'attribution du Nobel a, disons, réchauffé ma curiosité. Je ne regrette jamais d'avoir lu un livre, même quand j'en sors frustré. Quand j'arrête la lecture en cours de route, c'est que le livre m'a mis en colère, ou alors m'est tombé sur l'ongle incarné (trop lourd, sans doute : je parle du "poids" du livre).
Les prix littéraires, soit dit entre nous, je n’en pense rien, tant la valeur d’un livre ou d’un écrivain me semble incommensurable à sa reconnaissance officielle par une assemblée pontificale, quelle qu’elle soit. Un rite d'autocélébration, en quelque sorte. Une ambiance du genre « Bienvenue au club ! ».
De toute façon, ce qu'on appelle "Grand Prix", vous savez, ces récompenses célébrant les "talents", surtout quand on navigue en milieu littéraire, poétique ou artistique (en gros, ce qu'on appelle les "Affaires Culturelles"), ne sont que des moyens pour une classe dominante de faire passer, en direction des classes dominées, un message du genre : « Vous voyez bien, quand on veut, on peut y arriver ! ». En même temps que ça renforce la légitimité de l'ordre établi (fonction réelle de l'arrosage saisonnier à la Légion d'honneur). Avec ça, je passerai peut-être pour un bolchevique.
Quand on veut, on peut ! Voilà bien un refrain que je hais, un refrain qui sent son moralisme archéo-chrétien, et même pas très catholique. Machine à culpabiliser. Parlez-en au chômeur du coin, qui se heurte aux portes closes de la raréfaction du travail et à qui des Sarkozy viennent faire la leçon : si tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas ! C'est de ta faute ! Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même ! On va te couper les vivres !
Conclusion, en effet : quand on n'y arrive pas, c'est qu'on ne le mérite pas. Modiano, au Nobel, rachète heureusement sa soumission à ce protocole "chez les puissants" par une maladresse existentielle à peu près pathologique, qui ressemble d'assez près à sa littérature, preuve d'une sincérité impossible, je crois, à contrefaire. Si c'était "joué", il serait vraiment très salaud. Parce que, franchement, l'expression « une maladresse existentielle pathologique », ça ressemble d'assez près à une analyse littéraire de l'oeuvre de Patrick Modiano, vous ne trouvez pas ?
Patrick Modiano ressemble juste à l’idée que je me fais du véritable écrivain : celui qui est capable de créer un univers reconnaissable à quelques traits, de la même manière qu'on sait, après deux mesures, qu’on entend « du Chopin » ou, à la translucidité d'une main d'enfant devant la flamme d'une bougie, que l’on contemple « un Georges de La Tour ».
Ce n’est pas une raison pour avaler tous les titres de l’écrivain en file indienne. Pour Chopin, c'est la même chose : pas besoin d'aligner sur la platine les 12 CD de l'intégrale chronologique des œuvres pour piano seul de Frédéric Chopin par Abdel Rahman El Bacha. On sait déjà.
La seule expérience que j’ai faite de cette « méthode », ce fut avec l’œuvre de Henri Bosco, qui, en dehors de deux ou trois titres, n’a plus de secrets pour moi. Pardon : "la seule", c'est inexact : j'ai aussi fait ça avec les Rougon-Macquart (ce qui, entre parenthèses, m'a guéri de la Zola-rziose).
J’ai fait une tentative semblable avec un recueil d’ouvrages de Françoise Sagan (collection Bouquins) : j’ai calé au bout du cinquième, à cause, je crois, de l’atmosphère raréfiée de bocal à poissons rouges, de l'espèce des nantis à l'existence futile, dans laquelle elle plonge le lecteur. Ne pas confondre l'oeuvre littéraire avec le feuilleton. Après tout, il y a peut-être du feuilletoniste chez Modiano. Je dis peut-être une grossièreté ? Tant pis.
Je ne désespère pas de me remettre à la lecture chronologique de La Comédie humaine, abandonnée elle aussi, mais au bout d’une trentaine de titres tout de même. Balzac, c'est autre chose, il dépasse de loin la somme des recettes successives qu'il met en oeuvre. Et je reviens, bien entendu, assez régulièrement, à Simenon, entre autres à ses « Maigret », après avoir éclusé une trentaine également de ces derniers.
Je ne conseille par conséquent à personne de procéder de cette manière avec les romans de Patrick Modiano. Je n’userai pas du poncif de la « petite musique » qui sert d’échappatoire au « critique littéraire » qui n’a pas envie de se fouler pour entrer dans des considérations un peu précises et sérieuses. Il se trouve cependant qu’en ouvrant L’Herbe des nuits peu de temps après avoir lu Pour que tu ne te Perdes pas …, j’ai eu la curieuse impression de lire un décalque de celui-ci.
Même petit carnet rempli de notes diverses. Même ribambelle de noms, de dates, d’adresses, de numéros de téléphone, de lieux de rendez-vous, dont beaucoup ne disent plus rien au narrateur, perdus dans le brouillard d’un passé qu’il cherche à ressaisir, mais il a bien du mal, le pauvre, avec tout le temps qui a passé. Même genre de personnage féminin énigmatique (« Dannie »), à l’identité fuyante.
Même milieu interlope où cette femme évolue, au milieu de noms d’hommes un peu louches : un « Aghamouri », agent secret qui fait semblant d’être étudiant, un « Paul Chastagnier » qui donne au narrateur des « conseils d’ami ». Un « Unic Hôtel », quelque part à Montparnasse, dans le hall duquel ces hommes se retrouvent.
Peu importe au fond la succession des faits dont le livre se fait un argumentaire en quelque sorte obligé. Les récits que Modiano élabore dans ses romans n’ont rien d’événementiel. Non, pas de rebondissements, rien de spectaculaire, pas de tragédie grandiose. L’amateur de ce genre de littérature ne le trouvera pas ici.
L’étoffe dont sont tissés les livres de Modiano est de nature différente. Si je voulais résumer les impressions que me laisse L’Herbe des nuits, je commencerais par dire : une littérature d’état d’âme ; une littérature de climat. L’état d’âme d’un homme qui a été « mal jeté dans la vie » (j’ai connu un Benoît Vauzel  dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.
dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.
Du narrateur lui-même, d’ailleurs, on n’apprendra que des bribes, livrées parcimonieusement, par intermittence. Le narrateur en personne est un peu fuyant, c’est certain : il ne tient pas à laisser de traces derrière lui. Et puis, il semble fatigué, ce narrateur, dépressif peut-être ? C’est bien lui qui dit : « Mais, je n’y peux rien, en ce temps-là j’étais aussi sensible qu’aujourd’hui aux gens et aux choses qui sont sur le point de disparaître » (p. 89).
Dans L’Herbe des nuits, comme dans beaucoup de livres de Modiano, tout le monde pose beaucoup de questions. Quasiment aucune d’entre elles ne reçoit de réponse. Ici, il faut la convocation du narrateur par un certain Langlais, quai de Gesvres, pour qu’il réponde à des questions. On comprend que c'est un policier. Dans les livres de Modiano, j’ai l’impression que, quand ce n’est pas la police qui pose les questions, celles-ci ne reçoivent jamais de réponse. Et encore … Mais je me dis qu'après tout, la police ne pose jamais les bonnes questions.
Car il y a ce détour par la surprenante amitié de Langlais pour Jean, le narrateur, pour accéder à la clé de certains mystères. Pas tous, qu’on se rassure. Et même loin de là. « Dannie » a-t-elle finalement commis un crime ? La personne qui a reçu « deux balles perdues » a-t-elle, dans le passé, été victime d’une erreur de manipulation ou d’une intention claire ? Personne n’est en mesure de répondre. Même la police échoue à faire toute la lumière sur certaines petites choses finalement triviales de la réalité.
L’univers mental dans lequel se débattent désespérément, roman après roman, les héros de Patrick Modiano, est un univers à jamais flottant. Un univers où personne ne répond aux questions, en particulier à la question « Pourquoi ? ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature française, patrick modiano, l'herbe des nuits, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, prix nobel de littérature, éditions gallimard, collection blanche, affaires culturelles, nicolas sarkozy, abdel rahman el bacha, émile zola, henri bosco, rougon-macquart, françoise sagan, collection bouquins, la comédie humaine, honoré de balzac, georges simenon, commissaire maigret, benoît vauzel mal jeté dans la vie
mercredi, 29 janvier 2014
19 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Je ne fais pas exprès de passer du temps sur La Peau de chagrin : c'est le livre lui-même qui m'y conduit. Qui m'y oblige peut-être. Et pour dire les choses franchement, je trouve du plaisir à en parler. C'est peut-être un signe, après tout.
Alors en fait, qu’est-ce que c’est, concrètement, une peau de chagrin ? C'est le problème du jour. La deuxième partie, intitulée « La femme sans cœur », est totalement muette sur ce point, puisqu’elle raconte en long, en large et en détail ce qu’a été la vie de Raphaël avant la rencontre avec le vieux marchand d’antiquités.
Dans la première, la présentation et la description de la peau sont expédiées en cinq pages. Il est vrai que ces pages sont d'une densité rare. Tout le monde connaît le thème, ressassé dans les manuels scolaires et les dictionnaires et histoires de la littérature. Tout le reste est dans la dernière, quand la peau de chagrin, en entrant en possession, entre en action. Et c'est bien elle qui possède celui qui la possède. Une variante du pacte faustien, en quelque sorte.
Je commencerai donc logiquement par la dernière partie, lorsque Raphaël a déjà commencé à subir les effets de la peau magique. Et encore plus logiquement, je débuterai par cet épisode tout à fait étonnant, dans lequel Balzac raconte les démarches accomplies par le héros pour percer le secret de ce talisman incroyable, dont il a scrupuleusement tracé le contour d’origine sur une grande surface blanche, et dont il a constaté le rétrécissement, déjà conséquent au moment où j'en parle.
Balzac décide, à ce moment du récit où la vie de Raphaël se résume à une petite pièce de cuir qui rapetisse dès qu’il exprime un désir, de confronter la Science à un phénomène qui la dépasse. Le premier spécialiste qu’il consulte est le zoologiste Lavrille, qui lui révèle (ou lui affirme) que la peau est celle d’un âne de Perse, plus précisément un onagre.
Cela ne lui apprend strictement rien, puisqu'au moment où il découvrait l'existence de la peau (au début du livre), il déclarait : « J'avoue, s'écria l'inconnu, que je ne devine guère le procédé dont on se sera servi pour graver si profondément ces lettres sur la peau d'un onagre ». Mais il n'est pas impossible que ce détail soit une étourderie de Balzac : ce ne serait pas la seule.

UN ONAGRE
Comme Raphaël aimerait bien faire retrouver à la peau sa surface d’origine, Lavrille l’aiguille sur le professeur Planchette, célèbre spécialiste de mécanique, en plein siècle de la mécanique toute-puissante (et de son exaltation). Planchette, comme Lavrille et la plupart du temps les scientifiques, est un illuminé perdu dans ses raisonnements et ses découvertes, et insoucieux de la gloire et de l’argent.
Rendus chez le métallurgiste Spieghalter, Planchette introduit la peau entre les deux platines d’une presse hydraulique. Que croyez-vous qu’il arrive ? La presse se brise, incapable de venir à bout de cette peau animale : « Non, non, je connais ma fonte. Monsieur peut remporter son outil, le diable est logé dedans ». L’Allemand en colère aura beau flanquer un énorme coup de masse sur la peau posée sur une enclume, la faire brûler dans une forge, celle-ci ressort absolument intacte de tous les mauvais traitements : « Un cri d’horreur s’éleva, les ouvriers s’enfuirent ».
Planchette emmène alors Raphaël chez Japhet pour voir si la Chimie viendra à bout du problème, mais là encore : « La Science ? Impuissante ! les acides ? Eau claire ! La potasse rouge ? Déshonorée ! La pile voltaïque et la foudre ? Deux bilboquets ! ». La conclusion des deux savants, après avoir baptisé « diaboline » la substance de la peau est la suivante : « Gardons-nous bien de raconter cette aventure à l’Académie, nos collègues s’y moqueraient de nous ». Echec sur toute la ligne.
Ce n’est pas pour rien que le mot « cuir » a produit le mot « coriace ». C’est sûr, au sujet de la « Science », on ne saurait confondre Balzac et Zola. Ce qui les différencie ? Pour schématiser, je dirais volontiers que Balzac ressemble à un moteur à explosion, émotif par nature, quand Zola descend par filiation des animaux à sang froid, scientifiques par profession, par nature et par vocation. Le passionnel opposé au rationnel. L’observation du vivant, par contraste avec la dissection des cadavres sur le marbre d’un amphithéâtre de faculté de médecine. La palpitation des émotions contre l'esprit de système. Les battements du cœur contre la Raison toute-puissante et desséchée.
Pour résumer, je vote Balzac, et je jette (pas tout) Zola à la corbeille.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la peau de chagrin, émile zola
lundi, 02 septembre 2013
MEANDRES AVEC HENRI BOSCO
L’intéressant, quand on lit en rafale les livres d’un auteur, c’est qu’on perçoit rapidement, en quelques clics de regards successifs, ses tics et formalismes d’écriture, ses obsessions thématiques et ses petites manies. J’avais fait ça – plonger en immersion de longue durée –, il n’y a pas si longtemps, avec les Rougon-Macquart de Zola. Cela m’avait d’ailleurs éloigné de lui. Cette lecture m'avait fait osciller de la gourmandise la plus primaire à l'horripilation la plus stridente.
Zola a écrit, dans sa série soi-disant « scientifique », un certain nombre d’ouvrages insupportables (Le Docteur Pascal, La Faute de l’abbé Mouret, …), quelques-uns convenables (Son Excellence Eugène Rougon, …), et quelques autres rigolos (Nana, Pot-Bouille, …). J'en oublie sûrement. Pour moi, le Zola absolument rédhibitoire et pestilentiel réside presque tout entier dans l’infernal effort de démonstration. Tant qu'il se comporte en artiste-peintre, tout va bien. Je marche, parce que ça, vraiment, il connaît, il sait faire, il est très bon.
Mais chaque fois qu’il a quelque chose à prouver, il se comporte en bourreau : il ligote le lecteur au poteau de tortures, et lui assène, article par article, tous les commandements de la vraie foi, un nouveau Décalogue, en les détaillant, qui plus est, jusqu’à la plus infime virgule. Souvent caricatural à cause de ça. En un mot, Zola m'emmerde plus souvent qu'il ne m'intéresse. Je crois que le problème de Zola, c'est qu'il veut assener des vérités.
Son addition est lourde, consistant à alterner des énumérations dignes de la généalogie de Pantagruel et des raisonnements de commissaire du peuple à Moscou en 1937 : Emile Zola est alors digne du kouign-amann breton, pourtant encore à peu près digeste, même s’il est déjà relativement étouffe-chrétien, et, mieux encore, de l’authentique Christmas-pudding, dont les Britanniques eux-mêmes ne viennent à bout qu’après un usage énergique du burin. C’est d’ailleurs probablement d’une confrontation immémoriale avec le Christmas-pudding que les marins de Sa Majesté tiennent leur visage buriné. Pardon.
Sans en subir quelque séquelle que ce fût, j’avais auparavant pratiqué l’immersion de longue durée dans diverses étendues littéraires diversement profondes qui avaient nom Rabelais (immersion permanente), Montaigne (immersion récente) ou Balzac (immersion ancienne). J’avais aussi effectué des plongées de reconnaissance dans certains grands lacs américains nommés Steinbeck, Faulkner, Caldwell et quelques autres. Et ailleurs. Le retour à la surface s’était toujours déroulé sans dommage particulier. J’en avais conclu que Zola est un cas, mais alors un cas vraiment à part, un cas d’école peut-être. En clair : tout ce qu'il ne faut pas faire. En tout état de cause, on ne m’y reprendra plus.
L'immersion dans les eaux provençales des livres de Henri Bosco, pour parler franchement, je n’avais pas prévu. J’avais laissé au placard le masque, les bouteilles et les palmes. J’y suis donc allé d’abord en apnée, à faible profondeur. Et puis, je ne sais pas, peut-être que même là on risque l’ivresse ? Allez savoir. Ce qui est sûr, c’est que l’immersion s’est imposée d’elle-même. Il m’en est peut-être venu des branchies, après tout, à force de respirer sous l’eau. Allez savoir. Je garde en mémoire les vrais instants d'une vraie jubilation littéraire.
Ce n’est pas le coup de foudre, attention, on n’en est pas là. D’abord, on a passé l’âge. L’emballement de l’homme mûr, j’ai tendance à considérer ça comme un argument marketing développé par des cabinets d’avocats spécialisés dans le divorce, la garde des enfants, la récupération de grosses pensions alimentaires et autres prestations compensatoires, capturées au vol sur les cadavres consentants des maris infidèles et autres quinquagénaires en mal de peau lisse d’adolescentes attardées, celles qui sont à la recherche, tout à la fois, d’une épaule mâle et paternelle, d’un bel intérieur et d’un avenir matériel assuré.
Je n’ai aucune envie d'apparaître aux yeux du monde et de ses commérages comme le grand-père de mes enfants, ceux que pourrait soutirer de mes restes de fertilité séminale quelqu’une de ces femelles récentes, avides de sécurité de l’emploi, habiles dans le maniement du filet de pêche et passées expertes dans l'exhibition de diverses surfaces de peau soyeuse et de rondeurs savamment mises en valeur comme autant d'hameçons pour appâter le mâle impatient d'échapper enfin au spectacle du même nez au milieu de la même figure qu'il contemple depuis trop longtemps (cf. Auprès de mon arbre, de Georges Brassens). Moyennant les habituelles contreparties sonnantes.
Mais je me calme, je reprends mon souffle, et je reviens aux phrases courtes et à Henri Bosco. Je disais donc que ce n’est pas le grand amour. J’ai dit un mot du pourquoi de la chose mais, au-delà des sujets d’agacement, mes séances de plongée dans les eaux « bosciennes » m’ont permis d’apprécier une littérature française comme plus personne n’est en mesure d’en écrire. Même que c'en est un crève-cœur.
Si j’avais à caractériser l’univers de Henri Bosco en quelques mots, j’insisterais en tout premier lieu sur son amour incommensurable de la langue française, sur la très haute idée qu'il s'en faisait, sur la très haute exigence avec laquelle il la cultivait. Un amour de la langue française qui l'a amené, fidèlement au fil des ans, à la féconder et à lui faire des enfants magnifiques, écrits dans une prose riche et pleine, en même temps qu'exacte et précise. Qui sait encore écrire ainsi ?
J'insisterais ensuite sur l'aspect double de son univers : étranger et familier, proche et lointain, profond et épidermique, inquiet et serein, lisse et épineux : « Cela m’effraye. Cela aussi me charme ». De même, et de façon plus visible, l’état du narrateur est très souvent un « entre-deux », une hésitation entre la veille et le sommeil, entre le songe (Bosco parle rarement de "rêve") et la réalité, entre l’ombre et la lumière, entre la nuit et le jour. Une littérature du "peut-être", en somme. Une littérature de l'interrogation, voilà.
Les quelques livres que j’ai lus ces temps-ci regorgent de ces formules où le narrateur, quand il fait mine d’avancer, se débrouille pour préparer un éventuel recul : « J’entendis ce soupir, je pressentis cette aise, mon cœur s’apaisa.
Je ne savais que trop ce qu’il contenait de détresse et d’amertume ». Et encore : « Seul, ce cri insistant et d’une sauvagerie si mélancolique … ». Et encore : « … l’extrême lucidité de ma conscience en exaltation … ». Ces quelques formules sont picorées dans L’Antiquaire. Les délices ne sont jamais très loin de la terreur, à croire qu'elles sont réversibles les unes dans l'autre et inversement. Ou qu'on a affaire à deux polarités qui n'existent que se nourrissant l'une de l'autre, indissociables.
Il n’est pas jusqu’au narrateur lui-même qui ne se dédouble à l’occasion, et même plus souvent qu’à son tour. Toujours dans L’Antiquaire : « Car, seriez-vous entré (…) si vous n’eussiez porté à votre insu, en vous, un personnage différent de celui que vous êtes d’ordinaire, et qui s’est révélé soudain, grâce à cette rencontre ? » ; « Je perdis le pouvoir de me distinguer de moi-même …». J'avais noté le même dédoublement chez le narrateur d'Un Rameau de la nuit. Je pourrais continuer sur le thème.
Sans tomber dans l’étude systématique qui ferait fuir tout le monde, moi le premier, je dirais que Henri Bosco écrit avant tout pour creuser. Le Bosco est un animal fouisseur. Je vois en lui l’écrivain de la profondeur : celle de la nuit, celle de l’être, dont on ne sait combien d’êtres cohabitent au fond de lui, celle du mystère qui rattache l’être au monde, à commencer par la terre agricole, mais aussi le mystère qui lie les êtres entre eux, à commencer par l’homme en face de la femme qu'il aime. Jamais sans réticence. Pas facile de se donner, quand on est un personnage de Bosco.
Il y a chez Bosco (c'est une impression) autant de besoin de don de soi que de réticence à se donner. Un obstacle sépare bien souvent le narrateur de la statue resplendissante de la plénitude et de l'accomplissement. On pressent l'idéal, il n'est pas loin, mais on dirait que le réel oppose sans cesse l'opacité de sa matière à l'effort fait pour l'atteindre.
Les personnages successifs de narrateur sont des microcosmes qui tendent sans cesse à reconstituer l'univers au-dedans d'eux-mêmes, qui aiment laisser se mouvoir en eux le pressentiment du divin et de l'infini, mais qu'un objet bêtement concret, ou bien une innommable peur empêche d'inscrire ce désir immense dans la réalité. Car le désir est immense, mais il reste intérieur. Henri Bosco nous fait percevoir la limite, qui produit la frustration et la déception, mais aussi l'espoir.
Une autre obsession de l'auteur est l'omniprésence du songe. Pas du rêve, mais du songe. Le plus souvent vaste, nocturne, éventuellement dangereux. Le songe, jamais raconté dans son contenu et son déroulement (pourtant raconté en détail dans Le Récif), ouvre à l'esprit du narrateur l'espace infini de tous les possibles, qui vient compléter toutes les insuffisances de la raison et de la réalité concrète.
Il me semble que le songe, chez Bosco, est à la base d'une familiarité avec les êtres de même nature (ainsi la tante Martine), mais aussi avec les choses, que l'esprit du narrateur dote d'une existence propre, d'une sensibilité. D'une âme, pour ainsi dire. Le monde de Bosco est profondément animiste.
Et puis le grand mystère de l’existence. Il ne fait guère de doute que Henri Bosco est catholique. Ah non, il ne prêche pas, c’est certain. Simplement, c’est bien rare si une messe n’est pas dite à un moment ou à un autre, par un prêtre en tenue sacerdotale, devant un auditoire de fidèles plus ou moins fourni (parfois aucun, comme dans L'Epervier). C'est aussi bien rare si le narrateur n'est pas poussé à la prière, à un moment ou à un autre.
Même Baroudiel le mécréant, à la fin de L’Antiquaire, assiste en compagnie de son ami François Méjean à une messe : « Tous les gestes étaient de louange et d’extase ». On ne saurait être plus clair. Je le dis nettement : la présence de cette foi dans les livres de Bosco ne me rebute en rien. Et pourtant Dieu lui-même sait que je suis un incrédule endurci ! Païen irrévocable. Remarquez que Bosco lui-même ne serait pas exempt de toute accusation de paganisme, du fait du culte de la Nature qu'il professe. Disons, au moins, préchrétien.
Païen irrévocable donc. Et pourtant, ça ne m’empêche pas d’écouter religieusement Vingt regards sur l’enfant Jésus, le chef d’œuvre d’Olivier Messiaen, ou la Passion selon Saint Jean, de JSB. L’absence de foi ne saurait s’offusquer de la foi, cette force qui pousse l'homme à s'élever au-dessus de sa condition, quand l'expression de celle-ci crée des formes (poésie, musique, ...) où le sens supra-terrestre n'est jamais tout à fait explicite.
Même un païen peut tomber en arrêt, médusé, devant la merveille du chevet de Saint Austremoine d'Issoire. La traduction concrète de la foi n’est, à tout prendre, que la fumée du brasier de l’angoisse existentielle où se consume le bois sec et craintif de l’esprit humain (depuis l’aube des temps, comme on dit). Le fond du message prime-t-il sur la forme dans laquelle il a été formulé ? Ou l'inverse ?
Ce respect radical et immédiat que j'éprouve envers tous les monuments nés de la foi des hommes n'est peut-être, sait-on jamais, qu'une manifestation occulte de je ne sais quelle nostalgie du temps lointain où rien, en moi, ne contestait sa lumière, alors irréfutable ? Qui pourrait dire quel travail s'est fait ensuite ?
Pour dire combien ce temps est lointain, je me dois de confesser aujourd’hui avoir, quand j’avais sept ans, jeté la noire panique du néant satanique dans l’âme pure et pieuse de la pauvre « Sœur de Marie Auxiliatrice » qui me faisait le catéchisme, en lui affirmant qu’il était rigoureusement impossible, impensable, inimaginable, bref : déraisonnable d'admettre qu’un homme puisse revivre trois jours après sa mort. Affolée, elle avait repris toute l’affaire de A à Z. Je veux dire qu'elle avait récité fidèlement ce qu'on lui avait appris.
Conciliant et bon prince, j’avais écrasé le coup : on n’allait pas y passer le réveillon ! J’avais ma partie de billes en perspective. Guy B. me devait une revanche. Ça motive. Mais je garde encore en mémoire la terreur abyssale qui s'est peinte sur le visage de la nonne quand j'ai posé ma question. Mea culpa, ma sœur.
C'est sûr, de ce point de vue, Henri Bosco et moi, nous ne sommes pas de la même famille d'esprit. Mais ça n'empêche pas l'estime, et même l'admiration envers l'art d'écrire manifesté dans ses œuvres, art dont il possède la maîtrise accomplie, et qui a à peu près disparu aujourd'hui du paysage.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, henri bosco, émile zola, le docteur pascal, la faute de l'abbé mouret, sonexcellence eugène rougon, nana, pot-bouille, christmas pudding, rabelais, balzac, auprès de mon arbre, georges brassens, l'antiquaire, un rameau de la nuit, le récif, tante martine, l'épervier, accipiter, olivier messiaen, vingt regards sur l'enfant jésus, jean sébastien bach, passion selon saint jean, saint austremoine d'issoire, catholique, chrétien
jeudi, 27 juin 2013
POURQUOI JE LIS
Je ne suis pas un immense lecteur. Je suis même un lecteur un peu laborieux. Ce que je lis, il faut que je le mâche longuement, que je le mastique, que je le contemple en train de s'écraser en nourriture entre mes dents, avant d'aller alimenter et irriguer les canalisations de mon moi littéraire. Si je devais me comparer, je dirais que, dans l’ordre des lecteurs, j’appartiens à la famille placide et patiente des ruminants contemplatifs.
A propos de contemplatif, je me consolerais en me disant que Julien Gracq, qui n’a pas couvert de ses œuvres des kilomètres de rayons, a écrit sur le tard ce merveilleux petit bouquin intitulé Les Eaux étroites, qui, en condensant une matière longuement ruminée pour en polir le pur éclat de chacune des facettes, ouvre sur cette sorte d’infini en profondeur que recèle ce paysage minuscule, sa rivière de l’Evre, qui passe à Saint-Florent-le-Vieil.
Le paysage de mes lectures n'est pas aussi vaste, et n'a rien à voir avec les horizons des mers vides à perte de vue, avec ceux des plats pays aux ciels sillonnés de nuages, ou avec ceux de ce désert de sable où se découpe une caravane au sommet de la dune, sur fond de ciel, si possible en contre-jour (en fin de journée). Mes paysages de lecture sont bornés par les arbres qui dressent leur opacité bienfaisante et lumineuse au bout de mon jardin affectif. Même s'il arrive qu'un cachalot pointe sa mandibule débonnaire et souffle ses vapeurs non loin de mon embarcation.
Pour dire le vrai, ça fait déjà quelque temps que je n’ai plus envie de lire pour lire. Et même de lire pour avoir lu. Vous savez, ces œuvres qu’il faut avoir lues si l’on ne veut pas mourir idiot. Si, bien sûr, je m’en suis collé, des Mémoires d’Outre-tombe et des Rougon-Macquart. Mais souvent par devoir. Il ne faudrait jamais lire par devoir. Je plains de tout mon coeur les élèves de lycée : pour rien au monde, je n'aurais souhaité être à leur place. Même si ... Comment pourraient-ils aimer la littérature, s'il ne s'agit que « d'avoir 10 en français » ?
Pour les Mémoires … de Chateaubriand, j’exagère, car j’ai pris du plaisir en beaucoup d'endroits, - moins pour les tableaux historiques, où l'auteur s’efforce toujours de ne pas dessiner son propre personnage en trop petit dans un coin en bas, comme un vulgaire donateur, tiens, comme un « Chanoine van der Paele » dans un tableau de Jean Van Eyck, comme on faisait à la Renaissance et avant, - que pour les routes européennes (en particulier alpines) parcourues en tout sens et les portraits, en pied ou collectifs, aux contours dessinés d’un beau trait précis.
Les 20 Rougon-Macquart, je me les suis avalés dans l’ordre, enfin presque : non, je n’ai pas fini Le Docteur Pascal, c’était au-dessus de mes forces, le curé laïc, sa probité inentamable, son cœur gros comme ça, sa "bonne âme". Mais le docteur Pascal, on sait que c'est Zola en personne, c'est sans doute pour ça que je n'ai pas pu finir l'assiette.
Mais avant d’en arriver à ce dernier épisode, j’avais eu le temps de détester Le Ventre de Paris, Au Bonheur des dames et La Faute de l’abbé Mouret : Zola se serait amusé à décrire par le menu chacune des milliards de milliards de gouttes de pluie pendant les quarante jours et les quarante nuits qu’a durés le Déluge, il ne s’y serait pas pris autrement. De quoi noyer tout lecteur moyennement bien intentionné. Ces énumérations ! Epaisses comme des Dictionnaires de Cuisine, commes des Catalogues de la Redoute ou comme des Traités de Botanique Paradisiaque (dans l'ordre des titres) !
Au moins, mon verdict sur les romans de Zola, je ne le tiens de personne d’autre que de moi : tout ça est, à quelques exceptions près, épais, lourd, bourratif et indigeste. Parmi les exceptions, je dirais volontiers qu’il y a quelques friandises délectables à se mettre sous la dent, dans La Débâcle, La Bête humaine, malgré l'obsession gynophobique du héros, mais dont Robert Musil, dans L’Homme sans qualités, s’est peut-être souvenu pour son incroyable personnage de Moosbrugger.
Je goûte aussi quelques douceurs cachées dans La Conquête de Plassans, Son Excellence Eugène Rougon, L’Argent, La Curée. Non, tout n’est certes pas à jeter, même si j’aurais eu parfois envie de lui dire : « N’en jetez plus, la cour est pleine ! ». Zola a possédé vraiment la science (à défaut de l'art) d’écrire, mais je regrette qu’il ait écrit sous la dictée de l’idéologie, de la théorie et du poids documentaire. Et cette obsession de l’hérédité, ma parole ! Un vrai petit Lyssenko avant la lettre, vous savez, l'adepte stalinien de la transmission à tout crin des caractères acquis.
En revanche, quelqu'un qui n'a jamais lu L'Iris de Suse ne sait pas ce qu'est l'émerveillement. Il est vrai que, lorsque je l'ai ouvert, j'étais tout prêt et disposé, car je m'étais de longtemps familiarisé avec le bonhomme Giono et les concrétions romanesques qu'il a laissées sur son passage, comme par exemple le cycle du capitaine Langlois, ou alors Deux Cavaliers de l'orage, ce livre tout à fait improbable (ce colosse qui abat d'un seul coup de poing un cheval qui sème la panique, mais ça finira mal), ou encore le long cycle d'Angelo, ce héros chéri de Jean Giono (pour qui a lu Le Bonheur fou, est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi Angelo enferme son sabre dans un placard avant de sortir dans la rue où il sait que rôdent des spadassins, peut-être envoyés par sa propre mère ?). Giono n'explique rien : il montre. Voilà un romancier.
En fait, je peux bien l’avouer, je n’ai jamais lu « pour lire ». Je connais des gens (on en connaît tous, j’imagine) qui ne peuvent pas sortir de chez eux sans un livre à la main. Dans le métro, dans la rue, à la terrasse des cafés, c’est un enfer de livres ouverts, d'écrans de portables et de casques sur les oreilles, comme si les gens ne voulaient pas risquer de communiquer avec les gens présents en y frottant une parcelle de leur corps ou de leur tête, et se servaient de ces moyens pour s’embusquer dans leur tanière impénétrable, toutes griffes dehors.
On dirait que les gens se bouchent les oreilles avec leurs casques et les yeux avec leurs livres. Et c’est eux qui, ensuite, cherchent anxieusement l’âme sœur sur quelque site de rencontre. Je me dis que la peau virtuelle sur écran, l'écran fût-il tactile, est moins douce à caresser que celle qu’on vient de frôler, ici, là, dans le métro ou sur le trottoir, au rayon de ce magasin ou à l’arrêt de ce bus, et qu'on se met à suivre, à aborder, ... et plus si affinités. On ne sait jamais.
Car la peau qu'on vient de frôler et de laisser se perdre dans la foule, et qui t'inflige ce regret qui te mange le coeur et la mémoire si tu n'as pas fait le geste ou l'effort (Les Passantes, Georges Brassens), cela s'appelle le désir. Mais un désir rétrospectif, celui où tu te dis : « Merde, j'ai loupé l'occase du siècle ! ». Trop tard. Au sujet du regret que nous infligent après coup nos désirs désormais timorés et frileux, voir la rubrique « Transports Amoureux » dans le journal Libération.
Je conseille à tous les avanglés (« Te bâfres comme un avanglé ! », trouve-t-on dans Le Littré de la Grand-Côte) de « contact » électronique de relire comme un manuel de savoir-vivre les dernières pages de Ce Cochon de Morin, de Guy de Maupassant, c'est le beau Labarbe qui est envoyé pour arranger la sale affaire de Morin : « ʺJ’avais oublié, Mademoiselle, de vous demander quelque chose à lire.ʺ Elle se débattait ; mais j’ouvris bientôt le livre que je cherchais. Je n’en dirai pas le titre. C’était vraiment le plus merveilleux des romans, et le plus divin des poèmes. Une fois tournée la première page, elle me le laissa parcourir à mon gré ; et j’en feuilletai tant de chapitres que nos bougies s’usèrent jusqu’au bout ». Les bougies, c'était donc ça ! Maupassant ne reculait devant aucun "sacrifice" ! Quel salaud ! Quel macho ! Non : quel homme ! Au moins, lui, il donne envie de "lire" des "livres" !
Au lieu de ça, à cause de la musique portable, mais aussi, hélas, du livre de poche, on est dans la civilisation du « On ferme ! », au moment même où celle-ci se proclame à renforts de trompettes « Ouverte 24/24, 7/7 ! ». On n’en a pas fini avec le paradoxe et l’oxymore. Et la morosité tactile, éperdue et portable. Et les petites annonces amères « Transports amoureux » de Libé.
Voilà ce que je dis, moi.
09:01 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, lecture, livre, librairie, julien gracq, les eaux étroites, mémoires d'outre-tombe, chateaubriand, les rougon-macquart, peinture, jean van eyck, émile zola, le ventre de paris, au bonheur des dames, la faute de l'abbé mouret, la débâcle, la bête humaine, robert musil, l'homme sans qualités, moosbrugger, la conquête de plassans, l'argent, la curée, littré de la grand'côte, lyon, maupassant, ce cochon de morin, journal libération, les passantes, georges brassens
mardi, 25 juin 2013
PARLONS DE PHILIPPE MURAY

PAYSANNE, PAR AUGUST SANDER
***
Pour finir ce petit parcours informel dans un livre – Le 19ème siècle à travers les âges de Philippe Muray – fort, quoique fondé sur une thèse qui ne me convainc pas vraiment, il faut quand même essayer de dire d’où il tire sa force. C’est sûr, il reste un livre qui plane très haut au-dessus de la mêlée.
Au premier rang – c’est là-dessus que je finissais hier – vient une érudition étonnante (je disais « écrasante »). Il vous parle en effet des têtes d’affiches (Hugo, Balzac, Zola, mais aussi allumeurs de réverbères intellectuels et autres becs de gaz du 19ème, comme Auguste Comte, Ernest Renan, et autres acharnés anti-catholiques). Mais il vous parle aussi des queues d’affiches.
C’est vrai que la liste des noms cités par Muray tout au long du bouquin a un côté affolant. Pour vous dire, l’index des pages 675 à 686 ne compte pas moins de 726 noms propres. Beaucoup d’entre eux ne sont cités qu’une fois, alors que le nom de Victor Hugo apparaît à 214 reprises. Bon, on peut se demander si toutes ces lectures sont vraiment de première main, mais quoi qu’il en soit, cet aspect encyclopédique du livre demeure impressionnant.
L’intérêt de très nombreuses références est de mettre en lumière des facettes tout à fait méconnues de certaines célébrités littéraires. Si tout le monde connaît à peu près le penchant développé par Victor Hugo pour faire tourner les guéridons, c’est que tous les spectres bavards qui s’y sont manifestés (y compris Jésus Christ) parlaient le Victor Hugo sans peine, parfois même en alexandrins hugoliens, en revanche, les dernières œuvres d’Emile Zola sont à peu près totalement ignorées.
Il n’est pas sûr que la foule se précipite sur les vingt romans de la suite épuisante des aventures des familles Rougon et Macquart, mais des titres comme Nana, Au Bonheur des dames, Germinal ou La Bête humaine font partie d’un patrimoine littéraire commun, scolaire sans doute, mais réel. Muray s’attache quant à lui à la trilogie réunie sous le titre Les Trois villes (Lourdes, Rome, Paris) et à la tétralogie Les Quatre évangiles (Fécondité, Travail, Vérité, Justice). Que personne ne lit plus. En grande partie parce que c'est tout à fait illisible.
Il s’en prend à la logorrhée qui s’empare de la plume de Zola sur le tard : « Je passe sur le fait que, bien entendu, au fur et à mesure qu’il approche de sa fin, Zola se dispense de plus en plus de l’obligation fatigante d’écrire, tout simplement ». Il voudrait dire que Zola devient gaga et se contente de laisser courir sa main sur le papier, il ne s’y prendrait pas autrement. Mais c’est vrai qu’il n’est pas le seul à juger toutes ces dernières œuvres assez nulles sur le plan littéraire.
Je passe sur l’étrange multiplication que Muray opère deux pages avant la phrase citée : « Il ne faut pas moins de trois gros livres, trois livres de huit cents pages chacun, soit environ mille huit cents pages, pour … » (authentique). Il reste que Zola s’imagine en Grand-Prêtre et en Prophète, il se rêve en fondateur de la « Cité Nouvelle ». Son anti-catholicisme (la nouvelle « religion » étant fondée sur l’enseignement généralisé et sur la science) fait qu’il donne pour finir dans le panneau de la Littérature Edifiante. Ecoeurant.
Bon, je ne voudrais pas que mon propre commentaire tire à ce point en longueur qu’on puisse le qualifier de logorrhéique, alors je vais conclure. Je ne reviens que pour mémoire sur l’hypothèse occultiste : à mon avis, le « socialoccultisme » n’existe guère que dans le livre de Philippe Muray. Un regard original qui fait voisiner le progressisme des théories et utopies sociales et l’illuminisme des théories spiritistes les plus abracadabrantes, mais qui, selon moi, échoue à en montrer les implications réciproques de l’un dans l’autre : la cloison reste debout, épaisse, étanche.
Je ne voudrais pas insister trop lourdement sur ce qui fait la puissance du livre, mais il faut redire que son apport principal est dans le grand brassage de toutes sortes de matières, dont l'aboutissement est une remarquable synthèse sur la grande coalition des intérêts qui se sont ligués depuis les Lumières et la Révolution, pour abattre une bonne fois pour toutes le grand ennemi du Progrès : l’Eglise Catholique, rejetée dans l’obscurantisme moyenâgeux, au nom de la marche de l’humanité vers son avenir radieux, et de la nouvelle croyance : la Religion du Progrès.
J’ai oublié d’en parler, mais Philippe Muray mentionne un dommage « collatéral » de cette exaltation du Progrès grâce à la Science : l’antisémitisme, qui culmine en France à la fin du 19ème avec l’affaire Dreyfus, et au 20ème avec les chambres à gaz.
A cet égard, le regard de Philippe Muray est clairvoyant : la logique du Progrès de la Science et de la Technique, sorte de mécanique infernale mise en route par cette promotion démesurée de la Déesse Raison, si magnifiquement qu’il soit habillé, c’est l’horreur de la 1ère Guerre Mondiale (dont François Hollande s’apprête à « célébrer » le centenaire l’an prochain, en très grande pompe), c’est l’horreur des camps de la mort, c’est l’horreur de la première bombe atomique, c’est l’horreur des génocides qui ont jalonné le 20ème siècle d’un bout à l’autre (Arméniens, Juifs, Tziganes, Cambodgiens, Rwandais, …). Pardon, j’exagère, nous avons la télévision, les smartphones et les sachets de récupération des crottes de chiens sur les trottoirs. Ça compense largement.
A tout prendre, je considère Le 19ème siècle à travers les âges comme un excellent ROMAN du siècle romantique. Par la place centrale qu’il donne aux grands écrivains et poètes (ce n’est pas rien que le dernier chapitre soit un salut au maître Baudelaire dans ses derniers temps : « Crénom ! Non ! Crénom ! »), mais aussi par le style dont il maintient le caractère flamboyant d’un bout à l’autre, Philippe Muray, s’il n’a pas rédigé la meilleure des thèses universitaires possibles sur le sujet qu’il se proposait, a néanmoins écrit un chef d’œuvre : le meilleur roman possible sur un siècle dont, dit-il en 1984, nous ne sommes toujours pas sortis (d’où la formule du titre).

On voit, si l'on tient vraiment à le qualifier de réactionnaire, le sens qu'il faut donner à l'adjectif. Merci Maître Muray.
Voilà ce que je dis, moi.
09:35 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, auguste sander, hommes du 20ème siècle, allemagne, littérature, société, histoire, philippe muray, le 19ème siècle à travers les âges, victor hugo, balzac, émile zola, église catholique, les lumières, révolution française, auguste comte, ernest renan, jésus christ, les rougon-macquart, nana, au bonheur des dames, germinal, la bête humaine, les trois villes, les quatre évangiles, occultisme, spiritisme, obscurantisme, religion, antisémitisme, chambres à gaz, génocides, baudelaire
mercredi, 24 octobre 2012
BALZAC 2
Pensée du jour : « Quand Mannekenpis, Karachi ».
PROVERBE UZVARECHE
Variante uzvaro-bachkir : « Quand Saint-Sulpice, Mammamouchi ».
Ce qui hallucine aussi, dans la biographie de BALZAC (par exemple celle d’ANDRÉ MAUROIS, Prométhée ou la vie de Balzac, Hachette, 1965), c’est son énorme capacité à graver dans son disque dur, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, un décor des rives du Cher (Le Lys dans la vallée), les coulisses de la vie bourgeoise dans la ville d’Issoudun (La Rabouilleuse), les aléas industriels d’une imprimerie à Angoulême (David Séchard dans les Illusions), bref : une multitude de décors, de situations et de personnages qui lui farcissent la tête, comme autant de tiroirs qu'il n'aura qu'à ouvrir pour les en tirer pour rendre les mouvements de la vie dans ses livres.
Il porte en lui toute une société, dans sa diversité et sa multiplicité. C'est lui qui le dit. Et il faut le croire : les preuves sont là. Même si l'universitaire PIERRE BARBÉRIS (Le Monde de Balzac, Arthaud, 1973) relativise l'expression "toute une société". Il montre (démontre) que BALZAC s'intéresse tout particulièrement à l'aristocratie et à la bourgeoisie, ce qui fait déjà pas mal de monde. Il montre aussi que le peuple (le petit) est à peu près absent de La Comédie humaine. Moi, si je dis qu'il fallait bien laisser des sujets à EMILE ZOLA, vous serez d'accord avec moi, non ?
Ce qui fascine par ailleurs, c’est que, mort à l’âge de 51 ans, il a eu moins de 20 ans pour écrire toute son œuvre : il a trente ans quand il publie Les Chouans, son premier « grand livre ». Il en a 48 quand il publie les derniers, La Cousine Bette, Le Cousin Pons, Le Député d’Arcis (inachevé). Ne parlons pas des innombrables lettres écrites quotidiennement.
Mais c’est un travailleur prodigieux. Il épuise rapidement ceux qui se hasardent à lui servir de secrétaires. Aucun de ceux qu’il aura embauchés (dont JULES SANDEAU, un temps compagnon d’AURORE DUDEVANT, dite GEORGE SAND) ne résista longtemps au rythme inhumain que lui faisait subir BALZAC, qui se faisait réveiller à minuit pour travailler les 18 heures que la veille lui laissait. Pas tous les jours, j’imagine. Ce qui explique sans doute quelque peu sa fin précoce, compte non tenu des quantités astronomiques de café qu’il eu le temps d’absorber.
Mais quand on regarde la vie de BALZAC, tout, absolument tout est étonnant. Lui qui n’est pas beau, à proprement parler, avec son corps rond et son nez bizarre, a eu toute sa vie l’art de mettre dans sa poche, puis dans son lit, les femmes qui lui plaisaient.
A commencer par LAURE DE BERNY, respectable mère de famille de vingt-deux ans son aînée, et qui finit par céder à ses ardeurs. Bien lui en a pris : elle se révèlera une conseillère hors-pair dans le travail et la maturation de l’écrivain. Pas la peine de compter ses conquêtes féminines. Bon, c’est vrai qu’avec la duchesse de CASTRIES, il est tombé sur un bec : il ne faut pas exagérer.
Après BALZAC et les femmes, BALZAC et l’argent. Ce qu’il désirait le plus âprement, c’était de faire fortune. Malheureusement, il n’avait pas la bosse des affaires, c’est le moins qu’on puisse dire. S’agit-il d’investir dans une imprimerie ? Banco. Mais comme il n’a jamais un sou devant lui, il emprunte. Quand l’entreprise se casse la figure, il a deux fois des dettes. S’agit-il d’investir dans des mines d’argent en Sardaigne ? Quand il s’avise de donner suite, c’est trop tard. Des actions dans les chemins de fer du Nord ? Elles baissent inexorablement.
C’est sûr qu’en imagination, il a bâti des fortunes pharaoniques. A l’arrivée, les dettes s’accumulent. Il a les créanciers aux trousses. Il loue même (je crois que c’est à Passy) une maison qui s’ouvre sur deux rues différentes, au cas où. Et il n’est pas impossible que, s’il a écrit pour le théâtre (six pièces au total), c’est dans la perspective de se refaire un compte en banque présentable (il paraît que ce n’était pas faux).
Ce qui est sûr, c’est que BALZAC a gagné des fortunes. Mais un vrai paquet de fric, tel qu’on n’en a pas idée. Ce qui est sûr, c’est qu’il aurait pu devenir riche, au sens où on l’entendait dans la classe à laquelle il appartenait, et plus encore dans celle à laquelle il voulait accéder. Et le pathétique, dans la vie de BALZAC, il se situe, à mon sentiment, exactement là.
Parce que son problème, c’est quand même qu’il a laissé à son épouse polonaise des ardoises à foison, qu’elle semble avoir réglées (sur sa fortune personnelle) jusqu’au dernier centime. Mais le raisonnement de l’auteur se tenait. Il se disait : j’ai besoin des capitaux d’untel et untel. Je vais les convier à un repas pour en discuter. Si je veux leur donner envie d’investir, je ne peux pas faire le pingre. Soyons royal ! Et BALZAC, en cette matière, fut toujours royal. Mais jamais sur fonds propres. Toujours à crédit.
Parce que l’un des mystères les plus hermétiques de la vie de BALZAC est là : plus le temps a passé, plus la vitesse s’est accélérée, et plus les dettes se sont accumulées. Quelle énigme, quand même ! C’est sûr que, s’agissant du luxe, il n’a jamais lésiné. Et il en connaissait un rayon, le bougre. Il se faisait faire des cannes à pommeau incrusté de pierreries, au point qu’il était connu pour ça dans les gazettes.
Et le luxe, il voulait vivre dedans. Meubles, tableaux, tentures, tapis, vases précieux, rien n’avait de secret pour lui. Et tout ce qui coûtait le plus cher était bon. Il acheta même chez un antiquaire une commode ayant appartenu à MARIE DE MEDICIS. Peut-être l’a-t-il cru. Il achetait donc, à tout va, avant d’avoir l’argent pour payer. Ce qui renvoyait après tout à un chapitre de RABELAIS, auteur qu’il affectionnait particulièrement : « Eloge des debteurs et emprunteurs ».
Et comment payait-il ses dettes ? En PISSANT DE LA COPIE. Aussi net et aussi brutal que ça. Je n’y peux rien. La Comédie humaine ? C’est tombé de la plume d’un tâcheron qui était obligé de pisser de la copie pour payer ses dettes. Surtout que plusieurs de ses bouquins, selon les mœurs du temps, lui furent achetés avant qu’ils fussent écrits. BALZAC, qu’on se le dise, est un homme du projet. Un homme qui se projette sans cesse dans le futur. Un futur forcément radieux et reposé. Mais HONORÉ DE BALZAC, qu’on se le dise, ne s’est jamais reposé.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : honoré de balzac, littérature, la comédie humaine, pierre barbéris, le monde de balzac, émile zola, andré maurois, prométhée ou le vie de balzac, le lys dans la vallée, la rabouilleuse, les illusions perdues, les chouans, la cousine bette, le cousin pons, jules sandeau, george sand
jeudi, 02 février 2012
C'ETAIT ZOLA
EPISODE 5 (et dernier, ça commençait à faire)
Nous arrivons à Son Excellence Eugène Rougon. Oui, je crois que ZOLA est béat d’admiration devant cette catégorie d’hommes hors du commun qui appartiennent à l’espèce des « grands fauves » (voir le Haverkamp de JULES ROMAINS). Il fait tout en tout cas pour que le lecteur épouse la cause de Rougon.
Son seul truc à lui, c’est le même que NICOLAS SARKOZY : la conquête du pouvoir politique. On verra plusieurs fois l’empereur NAPOLEON III apparaître, dont une pour refuser la démission de Rougon, une autre pour l’accepter. Comme SARKOZY, il a peu d’appétit à table. Il n’a pas d’appétit non plus au lit. SARKOZY en a-t-il vraiment, ou s’est-il contenté de faire courir le bruit ?

EMILE ZOLA ADORAIT FAIRE DES PHOTOS
Eugène Rougon est un roué. Une petite bande s’est agglutinée autour de cet homme fascinant parce que puissant : Kahn, Charbonnel, Delestang, Du Poizat, Bouchard, … C’est un clan tout ce qu’il y a de minable, répugnant de mauvaise foi. Ils gravitent autour du maître auquel ils s’accrochent pour en tirer le bénéfice maximum, et dont ils se détournent dès qu’il est affaibli.
Il aura fort à faire avec la belle et dangereuse Clorinde, une aventurière ambitieuse qui voudrait bien, mais en vain, se faire épouser. On plaint cet Hercule à l’occasion, mais quelle idée de se laisser dominer par cette femme mystérieuse et intelligente, qui sait tracer son chemin, mais qui reste insaisissable. Quoi qu’il en soit, c’est un couple qui fait à merveille fonctionner cette machine romanesque.
Il est certain que Rougon se sent faible face à Clorinde, capable dans je ne sais plus quelle occasion de poser en Diane quasiment nue devant les hommes. Rougon, fasciné, s’abandonne, va jusqu’à lui expliquer les secrets de sa stratégie, alors qu’il ne sait pas grand-chose d’elle. La scène de la cravache dans l’écurie est excellente.
Les femmes jouent un rôle dans l’ascension des hommes : Clorinde, Madame Bouchard, Mme de Combelot. Elles sont soit vertueuses, soit belles. ZOLA ne craint pas la dichotomie, le contraste, voire l’antithèse. Vertueuses, elles seront intrigantes, méchantes, envieuses, cancanières. Belles, elles sont promises à tous les lits possibles, soit pour le plaisir, soit par calcul.
C’est DE GAULLE, paraît-il, qui disait : « Il y a deux sortes d’hommes, ceux qui pensent qu’il y a deux sortes d’hommes, … et les autres », avec un clin d’œil en direction de MALRAUX. En tout cas, pour le romancier ZOLA, les ressorts qui meuvent l’humanité en général, et la gent féminine en particulier, sont assez simples, pour ne pas dire rudimentaires. Il force toujours la note, peut-être par crainte de manquer l’effet.
Son Excellence Eugène Rougon est un livre remarquable. Par le tableau politique d’une époque, dont je me demande s’il n’est pas de toutes les époques. De bons personnages secondaires, comme Merle, le majordome, ou Flaminio, le domestique à tête de bandit. Ce que ZOLA s’efforce de montrer, c’est le vide sidéral des idées politiques (ça ne vous dit rien ?). Seules comptent ces deux règles : « s’enrichir et conserver » et « le pouvoir pour le pouvoir ».
***
Résultats des courses ? C’est vrai, je n’ai pas dit un mot, ou presque, de La Bête humaine, de Germinal, de L’Assommoir. Je crois qu’il n’y a pas de hasard si ce sont aujourd’hui les œuvres les plus célèbres d’EMILE ZOLA, les plus étudiées au lycée, les plus appréciées peut-être. Est-ce que ce sont les plus réussies ? Qui peut le dire ?
1 – On sait que ZOLA accumulait des montagnes de notes documentaires avant d’attaquer un roman. Qu’il savait tout de la Bourse et des mouvements financiers quand il a écrit L’Argent. Qu’il a voulu monter dans une locomotive pour écrire La Bête humaine. Qu’il a étudié dans le détail la guerre franco-prussienne de 1870 pour écrire La Débâcle. Tout comme ça. C’est très bien, et je le félicite.
2 – Sans compter que Monsieur ZOLA a quelque chose à démontrer. C’est d’ailleurs, en plus de toutes les thèses sociales, tout le travail du Docteur Pascal, dans le dernier volume de la série des Rougon-Macquart. C’est sûr qu’il s’en est donné, du mal, pour illustrer ses thèses. Le problème, c’est justement que ce sont des thèses (anticléricalisme, naturalisme, etc.).
Documentation + thèses à démontrer : double handicap. C’est sûr, en maints endroits la corde de ce travail n’a pas été couverte par l’enduit de la composition romanesque. Trop souvent, il ne laisse guère de place, dans la cage thoracique du roman, pour la respiration vivante des personnages. Tout romancier est forcément confronté à ce problème. Où se situe le point d’équilibre ?
D’une part, il doit donner coûte que coûte au lecteur l’impression que les personnages vivent de leur vie propre, autonome. D’autre part, s’il tient à ce que son livre soit « ancré dans la réalité » (comme on dit), il est obligé de se documenter. Voilà, tout est là. Après, c’est une affaire de mayonnaise : ça prend ou ça ne prend pas.
Il y a un troisième facteur, délicat à définir. Je crois que ZOLA, tout « naturaliste » qu’il se définisse, n’échappe pas à ses tentations subjectives : il y a des personnages qu’il doit traiter, mais qu’il n’aime pas, et il y en a vers lesquels il se sent spontanément « porté », des personnages qu’il « sent » mieux. Ceux qu'il n'aime pas prennent une silhouette scolaire, théorique. Ceux qu'il « sent » acquièrent une vie personnelle beaucoup plus intense.
Je crois qu’à ces trois égards, il y a des Rougon-Macquart réussis, et d’autres plus ou moins ratés, voire carrément H-I-É. J’ai fait mon choix, j’ai mes préférences, j’ai dit pourquoi. Ce n’est pas moi qui vais déboulonner la statue. Je n’ai rien à ajouter.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zola, littérature, société, poésie, naturalisme, émile zola, son excellence eugène rougon, nicolas sarkozy, politique, conquête du pouvoir, de gaulle, malraux
mardi, 31 janvier 2012
ET LA GORGONE EST ZOLA
Je sais, mon titre ne veut strictement rien dire. Voulant garder "gorgon" (à cause de "zola", évidemment, je sais, c'est très bête), je ne pouvais quand même pas évoquer le personnage ainsi nommé des Loups de Rougecogne, de la série « Chevalier Ardent », la BD de FRANÇOIS CRAENHALS. Et puis allez, embrayons, on n'a pas que ça à faire.
Pourquoi je veux garder "gorgon", vous me direz ? C'est très simplement un hommage à une campagne publicitaire, il y a quelques années, pour je ne sais plus trop quoi, qui affirmait péremptoirement qu'EMILE ZOLA n'était pas un fromage italien. Cela reste évidemment à démontrer.
EPISODE 4
Dans La Curée, ZOLA trouve un sujet qui lui convient, parce que j’ai l’impression qu’il est aussi fasciné que dégoûté par la personnalité de Saccard (Aristide Rougon). Ce petit employé à la Mairie, bien servi par le hasard du poste qu’il occupe, découvre les projets secrets de transformation de la capitale. Ayant épousé Renée, il devient un terrible prédateur, décidé à tout dévorer pour faire fortune. Il y a de l’ogre chez Saccard. Il y en a sans doute aussi chez ZOLA lui-même. Cette parenté donne réellement vie au personnage central et à ceux qui l’entourent.
Je veux bien que ce livre soit une dénonciation des pratiques spéculatives et immobilières d’une bande de vautours qui se sont abattus sur Paris à la suite du coup d’Etat de LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE et des grands travaux lancés celui-ci et le baron HAUSSMANN. Mais franchement, la narration est si bien menée, tellement goulue que je soupçonne l’auteur d’admirer profondément, mais sans le dire, ces personnalités hors du commun.
Le livre est très solide. Au centre, le trio Saccard, René, Maxime. On voit défiler une pléiade de seconds rôles bien ficelés, dont le moindre n’est pas Larsonneau, le complice de Saccard. Pour le contraste, ZOLA mise sur le vieux père, grave, de Renée, et sur Sidonie, sœur de Saccard.
La mayonnaise de l’atmosphère générale prend remarquablement : l’auteur peint à merveille une société de stuc et de dorure, au rayonnement extraordinaire, mais construite sur un vide béant. Saccard est un équilibriste menacé de faillite et de poursuites judiciaires. Mais tout le monde ici est plus ou moins équilibriste.
***
Avec La Conquête de Plassans, ZOLA montre de quoi il est capable, quand il veut bien. Je lui conseillerais volontiers de s’engager dans cette voie, à l’avenir. Voilà du beau travail. Sur fond de lutte entre les camps bonapartiste et légitimiste, on assiste au tissage de sa toile par l’araignée elle-même, méthodique et sournoise, en la personne de l’abbé Faujas.
C’est l’histoire d’un beau complot ecclésiastique pour faire triompher une influence aux dépens d’une autre, sur la ville. Il y a Monseigneur Rousselot, l’abbé Fenil, l’abbé Surin. J’aime toujours autant la subtilité raffinée de ZOLA dans le choix des noms de ses personnages (un abbé est montré comme bête à manger du foin, l’autre comme prêt à suriner). Un beau tableau d’ambitions, de manies, d’arrière-pensées, de calculs, de haines : guère de chrétienté dans tout ça.
Côté politique, on a aussi les deux clans : Péqueur (voir Pecqueux dans Germinal), le sous préfet un peu raté, bonapartiste de surcroît, face à Rastoil le légitimiste, autour du jardin « neutre » de Mouret, où Faujas fait son ascension arachniforme. Il y a le salon vert de Mme Rougon, autre terrain « neutre ».
Une des réussites du roman est la progression respective de trois personnages : François Mouret, Marthe, sa femme, et l’abbé Faujas. Marthe est prise peu à peu d’une véritable passion religieuse qui la fait se remettre entièrement entre les mains de l’abbé. Une passion dont on verra qu’elle est aussi tout à fait terrestre : « Je vous aime, Ovide », déclare-t-elle à Faujas, qui peut se dire que la partie est gagnée.
Et François Mouret dans tout ça, me direz-vous ? C’est simple : plus l’abbé Faujas grandit, plus il diminue (vous savez, c’est dans la logique de l’inscription du « retable d’Issenheim », de MATHIAS GRÜNEWALD, qu'on peut voir au musée Unterlinden de Colmar : « Illum oportet crescere, me autem minui », dit Saint Jean-Baptiste en pointant l'index sur celui qui doit grandir).
Après être devenu étranger dans sa propre maison, il sera jeté chez les fous. La folie de Mouret est pour moi une faiblesse romanesque, dont ZOLA avait peut-être besoin pour amener l’incendie final de la maison. Toujours cette obsession : ce n’est plus de l’hérédité, c’est de la doctrine. L’auteur avait-il vraiment besoin de le faire marcher à quatre pattes dans sa cellule des Tulettes ?
***
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les loups de rougecogne, françois craenhals, bande dessinée, émile zola, la curée, littérature, culture générale, napoléon iii, haussmann, la conquête de plassans
samedi, 28 janvier 2012
C'EST PAS MOI, M'SIEUR, C'EST ZOLA !
Résumé : EMILE ZOLA est le champion toutes catégories de l'énumération descriptive et de la description énumérative.
EPISODE 3
Cette frénésie d’énumération est exactement le défaut qui me rend insupportable la lecture de La Faute de l’abbé Mouret. Figurez-vous une tranche de « Paradou » entre deux tranches de religion. Bon, passe que ZOLA soit un anticlérical fieffé, qu’il s’en donne à cœur joie. Mais le Paradou reste indigeste aussi pour d'autres raisons que ce prêche cousu de fil blanc.

C'EST-Y PAS BEAU, LA FAMILLE ?
Comme dans Le Ventre de Paris et Au Bonheur des dames, l’auteur se laisse embarquer dans des litanies : ici, ce sont toutes les plantes qu’on trouve dans ce lieu paradisiaque, où l’abbé découvre le bonheur dans l’amour charnel.
Il est vrai qu’il n’est pas le seul à être pris de la folie de l’énumération. Je ne parle évidemment pas de Maître RABELAIS, qui domine forcément les débats avec ses listes de livres, de fous, de « couillons », etc. Mais on trouve quelque chose d’analogue, me semble-t-il, dans Suzanne et le Pacifique, de JEAN GIRAUDOUX.
Ce sont d’infernales énumérations, un interminable catalogue de toutes les plantes, de toutes les fleurs possibles, de paysages gorgés de sève et saturés de symboles : vertuchou, mille capédédiou, palsambleu, vertubleu, que c’est lourd ! La belle Albine opère sur l’abbé Mouret un « détournement de curé », et consomme en sa compagnie le crime de lèse-chasteté sous le grand arbre qui figure évidemment le père de toute chose. Et tout d’un coup, l’ecclésiastique a la révélation de la religion de l’amour charnel.
Et par qui l’abbé Mouret sera-t-il chassé du Paradou ? Par le frère Archangias : je vous le dis, rien ne nous est épargné. Il y a la Teuse, qui chapitre son curé en l’aimant bien quand même. Il y a le clan des mécréants : le docteur Pascal, la jeune Albine, le vieux Jeanbernat, qui finit par couper l’oreille d’Archangias (le Mont des Oliviers, mon vieux !).
Le curé, qui exprime au début le désir de rester eunuque, sera exaucé à la fin, quand il perdra sauvagement ses attributs, rendu à sa castration ordinale, après un passage éclatant, quoiqu'exorbitant, par la casevirile des hommes ordinaires.
On a une scène analogue à la fin de Germinal, quand les femmes châtrent l’épicier Maigrat (au nom oxymorique) et se promènent ensuite en brandissant fièrement tout l’appareil (mais là, il y a une vengeance ; enfin, n’y a-t-il pas toujours une vengeance dans la castration ? Je pose la question à Papa FREUD).
ZOLA a par ailleurs le souci de semer des petits cailloux blancs qui servent d’indices. Ici, ce sont quasiment des rochers : la femme morte dans la chambre ; le mot « suicide » en plein milieu de la 2ème partie. On retrouve l’auteur scolaire, qui ne laisse pas son livre vivre et respirer par lui-même, et qui proclame : « C’est moi qui commande ! ».
On a envie de lui dire : oui, on a compris que tu rejettes l’Eglise parce qu’elle est foncièrement opposée à cette Nature que tu présentes comme seule affirmation légitime de la Vie, qu’elle est négation radicale de la vie. Même rapportée à l’époque (réaction catholique avant les combats de la laïcité), ça fait d'un lourdingue, mes aïeux !
***
Nana tient davantage la route. Je ne parle pas de la pouliche de ce nom qui court à Longchamp (ou à Auteuil, je ne sais plus), déclenchant l’hystérie des parieurs. La facétie est anecdotique. Je parle de cette femme à nom de jument (à moins que ce ne soit l’inverse) venue des bas étages de la société (Gervaise et Coupeau de L’Assommoir) et à qui le théâtre va donner l’occasion de côtoyer et de pénétrer la haute société. Pour utiliser un mot moderne, le théâtre joue le rôle (un comble, pour un théâtre) d’interface entre les bas-fonds et le beau monde.

NANA ?
Nana n’est pas douée du tout pour le théâtre, mais son corps est fait de telle façon que sa simple apparition, pas trop habillée, sur une scène, met la gent masculine en délire, ce qu’aucun directeur de salle au monde ne saurait négliger. La « thèse » est limpide, comme d’habitude chez ZOLA : ce qui guide les hommes, ce ne sont pas les idées (ou autres fumées), ce sont les appétits.
Ce qui est drôle avec ZOLA, c’est que c’est comme ça que ça fonctionne : j’ai l’idée de ce que je veux démontrer, je rédige mon programme, et sur cette grille, je ponds mes 400 ou 500 pages. Les appétits sont capables de bouleverser les statuts sociaux, qu’on se le dise. Ça, c’est l’idée. La grille, c’est cette fille qui se prostitue à seize ans et qui devient une des femmes les plus célèbres de Paris à dix-huit, tout ça parce que son corps fait du mâle un cinglé prêt au pire. L’un devient un escroc, l’autre se suicide, bref, Nana, c’est Attila.
C’est par exemple le banquier Steiner qui doit régulièrement refaire sa fortune pour la claquer en femmes. C’est le comte Muffat, personnage socialement très en vue (chambellan de l’Impératrice), qui va de déclassement en déclassement, et qui devient au fur et à mesure un personnage tragique (ou dérisoire), pour les beaux yeux (et le reste) de celle qui était une putain il n’y a pas si longtemps.

Alors c’est sûr, on peut se dire que ZOLA montre « les bouleversements d’un ordre miné de l’intérieur par sa propre gangrène » ; la réversibilité des rangs sociaux. L’ordre social tel qu’il existe n’a pas de sens, seul l’arbitraire y règne, à travers les appétits des différentes forces en présence. Je dis : certes !
Encore deux choses à noter au sujet de Nana : la première, c’est la dernière scène du roman qui montre Nana en train d’agoniser dans sa chambre, atteinte de la « petite vérole », pendant que tous « ses hommes » font les cent pas sur le trottoir. Une scène très « cinématographique », je trouve. Et comique.
La seconde, c’est encore une fois sur la méthode de composition de ZOLA, qui semble toujours craindre que le lecteur ne comprenne pas ce qu’il tient absolument à démontrer. Ici, il applique la technique de « l’essuie-glace » : on passe avec une régularité de métronome de la description des bas-fonds aux intérieurs bourgeois, dans des allers-retours éminemment didactiques.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre, une autre fois.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, naturalisme, émile zola, les rougon-macquart, la faute de l'abbé mouret, le ventre de paris, au bonheur des dames, rabelais, jean giraudoux, suzanne et le pacifique, germinal, nana, l'assommoir
mercredi, 25 janvier 2012
ALORS, GORGON OU ZOLA ?
EPISODE 2
Je passe rapidement sur Pot-Bouille, sorte de La Vie mode d’emploi avant l’heure. Le « projet », évidemment, n’a rien à voir avec celui de GEORGES PEREC. On voit le jeune Octave Mouret avant son irrésistible ascension sociale, passer comme un ludion d’un étage à l’autre de cet archétype de l’immeuble bourgeois haussmannien, au gré de ses conquêtes féminines. L’idée est assez rigolote.

PHOTO PRISE PAR ZOLA (EXPO 1900 ?)
On voit la société qui occupe la scène (l’escalier principal) et la société qui reste en coulisse (l’escalier de service). Je me rappelle qu’au 5 de la rue Valentin-Haüy, l’escalier principal était recouvert jusqu’au dernier étage d’un superbe tapis rouge, solidement maintenu en place, à chaque marche, par une tringle de cuivre ou de laiton, et que l’escalier de service ouvrait dans la cuisine.
On fait connaissance avec Mme Josserand, personnage superbe, peut-être le foyer romanesque. On renifle les remugles qui montent de la cour, décrite comme un pur fantasme d’énorme poubelle. Mais on se lasse vite de quelques obsessions lexicales : « débâcle », « débandade », « massacre » (qu’on retrouve constamment aussi dans Au Bonheur des dames).
***
Au Bonheur des dames me rase passablement. La seule chose qui retient mon attention, c’est l’ensemble des observations d’ordre économique touchant l’essor du commerce de grande distribution, comme naissance d’une industrie tout entière fondée sur la production et la consommation de marchandises. Voilà quelque chose de lucide et moderne.
On y voit le petit artisan Bourras, qui sculpte amoureusement ses pommeaux de parapluie, se faire balayer impitoyablement par les entreprises qui produisent en grande série des objets standardisés et sans grâce, dans une logique d’accumulation et d’empilement. Tout cela est très juste, y compris la perte de l’amour du travail bien fait.
C’est d’autant plus juste que le projet de l’ambitieux Octave Mouret est de réduire la femme en esclavage. Pour moi, ce livre, qui n’est pas un bon roman, est en revanche un excellent documentaire, qui n’a rien perdu de son actualité. Tout ce qui y est romanesque est comme un dahlia artificiel dans un bouquet de roses fraîches.
Ce qui est difficile à supporter, là encore, c’est l’intention démonstrative, le schématisme des situations et des personnages, à commencer par le conte de fées qui clora le roman : Denise Baudu, petite employée héroïque qui élève ses deux frères, tapera dans l’œil d’Octave Mouret, qui la suppliera de l’épouser. Commencée avec les excavateurs, l’histoire se termine dans le sirop.
Ce qui est proprement insupportable, en cours de route, ce sont les trois visites éprouvantes, épuisantes, ennuyeuses, assommantes, etc. que l’auteur inflige sans pitié au lecteur, au fur et à mesure qu’Octave Mouret installe, dans le paysage économique en général et urbain en particulier, le triomphe du commerce industriel. Trois fois un interminable tour du propriétaire qui ne nous épargne aucun détail.
***
Ensuite, entrons dans Le Ventre de Paris. Franchement, qui peut considérer ce livre comme un chef d’œuvre de la littérature ? La littérature selon ZOLA est une entreprise. Si l’on veut, une entreprise picturale : il s’agit de composer un tableau. Attention, un tableau complet. Un tableau littéraire, si l’on veut, mais un tableau scientifique. On ne plaisante pas. La différence entre ZOLA et FLAUBERT, c’est que celui-ci efface méticuleusement les traces de son travail, alors que celui-là laisse les ficelles bien visibles.
Un détail est à prendre en compte : les Halles de Paris, ce sont celles de VICTOR BALTARD. Il faut garder ça présent à l’esprit pendant la lecture, qui en sort un peu sauvée par ce filigrane, cette perspective virtuelle. Qu’est-ce qui m’a rasé, dans ce livre ? Je le dis tout de go : la conception purement théorique et démonstrative de la trame. On sent l’esprit de système à l’œuvre.

HALLES DE BALTARD
Je passe sur les accumulations de boustifaille, petit 1, les légumes, petit 2, les volailles, petit 3, les poissons, et le reste défile à l’avenant. Si, quand même, je garde la scène où les femmes qui bavassent ont percé à jour le bagnard évadé dans le personnage de Florent, au milieu de l’odeur puante des fromages. Bon, d’accord, c’est rigolo. Mais ZOLA, ayant eu l’idée de son roman, développe tout ça avec une application scolaire horripilante.
Florent et Gavard sont si peu crédibles en républicains comploteurs et insurrectionnels que le retour de Florent au bagne est comme inscrit sur sa figure. Sa naïveté est si éclatante que, même comme outil romanesque, elle ne tient guère la route. Et le Gavard qui exhibe tout fiérot son pistolet devant les femmes ! Les ficelles du romancier sont trop grosses. L’intrigue finit par apparaître comme un simple prétexte à l’exposé documentaire.
Un beau personnage, cependant : la charcutière Lisa Macquart, dont on pressent que l’auteur la « sent » mieux. La belle Normande, future Mme Lebigre (le cafetier), fait à ce personnage symbolisant la satisfaction et la majesté de la réussite, un pendant honorable. Ne parlons pas de toute la symbolique assenée par ZOLA autour du gras et du maigre. C’est simplement épais.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre. Une fois, pas plus.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, société, naturalisme, émile zola, pot-bouille, la vie mode d'emploi, georges perec, paris, haussmann, au bonheur des dames, le ventre de paris, flaubert, halles baltard, halles de paris
jeudi, 19 janvier 2012
ÊTES-VOUS PLUTÔT GORGON OU PLUTÔT ZOLA ?
EPISODE 1
Je le dis d’entrée : ceci n’est pas un pamphlet (remarquez, MAGRITTE disait bien : « Ceci n’est pas une pipe »). EMILE ZOLA, j’aime bien. Le problème, c’est que ce n’est pas partout et pas tout le temps. Loin de là. Je dirai même que, chez ZOLA, beaucoup de choses m’insupportent carrément. Mais il faut encourager les jeunes auteurs : il ira peut-être loin, ce petit, on ne sait jamais.

Par exemple, le Claude Lantier de La Bête humaine, programmé en héritier d’alcoolique, qui sent monter en lui, en même temps que le désir sexuel, l’envie de tuer la femme qu’il tient dans ses bras, me semble une caricature de « cas psychiatrique », même si, à la réflexion, le cas de Moosbrugger, dans L’Homme sans qualités de ROBERT MUSIL, quoique différent, fait penser rétrospectivement au cas de Lantier.
Le parti-pris « scientifique » par lequel ZOLA fait de l’hérédité une sorte d’agent de la malédiction divine est, selon moi, à chier, parce que ça donne à ses romans, de façon différente dans chacun des Rougon-Macquart, un aspect plaqué, artificiel, théorique qui tue la vie propre du livre. L’effort de démonstration est tout sauf romanesque. Finalement, ce qui m’embête chez ZOLA, c’est l’idée.
Et puis, il y a le parti-pris « scolaire », je veux dire didactique, on pourrait dire la tentation documentaire. Je me rappelle avoir lu Le Théorème du perroquet, du mathématicien DENIS GUEDJ. Il paraît que c’est un roman. Moi, je veux bien, mais quand la partie romanesque est bouffée à ce point par l’intention didactique (découverte des mathématiques), on n’est pas loin de l’escroquerie. Il n’y a même plus d’intrigue.
Dans le même genre, Le Monde de Sophie, de JOSTEIN GAARDER, sur la philosophie, est bien mieux réussi. ZOLA est encore plus loin de cette caricature, mais c’est un aspect qui transparaît toujours de façon gênante.
Prenez Au Bonheur des dames, par exemple. Le petit Octave Mouret, qu’on voit, dans Pot-Bouille, changer d’étage au gré de ses changements de maîtresse, possède assez d’esprit d’entreprise pour, devenu adulte, construire en trois temps l’industrie de la grande distribution. Eh bien, pourquoi ZOLA se croit-il obligé d’infliger au lecteur trois visites exhaustives de l’hypermarché : un – éclosion, deux – développement, trois – triomphe ? Exhaustives, les visites ! Faut rien oublier !
Entrez dans Le Ventre de Paris, et vous étoufferez littéralement sous les tonnes, les variétés, les couleurs et les odeurs des victuailles, présentées dans des avalanches oppressantes. Il paraît qu’il faut considérer ces descriptions comme de « colossales natures mortes ». Moi, je veux bien, je ne suis pas contrariant.
Allez voir La Faute de l’abbé Mouret, où ZOLA nous inflige l’énumération lyrique du Bottin de toutes les plantes de la Création. L’action se passe dans le « Paradou » (ce nom !), quand le curé découvre, dans une amnésie brutale de tous ses devoirs de prêtre, le cataclysme des plaisirs de la chair en compagnie d’Albine. Le lecteur est brutalement assommé à coups de traités de botanique et de catalogues de pépiniéristes, tous épais comme un dictionnaire français / sanskrit en douze volumes.
Si le poids des péchés du monde est comparable à celui de ces énumérations, je comprends aussitôt l’horrible horreur du chrétien pour l’enfer. Et je suis prêt à considérer dès maintenant le haggis, la fondue au chester et le christmas pudding (spécialement conçus pour estomacs britanniques surentraînés) comme de tout légers amuse-gueule.

Voici à présent quelques exemples, non dénués d’humeurs diverses et de considérations arbitraires et injustes. Le monument national s’en remettra.
Voilà ce que je dis, moi.
Exemples et considérations à suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, naturalisme, émile zola, magritte, la bête humaine, l'homme sans qualités, robert musil, psychiatrie, denis guedj, mathématiques, le théorème du perroquet, le monde de sophie, jostein gaarder, au bonheur des dames, pot-bouille, le ventre de parie, les rougon-macquart, la faute de l'abbé mouret

