dimanche, 22 mars 2015
ENCORE MODIANO
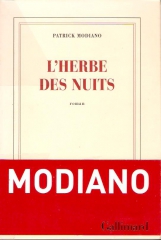 J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.
J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.
Si j'ai tardé à l'évoquer, c'est que mon intérêt pour Modiano, s'il ne s'était pas tout à fait éteint, peut-être avait-il tiédi. L'attribution du Nobel a, disons, réchauffé ma curiosité. Je ne regrette jamais d'avoir lu un livre, même quand j'en sors frustré. Quand j'arrête la lecture en cours de route, c'est que le livre m'a mis en colère, ou alors m'est tombé sur l'ongle incarné (trop lourd, sans doute : je parle du "poids" du livre).
Les prix littéraires, soit dit entre nous, je n’en pense rien, tant la valeur d’un livre ou d’un écrivain me semble incommensurable à sa reconnaissance officielle par une assemblée pontificale, quelle qu’elle soit. Un rite d'autocélébration, en quelque sorte. Une ambiance du genre « Bienvenue au club ! ».
De toute façon, ce qu'on appelle "Grand Prix", vous savez, ces récompenses célébrant les "talents", surtout quand on navigue en milieu littéraire, poétique ou artistique (en gros, ce qu'on appelle les "Affaires Culturelles"), ne sont que des moyens pour une classe dominante de faire passer, en direction des classes dominées, un message du genre : « Vous voyez bien, quand on veut, on peut y arriver ! ». En même temps que ça renforce la légitimité de l'ordre établi (fonction réelle de l'arrosage saisonnier à la Légion d'honneur). Avec ça, je passerai peut-être pour un bolchevique.
Quand on veut, on peut ! Voilà bien un refrain que je hais, un refrain qui sent son moralisme archéo-chrétien, et même pas très catholique. Machine à culpabiliser. Parlez-en au chômeur du coin, qui se heurte aux portes closes de la raréfaction du travail et à qui des Sarkozy viennent faire la leçon : si tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas ! C'est de ta faute ! Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même ! On va te couper les vivres !
Conclusion, en effet : quand on n'y arrive pas, c'est qu'on ne le mérite pas. Modiano, au Nobel, rachète heureusement sa soumission à ce protocole "chez les puissants" par une maladresse existentielle à peu près pathologique, qui ressemble d'assez près à sa littérature, preuve d'une sincérité impossible, je crois, à contrefaire. Si c'était "joué", il serait vraiment très salaud. Parce que, franchement, l'expression « une maladresse existentielle pathologique », ça ressemble d'assez près à une analyse littéraire de l'oeuvre de Patrick Modiano, vous ne trouvez pas ?
Patrick Modiano ressemble juste à l’idée que je me fais du véritable écrivain : celui qui est capable de créer un univers reconnaissable à quelques traits, de la même manière qu'on sait, après deux mesures, qu’on entend « du Chopin » ou, à la translucidité d'une main d'enfant devant la flamme d'une bougie, que l’on contemple « un Georges de La Tour ».
Ce n’est pas une raison pour avaler tous les titres de l’écrivain en file indienne. Pour Chopin, c'est la même chose : pas besoin d'aligner sur la platine les 12 CD de l'intégrale chronologique des œuvres pour piano seul de Frédéric Chopin par Abdel Rahman El Bacha. On sait déjà.
La seule expérience que j’ai faite de cette « méthode », ce fut avec l’œuvre de Henri Bosco, qui, en dehors de deux ou trois titres, n’a plus de secrets pour moi. Pardon : "la seule", c'est inexact : j'ai aussi fait ça avec les Rougon-Macquart (ce qui, entre parenthèses, m'a guéri de la Zola-rziose).
J’ai fait une tentative semblable avec un recueil d’ouvrages de Françoise Sagan (collection Bouquins) : j’ai calé au bout du cinquième, à cause, je crois, de l’atmosphère raréfiée de bocal à poissons rouges, de l'espèce des nantis à l'existence futile, dans laquelle elle plonge le lecteur. Ne pas confondre l'oeuvre littéraire avec le feuilleton. Après tout, il y a peut-être du feuilletoniste chez Modiano. Je dis peut-être une grossièreté ? Tant pis.
Je ne désespère pas de me remettre à la lecture chronologique de La Comédie humaine, abandonnée elle aussi, mais au bout d’une trentaine de titres tout de même. Balzac, c'est autre chose, il dépasse de loin la somme des recettes successives qu'il met en oeuvre. Et je reviens, bien entendu, assez régulièrement, à Simenon, entre autres à ses « Maigret », après avoir éclusé une trentaine également de ces derniers.
Je ne conseille par conséquent à personne de procéder de cette manière avec les romans de Patrick Modiano. Je n’userai pas du poncif de la « petite musique » qui sert d’échappatoire au « critique littéraire » qui n’a pas envie de se fouler pour entrer dans des considérations un peu précises et sérieuses. Il se trouve cependant qu’en ouvrant L’Herbe des nuits peu de temps après avoir lu Pour que tu ne te Perdes pas …, j’ai eu la curieuse impression de lire un décalque de celui-ci.
Même petit carnet rempli de notes diverses. Même ribambelle de noms, de dates, d’adresses, de numéros de téléphone, de lieux de rendez-vous, dont beaucoup ne disent plus rien au narrateur, perdus dans le brouillard d’un passé qu’il cherche à ressaisir, mais il a bien du mal, le pauvre, avec tout le temps qui a passé. Même genre de personnage féminin énigmatique (« Dannie »), à l’identité fuyante.
Même milieu interlope où cette femme évolue, au milieu de noms d’hommes un peu louches : un « Aghamouri », agent secret qui fait semblant d’être étudiant, un « Paul Chastagnier » qui donne au narrateur des « conseils d’ami ». Un « Unic Hôtel », quelque part à Montparnasse, dans le hall duquel ces hommes se retrouvent.
Peu importe au fond la succession des faits dont le livre se fait un argumentaire en quelque sorte obligé. Les récits que Modiano élabore dans ses romans n’ont rien d’événementiel. Non, pas de rebondissements, rien de spectaculaire, pas de tragédie grandiose. L’amateur de ce genre de littérature ne le trouvera pas ici.
L’étoffe dont sont tissés les livres de Modiano est de nature différente. Si je voulais résumer les impressions que me laisse L’Herbe des nuits, je commencerais par dire : une littérature d’état d’âme ; une littérature de climat. L’état d’âme d’un homme qui a été « mal jeté dans la vie » (j’ai connu un Benoît Vauzel  dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.
dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.
Du narrateur lui-même, d’ailleurs, on n’apprendra que des bribes, livrées parcimonieusement, par intermittence. Le narrateur en personne est un peu fuyant, c’est certain : il ne tient pas à laisser de traces derrière lui. Et puis, il semble fatigué, ce narrateur, dépressif peut-être ? C’est bien lui qui dit : « Mais, je n’y peux rien, en ce temps-là j’étais aussi sensible qu’aujourd’hui aux gens et aux choses qui sont sur le point de disparaître » (p. 89).
Dans L’Herbe des nuits, comme dans beaucoup de livres de Modiano, tout le monde pose beaucoup de questions. Quasiment aucune d’entre elles ne reçoit de réponse. Ici, il faut la convocation du narrateur par un certain Langlais, quai de Gesvres, pour qu’il réponde à des questions. On comprend que c'est un policier. Dans les livres de Modiano, j’ai l’impression que, quand ce n’est pas la police qui pose les questions, celles-ci ne reçoivent jamais de réponse. Et encore … Mais je me dis qu'après tout, la police ne pose jamais les bonnes questions.
Car il y a ce détour par la surprenante amitié de Langlais pour Jean, le narrateur, pour accéder à la clé de certains mystères. Pas tous, qu’on se rassure. Et même loin de là. « Dannie » a-t-elle finalement commis un crime ? La personne qui a reçu « deux balles perdues » a-t-elle, dans le passé, été victime d’une erreur de manipulation ou d’une intention claire ? Personne n’est en mesure de répondre. Même la police échoue à faire toute la lumière sur certaines petites choses finalement triviales de la réalité.
L’univers mental dans lequel se débattent désespérément, roman après roman, les héros de Patrick Modiano, est un univers à jamais flottant. Un univers où personne ne répond aux questions, en particulier à la question « Pourquoi ? ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature française, patrick modiano, l'herbe des nuits, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, prix nobel de littérature, éditions gallimard, collection blanche, affaires culturelles, nicolas sarkozy, abdel rahman el bacha, émile zola, henri bosco, rougon-macquart, françoise sagan, collection bouquins, la comédie humaine, honoré de balzac, georges simenon, commissaire maigret, benoît vauzel mal jeté dans la vie
jeudi, 01 janvier 2015
LE DERNIER MODIANO
Préambule destiné à faire partager, en guise de vœux de Nouvel An, l'étonnement ressenti à chaque fois à la lecture de ce petit poème de Jean Tardieu. On n'est pas forcé d'y mettre la musique dont Henri Dutilleux a cru bon, un jour, dans sa vanité, de l'encombrer. Même interprétée par la très belle Renée Fleming.
« L'autre jour j'écoutais le temps
qui passait sous l'horloge.
Chaînes, battants et rouages
il faisait plus de bruit que cent
au clocher du village
et mon âme en était contente.
J'aime mieux le temps s'il se montre
que s'il passe en nous sans bruit
comme un voleur dans la nuit ... ».
**************************
Impressions de lecture.
Retour à Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, de Patrick Modiano.
2/2
Car Jean Daragane, le protagoniste et narrateur, ne cesse de perdre quelque chose. Petit Poucet imprévoyant, il a semé sur sa route les miettes de sa vie, et quand il essaie de les retrouver, il se heurte à l'édredon obscur d'une sorte de brouillard.
L’histoire commence avec son carnet d’adresses, qui « avait sans doute glissé de la poche de sa veste au moment où il en sortait son billet pour le présenter au contrôleur ». Or un carnet d’adresses, c’est plein de noms de personnes avec leur prénom, et de noms de rues avec des numéros : autant de points de repère, de références. Un carnet d’adresses, c’est précis.
Sauf que c’est vrai, quand vous n’avez jamais changé de répertoire, qu’il est maintenant bien chiffonné et que les pages jaunies, mangées sur les bords ont du mal à rester solidaires (c'est si fastidieux de tout recopier dans un répertoire neuf !), que vous retrouvez un nom à côté d’une adresse, même adossés à un numéro de téléphone, il arrive que la mémoire vous fasse défaut : qui est-ce ? Dans quelles circonstances ai-je croisé la route de cette personne ? Comme beaucoup de gens sans doute, je le sais d’expérience.
C’est ce qui arrive à Jean Daragane : qui est Guy Torstel ? Annie Astrand ? Et puis qui c’est, ce Gilles Ottolini, à la « voix molle et menaçante », qui l’appelle parce qu’il a retrouvé son carnet « sous une banquette du buffet de la gare de Lyon » ? Qui est Perrin de Lara ? Qui est vraiment Chantal Grippay, qui a oublié une robe de soirée sur le dossier de son canapé ? Qu’est-ce qu’il est allé faire à Saint-Leu-la-Forêt quand il était gamin ? Quand il y a tant d'inconnues, ce n’est plus une équation qu'il vous faut résoudre, c’est un pan entier de votre vie qui se dérobe tout d’un coup sous vos pieds.
Enfin, est-ce que ça se dérobe ou ressurgit ? En vérité, les deux mon général. Parce que s’il perd constamment des choses, Jean Daragane, à commencer par le nord, il ne déploie qu’une énergie très modérée à récupérer ce qu’il a perdu. Au fond, il fait ce qu’il faut pour qu’on ne puisse pas dire qu’il n’a pas cherché, mais s’il ne trouve rien, je ne suis pas sûr qu’il ne se fera pas une raison.
D’ailleurs, sa raison est elle aussi moyennement en éveil : le dossier que lui a remis ce mystérieux Gilles Ottolini, disons-le, lui tombe des mains chaque fois qu’il essaie de s’y plonger. Mieux : ses yeux se ferment. Il y a bien ce cliché de Photomaton, ce brouillon abandonné d’un chapitre de son premier livre, Le Noir de l’été, ces informations aussi qui pourraient lui apprendre quelque chose, sait-on jamais, sur son enfance.
Je crois que le principe qui anime l’ensemble s’appelle l’angoisse. Et principe d’autant plus indicible que le livre tient, à la fois et bizarrement, de l’enquête policière et d’un refus affolé d’en apprendre davantage sur ce qui s’est passé, il y a si longtemps. Cette ambivalence douloureuse est lancinante, incessante, parfois aiguë, que ce soit avec l’homme qui lui téléphone un soir parce qu’il a retrouvé son carnet d’adresse.
Même ambivalence lors de la rencontre avec le docteur Voustraat, à qui il rend visite à Saint-Leu-la-Forêt, en espérant qu'il ne comprendra pas qu'il a à faire au gamin qui habitait La Maladrerie, la maison d'en face où, bien des années auparavant, il a observé des mouvements suspects, jusqu'à la longue perquisition policière qui y avait eu lieu, sans doute à cause des activités louches d'un certain Roger Vincent. Une paralysie de la volonté découle de ce tiraillement, qui explique peut-être l'espèce de léthargie dans laquelle évolue le personnage.
"Je voudrais et ne voudrais pas" (« Vorrei e non vorrei ») : c'est aussi ce que dit Zerline, dans Don Giovanni, quoique pour une tout autre raison (elle sera sauvée des griffes du prédateur par l'intervention de Dona Elvira). Ici, on redoute soit de trouver ce qu'on cherchait, soit de voir s'accomplir les menaces du présent. Le pressentiment domine. Un profond sentiment existentiel d'insécurité : qu'est-ce qui, du passé, s'apprête à me rejoindre ? A quoi faut-il que je m'attende prochainement ?
Le narrateur, donc, cherche sans être sûr de vouloir vraiment trouver, et puis il cherche tout en craignant de dévoiler l’objet de sa quête (entretien avec Voustraat), ou en ayant peur de se faire manipuler par un maître-chanteur (Gilles Ottolini) ou sa complice (Chantal Grippay).
Reste de tout ça un certain nombre de noms de personnes, mais qui se perdent dans les brumes du passé ou de circonstances fumeuses, vaguement menaçantes ; de noms de lieux et de rues (où l’on a fait quoi, au fait ?). La substance dont est fait le narrateur est faite de bribes inconsistantes qu’il échoue à recoudre en un vêtement cohérent et présentable. Tout ça parce qu’il a une peur panique de trouver, de même qu’il redoutait, enfant docile, de se perdre quand c’était Annie Astrand qui lui servait de mère.
La fin du livre présente cette peur à l’état aigu, sous forme de rafale sur quelques pages (141 à 143) : « … elle lui serrait très fort le poignet pour qu’il ne se perde pas dans la foule … », « Elle lui serre le bras pour qu’il ne perde pas l’équilibre », « S’il pouvait se souvenir de tous ses rêves, aujourd’hui, il compterait des centaines et des centaines de valises perdues ». Il faut dire que le tir en rafale avait commencé à Paris, à la page 138 : « ... où il se promenait seul avec dans sa poche la feuille pliée en quatre : POUR QUE TU NE TE PERDES PAS DANS LE QUARTIER ». Quel est, finalement, le contenu des lieux, des adresses, des âges, des villes ?
C'est la vie même du personnage qui semble souffrir d'un défaut initial et définitif de substance. Le sentiment de la perte découle de n'avoir jamais été en possession de ce dont on souffre de l'absence. Il est infiniment pire, car il dépose l'œuf du vide et du pourquoi au centre de la personne. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Le livre est peuplé d'interrogations.
La littérature de Patrick Modiano est une littérature du jalon, du point d'étape, de l'oasis. Des points de repère perdus dans un paysage de brouillard. La littérature de Modiano évoque une succession de lieux de passage sans épaisseur, en même temps qu'une succession d'itinéraires dépourvus de toute histoire. L'impossibilité de vivre la vie qui vient. Avec, pour s'accrocher, seulement les noms de la vie passée. Une vie qui, dès lors qu'elle commence, a tant de peine à exister qu'il n'en reste rien de bien consistant. Ce qui en constitue la moelle (disons l'expérience quotidienne qui accroche fermement les souvenirs à des objets, à des visages) a été perdu, on ne sait pas quand.
A la fin de Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, Jean Daragane n’a rien compris à ce qui lui est arrivé. Nous, on sait déjà que l'enfant qu'il était alors vient d'être abandonné.
Le tout début du livret de Maeterlinck pour le Pelléas et Mélisande de Debussy dit quelque chose d’approchant (c’est Golaud qui parle) : « Je ne pourrai plus sortir de cette forêt ! Dieu sait jusqu’où cette bête m’a mené. Je croyais cependant l’avoir blessée à mort ; et voici des traces de sang ! Mais maintenant, je l’ai perdue de vue ; je crois que je me suis perdu moi-même, et mes chiens ne me retrouvent plus ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie, jean tardieu, le temps l'horloge dutilleux, littérature française, patrick modiano, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier
mercredi, 31 décembre 2014
LE DERNIER MODIANO
Préambule destiné à illustrer l'altitude à laquelle se situe le débat politique en France : Nicolas Sarkozy installe donc l'état-major qui sera chargé de gouverner l'UMP en vue des « batailles politiques » qu'il envisage de livrer prochainement, tous gens de grande envergure et de haute vue, comme de juste. La preuve : Laurent Wauquiez a fait prendre les mesures de son bureau au centimètre près, pour être sûr que celui de Nathalie Kociusko-Morizet n'est pas de plus grandes dimensions.
**************************
1/2
Franchement, je ne pensais pas que ce serait si difficile de parler d’un livre de Patrick Modiano. De trouver assez de mots précis pour habiller les impressions reçues d'un livre qui vous échappe quand vous tentez de le saisir. Je n’avais jamais essayé d’écrire quoi que ce soit à leur sujet, et pourtant, en ai-je-t-y lu, des « romans de Modiano » ! A chaque parution, ou presque, j’allais en librairie verser mon obole à un écrivain à l’œuvre fascinante. Je n’ai jamais su expliquer cette fascination.
Essayez donc de résumer un seul de ses romans ! Malgré l'évanescence de l'intrigue, le flou des traits des personnages, la ténuité de l'action, l'auteur, sans avoir l’air de vous forcer, vous y entraîne aussi aisément que dans les évidences enfantines. Ensuite, les mains de votre mémoire se referment sur des fumerolles : c’est tout ce qui restera de votre lecture.
Si, quand même, vous avez les titres qui ont, mieux que les autres, marqué leur passage. Pour mon compte, ce sont Villa triste, Rue des boutiques obscures, Dora Bruder, Un Pedigree, quelques autres. Pourquoi ceux-ci plutôt que d’autres ? Mystère. Il me reste tout au plus quelques vagues ambiances où dominent les errances de lieu en lieu, de ville en ville, d’époque en époque, de nom en nom, souvent à la recherche de je ne sais plus quoi. C'est dans lequel, au fait, que le personnage se livre à un drôle de manège autour de livres anciens ?
C’est vrai que j’en ai lu beaucoup, des Modiano. Pas tous, forcément. Je n’ai pas procédé systématiquement, comme j'avais fait pour Henri Bosco, mais j’ai une excuse : Modiano est bien vivant, il continue à produire. Cela ne fait rien : allez voir dans la rubrique « Du même auteur », au début, mais aussi à la fin de chaque volume. Interminable, la liste. Une petite trentaine de romans. Sans compter le reste. Il a même fait un scénario de film (Lacombe Lucien). Il a même écrit une chanson pour Françoise Hardy (« Etonnez-moi, Benoît »). D’autres choses que je ne connais pas, peut-être.
Donc, pas facile de poser des mots sur la lecture qu’on vient de faire d’un livre de Patrick Modiano. D’ailleurs, à la réflexion, je ne devrais pas dire « le dernier Modiano », parce qu’il est probable qu’il ne va pas s’arrêter d’écrire des livres. C’est tout le mal qu’on lui souhaite. Et que le lecteur se souhaite par la même occasion.
Parce que ce « dernier Modiano » est un livre littérairement magistral, et quand il referme Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, le lecteur se dit qu’il s’est passé, quelque part au fond des méandres et des sables mouvants de son être, quelque chose de pas ordinaire. Et qu’il aimerait bien que ça lui fasse la même chose une prochaine fois, même s’il ne sait pas bien quoi. Pour peu qu’il soit entré dans le jeu, il en sort chapeau bas devant le maître du jeu : du grand art !
A se demander si Modiano n'est pas un lointain descendant d'un maître du bouddhisme zen : écrire sur rien. L'esthétique du vide. Quasiment un haïku romanesque, comparé aux pavés que les Américains lancent sur la gueule de nos libraires, même que c'est à cause de ça qu'ils sont de moins en moins nombreux : trop de risques ! Je galèje.
Oui, on peut dire qu'avec Pour que tu ne te perdes ..., quelque chose y a remué, là-bas dans le fond. Mais quelque chose de vague, impalpable pour ainsi dire. Aussi insaisissable que celui qui dit « Je » tout au long du roman. Car le narrateur lui-même semble exister à peine tant il livre peu d’éléments qui permettraient au lecteur de l’identifier, d’en esquisser au moins un portrait auquel il pourrait s’identifier, comme cela se passe dans les romans traditionnels.
Mais comme l’auteur se débrouille pour que le lecteur, comme dans le cinéma filmé caméra à l’épaule, voie le film se dérouler comme s’il en était lui-même le protagoniste, l’identification se produit malgré tout, et le lecteur se trouve alors comme aspiré dans un vortex d’une étrange inconsistance, pris dans le réseau immatériel des fils d’un passé en quête duquel le personnage est contraint de se lancer pour une raison indépendante de sa volonté.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, politique, nicolas sarkozy, laurent wauquiez, nathalie kosciusko-morizet, nkm, le canard enchaîné, littérature, littérature française, patrick modiano, prix nobel, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, villa triste, dora bruder

