dimanche, 02 octobre 2016
40 BALZAC : L'ENFANT MAUDIT

Balzac par Nadar (Félix Tournachon).
Dessin préparatoire au "Panthéon de Nadar" (défilé de 249 caricatures des gens (+ ou -) à notoriété, paru en 1854).
Le schéma sur lequel est construit ce récit paraît caricatural. L’action de situe en pleine guerre de religion. Jeanne de Saint-Savin, douce et frêle jeune fille, aimait le jeune Georges de Chaverny qui avait le tort d’être un vilain parpaillot. Elle est obligée par sa famille et par la situation d’épouser le comte d’Hérouville, seigneur normand, homme déjà âgé, mais aussi brutal et fanatique, tant comme catholique que comme royaliste et comme chef d’une maison de grande noblesse, qui la terrorise. Jusqu’alors sans enfant, il attend de sa jeune épouse un héritier mâle capable de perpétuer dignement la lignée.
Comme il a eu vent des sentiments de Jeanne pour un autre, il la menace du pire si elle accouche avant les neuf mois réglementaires. Catastrophe, le bébé va naître à sept mois. Le vieux d’Hérouville est persuadé qu’il n’est pas de lui.
Pour que l’événement se passe au mieux, on assiste alors à une étonnante mascarade : le seigneur et son serviteur de confiance se déguisent et vont proprement enlever en pleine nuit le très savant et mystérieux Beauvouloir, « un rebouteur » à la « réputation équivoque attachée à un médecin chargé d’œuvres ténébreuses », sommé, une fois à pied d’œuvre, de présider à l’accouchement. Le comte laisse vivre l’enfant, car l’accoucheur lui a déclaré qu’il ne vivrait pas, tant il était chétif.
C’est ainsi que naît Etienne d’Hérouville. Inutile de dire que son père légal le hait et ordonne qu’il grandisse dans une masure attenant au château, sans jamais en franchir les murs, sous peine de mort. Etienne restera, tant qu’il vivra, d’une touchante et terrible fragilité. Comme dit le bon Beauvouloir, une telle nature est toute âme. Maximilien, son cadet, sera l’exact opposé, viril, vigoureux et obtus. Malheureusement, il est tué par les protestants, en même temps que le maréchal d’Ancre, au pont du Louvre.
Cette mort force le désormais duc d’Hérouville à rappeler Etienne, qui est maintenant le seul espoir de perpétuer la lignée. Hélas, Etienne a grandi sous le magistère bienveillant du vieux Beauvouloir, qui a demandé à sa fille Gabrielle de venir lui tenir compagnie. Les deux jeunes gens, comme on peut s’y attendre, sont tombés amoureux. Quand il apprend ça, le duc rentre au château avec l’intention de marier Etienne et la fille de Mme de Grandlieu en faisant croire à son fils que Gabrielle est morte. A cet instant, Gabrielle chante dans la pièce où elle est retenue, ce qui décide Etienne à s’opposer frontalement à son père qui sue la haine : « Eh ! bien, crevez tous ! Toi, sale avorton, la preuve de ma honte. Toi, dit-il à Gabrielle, misérable gourgandine à langue de vipère qui as empoisonné ma maison ! ». La violence de la scène est telle que lorsque le vieux lève l’épée sur Gabrielle, Etienne tombe mort, aussitôt suivi par sa bien-aimée, qui essayait de le retenir. M. d'Hérouville les a tous deux proprement fait mourir de terreur. Le père alors se tourne vers Mlle de Grandlieu : « Je vous épouserai, moi ! – Et vous êtes assez vert-galaant pour avoir une belle lignée, dit la comtesse [la mère de la jeune fille !] à l’oreille de ce vieillard qui avait servi sous sept rois de France. ». Ce sont les derniers mots de la nouvelle.
Le caractère jusqu’au-boutiste, intraitable et fanatique du vieux d’Hérouville fait penser au Bartolomeo di Piombo de La Vendetta, qui manque de tuer sa fille quand il apprend qu’elle aime et veut épouser le dernier survivant des Porta, la famille de ses ennemis jurés. Dans les deux récits, on est évidemment dans la démesure. Balzac pousse le contraste à ses confins.
Cette recherche forcenée de l’effet affaiblit à mon avis le récit en ôtant de la vraisemblance aux faits et aux personnages. Je sais bien que la réalité est capable de dépasser la fiction, mais. Ici, la stature du duc est tellement terrible comparée aux pauvres créatures qui ont affaire à lui qu’on n’y croit qu’en se forçant, comme en présence d’une caricature. Pour racheter la tiédeur de ce jugement péremptoire, j’ajoute cependant que les portraits des personnages sont d’une grande force.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, l'enfant maudit, la vendetta
vendredi, 30 septembre 2016
39 BALZAC : LE LYS DANS LA VALLÉE

Avec Le Lys dans la vallée, Balzac a fait un des plus classiquissimes romans de La Comédie humaine. Un incontournable, comme on dit : jusqu’à quelles extrémités peut aller le sentiment éprouvé par un tout jeune homme qui s’enflamme durablement pour la beauté d’une femme qu’il a rencontrée par hasard un soir de bal ?
La scène de la rencontre vaut son pesant de littérature, et vaut en soi le voyage. Jugez-en par le portrait de Mme de Mortsauf que Félix de Vendenesse (cf. Une Fille d'Eve) dessine pour sa maîtresse d'alors, Natalie de Manerville, une fois l'aventure terminée (par la mort de l'héroïne). Le choix de "Mortsauf", ce nom quasiment oxymorique, me fait penser (à tort ou à raison) à l'insurpassable air de la Passion selon Saint-Jean "Mein teurer Heiland" : l'homme pose à Jésus crucifié la question : « Bin ich vom Sterben freigemacht ? » (suis-je libéré de la mort ?). Et le commentaire suit, sublime et tendre : « da neigest du das Haupt und sprischst "Ja" » (là, tu inclines le chef et dis "oui"), avec l'accompagnement de la basse par le chœur. Pour dire tout ce que Balzac a voulu mettre de sacrifice de soi dans le nom même de cette femme.
« Trompée par ma chétive apparence, une femme me prit pour un enfant prêt à s’endormir en attendant le bon plaisir de sa mère, et se posa près de moi par un mouvement d’oiseau qui s’abat sur son nid. Aussitôt je sentis un parfum de femme qui brilla dans mon âme comme y brilla depuis la poésie orientale. Je regardai ma voisine, et fus plus ébloui par elle que je ne l’avais été par la fête ; elle devint toute ma fête. Si vous avez bien compris ma vie antérieure, vous devinerez les sentiments qui sourdirent en mon cœur. Mes yeux furent tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies sur lesquelles j’aurais voulu pouvoir me rouler, des épaules légèrement rosées qui semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois, de pudiques épaules qui avaient une âme, et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme un tissu de soie. Ces épaules étaient partagées par une raie, le long de laquelle coula mon regard, plus hardi que ma main. Je me haussai tout palpitant pour voir le corsage et fus complètement fasciné par une gorge chastement couverte d’une gaze, mais dont les globes azurés et d’une rondeur parfaite étaient douillettement couchés dans des flots de dentelle ».
Est-ce assez érotique ? Balzac se souvient-il de Laure de Berny, dont les enfants ont à peu près son âge, mais que ça n’empêche pas de céder un soir (1821 ?) à ses avances, sur un banc du jardin de sa maison de Villeparisis ? Passons. Félix passe à l'action en se jetant de la bouche entre les deux omoplates de la belle, à quoi celle-ci répond par un « Monsieur ? » outré et une fuite précipitée.
Quand ils en sont à s’échanger des confidences, Félix et Henriette se rendent compte que leurs vies à leur début se ressemblent par la tristesse et la rudesse du sort que l’enfance et l’adolescence leur ont fait. Charles de Vendenesse capte toute l’attention et l’ambition de ses parents, au détriment du frère cadet qui, mal aimé, méprisé par sa mère, peine à accéder à une vie équilibrée (tout le début du roman).
Blanche-Henriette de Lenoncourt, quant à elle, a eu à subir bien des avanies, au point que, pour y échapper, elle s’est dépêchée d’accepter le déjà âgé M. de Mortsauf pour époux, qui s’est dépêché de la lester de deux enfants, Jacques et Madeleine. La vie avec lui est tout sauf facile et heureuse : c’est un homme aigri, acariâtre, tant soit peu déséquilibré, en proie à des crises de rage (ou de folie) qui sèment la panique au logis. Bref, une femme qui a le sens du sacrifice de soi et qui, par dévouement pour ses enfants et grâce à un sens exagéré du devoir conjugal, persiste à subir stoïquement un sort injuste.
Tout juste se laissera-t-elle aimer de Félix, à la condition expresse qu’il ne franchisse jamais les bornes d’une honnête décence, tout juste lui laissera-t-elle de loin en loin sa main à baiser. Le jeune homme, porté par l’infini de son amour, accepte tout. Dans la foulée, il laissera l’intensité de ses sentiments s’exprimer au moyen du langage des fleurs. Il s’ingénie, au cours de longues promenades dans la campagne, à composer des bouquets qui soient autant de figure de son amour sublimé.
Et là, Balzac met toute la gomme, comme il sait faire quand il lâche la bride à son démon. Attention les yeux, on a quasiment droit au manuel de botanique : flouve odorante, dont le parfum enivre, sédum des vignes, liserons à cloches blanches, bugrane rose, fougères, jeunes pousses de chêne, amourette purpurine, paturin des champs et des eaux, bromes, agrostis, roses du Bengale, daucus, linaigrette, reine des prés, cerfeuil sauvage, clématite en fruits, croisette, millefeuille, fumeterre, etc … (tout ça sur une seule page).
J’arrête là : « Quelle femme enivrée par la senteur d’Aphrodise cachée dans la flouve, ne comprendra ce luxe d’ides soumises, cette blanche tendresse troublée par des mouvements indomptés, et ce rouge désir de l’amour qui demande un bonheur refusé dans les luttes cent fois recommencées de la passion contenue, infatigable, éternelle ? ». Rien de mieux que les symboles pour compenser une frustration sexuelle (dans La Nouvelle Héloïse, Saint-Preux avouera à Julie, tout honteux, sa façon de compenser : qu'en est-il de Félix ? Balzac n'en dit rien).
Pour faire pendant au platonisme forcé de cette relation bizarre, Balzac mettra Félix en présence de la torride lady Dudley, qui l’entraîne dans des sarabandes autrement érotiques et concrètes. Ce caprice n’aura qu’un temps. Je passe sur quelques épisodes, à commencer par la maladie qui mène Mortsauf à la dernière extrémité, mais victorieusement combattue par l’irréprochable dévouement de son épouse. Je passe aussi sur la mort pathétique de Mme de Mortsauf et sur l'aversion que manifestera Madeleine à l'égard de Félix, alors que sa mère avait envisagé de la lui donner pour épouse (on sait par Une Fille d'Ève qu'il saura se consoler, et au-delà).
J’en viens à l’impression que m’a laissée la relecture de ce livre célèbre. Pour parler franchement, je m’y suis pas mal ennuyé. Littérairement impeccable, évidemment, c’est par son contenu que le bouquin m’a pompé l’air. Cette femme toute en abnégation de soi, guidée par un sens du devoir poussé jusqu'à l'absurde, qui considère son amoureux comme un troisième enfant, ce garçon qui, par idéalisme radical, accepte sa servitude comme une forme de castration, ce vieux comte auquel Balzac a fait un caractère impossible pour mieux faire ressortir la sublimité de la conduite de la comtesse, tout cela a quelque chose d’horripilant.
C’est sûrement une infirmité : c'est sans doute moi qui ne suis pas à la hauteur de ce chef d’œuvre.
Voilà ce que je dis, moi.
jeudi, 22 septembre 2016
38 BALZAC : UNE FILLE D’ÈVE

Le dessin d'Eugène Giraud après le décès.
Résumé : la faute (non consommée) d’une oie blanche tout juste sortie des jupes de sa mère, aussitôt épousée par un jeune homme au trop grand cœur, et qui, manipulée par quelques grandes dames qui veulent s’amuser à ses dépens, a l’impression de vivre une belle histoire d’amour en jetant son dévolu sur un homme nul, mais qui brille dans les salons aux yeux des ignorants, et qui risquera de l’entraîner dans le tourbillon d’un scandale, ce que le mari, de justesse, empêchera généreusement, lui montrant sa noblesse et sa grandeur d’âme.
****************
Le comte de Granville a deux filles, Marie-Angélique et Marie-Eugénie. Elles ont été élevées, pire qu’au couvent, par une mère plus dévote qu’une grenouille de bénitier. L’aînée a épousé Félix de Vendenesse, guéri de ses aventures, chastes avec Mme de Mortsauf, torrides avec Lady Dudley, décevantes avec Laure de Manerville. La cadette s’appelle Mme du Tillet depuis qu’elle a épousé un des deux grands banquiers de La Comédie humaine. Elle s’en repent d’ailleurs amèrement, car son mari, peu sympathique, intraitable dans son ménage comme dans ses affaires, la laisse sans le sou.
Félix, après des frasques qui lui ont fait la réputation d’un Don Juan, il a décidé de « faire une fin », usé par son usage des femmes, au point que Balzac le qualifie de « jeune vieillard », mais doté d’une solide connaissance des humains et de la société. Il apparaît ici en mari impeccable, plus prévenant avec sa femme qu’une poule avec ses poussins, faisant d’elle une femme du monde accomplie, et allant au-devant de ses moindres désirs avant même qu’ils aient été formulés, en sorte que quand commence le roman, elle est « cuite à point par le mariage pour être dégustée par l’amour » (on peut prédire un bel avenir à un auteur qui a un tel sens de la formule).
La totale confiance que Félix a dans sa femme fait que, lorsque, appâtée et guettée par un trio de dames jalouses de sa perfection, elle laisse apparaître la véritable toquade qui la jette vers Raoul Nathan, le mari n’y verra que du feu, de même que Marie-Angélique est aveugle sur les mérites de l’homme qu’elle croit aimer : Balzac en dresse d’ailleurs un portrait peu reluisant, qui tire à hue et à dia. Virtuellement grand écrivain, il voudrait aussi fort arriver en politique (tiens, Balzac aussi aurait bien voulu). En fait, il ne sait pas bien ce qu’il veut et s’active d’une façon désordonnée. En gros, c’est un journaliste « à prétentions ».
De plus, il est l’amant en titre de l’actrice Florine, chez laquelle il vit, dans un appartement richement meublé (car elle a fait une belle carrière), et décoré d’une foule d’objets et d’œuvres offerts par ses admirateurs. Nathan se garde bien de parler d’elle à la comtesse. Pour fonder un journal qui lui ouvrirait des perspectives politiques, il se laisse entortiller par le banquier du Tillet et un compère. Les réserves fondent rapidement à l’usage, les dettes s’accumulent, et Nathan est un jour sommé de les rembourser, sous peine d’aller en prison.
Il manque son suicide, sauvé in extremis par la comtesse, qui le cache et décide d’emprunter la somme nécessaire au paiement de la dette. La baronne de Nucingen accepte de la lui prêter. Elle sera sauvée du déshonneur par sa sœur, qui raconte tout à Vendenesse, qui rembourse aussitôt la créancière.
Il décide d’ouvrir les yeux de sa femme sur les vraies qualités de Raoul Nathan, l’amant indigne et brouillon, mais surtout sa relation pérenne avec l’actrice Florine. Marie-Véronique prend conscience de la réalité, aperçoit l’abime dans lequel elle a failli tomber et se rend compte de la noblesse de cœur de son mari, pour lequel elle éprouve désormais de l’admiration. Tout est bien qui finit bien. Le couple voyagera. A son retour d’Italie, la comtesse apercevra un jour Nathan (« dans un triste équipage ») et Florine dans la rue : « Un homme indifférent est déjà passablement laid aux yeux d’une femme ; mais quand elle ne l’aime plus, il paraît horrible, surtout lorsqu’il ressemble à Nathan ».
Ce court roman de Balzac n’est pas son meilleur, mais il reste intéressant. L’auteur l’ouvre « in medias res », lorsqu’Angélique aux abois se précipite chez sa sœur pour lui avouer toute son aventure et lui demander secours. En vain, puisque celle-ci ne dispose d’aucun argent en propre. L’irruption de du Tillet au cours de l’entretien plonge son épouse dans la terreur, car cet homme cruel et impitoyable leur révèle qu’il sait tout et qu’en abattant Nathan (qu’il a surnommé « Charnathan »), il l’évince de la place qu’il a bien l’intention d’obtenir pour lui-même (avec succès). La suite est grosso modo un long flash-back, avant que le récit renoue avec la scène inaugurale.
La tiédeur de l’impression que laisse le livre est peut-être due à la distance à laquelle les personnages sont maintenus par l’auteur, comme s’il les observait sur une scène depuis la salle. L’affaire se dénoue d’ailleurs par une comédie de masques, à la fin de laquelle Florine, ayant appris la duplicité de son amant, rend à la comtesse toutes les lettres qu’elle lui a envoyées.
Bon roman, quoiqu’un peu lisse, qui finit de façon au fond très morale, après avoir exploré les méandres de la méchanceté humaine dissimulée derrière le masque des conventions sociales.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, une fille d'ève, félix de vendenesse, la comédie humaine
mardi, 20 septembre 2016
37 BALZAC : LE CURÉ DE VILLAGE (1837-1845)
Résumé : il y avait un "Mais ...".
2
Mais ce que tout le monde ignore, à l’exception du bon curé Bonnet et du si perspicace Dutheil, vicaire général devenu évêque et plus tard archevêque, c’est le mensonge affreux sur le piédestal duquel s’élève la statue de la « sainte » : la femme de la bonne société qui est à l’origine du double meurtre commis par Tascheron n’est autre que Véronique Graslin en personne. Francis Graslin est-il même le fils de son père légal ? Le doute est au moins permis.
 Et alors là, Balzac met la surmultipliée (pour ceux à qui le mot deudeuche veut encore dire quelque chose : c'était, sur le levier des vitesses, celle qui permettait de monter à 80km/h, en descente et par vent arrière). S’il y avait eu le cinéma, Balzac n’aurait pas hésité devant le technicolor, l'écran géant, la 3D et la démesure des effets spéciaux.
Et alors là, Balzac met la surmultipliée (pour ceux à qui le mot deudeuche veut encore dire quelque chose : c'était, sur le levier des vitesses, celle qui permettait de monter à 80km/h, en descente et par vent arrière). S’il y avait eu le cinéma, Balzac n’aurait pas hésité devant le technicolor, l'écran géant, la 3D et la démesure des effets spéciaux.
Car au fur et à mesure que la région embellit et s’enrichit, Mme Graslin dépérit, au point qu'elle se trouve bientôt aux portes de la mort. On apprendra que, depuis douze ou quinze ans, pour faire pénitence, elle porte un cilice de crin qui met sa peau à vif (« Son corps n'est qu'une plaie », dira quelqu'un qui a coupé le cilice au ciseau sur l'ordre d'Horace Bianchon, qui s'exclame, en apprenant ça : « Comment ! au dix-neuvième siècle, s'écria le grand médecin, il se pratique encore de semblables horreurs ! »), et qu’elle ne mange, trois fois par jour et toujours seule, qu’ « un morceau de pain sec sur une grande terrine de cendre et des légumes cuits à l’eau, sans sel, dans un plat de terre rouge, semblable à ceux qui servent à donner la pâtée aux chiens ! ». Que tous ceux qui sont en surpoids en prennent de la graine ! Certains appelleraient peut-être ça l’anorexie (le triomphe de la volonté sur son propre corps, jusqu’à la mort).
Arrivée au bord de la tombe (comme on dit), elle a résolu de faire une confession publique, spectaculaire et solennelle de ses fautes, au cours d'une cérémonie grandiose, en présence de ses proches, du curé Bonnet, de l’archevêque en grande tenue, de M. de Grandville l’avocat général (en qui elle voyait le meurtrier de son amant), de Denise Tascheron la sœur du criminel revenue de son exil américain, toute la population étant réunie au château, au comble de l’émotion. Elle sera enterrée dans le petit cimetière de Montégnac, et reposera à côté de son ancien amant décapité. Trop, c'est trop : Balzac, avec emphase et solennité, avec le gros aiguillon dont il titille les émotions du lecteur, abuse des effets de grandeur.
J’avoue que cette séquence tire-larmes, par sa boursouflure et son outrance démonstrative, m’a bien fait rire, avec ses effets aussi gros qu'en son temps la scène finale du film Love story (1970) d'Arthur Hiller sur les âmes sensibles venues au cinéma avec une provision de mouchoirs (je dois être sans-cœur). Mais aussi que cette profession de foi catholique, proclamée à la face de tous et provoquant chez tous des émotions intenses et visibles reste un morceau de bravoure qui, d'un point de vue purement littéraire, garde quelque chose d’admirable.
Au total, un véritable tour de force romanesque, homogène bien que composite, doublé de l’insupportable manifeste d’un catholique fanatique et militant. Mais même si la leçon de catholicisme proprement dite passe quand même assez mal, on n’a pas envie de lâcher, quoiqu’en exceptant les longues dissertations sur l’état moral, économique et politique de la France et les moyens d’y remédier, qui semblent n'avoir rien à faire là, mais sont tout à fait appropriées au grand projet de transformation économique mis en œuvre par Mme Graslin à Montégnac.
Je renvoie ici aux propos tenus à l’évêché ou à l’hôtel Graslin, puis par l'auteur au début du troisième chapitre, puis la très longue lettre (de motivation) de l’ingénieur à M. Grossetête, protecteur de Véronique Graslin, puis les propos de table tenus au château par l’élite de Montégnac. Ici éclatent aussi les convictions anti-parlementaires, anti-égalitaires de l’auteur, qui déplore amèrement la montée de l’individualisme et de l'égalitarisme, du fait de l’affaiblissement de l’autorité royale, de l’autorité paternelle et des liens familiaux, sous les coups des idées révolutionnaires.
Balzac, à la dernière page, assume d’ailleurs crânement ce qu’il a mis de moralement édifiant dans son roman : « Cette discrétion fut un hommage rendu à tant de vertus par cette population catholique et travailleuse qui recommence dans ce coin de France les miracles des Lettres édifiantes » (lettres que devaient écrire du monde entier les missionnaires jésuites à leur général Ignace de Loyola pour rendre compte).
Tout en restant baba devant le génie de cette langue et de cette technique, on est autorisé à ne pas goûter le fond du propos, historiquement marqué au fer.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : j'ai relevé une phrase qui devrait faire plaisir à mon ami Roland : « La philanthropie moderne est le malheur des sociétés, les principes de la religion catholique peuvent seuls guérir les maladies qui travaillent le corps social ». Et puis une formule de Denise Tascheron l'exilée : « ... aux Etats-Unis, où il n'y a ni espérance, ni foi, ni charité ... ». Et enfin cette phrase qui sonne curieusement actuelle : « Les peuples unis par une foi quelconque auront toujours bon marché des peuples sans croyance ». Les Français d'aujourd'hui ont-ils encore un reste de "foi quelconque" ?
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, le curé de village, littérature édifiante, 2cv citroën, horace bianchon, love story film arthur hiller
lundi, 19 septembre 2016
36 BALZAC : LE CURÉ DE VILLAGE (1837-1845)
UN ROMAN ÉDIFIANT.
1
Résumé : roman hybride, qui commence dans une misère assise sur un tas d’or, se poursuit en plaidoyer pour la peine de mort (« la peine de mort, ce grand soutien des sociétés », écrit Balzac au deuxième chapitre), continue par de hautes considérations sur l’état moral et matériel de la France, et se termine dans l’outrance religieuse, sur un dithyrambe catholique.
Le vieux Sauviat, Auvergnat habitant à Limoges dans une maison à la limite de l’insalubre, exerce la profession de marchand forain. Il a épousé une demoiselle Champagnac (devenue ainsi « la Sauviat »), qui lui a plu parce qu’elle parlait le même patois que lui. Leur fille Véronique avait la beauté qu’on prête aux anges, mais la petite vérole l’a défigurée.
Le train de vie du ménage est d’une modestie telle qu’on pourrait le croire dans la misère, mais il n’en est rien : Sauviat, à force d’acheter et vendre de vieilles ferrailles, a pu, disons-le, amasser une petite fortune, qui permet de doter richement sa fille et de lui faire épouser M. Graslin, banquier limougeaud quarantenaire, ravi de faire une bonne affaire. Il n’est pas bien beau, souffrant d’éruptions cutanées liées à sa suractivité financière, heureusement épisodiques. Véronique va donc s’installer dans le superbe hôtel Graslin et devenir le centre d’attraction de la ville.
Au deuxième chapitre, changement radical de décor. Le bien nommé Pingret, vieil Harpagon, a été assassiné, en même temps que sa servante, dans le jardin où, de nuit, il alimentait son trésor, consistant en pièces d’or contenues dans quatre jarres, qu’on retrouve évidemment brisées. Il y en a pour quatre-vingt mille francs, somme énorme. L’enquête conduit à un jeune ouvrier porcelainier, Jean-François Tascheron. On le soupçonne d’avoir commis son crime à cause d’une femme de la bonne société.
Tout le temps de l’enquête, et jusqu’à la fin du procès d’Assises, Tascheron reste muet sur le mobile de son acte et sur l’identité de la femme, mais suivez mon regard : Mme Graslin, à plusieurs reprises, et fort subtilement, émet des avis tendant à dédouaner le jeune homme, qui n'avouera qu'au curé Bonnet, en confession, ce qu'il a dissimulé à tous, à commencer par la cachette où repose l'or. Vaste débat en Limousin : certains vont jusqu’à juger Pingret responsable de son propre assassinat ! Personne cependant n’est effleuré par le moindre soupçon sur la conduite de la belle Mme Graslin.
Pourtant on aurait quelque raison de s’interroger. Pourquoi, après la condamnation de Tascheron à mort, et après le rejet de son recours en grâce, cette dernière dirige-t-elle sa haine massive contre M. de Granville qui, avocat général aux Assises, a obtenu la tête du criminel ? Pourquoi, après la mort de son banquier de mari, quitte-t-elle Limoges pour aller s’enterrer dans le château de Montégnac, que celui-ci a fait construire sur une hauteur de ce petit village pauvre, inhospitalier, et même déshérité, du fait d’une nature ingrate ?
C’est d’abord à cause de M. Bonnet, curé de Montégnac. Ce prêtre, d’une humilité exemplaire, a par son ministère fait d’une population de vauriens prêts à rançonner le voyageur qui se hasardait, voire pire, une population de catholiques fervents et de bons travailleurs, assidus à la messe (d'où le titre du roman, bien que le personnage principal soit Mme Graslin). Mais c’est aussi à cause du fait que Jean-François Tascheron est né là, et qu’il y sera bientôt enterré, à la demande de Mme Graslin, sitôt exaucée que formulée, tant sa réputation est immaculée.
Le roman tombe alors dans le schéma du Médecin de campagne, ce roman où éclate la volonté d'un homme énergique d'amener le bonheur et la prospérité dans une région démunie de Savoie, où le docteur Bénassis, grâce à son génie de l’organisation, et avec l’aide de quelques appuis, au premier rang desquels le colonel Genestas, a complètement transformé tout un coin de montagne. Au  passage, notons que Bénassis, dans sa générosité, a quand même fait déporter tous les crétins des Alpes (ci-contre un authentique) qui, en se reproduisant, perpétuaient l’arriération dans laquelle vivait la vallée, et interdisaient son essor économique, un essor fondé sur le labeur, l’intelligence et la volonté. Il faut savoir ce qu’on veut, que diable ! Comme dit l'autre, là où il y a une volonté, il y a un chemin !
passage, notons que Bénassis, dans sa générosité, a quand même fait déporter tous les crétins des Alpes (ci-contre un authentique) qui, en se reproduisant, perpétuaient l’arriération dans laquelle vivait la vallée, et interdisaient son essor économique, un essor fondé sur le labeur, l’intelligence et la volonté. Il faut savoir ce qu’on veut, que diable ! Comme dit l'autre, là où il y a une volonté, il y a un chemin !
A l’image de Bénassis, Véronique Graslin se fait la grande dispensatrice des bienfaits qui ne tarderont pas à faire de Montégnac une commune riche et prospère. Elle embauche Grégoire Gérard, jeune ingénieur ambitieux, frais émoulu de Polytechnique, qui se morfond dans la routine stérile de l’emploi que l’Etat lui a donné.
Appuyé sur l’investissement des sommes énormes que la châtelaine a empruntées grâce à son crédit, tout le monde se met à l’ouvrage et transforme le paysage, en traçant des chemins, plantant des arbres par centaines, construisant des barrages pour recueillir les eaux pour irriguer les sols et en prévision des futures sécheresses, faisant de landes stériles des terres à fourrage, sur lesquelles vaches et chevaux ne tardent pas à se multiplier. Le résultat, après quelques années, est spectaculaire, la région métamorphosée. Le paysage, enfin façonné de la main de l’homme, est devenu productif et utile à tous. Inutile de décrire la dévotion qui entoure de toutes parts la personne de Mme Graslin, considérée comme une véritable sainte. Mais …
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, le curé de village, limoges, peine de mort, catholiques, catholicisme, chrétien, église, balzac le médecin de campagne, docteur bénassis balzac, arthur hiller love story, france, société, ignace de loyola
dimanche, 18 septembre 2016
35 BALZAC : URSULE MIROUËT (1841)
Résumé : Une charge sabre au clair contre la bourgeoisie provinciale, agrémentée de quelques singuliers miracles.
C’est un roman tout à fait étrange qu’Ursule Mirouët : très prenant, voire poignant par certains aspects, complètement improbable, à la limite du grotesque, par certains autres. L’action se passe à Nemours, ville de province où coule le Loing. La population se répartit en divers groupes. L’un rassemble trois familles bourgeoises qui ont fini par peupler tout l’arrondissement, les Massin, les Minoret et les Levrault qui, à force de se croiser et recroiser (Massin-Levrault, Minoret-Levrault, etc.) ont dessiné un arbre généalogique inextricable, que Balzac renonce raisonnablement à décrire dans le détail.
Minoret-Levrault domine, au début, le tableau familial. Cet hercule doté d’une Zélie qui porte impérieusement la culotte, et d’un Désiré dont il finance les études à Paris en lui voyant une brillante carrière dans la magistrature, est quant à lui d’une stupidité et d’une cupidité sans borne. Il exerce la profession de « maître de poste », qui le met au centre de bien des activités de la ville et au-delà, et dont il a tiré de substantiels bénéfices au fil des années.
Face aux bourgeois, vit tant bien que mal une vieille femme, veuve de M. de Portenduère, née Kergarouët, dont la noblesse, qui remonte à neuf cents ans, est restée intraitable s’agissant d’alliances et de mésalliances. L’intransigeance aristocratique de la vieille Portenduère va bientôt nuire à son fils Savinien. Elle soupçonne la jeune Ursule de calculs d'arriviste, mais touchée par l'héroïsme pur de sa conduite, elle l'acceptera pour sa fille.
L’histoire commence lorsque le docteur Minoret, autour de qui se forme le troisième groupe, après sa longue carrière, et après avoir été le médecin de l’Empereur, revient au bercail pour y finir ses jours, éveillant l’intérêt de ses neveux, qui, lui supposant (non à tort) une fortune personnelle, se considèrent par avance comme les héritiers naturels du médecin. Comme pour les contrarier, celui-ci a malheureusement reporté toute son affection sur la petite Ursule, orpheline, fille d’un aventurier musicien, lui-même fils d’un facteur de clavecins, Valentin Mirouët.
La seule idée du docteur est de donner à Ursule l’éducation la plus soignée, mais en la protégeant jalousement du « monde » et de ses maléfices, si bien que le cœur de la petite n’abandonnera jamais l’état de pureté qui a servi de cadre à sa croissance : elle n’aura aucune idée, même aux pires moments, de la méchanceté du monde, et sera bonne même pour ceux qui lui veulent le plus grand mal. Pour elle, pour son bonheur, il est capable de tous les sacrifices. Le pire est que le vieux tuteur est un athée convaincu, ami des encyclopédistes et rationaliste en diable.
Heureusement – c'est le premier miracle – il se convertit et devient un catholique fervent et convaincu. Par quel prodige ? C’est en effet un coup de baguette magique : retrouvant le docteur Bouvard, un vieux confrère avec lequel il était brouillé parce que celui-ci était un adepte du mesmérisme, cette doctrine sur le magnétisme (le baquet de Mesmer, …) qui apparaissait comme un charlatanisme au docteur Minoret, à l'esprit épris de stricte rationalité.
Mais dans la pièce où Bouvard introduit ce dernier, point de baquet : « Rien que le pouvoir de Dieu, répondit le swedenborgiste » (Swedenborg est, entre autres, un illuministe suédois qui avait eu des visions mystiques, cf. Louis Lambert). Le docteur est accueilli par un homme mystérieux (on dirait aujourd'hui un médium). Il a plongé une femme (de « classe inférieure », autrement dit, pour Balzac, d'une ignorance crasse) dans un sommeil hypnotique, qui, quand il lui a pris la main, se met à lui décrire sa maison de Nemours dans les moindres détails, avec sa bibliothèque ainsi que les faits et gestes d’Ursule, jusqu’au point rouge dont elle a marqué la Saint Savinien dans son agenda, parce qu’elle est amoureuse du jeune Portenduère, et jusqu’aux gros volumes des Pandectes de Justinien dans l'un desquels le docteur garde les billets des dépenses du trimestre, et dont le tome III est rangé avant le tome II.
Boum ! Patatras ! La révélation tombe sur le docteur : « Cette dernière partie de l’interrogatoire foudroya le docteur Minoret ». Et voilà mon athée, ami des encyclopédistes, changé en catholique pur jus en un instant. Shazam ! Moralité : la science ne sait pas tout, car Dieu est là. Minoret retourne à Nemours tout pénétré de religion. C'est proprement miraculeux, et j'avoue que j'ai eu du mal à gober. Le problème, c’est que quand les Massin et Minoret-Levrault voient le docteur accompagner sa filleule à l'église avec son paroissien sous le bras, ils entrent en ébullition. Ils n'ont alors qu'une seule pensée : dépouiller Ursule de tous ses droits à la succession, voire la chasser de la ville. Tout ça parce qu’à la mort du vieux médecin, ils comptent sur son héritage, qui ne peut manquer d’être imposant, vu que, côté finances, il n'y a pas plus avisé et prudent.
C’est là que le roman devient un véritable thriller palpitant : entrent en scène le notaire Dionis, et surtout son clerc Goupil, une créature infernale, prêt à tout pour s’élever dans la société, capable d'ignobles crapuleries pour arriver à ses fins. Il se forme autour des héritiers présomptifs un groupe compact de gens soucieux de leurs seuls intérêts, qui veulent au plus haut point empêcher Minoret de les dépouiller de leurs "espérances". Le docteur bénéficie heureusement de sa longue expérience des hommes et d'une profonde connaissance de leurs turpitudes, mais aussi des bons conseils des amis qui se réunissent tous les soirs chez lui : Jordy, l’abbé Chaperon (le bien nommé) et Bongrand, le juge de paix.
L’affaire se complique de l’amour qui lie Ursule et Savinien de Portenduère. Ce dernier, que le docteur a fait libérer de sa prison pour dettes en avançant la somme à sa mère, se révèle un homme droit, qui ne demande qu’à réparer tous ses torts. Pour aller vite, disons que tout finira pour le mieux, même pour Goupil qui, ayant obtenu un bon poste, ne cherche plus à nuire à quiconque (deuxième miracle).
Heureusement, troisième miracle : le tuteur mort vient visiter Ursule pendant son sommeil et lui révèle comment elle a été privée de son argent au moment de sa mort, annonçant même la mort future de Désiré, le fils du maître de poste, en qui ce dernier a placé tous ses espoirs. Minoret-Levrault est tiraillé par le remords, suite à l'infamie qu'il a commise après avoir surpris la dernière confidence faite par Minoret à Ursule à ses derniers instants : il a fait disparaître une somme considérable, en numéraire et « trois inscriptions ». Quatrième et dernier miracle, il deviendra lui aussi un catholique fervent et restituera tout à la belle Ursule Mirouët, qui pourra épouser son Savinien et recouvrer sa fortune et son château si ignoblement détournés.
C’est dommage, cette fascination de Balzac pour l’invraisemblable, car le happy end apparaît très forcé. En bonne logique, c’est la coterie des bourgeois de Nemours qui emporte le morceau. Mais non, il faut que le Bien triomphe et que le Mal soit puni : Désiré meurt misérablement, Zélie sa mère devient folle. Mais le roman reste très intéressant, à cause de l'incroyable férocité avec laquelle l'auteur décrit la bourgeoisie d’une petite ville de province : les dialogues qu’il met dans la bouche des conjurés et les actions qu’ils commettent ne permettent pas de s’attendre à ce dénouement heureux. On connaît pourtant un Balzac moins amateur de coups de théâtre et plus soucieux de vraisemblance, jusqu’à la cruauté à l’encontre des vertueux (voir le père impitoyable de La Vendetta ou le cynisme avide et répugnant de Mme d'Espard dans L'Interdiction).
Voilà ce que je dis, moi.
A noter le coup de chapeau à maître Rabelais, que Balzac - qui l'a beaucoup pastiché (voir les Contes drolatiques) - déplace avec ironie de la bouche de Frère Jean des Entommeures (au début de la guerre picrocholine dans le vignoble de l'abbaye de Seuillé) dans celle de Zélie (femme du maître de poste) : « Adieu paniers, vendanges sont faites ! », pour dire le désastre au cas où l'héritage échapperait. A noter aussi, pour amener « la science des fluides impondérables » du magnétisme mesmérien et Swedenborg, la révérence à Samuel Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, ursule mirouët, louis lambert, balzac l'interdiction, balzac la vendetta
vendredi, 16 septembre 2016
MISE AU POINT
Les curieux qui se hasardent sur ce blog avec une certaine régularité ont peut-être remarqué que les billets traitant de « l’actualité » et du monde comme il va se sont raréfiés, et même, plus généralement, que les billets « rédigés » ont presque disparu depuis le début de l’été, et même avant, le plus souvent remplacés par des photographies (qui valent bien sûr ce qu’elles valent, sans plus quoique sans moins). C'est parce que j'ai l'impression d'achever un tour de piste, et que je n'ai guère envie de recommencer en me répétant ad vitam aeternam, ad libitum et même usque ad nauseam.
Je l’avoue : j’ai de plus en plus de mal à me lancer dans des diatribes contre tout ce qui cloche en France, en Europe et à travers le monde. Et pourtant ce ne sont pas les occasions qui manquent, à commencer par les farces sportives qui se sont relayées pendant les derniers mois pour empêcher les gogos de penser à leur propre destin. Roland-Garros, Tour de France, Jeux Olympiques (et pire : les paralympiques, avec leur rugby-fauteuil (quid des placages ?) et leur sprint pour aveugles). Je précise que je n'ai strictement rien contre les handicapés, que je connais d'assez près : j'en veux juste au spectacle omniprésent, omnipotent, asservissant.
Ne parlons pas des grands « débats » soigneusement montés en mayonnaise par les sphères médiatique et politique (une déclaration de candidature à la primaire de la droite, une non-déclaration très attendue à la primaire de la gauche, une rixe sur une plage corse, la démission surprise d’un jeune loup du gouvernement, etc.). Toujours le spectacle ahurissant d'acteurs qui se démènent sous les yeux de foules invraisemblablement prosternées devant des "exploits" de plus en plus micrométriques.
Oui, je l’avoue : j’ai de plus en plus de mal. Oh ce n’est pas que la colère ait disparu, bien au contraire : elle est intacte, et même renforcée par certains avis qui convergent (l'extraordinaire phrase de Bernard Moitessier à la fin de La Longue route : « Je porte plainte contre le Monde Moderne ») et aiguisée par les nouvelles qui nous viennent d’à peu près partout, que ce soit de la politique (de plus en plus petite et dérisoire), de l'état de la société française (de plus en plus disloquée), du système économique (de plus en plus dans l’aliénation mentale), du diagnostic posé sur la santé de la planète (de plus en plus de mains sur le signal d’alarme, mais paralysées par des forces de plus en plus contraires).
C’est plutôt une sorte de lassitude : tout le monde (ou à peu près – je parle des gens de bonne foi) est d’accord, tant qu’on en reste au diagnostic : les démocraties sont en danger, et pas seulement pour des raisons extérieures (Daech, Al Qaïda, …), mais aussi à cause d’un essoufflement physiologique qui remet en cause jusqu’à leur existence. C'est quand il s'agit d'adopter des solutions que le consensus vole en éclats et que la Bête "moderne" freine des quatre fers.
Le changement climatique, la pollution, la dévastation de la nature conduisent avec une tranquille certitude et une bonhomie placide l’humanité vers son cataclysme. Quant à l’économie, elle est impatiente de régner sans partage et sans contre-pouvoir, entre les griffes de mastodontes financiers hallucinés et de mastodontes industriels plus puissants que des Etats (les fameux GoogleAppleFacebookAmazon, le colosse Bayer dévorant le mammouth Monsanto), le tout exerçant impunément sa dictature. Je ne parle pas de l’infinité des moyens de contrôle des individus pour les traquer dans tous les moments de leur vie (avec leur consentement empressé), et pour leur imposer la consommation de marchandises comme ultime raison de vivre.
Et pour dire le degré de lassitude, je viens même de cesser d’acheter et de lire la presse écrite, qui était pourtant depuis lurette une habitude invétérée, quasi-addictive. Ce n’est pas qu’on ne puisse trouver quelque article intéressant dans Le Monde, touchant les sciences, l’écologie, quelque interview d’une personne qui a vraiment, pour une fois, quelque chose à dire, quelque chronique nourrie d’un propos consistant, quelque reportage en des contrées plus rares.
Mais le tout-venant de l’actualité politique, le pêle-mêle de l’actualité économique, ajoutés à l’insupportable suffisance et la prétendue « neutralité » journalistique qui, à travers le filtre déformant de son langage expurgé, catégorisé, stéréotypé, jette sur le monde la myopie de ses regards « informés », et interdit de soumettre les propos des responsables et des élus au crible de la critique, tout cela finit par donner la nausée.
Ras-le-bol.
Alors, pour ne pas perdre tout espoir, je me replonge l'esprit dans La Comédie humaine, du Cabinet des antiques à Ursule Mirouët, de "Deux jeunes mariées" à mademoiselle de Cinq-Cygne (Une Ténébreuse affaire), de la demoiselle Cormon de La Vieille fille à M. Bonnet, dans Le Curé de village ; je me baigne l'oreille des harmonies sonores écloses pour le plaisir de l'auditeur, de Janequin, Certon et Sermisy, jusqu'à Mahler, Reger et Messiaen, en passant évidemment par Monteverdi, Bach et Beethoven ; et je me rafraîchis le regard en découpant dans le visible (vieilles plaques photographiques comprises) quelques îlots de choses plaisantes pour mon usage.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : blog, jeux olympiques, jeux paralympiques, roland-garros, tour de france, bernard moitessier, la longue route, je poret plainte contre le monde moderne, daech, al qaïda, gafa, google, apple, facebook, amazon, bayer-monsanto, journal le monde, honoré de balzac, le cabinet des antiques, mémoires de deux jeunes mariées, une ténébreuse affaire, mademoiselle de cinq-cygne, la vieille fille, le curé de village, janequinmusique, certon, sermisy, mahler, max reger, olivier messiaen, monteverdi, bach, beethoven
vendredi, 02 octobre 2015
SIMENON : QUELQUES MAIGRET
J’ai dit du mal de Maigret et de son inventeur, le docteur (ou commissaire, je ne sais plus) Georges Simenon. Et pourtant, paradoxe apparent, je les ai bien lus, ces dix-huit ou dix-neuf épisodes. Ça veut bien dire que je ne déteste pas tant que ça. Et c’est vrai. Je n’aurais pas dû en lire autant à la file, sans doute.
* La Patience de Maigret (Epalinges (Vaud), mars 1965)
Je me souviens d’avoir fait le pari, il fut un temps, d’avaler en file indienne les vingt épisodes de la série des Rougon-Macquart : ça m’a radicalement vacciné et définitivement guéri de l’ « émilezolite ». A force de lecture, le fil blanc des trucs, procédés, manies devient une véritable corde : j’avais l’impression de la sentir se resserrer sur mon cou.
* Maigret et le voleur paresseux (Noland (Vaud), janvier 1961)
L’esprit de système qui guidait l’auteur, l’aspect théorique et doctrinal de sa démarche me sont apparus en pleine lumière. L’avantage de la chose, c’est que j’ai décidé dès ce moment de fuir Emile Zola, et du même mouvement, tout ce qui pouvait ressembler à un roman à thèse. La littérature « à message », disons-le, est mauvaise, la plupart du temps.
* Maigret et les braves gens (Noland (Vaud), septembre 1961)
Je m'étais livré au même gavage avec les œuvres de Henri Bosco, mais là, rien à voir : si l’on repère quelques thèmes obsessionnels (l'ombre, le mystère pressenti, une obscure menace, ...), l’ensemble est somme toute bigarré, mais aussi et surtout, authentique, sincère, dépourvu de toute idée préconçue, de toute doctrine préalable. Chaque ouvrage était en quelque sorte le compte rendu d’une vraie recherche personnelle (Un Rameau de la nuit, Le Sanglier, ...), malgré ce que l’arrière-fond cosmique, païen, mystique, parfois illuminé pouvait parfois avoir d’horripilant (L'Antiquaire, Le Récif, ...).
* Maigret et le client du samedi (Noland (Vaud), février 1962)
Revenons à Simenon et, en particulier à Maigret. Je disais donc que l’auteur est un paresseux, qui s’épargne l’effort de creuser une idée quand elle est bonne. J’ai comparé avec ce qu’est Serge Gainsbourg dans le domaine de la chanson et de la variété, et je persiste : l’ensemble de ses chansons regorge d’idées formidables par leur originalité et leur diversité, mais il n’a jamais cherché à leur donner de l’ampleur en creusant ou développant la forme. Conforté par le succès, il s’est contenté d’aller à la facilité offerte par le contexte marchand et médiatique dans lequel il évoluait. Je me refuse à entrer dans la mythologie dont d’autres se sont complus à entourer, j’allais dire à nimber le personnage.
* Maigret et les témoins récalcitrants (Noland, Vaud, octobre 1958)
Simenon, c’est un peu la même chose : le succès, la facilité. Chaque aventure de son commissaire divisionnaire dépasse rarement les cent cinquante pages. Et de même que les chansons de Gainsbourg, Maigret n’est rien d’autre qu’un produit à consommer, à écouler sur un marché qui, à force de succès, s’est créé pour le voir s’écouler. On me dira ce qu’on voudra, sept jours pour écrire et quatre jours (voir illustration hier) pour réviser un chef d’œuvre, ça fait un tout petit peu léger. Les Maigret ne sont pas des chefs d'œuvre. On a la littérature qu'on mérite.
* Une Confidence de Maigret (Noland, Vaud, mai 1959)
On me dira que Le Père Goriot fut écrit en trois jours au château de Saché (dans la petite chambre, tout en haut), mais je rétorque que, et d’une, pour les trois jours, je demande à voir, et de deux, le bouquin de Balzac est d’une tout autre dimension romanesque et humaine : Rastignac, Vauquer, Vautrin, Goriot existent pleinement, alors que Maigret est un personnage « en creux », un personnage « en négatif ».
* Maigret aux Assises (Noland, Vaud, novembre 1959)
Il est vide. Il n’existe que comme une fonction. Une somme d'habitudes, si l'on veut. Le lecteur n’en a rien à faire de sa psychologie, de son histoire personnelle, de la façon dont son existence s’est construite. Comme Tintin, Maigret est un personnage « une fois pour toutes », monolithique, disons-le : un stéréotype. Dès son apparition, Maigret est un gros flic spongieux de toute éternité.
* Maigret et les vieillards (Noland, Vaud, juin 1960)
On me dira : mais pourquoi le lire, s’il en est ainsi ? Eh bien c’est très simple : il m’a été donné d’hériter la collection complète publiée autrefois par les éditions Rencontre, et je n’ai qu’à donner un coup de pioche dans le gisement pour en voir surgir un, prêt à l’emploi. Vingt-huit tomes de Maigret, soit quatre-vingt-trois romans (j’ai à ce jour parcouru la petite moitié du trajet, quant à la seconde, on verra à la prochaine crise de flemme) auxquels s’ajoutent trois volumes de nouvelles. Je n’ai encore ouvert aucun des quarante-quatre volumes d’ « autres » romans.
* Maigret s’amuse (Golden Gate, Cannes (Alpes-Maritimes, septembre 1956)
Et puis, il y a une autre raison : j’ai fait dans les temps récents quelques lectures que je qualifierai volontiers d’exigeantes, voire austères (Piketty, Jorion, Günther Anders,...), et que la contention, fût-elle intellectuelle, est possible, à condition que l’esprit sorte de temps à autre en récréation, comme on descend taper dans un ballon dans la cour de l’école après la classe.
* Maigret voyage (Noland Vaud, août 1957)
Alors oui, un Simenon fait figure de passe-temps, comme une tranche de détente entre deux tranches de stress. Une récréation.
* Les Scrupules de Maigret (Noland, Vaud, décembre 1957)
Un pis-aller. Un "faute-de-mieux". Et pourquoi pas, une solution de facilité.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, littérature française, commissaire maigret, georges simenon, émile zola, rougon-macquart, henri bosco, bosco l'antiquaire, bosco le récif, serge gainsbourg, le père goriot, honoré de balzac, château de saché, rastignac, vautrin, tintin, thomas piketty, maigret s'amuse, maigret voyage, maigret et les vieillards, maigret aux assises, une confidence de maigret, maigret et les témoins récalcitrants, maigret et le client du samedi, maigret et les braves gens, maigret et le voleur paresseux, la patience de maigret
mardi, 09 juin 2015
L'ASPECT DES CHOSES
« Sur cent femmes, il existe au moins une bonne demi-douzaine de créatures faibles qui, dans cette grande secousse, reviennent peut-être pour toujours à leurs maris, en véritables chattes échaudées craignant désormais l’eau froide. Cependant cette scène est un véritable alexipharmaque dont les doses doivent être tempérées par des mains prudentes » (c'est moi qui italique).
Honoré de Balzac, Physiologie du mariage, Deuxième partie (Des moyens de défense à l’intérieur et à l’extérieiur), Méditation XXII (Des péripéties).
On trouve aussi le mot "alexipharmaque" dans Là-bas, de Joris Karl Huysmans, cher au cœur du personnage de Soumission, le dernier roman de Michel Houellebecq.
********************************************************************************
Les jours se suivent ...
À noter, ci-dessus, les quatre martinets, à peu près alignés verticalement (désolé pour le format).
... eh bien tant pis ! Profitons-en pour en profiter !
Ici, j'ai fait presque (à beaucoup près) comme Harvey Keitel dans le film Smoke (1994, Wayne Wang, scénario de Paul Auster), où il jouait un marchand de cigares qui s'échinait, mais alors là tous les jours de toutes les semaines de tous les mois de toute l'année, à la même heure, à photographier son carrefour insignifiant pour en coller les tirages dans un album spécialement dédié, se disant peut-être : « Pas besoin de bouger. Le monde bouge déjà assez comme ça ».
mais alors là tous les jours de toutes les semaines de tous les mois de toute l'année, à la même heure, à photographier son carrefour insignifiant pour en coller les tirages dans un album spécialement dédié, se disant peut-être : « Pas besoin de bouger. Le monde bouge déjà assez comme ça ».
Je n'en suis pas encore là. J'ai peut-être tort.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, littérature, honoré de balzac, physiologie du mariage, harvey keitel, paul auster, smoke film, soumission, michel houellebecq
lundi, 08 juin 2015
L'ASPECT DES CHOSES
« Sur cent femmes, il existe au moins une bonne demi-douzaine de créatures faibles qui, dans cette grande secousse, reviennent peut-être pour toujours à leurs maris, en véritables chattes échaudées craignant désormais l’eau froide. Cependant cette scène est un véritable alexipharmaque dont les doses doivent être tempérées par des mains prudentes » (c'est moi qui italique).
Honoré de Balzac, Physiologie du mariage, Deuxième partie (Des moyens de défense à l’intérieur et à l’extérieur), Méditation XXII (Des péripéties).
La "scène" dont parle l'auteur est celle, superbe et implacable, mais généreuse, que le mari vient de faire à son épouse, après avoir, dans un geste d'une grande noblesse dédaigneuse, chassé du placard où il se cachait et de son domicile, le « célibataire » qui tenait compagnie à celle-ci. D'où la recommandation au sujet du dosage. Il faut préciser que si le mari s'était absenté (l'étourdi !), c'était parce que, ayant acquis quelque certitude sur son "infortune" (chantant sûrement ces mots de Georges Brassens : « Eh oui, je suis cocu, j'ai du cerf sur la tête »), il avait programmé avec soin le moment fracassant de son retour. Et la « bonne demi-douzaine » (sur cent) de femmes ainsi dûment reconquises laisse à penser comment Balzac jaugeait l'efficacité d'un tel procédé. La plupart des femmes, dans son esprit, ont un goût inextinguible pour « l'eau froide », comme sa biographie tend à le prouver.
******************************************************************************
EST-CE QUE ÇA PREND LA TÊTE ?
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, littérature française, honoré de balzac, physiologie du mariage, alexipharmaque, georges brassens, le cocu
dimanche, 22 mars 2015
ENCORE MODIANO
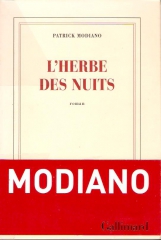 J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.
J’avais acheté L’Herbe des nuits à parution. C’était en 2012, dans l’élan qui m’avait fait lire plusieurs Modiano à la file. Je viens juste de le lire. Le dernier paru, Pour que tu ne te Perdes pas dans le quartier, c’était juste avant la consécration par le prix Nobel. J'en ai parlé ici les 31 décembre et 1 janvier derniers.
Si j'ai tardé à l'évoquer, c'est que mon intérêt pour Modiano, s'il ne s'était pas tout à fait éteint, peut-être avait-il tiédi. L'attribution du Nobel a, disons, réchauffé ma curiosité. Je ne regrette jamais d'avoir lu un livre, même quand j'en sors frustré. Quand j'arrête la lecture en cours de route, c'est que le livre m'a mis en colère, ou alors m'est tombé sur l'ongle incarné (trop lourd, sans doute : je parle du "poids" du livre).
Les prix littéraires, soit dit entre nous, je n’en pense rien, tant la valeur d’un livre ou d’un écrivain me semble incommensurable à sa reconnaissance officielle par une assemblée pontificale, quelle qu’elle soit. Un rite d'autocélébration, en quelque sorte. Une ambiance du genre « Bienvenue au club ! ».
De toute façon, ce qu'on appelle "Grand Prix", vous savez, ces récompenses célébrant les "talents", surtout quand on navigue en milieu littéraire, poétique ou artistique (en gros, ce qu'on appelle les "Affaires Culturelles"), ne sont que des moyens pour une classe dominante de faire passer, en direction des classes dominées, un message du genre : « Vous voyez bien, quand on veut, on peut y arriver ! ». En même temps que ça renforce la légitimité de l'ordre établi (fonction réelle de l'arrosage saisonnier à la Légion d'honneur). Avec ça, je passerai peut-être pour un bolchevique.
Quand on veut, on peut ! Voilà bien un refrain que je hais, un refrain qui sent son moralisme archéo-chrétien, et même pas très catholique. Machine à culpabiliser. Parlez-en au chômeur du coin, qui se heurte aux portes closes de la raréfaction du travail et à qui des Sarkozy viennent faire la leçon : si tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas ! C'est de ta faute ! Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même ! On va te couper les vivres !
Conclusion, en effet : quand on n'y arrive pas, c'est qu'on ne le mérite pas. Modiano, au Nobel, rachète heureusement sa soumission à ce protocole "chez les puissants" par une maladresse existentielle à peu près pathologique, qui ressemble d'assez près à sa littérature, preuve d'une sincérité impossible, je crois, à contrefaire. Si c'était "joué", il serait vraiment très salaud. Parce que, franchement, l'expression « une maladresse existentielle pathologique », ça ressemble d'assez près à une analyse littéraire de l'oeuvre de Patrick Modiano, vous ne trouvez pas ?
Patrick Modiano ressemble juste à l’idée que je me fais du véritable écrivain : celui qui est capable de créer un univers reconnaissable à quelques traits, de la même manière qu'on sait, après deux mesures, qu’on entend « du Chopin » ou, à la translucidité d'une main d'enfant devant la flamme d'une bougie, que l’on contemple « un Georges de La Tour ».
Ce n’est pas une raison pour avaler tous les titres de l’écrivain en file indienne. Pour Chopin, c'est la même chose : pas besoin d'aligner sur la platine les 12 CD de l'intégrale chronologique des œuvres pour piano seul de Frédéric Chopin par Abdel Rahman El Bacha. On sait déjà.
La seule expérience que j’ai faite de cette « méthode », ce fut avec l’œuvre de Henri Bosco, qui, en dehors de deux ou trois titres, n’a plus de secrets pour moi. Pardon : "la seule", c'est inexact : j'ai aussi fait ça avec les Rougon-Macquart (ce qui, entre parenthèses, m'a guéri de la Zola-rziose).
J’ai fait une tentative semblable avec un recueil d’ouvrages de Françoise Sagan (collection Bouquins) : j’ai calé au bout du cinquième, à cause, je crois, de l’atmosphère raréfiée de bocal à poissons rouges, de l'espèce des nantis à l'existence futile, dans laquelle elle plonge le lecteur. Ne pas confondre l'oeuvre littéraire avec le feuilleton. Après tout, il y a peut-être du feuilletoniste chez Modiano. Je dis peut-être une grossièreté ? Tant pis.
Je ne désespère pas de me remettre à la lecture chronologique de La Comédie humaine, abandonnée elle aussi, mais au bout d’une trentaine de titres tout de même. Balzac, c'est autre chose, il dépasse de loin la somme des recettes successives qu'il met en oeuvre. Et je reviens, bien entendu, assez régulièrement, à Simenon, entre autres à ses « Maigret », après avoir éclusé une trentaine également de ces derniers.
Je ne conseille par conséquent à personne de procéder de cette manière avec les romans de Patrick Modiano. Je n’userai pas du poncif de la « petite musique » qui sert d’échappatoire au « critique littéraire » qui n’a pas envie de se fouler pour entrer dans des considérations un peu précises et sérieuses. Il se trouve cependant qu’en ouvrant L’Herbe des nuits peu de temps après avoir lu Pour que tu ne te Perdes pas …, j’ai eu la curieuse impression de lire un décalque de celui-ci.
Même petit carnet rempli de notes diverses. Même ribambelle de noms, de dates, d’adresses, de numéros de téléphone, de lieux de rendez-vous, dont beaucoup ne disent plus rien au narrateur, perdus dans le brouillard d’un passé qu’il cherche à ressaisir, mais il a bien du mal, le pauvre, avec tout le temps qui a passé. Même genre de personnage féminin énigmatique (« Dannie »), à l’identité fuyante.
Même milieu interlope où cette femme évolue, au milieu de noms d’hommes un peu louches : un « Aghamouri », agent secret qui fait semblant d’être étudiant, un « Paul Chastagnier » qui donne au narrateur des « conseils d’ami ». Un « Unic Hôtel », quelque part à Montparnasse, dans le hall duquel ces hommes se retrouvent.
Peu importe au fond la succession des faits dont le livre se fait un argumentaire en quelque sorte obligé. Les récits que Modiano élabore dans ses romans n’ont rien d’événementiel. Non, pas de rebondissements, rien de spectaculaire, pas de tragédie grandiose. L’amateur de ce genre de littérature ne le trouvera pas ici.
L’étoffe dont sont tissés les livres de Modiano est de nature différente. Si je voulais résumer les impressions que me laisse L’Herbe des nuits, je commencerais par dire : une littérature d’état d’âme ; une littérature de climat. L’état d’âme d’un homme qui a été « mal jeté dans la vie » (j’ai connu un Benoît Vauzel  dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.
dont j’ai conservé le disque de chansons ainsi intitulé, ci-contre), et à qui sa vie elle-même échappe (« … tant j’avais l’habitude de vivre sans le moindre sentiment de légitimité … », p. 50), peut-être parce qu’il a du mal à rassembler ses forces et à bander sa volonté pour s’en emparer pleinement. Une inhibition à agir.
Du narrateur lui-même, d’ailleurs, on n’apprendra que des bribes, livrées parcimonieusement, par intermittence. Le narrateur en personne est un peu fuyant, c’est certain : il ne tient pas à laisser de traces derrière lui. Et puis, il semble fatigué, ce narrateur, dépressif peut-être ? C’est bien lui qui dit : « Mais, je n’y peux rien, en ce temps-là j’étais aussi sensible qu’aujourd’hui aux gens et aux choses qui sont sur le point de disparaître » (p. 89).
Dans L’Herbe des nuits, comme dans beaucoup de livres de Modiano, tout le monde pose beaucoup de questions. Quasiment aucune d’entre elles ne reçoit de réponse. Ici, il faut la convocation du narrateur par un certain Langlais, quai de Gesvres, pour qu’il réponde à des questions. On comprend que c'est un policier. Dans les livres de Modiano, j’ai l’impression que, quand ce n’est pas la police qui pose les questions, celles-ci ne reçoivent jamais de réponse. Et encore … Mais je me dis qu'après tout, la police ne pose jamais les bonnes questions.
Car il y a ce détour par la surprenante amitié de Langlais pour Jean, le narrateur, pour accéder à la clé de certains mystères. Pas tous, qu’on se rassure. Et même loin de là. « Dannie » a-t-elle finalement commis un crime ? La personne qui a reçu « deux balles perdues » a-t-elle, dans le passé, été victime d’une erreur de manipulation ou d’une intention claire ? Personne n’est en mesure de répondre. Même la police échoue à faire toute la lumière sur certaines petites choses finalement triviales de la réalité.
L’univers mental dans lequel se débattent désespérément, roman après roman, les héros de Patrick Modiano, est un univers à jamais flottant. Un univers où personne ne répond aux questions, en particulier à la question « Pourquoi ? ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature française, patrick modiano, l'herbe des nuits, pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, prix nobel de littérature, éditions gallimard, collection blanche, affaires culturelles, nicolas sarkozy, abdel rahman el bacha, émile zola, henri bosco, rougon-macquart, françoise sagan, collection bouquins, la comédie humaine, honoré de balzac, georges simenon, commissaire maigret, benoît vauzel mal jeté dans la vie
jeudi, 12 mars 2015
HOUELLEBECQ ECONOMISTE
 Résumé : il n'y a pas de science économique. C'est Bernard Maris qui l'écrit. Cela rend d'autant plus insupportable l'actuelle dictature que l'économie fait peser sur le monde. Michel Houellebecq, dans son œuvre, la révèle de façon infiniment plus vivante que n'importe quel manuel, plus percutante que n'importe quel pamphlet. Bernard Maris parle excellemment de l'œuvre excellente de Michel Houellebecq.
Résumé : il n'y a pas de science économique. C'est Bernard Maris qui l'écrit. Cela rend d'autant plus insupportable l'actuelle dictature que l'économie fait peser sur le monde. Michel Houellebecq, dans son œuvre, la révèle de façon infiniment plus vivante que n'importe quel manuel, plus percutante que n'importe quel pamphlet. Bernard Maris parle excellemment de l'œuvre excellente de Michel Houellebecq.
2/2
Plus rien n’échappe désormais aux impératifs de compétitivité, de rentabilité, de croissance, de mondialisation. On va vers une nouvelle forme de totalitarisme, la meilleure : celle qui suscite une adhésion spontanée des masses. Le totalitarisme consenti. Même plus besoin de les enrégimenter : elles se constituent elles-mêmes en troupeaux dociles, grâce en particulier à cet instrument totalitaire et consensuel de domestication qu'est la télévision.
Les Etats démocratiques n’auront en effet bientôt plus leur mot à dire : les tribunaux arbitraux que s’apprête à mettre en place la négociation Europe-Etats-Unis les condamneront (et leurs contribuables) à payer la moindre entrave à leur commerce, enfin libéré de toutes les réglementations, y compris celles qui protègent la santé des consommateurs, des citoyens, des automobilistes et des conseillers fiscaux.
Quand on sait, avec le cas Bernard Tapie, les saloperies dont sont capables les juges arbitres qui y siègent à huis clos et qui n'ont de comptes à rendre à personne, on devine le sort que nous réserve l'institution de tribunaux arbitraux dans les différends qui opposeront les grandes firmes transnationales aux Etats démocratiques.
Les autorités politiques des pays, émanées de processus électoraux (qui valent ce qu'ils valent), se sont fait déposséder de leur pouvoir effectif au profit d’instances économiques dépourvues, elles, de toute légitimité démocratique. Dans ses échanges, parfois vifs, avec Jean-Marc Sylvestre, Bernard Maris dénonçait avec constance et cohérence tout ce qui a tendu, au cours du temps, à faire de l’économie non plus un moyen d’apporter la prospérité aux populations, mais une fin en soi, un Graal, presque une loi de la nature, imposant sa nécessité aussi sûrement que la gravitation universelle.
Je viens de lire Houellebecq économiste, paru en 2014 (Flammarion), écrit par Bernard Maris, qui était, dit-on, l'ami de l'écrivain. Cela doit être vrai, puisque le romancier a suspendu la « tournée de promo » après avoir appris la mort de l’économiste dans le carnage de Charlie Hebdo. La « tournée de promo », c’est le parcours auquel les auteurs, à la sortie de leurs films, livres ou autres s’astreignent, plus ou moins obligés par le service com’ de l’éditeur, du producteur, …
Un peu de temps ayant passé depuis les attentats de janvier, j’ai pu lire Houellebecq économiste avec une distance apaisée. Disons-le, c’est un livre fort intéressant pour qui s’intéresse à l’œuvre de Houellebecq. Dire que c’est mon cas serait peu dire. Disons-le dans la foulée : ce n’est pas une étude universitaire, mais un tout petit livre (149 pages très aérées), que ceux qui connaissent l’esprit des deux auteurs liront sans problème.
Disons quand même que Bernard Maris exagère quand il écrit : « De Michel Houellebecq je ne connais que les livres » (p. 18). C’est très vilain de mentir. Pour être franc, il lui tresse trop de couronnes de laurier, ça finit par sentir l'emphase partiale, voire l'outrance partisane. Mais à part ça, c’est un livre tout à fait digeste, que le non-économiste que je suis a avalé aisément : l’auteur ne nous assène en effet ce qu'il faut d’économie que pour faire le lien entre l’œuvre du romancier et les élucubrations criminelles des théoriciens du libéralisme déchaîné.
De toute façon, les économistes, Bernard Maris ne les porte pas dans son cœur. Ce n’est pas pour rien que le deuxième mot du livre est « secte ». Il en dénonce le « discours hermétique et fumeux. On les respecte parce que l'on n'y comprend rien ». Mais il prend soin également de préciser : « Faire de Houellebecq un économiste serait aussi honteux que d’assimiler Balzac à un psycho-comportementaliste » (p.22). Précaution qu’il renouvelle en conclusion : « Houellebecq parle-t-il d’économie ? Non, direz-vous, et vous aurez raison » (p. 139).
Moi qui suis un thuriféraire assumé de l’œuvre romanesque de Michel Houellebecq, j’ai trouvé dans le livre de Bernard Maris une autre raison de l’admirer (l’œuvre, pas le bonhomme, car moi je peux affirmer sans mentir que je ne le connais que par là). En même temps, j’ai trouvé confirmation de quelques convictions bien arrêtées sur la marche économique du monde actuel vers un abîme de plus en plus probable et proche.
Une marche que le romancier a comprise dans toutes ses dimensions, avec une acuité digne des grands de la littérature. Contrairement à ce qu’une cohorte de minables et de vendus répandent à plaisir sur le compte de l’auteur honni (mais plébiscité par les lecteurs, voir le classement des ventes de livres), en termes d’insanités, d’invectives et de venin haineux, Michel Houellebecq est le seul écrivain français qui ait ce génie pour traduire en fiction romanesque l’horreur que provoque le spectacle qui se déroule sur la scène planétaire. Il rend palpable et compréhensible le pressentiment de la catastrophe.
Dire que Bernard Maris connaît comme sa poche l’œuvre de Michel Houellebecq, poésie, essais, romans, œuvres diverses, c’est inutile, tellement ça tombe sous la comprenette. Il l’a parcourue en tous sens, et avec la grille de lecture qu’il propose dans Houellebecq économiste, il nous livre une synthèse quintessenciée de ce qu’elle peut enseigner à tous ceux qui aimeraient bien que ce qui reste d’humanisme dans le monde aujourd’hui ne soit pas écrasé par le rouleau compresseur de l’économie mondialisée.
La vie humaine réduite à la compétition économique, cela s’appelle aussi la LOI DE LA JUNGLE. Le monde est atteint d’un cancer que se plaît à faire proliférer un petit nombre de méga-entreprises devenues trop puissantes pour que des Etats lui opposent une autre résistance que de pure forme.
Alors, la « phase terminale », c’est pour quand ? A quand, les « soins palliatifs » ? A quand, la « sédation profonde » en vue de la fin de vie ?
Voilà ce que je dis, moi.
Note : c'est à regret que je le fais, mais je le dois à madame la langue française. J'en suis désolé pour les mânes de Bernard Maris, mais il n'a pas le droit d'écrire, p. 58 : « La main de fer du marché poigne votre petite main, à jamais ». Même si l'idée est juste, il n'existe pas de verbe "poigner". Il existe en revanche un verbe "poindre". Il est du troisième groupe. La troisième personne du singulier est donc "point". Espérons que les mânes d'oncle Bernard ne m'en voudront pas trop.
Je profite de l'occasion pour rappeler à tous en général, et aux journalistes en particulier qu'il n'y a pas de verbe "bruisser", que le verbe bruire est aussi du troisième groupe et que, conjugué à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif, il se termine aussi par un "t" : la ville bruit de rumeurs. Pitié pour la conjugaison française ! Pitié pour notre langue !
To whom it may concern.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : houellebecq soumission, michel houellebecq, littérature française, bernard maris, sciences économiques, tribunal arbitral, totalitaire, totalitarisme, europe états-unis, bernard tapie, jean-marc sylvestre, france inter, houellebecq économiste, charlie hebdo, éditions flammarion, honoré de balzac, langue française, grammaire, bescherelle, verbe poindre, verbe bruire
mercredi, 19 mars 2014
32 BALZAC : JÉSUS-CHRIST EN FLANDRE (1831)
Commenter La Comédie humaine, je ne m'y risquerai pas. D'abord parce que les commentaires, gloses, études, exégèses, annotations, explications et autres bavardages érudits doivent se répandre sur je ne sais combien de dizaines de mètres de rayon dans toutes les bibliothèques savantes. Ce qui doit finir par faire des kilomètres.
Ensuite, parce que je crois profondément que toutes les couches de savoir dans lesquelles les savants croient englober l'acte créateur du génie laisseront toujours échapper ce qui en fait l'essentiel : la jouissance au présent. C'est pourquoi je me contente de donner une idée (parcellaire et subjective) des récits dont cette cathédrale est édifiée, non pas en les résumant, mais en en livrant des sortes de comptes rendus de lecture, sans doute tant soit peu scolaires. On fait ce qu'on peut.
Je me rappelle la visite faite il y a des temps au château de Saché, le plus éminent temple balzacien qui existe au monde. Un pèlerinage, en quelque sorte. On vous montre par exemple la chambre qu'il occupait tout en haut, reconstituée (?) avec soin, y compris la table devant la fenêtre dominant une allée bordée d'arbres nobles.

Y compris la cafetière chargée de fournir du carburant au moteur de son génie. Souvenir puissant, imprégné des contrastes que la lumière d'un soleil éclatant faisait peser sur les lieux. J'y reviendrai. Pour l'instant, parlons d'une drôle de nouvelle : Jésus-Christ en Flandre.
Disons que cette très courte nouvelle d’à peine vingt pages est une féerie, et n’en parlons plus. Une parabole si vous voulez, mais alors taillée à la hache. Une légende populaire ancienne aussi. Jugez plutôt. Un marinier qui fait la traversée d’un bras de mer entre Ostende et une île qui lui fait face embarque ses derniers passagers, quand un mystérieux personnage s’ajoute.
A l’arrière se sont installés un jeune cavalier fringant et arrogant faisant sonner ses éperons dorés ; une demoiselle portant faucon sur le poing et ne causant qu’à sa mère ou à l’archevêque qui leur tenait compagnie ; un gros bourgeois de Bruges accompagné d’un valet armé jusqu’aux dents à cause des gros sacs pleins d’argent ; enfin un homme de science à la haute renommée.
A l’avant, on trouve un vieux soldat, assez charitable pour laisser sa place assise à l’inconnu ; une ouvrière d’Ostende chargée d’un enfant ; un paysan et son fils ; une pauvresse bien pieuse. Le schéma est clair et édifiant : les riches à l’arrière, séparés des pauvres assis à la proue par les bancs des rameurs.
Attention, ça va secouer, l’orage menace et les passagers sont diversement inquiets, les uns s’en remettant à Dieu, les autres inquiets pour leur personne. L’orage devient tempête, et malgré la vigueur des rameurs, le sort de l’esquif devient de plus en plus précaire. Parmi les débats entre ceux qui croient au Ciel et ceux qui n’y croient pas, seul l’inconnu reste calme, disant à la jeune mère : « Ayez la foi, et vous serez sauvée ».
Puis, quand la barque a chaviré : « Ceux qui ont la foi seront sauvés ; qu’ils me suivent ». Se mettant debout, il se met à marcher sur la mer, suivi aussitôt par le soldat, puis par la petite vieille qui, à leur tour, marchent sur la mer. Les deux paysans les imitent, de même que Thomas, le marinier qui a accueilli la vieille sans réclamer le prix du passage. La foi de Thomas est chancelante, et il tombe plusieurs fois, mais réussit à suivre les autres.
Et les riches, allez-vous me demander ? Devinez, voyons, c’est la question à 15 euros : leur sort est éminemment moral. On retrouve ensuite le narrateur dans la cathédrale d’Ostende. Il est fatigué de vivre. On est en 1830, après la révolution de juillet et la chute des Bourbons. Il est assis et décrit ce qu’il voit. Mais la description se transforme en tableau fantastique, « comme sur la limite des illusions et de la réalité ».
Une femme, une petite vieille froide, de sa main glacée le prend par la main et le conduit dans une demeure obscure. Il comprend qu’elle est la Mort, veut fuir, ne peut pas : « Je veux te rendre heureux à jamais, dit-elle. Tu es mon fils ! ». Il l’apostrophe durement, lui reprochant de s’être prostituée, entre autres culpabilités. Alors la vieille se transforme en belle jeune fille lumineuse, et lui lance : « Vois et crois ! ».
Il aperçoit alors dans le lointain des milliers de cathédrales, magnifiquement ornées, il entend « de ravissants concerts », il voit des foules humaines empressées « de sauver des livres et de copier des manuscrits » ou de servir les pauvres. Puis la jeune fille redevient vieille, et souffle : « On ne croit plus ! ». Soudain une voix rauque le réveille, c’est le donneur d’eau bénite qui le prévient de la fermeture des portes.
La conclusion ? « Croire, me dis-je, c’est vivre ! Je viens de voir passer le convoi d’une Monarchie, il faut défendre l’Eglise ». La monarchie en question est la dynastie des Bourbons, qui s’écroule après cinq ou six siècles de règne. On comprend que ça fasse un choc à Balzac devenu (ou qui deviendra) légitimiste.
Chateaubriand en parle longuement dans Les Mémoires d’Outre-tombe, regrettant la raideur doctrinale du clan groupé autour de Charles X, allant même jusqu’à reprocher au roi, qui refuse de « rapporter les ordonnances de juillet », de n’avoir pas compris que la seule solution pour la survie de la royauté eût été, non pas d’épouser son époque, mais au moins d’en accepter quelques innovations.
Au fond, il s’agissait de montrer que le roi était capable d’accompagner le mouvement des idées, seul moyen pour Chateaubriand de rester à sa tête. Au lieu de quoi, c’est le clan le plus réactionnaire qui emporta la décision, et précipita la chute des Bourbons. Chateaubriand se serait pourtant bien vu en précepteur du futur Henri V, se proposant d’inculquer au fils de Charles X la souplesse d’esprit nécessaire à qui veut ne pas être écrasé par la modernité.
Balzac ne va pas aussi loin dans l’analyse. Il se contente ici de déplorer la disparition d’un des piliers de la nation française (le Trône) et veut tout faire pour sauver l’autre (l’Autel). J’adore quant à moi la phrase : « Je viens de voir passer le convoi d’une Monarchie, il faut défendre l’Eglise ». Qu’il ait emprunté pour cela au genre fantastique, ma foi, c’est une faute tout à fait vénielle, n’est-il pas ?
Jésus-Christ en Flandre se laisse lire sans déplaisir.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, jésus-christ, jésus-christ en flandre, la comédie humaine, château de saché, touraine, paul métadier, monarchie de juillet, chateaubriand, mémoires d'outre-tombe, charles x, bourbons
lundi, 03 mars 2014
29 BALZAC : LA FEMME DE TRENTE ANS
Drôle de livre que La Femme de trente ans. Pour une raison qui paraîtra évidente, mais qui peut désarçonner à la lecture quand on n’est pas au courant : ce n’est qu’en 1842 que Balzac décide de fusionner six nouvelles écrites séparément. D’où un ensemble tant soit peu hétérogène, voire décousu, par la longueur des récits, mais aussi par les thèmes abordés.
De plus, le titre est très réducteur, car la trame, que Balzac a vu se dessiner après coup pour lier les six récits, repose sur six périodes de la vie d’une femme, de la jeunesse nubile jusqu’au lit de mort. Certes le troisième chapitre s’intitule « A trente ans », mais il n’occupe qu’un dixième du volume. Il ne faudra pas non plus s’attarder sur la faiblesse de certaines soudures : l’auteur a colmaté tant bien que mal les brèches existant entre des récits d’abord indépendants.
Pour Balzac et pour son époque, une femme est fraîche à dix-huit ans, vieille à quarante. A trente ans, elle n'est plus l'une et pas encore l'autre. Être une femme de trente ans, cela veut dire, aux yeux de Balzac, qu'elle peut encore séduire, mais avec une supériorité sur la jeune fille : elle « connaît la vie ». Elle n'a plus sa fraîcheur innocente de jeune vierge, et elle peut encore prétendre capturer des amants par sa façon de se rendre désirable et par les ruses et moyens qu'elle déploie pour arriver à ses fins. Aujourd'hui, foin de ces considérations désuètes, pensez, même les maisons de retraite son devenues des théâtres amoureux.
Les deux épisodes les plus développés sont le premier, où Balzac s’amuse à dépeindre la fatale étourderie d’une jeune vierge, véritable oie blanche qui s’amourache d’un homme nul, et le cinquième, où il raconte les dégâts accomplis dans une famille par le poids du secret qui fait de la mère et de la fille des complices (la fille connaît l'adultère maternel et a provoqué la mort du fils adultérin).
Au début, Julie, au désespoir de son père, est complètement entichée du colonel Victor d’Aiglemont, qu’elle voit parader en compagnie de l’Empereur, un beau jour de 1813, scène sur laquelle Balzac s’attarde un peu longuement : il a beau être légitimiste, il ne se fait pas faute d’admirer le grand homme.
L’année suivante, dans la France envahie par les troupes étrangères, Julie, devenue madame d’Aiglemont, se mord déjà amèrement les doigts de sa toquade exaltée de jeune ignorante. Victor, ce piètre époux, conduit sa femme chez une tante, comtesse ou marquise suivant les pages : Mme de Listomère-Landon.
Celle-ci prend Julie sous son aile et lui promet de la former en lui apprenant comment manœuvrer un mari stupide. Malheureusement, elle meurt « de joie et d’une goutte remontée au cœur » (sic !) en revoyant à Tours le duc d’Angoulême. « Julie sentit toute l’étendue de cette perte ». Son inexpérience des choses de la vie lui donne un temps l’espérance de mourir jeune.
Il n’y aurait rien à raconter ensuite, si un jeune Anglais, lord Arthur Grenville, n’était tombé raide dingue amoureux de Julie d’Aiglemont. Il se consume d’amour, le pauvre garçon, et en pure perte, parce que Julie a décidé de rester vertueuse. Le malheur veut que, au moment où elle accepte de le recevoir chez elle au motif que son mari est à la chasse pour plusieurs jours, il fasse un retour inopiné après l’annulation. Brusquement obligée de le cacher, elle ne sait pas qu’elle lui a broyé les doigts en claquant la porte, et qu’il préfère se laisser mourir de froid plutôt que de compromettre celle qu’il aime.
Le deuxième épisode nous montre Julie venue se cloîtrer dans le château de son domaine de Saint-Lange. On voit là une marquise en proie aux remords causés par la mort de son amant (qui n’a pas eu le temps de le devenir). Elle ne veut voir personne et dépérit. Seul le vieux prêtre de l’endroit parvient à forcer sa porte. Effaré, il découvre une femme sans religion, qui lui avoue tout uniment son indifférence pour son mari et son amour contrarié pour lord Arthur Grenville. Il échouera à la ramener dans le sein de notre très sainte mère l’Eglise. Oui, bof, passons.
Le troisième chapitre voit apparaître Charles de Vandenesse, sans doute un parent du Félix du Lys dans la vallée, qui ambitionne de faire carrière dans la diplomatie. Madame Firmiani (dont le nom fait ailleurs l’objet de tout un récit) le présente à Julie, un jour où elle reçoit dans son salon. Avant de l’aborder, il la contemple, puis engage avec elle une conversation qui leur fait constater la déjà parfaite unisson dans laquelle chantent leurs deux âmes.
L’intérêt romanesque de l’épisode, en dehors de laisser pressentir le futur adultère, est une tirade typiquement balzacienne sur … sur … sur LA FEMME. Eh oui, et même farcie de formules propres au grand écrivain : « Il existe des pensées auxquelles nous obéissons sans les connaître » ; « Emanciper les femmes, c’est les corrompre » ; « La jeune fille n’a qu’une coquetterie, et croit avoir tout dit quand elle a quitté son vêtement ».
Mais il y a aussi des formules bien senties sur les contemporains de l’écrivain, qui n’y va pas de main morte. Parlant de « certains hommes toujours en travail d’une œuvre inconnue » : « statisticiens tenus pour profonds sur la base de calculs qu’ils se gardent bien de publier ; politiques qui vivent sur un article de journal ; auteurs ou artistes l’œuvre reste toujours en portefeuille ; gens savants avec ceux qui ne connaissent rien à la science (…) », j’arrête là les vacheries. Oui vraiment, ce sera tout pour aujourd’hui.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, balzac, la femme de trente ans, la comédie humaine, femme, adultère, le lys dans la vallée, féminisme, féministes
vendredi, 07 février 2014
24 BALZAC : ADIEU (1830)
Il y a quelque temps (« quelque temps » est une expression très pratique, du fait du brouillard compact qu’elle répand sur le sentiment de l’écoulement du temps), j’ai fait l’erreur d’acheter, un volume de la collection « Bouquins » (Robert Laffont, 29 euros). Sous le nom de l’auteur, imprimé en très gros caractères, cette mention : « Œuvres ». Sont rassemblés dans ce volume quinze livres de Françoise Sagan. L’erreur, elle est là, dans le nom de l’auteur. Je n’aurais pas dû.
Studieusement, j’ai lu les cinq premiers titres (Bonjour tristesse, Un Certain sourire, Dans un mois dans un an, Château en Suède, Aimez-vous Brahms ...), à la file et dans la foulée. Au milieu du sixième (Les Merveilleux nuages), j’en ai eu tout d’un coup assez, j’ai refermé. Je ne l’ai plus jamais rouvert. Ce verre de tisane dans lequel trempe l’âme exténuée de quelques personnages blasés, je m’en suis débarrassé en le vidant moralement dans le pot du Ficus Benjamina. Apparemment, ça ne lui a fait ni chaud ni froid : il a continué comme avant à se déplumer de ses feuilles. C’est une image.
Tout ça pour dire que Sagan est restée pour moi une sorte de sirop fade, l’image d’un univers délavé où les protagonistes se regardent mutuellement vivre dans leurs désillusions, où tout le monde en a assez de la réalité de la vie. Un univers en bout de course, où l’individu est limité à lui-même, et où la personne qui lui fait face a pour mission de renouveler le reflet de lui-même où il se complaît, mission jamais accomplie, espoir toujours déçu.
Tout ça pour dire que ça ronronne et que ça tourne en rond. Tout ça pour dire que Françoise Sagan est l’écrivain d’un seul sujet. Tout ça pour dire que Sagan épluche dans les moindres détails l’existence de gens peu intéressants, de gens sans projets, le plus souvent désœuvrés, souvent débarrassés de tout souci matériel, et qui ne savent pas quoi faire de leur existence inutile.
Des gens que le simple fait de vivre semble en soi ennuyer prodigieusement. J’ai donc abandonné. J’ai peut-être eu tort, allez savoir. Je n’ai pas envie d’explorer plus avant. Dans la littérature française d'après-guerre, Sagan est un peu l'étalon-or de ce qui est devenu dans nos années plus récentes le fin du fin de l' « écriture du moi » : l'abominable et autosatisfaite « auto-fiction ».
Je ne sais pas pourquoi, en train de lire des œuvres de Balzac, je suis parti sur Françoise Sagan. Le plaisir du contraste, peut-être. Mais c’est vrai aussi que, après la douzaine de romans et nouvelles du grand homme que je viens de lire, essayant de situer le lieu où se produit l’intensité que j’ai trouvée à retourner à des livres qui, soit dit pour résumer, ont amplement contribué à structurer et façonner ma sensibilité, je viens de repenser à ces œuvrettes de celle qui fut l’auteur "prodige" de Bonjour tristesse (autour de 18 ans, ce qui est en soi un aveu).
Ce titre de Françoise Sagan, épèle mot à mot et lettre à lettre le programme de toute son œuvre, enfin pour la partie que je peux en connaître, c’est-à-dire l’initiale. C’est carrément idiot, je sais, de mettre en présence Sagan face à Balzac, elle aurait bien rigolé, je pense. Mais je prends mes idées comme elles se présentent, et là, c’est Sagan qui s’est présentée. Allez comprendre.
Par rapport au vaste monde qui respire profondément, qui avale gloutonnement la vie et qui jouit à chaque instant de ce qu'il a devant les yeux et dans l'oreille, les œuvres de Françoise Sagan me semblent aussi étroites que les parois de verre du bocal où agonise le poisson rouge.
Je viens donc de lire Adieu. Balzac a écrit ça en 1830. Très curieux, très surprenant. Par l’organisation du récit, par le thème. Le récit s’ouvre sur une scène de chasse, où les deux amis, messieurs de Sucy et d’Albon, reviennent bredouilles après avoir parcouru beaucoup trop de kilomètres, d’Albon suant et pestant du fait de son embonpoint nettement plus remarquable que son ami, qui semble au contraire efflanqué comme Rossinante, tout en montrant la vigueur de l’ancien militaire qu’il est. Mais son visage porte la marque d’un grave souci, qui semble le ravager de l’intérieur. Cette entame ne laisse rien augurer du reste.
Car les deux amis ont hâte de trouver avant la nuit le gîte et le couvert. Le hasard fait qu’ils passent devant les grilles d’un domaine qui semble à l’abandon. C’est l’ancien couvent des « Bons-Hommes », comprennent-ils en entendant les grognements plus ou moins articulés par une femme plus ou moins restée dans l’animalité, du nom de Geneviève.
Déjà surpris par la scène, ils aperçoivent au loin une autre femme, qui grimpe aux arbres, saute, fait mille cabrioles. Elle a visiblement perdu la raison. Appelée par « Geneviève », elle s’approche de la grille et, en voyant les deux hommes, elle prononce le mot qui ouvre sur le drame : « Adieu ! ». D’Albon, très étonné, se tourne alors vers de Sucy, mais c’est pour le voir évanoui sur le sol.
Appelant à l’aide, il voit s’approcher obligeamment la voiture de M. et Mme de Grandville, ses voisins, qui le laissent volontiers en disposer pour ramener son ami au château. On a appris que la femme s’appelle la comtesse de Vandières, que de Sucy a semble-t-il reconnue, pour être une certaine Stéphanie. Son âme s’est soudain violemment déchirée.
Quand de Sucy est rétabli, il prie son ami de courir aux Bons-Hommes pour s’enquérir de tout ce qui concerne la comtesse. Il est accueilli par l’oncle de la dame, médecin de son état, qui le fait entrer et, apprenant l’existence de Philippe de Sucy, lui raconte l’histoire terrible et lamentable que la comtesse et lui ont vécue sur la Bérésina (sic) au moment de la retraite de Russie.
La suite au prochain numéro.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeux olympiques, sotchi, vladimir poutine, littérature française, honoré de balzac, adieu, la comédie humaine, françoise sagan, bonjour tristesse, un certain sourire, dans un mois dans un an, château en suède, aimez-vous brahms, les merveilleux nuages
vendredi, 31 janvier 2014
21 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Le roman est, selon l’histoire, celui qui a procuré la renommée au jeune écrivain, qui avait préalablement « fait ses classes » avec ce que la tradition appelle « romans de jeunesse ». Je suis pour ma part persuadé que La Peau de chagrin est un roman fondateur, un roman pourtant mal bâti. Je n’y peux rien, c’est mon avis : à la lecture, je vois un grave défaut, mais en refermant le livre, je suis saisi par la force de l’ensemble. Allez comprendre.
Le défaut, il est vite vu. Quand Raphaël sort du magasin, ayant glissé dans sa poche la peau fatale. Miracle ! Il tombe en effet (c’est vraiment le mot) sur son ami Emile, entouré de quelques copains, qui l’entraîne chez le banquier Taillefer, pour se lancer dans une bombance et une orgie acharnées. Emile lui annonce tout de go qu’il vient d’être bombardé directeur d’une revue financée par le banquier : il n’a pas intérêt à faire défaut.
La description de l’orgie est parfaite. Le problème, à mon avis, vient après le dialogue entre les deux amis et deux prostituées, Euphrasie et Aquilina. Sans entrer dans le détail, elles y exposent leur « philosophie » de l’existence, elles qui se savent promises à finir à « l’hôpital ». On verra qu’Euphrasie aura un autre, mais étonnant destin. C’est elle qui déclare aux deux amis : « J’aime mieux mourir de plaisir que de maladie. Je n’ai ni la manie de la perpétuité ni grand respect pour l’espèce humaine à voir ce que Dieu en fait ! Donnez-moi des millions, je les mangerai … ».
Ce n’est qu’ensuite que Raphaël commence à raconter sa vie à Emile. Et je vous jure, ça n’en finit pas. C’est qu’il faut faire tout un chapitre (le fameux « La femme sans cœur »), que diable. On a droit à tout. La vie de Raphaël défile donc, depuis la solitude auprès d’un père très autoritaire, intraitable et riche. Le destin (encore lui) veut qu’il soit ruiné, et il aura beau lancer son fils, devenu juriste par force, dans des procès à n’en plus finir, il ne lui restera rien ou presque (une petite île au milieu de la Loire, où est la tombe de sa femme).
Raphaël, devenu maître de sa vie, envisagera d’abord de se lancer dans la littérature et la science, entreprenant un énorme « Traité de la volonté » à la lueur d’une chandelle, dans la mansarde d’un petit hôtel tenu par une femme, qui vit seule avec sa fille Pauline, âgée de quatorze ans. Toutes deux vivent pauvrement et, voyant la grande austérité du régime que s’impose le jeune homme, se mettent à veiller sur lui sans qu’il s’en doute, sur son linge, sur ses repas, bref deux anges gardiennes. La dame attend le retour de son mari, prisonnier des Cosaques depuis si longtemps qu’il faut vraiment avoir la foi pour y croire. Mais sa certitude est entière.
Le malheur de Raphaël lui vient par Rastignac, soi-disant son ami, qui vient lui instiller la « philosophie » d’un certain Honoré de Balzac : avoir des dettes, c’est risquer de se ruiner, mais c’est avoir une chance d’attirer la chance. Rastignac est le premier tentateur : après lui avoir permis de gagner quelque argent facile par l’écriture de quelques traités grassement payés, il lui prend ses dernières pièces d’or pour aller les jouer. Le malheur c’est qu’il gagne gros.
Cela tombe très bien et très mal, car il a présenté Raphaël à Foedora. La femme sans cœur, c’est elle. Il en tombe éperdument amoureux, raide dingue et c’est peu dire. Il s’agit d’une femme, certes, mais ce n’est pas n’importe qui. Et le curieux de l’affaire, c’est que le bouquin est écrit en 1831, et que Balzac ne rencontre Madame Hanska qu’en 1833. Or il écrit en toutes lettres, à propos de Foedora : « Espèce de problème féminin, une Parisienne à moitié Russe, une Russe à moitié Parisienne ». Intuition ? Prédestination ? Fantasme ? Hasard pur ? Allez savoir.
Ce qui me reste de ça, c’est la course désespérée du pauvre Raphaël derrière la trop belle et trop cruelle Foedora, qui désespère tous les hommes par sa façon d’attirer tous leurs hommages. Et pour parler franchement, cet étalage des tourments d’un Raphaël écartelé entre l’idéal austère de l’œuvre à élaborer et l’espoir de jouissances beaucoup plus terrestres autant qu’immédiates, a quelque chose de fatigant.
Finissons. Le coup de théâtre est tellement théâtral que j’ai du mal à y croire. C’est au pénible réveil de tous les convives du banquier Taillefer que se présente l’homme de loi qui déclare à la face du monde ici rassemblé que Raphaël est le légataire tant recherché, qui hérite de l’immense fortune de son aïeul maternel. Le côté spectaculaire et m’as-tu-vu de toute la scène, en particulier la solennité tapageuse du notaire Cardot, a quelque chose de peu vraisemblable.
Car ce qui est sûr, c’est que Raphaël voit ici se réaliser son désir et que ce désir le fait penser à la mort. Il est saisi d’horreur. Ayant aussitôt mesuré le rétrécissement de la « peau de chagrin », il sait que le moindre de ses désirs précipite sa fin. Il s’enferme donc dans son luxe, servi par Jonathas, le vieux domestique dévoué, revenu se mettre à son service.
Jusqu’à ce qu’un jour il retrouve la jeune Pauline, mais transformée. En effet, le papa est revenu et, tenez-vous bien, nanti d’une fortune colossale amassée au cours de ses voyages dans les lointains. Et elle est amoureuse de son Raphaël, Pauline. Les deux amants sont bientôt mariés et vivent dans une fusion totale.
Tout ça finira mal, comme on sait, après quelques péripéties liées aux angoisses de mort de Raphaël, que Pauline ne comprendra qu’à la dernière extrémité, lançant à Jonathas accouru : « Que demandez-vous ? dit elle. Il est à moi, je l’ai tué, ne l’avais-je pas prédit ? ». Un drôle d’épilogue, rêveur et poétique, laisse entendre que Pauline est devenue vapeur et brume, « fantôme de la Dame des Cousines », du côté de quelque château de la Belle au Bois Dormant.
Je garde du livre cette impression partagée entre l’admiration pour la conception du roman et le regret dû à une composition que je me permets de trouver faible. Je sais, on me dira que « La femme sans cœur » permet à Balzac d’établir un contraste tranché entre le vain amour pour Fœdora dans lequel Raphaël manque de se perdre et l’amour réciproque et comblé pour Pauline, qui le tue.
Je crois que le défaut se situe dans la volonté de symétrie : l’auteur veut à tout prix découper son récit en trois parties équilibrées, ce qui l’oblige à étirer démesurément l'exposé que fait Raphaël à son ami, n’épargnant au lecteur aucun détail des tourments et déboires éprouvés, qu’ils soient pécuniaires ou amoureux. Pour le coup, on peut appeler ça du « tirage à la ligne ». Enfin, c’est mon avis, et je le partage, comme dit Dupont ou Dupond, je ne sais plus.
Cela dit, le fait que j’aie pu m’attarder (trop, et encore, j’aurais pu …) longtemps sur cette œuvre montre qu’elle recèle de riches profondeurs, ce qui n’étonnera guère les habitués de l’écrivain. Maintenant, ce qu’ont pu écrire des gens très savants sur les sources de La Peau de chagrin, je leur laisse les considérations oiseuses. Balzac s’est-il inspiré du mesmérisme ? A-t-il emprunté à L’Homme au sable (ETA Hoffmann) ?
Autant de questions que je n’ai même pas l’idée de me poser. J'aurais plutôt celle de ne pas trouver géniaux les deux coups de baguette magique que sont la spectaculaire annonce du fabuleux héritage et les spectaculaires retrouvailles avec Pauline, devenue elle aussi richissime grâce à l'incroyable retour de son père. On me dira qu'un miracle ne vient jamais seul.
On ne va pas chipoter.
Voilà ce que je dis, moi.
08:59 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, honoré de balzac, la peau de chagrin
mercredi, 29 janvier 2014
19 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Je ne fais pas exprès de passer du temps sur La Peau de chagrin : c'est le livre lui-même qui m'y conduit. Qui m'y oblige peut-être. Et pour dire les choses franchement, je trouve du plaisir à en parler. C'est peut-être un signe, après tout.
Alors en fait, qu’est-ce que c’est, concrètement, une peau de chagrin ? C'est le problème du jour. La deuxième partie, intitulée « La femme sans cœur », est totalement muette sur ce point, puisqu’elle raconte en long, en large et en détail ce qu’a été la vie de Raphaël avant la rencontre avec le vieux marchand d’antiquités.
Dans la première, la présentation et la description de la peau sont expédiées en cinq pages. Il est vrai que ces pages sont d'une densité rare. Tout le monde connaît le thème, ressassé dans les manuels scolaires et les dictionnaires et histoires de la littérature. Tout le reste est dans la dernière, quand la peau de chagrin, en entrant en possession, entre en action. Et c'est bien elle qui possède celui qui la possède. Une variante du pacte faustien, en quelque sorte.
Je commencerai donc logiquement par la dernière partie, lorsque Raphaël a déjà commencé à subir les effets de la peau magique. Et encore plus logiquement, je débuterai par cet épisode tout à fait étonnant, dans lequel Balzac raconte les démarches accomplies par le héros pour percer le secret de ce talisman incroyable, dont il a scrupuleusement tracé le contour d’origine sur une grande surface blanche, et dont il a constaté le rétrécissement, déjà conséquent au moment où j'en parle.
Balzac décide, à ce moment du récit où la vie de Raphaël se résume à une petite pièce de cuir qui rapetisse dès qu’il exprime un désir, de confronter la Science à un phénomène qui la dépasse. Le premier spécialiste qu’il consulte est le zoologiste Lavrille, qui lui révèle (ou lui affirme) que la peau est celle d’un âne de Perse, plus précisément un onagre.
Cela ne lui apprend strictement rien, puisqu'au moment où il découvrait l'existence de la peau (au début du livre), il déclarait : « J'avoue, s'écria l'inconnu, que je ne devine guère le procédé dont on se sera servi pour graver si profondément ces lettres sur la peau d'un onagre ». Mais il n'est pas impossible que ce détail soit une étourderie de Balzac : ce ne serait pas la seule.

UN ONAGRE
Comme Raphaël aimerait bien faire retrouver à la peau sa surface d’origine, Lavrille l’aiguille sur le professeur Planchette, célèbre spécialiste de mécanique, en plein siècle de la mécanique toute-puissante (et de son exaltation). Planchette, comme Lavrille et la plupart du temps les scientifiques, est un illuminé perdu dans ses raisonnements et ses découvertes, et insoucieux de la gloire et de l’argent.
Rendus chez le métallurgiste Spieghalter, Planchette introduit la peau entre les deux platines d’une presse hydraulique. Que croyez-vous qu’il arrive ? La presse se brise, incapable de venir à bout de cette peau animale : « Non, non, je connais ma fonte. Monsieur peut remporter son outil, le diable est logé dedans ». L’Allemand en colère aura beau flanquer un énorme coup de masse sur la peau posée sur une enclume, la faire brûler dans une forge, celle-ci ressort absolument intacte de tous les mauvais traitements : « Un cri d’horreur s’éleva, les ouvriers s’enfuirent ».
Planchette emmène alors Raphaël chez Japhet pour voir si la Chimie viendra à bout du problème, mais là encore : « La Science ? Impuissante ! les acides ? Eau claire ! La potasse rouge ? Déshonorée ! La pile voltaïque et la foudre ? Deux bilboquets ! ». La conclusion des deux savants, après avoir baptisé « diaboline » la substance de la peau est la suivante : « Gardons-nous bien de raconter cette aventure à l’Académie, nos collègues s’y moqueraient de nous ». Echec sur toute la ligne.
Ce n’est pas pour rien que le mot « cuir » a produit le mot « coriace ». C’est sûr, au sujet de la « Science », on ne saurait confondre Balzac et Zola. Ce qui les différencie ? Pour schématiser, je dirais volontiers que Balzac ressemble à un moteur à explosion, émotif par nature, quand Zola descend par filiation des animaux à sang froid, scientifiques par profession, par nature et par vocation. Le passionnel opposé au rationnel. L’observation du vivant, par contraste avec la dissection des cadavres sur le marbre d’un amphithéâtre de faculté de médecine. La palpitation des émotions contre l'esprit de système. Les battements du cœur contre la Raison toute-puissante et desséchée.
Pour résumer, je vote Balzac, et je jette (pas tout) Zola à la corbeille.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la peau de chagrin, émile zola
mardi, 28 janvier 2014
18 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Préambule : voilà-t-il pas que je tombe, dans l'avis « Au lecteur » qui ouvre L'Elixir de longue vie, sur cette jolie phrase d'Honoré de Balzac : « La lecture nous donne des amis inconnus, et quel ami qu'un lecteur ! nous avons des amis connus qui ne lisent rien de nous ! l'auteur espère avoir payé sa dette en dédiant cette œuvre Diis ignotis ». Je dédie cette déclaration aux curieux qui me font l'honneur de venir jeter un œil dans ce blog et d'y passer un moment.
Post-préambule : dernières nouvelles d'Egypte, où le général Sissi a été nommé maréchal : "Après Sissi Impératrice, Sissi Maréchal". Et ça commence à se savoir, que l'époque est au changement de sexe et au « trouble dans le genre ».
*******
LA PEAU DE CHAGRIN (1831)
La visite du magasin d’antiquités au début de La Peau de chagrin permet à Balzac de faire un inventaire de tout ce qu’on peut trouver d’original, de rare, voire d’unique dans toutes les contrées de la terre. Il faut savoir qu’il n’aimait rien tant que le beau et le cher, et quand il décrit l’intérieur somptueusement aménagé d’un hôtel particulier parisien, impossible de ne pas ressentir son goût pour les belles choses et le luxe.
Il s’ingéniait par exemple à se faire faire des cannes toutes plus curieuses et intéressantes les unes que les autres. Il va sans dire que son goût pour les meubles, les tentures, les rideaux, les objets, la vaisselle, tout était à l’avenant. On comprend sans mal que Madame Hanska, à la mort de l’écrivain, fut mise en face d’un monceau de dettes et en présence des figures patibulaires de la foule des créanciers du défunt.
Son principe était simple : s’endetter, c’est se mettre dans l’obligation de faire rentrer l’argent. Et puis rien de tel qu'un intérieur princier pour en mettre plein la vue à l'imprimeur, à l'entrepreneur, voire au créancier impatient, avant de traiter avec eux : faire croire qu'on est en mesure de dépenser sans compter, Balzac le considérait comme une mise de fonds, dont il attendait et espérait de généreux « retours sur investissement ». Ce n'est pas en paraissant misérable qu'on peut escompter entrer dans les affaires et faire fortune.
Et lui qui connaissait son Rabelais sur le bout des doigts, on peut se dire qu’il avait fait sienne la conviction exposée par Panurge dans les chapitres III et IV du Tiers livre, où il fait un long discours à la louange des « debteurs et emprunteurs », qui vaut son pesant de ʺPrix Nobel d’Economieʺ qui, comme chacun sait, n’existe pas, Alfred Nobel ayant toute sa vie professé une solide haine des mathématiques et de l’économie. Tant pis si j'exagère. Il est vrai que Rabelais corrige le chenapan au chapitre V, où Pantagruel expose sa réprobation et sa détestation de ces « acteurs du marché ».
Et les biographes se sont plu à commenter en parallèle les fortunes impressionnantes que Balzac a fait entrer dans ses caisses grâce à son acharné travail d’écrivain, et les richesses fabuleuses qu’il a prodiguées et englouties sans compter pour se créer un décor intime luxueux et prestigieux, digne de la haute idée qu’il se faisait de lui-même. Cette tendance de fond, est perceptible dans la visite qu’il nous fait faire du magasin de curiosités, où sont accumulés tous les objets capables de satisfaire son appétit insatiable ou son inextinguible curiosité.
Pour alimenter cet appétit et faire fonctionner la machine à faire rentrer l’argent, il ne lésina pas. La Comédie humaine tout entière fut écrite en dix-sept ans seulement ! Ce monument, unique dans l’histoire littéraire avec ses cent trente-trois œuvres (!!!!), fut conçu en 1833, l’année où il déboula chez sa sœur Laure, devenue Madame Surville, pour déclarer : « Saluez-moi, car je suis tout bonnement en train de devenir un génie ». Proclamation stupéfiante. Mais il avait diantrement raison. Revenons à nos moutons.
Quand Raphaël de Valentin, pour attendre l’heure nocturne de plonger dans la Seine, entre dans la boutique de curiosités, il n’est pas tout à fait dans son état normal : « … laissant voir sur ses lèvres un sourire fixe comme celui d’un ivrogne. N’était-il pas ivre de la vie, ou peut-être de la mort ? ». Sa vision des choses est troublée par son état, il s’en rend compte : « Il demanda simplement à visiter les magasins pour chercher s’ils ne renfermeraient pas quelques singularités à sa convenance ». Un « gros garçon joufflu » va le guider.
Je n’essaierai pas de résumer la visite, autant vaudrait réécrire le livre. En attendant ce moment improbable, il faut le lire. Qu’on imagine simplement un invraisemblable capharnaüm, où voisinent les objets les plus hétéroclites, les armes avec la vaisselle, les tableaux avec les marbres, les animaux empaillés avec les bibelots exotiques, que Balzac synthétise dans la jolie expression « fumier philosophique ». Raphaël, dans « ces trois salles gorgées de civilisations, de cultes, de divinités … », sous l’action de la mystérieuse émanation de ce fumier, quitte le monde réel.
Il est conseillé de prendre le mot « magasin » dans son premier sens d’ « entrepôt ». C’est une accumulation, un amoncellement, un bric-à-brac, une rubrique-à-braque, tout ce qu’on veut. Je soupçonne Balzac d’avoir soigneusement placé, au fur et à mesure de l’avancée de Raphaël dans la cataracte des objets énumérés dans cette scène ahurissante tout ce qui avait guidé les rêves de grandeur du jeune homme, quand il feuilletait le « Catalogue de la Manufacture des Armes et Cycles de Saint-Etienne ». Je plaisante à moitié : tous ces trucs, ces machins, ces bidules insolites, dont beaucoup coûtent la peau du cul, Balzac ne les a pas sortis de son chapeau. Je veux dire que, dans son imaginaire, ça vient de loin.
Ils font partie intégrante de son rêve de grandeur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la peau de chagrin, rabelais, panurge, pantagruel, tiers livre, l'élixir de longue vie
lundi, 27 janvier 2014
17 BALZAC : LA PEAU DE CHAGRIN
Il paraît que La Peau de chagrin est un des chefs d’œuvre de Balzac. C’est sûrement vrai, puisque des autorités éminentes en la matière l’ont affirmé. C’est en tout cas, encore aujourd’hui, un des romans les plus lus de l’auteur. Pour mon compte, je reste partagé. Pour une raison simple, tenant à la composition, qui donne l’impression d’une vaste digression placée au cœur même du livre et qui nous éloigne du sujet annoncé dans l’introduction.
Il est en effet divisé en trois parties, dont la première, introductive en quelque sorte, forme un petit tiers, la suite constituant les deux autres (gros) tiers : 1) Le Talisman ; 2) La femme sans cœur ; 3) L’agonie. La deuxième partie semble au premier abord, et surtout pendant la lecture, n'avoir aucun lien avec les deux autres. Le livre s’ouvre sur le pressentiment d’une tragédie : un jeune homme à la mine de déterré vient perdre son dernier écu dans une salle de jeu, puis se dirige vers la Seine, avec l’intention d’y finir sa triste existence.
Comme il fait grand jour et que Raphaël de Valentin (le lecteur ne découvre son identité que plus tard) ne veut pas rater sa mort et risquer d’être sauvé par la barque du « Secours aux asphyxiés », il doit attendre la nuit. Pour cela, rien de mieux que de passer le temps, par exemple en pénétrant dans cette boutique d’un « marchand de curiosités » : « … un magasin d’antiquités dans l’intention de donner une pâture à ses sens, ou d’y attendre la nuit pour y marchander des objets d’art ». Il ne sait pas encore que franchir le seuil va décider de son destin, en même temps que retarder sa fin.
Et là il faut dire quelque chose de la description de l’antre du maître des lieux. Bien souvent, les amateurs de littérature, quand ils sont tièdes, sont rebutés par ces longues pages où Balzac plante un décor avec le soin méticuleux d’un artiste peignant un paysage ou un bouquet de fleurs. Je pense aux pages introductives du Père Goriot, dans lesquelles l’auteur nous amène jusqu’à la salle à manger de la mère Vauquer (« Cette pièce est dans tout son lustre … »), que le lecteur moyen (disons le lycéen qui doit rendre son devoir lundi prochain) saute avec lassitude et empressement, déjà fatigué.
Le lecteur paresseux a toujours tort de délaisser ces passages qu’il juge fastidieux, car, surtout chez Balzac (ou Dostoïevski), si l’auteur se donne la peine de décrire longuement (voir la peinture de la Nature dans Les Chouans, déjà), c’est qu’il a une intention : en général, c’est de faire ressentir une ambiance, un climat, parfois même d’annoncer de façon métaphorique ce qui va se passer. Se passer des descriptions quand on lit Balzac, c'est s'exposer à ne rien comprendre aux profondeurs morales et psychologiques sur le flot desquelles il fait aller l'embarcation de son récit.
Dans La Peau de chagrin, dans cette boutique emplie de vieilles choses, que nous montre Balzac ? C’est simple : l’univers. L’impression qui domine en effet, est quasiment que : « Rien de ce qui est humain n’est absent ». Une concentration de trésors accumulés, sur lesquels veille un gros garçon joufflu : « Vous avez des millions ici, s’écria le jeune homme en arrivant à la pièce qui terminait une immense enfilade d’appartements dorés et sculptés par des artistes du siècle dernier. – Dites des milliards, répondit le gros garçon joufflu. Mais ce n’est rien encore, montez au troisième étage et vous verrez ! ».
On a l’impression que l’espace de la boutique s’est distendu aux dimensions de l’imaginaire de l’auteur, c’est-à-dire aux dimensions de l’infini. J’ai l’impression de retrouver la maison marseillaise des frères Sourbidouze dans L’Antiquaire (Henri Bosco) avec ses invraisemblables sous-sols démesurés, ses interminables boyaux tortueux à peine éclairés, ses portes épaisses et ses immenses cavernes secrètes.
Il ne faut à aucun prix bâcler la lecture du cheminement de Raphaël dans le magasin d'antiquités.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la peau de chagrin, l'antiquaire, henri bosco
mardi, 07 janvier 2014
7 BALZAC : LA PAIX DU MÉNAGE
Le troisième volume de l’édition complète de La Comédie humaine parue au Cercle du Bibliophile recueille une douzaine de nouvelles de dimensions variées. J’avais déjà évoqué la première, dont le titre espagnol – El Verdugo (« Le Bourreau ») – indique assez, sinon une volonté d’exotisme, du moins un souci de « couleur locale ».
Pour en rappeler brièvement la teneur, je dirai juste que cela se passe pendant la guerre de Napoléon en Espagne, dans le château du marquis de Léganès, « hidalgo » distingué en même temps que « grand d’Espagne ». Un détachement français est proprement massacré par les partisans, sauf un jeune officier qui parvient à s’enfuir (prévenu par la fille de la maison qui l'a trouvé mignon).
La vengeance du général « G…t…r » est terrible : la famille entière est condamnée à mort. Mais dans un sursaut de bonté sadique, il accorde au noble vieillard la survie de son nom à travers son fils, à condition que celui-ci se fasse le bourreau de tous les siens et leur coupe la tête. Court récit sec, net et violent, dramatique et spectaculaire. Un coup droit dans l'estomac.
Bien loin de cette ambiance intense de sang, de larmes et de frissons, La Paix du ménage nous introduit dans un grand salon parisien, au cours d’un bal prestigieux donné par un grand personnage de l’Empire (on est en 1809), le « citoyen Malin » devenu comte de Gondreville, sénateur et ami de Napoléon. C’était l’époque où, écrit Balzac, « l’engouement des femmes pour les militaires devint comme une frénésie, et concorda trop bien aux vues de l’empereur pour qu’il y mît un frein ». La phrase sent son épigramme rétrospective. Peut-être aussi un regret pour un temps qu'il n'a pas connu.
Dans la foule formée par cette somptueuse et splendide société, et après avoir établi tout le cadre historique et social, Balzac braque le lorgnon du lecteur sur quelques individus choisis, entre lesquels l’intrigue est savamment circonscrite, et qui, s’observant mutuellement avec une attention qui a quelque chose de sauvage, sauront interpréter le moindre des regards des autres protagonistes pour en tirer des conclusions sur les intentions des uns et des autres et sur l’état de leurs relations. L'évocation de ces regards dans le récit est en soi un petite merveille de mise en scène romanesque.
Deux amis, le baron Martial de la Roche-Hugon et le général Montcornet font le pari d’être chacun le premier à mettre dans son lit une femme mystérieuse, très belle quoique très mélancolique, restée à l’écart près d’un candélabre, avec toutes les apparences de la tristesse, voire de la souffrance. Personne ne semble la connaître.
Le baron est l’amant en titre de Mme de Vaudremont, l’une des plus belles femmes de Paris, jeune et belle veuve d'un militaire mort bravement, dont le plus grand souci est de n’apparaître, pour faire contraste, qu’au moment du bal où les autres femmes ainsi que leurs toilettes apparaissent déjà un peu fatiguées.
Elle semble s’intéresser à un autre militaire, le général comte de Soulanges, soit par jalousie (elle surprend son amant Martial empressé auprès de la belle inconnue), soit par inclination (le monsieur a de la prestance). Mais sur le conseil avisé de la duchesse de Lansac, vieille renarde rusée (« volpa astuta », comme dit Leos Janacek) des salons parisiens, qui fut, dit-on, maîtresse de Louis XV, elle se laisse détourner de l’amant en titre, informations désobligeantes à l’appui (« Il a des dettes »), pour s’intéresser, si elle veut du « solide », à Montcornet.
Puis la vieille duchesse se débrouille pour se faire raccompagner chez elle par Soulanges, qui se révèle n’être autre que le mari de la belle inconnue, qui s’apprêtait à brûler spectaculairement la cervelle de La Roche-Hugon, qui, à son goût, serre son épouse d’un peu trop près pour être honnête. Mais il n’en aura pas le temps, et qui plus est, sa crainte est infondée, puisque sa femme n’est venue (incognito) à cette soirée que pour reconquérir son époux volage en suscitant sa jalousie.
Et quand elle rentre chez elle, après avoir repoussé les avances du piètre La Roche-Hugon, au moment où elle pénètre dans sa chambre, elle est très surprise et bien heureuse d’y trouver son mari installé qui, sans doute sermonné par la vieille Lansac, juge plus sage de se réconcilier avec sa femme. « Tout est bien qui finit bien », comme il est dit à la fin du Trésor de Rackham le Rouge (c'était juste pour ça, l'illustration du début).
Une magnifique nouvelle, toute en subtilité, du jeune Balzac. Un bel exercice d’observation du monde, et une intrigue assez ramassée pour que la construction, sans une once de gras, en paraisse aussi savante qu’économe en moyens. Suprême habileté du futur grand romancier. Délectable d'intelligence.
Moralité : il faut lire Balzac.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, la comédie humaine, la paix du ménage
dimanche, 22 décembre 2013
4 BALZAC : PHYSIOLOGIE DU MARIAGE
Disons-le d’entrée de jeu : Physiologie du mariage n’est pas un roman. Le sous-titre éclaire déjà davantage la question : « Méditations de philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur conjugal ». J'admire la triple ironie contenue dans "méditations", dans "éclectique" et dans "philosophie". Ce n’est donc pas un roman, mais ça n’empêche pas le livre d’être un merveilleux bijou de vachardise (voire de férocité à l’occasion).
L’auteur, célibataire endurci de tout juste trente ans quand paraît son « Traité », propose aux maris tous les moyens imaginables de se prémunir contre le risque inhérent, voire consubstantiel à l’institution maritale et à la vie dans l’état conjugal : le cocuage. Il fait semblant de leur donner tous les conseils pour ne pas avoir un jour « du cerf sur la tête » (Brassens, Le Cocu). Ce n’est pas pour rien que Balzac ne s’est marié qu’à la toute fin de son existence, et l’on peut admirer ici un formidable catalogue d’observations, par lequel il prétend faire le tour de la question en même temps qu’épuiser le sujet.
Il est certain que l’ouvrage a acquis un intérêt plus historique que pertinent dans le contexte actuel : le mariage, le régime matrimonial, la famille étant devenus ce qu’ils sont, une grande partie des remarques de l’auteur tombe à plat, si on les regarde avec l’œil des générations actuelles, habituées à obéir à leur moindre désir avant même d’en savoir davantage sur son origine, sa destination, ses conséquences et diverses considérations auxquelles seuls les plus anciens sont désormais accessibles.
Je veux dire que l’institution du mariage est devenue un supermarché où chacun trouve un produit à sa convenance, un produit dont une enquête marketing fine a permis de dessiner le « profil » adapté à sa « cible »; on pourrait dire aussi qu’elle est devenue un restaurant dont la carte proposerait tous les menus et tous les plats qu’il est possible de manger sur notre planète. Je veux dire évidemment que la notion même d’institution a pris du plomb dans l’aile, et que ce qui reste de son corps décharné agonise dans la liesse générale.
Pendant ce temps, une ribambelle de doctes intitulés « penseurs » et de cuistres autoproclamés « intellectuels », s’interrogeant sur le délitement du lien social et les moyens de le retisser, pondent des thèses sur le Progrès indéniable que constitue l’évolution dans les mœurs, tout en accompagnant, si ce n’est en précédant ou provoquant, par le contenu de leur « pensée », le dit délitement.
Michel Foucault et Pierre Bourdieu, entre beaucoup d’autres, ont fondé leur renommée sur leur talent à structurer et théoriser leur haine de l’ordre social, et en le « déconstruisant » patiemment et méthodiquement, pour en dégager et extirper l’insupportable odeur d’arbitraire. Jusqu’à faire découvrir au bon peuple ébahi, comme si c’était une nouveauté révolutionnaire, que la « culture » se différencie radicalement de la « nature », vieux cours de philo pour classes terminales d’après-guerre.
A cet égard, Physiologie du mariage apparaîtra, aux yeux des thuriféraires de cette « société en mouvement » (on se demande autant ce qu’est une société en mouvement : une société statique, ça n’existe pas, du moins aussi longtemps que les membres en sont en vie), comme un livre abominablement suranné, tout juste capable de motiver et d’intéresser je ne sais quel boutonneux soucieux d’accéder pas trop tard à une chaire en Sorbonne. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j’ai refermé le livre, c’était comme si je m’étais abreuvé à la source Hippocrène. C’est sur le mont Hélicon, près de Thespies. Ah, le sabot de Pégase ! Je veux dire que je m’y suis « ressourcé ».
D’abord parce qu’on y retrouve une société où un partisan des institutions n’était pas encore considéré comme un ennemi public à anéantir. Ensuite parce qu’on sait, après ça, ce que c’est que la littérature. Et dire qu’il y a des gens d’un goût apparemment très sûr prêts à soutenir que « Balzac ne sait pas écrire » (citation d’un propos récemment entendu dans la bouche de quelqu’un d’éminemment sensé). N’en veuillons pas trop à la personne : de même que quelqu’un a dit : « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc, XXIII, 34, traduction du chanoine A. Crampon), certains ne savent pas ce qu’ils disent, et il ne serait pas charitable de leur en tenir rigueur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, honoré de balzac, physiologie du mariage, comédie humaine
lundi, 16 décembre 2013
2 BALZAC : LES CHOUANS
Balzac n’aime pas la Bretagne : « La place que la Bretagne occupe au centre [sic] de l’Europe la rend beaucoup plus curieuse à observer que ne l’est le Canada. Entouré de lumières dont la bienfaisante chaleur ne l’atteint pas, ce pays ressemble à un charbon glacé qui resterait obscur et noir au sein d’un brillant foyer. Les efforts tentés par quelques grand esprits pour conquérir à la vie sociale et à la prospérité cette belle partie de la France, si riche de trésors ignorés, tout, même les tentatives du gouvernement, meurt au sein de l’immobilité d’une population vouée aux pratiques d’une immémoriale routine ». On trouve ça dans Les Chouans. On n’est pas plus amène, n’est-ce pas. A méditer à la lueur de l’actualité (bonnets rouges, etc.).
Pourtant, son mépris ne peut s'empêcher de se teinter d'admiration : « Une incroyable férocité, un entêtement brutal, mais aussi la foi du serment ; l’absence complète de nos lois, de nos mœurs, de notre habillement, de nos monnaies nouvelles, de notre langage, mais aussi la simplicité patriarcale et d’héroïques vertus s’accordent à rendre les habitants de ces campagnes plus pauvres de combinaisons intellectuelles que ne le sont les Mohicans et les Peaux-Rouges de l’Amérique septentrionale, mais aussi grands, aussi rusés, aussi durs qu’eux ». On peut comprendre l’ancienne double consigne qui figurait autrefois à l’entrée des écoles bretonnes : « Défense de parler breton et de cracher par terre ».
Ce qui peut surprendre, dans Les Chouans, c’est le mépris que l’auteur manifeste pour ces paysans, de vraies brutes au plafond bas, mal dégrossies. Car dans l’Avant-Propos à la Comédie Humaine, voici ce qu’il déclare : « J’écris à la lueur de deux Vérités éternelles : la Religion, la Monarchie, deux nécessités que les événements contemporains proclament, et vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays ». Il est vrai que c’est écrit en 1842, alors que le livre date de 1829.
Le plus étonnant, c’est que le roman, déjà à ce moment-là, ne ridiculise pas la religion, bien au contraire : il suffit que l’abbé Gudin paraisse pour que les Chouans se taisent et s’agenouillent, même si Balzac assaisonne le curé de remarques peu aimables à l’égard des curés fanatiques qui se mêlent de politique. A l’opposé, il tresse des louanges à l’humble abbé qui, à la fin, est introduit dans la maison de Marie de Verneuil pour la marier au marquis de Montauran. Lui au moins, sans ostentation, se contente de servir humblement et obscurément Dieu et la religion.
Toujours dans l’Avant-Propos, il ajoute cet argument qui devrait nous pousser à réfléchir, nous qui, aujourd’hui, nous contentons d’exister politiquement les jours d’ouverture des bureaux de vote, et d'être contraints au silence le reste du temps : « Sans être l’ennemi de l’Election, principe excellent pour constituer la loi, je repousse l’Election prise comme unique moyen social, et surtout aussi mal organisée qu’elle l’est aujourd’hui, car elle ne représente pas d’imposantes minorités aux idées, aux intérêts desquelles songerait un gouvernement monarchique ». Je suis bien d’accord avec lui : la peste soit de la dictature majoritaire, qui laisse les mains libres au parti vainqueur d’imposer leurs caprices à des masses qui auront tout oublié des avanies ainsi subies quand on leur demandera de voter à nouveau.
Marche-à-Terre est un très beau personnage, décrit comme aussi redoutable qu’insaisissable. Au début, dans le premier affrontement, il ne lui faut qu’un instant pour se soustraire à la vue des soldats, dont il vient de fracasser le crâne des deux qui le surveillent, avec le manche de son fouet. C’est le personnage qui sert de fil rouge à la partie chouanne du récit, toujours aux aguets, toujours aux premières loges pour casser du républicain. C’est même sur lui que se referme le roman : « … et personne ne lui disait rien quoiqu’il eût tué plus de cent personnes ».
Chez les Bleus, la figure qui domine est celle de Hulot, chef de demi-brigade, vieux militaire respecté par ses hommes, féru de discipline et de manœuvres savantes comme on le verra à la fin. Un homme fier aussi, qui brise son épée quand Marie de Verneuil sort de son corset le papier donnant l’ordre de Fouché à tous les républicains de se mettre aux ordres de sa personne : « Je ne sais pas servir où les belles filles commandent ».
Le féminisme n’était pas encore passé par là.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, honoré de balzac, les chouans
dimanche, 15 décembre 2013
1 BALZAC : LES CHOUANS
Il y a des chances que Balzac n’ait éprouvé pour la Bretagne et les Bretons que du mépris. Mais un mépris curieusement teinté d’admiration. Dans Les Chouans, le mépris s’exprime dans la description des mœurs, des habitations et de la pauvreté misérable de la région et de ses habitants, qu’il juge à peine civilisés. Il faut lire la description de la cabane de la Barbette, la femme de Galope-Chopine.
Il écrit ceci : « … et les Chouans sont restés comme un mémorable exemple du danger de remuer les masses peu civilisées d’un pays », et je ne cite pas le pire. Il se moque de leur manie de placer leur fumier au haut bout de leur cour, ce qui a selon lui de fâcheuses conséquences. L’admiration transparaît dans ce que l’auteur dit de l’attitude des chouans dans la bataille.
Mais là encore, il ne peut s’empêcher de voir en ceux-ci des sortes de brigands, dont les motivations sont bassement matérielles, tant ils sont avides de s’emparer de l’or qui passe à portée de leurs mains. Tout ça manque singulièrement de grandeur, et Balzac montre à plaisir, en même temps que leur indéniable courage, la cupidité (et la stupidité de bûche) de ces va-nu-pieds féroces.
En 1829, Balzac n’a pas encore eu l’idée de la future Comédie humaine. C’est après coup qu’il inclut Les Chouans dans son énorme cycle. Pour dire le vrai, ce roman porte un titre tant soit peu trompeur. Je ne l’avais jamais lu. Et pourtant le livre se lit tout seul : pour le coup, c’est un roman d’action, seulement ponctué par quelques instants de contemplation de la nature, et par un fort long, subtil et passionnant duel verbal entre les deux héros.
Le titre est trompeur : il aurait pu tout aussi bien s’intituler Les Blancs et les Bleus, ou encore Une tragédie amoureuse. Les Chouans sont une des composantes principales du roman, mais à peu près à égalité avec les soldats républicains (uniforme bleu) envoyés pour les combattre. L’autre composante essentielle est constituée des deux personnages principaux : Mademoiselle de Verneuil et le marquis de Montauran, surnommé par tout le monde « Le Gars ».
La première est envoyée par Fouché pour faire tomber le second en le prenant dans ses filets au moyen de son talent insurpassable de séduction amoureuse. Le second est envoyé par le roi pour soulever la Bretagne, pendant qu’un autre gentilhomme soulève la Vendée. Les deux sont donc en mission politique, quasiment nationale, sauf que ce n’est pas pour le même pouvoir. Tous deux tendent leurs filets, sauf qu’ils ne sont pas du même genre. Et que tous deux vont être pris dans le filet de l’ennemi, à leur corps défendant, et en perdre la vie.
Car Les Chouans raconte d’abord une histoire d’amour dans une région en guerre civile. C'est l’histoire tragique de deux ennemis amoureux l’un de l’autre, l’histoire de deux dons de la vie de soi à la vie de l’autre, l’histoire de deux sacrifices voulus, désirés, consentis d’un jeune homme et d’une jeune fille prêts à tout donner dès lors qu’ils ont la certitude absolue d’avoir trouvé l’élu de leur cœur, l’unique objet qu’ils attendaient pour se dire qu’à défaut, leur vie ne valait pas la peine, et qu’à ce moment-là, autant la gaspiller.
Les Chouans, c’est une sorte de « remake » étendu à la nation française d’alors de l’immortelle discorde véronaise entre Capulet et Montagu, à la différence que, dans ce combat politique impitoyable, Marie et Le Gars, s’ils ont le coup de foudre chacun de son côté, sont retenus par la méfiance : la Bretagne d’alors est un terrain dangereux, où tout le monde ignore d’où le coup de fusil mortel peut partir.
A cet égard, les moments où Balzac nous fait ressentir les heures d’affres du doute et de la défiance éprouvés par les amoureux sont des chefs d’œuvre où s’expose et se surmonte peu à peu leur résistance à leur désir spontané, immédiat et total de confiance de l’un à l’autre.
Chez les Chouans, les figures les plus travaillées sont au premier chef celle de Marche-à-Terre, et juste derrière lui, celles de Pille-Miche et de Galope-Chopine. Ce dernier se verra la tête coupée par les deux autres au motif que sa femme Barbette a renseigné Mademoiselle de Verneuil, ce qu’ils considèrent comme une trahison. Du coup, d’ailleurs, la Barbette se vengera en trahissant carrément la cause auprès des Bleus.
C’est bien fait pour les Chouans.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, honoré de balzac, les chouans, bretagne, bretons
jeudi, 17 janvier 2013
POUR UNE POIGNEE DE SABLE EN FEU
Pensée du jour :
« Le malheur est un marche-pied [sic] pour le génie, une piscine pour le chrétien, un trésor pour l’homme habile, pour les faibles un abîme ».
HONORÉ DE BALZAC
Alors, fallait-y y aller, fallait-y pas y aller ? Où ça ? Comment ? De quoi ? Ben les Rafales, les bombes, la France à l’assaut de ses anciennes colonies ! La guerre, quoi ! Fallait-il, une fois de plus, endosser l'uniforme du justicier et du redresseur de torts, du défenseur de la veuve et de l'orphelin ? S'occuper des affaires des autres ? Ils ont appelé l'opération du nom d'un charmant félin, le SERVAL, qui, paraît-il et dans les temps anciens, fut un compagnon de chasse de l'homme (je crois ce qu'on me dit, moi, je fais confiance, vous pouvez pas savoir).
Alors, fallait-il que le président de la France, FRANÇOIS HOLLANDE, décidât que la France entrât en guerre ? Personnellement, j’ai tendance à penser qu'oui (l'apostrophe, c'est juste pour éliminer l'hiatus - et non pas "le" hiatus, comme disent les étourdis et les ignorants). Pour la raison simple que, certes, ce sont les affaires des autres, mais pas complètement quand même, à cause, par exemple, de l'importance de la communauté malienne en France. Eh oui, l'industrie a eu besoin des bras maliens. Faut assumer.
Si, face à la pétaudière géopolitique que constitue la Syrie, rien ne semble bouger, en revanche, face à la main de fer que quelques centaines de gangsters, de sadiques et, pour tout dire, de FASCISTES ont abattue sur les populations du nord du Mali, il fallait donc agir sans attendre qu’ils se fussent implantés à demeure et qu’ils eussent étendu la surface de leur conquête à l'ensemble du Mali. Et plus, si affinités, comme on dit. Pour la France, c'est d'une certaine manière de l'autodéfense.
Que ces fascistes soient aussi musulmans n’y change rien, et en plus il est permis d’en douter fortement : des salafistes tunisiens n’ont-ils pas fait brûler le sanctuaire soufi (la tendance mystique et pacifique de l’Islam, s'il en est) de Sidi Bou Saïd, avec les Corans qui y étaient. Des musulmans qui brûlent le Coran ? Voilà un scoop, coco. Fascistes j’ai dit, fascistes je maintiens. Et des bandits par-dessus le marché, dont le projet est, à travers le Sahara, la construction d'une autoroute de la drogue à destination de l'Europe. Coupeurs de mains pour compléter la panoplie et soigner l'image médiatique.
Parmi eux figurent d’ailleurs peut-être des Toubous tchadiens, les anciens mercenaires sur lesquels KHADAFI faisait pleuvoir l'or de son pétrole. Il y avait en tout cas beaucoup de Touaregs qui, une fois le mécène tué atrocement (= lynché sans procès), sont rentrés chez eux (façon de parler, ils sont nomades, nous dit-on), en emportant tout un tas de lance-missiles perfectionnés qu'ils avaient appris à manœuvrer.
Remarquez, KHADAFI est mort, mais l'argent continue à affluer dans les caisses des salafistes pour qui l'Arabie saoudite est le paradis sur terre, mais qui, au passage, ne peuvent pas encadrer les Frères musulmans. Et on nous raconte que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont nos alliés ?
En tout cas, on leur achète tellement de pétrole qu'ils peuvent tout se permettre : acheter le PSG ou des hôtels particuliers du XVIIIè à Paris, et donner aux salafistes et autres djihadistes assez d'argent pour former des armées anti-occidentales. Heureusement, tous sont des sunnites, et s'entendent pour vouloir exterminer ces salopards de chiites et leurs cousins alaouites. On prend les paris sur ce qui va se passer entre eux, quand ils auront eu la peau d'ASSAD, en Syrie ?
Les Toubous du Tchad et les Touaregs de nulle part et de partout croient-ils seulement en quelque chose d’autre que l’argent ? C'est quoi au juste, ce fantasme des « droits des peuples à disposer d'eux-mêmes », au moment où la cocaïne des cartels de Colombie et d'ailleurs nous arrive à travers le Sahara ? Au nom du « droit à l'autodétermination », sans doute ?
Je pose juste la question. Reste que couper des mains et brûler des sanctuaires est le fait d'une petite bande de "tableraseurs du passé", qui me semblent autrement dangereux que les "sans-culotte" de 1793, qui n'avaient au moins dans le collimateur que tout ce qui déparait la sacro-sainte égalité. Les bandits fascistes du Sahel, eux, sèment leur bon plaisir et leur mafia partout où ils font le malheur des autres en débarquant dans leur existence. Et tout ça, grâce à la guerre en Libye.
Les LE PEN, à côté, c’est du pipi de chat et de la roupie de sansonnet, et quand on compare, ça fait même étrange de les entendre traiter de « fachos ». Ils n’ont pas encore coupé de mains, eux. LE PEN en Algérie ? Certes, mais il n’a rien fait d’autre que ce qu’ont fait les AUSSARESSE, BIGEARD, MASSU et compagnie. Je le dis d’autant plus volontiers que je ne suis pas près de voter pour MARINE. Il ne faut pas confondre fascisme et "créneau porteur".
Bref. Personnellement, je suis aussi assez favorable à l’entreprise au Mali, parce que j’ai entendu un général déclarer sérieusement que l’opération n’était que la 2ème phase de ce qui avait été commencé en Lybie par un certain … NICOLAS SARKOZY. Car ce qui est prouvé, c’est que la catastrophe malienne découle directement de la décision va-t-en-guerre de NICOLAS SARKOZY, inspiré par son « Père Joseph » nommé BERNARD-HENRI LÉVY, de tuer le Colonel KHADAFI.
Les charmants garçons d'AQMI (ex-GSPC), du MUJAO et d'Ansar Eddine ne sont que des ingrats : ils devraient savoir gré à NICOLAS SARKOZY de leur avoir ouvert en grand les portes des arsenaux pléthoriques et superbement garnis de MUHAMMAR KHADAFI.
Digne successeur de son prédécesseur, FRANÇOIS HOLLANDE prend bien soin de placer ses pieds dans les traces laissées par ceux du gars à qui il sortait, en plein débat préélectoral : « Moi, président de la République, … Moi, président … ». Mais pour être honnête, il faut dire que HOLLANDE a été obligé de prendre sa décision d’intervenir à cause de la situation créée par l’irréflexion congénitale propre à SARKO, et par son besoin souverain de faire du spectaculaire (dictature du 20 heures de TF1).
« Le changement c’est maintenant », qu’il disait. Remarquez, SARKOZY nous avait déjà fait le coup de la « rupture » en 2007. Et en fait de « rompre », il avait surtout « cassé » (l’hôpital, l’école, la justice, la police, …). Ah c’est sûr, HOLLANDE prend bien soin de ne rien casser. Moi dans mon coin, j’avais déjà pensé qu’il ne « cassait rien » (comme on dit vulgairement), HOLLANDE. Et pourtant si : il a envoyé l’armée « casser du nègre et du bougnoule », comme on disait joliment, du temps de la « coloniale ».
Surtout, il prend soin de ne rien casser de ce qu’a fait le prédécesseur, NICOLAS SARKOZY. C’est sûr qu’il veille à ce que les ruines laissées par lui restent en l’état, aussi propres et nettes qu’il les a trouvées en entrant dans les « lieux » (si vous voyez ce que je veux dire). Rien n'est plus seyant que de belles ruines bien entretenues. Voyez Pompéi.
Reste que les frontières dessinées par les colonisateurs de l’Afrique avant leur départ relèvent la plupart du temps de la plus haute fantaisie. Cela vient en grande partie, ai-je cru comprendre, du fait que ce sont des officiers de l’infanterie terrestre qui ont manié le crayon. Alors que les frontières tracées sur les cartes, mettons, en Asie du Sud-Est, l’ont été par des officiers de marine, et que sur le plan ethnique, en gros, ces frontières ont du sens (idée de l'immense géographe YVES LACOSTE). Pas celles des pays du Sahara.
Le marin, il a un peu étudié le terrain, il a vu les populations dont il a fumé l’opium, il agit avec un certain tact et une certaine subtilité. Le biffin, lui, il carbure à l'alcool, il ne se tracasse pas, il prend une grande règle et c’est parti pour tracer de beaux traits bien rectilignes. Ça y est, vous avez un Etat. Ben non, ce n’est pas comme ça que ça se passe. Un Etat, avec tous ses attributs, pour que ça ait une cohérence, il faut procéder autrement. Les seuls traits qui aient un peu de sens, là, sont ceux qui suivent le tracé des fleuves. Et encore : quels fleuves ?
A cet égard, de la Mauritanie au Soudan (c'est-à-dire de l’Atlantique à la Mer Rouge), en passant par le Mali, le Niger et le Tchad, ainsi que par le sud de l’Algérie, de la Lybie et de l’Egypte, l’arbitraire des tracés relèverait du registre le plus comique si, dans la réalité, ceux-ci n’étaient pas de pures fictions. Je crois rêver quand j’entends un journaliste déclarer doctement que « l’Algérie va fermer ses frontières ». Il sait ce que c'est, une frontière de 1400 kilomètres ? Dans le désert ? C’est ce qui s’appelle avoir le sens des réalités. Oui : des réalités virtuelles. Voilà ce que c'est quand on joue trop à la console.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, honoré de balzac, littérature, france, langue française, guerre mali, al qaïda, terrorisme, sahel, aqmi, mujao, ansar eddine, gspc, guerre, françois hollande, nicolas sarkozy, fascistes, musulmans, islam, bamako, opération serval, bernard-henri lévy, bhl, khadafi, lybie, parti socialiste, niger, tchad, sahara, algérie, otages, mokhtar belmokhtar
mardi, 15 janvier 2013
ELOGE D'HENRI BERGSON 1
Pensée du jour :
« La brute se couvre, le riche ou le sot se pare, l’homme élégant s’habille », Traité de la vie élégante.
HONORÉ DE BALZAC
Ce n'est pas pour me vanter, mais je viens d’achever la lecture des œuvres d’HENRI BERGSON. Drôle d’idée, non ? Remarquez, on me dira que la tâche est loin d’être insurmontable. D’abord parce que ces « œuvres » ne sont pas si nombreuses que ça. C’est tout à fait vrai. Quatre livres, en tout et pour tout, ça reste à hauteur d’homme. Je ne parle pas des deux recueils d’articles, du petit bouquin intitulé Le Rire, des Ecrits et paroles, et de divers papiers plus récemment publiés.
Je me suis limité aux quatre piliers du temple bergsonien : Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), Matière et mémoire (1896), L’Evolution créatrice (1907), Les Deux sources de la morale et de la religion (1932). Un peu moins de mille pages. J'avais acheté (45 francs, si je me souviens bien) le volume chez le libraire du péristyle de l'opéra quand j'étais en classe de première. Oui, il ne faut jamais désespérer.
Oui, ça n’a l’air de rien, je sais. Encore faut-il s’y mettre, et puis s’y cramponner. Les trois premiers livres (augmentés de toutes les activités annexes) suffisent, en 1927, à lui faire attribuer le prix Nobel, même si c’est celui de littérature (révélateur, d'un certain point de vue).
Résultat des courses ? D’abord une impression curieuse : BERGSON écrit dans un français absolument parfait (en plus, absolument accessible et dépourvu de jargon) une philosophie qui exige une attention soutenue, pour ne pas dire un important effort de contention. N’a-t-il pas déclaré un jour : « Il faut avoir poussé jusqu’au bout la décomposition de ce qu’on a dans l’esprit, pour arriver à s’exprimer en termes simples », c’est-à-dire, comme PASCAL, DESCARTES ou ROUSSEAU, dans « la langue de toute le monde ». Voilà un philosophe qu'il est bon !
Voyez plutôt les dernières lignes de son dernier grand livre (1932) : « L’humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu’elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d’elle. A elle de voir si elle veut continuer à vivre. A elle de se demander ensuite si elle veut vivre seulement, ou fournir en outre l’effort nécessaire pour que s’accomplisse, jusque sur notre planète réfractaire, la fonction essentielle de l’univers, qui est une machine à faire des dieux ». Prémonitoire ou carrément utopique ?
Il a eu le temps d’écrire, juste avant, cette phrase merveilleuse, au sujet du « monde inconnu » qu’il appelle de ses vœux : « Le plaisir serait éclipsé par la joie ». Considérons cela comme le point d’orgue de l’œuvre du philosophe. Mort en 1941, il a eu le temps de voir venir l’horreur sur ses tout vieux jours. Pas celle de la bombe atomique. C’est déjà ça.
Je ne sais pas vous, mais moi, ça m’épastrouille, ces phrases. Cette force. Pour clore son œuvre sur de pareilles considérations, il faut être soit devenu sénile (en 1932, il a 73 ans), soit resté complètement culotté, tout comme un jeune con. Pour quelqu’un qui prend ça direct en face, ça peut sembler du n’importe quoi.
Pour quelqu’un qui referme le bouquin là-dessus, ça fait un effet incroyable, même si, la nuit et dans le brouillard, ça vous a un arrière-goût du fossile EDGAR MORIN, vous savez, le boursoufleur d’idées générales, le gonfleur de baudruches conceptuelles globalisantes et creuses.
Certains riront de mon pléonasme, toute globalisation abusive étant forcément creuse : « On ne saurait remplir du tout avec du rien » (je cite de mémoire et en substance). Quand je conduisais l’attelage de bœufs du père PIC, ce qu’il me disait là, c’était l’évidence. Et ça l’est restée. Il reste qu’EDGAR MORIN aura mouliné beaucoup de vent. Et « gonflé » beaucoup d’auditeurs. J’espère. Peut-être à tort.
BERGSON, contrairement à MORIN, ne dit jamais qu’il est en train de dire le sens du monde. Certes, dans son dernier livre, il se laisse aller à une exaltation, à un optimisme au sujet de l’avenir humain. Mais d’après ce que j’en ai compris, HENRI BERGSON ne brasse jamais du vent. Mais c'est un philosophe, lui. C’est peut-être pour ça qu’il ne passe jamais à la télé.
Ah, on me dit qu’il est mort en 1941. Soit. D’ailleurs, il aurait peut-être aimé les plateaux de TF1 : les « belles dames » à la mode se bousculaient à ses cours au Collège de France, et ce ne sont pas les dignités et responsabilités internationales qui l’ont effarouché ou fait fuir. Il avait une « cause » à défendre : ne fait-il pas l’éloge de la Société des Nations (SDN, ancêtre de l’ONU) à la fin des Deux Sources … ?
Je crains qu’HENRI BERGSON, en effet, n’ait appartenu au camp des increvables optimistes.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, honoré de balzac, littérature, henri bergson, philosophie, essai sur les données immédiates de la conscience, matière et mémoire, l'évolution créatrice, les deux sources de la morale et de la religion, prix nobel de littérature, langue française, france, edgar morin, sdn, onu, collège de france




















