samedi, 07 mai 2016
S.A. NOBEL DE LITTÉRATURE
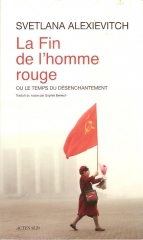 2
2
La Fin de l’homme rouge, livre de Svetlana Alexievitch, est bourré de la souffrance du peuple russe. L’étonnant, c’est que certains communistes intimement convaincus sont restés d’indéfectibles fidèles du Parti, même après avoir passé dix ans dans les camps de travail sibériens, pour avoir dévié si peu que ce soit de la « ligne » officielle, du moins dans l’acte d’accusation que la police rédigeait et, au besoin, fabriquait intégralement pour les besoins de la cause (ce gars qui, sous la torture, avoue qu’il est un espion, puis demande au juge d’instruction pour qui il est convenu d’espionner et qui, face à l’échantillon que l’autre lui présente, opte pour l’espionnage au profit des Polonais). Beaucoup ont toujours ignoré jusqu’au motif réel de cette accusation.
En tout cas, d’innombrables Russes (et autres) non communistes (ou pas assez), mais aussi des communistes pur jus, ont eu à connaître les camps. Tout le monde a entendu parler du Goulag, acronyme signifiant « administration centrale des camps ». L’URSS en a compté des milliers, répartis sur tout le territoire soviétique (ce que veut dire l' "Archipel" dont parle Soljenitsyne). Parmi eux, celui de Karaganda, où Anna Maïa, architecte de 59 ans, raconte que, petite fille, elle dut y suivre sa mère, qui avait été condamnée, et qu’elle y est, devenue adulte, retournée, dans une sorte de pèlerinage. Ensuite, elle se dit qu’elle n’aurait pas dû.
Voici ce qu’elle raconte. Elle est assise dans l’autobus, à côté d’un vieillard qui lui parle du camp, autrefois : « "Vous parlez des baraques ? On a détruit les dernières il y a deux ans. Avec les briques, les gens se sont construit des remises, des saunas. Les terrains ont été vendus pour y construire des datchas. On se sert des barbelés pour délimiter les potagers. Mon fils a un terrain ici. Eh bien, vous savez, ce n’est pas très agréable … Au printemps, avec la fonte des neiges et les pluies, des ossements remontent au milieu des pommes de terre. Ça ne dérange personne, on a l’habitude. Ici, les os, c’est comme les cailloux, il y en a partout … On les jette le long des terrains, on marche dessus … On les piétine. On est habitués ! Dès qu’on commence à creuser, ça grouille littéralement …" J’avais le souffle coupé, j’ai cru que j’allais m’évanouir. Le vieux s’est tourné vers la fenêtre : "Tenez, là-bas, derrière ce magasin, ils ont comblé un cimetière. Et là-bas aussi, derrière les bains." Je n’arrivais plus à respirer. A quoi m’étais-je attendue ? A voir des pyramides ? Des monuments funéraires ? » (p.308). A ne pas lire au moment de l’apéro.
Non plus que cet autre passage, où l’ancien colonel devenu homme d’affaires raconte le mariage qu’il a failli faire, et auquel il a renoncé après avoir rencontré son futur beau-père, dont il restitue les discours tenus un jour de boisson forte : « Je suis un soldat, moi ! On me donnait des ordres, et j’obéissais. J’exécutais des gens. Si on t’en donnait l’ordre, tu le ferais, toi aussi. Tu-le-fe-rais, nom de Dieu ! Je tuais des ennemis. Des saboteurs. Il y avait un papier officiel avec écrit dessus : "Condamné à la mesure suprême de défense sociale". Une sentence du gouvernement … Ah, c’était du boulot, je te dis pas ! Si le type n’est pas tué sur le coup, il s’écroule et il gueule comme un porc … Il crache du sang … Le plus désagréable, c’est de tirer sur quelqu’un qui rigole. Soit il est devenu fou, soit il te méprise. Les hurlements et les jurons, ça pleuvait des deux côtés. Faut jamais manger avant de faire ça. Moi je ne pouvais pas » (p.326-327).
Plus loin : « Tu sais, c’était rare, mais ça arrivait qu’on tombe sur un soldat à qui ça plaisait de tuer … On le retirait de l’équipe des exécutants et on le mutait ailleurs. On n’aimait pas les gens comme ça ». Pour finir là-dessus : « On oblige la personne à se mettre à genoux, et on tire avec son revolver presque à bout portant dans la tempe gauche … près de l’oreille. A la fin de la journée, on a la main qui pendouille comme un vieux chiffon. C’est surtout l’index qui déguste. Nous aussi, on avait un plan à remplir, comme partout. Comme à l’usine. Au début on n’y arrivait pas. On n’y arrivait pas physiquement. Alors ils ont fait venir des médecins, un conseil de médecins, et ils ont décidé de faire des massages aux soldats deux fois par semaine. Des massages de la main droite et de l’index droit » (p.327).
Svetlana Alexievitch, dans La Fin de l’homme rouge, a aussi recueilli une riche matière où apparaît, de façon éparse mais relativement nette, le portrait de ce qu’on appelle en général « l’âme russe ». Pour donner une idée approchante de la chose, disons que ce portrait est à même de provoquer chez les féministes exaltées le pire des urticaires virulents. Pensez : les femmes sont très généralement des mères dévouées, y compris pour leurs maris, et les hommes sont tous sommés de se conformer au rôle de héros virils, vodka comprise : « Nos hommes sont des martyrs, ils sont tous traumatisés, soit par la guerre, soit par la prison. Par les camps » (p.255). On voit que j’exagère à peine.
Ce qui frappe aussi, au moment de l’effondrement de tout le système soviétique en 1991, c’est la rapidité avec laquelle les voisins, russes et autres, sont devenus des ennemis. Du jour au lendemain, les Géorgiens, les Tadjiks, les Abkhazes, se sont jetés sur les Russes, brutalement considérés comme des étrangers ou des envahisseurs. Ils les ont chassés, parfois tirés comme des lapins. Alexievitch raconte l’histoire de cette femme qui a épousé un Russe, que son propre frère agonit d’injures pour ce seul motif. Je ne me rappelle plus s’il le tue.
On reconnaît le mécanisme qui a dressé les uns contre les autres, dans les années 1990, les Serbes contre les Croates ou les Bosniaques : ce fut brutal. Des voisins qui jusque-là vivaient en bonne entente, se mariaient et avaient des enfants ensemble, se retournent contre des voisins. Cela reste tout à fait incompréhensible : pourquoi la vie en bon voisinage devient-elle, du jour au lendemain, impossible, insupportable, inenvisageable ? Qu’est-ce qui fut mis sous le couvercle, pendant ces dizaines d’années ? Qui peut m’expliquer ? Cela dépasse l’entendement.
Dernier point à mentionner : le tableau que peint Svetlana Alexievitch de la vie quotidienne des gens simples, du petit peuple, que cela soit dans le régime soviétique ou après la chute de l’Empire, ne change guère. Certains considèrent même que leur situation nouvelle est pire qu’avant. Si la « perestroïka » a suscité l’enthousiasme, la façon dont toutes les entreprises publiques, après 1991 (Boris Eltsine), tout ce qui faisait le « bien commun » ont été dépecés, les remplit d’une profonde amertume, eux qui sont obligés de courir à droite et à gauche toute la journée, simplement pour trouver le moyen de survivre.
La fortune insolente et soudaine de ceux qu’on n’a pas tardé à appeler les « oligarques », les pouvoirs exorbitants que la richesse leur donne, sont proprement écœurants. Beaucoup ne les considèrent pas autrement que comme des gangsters. Est-il vrai que Vladimir Poutine, le « capo dei capi », en quelque sorte, possède quarante datchas ? Que sa fortune personnelle se monte à plusieurs milliards de dollars ? Le plus étonnant, dans certaines pages, c’est que beaucoup regrettent non pas le communisme, mais la perte de l’idéal exaltant auquel ils croyaient et qui les motivait.
Si La Fin de l’homme rouge ne ressemble pas à ce qu’on a coutume de nommer littérature, le travail de collecte auquel s’est livrée Svetlana Alexievitch pour composer ce livre aboutit à cet objet littéraire, certes non identifié, mais d’une puissance d’évocation que j’ai rarement rencontrée dans des romans plus traditionnels.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : svetlana alexievitch, la fin de l'homme rouge, littérature, prix nobel de llittérature, communisme, totalitarisme, staline, stalinisme, goulag, karaganda, urss, vladimir poutine
vendredi, 06 mai 2016
S.A. NOBEL DE LITTÉRATURE
SVETLANA ALEXIEVITCH
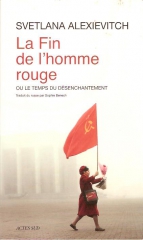 1
1
Quel livre terrible que La Fin de l’homme rouge, ce gros livre (542 pages grand format) de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature. Pour situer le cadre, disons que l’auteur s’est faite journaliste pour recueillir des dizaines de témoignages, chez les gens les plus divers, en les interrogeant non sur l’URSS, Staline ou le Communisme, mais sur la façon dont leur vie quotidienne se déroulait concrètement. On n’est pas dans les généralités abstraites et les grands principes. On est dans la réalité tangible d’existences particulières.
Svetlana Alexievitch a fait de cette façon de procéder une véritable méthode de composition littéraire. Les fines bouches pourront bien dire qu’en laissant la parole à d’autres, l’auteur évite d’avoir à surmonter l’épineux problème de l’écriture et du style, et qu’à la limite, ce n’est donc pas de la littérature. Certes.
Je répondrai que l’empilement de témoignages qui sont autant de cas particuliers, formulés dans des registres de langue extrêmement divers (du populaire au très soigné), finit par produire un effet saisissant de généralité, dont se dégage un vrai point de vue sur un monde, à la fois vaste et profond, comme dans les romans de Balzac. Comme dans la grande littérature. Une plongée terrifiante au cœur de la vie dans le système totalitaire mis en place par Staline (mais déjà, Lénine avait montré ce dont il était capable).
Ce que les gens racontent dans le micro de l’auteur recouvre une période de temps très large, qui va, en gros, de la « grande guerre patriotique » (1941-1945), et même un peu avant, à nos jours, y compris le moment de bascule du communisme au capitalisme, que la phase de transition qui s’est appelée la perestroïka (Gorbatchev) a sinon provoqué, du moins facilité. Quelques interlocuteurs évoquent, au sujet du dernier maître du Kremlin communiste, la « faiblesse » de Mikhaïl Gorbatchev.
C’est vrai que, vu rétrospectivement, le système soviétique finissant ne tenait plus que par l’extrême rigidité de ses structures bureaucratiques, et Gorbatchev a peut-être commis l’erreur de juger qu’on pouvait instiller une dose de souplesse dans un édifice qui, sclérosé de la base au sommet, n’attendait qu’une chiquenaude pour s’écrouler brutalement : « Sans Terreur, tout va s’écrouler en un clin d’œil » (p.324), dit assez justement un ancien exécuteur politique, qui s’était fait prescrire des massages de la main droite pour soigner les crampes qu’il avait le soir, quand il avait dû appuyer trop souvent sur la queue de détente (c'est le vrai nom de la "gâchette") de son revolver dans la journée, dans les caves de la Loubianka.
Reste que le livre de Svetlana Alexievitch, en offrant au lecteur de plonger dans l’avant et dans l’après, permet de mesurer la profondeur et l’intensité du malheur auquel le peuple russe, dans son immense majorité, semble destiné. Toutes sortes de « profils » s’y côtoient, du plus humble ouvrier jusqu’à l’ancien colonel devenu un entrepreneur prospère (émigré au Canada).
Les récits où la cruauté du système soviétique apparaît en pleine lumière sont légion. Par exemple celui-ci, d’un homme dont la femme a été arrêtée par le NKVD, comme beaucoup de ses amis : « A la dernière réunion du Parti, quand on avait récité la litanie des félicitations au camarade Staline, toute la salle s’était levée. Il y avait eu une tempête d’ovations. "Gloire au camarade Staline, l’organisateur et l’inspirateur de nos victoires ! Gloire à Staline ! Gloire à notre Guide !" Cela a duré un quart d’heure, une demi-heure … Tous les gens se regardaient, mais personne ne voulait être le premier à se rasseoir. Ils restaient assis. Et, je ne sais pas pourquoi, je me suis assis. Machinalement. Deux hommes en civil se sont approchés de moi : "Pourquoi vous êtes-vous assis, camarade ?" Je me suis levé d’un bond » (p.211). Inutile de dire que les ennuis ne faisaient que commencer. Sur le bureau du juge d’instruction, il reconnaît l’écriture de son voisin dans la lettre qui le dénonçait, celui qui a ressorti à la police, mot à mot, les conversations que sa femme et lui avaient en sa présence.
Dans la cellule de cinquante personnes où il est enfermé, il raconte l’histoire drôle qui a envoyé son narrateur dans les griffes de la police politique : « Il y a un portrait de Staline au mur, un conférencier fait un exposé sur Staline, un chœur chante une chanson sur Staline, un artiste déclame un poème sur Staline … Qu’est-ce que c’est ? Une soirée consacrée au centenaire de la mort de Pouchkine ». Ce genre d’histoire abonde dans le livre, et donne une idée de la glaciation totalitaire qui a immobilisé le pays tout entier pendant soixante-dix ans.
Les seules échappatoires qui offraient aux gens une issue de secours, une soupape de sûreté, étaient l’alcool, les livres et la cuisine. Pas le mitonnage de petits plats, mais la pièce où on les prépare. Les « réunions » qui s’y déroulent n’ont rien d’officiel, et c’est le seul endroit où les propos sont à peu près libres, si l’on excepte les délateurs possibles, mais aussi les éventuels micros, vers lesquels on se retourne parfois, par défi, pour s’adresser au flic censé écouter.
Autre histoire de dénonciation, p.87 : deux femmes sont très amies, elles ont chacune une fille. L’une, un jour, quand elle est arrêtée, demande à l’autre de veiller sur sa fille. Dix-sept ans après, quand elle revient, elle baise les pieds de son amie, pour avoir veillé sur l'enfant. Et puis un jour où elle peut consulter le dossier qui l’a envoyée en camp, quand elle découvre que la lettre de dénonciation avait été écrite par cette « meilleure amie », elle se pend.
Autre histoire encore : « Mais oncle Vania est revenu … Sans dents, avec une main desséchée et un foie hypertrophié. Il a recommencé à travailler dans son usine, au même poste, il était dans la même pièce, le même bureau … (Il allume une autre cigarette.) Et celui qui l’avait dénoncé était assis en face de lui. Tout le monde le savait, et oncle Vania le savait aussi … Ils allaient aux réunions et aux manifestations, comme avant » (p.321).
Sans commentaire.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, prix nobel de littérature, svetlana alexievitch, la fin de l'homme rouge, urss, staline, stalinisme, communisme, totalitarisme, grande guerre patriotique, kremlin, mikhaïl gorbatchev, perestroïka, loubianka, nkvd
lundi, 18 janvier 2016
ACTUALITÉ DE GUY DEBORD
Dans son Journal de 1988, Philippe Muray cite à plusieurs reprises l’ouvrage de Guy Debord paru cette année-là : Commentaires sur La Société du spectacle. Cela m’a donné envie d’y retourner pour jeter un œil. On sait que La Société du spectacle date de 1967. Les Commentaires examinent ce qu’il en est advenu de cette société vingt ans après. Et l’on peut dire que le constat fait frémir. Ajoutons que Debord se contente, précisément, de constater : « Les présents commentaires ne se soucient pas de moraliser. Ils n’envisagent pas davantage ce qui est souhaitable, ou seulement préférable. Ils s’en tiendront à ce qui est » (Guy Debord, Œuvres, Gallimard/Quarto, p. 1595).
On peut dire que l’évolution irrésistible du système, dont il faisait déjà une critique radicale, a comblé toutes les attentes que l’auteur avait placées en elle, et même au-delà. D’après ce que j’ai pu en comprendre, le « spectacle », dans le vocabulaire de Debord, n'a pas grand-chose à voir avec les maisons de théâtre, de cinéma ou d’opéra. Je me rappelle une émission de Bernard Pivot consacrée à La Société du spectacle, où ce grand couillon de Franz-Olivier Giesbert faisait l'énorme contresens habituel de tout confondre. Le malentendu demeure profond.
Pour reformuler dans mes propres termes ce que je pense avoir compris de ce concept de « spectacle », je dirai que c’est très généralement l’instauration d’une relation de plus en plus impossible entre les hommes et le monde, une relation non plus immédiate, comme depuis des millénaires, c’est-à-dire où rien ne vient s’interposer entre l’individu et le monde, mais médiate. Une relation désormais induite par une représentation artificielle (le "spectacle" ?), elle-même produite en dehors, puis introduite à l'intérieur de l’esprit par une instance tierce.
Le « spectacle », c’est cette représentation (ce discours, ce pouvoir) qui s’impose pour faire écran entre l’individu et le monde. Qui prépare et canalise en amont l’expérience que l’individu peut avoir du monde. Qui formate sa perception. Ce discours fonctionne comme un conditionnement préalable de l’esprit, dont le résultat est illustré par ce « proverbe africain » : « Le touriste ne voit que ce qu’il sait », qu’on pourrait traduire ainsi : « L’individu ne consiste désormais qu'en ce qu’on lui a précédemment inculqué ». Le système a inventé l'homme-ectoplasme.
On pourrait même dire que l’individu, dans sa mémoire et dans ses affects, n’est plus composé que des éléments dont on l'a fabriqué : il ne s’appartient plus. Il voit, entend, réfléchit, avec les yeux, les oreilles et le cerveau qu’on lui a greffés sans qu'il s'en aperçoive. Le sommet du grand art dans la fabrication de l’ "Homme Nouveau", dont rêvèrent Hitler et Staline, mais de façon combien fruste et grossière ! La principale caractéristique du discours ainsi médiatisé qui préside à cet endoctrinement et qui façonne la façon dont l’individu va percevoir et expérimenter le monde, est d’émaner d’un Pouvoir. Etant entendu que les « médias » ne sont qu’un aspect particulier, le plus visible, du système élaboré par et pour le maintien de ce Pouvoir : il faut deviner l'énorme masse de glace de l'iceberg systémique qui se cache sous la surface.
Autrement dit, tout ce qui descend du « spectacle » en direction de « la plèbe des spectateurs », « ce sont des ordres ». Et l’individu n’a d’autre choix que d’obtempérer, obéir, se soumettre, puisque le monde est ainsi fait, n'est-ce pas. Puisqu’il est convaincu d’avance qu’il serait vain d’essayer de le changer. Puisque l’idée même que cela fût possible, qu’on le pût ou qu’on le dût ne lui effleurerait jamais l’esprit.
Mais dans ses Commentaires, Debord ajoute une nouvelle forme de « pouvoir spectaculaire » aux deux que le précédent ouvrage avait mises au jour. Il y parlait de la « concentrée », brillamment illustrée au cours du 20ème siècle par les grandes aventures hitlérienne et stalinienne. Il y parlait de la « diffuse », portée par la civilisation américaine, qui avilit l’idéal de Liberté en le réduisant à la médiocre « liberté de choix », c’est-à-dire une liberté dégénérée, une liberté de basse-cour.
En 1988, pour compléter le tableau, il définit un pouvoir « spectaculaire intégré », qui est une combinaison des deux autres, et qu'il voit déjà partie à la conquête du monde. Le « spectaculaire intégré » emprunte au « concentré » l’autoritarisme, mais en le dissimulant : « … le centre directeur en est devenu occulte … » (on pense au "gouvernement invisible" appelé de ses vœux par le grand-prêtre de la publicité contemporaine, Edward Bernays : comment se révolterait-on contre une "Société Anonyme" ? A qui, en effet, pourrait-on s'en prendre nommément ?) ; et au « diffus » le formatage généralisé des comportements et des choses : « Car le sens final du spectaculaire intégré, c’est qu’il s’est intégré dans la réalité même à mesure qu’il en parlait ; et qu’il la reconstruisait comme il en parlait ».
L’effet magistral ainsi obtenu est l’escamotage pur et simple de la réalité, le monde concret, les choses enfin, comment qu’on les nomme. Le dur sur lequel je me cogne. Les épines des églantiers qu’il ne faut pas hésiter à affronter bravement si l’on tient vraiment à la confiture succulente qui en découlera après un processus compliqué : tout salaire mérite sa peine. Maintenant, l'artifice absolu est devenu le monde dans lequel nous vivons tous les jours, incluant jusqu'à nos mots, nos images et nos existences. J’avais lu, à publication, Le Crime parfait, de Jean Baudrillard, qui décrivait la même mise à mort, quoiqu’en termes différents (vocabulaire, syntaxe et perspective, j'avoue que j'ai un peu oublié).
Et Guy Debord ajoute, pour parfaire le triptyque de ses « pouvoirs spectaculaires » : « Quand le spectaculaire était concentré la plus grande part de la société périphérique lui échappait ; et quand il était diffus, une faible part ; aujourd’hui rien ». Traduction proposée : en régime dictatorial, il suffit de se maintenir en dessous de la couverture radar pour rester à peu près peinard. En régime capitaliste à l’américaine, on a du mal à échapper à la marchandise et à son cortège de servitudes.
Mais alors là, en régime de « spectaculaire intégré » (déjà en 1988), impossible d’échapper aux griffes propagandistes de Moloch-Baal et au formatage et au conditionnement précis qu’il fait subir à tous ceux qui entrent sur la planète, planète qui leur apparaîtra forcément sous les traits du « monde tel qu’il est ». Et là, quel Michel Foucault, quel Jacques Derrida, quel Gilles Deleuze, ces champions de la "Déconstruction" de tout ce qui faisait notre civilisation, déconstruiront, mais à l'envers, leurs représentations pour leur dévoiler la vérité ?
Ils seront tenus dans la complète ignorance du nombre et de la qualité des opérations successives d’usinage dont ils seront le résultat. Ils auront beau être fils de leur mère, ils ne sauront jamais de quel processus ils sont l’aboutissement. Ils seront ce qu’on leur aura dit qu’ils sont et préparés à être. A moins de s’appeler Winston Smith (dans 1984 de George Orwell).
En fait, je ne voulais pas, en me lançant dans ce billet, brasser toutes ces matières. Je voulais seulement partager avec quelques lecteurs un paragraphe qui a littéralement explosé sous mes pas quand je suis passé dessus. Se souvenir, avant de le lire, qu’il fut publié en 1988 (le livre sort en mai, l’attentat de Lockerbie se situe en décembre). C’est vrai, on parlait déjà de terrorisme (OLP, FPLP, FPDLP, et leurs frères, leurs cousins, leurs conjoints, leurs alliés, …). Mais dites-moi si ce paragraphe ne sonne pas étrangement.
« Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi, le terrorisme. Elle veut en effet être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. L’histoire du terrorisme est écrite par l’Etat ; elle est donc éducative. Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que, par rapport à ce terrorisme, tout le reste devra leur sembler plutôt acceptable, en tout cas plus rationnel et plus démocratique. »
Dites, je ne sais pas vous, mais moi, j’aimerais savoir ce qu’il buvait comme café pour lire dans ce marc extralucide. Car derrière « tout le reste », j’entends toute l’entreprise actuelle de Hollande et consort pour amoindrir le poids du pouvoir judiciaire et pour accroître celui de l’administration policière de la vie collective.
J’ai peur pour l’état de droit.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe muray, muray journal intime, muray ultima necat, éditions belles lettres, littérature, guy debord, la société du spectacle, commentaires sur la société du spectacle, gallimard quarto, philosophie, société, système capitaliste, situationnistes, hitler, staline, totalitarisme, michel foucault, jacques derrida, gilles deleuze, 1984 george orwell, terrorisme, françois hollande, état d'urgence, état policier, politique, franz-olivier giesbert
mercredi, 09 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 4/9

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS
ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
4/9
De pouvoir (ou non) supporter la laideur.
Héritier fidèle, viscéral et obstiné de ces Lumières-là, je demeure un fervent partisan de la liberté en tout, mais, soit dit une fois pour toutes, une liberté régulée. Une liberté contenue dans des bornes. Une liberté qui accepte de se restreindre. Tout n’est pas permis à l’homme, qu’il soit un individu, une collectivité, une société, un Etat, une entreprise. Tous les désirs n'ont pas à être réalisés au prétexte que c'est techniquement possible, que l'occasion s'en présente ou parce que, « après tout, j'y ai droit ».
Même Dieu en personne n'a pas le droit de tout faire, contrairement à ce que serine le Coran (par exemple : « Décide-t-Il d'une chose ? Il Lui suffit de dire : "Sois", et elle est », sourate XL, verset 68). L’individu est doté de liberté, de désirs et de conscience, oui, entièrement d’accord, mais il est aussi socialisé, je veux dire conscient de ses limites et de ses responsabilités à l'égard de ce qui rend sa vie possible, car il reste conscient qu'il n'est rien sans son lien avec le corps social : ça lui confère des droits, mais sûrement pas rien que des ou tous les droits. Je ne suis peut-être pas qualifié pour énumérer les caractères de ce qui fait une civilisation, mais j'ai l'impression d'en avoir dessiné ci-dessus quelques traits caractéristiques.
Autant le dirigisme et l'autoritarisme (quand un autoproclamé se met à parler à l'impératif) sont faits pour maintenir l'individu dans la sujétion, la frustration, la peur et l'immaturité, autant la permissivité, le laxisme, la dérégulation à tout va, qu’il s’agisse d’un individu, d’un Etat, de l'économie ou d’une entreprise, sont des facteurs de déliaison, de morcellement de l'entité collective, d’atomisation des individus, de désagrégation du « corps social » en une infinité d'unités autonomes. Oui, pour qu’il y ait société, il y a des limites à ne pas franchir.
Je dis cela en pensant à tous les fanatiques de la « transgression dérangeante », les adeptes de l’infraction innovante, de la provocation révolutionnaire et de l'outrage rédempteur, les casseurs de normes et de frontières et autres conformistes de l’anticonformisme, je veux dire ceux qui occupent en masse le haut du pavé de tous les terrains culturels subventionnés, de la danse au théâtre, en passant par l’opéra, la musique, la peinture et tout le reste. Toutes ces quilles que la boule impitoyable de Philippe Muray (il les traitait fort pertinemment de « Mutins de Panurge », cette formule géniale) n'a malheureusement pas réussi à abattre. Le pouvait-elle ?
Au surplus, j'ajoute que si je sais que l'intention prioritaire de l'artiste est par-dessus tout de me "déranger", de me provoquer ou de me choquer, je discerne la visée manipulatrice : pas de ça, Lisette ! Fous le camp ! Pauvre artiste en vérité qui se donne pour seul programme de modifier son public (c'était ce que voulait déjà Antonin Artaud, avec son "théâtre de la cruauté", Les Cenci et tout ça ... On a vu comment il a fini. Dire qu'il fascinait les élites culturelles !).
Pauvre artiste, qui se soucie moins de ce qu'il met dans son œuvre que de l'effet qu'elle produira : l'œuvre en question est ravalée au rang de simple instrument de pouvoir. Mégalomanie de l'artiste à la mode (c'était quand, déjà : « Sega, c'est plus fort que toi » ?), ivresse de puissance et, en définitive, un pauvre illusionniste qui s'exténue à chercher sans cesse de nouveaux « tours de magie » pour des gogos qui applaudissent, trop heureux d'y croire un moment, avant de retomber dans la grisaille interminable « d'un quotidien désespérant » (Brassens, "Les Passantes"). Après tout, ça leur aura "changé les idées" !
Je préfère que l'artiste ait le désir, l'énergie et le savoir-faire de créer à mon intention une forme qui me laisse libre de l'apprécier à ma guise. C'est ce que formule Maupassant dans la préface à son roman Pierre et Jean : « En somme, le public est composé de groupes nombreux qui nous crient : "Consolez-moi. Amusez-moi. Attristez-moi. Attendrissez-moi. Faites-moi rêver. Faites-moi rire. Faites-moi frémir. Faites-moi pleurer. Faites-moi penser." – Seuls, quelques esprits d'élite demandent à l'artiste : "Faites-moi quelque chose de beau, dans la forme qui vous conviendra le mieux, suivant votre tempérament" ». C'est parler d'or.
Voilà un programme qu'il est bon, nom de Zeus ! Je vois bien la contradiction : faut-il que l'artiste se retire dans son laboratoire pour peaufiner son grand œuvre sans se soucier de sa réception ? Faut-il qu'il cherche à plaire, à impressionner, en pensant à un public précis sur la plasticité et la réceptivité duquel il sait qu'il peut compter ? Il y a dilemme : y a-t-il pour autant incompatibilité ? J'essaie de répondre à la question dans un très prochain billet.
Vouloir agir sur le spectateur, c'est une intention de bas étage, de bas-côté, et même de bas-fond (au point que : « ... à peine si j'ose Le dire tellement c'est bas », Tonton Georges, "L'Hécatombe"). La création d'une forme, c'est une autre paire de manches. Les "transgresseurs" sont finalement des pauvres types, des médiocres, des minables destinés à disparaître au moment même de leur épiphanie.
Pour revenir à l'atomisation du corps social, je signale accessoirement que faire des individus autant d’entités autonomes, dégagées de tout apparentement est une visée propre à ce qu’on appelle le totalitarisme. Si on n’y est pas encore, on n’en est pas loin. Le totalitarisme, tout soft, invisible et sournois qu’il soit, dont est imprégnée à son insu notre démocratie (acharnée à nier et refouler cet inconscient-là) ; la frénésie et l’enthousiasme technicistes qui ont fait de l’innovation le seul idéal social encore agissant ; l’ultralibéralisme économique qui instaure la compétition comme seul horizon collectif et la marchandise comme unique accomplissement individuel, voilà, en gros, les trois facettes de notre condition humaine qui ont fini par se fondre dans mon esprit en un tout où l’humanité de l’homme n’a plus sa place. Inutile de le cacher : c’est une vision pessimiste.
Le pire, c’est que ce sont toutes les conditions de la vie collective qui me sont alors apparues comme affreuses. Ceci est assez difficile à exprimer en termes clairs : j’ai eu l’impression (fondée ou erronée, va savoir ...) d’acquérir progressivement une vue globale de la situation imposée à l’humanité par la « modernité ». J’ai acquis la conviction que les formes de ce qu’on appelle depuis plus de soixante ans l’ « art contemporain » ne sont pas une excroissance anormale de leur époque mais, au contraire, leur corollaire absolument logique. La même logique qui fait que l'arbre produit son fruit, et que l'Allemagne en crise produit Hitler. Eh oui, la difformité et l'aberration sont elles aussi produites, et ne sortent pas de nulle part.
Qui adhère avec enthousiasme à l’époque, est logiquement gourmand d’art contemporain, de musique contemporaine. Qui est rebuté par l’art contemporain, en toute logique, devrait diriger sa vindicte contre l’époque dont celui-ci est issu. J’ai mis du temps, mais j’ai fini par y venir. C’est alors que le processus de désaliénation (désintoxication si l’on veut) a pu s’enclencher : qui n’aime pas l’époque ne saurait aimer l’art qu’elle produit. Le lien de cause à effet est indéniable. Moi, je croyais aimer l’art de mon temps parce que je voulais être de mon temps. C’était décidé, il le fallait.
L’art contemporain découle de son époque. Tout ce qui apparaît minable dans l’art contemporain découle logiquement du minable de l’époque qui le produit. Ce n’est pas l’art qui pèche : c’est l’époque. Nous avons l’art que notre époque a mérité. Quand la laideur triomphe, c’est que l’époque désire la laideur : le vert « plug anal » géant de Paul McCarthy en pleine place Vendôme, précisément la place de Paris où sont fabriqués et exposés parmi les plus beaux, les plus précieux bijoux du monde, est logiquement produit par l’époque qui l’a vu naître. Les extrêmes – le sublime et la merde – se tiennent par la barbichette (que le sublime qui n'a jamais tiré la barbichette du merdique avance d'un pas, tiens, il va voir !). Quand il y a neuf « zéros » après le « un » de la fortune, la merde et le diamant se valent. On croit deviner que c'est en toute logique que le bouchon d'anus (sens de "plug") de M. McCarthy suscite l'émoi "esthétique" de la dame qui porte la présente bague (à propos de bague, cf. l'autrement élégante histoire de "L'anneau de Hans Carvel", qu'on trouve chez Rabelais, Tiers Livre, 26, qui donne une recette infaillible à tous les maris qui ne supportent pas l'idée que leur épouse les fasse un jour cocus).
laideur triomphe, c’est que l’époque désire la laideur : le vert « plug anal » géant de Paul McCarthy en pleine place Vendôme, précisément la place de Paris où sont fabriqués et exposés parmi les plus beaux, les plus précieux bijoux du monde, est logiquement produit par l’époque qui l’a vu naître. Les extrêmes – le sublime et la merde – se tiennent par la barbichette (que le sublime qui n'a jamais tiré la barbichette du merdique avance d'un pas, tiens, il va voir !). Quand il y a neuf « zéros » après le « un » de la fortune, la merde et le diamant se valent. On croit deviner que c'est en toute logique que le bouchon d'anus (sens de "plug") de M. McCarthy suscite l'émoi "esthétique" de la dame qui porte la présente bague (à propos de bague, cf. l'autrement élégante histoire de "L'anneau de Hans Carvel", qu'on trouve chez Rabelais, Tiers Livre, 26, qui donne une recette infaillible à tous les maris qui ne supportent pas l'idée que leur épouse les fasse un jour cocus).
 Paul McCarthy est l’humble serviteur de son temps : son œuvre est le revers infâme de la médaille dont la maison Van Cleef & Arpels (ci-contre) décore si luxueusement l’avers. Paul McCarthy est un artiste rationnel : il ne fait que tirer les conclusions qu’on lui demande de tirer. Son message ? "Parlant par respect", comme dit Nizier du Puitspelu dans son très lyonnais Littré de la Grand’Côte, quand il définit des mots et expressions "grossiers" : « Vous l’avez dans le cul ».
Paul McCarthy est l’humble serviteur de son temps : son œuvre est le revers infâme de la médaille dont la maison Van Cleef & Arpels (ci-contre) décore si luxueusement l’avers. Paul McCarthy est un artiste rationnel : il ne fait que tirer les conclusions qu’on lui demande de tirer. Son message ? "Parlant par respect", comme dit Nizier du Puitspelu dans son très lyonnais Littré de la Grand’Côte, quand il définit des mots et expressions "grossiers" : « Vous l’avez dans le cul ».
Mais si l’on admet que c’est l’époque qui produit cet art déféqué, c’est moins l’art qui est à dénoncer que l’époque qui l’a vu et fait naître, tout entière. De fait, ce n’est pas seulement l’art contemporain, la musique contemporaine, c’est le 20ème siècle dans son entier qui m’est devenu monstrueux. J’ai compris que Günther Anders avait raison : au 20ème siècle, l’humanité a commencé à méticuleusement édifier la laideur d'un monde d’une dimension telle que nulle force humaine n’était plus en mesure d'en comprendre le sens, encore moins d’en contrôler la trajectoire, et encore moins d'y vivre heureux.
Et le raisonnement qu’il tient à propos de la bombe atomique s’applique à tous les autres aspects du « Système » mis en place : c’est le bateau Terre qui, faute de pilote, est devenu ivre.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : siècle des lumières, liberté égalité fraternité, france, dieu, allah, coran, islam, maupassant, préface pierre et jean, georges brassens, totalitarisme, hitler, paul mccarthy, mccarthy plug anal, place vendôme, van cleef & arpels, lyon, nizier du puitspelu, littré de la grand'côte, l'obsolescence de l'homme, brassens l'hécatombe, brassens les passantes, élections régionales, jean-pierre masseret, politique, günther anders
mardi, 08 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 3/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
3/9
De l'importance de la lecture.
Ce qui est sûr, c’est que l’art contemporain, la musique contemporaine, la poésie contemporaine (en ai-je bouffé, des manuscrits indigestes, futiles, vaporeux ou dérisoires, au comité de lecture où je siégeais !), tout cela est tombé de moi comme autant de peaux mortes. De ce naufrage, ont surnagé les œuvres de quelques peintres, de rares compositeurs, d’une poignée de poètes élus. Comme un rat qui veut sauver sa peau, j’ai quitté le navire ultramoderne. J'ai déserté les avant-gardes. C’est d’un autre rivage que je me suis mis à regarder ce Titanic culturel qui s’enfonçait toujours plus loin dans des eaux de plus en plus imbuvables.
Comment expliquer ce revirement brutal ? Bien malin qui le dira. Pour mon compte, j’ai encore du mal. Je cherche. Le vrai de la chose, je crois, est qu’un beau jour, j'ai dû me poser la grande question : je me suis demandé pourquoi, tout bien considéré, je me sentais obligé de m’intéresser à tout ce qui se faisait de nouveau.
Mais surtout, le vrai du vrai de la chose, c’est que j’ai fait (bien tardivement) quelques lectures qui ont arraché les peaux de saucisson qui me couvraient les yeux quand je regardais les acquis du 20ème siècle comme autant de conquêtes victorieuses et de promesses d'avenir radieux. J’ai fini par mettre bout à bout un riche ensemble homogène d’événements, de situations, de manifestations, d’analyses allant tous dans le même sens : un désastre généralisé. C’est alors que le tableau de ce même siècle m’est apparu dans toute la cohérence compacte de son horreur, depuis la guerre de 14-18 jusqu’à l’exploitation et à la consommation effrénées des hommes et de la planète, jusqu'à l’humanité transformée en marchandises, en passant par quelques bombes, quelques génocides, quelques empoisonnements industriels.
 Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
A tort ou à raison, j’ai conclu de cette lecture décisive qu’Hitler et Staline, loin d’être les épouvantails, les effigies monstrueuses et retranchées de l’humanité normale qui en ont été dessinées, n’ont fait que pousser à bout la logique à la fois rationnelle et délirante du monde dans lequel ils vivaient pour la plier au fantasme dément de leur toute-puissance. Hitler et Staline, loin d’être des monstres à jamais hors de l’humanité, furent des hommes ordinaires (la « Banalité du Mal » dont parle Hannah Arendt à propos du procès Eichmann). Il n'y a pas de pommes s'il n'y a pas de pommier. Ils se contentèrent de pousser jusqu’à l’absurde et jusqu’à la terreur la logique d’un système sur lequel repose, encore et toujours, le monde dans lequel nous vivons.
Hitler et Staline (Pol Pot, …) ne sont pas des exceptions ou des aberrations : ils sont des points d’aboutissement. Et le monde actuel, muni de toutes ses machines d’influence et de propagande, loin de se démarquer radicalement de ces systèmes honnis qu’il lui est arrivé de qualifier d’ « Empire du Mal », en est une continuation qui n’a eu pour talent que de rendre l’horreur indolore, invisible et, pour certains, souhaitable.
Un exemple ? L’élimination à la naissance des nouveau-nés mal formés : Hitler, qui voulait refabriquer une race pure, appelait ça l’eugénisme. Les « civilisés » que nous sommes sont convenus que c’était une horreur absolue. Et pourtant, pour eux (pour nous), c’est devenu évident et « naturel ». C’est juste devenu un « bienfait » de la technique : permettre de les éliminer en les empêchant de naître, ce qui revient strictement au même. C’est ainsi que, dans quelques pays où la naissance d’une fille est une calamité, l’échographie prénatale a impunément semé ses ravages.
 D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système
D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
Je citerai une troisième facette de ladite évolution : une réflexion tirée d’ouvrages d’économistes, parmi lesquels ceux du regretté Bernard Maris (à  commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
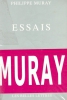 J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
Mais je dois reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
 Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude
Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
L'Histoire (le Pouvoir, la Politique), la Technique, l'Economie, donc : la trinité qui fait peur.
Restent les Lumières originelles : étonnamment et bien que je ne sache pas si le résultat est très cohérent, au profond de moi, elles résistent encore et toujours à l'envahisseur. Sans doute parce qu'en elles je vois encore de l'espoir et du possible.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, avant-garde, titanic, hannah arendt, les origines du totalitarisme, nazisme, staline, hitler, totalitarisme, stalinisme, banalité du mal, jacques ellul, le système technicien, le bluff technologique, günther anders, l'obsolescence de l'homme, bernard maris, charlie hebdo, antimanuel d'économie, jean-marc sylvestre, ultralibéralisme, philippe muray, l'empire du bien, exorcismes spirituels, éditions les belles lettres, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, une paire de bottes vaut shakespeare, éditions gallimard, george orwell essais articles lettres, jean-claude michéa, l'enseignement de l'ignorance, le moi assiégé, christopher lasch, la culture du narcissisme, michel houellebecq, la carte et le territoire, éditions l'encyclopédie des nuisances
vendredi, 13 novembre 2015
LA MORT DE STALINE
On est le 28 février 1953, à la Maison de la Radio du Peuple, à Moscou. Au programme du concert, le concerto pour piano de Mozart n°23. Au piano, Maria Ioudina. Le concert est diffusé en direct. Tout s’est bien passé, et les musiciens s’apprêtent à rentrer chez eux. Mais le directeur a donné l’ordre aux sentinelles d’empêcher toute sortie.
Car le directeur est tout près de faire dans sa culotte : il a reçu un coup de fil qui lui a enjoint de téléphoner à un certain numéro. « Dans exactement 17 minutes ». S’exécutant, il entend la voix de Staline en personne : « J’ai beaucoup aimé le concerto de ce soir. Je souhaite en recevoir un enregistrement. On viendra le chercher demain ». Le ciel lui tomberait sur la tête, le directeur ne serait pas plus épouvanté.
Car les techniciens, comme à l’habitude en cas de direct, n’ont rien enregistré. Conclusion du directeur : « On va tous mourir ». Et Staline est injoignable : « Le numéro que vous avez demandé n’est plus attribué ». Seule solution : rejouer. Les musiciens de l’orchestre savent trop ce qu’ils risquent s’ils refusent. Seule la pianiste exclut résolument cette possibilité : « Tu veux tous nous faire tuer ? – Bien sûr qu’on veut jouer », lui lancent les autres. Elle acceptera, contre 20.000 roubles.
Ensuite, c’est le chef qui s'écroule victime d'un malaise, tétanisé par la perspective de diriger « … pour Staline … pour Staline … pour Staline … ». On réveille un sous-chef qu’on emmène de force jusqu’à la salle : il dirigera en robe de chambre. Quand les agents du NKVD se présentent pour réceptionner le disque, la pianiste Maria Ioudina glisse dans la pochette un petit mot destiné à Staline : « Cher camarade Staline, Je vais prier pour vous, jour et nuit, et demander au Seigneur qu’Il vous pardonne vos lourds péchés envers le peuple et la nation … ».
Il écoute le début du disque, tout en froissant rageusement le papier, sans doute en méditant le sort affreux qu'il fera subir à l'insolente. Mais il ne fera plus mal à personne : une attaque le terrasse brutalement. Il ne s’en relèvera pas. Il meurt officiellement le 5 mars. Il y eut vraiment une Maria Yudina (1899-1970), grande pianiste russe, la préférée de Staline. Une autre notice indique : « ... elle passe pour avoir été la seule pianiste que supportait Staline qui l'aurait convoquée en pleine nuit au Kremlin avec un orchestre pour jouer le concerto K. 488 de Mozart » (soit dit en passant, c'est bien le n°23). Son mot adressé au « Petit Père des peuples » est-il historique ? A-t-il causé, directement ou non, sa mort ? Je n’en sais rien, et peu importe.

En tout cas, c’est ainsi que commence La Mort de Staline, de Nury et Robin, admirable volume de bandes dessinées. Admirable introduction : bienvenue dans l'enfer rouge. Les auteurs mettent en pleine lumière l’ambiance de terreur qui règne partout, et même (et surtout) au sommet du pouvoir, à l’époque où le dictateur semble tout-puissant, où chacun sait et sent que la moindre erreur, la moindre imprudence peuvent conduire à la mort, au goulag, en tout cas à l’arbitraire total de la volonté d’un seul.
C'est clair : dans un tel système, tout le monde tremble comme une feuille. Avec raison : tous les témoins de la fin de Staline sont embarqués dans des camions militaires, en direction, on s'en doute, des glaces de la Sibérie et des sévérités du Goulag, voire pire. Béria exige de Lydia Timotchouk qu'elle lui envoie les meilleurs médecins au chevet de Staline, au simple motif que c'est elle qui a dénoncé tous les médecins qui ont, sur sa simple accusation, été condamnés dans l'affaire dite des « blouses blanches ». Béria a barre sur elle, depuis le 17 janvier 1938, « date à laquelle je t'ai baisée par tous les trous ». Il est bien entendu qu'aucun des médecins, aucun des témoins de tout ça, ne sortiront vivants de l'événement.
La BD s’est mise au diapason : à sujet brutal, traitement brutal. Les silhouettes, les faits et gestes sont dessinés au couteau. Les traits sont accusés, les visages sont constamment traversés des grandes balafres qu’y tracent les passions mauvaises. Tout est crade et impitoyable dans cette histoire noire, pleine de menaces, de coups bas et de cruautés. Le régime totalitaire dans toute sa splendeur, tel que décrit par Hannah Arendt : délation, espionnage de tous à tout instant, intérêts sordides promus raison d’Etat, caprices des puissants et bassesses en tout genre.
L’histoire, c’est celle qui se déroule après l’agonie et la mort de Staline (qui avait commencé simple braqueur de banque). L’URSS est un bloc de glace dans lequel pas une oreille ne consent à bouger si elle n’a pas l’autorisation expresse de son supérieur hiérarchique. L’ombre de Staline s’appelle Béria. Quand le maître a son attaque, l’ombre en question voit soudain son horizon s’ouvrir. Il n’attendait que ce moment pour enfin passer du rang de dieu subalterne à celui de dieu en chef.


Il ne néglige aucune précaution : occupé à se servir du corps d’une fille au moment où il reçoit l’appel fatal, il ordonne à ses sbires, qui lui demandent quoi faire d’elle : « Ramenez-la chez elle… Arrêtez son père ». Plus fort et plus terrible : arrivé chez Staline pour se rendre compte de l'état de celui-ci, et avant même de prévenir les autres responsables, il met la main sur tout un tas de dossiers qui compromettent ses rivaux potentiels du « Conseil des ministres » (Krouchtchev, Malenkov, Mikoyan, Boulganine, Molotov, …), espérant que le chantage les musellera.
Pas de chance pour lui : ceux-ci se liguent contre lui et préparent longuement le moment où ils le jetteront bas. Béria finit misérablement fusillé dans un sous-sol. Quant aux comploteurs, ils sont désormais les maîtres. Ils ne veulent surtout pas changer quoi que ce soit au mode de fonctionnement de l’URSS : ils se sont juste réparti les rôles, dans un nouvel équilibre des forces. « Vers un avenir radieux » (dixit Béria, au moment où les balles le traversent).
Plusieurs épisodes sont absolument glaçants. Les trains étant immobilisés pour éviter toute manifestation de masse, le peuple, à l'annonce de la mort de Staline, marche vers Moscou pour rendre hommage à son idole : la police tire dans le tas. Ailleurs, c'est l'équipe des médecins convoqués autour du dictateur, tous pétrifiés de peur, puis embarqués vers le goulag ou la mort après la mise en bière du corps, en compagnie de tout le personnel civil, y compris la gouvernante du défunt, fidèle et effondrée de chagrin. Ailleurs encore, ce sont les principaux comploteurs qui, pour mettre au point la chute de Béria, se réfugient sur le balcon, parce que l'intérieur est truffé de micros. C'est là qu'ils évoquent les listes à constituer des gens à éliminer : « Bien sûr ... Une purge complète, comme on a fait en 36 avec Staline. (...) De très longues listes, où l'on n'oubliera personne ».

L'implacable et très juste récit d'une époque et d'un système terribles. Inhumain. Mais on le sait : tout ce qui est inhumain est humain.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, nury robin la mort de staline, éditions dargaud, stalinisme, communisme, totalitarisme, urss, moscou, kremlin, béria, mozart concerto 23 k 488, maria youdina, nkvd, krouchtchev, molotov, joukov, malenkov, mikoyan, histoire, musique
mercredi, 02 septembre 2015
KADARÉ : LE PALAIS DES RÊVES
 MES LECTURES DE PLAGE 2
MES LECTURES DE PLAGE 2
C’est l’histoire de Mark-Alem Kuprili qui, grâce à l’appui de son oncle le Vizir, devient un fonctionnaire de l’Etat dans cette vaste institution qui s’appelle le « Palais des Rêves ». Nous sommes dans l’empire ottoman. Il me semble que le palais est évoqué dans La Niche de la honte. Ce roman est formidable, y compris au sens étymologique du mot. A cause de son actualité : nous ne vivons pas dans un régime totalitaire, mais.
Les Kuprili sont une vieille et grande famille qui a donné à l’Etat cinq premiers ministres et une foule d’autres serviteurs à des rangs moins en vue : « … cette famille qui, aujourd’hui encore, malgré son relatif effacement, demeurait l’un des piliers de l’Empire, la première à avoir lancé l’idée de la reconstruction du grand Etat sous la forme des E.U.O. (Etats-Unis ottomans), la seule famille, avec la dynastie impériale, à figurer dans le Larousse, et cela à la lettre K, avec la notice suivante : "KÖPRÜLÜ : grande famille albanaise dont cinq membres furent, de 1666 à 1710, grands vizirs de l’empire ottoman", famille à la porte de laquelle, enfin, venaient frapper timidement les hauts fonctionnaires de l’Etat pour solliciter protection, avancement, intercession en vue d’une grâce … ». Mon Larousse 1903 confirme à peu près, sauf qu’il date le début de cette puissante famille de 1656. Et qu’il orthographie le nom « Kupruli ou Koproli ».
Mark-Alem pénètre donc un jour dans ce fameux et redouté Palais des Rêves comme un tout petit fonctionnaire. La première impression est qu’il entre dans un désert absolument immense, où il a d’abord le sentiment angoissant de se perdre, tant à cause des dimensions prodigieuses de l’édifice que de l’absence totale d’indications qui lui permettraient de s’orienter.
Il tombe presque par hasard sur un responsable, qui semble ne pas le voir puis qui, ayant pris la lettre de recommandation donnée par l’oncle, la brûle instantanément : « Au Tabir Sarrail, on n’accepte pas les recommandations, c’est foncièrement contraire à l’esprit de cette institution ». Inquiet, Mar-Alem écoute la suite : « Le fondement du Tabir Sarrail est non point l’ouverture, mais, au contraire, la fermeture aux influences extérieures, non point l’ouverture, mais l’isolement, et, partant, non pas la recommandation, mais précisément son opposé. Malgré tout, à compter d’aujourd’hui, tu es nommé à ce Palais ». Que peut bien être l’opposé de la recommandation ? Passons.
Mark-Alem est d’abord affecté au service de la Sélection (pas tout à fait en bas de l’échelle, puisqu’il est supérieur aux simples copistes). Il s’assied à la place qui lui est assignée, tout comme les innombrables employés du service déjà au travail. Il s’agit de faire le tri, dans l’épais dossier qui lui est confié, des récits de rêves qui sont parvenus au Palais des endroits les plus reculés de l’Empire. Car tous les sujets sont tenus, lorsqu’ils font un rêve qui leur semble particulièrement signifiant, de rejoindre l’office de collecte le plus proche de leur domicile et de le raconter au fonctionnaire préposé à cette tâche, qui le transcrit fidèlement, et cela quel que soit le temps ou la saison.
La date, le lieu, le nom du rêveur sont soigneusement précisés sur la feuille. Un service de voitures a pour tâche exclusive de réceptionner régulièrement les rêves produits et de les acheminer à la capitale, où un personnel ad hoc est là vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour les rassembler en de volumineux dossiers. Certains rêves recèlent un contenu tellement épouvantable que le cheval refuse obstinément d'avancer : une procédure exceptionnelle permet de le retirer et de le détruire.
La tâche de Sélection des rêves consiste à jeter les insignifiants et à conserver les autres pour les envoyer au service de l’Interprétation, auquel Mark-Alem ne tardera d’ailleurs pas à être affecté. Cette promotion l’étonnera. Mais la responsabilité est aussi plus grande : il s’agit de ne commettre aucun impair et aucune erreur, car le cheminement du rêve est soigneusement enregistré, étape par étape et fonctionnaire par fonctionnaire. Les erreurs d'appréciation peuvent être durement sanctionnées.
Les rêveurs eux-mêmes ne sont pas à l'abri de sanctions : Mark-Alem assiste à l’interrogatoire de l’un d’eux. Les policiers du rêve veulent en savoir plus. Après plusieurs dizaines de pages de procès-verbal et plusieurs jours d’interrogatoire, il voit sortir du bureau un cercueil porté par quatre hommes. On pense évidemment à la Loubianka et aux méthodes du KGB.
Les rêves se rangent ensuite dans quelques grandes catégories thématiques, qui vont du simple délire et du rêve fabriqué jusqu’au complot contre l’Etat. Régulièrement, parmi les dizaines ou centaines de milliers de rêves ainsi collectés, se voit élire le « Maître-Rêve », indispensable au Sultan dans la bonne administration de l’Empire, pour prévenir les problèmes ou pour déjouer les manœuvres qui pourraient viser à l’affaiblir ou à le renverser.
On l’a compris, Le Palais des Rêves raconte sur le mode fictionnel, comment se met en place une Police de la Pensée dans un régime totalitaire. Les décisions concernant les hommes tombent de tout en haut sans que quiconque puisse en comprendre le motif. L’arbitraire règne en maître. C’est ainsi que Mark-Alem, du rang de minuscule fonctionnaire qui était le sien au début, finira par être bombardé Directeur Général du Palais des Rêves, sans comprendre les raisons d’une telle faveur.
Mark-Alem a compris que sa puissance apparente est éminemment fragile. Il pense en effet à son oncle le Vizir qui, peut-être enivré de sa position dominante, s’est permis d’organiser dans son palais une fête grandiose au cours de laquelle il comptait faire chanter la grande ballade albanaise en l’honneur des Kuprili.
La sanction n’a pas tardé : alors que la fête bat son plein et que les musiciens s’apprêtent à se produire, une foule d’hommes en armes fait irruption. Les trois musiciens sont poignardés, le Vizir emmené. On apprendra plus tard qu’il a été proprement décapité. Comme quoi il n’y a pas qu’à Rome que « la roche tarpéïenne est proche du Capitole ».
Ismaïl Kadaré semble avoir pour obsession littéraire la description méticuleuse de la façon dont s’installe et perdure un système totalitaire, et des méthodes qui sont les siennes pour terroriser la population : les yeux se font inquiets quand on évoque le Palais des Rêves, qui semble enveloppé d’un mystérieux brouillard de crainte.
Beau livre, qui m’a fait penser (pour ce qui est du thème) à La Niche de la honte et à La Pyramide, du même auteur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, ismaïl kadaré, albanie, enver hodja, dictature, empire ottoman, totalitarisme, police de la pensée, la niche de la honte, le palais des rêves, urss, kgb, loubianka, kadaré la pyramide
lundi, 06 juillet 2015
ISMAÏL KADARÉ : LA PYRAMIDE
FEUILLETON GREC
La question est (aussi, entre autres) de savoir si François Hollande cessera enfin d'être le « Grand Léchant Mou » auquel la dernière élection présidentielle a condamné la France, et s'il osera mettre le poing sur la table en opposant, face à Merkel et compagnie, un VETO décidé à la sortie de la Grèce de la zone euro. Sois un homme, François, au moins une fois dans ta vie. Montre que tu en as ! On attend que tu dises à Angela Merkel : « Avant de bouter la Grèce hors d'Europe, il faudra que tu me passes sur le corps ». Il n'est d'ailleurs pas dit que Brünnhilde hésiterait à le faire. Ce serait même une occasion pour les caméras de télévision de fixer pour l'éternité une scène hautement historique. Et ... délectable. Et sans doute pornographique.
Vas-y, Grand Léchant Mou ! Te dégonfle pas !
******************************************
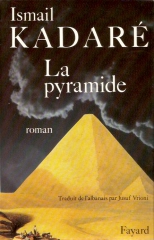 Ismaïl Kadaré vient de publier un petit ouvrage autobiographique où il est question de sa mère. Il paraît que c’est habituel : parvenu sur ses vieux jours, on a tendance à se retourner sur les premiers. Il a été traduit par Tedi Papavrami (né en 1971), le virtuose du violon. Je n’ai pas, au moins a priori, très envie de le lire (voir mes billets 28-29 mai et 17 juin). Kadaré est né dans la même ville d'Albanie du sud qu'Enver Hodja, le dictateur qui a terrorisé le pays : Gjirokastër.
Ismaïl Kadaré vient de publier un petit ouvrage autobiographique où il est question de sa mère. Il paraît que c’est habituel : parvenu sur ses vieux jours, on a tendance à se retourner sur les premiers. Il a été traduit par Tedi Papavrami (né en 1971), le virtuose du violon. Je n’ai pas, au moins a priori, très envie de le lire (voir mes billets 28-29 mai et 17 juin). Kadaré est né dans la même ville d'Albanie du sud qu'Enver Hodja, le dictateur qui a terrorisé le pays : Gjirokastër.
Heureusement, il a écrit beaucoup de beaux romans. Je viens de lire La Pyramide, aperçu dernièrement dans la vitrine du Livre à Lili, et acheté deux euros, en me disant que les livres ne valent plus grand-chose de nos jours : le prix des occasions en est un signe, qui invite à la mélancolie ceux qui ont toujours vécu entourés de bouquins.
La Pyramide raconte l’édification de la plus grande que l’Egypte ait jamais construite : celle de Chéops. Mais qu’on ne s’y trompe pas : malgré la solide documentation que Kadaré s’est procurée en égyptologie ancienne, ce n’est pas un livre sur l’histoire du pays : c'est bel et bien un roman, mais sur la façon dont procède, de la façon la plus générale, tout pouvoir totalitaire pour assujettir durablement la population. Après La Niche de la honte (l’empire ottoman, voir billet du 17 juin), nous voilà replongés dans le totalitaire, quoique d’une tout autre manière.
Tout l’argument du livre est contenu dans les quinze premières pages. Quand le pharaon déclare qu’il refuse de se faire construire un tombeau, les grands-prêtres du royaume sont catastrophés. Après s’être fiévreusement penchés sur les plus vieilles archives du royaume (les « vieux papyrus »), ils reviennent auprès de Chéops, dans le but de l’éclairer sur les véritables raisons qui ont poussé ses prédécesseurs et ses ancêtres à édifier chacun sa pyramide.
Et ce qu’ils ont trouvé dans les archives ne peut qu’intéresser le pharaon. Si les rois d’Egypte, depuis Djoser, ont tous tenu à avoir leur pyramide, « l’idée de cette construction n’avait à l’origine aucun rapport avec un tombeau ni avec le trépas ». Les prêtres ont conclu de leurs recherches que « l’idée de la pyramide, Majesté, a vu le jour en temps de crise ». Mais attention, pas n’importe quelle sorte de crise : une crise du pouvoir. Et ça, ça commence à l'intéresser, Chéops.
En effet, dans le passé, on s’est aperçu que, lorsque le pouvoir était affaibli, ce n’était pas à cause des mauvaises récoltes ou de la peste, mais au contraire, à cause de l’abondance et du bien-être ! On doit en déduire que le bien-être du peuple est nuisible au pouvoir : « … le bien-être, en rendant les gens indépendants, plus libres d’esprit, les faisait aussi plus rétifs à l’autorité en général et notamment au pouvoir pharaonien … ». Le message de l’astrologue envoyé au Sahara, pour méditer sur les solutions possibles, fut tout à fait clair : « … il fallait éliminer le bien-être ».
Oui, mais comment obtenir ce résultat de la manière la plus efficace ? Il fallait sans doute lancer le pays dans des travaux grandioses, dont les canaux mésopotamiens offraient alors un exemple. Sans compter tout le profit économique que le pays aux deux fleuves en a tirés.
Mais l’Egypte se devait de faire mieux : « Entreprendre une œuvre qui passât l’imagination, dont les effets seraient d’autant plus débilitants et anémiants pour ses habitants qu’elle serait plus colossale. Bref, quelque chose d’épuisant, de destructeur pour le corps et l’esprit, et d’absolument inutile. Ou, plus exactement, une œuvre aussi inutile pour les sujets qu’elle serait indispensable à l’Etat ». Quasiment une définition du totalitarisme.
Ce n’est qu’après cette intense réflexion qu’a germé l’idée de construire un tombeau monumental. Je passe sur les détails qui ont précédé le choix (un rempart autour de l’Egypte ? un trou sans fond ? …). Inutile d’ajouter que Chéops a vite fait de se convertir à l’idée de la pyramide, cette forme pointant vers le ciel avec lequel elle semble s’unir, et préparant la future célestisation du pharaon. Hemiounou le grand-prêtre ajoute, pour définir la fonction de la pyramide : « Au premier chef, elle est pouvoir, Majesté ». Bien vu.
Ce premier chapitre est un chef d'œuvre de mise en place romanesque. Il condense magistralement l’exposé des motifs de tout système totalitaire. Tout le reste du bouquin déroule avec méthode les implications logiques de la chose. Chaque chapitre vient préciser un aspect du système, si bien qu’au bout du compte, rien n’a été oublié.
Très vite, le peuple égyptien mesure le poids de la poigne de fer impitoyable qui vient de s’abattre sur lui : les moindres compartiments de l’existence de tous les individus ont été catalogués, et nul ne peut échapper à la case qu’on a prévue pour lui. Et la vie des individus ne pèse pas bien lourd, que ce soit entre les mains des policiers pharaoniques ou sur la trajectoire d'une pierre hors de contrôle (Kadaré semble avoir trouvé quelque par le nombre exact de ce qu'il a fallu pour édifier la pyramide).
Je n’ai pas envie d’inventorier toutes les richesses de ce livre. Ismaïl Kadaré a pensé à tout. Juste une mention pour le chapitre X (sur XVII), intitulé « L’hiver du soupçon général », qui rappelle qu’un totalitarisme fait de tout citoyen l’espion ou le flic de tous les autres, et de la délation un moyen peu coûteux de faire régner l’ordre (et la terreur). Une façon d’écraser jusqu’à la vie quotidienne de chacun.
Ah, encore un détail : la pente de la pyramide de Chéops n’est pas de 45°, mais de 52°. Je n’ai pas vérifié l’exactitude de l’information.
Ismaïl Kadaré a écrit ce livre entre Tirana et Paris, de 1988 à 1992. Hodja, le dictateur albanais, est mort en 1985, le Mur en 1989, l’URSS en 1991. Autrement dit, l’écriture a comme accompagné la fin d’un monde. Il va de soi que l’Egypte est une métaphore du totalitarisme en général.
L’auteur peint ici un tableau absolument magistral de ce système inhumain.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : juste pour dire à quoi m'a fait penser la momie du pharaon (il y a dans le livre des scènes qui sentent un peu fort, avec les pillards). Il y a dans Wunderkind, de Nikolai Grozni (dont j'ai parlé ici l'an dernier), une scène scolaire, après la visite au mausolée où dort la momie du "Père de la nation bulgare" : « Tu trouves ça drôle, Peppy ? Dis à tes camarades ce que tu as appris. − Qu'on est obligé de remplir le ventre du Père de la Nation de barbe à papa pour l'empêcher de puer ». Bon appétit.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce, françois hollande, angela merkel, zone euro, europe, littérature, littérature albanaise, ismaïl kadaré, tedi papavrami, enver hodja, gjirokastër, albanie, kadaré la pyramide, égypte, pyramide de khéops, le livre à lili, kadaré la niche de la honte, empire ottoman, pharaon chéops, totalitarisme, union soviétique
samedi, 16 mai 2015
IL Y A DU TOTALITAIRE ...
... DANS LA STATISTIQUE
Résumé : vous n'avez plus à vouloir, ni même à désirer. Grâce aux statistiques, il n'y a plus que des faits observables. Laissez-vous aller au mouvement dominant. La société dans son entier est une éprouvette sur la paillasse de chercheurs qui consignent en permanence en des écrits incontestables le fruit de leurs observations objectives.
En route pour la société scientifiquement établie.
2/2
Deuxième fonction de la statistique : établir des moyennes. Ah, les moyennes ! Quelle formidable trouvaille que la moyenne ! Votre enfant, avec 10 de moyenne, aura son bac. Et le plus fort, c’est que ça tranquillise les parents. On oublie de leur dire que dans le même temps, il est à 50 % des possibilités offertes par l’échelle des notes. Mais si grands sont les mystères de la "docimologie", n'est-ce pas ! ...
C’est pareil pour la température corporelle : vous mettez la tête dans l’azote liquide (- 273°C), les pieds dans la chaudière, vous arrivez à une température moyenne satisfaisante. Oui. Sauf que vous êtes mort. La statistique c’est ça.
Pareil pour le pouvoir d’achat : chiffres à l’appui, l’INSEE va vous persuader – si, si ! – qu’il a augmenté. Ah, avec la même somme, vous en mettez moins dans le caddie ? Je veux pas le savoir : les chiffres le démontrent. Votre impression est donc fausse. Pareil pour le passage à l’euro : vous dites que les prix ont augmenté spectaculairement entre avant et après ? Encore une impression fausse. Ah, il faut autant d’euros qu’il vous fallait de francs pour acheter le pain ? Mais où avez-vous pris ça ? Impression fausse, je vous dis ! Faites confiance à la science des nombres et au savoir-faire des statisticiens, qui savent mieux que vous comment vous vivez.
Etablir des nombres, des pourcentages et des moyennes pour tout, voilà qui nous amène à une autre fonction de la statistique : mettre en évidence des écarts. C’est très pratique : ça vous permet de vous situer, de vous comparer. De vous assigner une place. C'est quelqu'un d'anonyme qui vous dit qui vous êtes. La statistique a ceci d'étonnant qu'elle abolit la nécessité de la relation humaine interpersonnelle. C'est le bureaucrate qui confirme votre existence, et qui décrète de quoi elle est faite.
Mais mine de rien, en produisant cet effet, la statistique en induit un autre : en faisant d’un chiffre, d’un pourcentage, d’une moyenne, la référence commune, la statistique fait disparaître la notion de différence, et la métamorphose, comme par un coup de baguette magique, en inégalité. Voilà : la statistique anéantit la différence et instaure le règne des inégalités (forcément pestilentielles et haïssables). Et qu'on ne me raconte pas qu'elle les « révèle ».
Taux de postes à responsabilités occupés par des femmes, salaires comparés des hommes et des femmes, partage des tâches domestiques, taux de visibilité des minorités ethniques, religieuses ou sexuelles dans les médias audiovisuels, tout y passe. Ceux qui dénoncent l'intolérable de ces situations peuvent remercier les statistiques.
Féministes, musulmans, noirs, homosexuels, handicapés, tous les brimés, les discriminés, les stigmatisés peuvent, grâce aux chiffres scientifiquement établis, peuvent faire valoir à bon droit leurs « légitimes revendications », dans cette société si profondément et injustement « inégalitaire ». Paradoxal, vraiment, que cette "science" qui sert à globaliser, voire régenter la population, serve de base de travail aux « combats » des « minorités ». Sans la statistique, le féminisme serait réduit à néant ? Etonnant, non ?
Encore un autre effet du chiffrage systématique de tous les aspects de la vie : à combien de % êtes-vous « normal » ? La statistique vous le révèle, infaillible. Car elle transforme les espaces de vie en espaces normatifs : les statistiques servies à satiété comme n'importe quel bien de consommation courante, grâce au même effacement des différences, produisent un conformisme fondé non plus sur des « codes sociaux », mais sur la crainte psychologique de trop s’écarter des normes chiffrées. Conformisme non plus de l’apparence, mais intériorisé au niveau de la fabrication du désir individuel. Plus besoin de désirer, plus besoin de vouloir.
« Chiffres à l’appui », « les chiffres sont là » : quand un politicien, un journaliste, un militant de n’importe quelle cause veut prouver qu’il a raison, il a recours à la statistique qui va dans le bon sens : le sien. Car le chiffre impressionne, il intimide l’adversaire, il donne raison par avance. C’est un argument imparable. Son effet est dévastateur dans un débat public, comme Nicolas Sarkozy l’a abondamment prouvé, à la suite d’innombrables autres (« Le 1 % de croissance qui manque, j'irai le chercher avec les dents »).
Je préfère de beaucoup ce que disait Winston Churchill de la chose : « Je ne crois jamais une statistique, à moins de l’avoir moi-même falsifiée ». Mark Twain, dans son autobiographie, disait la même chose un peu différemment : « Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les maudits mensonges ["damned lies"] et les statistiques », en attribuant la phrase à Disraeli.
Partant de là, il y a quelque chose d’effrayant à constater l’empire que les statistiques exercent sur les esprits en général, et celui des décideurs et responsables en particulier. Un peu comme si tout le monde consentait à l’imposture, et à construire ainsi une représentation fallacieuse de la réalité sociale.
Disons un mot des sondages, qui ne sont qu’une extension, en infiniment plus fantaisiste, voire plus délirant, des statistiques, puisqu'ils reposent par principe sur l’extrapolation à une collectivité entière de résultats obtenus au sein d’un « échantillon représentatif » de la population.
J'aimerais bien, par exemple et au hasard, savoir quel « échantillon représentatif » de la population a été interrogé, au moment du débat sur le mariage homosexuel, pour aboutir aux mirifiques 63 % de la population approuvant cette extension brutale de la conjugalité. Quelle merveilleuse trouvaille que l’ « échantillon représentatif » (méthode des quotas ou autre) : un pas de plus vers la virtualisation des gens de chair et d’os devenus des abstractions. Pour les convaincre que ce qu'ils pensent n'est pas ce qu'ils croient penser. Et que de toute façon, c'est inéluctable, et que le mieux pour leur équilibre mental est de l'admettre. Un pas de plus en direction de l'intimidation par les chiffres et de la manipulation des esprits.
Un moyen pour les comptables qui tiennent tous les leviers de commande de la vie collective (économie, politique, société, …) de transformer les humains concernés par leurs décisions en simples items dans des listes d’items.
Vous avez dit « déshumanisation » ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : statistique, sociologie, société, france, politique, docimologie, insee, totalitaire, totalitarisme
vendredi, 15 mai 2015
IL Y A DU TOTALITAIRE ...
... DANS LA STATISTIQUE
1/2
A quoi servent les statistiques ? Est-ce seulement ce merveilleux outil de connaissance, qui permet de mettre en lumière des aspects de la réalité inaccessibles à la simple perception individuelle ? Faits sociaux, situations politiques, données économiques, recherches scientifiques, les statistiques font partie intégrante de notre monde, dans tous les domaines qui concernent (de très près ou de très loin) notre vie quotidienne.
Non, elles ne sont pas seulement un outil de connaissance : elles sont aussi un outil de gouvernement. Un outil qui peut se révéler terrible à l'usage. Il en est d'ailleurs ainsi pour les sciences humaines : inutile sans doute de s'appesantir sur l'utilisation des avancées dans la connaissance du psychisme humain par la publicité, par la propagande et par toutes les techniques de manipulation mentale. Vous vous rendez compte : sans Sigmund Freud, pas de Scientologie. Pas d'agressions Coca-Cola par panneaux 4 m. x 3. Pas de surréalisme. « Que la vie serait belle en toute circonstance Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards » (Tonton Georges a toujours raison).
Les statistiques sont donc entrées dans les mœurs. Il faudrait même dire : « Dans les têtes », tant chacun a désormais intériorisé la notion abstraite de « catégorie de la population », dans laquelle, à force de bourrage de crâne, il tend aujourd’hui à se ranger spontanément, sans qu’un seul flic lui en ait seulement intimé l’ordre.
Qu’il le veuille ou non, chacun a désormais une connaissance statistique de lui-même. Chacun est prié de s'éprouver non plus à partir de ses confrontations concrètes à des réalités contondantes ou suaves, mais par le médium infaillible des chiffres élaborés par des experts dont la science le dépasse de trop loin. Chacun est prié d'acquérir une connaissance objective de lui-même. Les statistiques portent le négationnisme de la subjectivité. C'est en cela qu'elles sont porteuses du germe totalitaire.
Chaque jour, journalistes, économistes, politiciens, « experts » et « spécialistes » produisent à qui mieux-mieux, à destination de tous les individus, l’inépuisable spectacle des statistiques dans le fatras desquelles tous ces "sachants" leur intiment l’ordre de trouver leur place. Les statistiques sont la nouvelle figure de la « collectivité », de la « société ». Si ça se trouve, vous appartenez à des catégories dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. On vous définit sans vous demander votre avis. On vous assigne une identité dont vous n'avez nulle idée.
La statistique est par nature l’action de compartimenter les comportements humains en les rangeant successivement dans toutes sortes de cases soigneusement étiquetées en un nombre incalculable de catégories abstraites. La statistique a quelque chose à voir avec la dissection : il s’agit de segmenter un corps pour en étudier de plus près chacun des segments.
Evidemment, comme dans toute dissection, on n’étudie valablement que quelque chose qui fut vivant, mais qui ne l’est plus. Sinon, ça s’appelle un supplice. Premier effet des statistiques : elles font de populations de chair, d’os et d’existences concrètes des abstractions pures et simples. Autrement dit, une population statistique est une humanité chiffrée, comme l’énonce clairement le titre d’Alain Supiot, sur le blog de Paul Jorion : La Gouvernance par les nombres. L’humanité accède enfin à l’existence numérique, seule collectivité sociale aux yeux du statisticien.
Définitions : « 1 – Etude méthodique des faits sociaux, par des procédés numériques (classements, dénombrements, inventaires chiffrés, recensements, tableaux …). 2 – Ensemble de techniques d’interprétation mathématique appliquées à des phénomènes pour lesquels une étude exhaustive de tous les facteurs est impossible, à cause de leur grand nombre ou de leur complexité ».
Historique : « Statistique : n. f. et adj. est un emprunt (1771 selon F. e. w.) au latin moderne statisticus "relatif à l’Etat" (1672), formé à partir de l’italien "statistica" (1663), dérivé de "statista" (homme d’Etat), lui-même de "stato", du latin classique "status" ».
La statistique établit donc des catégories. Ça a des aspects éventuellement rigolos : on peut être « contribuable » et « automobiliste », « électeur » et « pêcheur à la ligne » (on peut s'amuser longtemps à juxtaposer les carpes et les lapins) ; on est rangé par sexe, par appartenance professionnelle, par âge, par situation géographique, que sais-je. On n’en finirait pas. Ce sont les « critères ». Le résultat de tout ça, c’est qu’on a fini par réaliser ce que Voltaire dit de l’homme vu par Micromégas : un amas d’atomes. Voilà, la statistique atomise l’humanité : vous appartenez sans le savoir à mille huit cent quatre-vingt-douze catégories de la population suivant le critère qui est retenu contre vous.
Première fonction selon moi de la statistique : quantifier à l'infini en subdivisant à l'infini. Etablir des nombres. La statistique instaure le règne des comptables sur le corps social et réduit la vie sociale à une gestion bureaucratique. Elle établit une dichotomie rigoureuse entre sujet et objet, étant entendu que, pour le statisticien, personne n'est une personne, vu qu'il n'y a que des objets.
Elle vous apprend qu’au 1er janvier 2015, la France comptait 32.126.316 hommes et 34.191.678 femmes. Soit dit en passant, on voit que la statistique établit clairement que la génétique se moque éperdument de la parité entre les sexes et de l'égalité hommes-femmes.
On en pense ce qu'on veut.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : totalitaire, totalitarisme, statistique, sciences humaines, publicité, propagande, manipulation mentale, journalisme, presse, politique, société, paul jorion, alain supiot, la gouvernance par les nombres, voltaire, micromégas, recenssement, georges brassens, sigmund freud, psychanalyse, scientologie, coca-cola, surréalisme
lundi, 23 mars 2015
UN TRISTE SIRE ...
… ET UN ODIEUX PERSONNAGE
Je ne connais pas Laurent Obertone. Il vient de publier La France Big Brother, que je ne lirai pas : cela fait belle lurette que je suis au courant. Je n’oublie pas ma lecture de 1984, il y a longtemps, où apparaît le « Grand Frère », cette simple anticipation que George Orwell appliquait alors au régime stalinien, mais qui, le progrès technique aidant, est devenu le modèle de développement de grands groupes industriels (Apple, Google, etc. …), jusqu’à modeler de A à Z ce qu’il est convenu d’appeler encore une « civilisation occidentale ». 1984 apparaîtrait presque comme l'ébauche grossière et prémonitoire de ce modèle, qui s'est, depuis, merveilleusement perfectionné.
Sans même parler des « Grandes Oreilles » mises en place par la CIA, la NSA et les officines d’espionnage de tous les pays (Edward Snowden, ...), ces firmes ont substitué aux polices secrètes du « Petit Père des Peuples » (PPP, à ne pas confondre avec les Partenariats Public-Privé, ruineux pour les finances publiques, instaurés par Nicolas Sarkozy) l’ordre numérique et marchand qui surveille nos comportements grâce à des logiciels et algorithmes de plus en plus sophistiqués et intrusifs.
Je n'apprends rien à personne : le moindre pas de la fourmi dans sa fourmilière est cartographié, mis en mémoire, retraçable, inoubliable, ineffaçable. La police n'a plus besoin de poser des questions à des personnes, plus d'interrogatoire à mener : les réponses n'attendent qu'une requête de sa part pour parvenir.
Avouez que le profilage commercial de l’internaute consommateur et le stockage ad libitum de ses « données personnelles » dans une « ferme de serveurs » aux fins de constituer un réservoir infini de « Big Data », c’est tout de même moins terroriste que le KGB ou le NKVD de Staline.
Est-ce moins totalitaire ? Je pose la question. Je réponds que, tout bien considéré, une autre forme de totalitarisme pointe ici le bout de l'oreille. Au moins le bout : le nec plus ultra en matière de totalitarisme, celui auquel les masses adhèrent avec enthousiasme.
Est-ce moins totalitaire ? Laurent Joffrin, lui, le cogérant et directeur de la publication et de la rédaction (tout ça !) du journal Libération, répond par une affirmative épanouie, décomplexée, et pour tout dire d’un optimisme enfin libéré de toute entrave : nos chères démocraties n'ont strictement rien à voir avec ça. Exactement ce que Philippe Muray nommait « L'Empire du Bien ». L'insupportable et invivable Empire du Bien. Précisément le fonds de commerce du « journaliste » Laurent Joffrin (il a la carte, mais ...).
Laurent Joffrin ignore de toute la hauteur de sa superbe (et de sa suffisance satisfaite, voir le portrait, ci-contre, qu'il aime afficher dans son journal), le fichage généralisé des individus qui usent des technologies numériques en général et de l'informatique en particulier. Il n'y voit aucune atteinte aux libertés. Il doit se dire : « Ça ne me pose aucun problème, je n'ai rien à me reprocher ». S'il raisonne ainsi, il a de drôles de lunettes.
suffisance satisfaite, voir le portrait, ci-contre, qu'il aime afficher dans son journal), le fichage généralisé des individus qui usent des technologies numériques en général et de l'informatique en particulier. Il n'y voit aucune atteinte aux libertés. Il doit se dire : « Ça ne me pose aucun problème, je n'ai rien à me reprocher ». S'il raisonne ainsi, il a de drôles de lunettes.
Dire que Laurent Joffrin, Mouchard de son vrai nom (on se demande bien pourquoi il en a honte, c'est un joli nom, Mouchard, pour un journaliste), n’aime pas Laurent Obertone, c’est un euphémisme. Il y a peut-être des raisons de ne pas aimer Laurent Obertone, si on se réfère à ce que j’ai trouvé sur le monsieur en pianotant devant l’ordinateur. Je n’ai ni le temps ni l’envie de creuser la question. Il faut juste retenir que Laurent Joffrin se paie une page de publicité gratuite en plantant ses ergots de coq dévasté par le multiculturalisme dans le cadavre bientôt froid de son ennemi. C'est dans son journal qu'on la trouve, sous la forme d'une "chronique des livres parus".
Donc, Laurent Joffrin n’aime pas Laurent Obertone (c’est aussi un pseudo, paraît-il). Raison ou pas, mon propos est ailleurs. Il se trouve qu’il mentionne en passant, dans son papier, « l’excellente émission d’Alain Finkielkraut » (« Répliques », le samedi matin à 9 heures sur France Culture). Inutile de dire qu'il la trouve excellente parce qu'il y est invité. Il se trouve que j’ai écouté le début de cette émission. Juste le début.
Or il écrit, dans la « recension » (le mot « assassinat » serait plus exact, puisqu'il l'intitule d'une façon qui se veut originale et humoristique, et qui est juste infamante et grotesque, voir ci-dessous) qu’il en propose dans Libération de samedi 21 mars : « Il a, ainsi, pu expliquer, une heure durant, sur une radio nationale, que le système médiatique aux mains de la pensée unique l’empêchait de parler ». Je m’inscris en faux, monsieur Joffrin. Je vous prends ici en flagrant délit de mensonge.

Je ne connais pas Laurent Obertone. Je doute fort, cependant, qu'il ressemble en quoi que ce soit à l'illustre chef de guerre des barbares.
Si Laurent Obertone a été empêché de parler, ce n’est pas à cause du « système médiatique », c’est parce qu’un certain Laurent Joffrin n'a cessé de lui couper la parole dès qu’il ouvrait la bouche pour exposer ses idées. Si celles-ci sont aussi nauséeuses que le pense Joffrin, la moindre des courtoisies à l'égard de l’auditeur que je suis, pour qu'il s'en rende compte par lui-même, c'est de laisser le monsieur étaler en détail ce qui fait son ignominie supposée : sinon, je n’ai aucun moyen de savoir à quoi m’en tenir, à part acheter le livre.
Laurent Obertone n’a strictement rien pu développer. J’ai dit que j’ai écouté le début de « Répliques ». En effet, quand j’ai jugé, au bout d'un quart d'heure, que, vraiment, monsieur Joffrin s’était rendu assez odieux, j’ai coupé. Comment puis-je encore acheter le torchon publié sous l'autorité de Laurent Joffrin ? Peut-être parce que j'y trouve, de loin en loin, de véritables et importantes informations. Que j'estime trop cher payées.
Non seulement l’odieux monsieur Joffrin n’a cessé de couper la parole de l’interlocuteur, mais dans l’article cité ci-dessus, il ment effrontément en affirmant qu’Obertone « a pu expliquer, une heure duant … ». Vous êtes un odieux menteur, monsieur Joffrin, je suis là pour en témoigner. Et ce faisant, vous êtes à vous tout seul une illustration exemplaire de la validité du reproche que Laurent Obertone, selon vous, fait au « système médiatique ».
La peste soit de ces voix que leur notoriété autorise à s’exprimer sur les ondes ou dans les journaux, et à empêcher de le faire tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Je pense à Edwy Plenel, à Caroline Fourest, à quelques autres, qui viennent jouer les professeurs de morale sur France Culture. Laurent Joffrin appartient à cette même espèce nuisible qui se cramponne aux lambeaux des valeurs qui ont fait la démocratie, la République française, et dont il ne restera bientôt plus que le souvenir.
De derrière ce rempart en mie de pain, ces petits flics de la pensée (assez minables dans leur démarche, il faut le dire) lancent incantations, imprécations et foudres sur ceux qui osent rouler un peu à côté des rails des certitudes orthodoxes, émettre le moindre doute sur la validité du modèle qui les nourrit, remettre tant soit peu en question le bien-fondé des certitudes et du modèle.
Laurent Joffrin, avec ses semblables, tente de disqualifier, de ridiculiser l’adversaire en caricaturant son message (ici, Laurent Obertone est dénoncé pour l'amalgame qu'il fait entre nos régimes démocratiques et le totalitarisme policier élaboré par Staline). Exemple : « Dans cette société totalitaire, en effet, on a le front de penser, en général, que les hommes sont égaux en droit, que le racisme est condamnable et que les femmes peuvent prétendre aux mêmes droits que les hommes ». Un peu lourd, vous ne trouvez pas ?
Ça lui permet, et d'une, de faire ronfler une fois de plus les grands mots de la doxa, et de deux, de ne pas faire l'effort d'entrer dans les détails, le CQFD servant de point de départ à son raisonnement. En logique, cela s’appelle une « pétition de principe », le raisonnement typique du fraudeur et du démagogue, qui consiste à dénaturer les arguments de l'adversaire pour mieux les anéantir et le faire huer par le public qu'on a ainsi mis de son côté, conquis par la force de l'évidence.
Comme ses semblables, non content de faire semblant, outrageusement semblant, Laurent Joffrin pratique allègrement la dénégation du réel, au nom, dit-il, des grands principes. L’odieux, ici, est qu’il fait semblant d’oublier que le propre d’une idéologie, c’est de se présenter comme une évidence incontestable, de ne pas se reconnaître comme idéologie, mais de s'affirmer comme vérité. Laurent Joffrin est finalement le parfait exemple de l’idéologue qui, parce qu’il en tire les moyens de sa subsistance, se tient dans le système comme un rat dans son fromage.
Encore quelqu'un qui ne doit pas aimer les livres de Michel Houellebecq.
On a compris que je n'irai pas à l'enterrement de Laurent Joffrin : je ne veux pas entendre l'éloge que prononcera François Hollande à la mémoire de ce grand « Patron de Presse ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal libération, laurent joffrin, laurent obertone, la france big brother, totalitarisme, philippe muray, l'empire du bien, george orwell 1984, staline, stalinisme, kgb, nkvd, cia, nsa, edward snowden, big data, alain finkielkraut répliques, france culture, edwy plenel, caroline fourest, michel houellebecq
jeudi, 12 mars 2015
HOUELLEBECQ ECONOMISTE
 Résumé : il n'y a pas de science économique. C'est Bernard Maris qui l'écrit. Cela rend d'autant plus insupportable l'actuelle dictature que l'économie fait peser sur le monde. Michel Houellebecq, dans son œuvre, la révèle de façon infiniment plus vivante que n'importe quel manuel, plus percutante que n'importe quel pamphlet. Bernard Maris parle excellemment de l'œuvre excellente de Michel Houellebecq.
Résumé : il n'y a pas de science économique. C'est Bernard Maris qui l'écrit. Cela rend d'autant plus insupportable l'actuelle dictature que l'économie fait peser sur le monde. Michel Houellebecq, dans son œuvre, la révèle de façon infiniment plus vivante que n'importe quel manuel, plus percutante que n'importe quel pamphlet. Bernard Maris parle excellemment de l'œuvre excellente de Michel Houellebecq.
2/2
Plus rien n’échappe désormais aux impératifs de compétitivité, de rentabilité, de croissance, de mondialisation. On va vers une nouvelle forme de totalitarisme, la meilleure : celle qui suscite une adhésion spontanée des masses. Le totalitarisme consenti. Même plus besoin de les enrégimenter : elles se constituent elles-mêmes en troupeaux dociles, grâce en particulier à cet instrument totalitaire et consensuel de domestication qu'est la télévision.
Les Etats démocratiques n’auront en effet bientôt plus leur mot à dire : les tribunaux arbitraux que s’apprête à mettre en place la négociation Europe-Etats-Unis les condamneront (et leurs contribuables) à payer la moindre entrave à leur commerce, enfin libéré de toutes les réglementations, y compris celles qui protègent la santé des consommateurs, des citoyens, des automobilistes et des conseillers fiscaux.
Quand on sait, avec le cas Bernard Tapie, les saloperies dont sont capables les juges arbitres qui y siègent à huis clos et qui n'ont de comptes à rendre à personne, on devine le sort que nous réserve l'institution de tribunaux arbitraux dans les différends qui opposeront les grandes firmes transnationales aux Etats démocratiques.
Les autorités politiques des pays, émanées de processus électoraux (qui valent ce qu'ils valent), se sont fait déposséder de leur pouvoir effectif au profit d’instances économiques dépourvues, elles, de toute légitimité démocratique. Dans ses échanges, parfois vifs, avec Jean-Marc Sylvestre, Bernard Maris dénonçait avec constance et cohérence tout ce qui a tendu, au cours du temps, à faire de l’économie non plus un moyen d’apporter la prospérité aux populations, mais une fin en soi, un Graal, presque une loi de la nature, imposant sa nécessité aussi sûrement que la gravitation universelle.
Je viens de lire Houellebecq économiste, paru en 2014 (Flammarion), écrit par Bernard Maris, qui était, dit-on, l'ami de l'écrivain. Cela doit être vrai, puisque le romancier a suspendu la « tournée de promo » après avoir appris la mort de l’économiste dans le carnage de Charlie Hebdo. La « tournée de promo », c’est le parcours auquel les auteurs, à la sortie de leurs films, livres ou autres s’astreignent, plus ou moins obligés par le service com’ de l’éditeur, du producteur, …
Un peu de temps ayant passé depuis les attentats de janvier, j’ai pu lire Houellebecq économiste avec une distance apaisée. Disons-le, c’est un livre fort intéressant pour qui s’intéresse à l’œuvre de Houellebecq. Dire que c’est mon cas serait peu dire. Disons-le dans la foulée : ce n’est pas une étude universitaire, mais un tout petit livre (149 pages très aérées), que ceux qui connaissent l’esprit des deux auteurs liront sans problème.
Disons quand même que Bernard Maris exagère quand il écrit : « De Michel Houellebecq je ne connais que les livres » (p. 18). C’est très vilain de mentir. Pour être franc, il lui tresse trop de couronnes de laurier, ça finit par sentir l'emphase partiale, voire l'outrance partisane. Mais à part ça, c’est un livre tout à fait digeste, que le non-économiste que je suis a avalé aisément : l’auteur ne nous assène en effet ce qu'il faut d’économie que pour faire le lien entre l’œuvre du romancier et les élucubrations criminelles des théoriciens du libéralisme déchaîné.
De toute façon, les économistes, Bernard Maris ne les porte pas dans son cœur. Ce n’est pas pour rien que le deuxième mot du livre est « secte ». Il en dénonce le « discours hermétique et fumeux. On les respecte parce que l'on n'y comprend rien ». Mais il prend soin également de préciser : « Faire de Houellebecq un économiste serait aussi honteux que d’assimiler Balzac à un psycho-comportementaliste » (p.22). Précaution qu’il renouvelle en conclusion : « Houellebecq parle-t-il d’économie ? Non, direz-vous, et vous aurez raison » (p. 139).
Moi qui suis un thuriféraire assumé de l’œuvre romanesque de Michel Houellebecq, j’ai trouvé dans le livre de Bernard Maris une autre raison de l’admirer (l’œuvre, pas le bonhomme, car moi je peux affirmer sans mentir que je ne le connais que par là). En même temps, j’ai trouvé confirmation de quelques convictions bien arrêtées sur la marche économique du monde actuel vers un abîme de plus en plus probable et proche.
Une marche que le romancier a comprise dans toutes ses dimensions, avec une acuité digne des grands de la littérature. Contrairement à ce qu’une cohorte de minables et de vendus répandent à plaisir sur le compte de l’auteur honni (mais plébiscité par les lecteurs, voir le classement des ventes de livres), en termes d’insanités, d’invectives et de venin haineux, Michel Houellebecq est le seul écrivain français qui ait ce génie pour traduire en fiction romanesque l’horreur que provoque le spectacle qui se déroule sur la scène planétaire. Il rend palpable et compréhensible le pressentiment de la catastrophe.
Dire que Bernard Maris connaît comme sa poche l’œuvre de Michel Houellebecq, poésie, essais, romans, œuvres diverses, c’est inutile, tellement ça tombe sous la comprenette. Il l’a parcourue en tous sens, et avec la grille de lecture qu’il propose dans Houellebecq économiste, il nous livre une synthèse quintessenciée de ce qu’elle peut enseigner à tous ceux qui aimeraient bien que ce qui reste d’humanisme dans le monde aujourd’hui ne soit pas écrasé par le rouleau compresseur de l’économie mondialisée.
La vie humaine réduite à la compétition économique, cela s’appelle aussi la LOI DE LA JUNGLE. Le monde est atteint d’un cancer que se plaît à faire proliférer un petit nombre de méga-entreprises devenues trop puissantes pour que des Etats lui opposent une autre résistance que de pure forme.
Alors, la « phase terminale », c’est pour quand ? A quand, les « soins palliatifs » ? A quand, la « sédation profonde » en vue de la fin de vie ?
Voilà ce que je dis, moi.
Note : c'est à regret que je le fais, mais je le dois à madame la langue française. J'en suis désolé pour les mânes de Bernard Maris, mais il n'a pas le droit d'écrire, p. 58 : « La main de fer du marché poigne votre petite main, à jamais ». Même si l'idée est juste, il n'existe pas de verbe "poigner". Il existe en revanche un verbe "poindre". Il est du troisième groupe. La troisième personne du singulier est donc "point". Espérons que les mânes d'oncle Bernard ne m'en voudront pas trop.
Je profite de l'occasion pour rappeler à tous en général, et aux journalistes en particulier qu'il n'y a pas de verbe "bruisser", que le verbe bruire est aussi du troisième groupe et que, conjugué à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif, il se termine aussi par un "t" : la ville bruit de rumeurs. Pitié pour la conjugaison française ! Pitié pour notre langue !
To whom it may concern.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : houellebecq soumission, michel houellebecq, littérature française, bernard maris, sciences économiques, tribunal arbitral, totalitaire, totalitarisme, europe états-unis, bernard tapie, jean-marc sylvestre, france inter, houellebecq économiste, charlie hebdo, éditions flammarion, honoré de balzac, langue française, grammaire, bescherelle, verbe poindre, verbe bruire
mercredi, 11 mars 2015
HOUELLEBECQ ECONOMISTE
 1/2
1/2
Michel Houellebecq a publié, le 6 janvier, son sixième roman : Soumission (voir ici même au 16 janvier). Le 7 janvier, les frères Kouachi font un carnage à Charlie Hebdo : douze morts. Parmi eux, une figure que je respectais et dont j’appréciais les dessins, mais aussi l’esprit paradoxal et le raisonnement tordu : Wolinski.
Et puis une figure qui faisait partie depuis toujours de mon paysage favori et dont je ne me console pas, comme beaucoup d’autres, de la perte irréparable : Cabu. Non, ils n'avaient pas le droit de tuer Cabu. Pour moi, Cabu a joué le rôle du vieux frangin, tarabâte (désolé, c'est du lyonnais, vous n'avez qu'à consulter votre Littré de la Grand'Côte) et indispensable, que je ne me console pas de n'avoir jamais eu. Cabu, au-delà de tout, tenait pour moi la place du vieux frère.
Et puis aussi une autre figure pour laquelle j’avais grande estime, à cause de sa façon non-conformiste et non-consensuelle de parler d'économie : Bernard Maris, qui avait publié le matin même un article élogieux sur le roman que Houellebecq publiait (voir ici 20 janvier). J’avais lu son Anti-Manuel d’économie, j’avais lu Ah Dieu ! Que la guerre économique est jolie !, j’avais lu Lettre ouverte aux gourous de l’économie qui nous prennent pour des imbéciles. Autant de lectures stimulantes.
Du temps que j’écoutais encore France Inter, je suivais ses joutes régulières avec Jean-Marc Sylvestre, le fanatique de la libre entreprise et de l’ultralibéralisme. Pour faire court, j’étais d’accord avec la façon dont Maris expliquait que la place acquise par l’économie dans la vie des individus, des sociétés, des nations et du monde constituait un abus de pouvoir, un véritable putsch.
J’avais lu, en 1996, L’Horreur économique, puis, en 2000, Une Etrange dictature, deux livres de Viviane Forrester. Je devrais dire : « Lu et approuvé ». Le putsch des entreprises transnationales, portées en triomphe par une secte d’économistes fanatiques et de gouvernants complices, et régulièrement célébrées par la banque de Suède sous l’appellation mensongère et usurpée de « Prix Nobel d’économie », a instauré, en quatre décennies, une véritable dictature économique qui a étendu son emprise sur la planète entière.
« Car il n’y a pas de science économique » (p. 146), voilà une vérité irréfutable. L’économie est à l'extrême rigueur un catalogue (très copieux et sophistiqué) des techniques utilisées par les hommes depuis l’aube des temps pour produire, échanger et consommer. Pas plus. Il faudrait enfin que monsieur Toulemonde se convainque qu’il se trouvera toujours un économiste médiatique pour lui expliquer après-demain que sa prévision d’aujourd’hui pour demain s'est révélée fausse parce que.
Tout en étant prêt séance tenante à récidiver. Quelque chose de bizarre fait que ce genre de type a toujours l'air d'avoir raison. Mais après-coup.
Toutes les théories économiques se trouvent après le "parce que". Jamais avant. Une véritable science a des vertus prédictives, comme l'a prouvé monsieur Higgs, qui avait postulé dès 1964 la nécessité du boson auquel on a donné son nom, et dont l'existence a attendu 2012 et les expériences du LHC pour être attestée.
Mettez quatre économistes autour d'une table et d'une question d'actualité : cinq minutes leur suffisent pour en venir aux engueulades à propos de ce qu'il faudrait faire pour (là, on peut mettre n'importe quel sujet). Il n’y a pas de science économique. Même chose sans doute pour toutes les disciplines que l'on persiste à appeler abusivement « sciences humaines ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel houellebecq, bernard maris, houllebecq économiste, charlie hebdo, frères kouachi, 7 janvier, wolinski, dessin satirique, caricature, cabu, canard enchaîné, littré de la grand côte, nizier du puitspelu, lyon, anti-manuel d'économie, ah dieu que la guerre économique est jolie, lettre ouverte aux gourous de l'économie, france inter, jean-marc sylvestre, viviane forrester, l'horreur économique, une étrange dictature, prix nobel d'économie, banque de suède, totalitarisme, états-unis, europe, traité transatlantique de libre-échange, loi de la jungle, houellebecq soumission
mercredi, 04 avril 2012
UN ALGERIEN JUGE LES ISLAMISTES
Je viens de lire Le Village de l’Allemand, de BOUALEM SANSAL. Pourquoi, me dira-t-on ? Eh bien l’occasion s’est présentée lors d’un précédent article au sujet de l’Islam. On trouve sur Internet un certain nombre de vidéos. J’ai visionné à tout hasard une interview de l’auteur, à propos de cet ouvrage, paru en 2008.
Le journaliste lui demandait s’il n’exagérait pas en faisant dans son livre un parallèle strict entre les islamistes algérien des GIA et les nazis des camps de la mort. L’auteur répond par la négative : il voit dans le projet des musulmans les plus radicaux (les « djihadistes ») se profiler une vision totalitaire de la société.
<object width="480" height="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/uqKLHNNpsGc?version=3&h... name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/uqKLHNNpsGc?version=3&h..." type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
J’ai voulu en avoir le cœur net, en lisant le bouquin. Intuitivement, j’ai tendance à lui donner raison (voir le prêche plein de bonnes intentions totalement inopérantes (« nous devons nous maintenir vigilants ») d’ABDELWAHAB MEDDEB dans Libération du 2 avril, où il prononce lui-même le mot de « totalitaire », sans être forcé).
Ceci n’est pas exactement une note de lecture, et pour une raison simple : sur le plan romanesque, le livre est assez raté, alors que, par son sujet, il pose une question grave.
Comme bien souvent, quand un romancier se lance dans un livre « à thèse », le résultat est littérairement décevant, quand il n’est pas carrément nul. L’art fait toujours (ou presque) mauvais ménage avec la démonstration. Et aussi avec le militantisme. Car Le Village de l’Allemand (2008, disponible en Folio) est un roman « engagé ».
L’auteur s’insurge en effet, très fortement, contre l’infiltration de « guerriers » de l’Islam dans les banlieues françaises, depuis un certain (?) nombre d’années. On ne peut pas lui donner complètement tort. MARINE LE PEN a évidemment tort de souffler sur les braises des antagonismes, mais il y a de la vérité quand elle parle de « fascisme vert ».
Oui, il y a des « fascistes verts » en France. Que leur nombre (très faible) fasse « courir un risque à la République », c’est un fantasme d’une autre paire de manches, dont je me garderai de franchir le pas (comme dirait le Maire de Champignac). Mais on ne peut nier qu’il y a en France, aujourd’hui, des fanatiques.
Leur objectif est d’étendre leur emprise à visée totalitaire sur des parties de la population, disons pour aller vite, « d’origine maghrébine ». Ils se considèrent comme des soldats en guerre contre la civilisation européenne. J’en reparlerai prochainement.
Alors le bouquin de BOUALEM SANSAL, maintenant. Rachel et Malrich sont deux frères, nés de mère algérienne et de père allemand. Aïcha Majdali, du village d’Aïn Deb, a épousé Hans Schiller. Rachel est la contraction de Rachid et d’Helmut ; Malrich, celle de Malek et Ulrich. La vraisemblance de tout ça est relative, mais enfin bon.
Le père pourrait s’appeler le père-iple, tant sa trajectoire est compliquée, avant de débarquer dans ce tout petit patelin. Il fut officier SS, en poste dans différents camps de la mort. A la Libération, il suit une filière compliquée d’exfiltration des anciens nazis, qui passe par la Turquie, l’Egypte, et qui l’amène en Algérie, où il rendra quelques « services », avant d’être remercié et de prendre une retraite bien méritée, sous le nom de Hassan Hans, dit Si Mourad. Bon, pourquoi pas, après tout ?
L’action du bouquin se passe pendant la sale guerre que se livrent le gouvernement algérien et les islamistes du GIA (60.000 à 150.000 morts selon les sources). C’est dans cet affrontement que le couple arabo-allemand est massacré, dans une tuerie collective nocturne. Rachel fait le voyage, et tombe sur les papiers laissés par son père.
Voilà ce que je dis, moi.
J’ai essayé de faire court, mais ça finit demain.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, DANS LES JOURNAUX, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boualem sansal, algérie, islam, islamisme, musulman, extrémiste, djihad, salafiste, salafisme, le village de l'allemand, gia, guerre civile, religion, fanatisme, abdelwahab meddeb, libération, presse, journaux, totalitaire, totalitarisme, nazi, nazisme, marine le pen, politique, société, mohamed mehra
lundi, 16 janvier 2012
QUI TE MANIPULE ?
Résumé : Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, livre de BEAUVOIS et JOULE, expose diverses techniques visant à faire faire à quelqu’un quelque chose qui, normalement, lui répugnerait. Si l’opération réussit, la personne va changer d’avis, pour se remettre en accord avec elle-même, parce que l’action a produit en elle une dissonance. Elle aura donc été manipulÉe.
Le point de vue de B. & J., pour le dire rapidement, se veut scientifique donc neutre, au moins théoriquement. C’est la merveille due au découpage du savoir en une infinité de « disciplines scientifiques ». Chacune est autonome. Et dans la bonne science, on ne regarde pas ce qu’il y a dans l’assiette du voisin.
Ça veut dire au passage que chaque discipline fonctionne en vase clos, selon sa propre logique, sans rendre de comptes à personne. Il faut bien se dire que, s’agissant de l’homme officinal (retenez bien la formule, c’est moi l’inventeur), plus personne n’est en mesure, depuis trois ou quatre siècles, d’envisager la totalité. C’est d’ailleurs pour compenser cette infirmité que l’ordinateur a été inventé.
Chaque rat est prié de croquer dans sa part individuelle de fromage. La « psychologie sociale » fait comme les autres. Elle n’a pas à se mêler de biologie moléculaire, de mécanique des fluides, de morale ou de politique. Oui, je sais, on me dira que morale et politique ne sont pas des « disciplines scientifiques ».
La conclusion de B. & J., à propos de leur notion de « soumission librement consentie », est : « P’têt ben que ce n’est pas bien, mais c’est nécessaire à la paix sociale ». Il est vrai que nous vivons dans une société de masse. Pour que la machine fonctionne, il faut, nous dit-on, huiler les rouages. La manipulation des foules serait donc le lubrifiant indispensable, pour que les gens continuent à « faire groupe ». Sinon, la collectivité se transforme en centrifugeuse, et elle éclate.
Peut-être, après tout, le « communautarisme » tant redouté par les républicains (ce qu’il en reste) est-il le lubrifiant de substitution qui permet de croire encore pour quelque temps au « vivre-ensemble » (comme ils disent), selon le vieux principe du « divide ut regnas » (c’est du latin : si tu veux régner, divise). Chaque « minorité » (asiatiques, noirs d’Afrique, Antillais, arabes, sans compter les ratons laveurs, aurait ajouté le détestable JACQUES PREVERT) restera bocalisée, aquariumisée dans son quartier. Peut-être, après tout, est-ce la fin de la fiction du « peuple » ?
On me dira ce qu’on voudra : s’il faut gouverner les gens sans qu’ils le sachent, c’est qu’on est arrivé aux frontières du totalitaire.
Car je me pose toujours la même question : comment se fait-il, dans un monde où il n’y a jamais eu autant de liberté, que tout le monde ou presque fasse la même chose, parfois au même moment (plages, supermarché, télévision, etc.) ?
Comment se fait-il que des masses d’individus LIBRES décident librement de faire la même chose que tout le monde au même moment ? On me dira ce qu’on voudra : CE N’EST PAS NORMAL.
Et puis, franchement, n’avons-nous pas déjà acclimaté dans nos démocraties exemplaires, que les petits hommes verts planètes les plus avancées de l’univers nous envient, les merveilleuses trouvailles mises au point par ADOLF HITLER ?
J’exagère ? Alors je demande qu’on me dise ce que c’est, l’échographie. Cette technique si pratique qui permet d’éviter l’amniocentèse tout en arrivant au même résultat, qu’est-ce d’autre qu’un moyen d’éviter la naissance de bébés mal formés ? Qu’est-ce que c’est, sinon cet EUGENISME dont on fait bêtement reproche à HITLER ? Accessoirement, l’échographie permet, par exemple en Inde, d’éviter la naissance des filles.

LE PETIT PERE DES PEUPLES

LE FÜHRER
(à moins que ce ne soit l'inverse)
Oui, l’EUGENISME est bel et bien parmi nous. Est-ce bien, est-ce mal, c’est autre chose. Je suis comme tout le monde, je n’aimerais pas du tout avoir un enfant mongolien. Si une technique « non invasive » permet de l’éviter, je m’en félicite, mais je me dis qu’il s’agit, qu’on le veuille ou non, de SELECTION.
Cette analogie avec ce qui se passait dans un régime politique unanimement VOMI par le monde démocratique actuel me laisse perplexe. C’est vrai qu’HITLER éliminait des personnes déjà nées, donc bien vivantes, alors que l'échographie débouche, en cas de mauvais diagnostic, sur un AVORTEMENT. A part cette « menue » différence, j'attends qu’on me dise en quoi le projet est différent (« élimination des mal formés », qu’on pratiquait déjà dans la Sparte antique).
Autre chose, tiens, pendant que j’y suis. Je ne vais pas, une fois de plus, m’insurger contre la télévision, mais là encore, je note que des gens comme HITLER ou STALINE auraient rêvé d’avoir à leur disposition un tel outil de domestication des masses. Le simple fait de les savoir assises devant l’écran les aurait sans doute rassurés.
Je trouve admirable que, bien avant le règne sans partage de la télévision sur les esprits, le 1984 de GEORGE ORWELL ait explicitement associé le télécran au régime totalitaire décrit dans le bouquin (le stalinisme en particulier, mais en regardant bien ...).

GEORGE ORWELL
Or, aujourd’hui, qu’un type comme PHILIPPE SOLLERS puisse, parlant de LOUIS ALTHUSSER, affirmer que ne saurait se prétendre penseur un homme qui n’a pas la télévision, en dit long. Qu’est-ce que c’est, la télévision comme mode de vie, sinon le bromure que les militaires mettaient dans la nourriture des bidasses le premier soir de leur incorporation, pour qu’ils se tinssent tranquilles pendant les premiers jours ?
Vous voulez encore un exemple ? Selon vous, qui a inventé l’architecture de masse, le gigantisme architectural ? Personne d’autre qu’ADOLF HITLER, brillamment secondé (ou précédé) par son ALBERT SPEER préféré. Il suffit d’aller voir les projets de stade, d’arc de triomphe et autres lubies, pour le comprendre. A qui devons-nous les premières autoroutes, ces structures dirigistes, autoritaires, voire policières ? BENITO MUSSOLINI. Vous pouvez vérifier (autoroute Milan-Lacs, 1924). HITLER n’a pas mis longtemps à comprendre tout l’avantage technique de la chose.
Dans quels régimes dénoncés comme totalitaires a été utilisée la manipulation mentale ? Vous le savez : l’Allemagne hitlérienne et la Russie stalinienne. Deux pays pour lesquels tout bon démocrate dûment estampillé au fer rouge sur la fesse gauche a autant de détestation que si c’étaient des enfers. Ceux que ça intéresse peuvent aller voir mes notes de 12 et 20 mai 2011 (c’est loin, je sais).
Voilà ce que je dis, moi.
A demain pour la suite.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : beauvois et joule, petit traité de manipulation, sociologie, psycho-sociologie, manipulation mentale, totalitaire, totalitarisme, adolf hitler, eugénisme, démocratie, staline, philippe sollers, louis althusser, albert speer, george orwell, 1984
jeudi, 26 mai 2011
HITLER AUJOURD'HUI ?
DE L’EUGENISME EN DEMOCRATIE « AUGMENTEE »
Tout d’abord, je signale aux lecteurs de ce blog que la présente note prolonge celle du 12 mai, intitulée « Eugénisme : HITLER a gagné ». En fait, ceci est un simple codicille, dont l’actualité me fournit le prétexte. Bon, c’est vrai que ce numéro du Monde date déjà du 25 (hier, au moment où j’écris : ça commence à se faire vieux). C’est au bas de la page 11. C’est intitulé « Alarmiste face au projet de loi de bioéthique, l’Eglise catholique dénonce un recul de civilisation » (en gras, les mots placés entre guillemets dans l’article). C’est signé Stéphanie Le Bars (est-elle la famille d'Hugues Le Bars, qui a habillé de musique des paroles de IONESCO : « Eh bien, Monsieur, Madame, Mademoiselle, je suis bien fatigué, et je voudrais bien me reposer » ? Morceau étonnant.). Le nom sonne breton.
Monseigneur Vingt-Trois (il paraît que la réserve des noms de famille en France est en train de se vider, mais avec un nom pareil, on s’est surpassé, presque autant que les Chevassus-à-l’Antoine ou Chevassus-au-Louis (authentique évidemment)), Monseigneur Vingt-Trois, disais-je, vient donc de réagir à un projet de loi. Déjà, on sent de quel côté penche Le Monde : « Alarmiste », ça pointe déjà quelqu’un qui crierait avant d’avoir été touché. En gros, « alarmiste », c’est juste avant la pathologie. L’article aborde d’entrée la tentative de « lobbying politique » de l’Eglise. Et ça continue avec : « Quitte parfois à forcer le trait ». On voudrait faire sentir que cet individu à nom de nombre a tendance à exagérer, on ne s’y prendrait pas autrement.
Qu’est-ce qu’il dit, l’archevêque de Paris ? D’abord la citation de ses propos mise en gros caractères au milieu de l’article : « On ne peut pas dire : "Les handicapés, on les aime bien, pourvu qu’ils ne viennent pas au monde" ». Voilà pour la référence à ma note du 12 mai (pour ça que je passe sur les détails du projet de loi, qui feraient ici double emploi). Le reste ? « Eugénisme d’Etat », « instrumentalisation de l’être humain ». La loi discutée à partir du 24 mai constitue « un recul de civilisation », et « une certaine conception de l’être humain serait très gravement compromise ». Qu’est-ce que je dis d’autre, le 12 mai ? Le président de la Conférence des évêques de France s’inquiète de « la systématisation juridique du diagnostic prénatal ». Il s’interroge : « Les faibles, les vulnérables auront-ils encore leur place dans notre société ? ». Il dénonce un « paradoxe », dans « cette instrumentalisation de l’être humain au moment où la Commission européenne travaille à la protection des embryons animaux ».
Rapidement : diagnostic prénatal (qui va évidemment de pair avec le remarquable avortement thérapeutique), recherche sur les cellules souches embryonnaires, extension à tous les couples de la P. M. A. (procréation médicalement assistée, dans la langue de bois officielle), proposition défendue pas les associations de défense des familles homoparentales : voilà des aspects de la loi abordés par le prélat. La journaliste écrit ensuite (en son nom propre, donc) : « En creux, le cardinal a salué le travail des députés catholiques et de la Droite républicaine, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour défendre les idées de l’Eglise sur ces questions ». Ben voilà, il fallait que ce fût dit : Monseigneur Vingt-Trois est un sale vieux RÉAC. Mine de rien, voilà comment s’exerce la sacro-sainte neutralité d’une journaliste du « journal de référence » Le Monde. Mine de rien, il s’agit, à dose homéopathique, d’amener le lecteur à ranger l’Eglise dans le camp des vilains : les « réactionnaires », Le Monde étant bien entendu dans celui du Bien. Personnellement, je parlerais plutôt du camp des « bien-pensants » (au sens de Bernanos). Et "en creux", j'avoue que c'est à savourer longuement.
Je ne suis pas catholique. Je ne suis ni croyant, ni incroyant. Pour parler franc : je m’en fous. Mais, suite à la petite analyse que je proposais le 12 mai, je ne peux que confirmer ma conclusion : HITLER, qui a voulu promouvoir l’eugénisme au rang de politique d’Etat, a bel et bien GAGNÉ. L’Eglise, quoi qu’elle dise, a d’ores et déjà subi une défaite. L’atmosphère est au consentement général (ou à l’indifférence). Et ça se passe sous la pression de groupes minoritaires, qui réclament des « droits », « à égalité avec les autres citoyens ». Comme si ces groupes étaient composés d’autres individus que des citoyens !
Est-ce que ce projet de loi est bon ou mauvais ? Je ne sais pas. Ce que j’observe, de nouveau, c’est qu’il adopte de façon fervente et militante des principes qu’avait commencé à mettre en œuvre quelqu’un dont il suffit de citer le nom pour faire naître dans l’oreille qui l’entend un écho immédiat du MAL ABSOLU. C’est évidemment ADOLF HITLER. Et dès lors, je m’interroge : sommes-nous sûrs, dans cette société dépourvue d’autre ennemi que l’infâme terrorisme ; somme-nous sûrs, dans ce monde qui a définitivement versé dans le camp du BIEN, qui a, en quelque sorte, « basculé du côté LUMINEUX de la Force » ; sommes-nous absolument sûrs d’avoir choisi le parti de l’humanité ? Monseigneur Vingt-Trois, qu’il soit catho, je m’en tape : son inquiétude devrait être celle de TOUS.
Qu'y a-t-il de faux dans la phrase : « Les handicapés, on les aime bien, pourvu qu'ils ne viennent pas au monde. » ? Et qu'est-ce que ça a de RASSURANT, je vous prie ?
Le corps d'ADOLF HITLER est certainement mort. Mais ses idées ? Son PROGRAMME ? "Rassurez-vous" : tout ça est en cours d'exécution.
Le Meilleur des mondes est parmi nous.
22:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eugénisme, totalitarisme, société, politique, littérature, hitler, église catholique, presse, journaux, le monde, bioéthique, réactionnaire, handicapés
vendredi, 20 mai 2011
ARCHITECTURE : HITLER A GAGNE
Il faudra bien qu’un jour on cesse de faire de Staline et Hitler des épouvantails, des incarnations d’un Mal définitivement enterré à des années-lumière de notre monde si heureusement né au chef d’œuvre qu’est la démocratie, dans l’histoire des sociétés humaines. Il faudra cesser de mettre les deux grands totalitarismes du 20ème siècle dans des parenthèses, comme des parois étanches qui en font des sortes d’exceptions historiques, des espèces de dérapages du flux normal de la grande Histoire : finalement des erreurs. Non : Staline et Hitler ne sont ni des dérapages, ni des exceptions, ni des erreurs. Ils sont l’expression, la conclusion logique, l’aboutissement « normal » d’un système né avec l’Europe industrielle (ça fait 150 ans, ou à peu près).
Qu’ils en aient été de sinistres caricatures ne change rien : Staline découle en pire du terrorisme d’Etat mis en place par Lénine (après tout, il a commencé sa carrière en attaquant des banques avec la bande qu’il dirigeait) ; Hitler découle en pire des traités qui ont suivi la guerre de 1914-1918 et des errements de la République de Weimar. Alors, c’est vrai : les doctrines de l’un et de l’autre, dûment condamnées, sont enfermées dans les placards, dans les caves et dans les archives. Mais elles ne sont pas restées sans postérité, sans descendants, sans héritiers dans notre monde très moderne, très actuel, pour tout dire. Le monde que nous héritons du passé doit aujourd'hui beaucoup à Staline et Hitler, comme j’ai essayé de le montrer pour l’eugénisme dans ma note du 12 mai dernier.
Pour voir si je ne délire pas, je me tourne vers un témoin irréfutable : Albert Speer, l’architecte de HITLER, son seul confident, paraît-il. Evidemment inscrit au Parti nazi, dont il devient rapidement l’architecte en chef, il a une conception de l’architecture qui épouse étroitement les visions du Führer, mais celui-ci va y insuffler toute l’ampleur de sa démesure. Et c’est quoi sa conception ? Par exemple, il invente « la valeur des ruines » : dans 1000 ans, il faudra que les ruines laissées soient aussi belles que celles, visibles aujourd’hui, de l'antiquité grecque. Dans leurs cartons, qu’est-ce qu’ils ont comme projets, les deux complices ? Le Reichstag, paraît-il (cf. Wikipédia), une coupole treize fois plus haute que Saint Pierre de Rome (131 mètres, ça nous porte à 1703 mètres : étrange). L’arche triomphale aurait pu contenir dans son ouverture l’Arc de Triomphe de l’Etoile (49,54 mètres). Pour le futur stade des « jeux aryens » à Nuremberg (après suppression des Jeux Olympiques), 400.000 places prévues. Bref, l'architecture nazi, c’est de l’impérial, du monumental, du triomphal de masse. Bref : surenchère, démesure, volonté de puissance (tiens tiens !).
Il faut dire que Mussolini a tenté de rivaliser avec Hitler, mais il n’avait pas les moyens. Consolons-le en lui répétant, sur son bulletin scolaire, que l’intention y était : « Bien, mais doit mieux faire, s’il veut accéder à la plus haute marche ». Côté Staline, c’est pas mieux, à voir les palais soviétiques, la magnifique Loubianka, à Moscou, vous savez, le palais du KGB de sinistre mémoire, remplacé par le moderne et riant FSB, et diverses autres grandioses réalisations dans les « démocraties populaires ». J’ai vu de mes yeux, en 1990, ce que Ceaucescu avait prévu de construire en plein Bucarest : un immeuble-ville, après avoir détruit sans sourciller quelques dizaines d’églises, dont certaines du 18ème siècle. Dans le même temps, il projetait de rassembler la population roumaine dans quelques dizaines de méga-villes, pour restituer à l’agriculture toute la surface disponible, moyennant la destruction pure et simple de quelque 5000 villages. Quand je me tue à vous dire que Hitler, il est pas mort. Est-ce que le gouvernement roumain d’aujourd’hui, forcément démocratique, on vous dit, sait désormais quoi faire de ce machin (je ne vois pas d’autre terme) ?
Mais du côté de chez nous, les pays « libres», comme toute le monde dit, qu’est-ce qu’on voit, éberlué ? Qu’est-ce que c’est, l’Empire State Building ? Qu’est-ce que c’est, les tours de Kuala Lumpur ? Burj Khalifa à Dubaï (828 mètres) ? Le stade de Maracaña ? Qu’est-ce que c’est, le plus grand pont du monde ? Le plus gigantesque barrage du monde (en Chine : le « Trois gorges ») ? Le tunnel le plus long du monde (en Suisse : le « Gothard »)? Etc., etc., on n’en finirait pas. Bon, vous avez compris : surenchère, démesure, volonté de puissance. Quand je vous disais que Staline et Hitler ne furent que l’expression caricaturale d’un système industriel voué par nature au gigantisme et à la compétition illimitée du gigantisme !
Je vais aggraver notre cas, à nous autres, les sociétés « démocratiques », qui se donnent en spectacle désirable à « toutes les dictatures antédiluviennes » (qu’on se demande comment elles ont pu se perpétuer). C’est à propos d’une autre trouvaille architecturale, vous savez, celle qui, moyennant finance, vous permet de gagner la Côte d’Azur le plus rapidement (sauf en cas de bouchon, d’accident ou de chute de neige un peu imprévue). Allez, lecteur, ne te fais pas plus bête que tu n’es. C’est évidemment l'autoroute. Tu sais, estimable lecteur, de quand ça date, l’autoroute ? De 1924 (77 kilomètres entre Milan et la région des lacs). Et tu ne devineras jamais où ça a été inventé ? Allez, je te le dis : Italie. Et qui est au pouvoir ? Mussolini. Et qui va se mettre à en fabriquer à n’en plus finir ? Adolf Hitler. Et à quoi ça devait servir prioritairement ? Acheminer les armées, les camions, les blindés, les canons, les chars. Evidemment, aujourd’hui, plus personne ne se pose la question : l’autoroute, c’est tellement plus pratique (tiens, c’est comme l’ordinateur, l’internet, le téléphone portable, la musique portable, etc.). L’autoroute, on l’emprunte (et on la rend à la sortie).
Moralité ? Toute le monde a compris : l'architecture et l'autoroute, qui structurent de fond en comble l’espace et le territoire de nos si désirables démocraties, nous ont été léguées par Hitler.
L’excellent Philippe Muray (y avait longtemps…) parle quelque part des fameuses tours du World Trade Center. Il parle, à leur propos de cataclysme architectural. Je trouve que c’est bien vu. Mais si l’on va par là, il faut bien dire que la tour Eiffel s’inscrit dans la lignée, au chapitre de l’archéologie des cataclysmes architecturaux (tour qui, au passage, a été prolongée « ad vitam aeternam » en 1909, année prévue de sa démolition, quand ce sont des militaires qui se sont rendu compte qu’elle pouvait rendre d’éminents services). La Tour Eiffel inaugure l’ère des exploits architecturaux. Ils ne cesseront plus. Je passe sur les projets que Le Corbusier, heureusement, n’a pas eu le temps ou l’occasion de concrétiser, restés à l’état de dessins : Paris rasé, sauf les monuments touristiques, pour dégager l’espace et y construire de gigantesques tours pour y mettre les masses ; Rio de Janeiro réduit à un gigantesque immeuble continu (sur des kilomètres), avec, évidemment, l’autoroute passant sur le toit.
Surenchère, démesure, volonté de puissance. Vous vous rappelez la devise si sublime des Jeux olympiques ? « Citius, Altius, Fortius ». Je n’ai même pas besoin de traduire, je pense ? Ce que nous condamnons aujourd’hui dans les camps de concentration, c’est l’espace même dans lequel nous vivons. Un espace concentrationnaire. La seule différence, c’est que pour nous, c’est payant.
Staline et Hitler sont les paroxysmes de la civilisation industrielle. Nous en sommes les continuateurs. Les héritiers, en quelque sorte.
Alors, vous croyez toujours qu’ils sont des aberrations de l'histoire ?
15:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : staline, hitler, dictature, architecture, totalitarisme, espace, autoroute, albert speer, berlin, nazi, nazisme, ceaucescu, mussolini, tour eiffel, le corbusier, philippe muray, jeux olympiques

