samedi, 07 mai 2016
S.A. NOBEL DE LITTÉRATURE
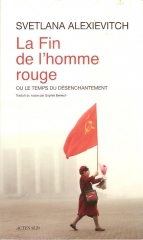 2
2
La Fin de l’homme rouge, livre de Svetlana Alexievitch, est bourré de la souffrance du peuple russe. L’étonnant, c’est que certains communistes intimement convaincus sont restés d’indéfectibles fidèles du Parti, même après avoir passé dix ans dans les camps de travail sibériens, pour avoir dévié si peu que ce soit de la « ligne » officielle, du moins dans l’acte d’accusation que la police rédigeait et, au besoin, fabriquait intégralement pour les besoins de la cause (ce gars qui, sous la torture, avoue qu’il est un espion, puis demande au juge d’instruction pour qui il est convenu d’espionner et qui, face à l’échantillon que l’autre lui présente, opte pour l’espionnage au profit des Polonais). Beaucoup ont toujours ignoré jusqu’au motif réel de cette accusation.
En tout cas, d’innombrables Russes (et autres) non communistes (ou pas assez), mais aussi des communistes pur jus, ont eu à connaître les camps. Tout le monde a entendu parler du Goulag, acronyme signifiant « administration centrale des camps ». L’URSS en a compté des milliers, répartis sur tout le territoire soviétique (ce que veut dire l' "Archipel" dont parle Soljenitsyne). Parmi eux, celui de Karaganda, où Anna Maïa, architecte de 59 ans, raconte que, petite fille, elle dut y suivre sa mère, qui avait été condamnée, et qu’elle y est, devenue adulte, retournée, dans une sorte de pèlerinage. Ensuite, elle se dit qu’elle n’aurait pas dû.
Voici ce qu’elle raconte. Elle est assise dans l’autobus, à côté d’un vieillard qui lui parle du camp, autrefois : « "Vous parlez des baraques ? On a détruit les dernières il y a deux ans. Avec les briques, les gens se sont construit des remises, des saunas. Les terrains ont été vendus pour y construire des datchas. On se sert des barbelés pour délimiter les potagers. Mon fils a un terrain ici. Eh bien, vous savez, ce n’est pas très agréable … Au printemps, avec la fonte des neiges et les pluies, des ossements remontent au milieu des pommes de terre. Ça ne dérange personne, on a l’habitude. Ici, les os, c’est comme les cailloux, il y en a partout … On les jette le long des terrains, on marche dessus … On les piétine. On est habitués ! Dès qu’on commence à creuser, ça grouille littéralement …" J’avais le souffle coupé, j’ai cru que j’allais m’évanouir. Le vieux s’est tourné vers la fenêtre : "Tenez, là-bas, derrière ce magasin, ils ont comblé un cimetière. Et là-bas aussi, derrière les bains." Je n’arrivais plus à respirer. A quoi m’étais-je attendue ? A voir des pyramides ? Des monuments funéraires ? » (p.308). A ne pas lire au moment de l’apéro.
Non plus que cet autre passage, où l’ancien colonel devenu homme d’affaires raconte le mariage qu’il a failli faire, et auquel il a renoncé après avoir rencontré son futur beau-père, dont il restitue les discours tenus un jour de boisson forte : « Je suis un soldat, moi ! On me donnait des ordres, et j’obéissais. J’exécutais des gens. Si on t’en donnait l’ordre, tu le ferais, toi aussi. Tu-le-fe-rais, nom de Dieu ! Je tuais des ennemis. Des saboteurs. Il y avait un papier officiel avec écrit dessus : "Condamné à la mesure suprême de défense sociale". Une sentence du gouvernement … Ah, c’était du boulot, je te dis pas ! Si le type n’est pas tué sur le coup, il s’écroule et il gueule comme un porc … Il crache du sang … Le plus désagréable, c’est de tirer sur quelqu’un qui rigole. Soit il est devenu fou, soit il te méprise. Les hurlements et les jurons, ça pleuvait des deux côtés. Faut jamais manger avant de faire ça. Moi je ne pouvais pas » (p.326-327).
Plus loin : « Tu sais, c’était rare, mais ça arrivait qu’on tombe sur un soldat à qui ça plaisait de tuer … On le retirait de l’équipe des exécutants et on le mutait ailleurs. On n’aimait pas les gens comme ça ». Pour finir là-dessus : « On oblige la personne à se mettre à genoux, et on tire avec son revolver presque à bout portant dans la tempe gauche … près de l’oreille. A la fin de la journée, on a la main qui pendouille comme un vieux chiffon. C’est surtout l’index qui déguste. Nous aussi, on avait un plan à remplir, comme partout. Comme à l’usine. Au début on n’y arrivait pas. On n’y arrivait pas physiquement. Alors ils ont fait venir des médecins, un conseil de médecins, et ils ont décidé de faire des massages aux soldats deux fois par semaine. Des massages de la main droite et de l’index droit » (p.327).
Svetlana Alexievitch, dans La Fin de l’homme rouge, a aussi recueilli une riche matière où apparaît, de façon éparse mais relativement nette, le portrait de ce qu’on appelle en général « l’âme russe ». Pour donner une idée approchante de la chose, disons que ce portrait est à même de provoquer chez les féministes exaltées le pire des urticaires virulents. Pensez : les femmes sont très généralement des mères dévouées, y compris pour leurs maris, et les hommes sont tous sommés de se conformer au rôle de héros virils, vodka comprise : « Nos hommes sont des martyrs, ils sont tous traumatisés, soit par la guerre, soit par la prison. Par les camps » (p.255). On voit que j’exagère à peine.
Ce qui frappe aussi, au moment de l’effondrement de tout le système soviétique en 1991, c’est la rapidité avec laquelle les voisins, russes et autres, sont devenus des ennemis. Du jour au lendemain, les Géorgiens, les Tadjiks, les Abkhazes, se sont jetés sur les Russes, brutalement considérés comme des étrangers ou des envahisseurs. Ils les ont chassés, parfois tirés comme des lapins. Alexievitch raconte l’histoire de cette femme qui a épousé un Russe, que son propre frère agonit d’injures pour ce seul motif. Je ne me rappelle plus s’il le tue.
On reconnaît le mécanisme qui a dressé les uns contre les autres, dans les années 1990, les Serbes contre les Croates ou les Bosniaques : ce fut brutal. Des voisins qui jusque-là vivaient en bonne entente, se mariaient et avaient des enfants ensemble, se retournent contre des voisins. Cela reste tout à fait incompréhensible : pourquoi la vie en bon voisinage devient-elle, du jour au lendemain, impossible, insupportable, inenvisageable ? Qu’est-ce qui fut mis sous le couvercle, pendant ces dizaines d’années ? Qui peut m’expliquer ? Cela dépasse l’entendement.
Dernier point à mentionner : le tableau que peint Svetlana Alexievitch de la vie quotidienne des gens simples, du petit peuple, que cela soit dans le régime soviétique ou après la chute de l’Empire, ne change guère. Certains considèrent même que leur situation nouvelle est pire qu’avant. Si la « perestroïka » a suscité l’enthousiasme, la façon dont toutes les entreprises publiques, après 1991 (Boris Eltsine), tout ce qui faisait le « bien commun » ont été dépecés, les remplit d’une profonde amertume, eux qui sont obligés de courir à droite et à gauche toute la journée, simplement pour trouver le moyen de survivre.
La fortune insolente et soudaine de ceux qu’on n’a pas tardé à appeler les « oligarques », les pouvoirs exorbitants que la richesse leur donne, sont proprement écœurants. Beaucoup ne les considèrent pas autrement que comme des gangsters. Est-il vrai que Vladimir Poutine, le « capo dei capi », en quelque sorte, possède quarante datchas ? Que sa fortune personnelle se monte à plusieurs milliards de dollars ? Le plus étonnant, dans certaines pages, c’est que beaucoup regrettent non pas le communisme, mais la perte de l’idéal exaltant auquel ils croyaient et qui les motivait.
Si La Fin de l’homme rouge ne ressemble pas à ce qu’on a coutume de nommer littérature, le travail de collecte auquel s’est livrée Svetlana Alexievitch pour composer ce livre aboutit à cet objet littéraire, certes non identifié, mais d’une puissance d’évocation que j’ai rarement rencontrée dans des romans plus traditionnels.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : svetlana alexievitch, la fin de l'homme rouge, littérature, prix nobel de llittérature, communisme, totalitarisme, staline, stalinisme, goulag, karaganda, urss, vladimir poutine

