samedi, 23 avril 2022
DES RUSSES ET DES UKRAINIENS
LES SECRETS DE LA MER NOIRE.
(Dupuis, 1994, scénario Jacques de Douhet, dessin Francis Bergèse)

Le navire "Ladoznskoye", commandé par le capitaine Stornik, appartient au K.G.B. (aujourd'hui F.S.B.) et participe au complot qui ne vise rien de moins que d'assassiner Gorbatchev, le promoteur de la "glasnost" et de la "perestroïka" honni par toute la "vieille garde", c'est-à-dire tous les "vrais communistes".
L'histoire racontée par les deux auteurs se situe entre juillet et août 1991, période cruciale qui a vu dans la réalité ce qui fut l'immense U.R.S.S. sombrer et passer à deux doigts de voir accéder au pouvoir des fascistes, avant qu'un certain Boris Eltsine parvienne in extremis à écarter le danger. Ce n'est qu'ensuite qu'a émergé la figure d'un certain Vladimir Poutine.
Il s'agit, pour les comploteurs de la B.D., d'en finir avec tous ceux qui s'éloignent du modèle "communiste" pur et dur, et de renouer avec l'époque où, magnifiquement dirigée par le camarade Brejnev, le digne héritier et successeur du camarade Staline, le "Soleil Rouge" de la fière nation soviétique faisait peur aux horribles impérialistes américains.
En face, les forces du Bien et du Progrès se concentrent autour du porte-avions Kousnetzov, commandé par l'amiral Frondze, vieux militaire dans l'âme et qui se sent un peu dépassé par les événements qui se présentent à l'horizon (« Rien de ma vie ou de ma carrière ne m'y a préparé », dit-il p.36).
Bergèse et De Douhet jettent dans ce panier de crabes l'intrépide colonel Buck Danny. A la suite d'un vilain stratagème, celui-ci est fait prisonnier à bord du Ladoznskoye. Dans les plans de Stornik et de ses affidés, il faut qu'aux yeux du monde entier le colonel passe pour l'assassin de Gorbatchev, même si ça doit déclencher la troisième guerre mondiale. Qu'on se rassure, le complot échouera lamentablement, grâce à l'intervention de l'enseigne Platypov, alias "Nicolayev 17", l'agent infiltré de l'amiral américain Farell qui est à l'origine de la mission de Danny.

Ce qui m'intéresse dans ces quelques vignettes, c'est ce qui est dit des rapports entre les Russes authentiques ("de souche" ?) et les Ukrainiens. Le Kremlin présentait ces derniers, il y a encore peu de temps comme des "petits frères", mais ce gros bobard, la guerre déclenchée par Poutine s'est empressée de le démentir.
Je ne sais pas quel degré de véracité il faut accorder aux expressions « C'est un Ukrainien stupide », « ... un imbécile d'Ukrainien comme toi ». Je trouve cependant intéressant de replacer ces propos fictifs dans le contexte — tristement réel celui-ci — qui se développe aujourd'hui sous nos yeux.
La question me semble valide : quel regard les Russes dans leur ensemble portent-ils sur les Ukrainiens ? J'ignore s'il est facile de répondre à cette question, et même si c'est possible, mais quand on entend Poutine vanter son entreprise de "dénazification" pour aller guerroyer en Ukraine, peut-être cela nous autorise-t-il à voir dans ces répliques un reflet plus ou moins fidèle de la réalité.

Cette bande dessinée a été publiée en 1994, alors que la situation et les rapports de force commençaient à se clarifier (?) dans la nouvelle Russie.
09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, les aventures de buck danny, francis bergèse, jacques de douhet, urss, gorbatchev, glasnost, perestroïka, russie, les secrets de la mer noire, kgb, fsb, boris eltsine, vladimir poutine, leonid brejnev, staline, dénazification, ukraine, donbass, kiev, kremlin
lundi, 14 février 2022
MORT D'UNE GRANDE DAME
Une grande dame vient de mourir. Une grande dame du droit. Je ne suis pas juriste, mais j'avais lu avec un immense intérêt Libertés et sûreté dans un monde dangereux (Seuil, 2010). J'écoutais avec le même immense intérêt ses cours au Collège de France, vous savez, à l'époque où France Culture diffusait, à l'usage de « la France qui se lève tôt » (citation), une émission intitulée "L'Eloge du Savoir", sous les auspices de Christine Goémé, entre cinq et six heures du matin.
Pour rendre hommage à l'impeccable juriste qui vient de mourir, je ne trouve rien de mieux que de republier un texte que j'avais écrit en 2015 après la lecture du livre cité ci-dessus. Les réflexions qu'il m'inspire encore sur les restrictions apportées à l'état de droit par les gouvernements successifs pourraient, je crois, alimenter utilement certains débats actuels et en particulier certains "convois de la liberté".
MADAME MIREILLE DELMAS-MARTY

L’inconvénient des formations juridiques, c’est qu’elles donnent en fin de parcours aux étudiants une tournure d’esprit excessivement attachée à la « lettre » du droit. D’où une certaine rigidité intellectuelle. Je ne sais pas si vous avez jamais mis le nez dans le texte de la « Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant » (1989) : à vous dégoûter de faire des enfants.
Et je ne parle pas du « Traité établissant une Constitution pour l’Europe », de sinistre mémoire, dont le pavé particulièrement indigeste (191 pages découpées en un déluge de parties, de chapitres, de sections, d'articles et de paragraphes), envoyé à tous les Français en 2005, après un rejet par référendum, leur a été enfoncé de force, légalement et démocratiquement dans la gorge par Nicolas Sarkozy, un peu plus tard, pour les punir d'avoir "mal voté" la première fois.
Libertés et sûreté dans un monde dangereux (Seuil, 2010), le livre de Mireille Delmas-Marty n’échappe pas à cette rigidité. En revanche, si les formations juridiques ont l'inconvénient que j'ai dit, elles ont l'avantage qui en découle : précision et exactitude. On appellera ça la rigueur. Un certain aspect « scolaire », si l’on veut, dans l’effort de construction, un peu « dissertation », avec introduction générale, trois parties subdivisées et chaque fois introduites et conclues, et une conclusion générale. Personne ne peut se perdre sur un parcours aussi visiblement balisé. La supériorité indéniable de cette méthode, c’est son impeccable netteté.
Alors, de ce livre un peu ardu pour l'éternel néophyte que je suis dans la langue des juristes, je ne retiens pas tout. Je laisse en particulier de côté ce qui fait la complexité et les vents contraires qui agitent les relations entre les instances juridiques nationales, européennes et internationales, les subsidiarités, les conflits, les résistances.
Je garderai juste la convergence de vues entre l’auteur et un juge dont j’ai lu récemment Le Rapport censuré (Jean de Maillard, voir mon billet du 9 mars), au sujet du poids incroyable que pèsent les Etats-Unis dans le domaine des relations (judiciaires et autres) internationales. Si je voulais résumer en simplifiant, je dirais que les Etats-Unis, non seulement se permettent tout quand leurs intérêts sont en jeu (Guantanamo, Bagram, …), mais font pression sur les autres nations pour qu’elles adoptent les mêmes critères qu’eux dans la « lutte contre le terrorisme ». Traduction : ils les y obligent, au motif de la loi du plus fort (le juge Maillard parle des transactions commerciales en dollar, qui doivent impérativement passer par une banque américaine sous peine de).
Ce qui m’a en revanche intéressé au plus haut point dans le livre de Mireille Delmas-Marty, c’est tout ce qu’elle dit de l’évolution inquiétante du droit, qu’il soit national ou international. Et pas dans le sens de l’Etat de droit. Je le dis tout net : tout en n’étant pas juriste, j’ai trouvé passionnante l’analyse qu’elle fait de deux conceptions opposées du droit, qui renvoient à deux conceptions antinomiques de l’humanité, l’une de tradition « humaniste », l’autre de tradition « guerrière ». Les gens au courant trouveront sûrement "basique" cette petite leçon de philosophie du droit. Elle est à mon niveau.
En France, traditionnellement, la justice attend qu'un individu ait commis un délit ou un crime pour le juger et le condamner, après établissement irréfutable des faits. L’auteur appelle cela « le couple culpabilité / punition », ajoutant que cette « école pénale » est « fortement influencée par Kant et Beccaria », c’est-à-dire qu’elle repose sur « l’universalisme des droits de l’homme » (p. 84-85)
Mais elle repose aussi sur l'idée que l'individu, sauf circonstances spéciales, sait ce qu'il fait. Il est mû par la raison, il est libre, donc il est responsable. "Justiciable", comme on dit. Le corollaire, c’est que personne ne peut être poursuivi avant. C’est l’acte qui fait le délinquant. C’est l’infraction qui justifie la poursuite. C’est un individu particulier qui est présenté au juge ("individualisation de la peine").
Or il existe une « école pénale » qui prône des idées radicalement autres. Une école dont la philosophie repose sur une « anthropologie guerrière ». Une école « positiviste », qui fait de l'homme, non un être libre et responsable, mais un être entièrement déterminé. Une école fondée par un certain docteur Lombroso au tournant du 20ème siècle. Une école qui invente le concept de « criminel-né ». Un juriste allemand, Carl Schmitt (1932), ira jusqu’à formuler l’idée d’ « ennemi absolu ». Deux concepts qui semblent s'imposer de nos jours.
Cette école divise donc l'humanité en une masse de gens normaux d'une part, et d'autre part une catégorie d’humains naturellement prédisposés à commettre des crimes. Des humains dans lesquels le Mal est inné (à supposer que tous les autres en naissent exempts). Mais le soupçon peut se porter pratiquement sur n'importe qui, étant donné que cette prédisposition ne se porte pas sur le visage. La preuve, c'est la stupéfaction des voisins quand le père tranquille tue sa femme, ou autres circonstances tragiques.
Selon cette conception, on ne parle plus de « culpabilité », mais de « dangerosité potentielle ». On ne parle plus de « peines de prison », mais de « mesures de sûreté », aux contours éminemment flous, à durée indéfinie. Ce n'est plus ce que vous avez fait qui compte, mais ce qu'un collège d' « experts » vous aura jugé capable de commettre dans l'avenir.
Autrement dit, on passe du diagnostic (acte avéré) au pronostic (acte potentiel, virtuel ). Sarkozy, on s’en souvient, était même allé jusqu’à proposer un « dépistage » précoce (dès trois ans) de la dangerosité future des enfants. Si vous enfermez un type pour des actes qu’on l’imagine potentiellement capable de commettre, il passera sa vie derrière les barreaux, plus sûr moyen de ne jamais savoir s’il en aurait commis.
Autrement dit, dès la naissance, il y a les humains et les autres. Des « monstres », pourquoi pas. Souvent présentés comme tels, en tout cas. Cette conception est éminemment anti-humaniste. Je reste convaincu qu'Adolf Hitler, Staline, Pol Pot et consort ne sont pas des monstres inhumains, mais qu'ils font hélas partie de l'espèce humaine. Hitler et Pol Pot sont nos semblables. Je déteste l'idée, mais je la crois vraie. L'horreur est humaine, trop humaine.
De plus, Mireille Delmas-Marty pointe, chez Carl Schmitt, une tendance à assimiler dans la même personne l’ « ennemi absolu » et le « criminel-né ». C’est-à-dire qu’il fusionne potentiellement deux institutions : celle destinée à maintenir l’ordre et celle destinée à défendre le territoire national contre une attaque étrangère.
Maintien de l’ordre et guerre reviendraient alors à une tâche unique. Armée et police même combat, avec pour conséquence l'extension de la notion d' « état d'urgence » dans le temps et dans l'espace, avec toutes les restrictions à l' « état de droit » que cela suppose. Je pose la question : qu'est-ce que c'est, l'opération « Vigipirate » (à laquelle vient de succéder « Sentinelle ») ? La « loi renseignement » est du même tonneau.
Elle cite un certain Gunther Jakobs, qui réclame le droit pour la société de « se défendre par des mesures radicales comme l’internement de sûreté ou la création de camps du type de celui de Guantanamo ou de Bagram ». Le vocabulaire employé pour justifier aujourd'hui l'action de l'armée française en Afrique et ailleurs (« Sécurité » ? « Maintien de la Paix » ? « Guerre au terrorisme » ?) est assez élastique pour tout confondre.
Pour le coup, l'état d'urgence tend à se pérenniser, étant entendu que l'urgence devient une norme permanente. C'est comme la drogue : ça commence par le plaisir, ça continue par la dépendance, et après une phase d'accoutumance (augmentation incessante de la dose), ça finit par une overdose.
Ce qui ressort, en définitive, de tout le livre, c’est ce qu’on voit se développer dans toutes les directions depuis le 11 septembre 2001 : la collecte généralisée des données, en particulier des données personnelles. Le nœud coulant policier, dans le monde entier, se resserre autour du cou des individus, que ce soit pour des raisons commerciales (profilage algorithmique des habitudes des consommateurs) ou pour satisfaire le besoin toujours accru de sécurité collective (repérage de mots-clés supposés se rapporter au terrorisme).
Tout cela se passe avec la complicité des plus hautes instances juridiques (Conseil constitutionnel en France, Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne, …) qui avalisent, non sans contradictions, des lois restreignant les droits, même si d’autres institutions font de la résistance (Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), par exemple).
Bref, en plein débat sur la « loi renseignement », ce livre de 2010 est encore plus actuel, et devrait alerter les défenseurs de ce qui reste de l’ « état de droit ». Un témoignage de plus sur l’aspect peu ragoûtant du monde qui est en train de mijoter sur les fourneaux de tous les pouvoirs.
Merci madame, pour la confirmation. Total respect.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : Je préfère ne pas trop évoquer l'optimisme de commande que Mireille Delmas-Marty manifeste en conclusion. Elle veut parier sur la raison des hommes et leur « communauté de destin », plutôt que sur la crainte que s'établissent des « sociétés de la peur ». Je veux bien. C'est son droit. En tant que grande universitaire, elle ne se sent peut-être pas le droit de faire autrement. On n'est pas obligé de partager cet optimisme, vu les évolutions actuelles sur de multiples terrains différents (politique, société, économie, écologie, ...).
***
On a eu le temps de perdre de vue le contexte de l'époque qui a assisté aux débats sur la « loi renseignement », mais sept ans après cette lecture marquante et après deux ans d'alerte sanitaire constante quoique sinusoïdale au gré des navigations à vue et des "stop and go" du gouvernement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup à changer ou ajouter.
Quand Mireille Delmas-Marty a pris sa retraite en 2012, c'est monsieur Alain Supiot qui lui a succédé. Si ses perspectives sont très différentes de celles de notre grande dame, son propos reste accroché à une altitude où la raréfaction de l'air nécessite une contention permanente de l'esprit : la densité des analyses n'est pas faite pour les paresseux.
En témoigne une lecture que je ne suis pas près d'oublier et que je conseille à tous les lecteurs avides de comprendre dans quel monde les pouvoirs modernes cherchent à nous faire vivre : La Gouvernance par les nombres.
TOTAL RESPECT !!
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mireille delmas-marty, libertés et sûreté dans un monde dangereux, état de droit, france, société, jean de maillard, imanuel kant, beccaria, docteur lombroso, carl schmitt, adolf hitler, staline, pol pot, guantanamo, france culture, christine goémé, collège de france, alain supiot, la gouvernance par les nombres
samedi, 15 juin 2019
ECOLOGIE = ANTICAPITALISME 2/2
2
Donc l’anticapitalisme dont je parle n'est en rien "communiste", mais exclusivement écologique, et l'écologie authentique dont je parle est exclusivement anticapitaliste, sachant qu'il ne s'agit ici en aucune manière d'un choix "politique" au sens pépère (= gauche/droite), tout au plus d'un choix politique, au sens où l'entendaient les Grecs, impliquant la décision de tout le corps social dans le choix de son organisation et de son mode de vie.
Car le seul, l'unique, l'exclusif coupable des crimes écologiques actuels (pillage des ressources, destructions innombrables, poubellisation généralisée, ...), c'est le capitalisme industriel et productiviste. Et ce brillant résultat a été vendu à l’humanité grâce à un argumentaire où scintillaient toutes les promesses miraculeuses : l’arracher à la malédiction biblique de la souffrance et du travail, et lui apporter tout à la fois bonheur, prospérité, confort et raton laveur.
L’économie capitaliste a atteint cet objectif, inutile de le nier, et chacun (moi compris) est heureux ou désireux de profiter de ses apports. Au passage, c'est fou ce qu'elle a pu inventer et fabriquer en matière de ratons laveurs superflus et inutiles, pour amuser, divertir, détendre, détourner l'attention, etc. Et s'enrichir. Je veux évidemment parler des "gadgets" et autres marchandises sans utilité, le raisonnement étant fondé sur : « Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver à leur vendre ? ».
Cette réussite a été rendue possible par l’invention de toutes sortes de moteurs, je veux dire de moyens de produire de la force (vapeur, pétrole, électricité, …) par des moyens artificiels (je fais abstraction du moulin à vent, de la voile ou de la roue à aube, qui ne faisaient qu’utiliser – intelligemment – l’énergie produite par la nature). Avec le moteur, l’homme a forcé la nature à lui donner infiniment plus que ce dont elle était capable spontanément.
Bien sûr, un moteur consomme le potentiel énergétique qu'on lui injecte, et la quête effrénée de sources d'énergie qui en découle est une partie cruciale du problème actuel. Toute la civilisation actuelle repose sur le moteur et son carburant. C'est sur le moteur que l'humanité a fait retomber l'essentiel de la quantité de travail. Enlevez le moteur, que reste-t-il ? Tout le monde à la réponse : de combien de moteurs nous servons-nous dans une journée ?
Le capitalisme a donc réussi, mais d'une part en réservant tous les fruits de la récolte à une infime minorité de privilégiés (pays "riches"), et d'autre part en prenant soin, tout au long de son développement, de glisser sous le tapis toutes les saloperies que la machine qu’il avait mise en route jetait à tous les vents, dans toutes les eaux, dans tous les sols et dans tous les êtres.
Il y a maintenant plus d’un demi-siècle que de grands illuminés (la liste est connue) ont été assez perspicaces pour voir que le "développement" étendu à tous les pays conduisait à une impasse, que le tapis n'était plus assez grand pour tout cacher, et que les saloperies commençaient à déborder par tous les pores de la nouvelle civilisation. Ils furent aussi assez inconscients pour proclamer cette vérité à la face du monde, en tenant pour négligeable de passer pour des rigolos ou des faux prophètes. C’est pourtant eux qui avaient raison, c’est aujourd’hui avéré. Et il est sans doute trop tard pour remédier à la folie qui a produit la catastrophe à laquelle nous assistons sans trop nous en formaliser encore (ça commence à remuer vaguement, mais concrètement ? et à quel rythme ?).
Le capitalisme productiviste et technico-industriel s'est imposé il y a deux siècles. A partir de là, il a répandu le Mal (la démesure). Nos ancêtres y ont goûté : ils ont trouvé le Mal délectable, ils en ont vu les bienfaits présents, les bénéfices futurs et, pour tout dire les « progrès » promis à l’humanité. Ils ont donc accueilli le Mal à bras ouverts, avec joie et fierté, persuadés d’œuvrer pour le Bien. Ils ont bu jusqu'à l'ivresse le philtre d'amour du progrès technico-industriel offert par Méphisto (voir le second Faust, je ne sais plus dans quelle scène), qui devait rendre l'humanité puissante et invulnérable. Tragique erreur.
Et nous-mêmes en sommes tellement gorgés qu’il est devenu indissociable de notre être. Qu'il est devenu notre chair, notre nature, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Nous respirons capitaliste, nous mangeons capitaliste, nous buvons capitaliste, nous forniquons capitaliste, nous déféquons capitaliste, nous dormons capitaliste, nous éduquons capitaliste, nous pensons capitaliste, etc. La moindre de nos cellules est capitaliste jusqu'au noyau. Comment logerait-on un écologiste dans ce milieu hostile ?
En un mot : chacun de nous est tout entier capitaliste, de la tête aux pieds, du sol au plafond, du cœur à la peau, du fond à la surface et de la naissance à la mort. Mieux : chacun de nous (y compris moi) est en soi un capitalisme en réduction, puisqu'il en est le produit, et militant avec ça, puisque le fait de consommer alimente le système (comment faire autrement ?). Chacun de nous se trouve dès sa naissance petit porteur de tout le capitalisme. Chacun de nous devient dès lors une parcelle vivante du système capitaliste.
Nous n'avons pas le choix : au mieux, complices taraudés par le doute ; au pire, partisans enthousiastes. Qu'ils soient velléitaires ou résolus, portés par la mauvaise conscience ou par la haine, tièdes ou bouillants, qu'ils aient la ferme intention de détruire le capitalisme ou qu'ils travaillent à le corriger ou à l'améliorer, les ennemis du système sont eux aussi pris dans le système, et du coup sont bourrés de contradictions.
Je veux dire que nous sommes tous si intimement imprégnés de ce que le capitalisme a fait du monde et des hommes qu’il est absolument inenvisageable de nous enlever la moindre parcelle du système sans nous arracher un morceau vital de chair. Nous hurlerions sous la torture. Il suffit pour s’en rendre compte de voir ce que nous coûtera l’abandon de misères telles que les touillettes, les cotons-tiges, et tous les objets en plastique à usage unique. Ne parlons pas du smartphone.
Alors dans ces conditions, tout ce que proposent sincèrement les gens conscients, actifs et responsables pour que le pire n’arrive jamais, tous les appels aux gouvernants, aux puissants, aux industriels et même aux individus, tout cela n’est que poudre de perlimpinpin, miroir aux alouettes, faux espoirs et charlatanerie. Tous les « Discours de Politique Générale » de tous les Edouard Philippe auront beau se « teinter de vert » (« Plus personne n’a aujourd’hui le monopole du vert ! », a-t-il textuellement scandé le 12 juin), on restera très loin du compte. Je dirai même : à côté de la plaque.
Et le succès de Yannick Jadot aux élections européennes reste, sur le planisphère des activités humaines, une voie de garage, même s'il indique la persistance d'un sentiment de culpabilité des populations à l'égard de la nature naturelle (enfin, ce qui en subsiste) : à quel taux de probabilité s'élèvent ses capacités d'action efficace ? Ses possibilités de transformer l'existant ? Combien sont-ils, les Verts, au Parlement européen ? Et qu'est-ce que le Parlement européen, dans le vaste chaudron de la mondialisation ?
***
Cette hypocrisie générale, ce mensonge n’est plus de mise. Thomas Piketty a bien raison d'intituler sa chronique du Monde du 9 juin 2019 "L'illusion de l'écologie centriste". Malheureusement, il se contente d'observer les jeux de vilains des politicards en présence, du coup la portée de son papier en souffre. Ce n’est pas de demi-mesures, d'accommodements courtois, de corrections à la marge, de remèdes de surface que l’humanité a besoin : ce serait d’un retour radical et volontaire à une conception raisonnable de tous nos rapports avec le monde. Carrément l'utopie, quoi !
C’est précisément cette conception que nous avons perdue et oubliée depuis deux siècles : nous avons quitté sans retour le monde ancien. Et malgré tous les hypocrites "c'était mieux avant" ou "c'était le bon temps", nous nous félicitons à chaque instant, par nos gestes mêmes, du fait que ce monde ancien nous soit devenu étranger (ringard, vieillot, suranné, etc.). Si par extraordinaire nous décidions de retrouver ce mode de vie (frugalité, sobriété, etc.), l’événement serait d’une violence insoutenable (y compris pour moi).
Vous imaginez la quantité astronomique de travail qui nous retomberait sur le dos ? Ce serait une conversion infiniment douloureuse. De façon plus réaliste, je crois que la perte est définitive et irréversible : on n'arrête pas une machine qui a les dimensions de la planète et qui régente l'existence de (presque) tout le monde..
Et si beaucoup de gens souhaitent "faire des gestes pour la planète" (nous culpabilisons), personne n'a vraiment compris. Je veux dire que personne n'est prêt (moi compris) à perdre tout ce qu'il faudrait pour retrouver l'équilibre perdu. Parce que ce serait individuellement trop coûteux. Sans même parler des efforts constants du système pour accroître sa puissance et son emprise, personne ne peut s'extraire de l'engrenage, même les écologistes convaincus, qui aiment se raconter de belles histoires (consommer "bio", circuits courts, agriculture raisonnée, permaculture, etc.). A quelle hauteur s'élève leur refus du système ? Leurs concessions au système ? Tout ça ressemble à : « Encore quelques minutes, monsieur le bourreau ! ».
Il nous faudrait réapprendre tout ce que nos ancêtres connaissaient par cœur. Dans quelle école apprendrions-nous aujourd’hui ce dont nous nous sommes dépouillés avec soulagement et enthousiasme il y a deux siècles et dont nous avons perdu la mémoire ? Comment trouverions-nous, sept milliards que nous sommes, un terrain d’entente avec la nature, avec la planète, avec le monde, bref : avec les nécessités irréductibles de la nature et des éléments ?
Quel coup de baguette magique nous inculquerait le sens et le respect des limites à ne pas dépasser, que l’humanité a respectées pendant pas mal de millénaires, et dont nous avons fait en deux cents ans des guenilles indignes d’être portées, que nous avons jetées aux orties ? L'humanité présente éprouve une haine viscérale des limites, comme le montrent à profusion les inventions des "créateurs culturels" dans leurs spectacles où fourmillent la transgression, l'attentat aux tabous, le franchissement des limites. Après toutes les Déclarations des droits humains, à quand la signature solennelle de la Déclaration Universelle des Limites Humaines ?
L’humanité présente est une Cendrillon qui n’a pas entendu les douze coups de minuit : il nous reste la citrouille, les rats et les trous dans la pantoufle de vair. Grâce à la machine du capitalisme industriel et productiviste, l’humanité retournera dans son taudis avec les pieds écorchés.
Malheureusement, il nous reste quand même, indéracinable, le rêve de la splendeur du palais princier, le rêve des vêtements chamarrés du bal de la cour. Il nous reste le rêve du bonheur définitif, le rêve de l’abondance des biens, le rêve des fontaines où coulent l’or de nos désirs et les diamants de la certitude de pouvoir les assouvir : la créativité humaine (l'innovation technique) reste pour nous infinie, et nous n'avons ni les moyens ni l'envie d'inverser le cours de l'histoire.
L’humanité présente rêve. Elle vit dans un conte de fées. Elle a fait de la planète un Disneyland géant en même temps qu'une poubelle, et n’envisage à aucun prix d’en sortir. L’humanité, qui a les pieds dans la merde, ne renonce pas à ses rêves sublimes, et ce ne sont pas les écologistes qui la réveilleront. La réalité l’attend au coin du bois.
« La mort lui fit au coin d'un bois le coup du père François ».
"Grand-père", Georges Brassens.
En résumé, si, pour être écologiste, il faut détruire le capitalisme, il faudrait en même temps dire comment on fait. Jusqu'ici, le capitalisme a régulièrement prouvé qu'il était increvable : il a tout digéré, y compris ses pires ennemis. Paul Jorion déclarait assez justement que les capitalistes ne feraient quelque chose pour sauver la planète que si ça leur rapportait. Autrement dit : aucune issue. Tant que l'écologie ne consiste qu'en pratiques fort sympathiques, mais infinitésimales, soigneusement montées en épingle par ses partisans, et qu'elle n'a, à part ça, que des mots à opposer au système capitaliste, celui-ci peut dormir tranquille : il ne sera pas dérangé.
Moralité : être écologiste aujourd'hui, ça n'existe pas. Et ça n'est pas près d'exister.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : changement climatique, écologie, défense de l'environnement, politique, écologistes, yannick jadot, eelv, parti écologiste, énergies renouvelables, développement durable, tri sélectif, biocoop, consommacteur, anticapitaliste, urss, kgb, goulag, communisme, staline, bolchevique, marxisme, collectivisme, npa, nouveau parti anticapitaliste, olivier besancenot, course à la bombe, course à la lune, stakhanovisme, amérique, droits de l'homme, industrialisme, productivisme, lendemains qui chantent, parti communiste, svetlana alexievitch, alexievitch la supplication, pillage des ressources, méphistophélès, goethe, second faust, emmanuel macron, édouard philippe, déclaration de politique générale, journal le monde, thomas piketty, disneyland, georges brassens, paul jorion
vendredi, 14 juin 2019
ÉCOLOGIE = ANTICAPITALISME 1/2
1
Toutes les grandes âmes, politiques ou autres, se rendent compte aujourd’hui que les populations électorales et consommatrices sont de plus en plus préoccupées par l’état de la planète, le changement climatique, l’empoisonnement chimique de l’environnement et autres réalités antipathiques. En un mot, les populations sont de plus en plus sensibles aux questions écologiques.
Pour leur donner l’impression qu’ils gardent un peu la maîtrise des choses, tous les "amis du peuple" qui briguent ses suffrages ont inscrit la protection de l’environnement à leur programme, sous forme de quelques virgules verdâtres, quelques phrases de sinople ou quelques paragraphes smaragdins, bref : des déclarations d'intention. Disons-le : ils veulent juste faire joli, et ça ne tire pas à conséquence. Le programme du parti écologiste lui-même, dont le chef provisoire ne vise rien de moins que la conquête du pouvoir (déclaration récente de Yannick Jadot), est – et c’est logique – entièrement consacré à ce thème.
Tous ces braves gens mentent effrontément. Ils mentent quand ils parlent de « développement durable ». Ils mentent quand ils parlent de « croissance verte ». Ils mentent quand ils enfourchent le cheval des « énergies renouvelables ». Ils mentent quand ils parlent de « consommateurs responsables » et de « tri sélectif ». Et la chaîne Biocoop se fout de nous, avec son slogan sur le "consommacteur". Pour résumer, dans la vie politique, l'écologie reste une potiche garnie d'une plante verte dans un coin de la scène où pérorent les responsables.
S’agissant d’écologie et de défense de l’environnement, il n’y a qu’une seule vérité : personne n’est écologiste s’il n’est pas résolument anticapitaliste. Aucun humain ne peut se prétendre écologiste s’il ne considère pas le capitalisme comme l’Ennemi à détruire. Toute autre position, qui accepte de transiger avec ce principe est une lâcheté, une tricherie, un mensonge, une imposture. Partant de cette prémisse, on aura beau chercher un écologiste avec une lanterne à la main, on n'en trouvera pas. Cela veut dire accessoirement que tout le monde ment, y compris les écologistes estampillés.
***
Le titre de ce billet est en soi un pléonasme. Pour être vraiment écologiste, il faut être un anticapitaliste résolu. J'avoue que, politiquement, le problème est difficile à résoudre. Dans les croyances les plus répandues, se déclarer anticapitaliste, c'est automatiquement être étiqueté bolchevique, marxiste, collectiviste, communiste, et toutes ces vieilles représentations armées d'un couteau entre les dents, où la planification autoritaire voisine avec la police politique, le Goulag, le KGB et les charmants souvenirs qu’a laissés le camarade Staline, petit père des peuples par antiphrase.
Cet anticapitalisme-là est une sinistre farce qui a été soigneusement entretenue par l'armée des agents de l'URSS à l'étranger connus sous le nom de "partis communistes". Car contrairement à la légende, l’URSS n’était pas anticapitaliste (Lénine a réprimé les premiers vrais soviets) : après 1945, elle fut seulement antiaméricaine. Et ça change tout. Ce qu'on nous a présenté pendant presque un siècle comme la patrie de l'anticapitalisme n'était ni plus ni moins qu'un autre système capitaliste, mais un capitalisme d'Etat, c'est-à-dire opposé au capitalisme à l'américaine, fondé, lui, sur la libre entreprise et l'initiative individuelle.
Dans l'un, tout était fait pour favoriser la libération des énergies des hommes entreprenants et courageux, dans l'autre, tout était administré par le couvercle d'une bureaucratie tatillonne et policière. – Soit dit par parenthèse, le rejeton bâtard de l'URSS nommé Nouveau Parti Anticapitaliste (Olivier Besancenot) ne fait que brouiller la donne. Heureusement : qui y croit ? Je ferme la parenthèse.
En dehors de cette différence – cruciale pour ce qui est des droits de l'homme – on aurait pu calquer à peu près le système soviétique sur le système américain : les deux s'entendaient à merveille pour faire de l’industrialisme et du productivisme à outrance l'alpha et l'oméga de la perfection des inventions humaines (voir par exemple la course à la bombe, la course à la Lune, les Jeux olympiques, ...). Le seul moteur qui alimentait l'antagonisme sauvage (quoique mimétique) que tout le monde prenait pour une incompatibilité de nature, une antinomie essentielle, c'était la performance dans tous les domaines possibles.
On se souvient du mythe de Stakhanov, ce "héros" du prolétariat mondial capable de remonter du fond de la mine cinq fois plus de charbon que le communiste ordinaire ; on se souvient de la souveraineté du "Plan" dont, systématiquement, le Soviet suprême concluait a posteriori que "le bilan était globalement positif". L'Amérique et l'URSS se sont simplement tiré la bourre pendant un demi-siècle pour savoir lequel des deux serait capable d'étouffer l'autre sous la masse supérieure de ses performances économiques, scientifiques et militaires chiffrées.
L'URSS a trahi tous les gogos qui ont cru aux "lendemains qui chantent". Une trop longue illusion qui a plongé toutes les gauches et les travailleurs de la planète entière dans la stupeur et le découragement quand l'imposture, au début des années 1990, s'est brutalement révélée pour ce qu'elle était, et que le "communisme" s'est désintégré sous nos yeux, dans une déflagration soudaine, comme par un effet de prestidigitation, où les apparatchiks purs et durs ont su se glisser du jour au lendemain dans le costume rutilant (et mafieux) des "oligarques" gourmands et forcenés. L'URSS abattue a laissé le champ libre aux Etats-Unis, qui ont pu croire que l'ennemi était définitivement à terre, et qu'il ne se relèverait jamais.

Vignette quasi-conclusive de Les Secrets de la Mer noire, de Bergèse et De Douhet, n°45 de la série "Buck Danny". Le volume est paru en 1994 !!!
Pour ce qui est du productivisme, de l’industrialisme et de la destruction de la nature, USA et URSS s’entendaient comme larrons en foire, avec cependant une prime aux soviétiques qui se souciaient de la vie humaine et de la sauvegarde de l'environnement encore moins que les Américains (c'est tout dire), comme l’ont montré les premières interventions après l’accident de Tchernobyl (voir La Supplication, de Svetlana Alexievitch, Lattès, 1998). Et il paraît qu’il vaut mieux ne pas tremper un orteil dans les eaux de Mourmansk ou de la Mer blanche, à cause des déchets innommables qui y ont été immergés.
Le capitalisme, incarné par son champion américain, est un anti-écologiste endurci, c'est sa nature, on le sait. Mais son ennemi déclaré, la soi-disant anticapitaliste et "communiste" URSS, était encore plus anti-écologiste que lui. L'écologie est le seul anti-capitalisme authentique.
A suivre.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : changement climatique, écologie, défense de l'environnement, politique, écologistes, yannick jadot, eelv, parti écologiste, énergies renouvelables, développement durable, tri sélectif, biocoop, consommacteur, anticapitaliste, urss, kgb, goulag, communisme, staline, bolchevique, marxisme, collectivisme, npa, nouveau parti anticapitaliste, olivier besancenot, course à la bombe, course à la lune, stakhanovisme, amérique, droits de l'homme, industrialisme, productivisme, lendemains qui chantent, parti communiste, svetlana alexievitch, alexievitch la supplication
mercredi, 12 octobre 2016
ÇA FAISAIT DES BULLES …
… C’ÉTAIT RIGOLO.
Au premier rang des cimaises de ma galerie BD.

Hugo Pratt : ici Corto Maltese en Sibérie, en compagnie de Nino Ferrer rhabillé en "Capitaine Nino". Corto, ce personnage entré en France par l'entremise de Pif gadget, qui s'efforce d'empêcher les fantômes de son passé (autrement dit la nostalgie, ou alors les regrets) de l'envahir, bien qu'on sache que sa route a croisé (outre Bouche dorée, le professeur Steiner, Venexiana Stevenson ou l'officier Sorrentino), en 1907, celle de Staline, quand celui-ci était portier de nuit à Ancône ou voleur des cloches de l'église arménienne Saint-Lazare à Venise (La Maison dorée de Samarkand) ; ou, en France, quelque part entre Zuydcoote et Bray-Dunes entre 1914 et 1918 (Les Celtiques), un Rotschild dont il est impatient d'aller goûter le bordeaux ; ou encore, toujours entre 14 et 18, mais en Italie cette fois, du côté de Sette Casoni, un certain armateur grec du nom transparent d'Onatis (Sous le Drapeau de l'argent) ; l'auteur, en restant savamment allusif, crée ainsi, derrière son personnage, une étonnante profondeur de champ historique qui lui confère une épaisseur dont il n'est pas dénué par ailleurs, qui est sans doute pour quelque chose dans le pouvoir de fascination qu'il exerce ; Corto Maltese pourrait à bon droit endosser la paternité de cet alexandrin :
« J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans »
(est-il besoin de préciser que l'auteur s'appelle Baudelaire ?),
dans (A suivre) n°4.
09:05 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, hugo pratt, bd, corto maltese, nino ferrer, staline, la maison dorée de samarkand, rotschild, zuydcoote bray dunes, pratt les celtiques, aristote onassis, armateur grec, j'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans, baudelaire
samedi, 07 mai 2016
S.A. NOBEL DE LITTÉRATURE
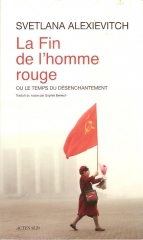 2
2
La Fin de l’homme rouge, livre de Svetlana Alexievitch, est bourré de la souffrance du peuple russe. L’étonnant, c’est que certains communistes intimement convaincus sont restés d’indéfectibles fidèles du Parti, même après avoir passé dix ans dans les camps de travail sibériens, pour avoir dévié si peu que ce soit de la « ligne » officielle, du moins dans l’acte d’accusation que la police rédigeait et, au besoin, fabriquait intégralement pour les besoins de la cause (ce gars qui, sous la torture, avoue qu’il est un espion, puis demande au juge d’instruction pour qui il est convenu d’espionner et qui, face à l’échantillon que l’autre lui présente, opte pour l’espionnage au profit des Polonais). Beaucoup ont toujours ignoré jusqu’au motif réel de cette accusation.
En tout cas, d’innombrables Russes (et autres) non communistes (ou pas assez), mais aussi des communistes pur jus, ont eu à connaître les camps. Tout le monde a entendu parler du Goulag, acronyme signifiant « administration centrale des camps ». L’URSS en a compté des milliers, répartis sur tout le territoire soviétique (ce que veut dire l' "Archipel" dont parle Soljenitsyne). Parmi eux, celui de Karaganda, où Anna Maïa, architecte de 59 ans, raconte que, petite fille, elle dut y suivre sa mère, qui avait été condamnée, et qu’elle y est, devenue adulte, retournée, dans une sorte de pèlerinage. Ensuite, elle se dit qu’elle n’aurait pas dû.
Voici ce qu’elle raconte. Elle est assise dans l’autobus, à côté d’un vieillard qui lui parle du camp, autrefois : « "Vous parlez des baraques ? On a détruit les dernières il y a deux ans. Avec les briques, les gens se sont construit des remises, des saunas. Les terrains ont été vendus pour y construire des datchas. On se sert des barbelés pour délimiter les potagers. Mon fils a un terrain ici. Eh bien, vous savez, ce n’est pas très agréable … Au printemps, avec la fonte des neiges et les pluies, des ossements remontent au milieu des pommes de terre. Ça ne dérange personne, on a l’habitude. Ici, les os, c’est comme les cailloux, il y en a partout … On les jette le long des terrains, on marche dessus … On les piétine. On est habitués ! Dès qu’on commence à creuser, ça grouille littéralement …" J’avais le souffle coupé, j’ai cru que j’allais m’évanouir. Le vieux s’est tourné vers la fenêtre : "Tenez, là-bas, derrière ce magasin, ils ont comblé un cimetière. Et là-bas aussi, derrière les bains." Je n’arrivais plus à respirer. A quoi m’étais-je attendue ? A voir des pyramides ? Des monuments funéraires ? » (p.308). A ne pas lire au moment de l’apéro.
Non plus que cet autre passage, où l’ancien colonel devenu homme d’affaires raconte le mariage qu’il a failli faire, et auquel il a renoncé après avoir rencontré son futur beau-père, dont il restitue les discours tenus un jour de boisson forte : « Je suis un soldat, moi ! On me donnait des ordres, et j’obéissais. J’exécutais des gens. Si on t’en donnait l’ordre, tu le ferais, toi aussi. Tu-le-fe-rais, nom de Dieu ! Je tuais des ennemis. Des saboteurs. Il y avait un papier officiel avec écrit dessus : "Condamné à la mesure suprême de défense sociale". Une sentence du gouvernement … Ah, c’était du boulot, je te dis pas ! Si le type n’est pas tué sur le coup, il s’écroule et il gueule comme un porc … Il crache du sang … Le plus désagréable, c’est de tirer sur quelqu’un qui rigole. Soit il est devenu fou, soit il te méprise. Les hurlements et les jurons, ça pleuvait des deux côtés. Faut jamais manger avant de faire ça. Moi je ne pouvais pas » (p.326-327).
Plus loin : « Tu sais, c’était rare, mais ça arrivait qu’on tombe sur un soldat à qui ça plaisait de tuer … On le retirait de l’équipe des exécutants et on le mutait ailleurs. On n’aimait pas les gens comme ça ». Pour finir là-dessus : « On oblige la personne à se mettre à genoux, et on tire avec son revolver presque à bout portant dans la tempe gauche … près de l’oreille. A la fin de la journée, on a la main qui pendouille comme un vieux chiffon. C’est surtout l’index qui déguste. Nous aussi, on avait un plan à remplir, comme partout. Comme à l’usine. Au début on n’y arrivait pas. On n’y arrivait pas physiquement. Alors ils ont fait venir des médecins, un conseil de médecins, et ils ont décidé de faire des massages aux soldats deux fois par semaine. Des massages de la main droite et de l’index droit » (p.327).
Svetlana Alexievitch, dans La Fin de l’homme rouge, a aussi recueilli une riche matière où apparaît, de façon éparse mais relativement nette, le portrait de ce qu’on appelle en général « l’âme russe ». Pour donner une idée approchante de la chose, disons que ce portrait est à même de provoquer chez les féministes exaltées le pire des urticaires virulents. Pensez : les femmes sont très généralement des mères dévouées, y compris pour leurs maris, et les hommes sont tous sommés de se conformer au rôle de héros virils, vodka comprise : « Nos hommes sont des martyrs, ils sont tous traumatisés, soit par la guerre, soit par la prison. Par les camps » (p.255). On voit que j’exagère à peine.
Ce qui frappe aussi, au moment de l’effondrement de tout le système soviétique en 1991, c’est la rapidité avec laquelle les voisins, russes et autres, sont devenus des ennemis. Du jour au lendemain, les Géorgiens, les Tadjiks, les Abkhazes, se sont jetés sur les Russes, brutalement considérés comme des étrangers ou des envahisseurs. Ils les ont chassés, parfois tirés comme des lapins. Alexievitch raconte l’histoire de cette femme qui a épousé un Russe, que son propre frère agonit d’injures pour ce seul motif. Je ne me rappelle plus s’il le tue.
On reconnaît le mécanisme qui a dressé les uns contre les autres, dans les années 1990, les Serbes contre les Croates ou les Bosniaques : ce fut brutal. Des voisins qui jusque-là vivaient en bonne entente, se mariaient et avaient des enfants ensemble, se retournent contre des voisins. Cela reste tout à fait incompréhensible : pourquoi la vie en bon voisinage devient-elle, du jour au lendemain, impossible, insupportable, inenvisageable ? Qu’est-ce qui fut mis sous le couvercle, pendant ces dizaines d’années ? Qui peut m’expliquer ? Cela dépasse l’entendement.
Dernier point à mentionner : le tableau que peint Svetlana Alexievitch de la vie quotidienne des gens simples, du petit peuple, que cela soit dans le régime soviétique ou après la chute de l’Empire, ne change guère. Certains considèrent même que leur situation nouvelle est pire qu’avant. Si la « perestroïka » a suscité l’enthousiasme, la façon dont toutes les entreprises publiques, après 1991 (Boris Eltsine), tout ce qui faisait le « bien commun » ont été dépecés, les remplit d’une profonde amertume, eux qui sont obligés de courir à droite et à gauche toute la journée, simplement pour trouver le moyen de survivre.
La fortune insolente et soudaine de ceux qu’on n’a pas tardé à appeler les « oligarques », les pouvoirs exorbitants que la richesse leur donne, sont proprement écœurants. Beaucoup ne les considèrent pas autrement que comme des gangsters. Est-il vrai que Vladimir Poutine, le « capo dei capi », en quelque sorte, possède quarante datchas ? Que sa fortune personnelle se monte à plusieurs milliards de dollars ? Le plus étonnant, dans certaines pages, c’est que beaucoup regrettent non pas le communisme, mais la perte de l’idéal exaltant auquel ils croyaient et qui les motivait.
Si La Fin de l’homme rouge ne ressemble pas à ce qu’on a coutume de nommer littérature, le travail de collecte auquel s’est livrée Svetlana Alexievitch pour composer ce livre aboutit à cet objet littéraire, certes non identifié, mais d’une puissance d’évocation que j’ai rarement rencontrée dans des romans plus traditionnels.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : svetlana alexievitch, la fin de l'homme rouge, littérature, prix nobel de llittérature, communisme, totalitarisme, staline, stalinisme, goulag, karaganda, urss, vladimir poutine
vendredi, 06 mai 2016
S.A. NOBEL DE LITTÉRATURE
SVETLANA ALEXIEVITCH
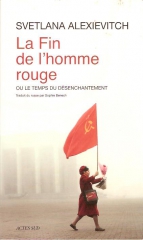 1
1
Quel livre terrible que La Fin de l’homme rouge, ce gros livre (542 pages grand format) de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature. Pour situer le cadre, disons que l’auteur s’est faite journaliste pour recueillir des dizaines de témoignages, chez les gens les plus divers, en les interrogeant non sur l’URSS, Staline ou le Communisme, mais sur la façon dont leur vie quotidienne se déroulait concrètement. On n’est pas dans les généralités abstraites et les grands principes. On est dans la réalité tangible d’existences particulières.
Svetlana Alexievitch a fait de cette façon de procéder une véritable méthode de composition littéraire. Les fines bouches pourront bien dire qu’en laissant la parole à d’autres, l’auteur évite d’avoir à surmonter l’épineux problème de l’écriture et du style, et qu’à la limite, ce n’est donc pas de la littérature. Certes.
Je répondrai que l’empilement de témoignages qui sont autant de cas particuliers, formulés dans des registres de langue extrêmement divers (du populaire au très soigné), finit par produire un effet saisissant de généralité, dont se dégage un vrai point de vue sur un monde, à la fois vaste et profond, comme dans les romans de Balzac. Comme dans la grande littérature. Une plongée terrifiante au cœur de la vie dans le système totalitaire mis en place par Staline (mais déjà, Lénine avait montré ce dont il était capable).
Ce que les gens racontent dans le micro de l’auteur recouvre une période de temps très large, qui va, en gros, de la « grande guerre patriotique » (1941-1945), et même un peu avant, à nos jours, y compris le moment de bascule du communisme au capitalisme, que la phase de transition qui s’est appelée la perestroïka (Gorbatchev) a sinon provoqué, du moins facilité. Quelques interlocuteurs évoquent, au sujet du dernier maître du Kremlin communiste, la « faiblesse » de Mikhaïl Gorbatchev.
C’est vrai que, vu rétrospectivement, le système soviétique finissant ne tenait plus que par l’extrême rigidité de ses structures bureaucratiques, et Gorbatchev a peut-être commis l’erreur de juger qu’on pouvait instiller une dose de souplesse dans un édifice qui, sclérosé de la base au sommet, n’attendait qu’une chiquenaude pour s’écrouler brutalement : « Sans Terreur, tout va s’écrouler en un clin d’œil » (p.324), dit assez justement un ancien exécuteur politique, qui s’était fait prescrire des massages de la main droite pour soigner les crampes qu’il avait le soir, quand il avait dû appuyer trop souvent sur la queue de détente (c'est le vrai nom de la "gâchette") de son revolver dans la journée, dans les caves de la Loubianka.
Reste que le livre de Svetlana Alexievitch, en offrant au lecteur de plonger dans l’avant et dans l’après, permet de mesurer la profondeur et l’intensité du malheur auquel le peuple russe, dans son immense majorité, semble destiné. Toutes sortes de « profils » s’y côtoient, du plus humble ouvrier jusqu’à l’ancien colonel devenu un entrepreneur prospère (émigré au Canada).
Les récits où la cruauté du système soviétique apparaît en pleine lumière sont légion. Par exemple celui-ci, d’un homme dont la femme a été arrêtée par le NKVD, comme beaucoup de ses amis : « A la dernière réunion du Parti, quand on avait récité la litanie des félicitations au camarade Staline, toute la salle s’était levée. Il y avait eu une tempête d’ovations. "Gloire au camarade Staline, l’organisateur et l’inspirateur de nos victoires ! Gloire à Staline ! Gloire à notre Guide !" Cela a duré un quart d’heure, une demi-heure … Tous les gens se regardaient, mais personne ne voulait être le premier à se rasseoir. Ils restaient assis. Et, je ne sais pas pourquoi, je me suis assis. Machinalement. Deux hommes en civil se sont approchés de moi : "Pourquoi vous êtes-vous assis, camarade ?" Je me suis levé d’un bond » (p.211). Inutile de dire que les ennuis ne faisaient que commencer. Sur le bureau du juge d’instruction, il reconnaît l’écriture de son voisin dans la lettre qui le dénonçait, celui qui a ressorti à la police, mot à mot, les conversations que sa femme et lui avaient en sa présence.
Dans la cellule de cinquante personnes où il est enfermé, il raconte l’histoire drôle qui a envoyé son narrateur dans les griffes de la police politique : « Il y a un portrait de Staline au mur, un conférencier fait un exposé sur Staline, un chœur chante une chanson sur Staline, un artiste déclame un poème sur Staline … Qu’est-ce que c’est ? Une soirée consacrée au centenaire de la mort de Pouchkine ». Ce genre d’histoire abonde dans le livre, et donne une idée de la glaciation totalitaire qui a immobilisé le pays tout entier pendant soixante-dix ans.
Les seules échappatoires qui offraient aux gens une issue de secours, une soupape de sûreté, étaient l’alcool, les livres et la cuisine. Pas le mitonnage de petits plats, mais la pièce où on les prépare. Les « réunions » qui s’y déroulent n’ont rien d’officiel, et c’est le seul endroit où les propos sont à peu près libres, si l’on excepte les délateurs possibles, mais aussi les éventuels micros, vers lesquels on se retourne parfois, par défi, pour s’adresser au flic censé écouter.
Autre histoire de dénonciation, p.87 : deux femmes sont très amies, elles ont chacune une fille. L’une, un jour, quand elle est arrêtée, demande à l’autre de veiller sur sa fille. Dix-sept ans après, quand elle revient, elle baise les pieds de son amie, pour avoir veillé sur l'enfant. Et puis un jour où elle peut consulter le dossier qui l’a envoyée en camp, quand elle découvre que la lettre de dénonciation avait été écrite par cette « meilleure amie », elle se pend.
Autre histoire encore : « Mais oncle Vania est revenu … Sans dents, avec une main desséchée et un foie hypertrophié. Il a recommencé à travailler dans son usine, au même poste, il était dans la même pièce, le même bureau … (Il allume une autre cigarette.) Et celui qui l’avait dénoncé était assis en face de lui. Tout le monde le savait, et oncle Vania le savait aussi … Ils allaient aux réunions et aux manifestations, comme avant » (p.321).
Sans commentaire.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, prix nobel de littérature, svetlana alexievitch, la fin de l'homme rouge, urss, staline, stalinisme, communisme, totalitarisme, grande guerre patriotique, kremlin, mikhaïl gorbatchev, perestroïka, loubianka, nkvd
mardi, 19 avril 2016
I WILL SURVIVE
CHRISTOPHER LASCH : LE MOI ASSIÉGÉ
Quelques réflexions après lecture. Attention : la lecture de ce billet est déconseillée aux personnes à tendance dépressive : Le Moi assiégé est un livre démoralisant, ... et indispensable pour comprendre un aspect non négligeable et peu reluisant des conditions qui sont faites aux gens qui vivent dans le monde moderne (cf. Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne).
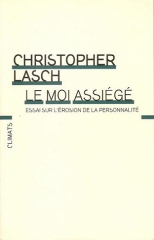 Une autre idée pas drôle du tout, développée par Christopher Lasch dans Le Moi assiégé tourne autour de la notion de « survivalisme ». Vous avez dit Survivalisme ? C’est quoi, cette bête ? La première approximation qui me vient à l’esprit est contenue dans deux titres de films, qui disent bien, à mon avis, ce que la notion veut dire : Vivre pour vivre (Claude Lelouch, 1967) et La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989, je ne parle que des titres, pas des films). Voilà : la vie sans dimension, sans horizon, quasiment réduite aux fonctions animales, l’homme s’éprouvant comme une sorte de bête traquée qui n’a qu’une idée en tête : durer : « … renforce la tournure d’esprit qui considère la préservation de la vie comme une fin en soi » (p.76).
Une autre idée pas drôle du tout, développée par Christopher Lasch dans Le Moi assiégé tourne autour de la notion de « survivalisme ». Vous avez dit Survivalisme ? C’est quoi, cette bête ? La première approximation qui me vient à l’esprit est contenue dans deux titres de films, qui disent bien, à mon avis, ce que la notion veut dire : Vivre pour vivre (Claude Lelouch, 1967) et La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989, je ne parle que des titres, pas des films). Voilà : la vie sans dimension, sans horizon, quasiment réduite aux fonctions animales, l’homme s’éprouvant comme une sorte de bête traquée qui n’a qu’une idée en tête : durer : « … renforce la tournure d’esprit qui considère la préservation de la vie comme une fin en soi » (p.76).
Gloria Gaynor, c'est juste pour mettre un peu de baume sur la plaie.
C’est une obsession particulièrement américaine : « Elle trouve son obsession la plus caractéristique et insidieuse, son expression ultime, dans l’illusion de guerres nucléaires que l’on pourrait remporter ; mais elle ne s’épuise aucunement dans l’anticipation de calamités ahurissantes » (p.57). Il parle sans doute de ces citoyens qui ont assez de moyens pour se doter de bunkers souterrains dans leurs jardins et de réserves de survie pour une durée suffisante en vue de ressortir à l’air libre sans risquer la mort, dans on ne sait combien de temps.
Je ne suis pas sûr que l’Américain moyen soit en possession de ces moyens. Mais la mentalité qui va avec, qu’on ait les moyens ou pas, s’est répandue ailleurs qu’aux USA, quoiqu’avec retard, en même temps que la culture spécifiquement américaine conquérait les esprits un peu partout. Car cette mentalité a gagné le monde (des vertus du "soft power") : qu'on le veuille ou non, le monde est grosso modo américanisé. L'Amérique a universalisé beaucoup de ses problématiques propres, même si celles-ci sont plus ou moins forcées de s'adapter aux cultures locales pour coller au terrain et avoir une chance de prendre racine (pour vendre les produits qui vont avec).
Il ne s’agit donc pas que de moyens : c’est toute une mentalité qui s’est ainsi organisée autour de la nécessité de se préparer à survivre à des conditions extrêmes faites à l’existence de l’humanité ordinaire. L’une des conséquences de la montée du survivalisme, c’est la disparition dans les mentalités de toute possibilité de consacrer son existence à la réalisation d’idéaux quels qu’ils soient, pour lesquels on serait capable d’aller jusqu’au « sacrifice personnel ». Tout ce qui ressemble à de l’héroïsme apparaît comme étrange ou incongru, voire anormal.
Or, avoir un idéal, quel qu’il soit, permet de donner un sens à sa vie (à tort ou à raison, on y croit). Le dilemme est le suivant : dans les conditions qui sont faites à toutes les populations par le système industriel et la société marchande, faut-il se contenter de survivre par tous les moyens, ou doit-on chercher à donner un sens à la présence humaine sur terre ? L’homme ne se considère plus comme un « agent moral » (doté de volonté et de rationalité), mais comme la « victime » d'un système impitoyable qui le domine et l'exploite : « … la protestation politique dégénère en apitoiement sur soi » (p.75).
Le plus effrayant dans le survivalisme, par la folie qu’il y a à faire certains rapprochements, c’est que ses partisans vont chercher dans l’histoire du 20ème siècle des points de comparaison pour qualifier le sort que la société moderne fait aux hommes et pour justifier leur théorie. C’est dans ce but qu’ils s’appuient sur l’exemple des camps de concentration et des camps de la mort, malgré l’énormité du culot et la disproportion flagrante des situations en nombre de victimes et en atrocités subies.
Christopher Lasch se réfère ici à Hannah Arendt, qui pense que les totalitarismes du 20ème siècle, hitlérisme et stalinisme, représentent « une solution, certes irrationnelle, aux problèmes non résolus de la société industrielle » (p.106), problèmes au premier rang desquels se situe la production par la dite société d’une part toujours plus grande de « populations superflues ». Que faut-il faire de l'hitlérisme et du stalinisme ? Des repoussoirs ? Des préfigurations ?
Faut-il, à la suite d’Arendt, considérer le génocide des juifs par Hitler comme un fait radicalement sans précédent ? On perd alors « la faculté de la mettre en perspective » historique pour établir des comparaisons et des correspondances possibles. Faut-il au contraire englober le génocide des juifs dans une problématique plus vaste qui permettrait d’évaluer « la culture et la politique modernes » ? On masque alors « son horreur particulière » (p.103), tout à fait spécifique du sort fait aux juifs sous le régime hitlérien.
On le voit, la question est difficile à trancher. Quand je vois le sort fait aux aliments destinés aux hommes dans les système de la production agricole industrielle, quand je vois le sort fait aux animaux destinés à l'alimentation des hommes dans la production industrielle des animaux comestibles, j'ai tendance à me dire que la structure même qui a permis aux camps de la mort d'exister a été grosso modo transplantée de l'univers nazi dans l'univers capitaliste, sans que la signification intime et profonde de la structure en soit bouleversée.
J’ai personnellement du mal à perdre de vue que l’uniformisation actuelle du monde sous la bannière de la production industrielle généralisée de la totalité de ce dont nous avons besoin pour vivre, rend les produits comme les hommes insignifiants, interchangeables, et par suite, jetables : les camps de la mort, pour aberrants, odieux et innommables qu’ils soient, n'étaient d’une certaine manière que l’application du même principe, sauf que, cette fois, c’est de la mort que l’industrie rendue folle s’était mise à produire.
L’horreur en moins, le sort de l’humanité en devient-il pour autant plus enviable ? L’idolâtrie et le culte fasciné dont l’innovation technologique (dernièrement, la puce qui rend possible au tétraplégique des gestes de la main, demain l’humanité « augmentée ») est aujourd’hui l’objet a tendance à m’apparaître comme le symptôme inquiétant d’un mal moral délétère (irréversible ?), qui voit l’homme se réjouir d’être bientôt débarrassé du fardeau de la liberté et de la volonté, et de pouvoir bientôt s’en remettre aux machines du souci d’exister.
Christopher Lasch, dans Le Moi assiégé, ne s’aventure pas aussi loin ni sur un terrain aussi risqué : c'est moi qui parle ici. Il semble trancher le dilemme en laissant la parole aux survivants des camps eux-mêmes : « Ce sont les survivants qui voient leur expérience comme une lutte non pas pour survivre mais pour rester humains » (p.129). Rester humain ? Je pense à l'inoubliable L'espèce humaine, du grand et bien oublié Robert Antelme. Rester humain, c'est tout de même tout autre chose que survivre !
Si tel est bien le cas, quand le personnage principal du film Pasqualino (Lina Wertmüller, 1976), un petit truand minable qui survivra au camp grâce à sa débrouillardise et sa totale absence de scrupules, suscitera l’admiration des foules, Lasch semble pointer ce qui différencie radicalement l’expérience réelle rapportée par les survivants des camps, et la dérision de toute valeur dans l’exaltation d’un personnage moralement infinitésimal, voire répugnant.
Car si les foules se reconnaissent en lui, une triste perspective s’ouvre, qui en dit long sur la valeur du mot "valeur", que tant d'authentiques salopards au pouvoir ont en permanence à la bouche, alors qu'ils savent que c'est l'insignifiance et la dérision qui nous guettent.
On les comprend : eux aussi, ils veulent "survivre".
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MES CHANSONS, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christopher lasch, le moi assiégé, survivalisme, lelouch vivre pour vivre, tavernier la vie et rien d'autre, claude lelouch, bertrand tavernier, hannah arendt, amérique, usa, états-unis, condition de l'homme moderne, juifs, camps de la mort, auschwitz, camps de concentration, adolf hitler, staline, lina wertmüller pasqualino, robert antelme l'espèce humaine, gloria gaynor, i will survive, génocide, la destruction des juifs d'europe
lundi, 18 janvier 2016
ACTUALITÉ DE GUY DEBORD
Dans son Journal de 1988, Philippe Muray cite à plusieurs reprises l’ouvrage de Guy Debord paru cette année-là : Commentaires sur La Société du spectacle. Cela m’a donné envie d’y retourner pour jeter un œil. On sait que La Société du spectacle date de 1967. Les Commentaires examinent ce qu’il en est advenu de cette société vingt ans après. Et l’on peut dire que le constat fait frémir. Ajoutons que Debord se contente, précisément, de constater : « Les présents commentaires ne se soucient pas de moraliser. Ils n’envisagent pas davantage ce qui est souhaitable, ou seulement préférable. Ils s’en tiendront à ce qui est » (Guy Debord, Œuvres, Gallimard/Quarto, p. 1595).
On peut dire que l’évolution irrésistible du système, dont il faisait déjà une critique radicale, a comblé toutes les attentes que l’auteur avait placées en elle, et même au-delà. D’après ce que j’ai pu en comprendre, le « spectacle », dans le vocabulaire de Debord, n'a pas grand-chose à voir avec les maisons de théâtre, de cinéma ou d’opéra. Je me rappelle une émission de Bernard Pivot consacrée à La Société du spectacle, où ce grand couillon de Franz-Olivier Giesbert faisait l'énorme contresens habituel de tout confondre. Le malentendu demeure profond.
Pour reformuler dans mes propres termes ce que je pense avoir compris de ce concept de « spectacle », je dirai que c’est très généralement l’instauration d’une relation de plus en plus impossible entre les hommes et le monde, une relation non plus immédiate, comme depuis des millénaires, c’est-à-dire où rien ne vient s’interposer entre l’individu et le monde, mais médiate. Une relation désormais induite par une représentation artificielle (le "spectacle" ?), elle-même produite en dehors, puis introduite à l'intérieur de l’esprit par une instance tierce.
Le « spectacle », c’est cette représentation (ce discours, ce pouvoir) qui s’impose pour faire écran entre l’individu et le monde. Qui prépare et canalise en amont l’expérience que l’individu peut avoir du monde. Qui formate sa perception. Ce discours fonctionne comme un conditionnement préalable de l’esprit, dont le résultat est illustré par ce « proverbe africain » : « Le touriste ne voit que ce qu’il sait », qu’on pourrait traduire ainsi : « L’individu ne consiste désormais qu'en ce qu’on lui a précédemment inculqué ». Le système a inventé l'homme-ectoplasme.
On pourrait même dire que l’individu, dans sa mémoire et dans ses affects, n’est plus composé que des éléments dont on l'a fabriqué : il ne s’appartient plus. Il voit, entend, réfléchit, avec les yeux, les oreilles et le cerveau qu’on lui a greffés sans qu'il s'en aperçoive. Le sommet du grand art dans la fabrication de l’ "Homme Nouveau", dont rêvèrent Hitler et Staline, mais de façon combien fruste et grossière ! La principale caractéristique du discours ainsi médiatisé qui préside à cet endoctrinement et qui façonne la façon dont l’individu va percevoir et expérimenter le monde, est d’émaner d’un Pouvoir. Etant entendu que les « médias » ne sont qu’un aspect particulier, le plus visible, du système élaboré par et pour le maintien de ce Pouvoir : il faut deviner l'énorme masse de glace de l'iceberg systémique qui se cache sous la surface.
Autrement dit, tout ce qui descend du « spectacle » en direction de « la plèbe des spectateurs », « ce sont des ordres ». Et l’individu n’a d’autre choix que d’obtempérer, obéir, se soumettre, puisque le monde est ainsi fait, n'est-ce pas. Puisqu’il est convaincu d’avance qu’il serait vain d’essayer de le changer. Puisque l’idée même que cela fût possible, qu’on le pût ou qu’on le dût ne lui effleurerait jamais l’esprit.
Mais dans ses Commentaires, Debord ajoute une nouvelle forme de « pouvoir spectaculaire » aux deux que le précédent ouvrage avait mises au jour. Il y parlait de la « concentrée », brillamment illustrée au cours du 20ème siècle par les grandes aventures hitlérienne et stalinienne. Il y parlait de la « diffuse », portée par la civilisation américaine, qui avilit l’idéal de Liberté en le réduisant à la médiocre « liberté de choix », c’est-à-dire une liberté dégénérée, une liberté de basse-cour.
En 1988, pour compléter le tableau, il définit un pouvoir « spectaculaire intégré », qui est une combinaison des deux autres, et qu'il voit déjà partie à la conquête du monde. Le « spectaculaire intégré » emprunte au « concentré » l’autoritarisme, mais en le dissimulant : « … le centre directeur en est devenu occulte … » (on pense au "gouvernement invisible" appelé de ses vœux par le grand-prêtre de la publicité contemporaine, Edward Bernays : comment se révolterait-on contre une "Société Anonyme" ? A qui, en effet, pourrait-on s'en prendre nommément ?) ; et au « diffus » le formatage généralisé des comportements et des choses : « Car le sens final du spectaculaire intégré, c’est qu’il s’est intégré dans la réalité même à mesure qu’il en parlait ; et qu’il la reconstruisait comme il en parlait ».
L’effet magistral ainsi obtenu est l’escamotage pur et simple de la réalité, le monde concret, les choses enfin, comment qu’on les nomme. Le dur sur lequel je me cogne. Les épines des églantiers qu’il ne faut pas hésiter à affronter bravement si l’on tient vraiment à la confiture succulente qui en découlera après un processus compliqué : tout salaire mérite sa peine. Maintenant, l'artifice absolu est devenu le monde dans lequel nous vivons tous les jours, incluant jusqu'à nos mots, nos images et nos existences. J’avais lu, à publication, Le Crime parfait, de Jean Baudrillard, qui décrivait la même mise à mort, quoiqu’en termes différents (vocabulaire, syntaxe et perspective, j'avoue que j'ai un peu oublié).
Et Guy Debord ajoute, pour parfaire le triptyque de ses « pouvoirs spectaculaires » : « Quand le spectaculaire était concentré la plus grande part de la société périphérique lui échappait ; et quand il était diffus, une faible part ; aujourd’hui rien ». Traduction proposée : en régime dictatorial, il suffit de se maintenir en dessous de la couverture radar pour rester à peu près peinard. En régime capitaliste à l’américaine, on a du mal à échapper à la marchandise et à son cortège de servitudes.
Mais alors là, en régime de « spectaculaire intégré » (déjà en 1988), impossible d’échapper aux griffes propagandistes de Moloch-Baal et au formatage et au conditionnement précis qu’il fait subir à tous ceux qui entrent sur la planète, planète qui leur apparaîtra forcément sous les traits du « monde tel qu’il est ». Et là, quel Michel Foucault, quel Jacques Derrida, quel Gilles Deleuze, ces champions de la "Déconstruction" de tout ce qui faisait notre civilisation, déconstruiront, mais à l'envers, leurs représentations pour leur dévoiler la vérité ?
Ils seront tenus dans la complète ignorance du nombre et de la qualité des opérations successives d’usinage dont ils seront le résultat. Ils auront beau être fils de leur mère, ils ne sauront jamais de quel processus ils sont l’aboutissement. Ils seront ce qu’on leur aura dit qu’ils sont et préparés à être. A moins de s’appeler Winston Smith (dans 1984 de George Orwell).
En fait, je ne voulais pas, en me lançant dans ce billet, brasser toutes ces matières. Je voulais seulement partager avec quelques lecteurs un paragraphe qui a littéralement explosé sous mes pas quand je suis passé dessus. Se souvenir, avant de le lire, qu’il fut publié en 1988 (le livre sort en mai, l’attentat de Lockerbie se situe en décembre). C’est vrai, on parlait déjà de terrorisme (OLP, FPLP, FPDLP, et leurs frères, leurs cousins, leurs conjoints, leurs alliés, …). Mais dites-moi si ce paragraphe ne sonne pas étrangement.
« Cette démocratie si parfaite fabrique elle-même son inconcevable ennemi, le terrorisme. Elle veut en effet être jugée sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. L’histoire du terrorisme est écrite par l’Etat ; elle est donc éducative. Les populations spectatrices ne peuvent certes pas tout savoir du terrorisme, mais elles peuvent toujours en savoir assez pour être persuadées que, par rapport à ce terrorisme, tout le reste devra leur sembler plutôt acceptable, en tout cas plus rationnel et plus démocratique. »
Dites, je ne sais pas vous, mais moi, j’aimerais savoir ce qu’il buvait comme café pour lire dans ce marc extralucide. Car derrière « tout le reste », j’entends toute l’entreprise actuelle de Hollande et consort pour amoindrir le poids du pouvoir judiciaire et pour accroître celui de l’administration policière de la vie collective.
J’ai peur pour l’état de droit.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe muray, muray journal intime, muray ultima necat, éditions belles lettres, littérature, guy debord, la société du spectacle, commentaires sur la société du spectacle, gallimard quarto, philosophie, société, système capitaliste, situationnistes, hitler, staline, totalitarisme, michel foucault, jacques derrida, gilles deleuze, 1984 george orwell, terrorisme, françois hollande, état d'urgence, état policier, politique, franz-olivier giesbert
mardi, 08 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 3/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
3/9
De l'importance de la lecture.
Ce qui est sûr, c’est que l’art contemporain, la musique contemporaine, la poésie contemporaine (en ai-je bouffé, des manuscrits indigestes, futiles, vaporeux ou dérisoires, au comité de lecture où je siégeais !), tout cela est tombé de moi comme autant de peaux mortes. De ce naufrage, ont surnagé les œuvres de quelques peintres, de rares compositeurs, d’une poignée de poètes élus. Comme un rat qui veut sauver sa peau, j’ai quitté le navire ultramoderne. J'ai déserté les avant-gardes. C’est d’un autre rivage que je me suis mis à regarder ce Titanic culturel qui s’enfonçait toujours plus loin dans des eaux de plus en plus imbuvables.
Comment expliquer ce revirement brutal ? Bien malin qui le dira. Pour mon compte, j’ai encore du mal. Je cherche. Le vrai de la chose, je crois, est qu’un beau jour, j'ai dû me poser la grande question : je me suis demandé pourquoi, tout bien considéré, je me sentais obligé de m’intéresser à tout ce qui se faisait de nouveau.
Mais surtout, le vrai du vrai de la chose, c’est que j’ai fait (bien tardivement) quelques lectures qui ont arraché les peaux de saucisson qui me couvraient les yeux quand je regardais les acquis du 20ème siècle comme autant de conquêtes victorieuses et de promesses d'avenir radieux. J’ai fini par mettre bout à bout un riche ensemble homogène d’événements, de situations, de manifestations, d’analyses allant tous dans le même sens : un désastre généralisé. C’est alors que le tableau de ce même siècle m’est apparu dans toute la cohérence compacte de son horreur, depuis la guerre de 14-18 jusqu’à l’exploitation et à la consommation effrénées des hommes et de la planète, jusqu'à l’humanité transformée en marchandises, en passant par quelques bombes, quelques génocides, quelques empoisonnements industriels.
 Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
A tort ou à raison, j’ai conclu de cette lecture décisive qu’Hitler et Staline, loin d’être les épouvantails, les effigies monstrueuses et retranchées de l’humanité normale qui en ont été dessinées, n’ont fait que pousser à bout la logique à la fois rationnelle et délirante du monde dans lequel ils vivaient pour la plier au fantasme dément de leur toute-puissance. Hitler et Staline, loin d’être des monstres à jamais hors de l’humanité, furent des hommes ordinaires (la « Banalité du Mal » dont parle Hannah Arendt à propos du procès Eichmann). Il n'y a pas de pommes s'il n'y a pas de pommier. Ils se contentèrent de pousser jusqu’à l’absurde et jusqu’à la terreur la logique d’un système sur lequel repose, encore et toujours, le monde dans lequel nous vivons.
Hitler et Staline (Pol Pot, …) ne sont pas des exceptions ou des aberrations : ils sont des points d’aboutissement. Et le monde actuel, muni de toutes ses machines d’influence et de propagande, loin de se démarquer radicalement de ces systèmes honnis qu’il lui est arrivé de qualifier d’ « Empire du Mal », en est une continuation qui n’a eu pour talent que de rendre l’horreur indolore, invisible et, pour certains, souhaitable.
Un exemple ? L’élimination à la naissance des nouveau-nés mal formés : Hitler, qui voulait refabriquer une race pure, appelait ça l’eugénisme. Les « civilisés » que nous sommes sont convenus que c’était une horreur absolue. Et pourtant, pour eux (pour nous), c’est devenu évident et « naturel ». C’est juste devenu un « bienfait » de la technique : permettre de les éliminer en les empêchant de naître, ce qui revient strictement au même. C’est ainsi que, dans quelques pays où la naissance d’une fille est une calamité, l’échographie prénatale a impunément semé ses ravages.
 D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système
D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
Je citerai une troisième facette de ladite évolution : une réflexion tirée d’ouvrages d’économistes, parmi lesquels ceux du regretté Bernard Maris (à  commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
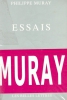 J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
Mais je dois reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
 Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude
Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
L'Histoire (le Pouvoir, la Politique), la Technique, l'Economie, donc : la trinité qui fait peur.
Restent les Lumières originelles : étonnamment et bien que je ne sache pas si le résultat est très cohérent, au profond de moi, elles résistent encore et toujours à l'envahisseur. Sans doute parce qu'en elles je vois encore de l'espoir et du possible.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, avant-garde, titanic, hannah arendt, les origines du totalitarisme, nazisme, staline, hitler, totalitarisme, stalinisme, banalité du mal, jacques ellul, le système technicien, le bluff technologique, günther anders, l'obsolescence de l'homme, bernard maris, charlie hebdo, antimanuel d'économie, jean-marc sylvestre, ultralibéralisme, philippe muray, l'empire du bien, exorcismes spirituels, éditions les belles lettres, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, une paire de bottes vaut shakespeare, éditions gallimard, george orwell essais articles lettres, jean-claude michéa, l'enseignement de l'ignorance, le moi assiégé, christopher lasch, la culture du narcissisme, michel houellebecq, la carte et le territoire, éditions l'encyclopédie des nuisances
jeudi, 24 septembre 2015
L'HOMME OBSOLÈTE
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 4
Sur la bombe et les causes de notre aveuglement face à l’Apocalypse
La remarque la plus étonnante – la plus amusante si l’on veut – qu’on trouve dans ce dernier essai composant L’Obsolescence de l’homme, se trouve p. 283. C’est le titre du §8 : « L’assassin n’est pas seul coupable ; celui qui est appelé à mourir l’est aussi ». Il se trouve que j’étais en train de lire Maigret et le clochard. Les hasards de l’existence … On lit en effet au chapitre IV ce petit dialogue entre M. et Mme Maigret : « – Les criminologistes, en particulier les criminologistes américains, ont une théorie à ce sujet, et elle n’est peut-être pas aussi excessive qu’elle en a l’air … – Quelle théorie ? – Que, sur dix crime, il y en a au moins huit où la victime partage dans une large mesure la responsabilité de l’assassin ». Le rapprochement s’arrête évidemment à cette coïncidence.
Günther Anders analyse ici les implications et significations de la bombe atomique. Il reprend une idée exprimée dans Sur la Honte prométhéenne : « Nous lançons le bouchon plus loin que nous ne pouvons voir avec notre courte vue » (p.315). Autrement dit, nous agissons sans nous préoccuper des conséquences de nos actes, et nous inventons des choses qui finissent par nous dépasser, voire se retourner contre nous.
Je me contenterai de picorer ici des réflexions qui m’ont semblé intéressantes. D’abord cette idée que, aujourd’hui, « c’est nous qui sommes l’infini », qui dit assez bien ce que la bombe, fruit de l’ingéniosité humaine, a d’incommensurable avec l’existence humaine : nous éprouvons désormais « la nostalgie d’un monde où nous nous sentions bien dans notre finitude ».
Faust est mort, dit l’auteur, précisément parce qu’il est le dernier à se plaindre de sa « finitude ». Je ne sais plus où, dans le Second Faust, le personnage s’adresse à Méphisto : « Voilà ce que j’ai conçu. Aide-moi à le réaliser ». Notons au passage qu’aux yeux de Goethe, c’est la technique en soi qui a quelque chose de diabolique, puisque c’est Méphisto qui l’incarne.
Une autre idée importante, je l’ai rencontrée récemment dans la lecture de La Gouvernance par les nombres d’Alain Supiot (cf. ici, 9 et 10/09) : ce dernier appelle « principe d’hétéronomie » l’instance d’autorité qui, surplombant et ordonnant les activités des hommes, s’impose à tous. Or ce principe, dans une civilisation dominée par la technique, tend à devenir invisible, conférant alors au processus lui-même une autorité d’autant plus inflexible qu’elle n’émane pas d’une personne. Ce qui fait que la finalité de la tâche échappe totalement à celui qui l’accomplit, avec pour corollaire : « Personne ne peut plus être personnellement tenu pour responsable de ce qu’il fait » (p.321).
C’est aussi dans le présent essai qu’on trouve le chapitre intitulé « L’homme est plus petit que lui-même ». Je ne reviens pas en détail sur cette idée formidable, qui développe d’une certaine manière les grands mythes modernes suscités par la créature du Dr Frankenstein (Mary Shelley) ou par le Golem (Gustav Meyrink) : l’homme, en déléguant sa puissance à la technique, a donné naissance à une créature qui lui échappe de plus en plus. Avec pour conséquence de multiplier les risques pour l’humanité : « Ce qui signifie que, dans ce domaine, personne n’est compétent et que l’apocalypse est donc, par essence, entre les mains d’incompétents » (p.301). Autrement dit, l’humanité a construit un avion pour lequel il n’existe pas de pilote.
Je signale une expression qui m’a aussitôt fait penser à Hannah Arendt : « cette horrible insignifiance de l’horreur » (p.304).
Pour terminer, ce passage (l'auteur vient d'évoquer Les Frères Karamazov) : « Accepter que le monde qui, la veille encore, avait un sens exclusivement religieux devienne l’affaire de la "physique" ; reconnaître, en lieu et place de Dieu, du Christ et des saints, "une loi sans législateur", une loi non sanctionnée, sans autre caution que sa seule existence, une loi absurde, une loi ne planant plus, « implacablement », au-dessus de la nature, bref la « loi naturelle » – ces nouvelles exigences imposées à l’homme de l’époque, il lui était tout simplement impossible de s’y plier » (p.333). Le « Système technicien » (Jacques Ellul) s’est autonomisé. L’homme se contente de suivre la logique de ce système, de se mettre à son service pour qu’il se développe encore et toujours et, pour finir, de lui obéir aveuglément.
Au total, un livre qui secoue pas mal de cocotiers.
Voilà ce que je dis, moi.
FIN
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer, maigret, georges simenon, maigret et le clochard, la banalité du mal, goethe, méphisto faust, alain supiot
mercredi, 23 septembre 2015
L'HOMME OBSOLÈTE
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 3
Le Monde comme fantôme et comme matrice
Le monde qu’analyse cet essai est celui de la médiatisation triomphante de tout. Günther Anders parle seulement de la radio et de la télévision, mais je suis sûr qu’il ne verrait aucun obstacle à étendre ses analyses aux médias qu’une frénésie d’innovation technique a inventés depuis son essai (1956). Aujourd’hui, tout le monde est « connecté », au point qu’être privé de « réseau » peut occasionner de graves perturbations psychologiques.
Il commence par nier la valeur de l’argument habituel des défenseurs de la technique face à ceux qui s’indignent de certains « dommages collatéraux » : ce n’est pas la technique qui est mauvaise, ce sont les usages qu’on en fait (air connu). Cet argument rebattu fait semblant d’ignorer que « les inventions relèvent du domaine des faits, des faits marquants. En parler comme s’il s’agissait de "moyens" – quelles que soient les fins auxquelles nous les faisons servir – ne change rien à l’affaire » (p.118).
Notre existence, dit-il, ne se découpe pas en deux moitiés séparées qui seraient les « fins » d’une part, les « moyens » d’autre part. L’ « individu », par définition, ne peut être coupé en deux (cf. le jugement de Salomon). L’argument n’a l’air de rien, mais il est puissant. Conclusion, il est vain de se demander si c’est la technique qui est mauvaise en soi, ou les usages qui en sont faits ensuite : une poêle sert à griller des patates, elle peut servir à assommer le voisin qui fait du bruit à deux heures du matin.
Pour qui est familiarisé avec les critiques lancées contre la télévision dans la dernière partie du 20ème siècle, le propos de Günther Anders compose un paysage connu. Les Situationnistes en particulier, à commencer par Guy Debord, ont constamment passé dans leur moulinette virulente la « société spectaculaire-marchande ». Il n’est d’ailleurs pas impossible que Debord (La Société du spectacle date de 1967) ait picoré dans l’essai d’Anders (paru en 1956).
Si les films, marchandises standardisées, amènent encore les masses à se réunir dans des salles pour assister collectivement à la projection, la télévision semble livrer le monde à domicile. Pour décrire l’effet produit par ce changement, Anders a cette expression géniale : « Le type de l’ "ermite de masse" était né ». « Ermite de masse » est une trouvaille, chacun étant chez soi, en quelque sorte, « ensemble seul ».
On peut ne pas être d’accord avec l’auteur quand il met exactement sur le même plan radio et télévision, car la réception d’images visuelles change pas mal de choses. Le point commun réside dans l’action de médiatisation : l’écran de télévision, et dans une moindre mesure le poste de radio, littéralement, « font écran » entre le spectateur et la réalité concrète du monde, qui du coup n’est plus l’occasion d’une expérience individuelle par laquelle chacun teste sa capacité d’action sur celle-ci.
L’auteur le dit : le monde, qui est servi « à domicile », n’est plus que le « fantôme » de lui-même : « Maintenant, ils sont assis à des millions d’exemplaires, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas pour fuit le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde "en effigie" ». L’exagération ne peut toutefois s’empêcher de ressurgir : « Chaque consommateur est un travailleur à domicile non rémunéré [il faudrait même dire "payant"] qui contribue à la production de l’homme de masse ». Mais on a bien compris l’idée.
Autrement intéressante est l’idée que radio et télévision induisent l’établissement, entre la source et le récepteur (entre les animateurs du spectacle et les auditeurs et téléspectateurs) une « familiarité » pour le moins étrange, qui semble tisser entre eux des liens de proximité immédiate, du seul fait que ces voix semblent s’édresser à eux personnellement. On pense ici à tout ce que peuvent déclarer de charge affective et d’identification les consommateurs quand ils s’adressent aux animateurs par oral ou par écrit. De plus, ces liens apparents entraînent une relative déréalisation des proximités concrètes (exemple p. 148-149). Ces liens sont en réalité une grande imposture qui fait que l’ « individu devient un "dividu" » (p.157). C’est bien trouvé.
Anders évoque aussi l’espèce d’ubiquité que produit le média et la schizophrénie artificiellement produite qui en découle. S’il voyait aujourd’hui avec quelle attention fascinée passants, clients de terrasses de bistrots et passagers du métro fixent l’écran de leur téléphone, même marchant ou en compagnie, il serait encore plus catastrophé par le monde que les hommes ont continué à fabriquer.
Faisant semblant d’être ici (puisqu’ils « communiquent » et sont « connectés ») et faisant semblant d’être ailleurs (pour les mêmes raisons !), ils constituent une sorte d’humanité « Canada dry », cette boisson qui « ressemble à de l’alcool, mais ce n’est pas de l’alcool ». Voilà : ça ressemble à de l’humanité, mais ce n’est pas de l’humanité. L’incessante innovation technique au service de la marchandise tient l’humanité en laisse.
Je n’insiste pas sur le conditionnement du désir, en amont de la manifestation d’une volonté et d’une liberté, pour orienter celui-ci sur des marchandises. Je n’insiste pas sur le caractère impérieux, voire vaguement totalitaire, de cette façon d’imposer une représentation du monde (une idéologie) : « Que ma représentation soit votre monde » (p. 195), façon plus sophistiquée que celle qu’Hitler utilisait pour formater les esprits. Günther Anders suggère que le règne de la radio et de la télévision produit un autre totalitarisme.
L’essai Le monde comme fantôme et comme matrice (titre pastichant Schopenauer), par sa radicalité dans l’analyse de la radio et de la télévision, indique assez que son auteur n’attend rien de bon de l’évolution future de l’humanité et du sort que l’avenir, sous l’emprise de la technique, lui réserve.
Il serait désespéré que ça ne m’étonnerait pas. Sa réflexion, qui remonte à plus d’un demi-siècle, n’a en tout cas rien perdu de sa force.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer
mardi, 22 septembre 2015
L’HOMME OBSOLÈTE
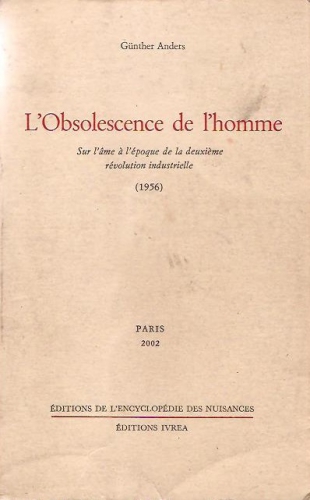 GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2
Je disais que, selon Günther Anders, l'homme n'est plus à la hauteur du monde qu'il a fabriqué.
Sur la honte prométhéenne
Le premier essai de l’ouvrage, développe cette idée. L’auteur parle de la réaction de son ami T. lors de leur visite à une exposition technique : « Dès que l’une des machines les plus complexes de l’exposition a commencé à fonctionner, il a baissé les yeux et s’est tu ». Il va jusqu’à cacher ses mains derrière son dos. L'auteur en déduit que T. est saisi de honte devant tant de perfection, honte motivée par la cruauté de la comparaison entre l’organisme humain, fait d’ « instruments balourds, grossiers et obsolètes » et des « appareils fonctionnant avec une telle précision et un tel raffinement ».
J’imagine que certains trouveront gratuite l’interprétation de l’attitude de T., mais je pense à une page de Zola (L’Assommoir ?), où Coupeau et Gervaise visitent une usine, page où Zola décrit les machines comme douées de vie propre, alors que les visiteurs semblent rejetés hors de l’existence. Et Coupeau, abattu et découragé après une bouffée de colère contre les machines, de conclure : « Ça vous dégomme joliment, n’est-ce pas ? ». C’est bien une réaction du même genre.
Moralité : l’homme est « inférieur à ses produits ». J’avoue que je me tapote le menton quand il énonce : « Avec cette attitude, à savoir la honte de ne pas être une chose, l’homme franchit une nouvelle étape, un deuxième degré dans l’histoire de sa réification ». Mais après tout, quand on sait ce que suppose l’apprentissage des gestes sportifs et la discipline requise dans les sports de haut niveau aujourd’hui, on est obligé de se dire que le corps des plus grands champions que les foules vénèrent s'est peu ou prou mécanisé.
Il est de notoriété publique que l’industrie européenne a été amplement délocalisée dans les pays à bas coût de main d’œuvre. Et que quand on parle aujourd’hui de « relocalisation industrielle », c’est pour installer des usines entièrement robotisées, où une quinzaine d’humains suffisent pour surveiller et maintenir en état, quand l’installation précédente, avant délocalisation, avait besoin de plusieurs centaines d’ouvriers. Et Günther Anders a publié L’Obsolescence … en 1956 ! L’homme devient l’accessoire de la machine.
De même, l’auteur attige quand il affirme : « … les choses sont libres, c’est l’homme qui ne l’est pas ». De même : « Il espère, avec leur aide, obtenir son diplôme d’instrument et pouvoir ainsi se débarrasser de la honte que lui inspirent ses merveilleuses machines ». C’est la qu’on voit à l’œuvre la méthode de « l’exagération ». Il y a visiblement, dans cette façon de prendre les perceptions ordinaire à rebrousse-poil, un goût du paradoxe et un désir de provoquer.
Il n’empêche que, quand on prend conscience de l’emprise de plus en plus grande des machines sur le cadre et les conditions de notre vie, on se dit que les caricatures et hyperboles formulées par Günther Anders recèlent leur part de vérité. Il est assez juste de soutenir comme il le fait que l’homme « n’est plus proportionné à ses propres productions », même si ce qu’il dit un peu plus loin de « l’hybris » (démesure, orgueil) le conduit à tenir un raisonnement alambiqué.
Ce qui reste très étonnant malgré tout dans la lecture de « Sur la honte prométhéenne », c’est que l’auteur pressent quelques conséquences de la frénésie d’innovation technologique. Je pense au clonage, évoqué indirectement dans un très beau passage : « Mais si on la considère en tant que marchandise de série, la nouvelle ampoule électrique ne prolonge-t-elle pas la vie de l’ancienne qui avait grillé ? Ne devient-elle pas l’ancienne ampoule ? Chaque objet perdu ou cassé ne continue-t-il pas à exister à travers l’Idée qui lui sert de modèle ? L’espoir d’exister dès que son jumeau aura pris sa place, n’est-ce pas une consolation pour chaque produit ? N’est-il pas devenu "éternel" en devenant interchangeable grâce à la reproduction technique ? Mort, où est ta faux ? » (p.69). Devenir éternel en devenant interchangeable, c’est à peu de chose près le programme du héros de La Possibilité d’une île, de Michel Houellebecq. Il suffit de remplacer par l’être humain l’objet fabriqué. Pour Anders, l’homme est inférieur puisqu’une telle immortalité lui est refusée : à son époque, le clonage était inconcevable.
Pour être franc, je ne suis guère convaincu, à l’arrivée, par le concept de « honte », qui me semble inopérant. L’expression oxymorique « honte prométhéenne » est à prendre (selon moi) pour un tour de force intellectuel, pour un jeu conceptuel virtuose si l’on veut.
Dernier point : tout le §14 est étonnamment consacré à la musique de jazz. Je ne sais pas bien à quel genre de jazz pense Günther Anders en écrivant. En 1956, la vague « be-bop » est encore bien vivante. Miles Davis (Ascenseur pour l’échafaud, 1957) et Ornette Coleman (Change of the century, 1959) vont bientôt donner quelques coups de fouet à cette musique. Inutile de dire que le développement est fait pour choquer l’amateur de jazz, à commencer par celui (dont je suis) qui préfère les petites formations fondées sur le trio rythmique, éventuellement augmenté d’un ou plusieurs « souffleurs », où les uns et les autres ne cessent de se relancer, de se répondre et de se stimuler.
Le §14 est intitulé « L’orgie d’identification comme modèle du trouble de l’identification. Le jazz comme culte industriel de Dionysos » (p.103). Je me demande ce qui prend à l’auteur d’affirmer : « La "fureur de la répétition", qui neutralise en elles tout sentiment du temps et piétine toute temporalité, est la fureur du fonctionnement de la machine » (p.104). Je me dis pour l’excuser que la techno n’existait pas : il faut avoir assisté (je précise : par écran interposé !) à une « rave party » pour avoir une idée modernisée de ce qu’est le « culte industriel de Dionysos ».
Désolé, M. Anders, rien de moins machinal que le jazz auquel je pense.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre
lundi, 21 septembre 2015
L’HOMME OBSOLÈTE
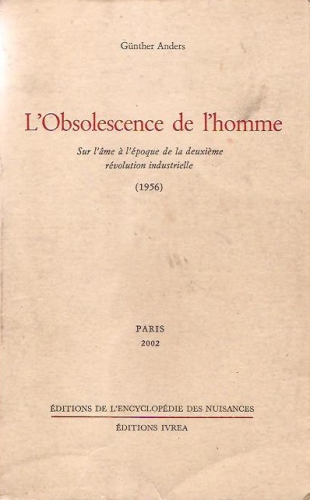 GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 1
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 1
L’Obsolescence de l’homme, (éditions de l’Encyclopédie des Nuisances + éditions Ivréa, Paris, 2002) du philosophe Günther Anders, voilà un livre qui m’a donné du fil à retordre (comme le montre ci-contre l'état de la couverture). Mais un livre important.
L’idée surgit au 20ème siècle : l’homme est désormais « de trop ». La preuve, l'homme (pas le même) est capable de l’éliminer en masse de 1914 à 1918, puis de 1939 à 1945. La preuve, Staline a supprimé sans doute cinquante millions de « mauvais soviétiques ». La preuve, les nazis furent les premiers industriels de la mort de populations civiles. La preuve, les Américains ont effacé de la surface de la Terre deux villes « ennemies », avec leurs habitants. D’autres preuves ne manquent pas, inutile d’énumérer.
Cette idée que l’homme a été rendu « superflu », je l’avais découverte en lisant Les Origines du totalitarisme, le grand ouvrage de Hannah Arendt. Pierre Bouretz la souligne dès son introduction (Gallimard-Quarto, 2002) : « Son horizon est un système dans lequel "les hommes sont superflus" » (p.151). Arendt enfonce le clou dans sa deuxième partie (« L’impérialisme »), attribuant à la « monstrueuse accumulation du capital » la production d’une richesse superflue et d’une main d’œuvre superflue (p.405). A deux doigts d'expliquer ainsi la concurrence colonialiste entre puissances européennes.
Je viens de trouver la même idée (pas tout à fait : "superflu" n’est pas "obsolète", mais le résultat est le même, répondant à la même question : « A quoi sers-je ? ») exprimée dans le dernier livre paru de Paul Jorion (Penser tout haut l’économie avec Keynes, Odile Jacob, septembre 2015), qui cite le célèbre économiste britannique : « Mais l’effet des machines des générations les plus récentes est toujours davantage, non pas de rendre les muscles de l’homme plus efficaces, mais de les rendre "obsolètes" » (p.94). Il écrivait cela en 1928. Que dirait-il aujourd’hui, où la numérisation bat son plein et où la robotisation avance par vent arrière et a sorti le spinnaker ?
Le livre de Günther Anders, sous-titré « Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle », publié en 1956, s’il n’invente pas la notion, la place en tant que telle au centre de la réflexion du philosophe. C’est du brutal. A noter que la notion d’ « obsolescence programmée » est inventée à la fin des années 1920, quand les fabricants d’ampoules lumineuses se rendent compte que si celles-ci sont éternelles ou presque (comme ils sont parfaitement capables de le faire), leurs entreprises ne survivront pas longtemps.
Je l’avoue : il m’arrive de lire des philosophes. J’exècre, je l’ai dit, les économistes qui jargonnent pour bien faire comprendre leur supériorité sur les gens ordinaires en usant de concepts sophistiqués et d’un vocabulaire amphigourique. C’est la même chose pour la psychanalyse : Lacan me fait rire, contrairement à quelqu’un comme Didier Anzieu, qui n’abrite pas son « autorité » derrière un sabir ou un volapük motivé selon lui par l’extrême précision technique que requiert sa discipline.
C’est encore la même chose avec les philosophes. Je ne suis pas familier de la discipline, mais il m’arrive d’en fréquenter, tout au moins parmi ceux qui me paraissent fréquentables, dans la mesure où ils écrivent pour être compris du commun des mortels, et non du seul petit cercle de leurs confrères spécialistes de la spécialité. Pour rendre intelligible leur pensée, en rédigeant en « langue vulgaire », c’est-à-dire – au sens latin – la langue « commune à tous ».
Ce qui est curieux (et qui rend la lecture tant soit peu ardue), avec le livre de Günther Anders, c’est qu’il cumule. Je m’explique. Il s’exprime dans une langue très accessible, sans toutefois s’interdire de recourir à l’occasion au dialecte propre à quelques philosophes (Hegel, Heidegger, …). Mais il accroît la difficulté : le contenu même des idées est fait pour rebuter le lecteur, dans la mesure où celui-ci se retrouve démuni et perdu, faute d’apercevoir quelques points de repère grâce auxquels il ait l’impression d’être en terrain connu. Indéniablement, on a à faire à un original authentique. L’éditeur le déclare d’entrée de jeu : si la traduction française paraît près d’un demi-siècle après l’édition allemande, « La difficulté du texte y est certainement pour quelque chose … ».
Anders (pseudo signifiant « autre », son vrai nom étant Stern) est un philosophe de toute évidence marginal, à cause de sa radicalité, et surtout à cause d’une « méthode » pour le moins idiosyncrasique. Il revendique en effet le droit à l’exagération comme méthode. Il justifie ce choix en comparant sa recherche à celles que mène un virologue, dont l’outil principal est le microscope : que serait une « virologie à l’œil nu » (encyclopédie en ligne) ?
L’argument semble d’autant plus valable qu’il soutient que ce n’est pas lui mais le monde dont il parle qui exagère : ce qu’il écrit « … n’est que l’exposé outrancier de ce qui a déjà été réalisé dans l’exagération » (p.35). Il le dit ailleurs : l’humanité a commencé à fabriquer « un monde au pas duquel nous serions incapables de marcher ». La grande idée qui traverse tout l’ouvrage est que certes, par son génie, l’homme a élaboré un monde qui tend à se rapprocher des œuvres divines, mais que, par sa nature, il en reste à jamais « pas à la hauteur ».
« L’homme est plus petit que lui-même » est d’ailleurs le titre d’un des chapitres. Le pataphysicien pense bien sûr au chapitre IX du livre II de Faustroll : « Faustroll plus petit que Faustroll ». « Tout est dans Faustroll », s’écriait d’ailleurs le docteur Irénée-Louis Sandomir (fondateur du Collège de 'Pataphysique), pour bien signifier qu’Alfred Jarry reste un grand précurseur.
L’homme n’est pas à la hauteur du monde qu’il a fabriqué à partir du 20ème siècle. Il y faudrait, comme dit Jarry, un SURMÂLE, du type d'André Marcueil.

Dessin de Pierre Bonnard pour Le Surmâle, d'Alfred Jarry.
Mais il n'y a pas de surmâle, comme le montre la baudruche appelée indûment Superman. Comme par hasard américaine.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les rigines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique
mercredi, 27 mai 2015
« POSSÉDÉS » ou « DÉMONS » ?
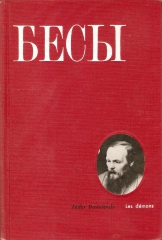 Ci-contre, l'édition "club" : lire "bessy" (ou "biessy ?"), qui veut dire "Les Démons".
Ci-contre, l'édition "club" : lire "bessy" (ou "biessy ?"), qui veut dire "Les Démons".
2/2
La deuxième moitié du livre nous fait prendre pied sur le terrain politique. Verkhovensky fils (Piotr Stépanovitch) est le chef d’une section clandestine de révolutionnaires. Il fait croire à ces exaltés tant soit peu nihilistes que celle-ci n’est qu’une cellule dans un vaste réseau dirigé depuis l’étranger par une sorte de Comité Central.
La réunion (intitulée « Chez les nôtres ») a quelque chose de proprement stupéfiant de prescience du régime qu’instaureront beaucoup plus tard Lénine, puis Staline. Sorties du cerveau de Chigaliov (le théoricien qui forme avec l'activiste Verkhovensky la transposition dans le roman du nihiliste frapadingue et historique Netchaïev) et expliquées par « le professeur boiteux », on lit des choses comme : « Partant de la liberté illimitée, j’aboutis au despotisme illimité ».
Plus fort encore : « Pour résoudre définitivement la question sociale, il propose de partager l’humanité en deux parts inégales. Un dixième obtiendra la liberté absolue et une autorité illimitée sur les neuf autres dixièmes qui devront perdre leur personnalité et devenir en quelque sorte un troupeau ; maintenus dans une soumission sans bornes, ils atteindront, en passant par une série de transformations, à l’état d’innocence primitive, quelque chose comme l’Eden primitif, tout en étant astreints au travail ».
Et Verkhovensky explique plus tard à Stavroguine : « Son projet est remarquable (…). [Chigaliov] établit l’espionnage. Chez lui, tous les membres de la société s’épient mutuellement et sont tenus de rapporter tout ce qu’ils apprennent. Chacun appartient à tous, et tous appartiennent à chacun. Tous les hommes sont esclaves et égaux dans l’esclavage ». Ah bon ? Ça vous rappelle quelque chose ?
Et puis encore : « La soif d’instruction est déjà une soif aristocratique. A peine laisse-t-on s’installer la famille ou l’amour, que naît aussitôt le désir de propriété. Nous tuerons ce désir : nous développerons l’ivrognerie, la calomnie, la délation ; nous plongerons les hommes dans une débauche inouïe, nous détruirons dans l’œuf tout génie ».
Allez, une dernière pour la route : « Seul le nécessaire est nécessaire, telle doit être dorénavant la devise de l’humanité. Mais il faudra aussi lui accorder de temps en temps quelques convulsions ; et nous, les chefs, nous y pourvoirons. Les esclaves doivent avoir des maîtres. Obéissance complète, dépersonnalisation absolue ; mais tous les trente ans, Chigaliov autorise les convulsions ; et alors tous se jetteront les une sur les autres et s’entre-dévoreront ; mais jusqu’à une certaine limite seulement, uniquement pour vaincre l’ennui. L’ennui est un sentiment aristocratique. La société de Chigaliov ne connaîtra plus les désirs ». Précisons que Stavroguine, qui écoute ce galimatias, se demande si l'autre n'est pas carrément cintré ou complètement ivre.
Que Chigaliov (à moins que ce ne soit Verkhovensky) et son programme transposent (en caricaturant ?) le hélas trop authentique et historique Netchaïev et son Catéchisme du révolutionnaire ne fait guère de doute. Intéressant de savoir aussi que Lénine s’inspira de celui-ci pour concevoir dès 1902, puis organiser le parti bolchévik qui allait prendre le pouvoir quinze ans plus tard, avec les suites bien connues, mises en musique par Staline et consort.
Pour confirmation, on se reportera à la remarquable bande dessinée La Mort de Staline, de Fabien Nury et Thierry Robin, pour se faire une idée de l’ambiance terrifiante qui régnait au sommet de l’Etat soviétique, y compris et surtout parmi les plus proches du pouvoir suprême, qui savaient comment ils étaient arrivés là, et qui avaient donc toutes les raisons de redouter le pire à tout instant de la part de leurs meilleurs « amis ».

Molotov, Krouchtchev : ils se les caillent sur le balcon, parce que Béria a fait poser des micros partout à l'intérieur. Ça ne les empêche pas de préparer l'avenir d'un certain nombre de leurs « amis » : « De très longues listes, où l'on n'oubliera personne ». Il n'y a pas que dehors qu'il fait très froid. Brrr ...
Le projet de ce petit noyau de révolutionnaires, à qui l’on a fait croire que la même chose se passerait partout dans les campagnes russes, est de gâcher la « fête » voulue par Julie Mikhaïlovna, épouse du gouverneur Von Lembke, une sorte de fantoche et de mari falot, et de semer le trouble dans la ville par tous les moyens, dans l’espoir de provoquer l’insurrection qui balaierait l’ordre établi.
On ne résume pas Les Possédés. Il faudrait encore citer le personnage de Lébiadkine, vaguement officier en retraite et diplômé d’ivrognerie, qui bat sa sœur, laide, boiteuse et plus qu’à moitié folle. On apprendra que celle-ci (Maria Timopheïevna) a été épousée autrefois, par bravade et par Nicolaï Vsévolodovitch (c'est un zeugma), fils de Varvara Petrovna Stavroguine.
Ce personnage, qui occupe dans le roman une place centrale, on découvre dans un chapitre censuré (« La Confession de Stavroguine », ou « Chez Tikhone »), qu’il a longtemps été complètement barré, désespéré, capable de prendre au pied de la lettre, dans une réunion mondaine, le nommé Gaganov affirmant : « On ne me mène pas par le bout du nez », le saisissant aussitôt par l’appendice nasal et lui faisant traverser le salon.
La vie ne lui est de rien, semble-t-il, aussi incapable de s’aimer que d’aimer Lisaveta Nicolaïevna. On comprend, dans sa « confession », qu’il a sans doute violé une fillette, qu’il n’empêche pas ensuite de se pendre après qu'elle lui a déclaré : « J’ai tué Dieu ». Et pourtant, le comploteur Piotr Stépanovitch l’admire tel un demi-dieu, qu’il rêve de voir sur le trône de Russie en tant que « tsarévitch Ivan ». Allez comprendre. Je garde après lecture le sentiment que Stavroguine est un personnage romanesque incohérent (un peu à l'image du livre pris dans son entier).
Lébiadkine et sa sœur seront assassinés, soi-disant par l’ancien forçat évadé Fédka qui croyait trouver une forte somme. Les assassins présumés ont tenté de dissimuler leur forfait en mettant le feu à la maison au cours de l’incendie qui a détruit tout un quartier de la ville, mais la maison, isolée au milieu d’un terrain vague, a refusé de brûler. Fédka sera lui-même retrouvé mort, sur un chemin.
Il semblerait aussi que Dostoïevski a voulu régler quelques comptes avec l'écrivain Tourgueniev, qui s'est paraît-il offusqué du portrait dressé par l'auteur de l'écrivain Karmazinov, qui le présente sous un jour très peu sympathique. Entre « amis », n'est-ce pas.
Alors maintenant, quel est le vrai titre du livre ? J’avais depuis longtemps dans mes rayons Les Démons, dans une édition « club ». Et puis j’ai découvert que ce livre et le « poche » que je viens d’acheter (traduction de Boris de Schloezer) à 1,60 € ne font qu’un. Enfer et damnation. Il paraît qu’il faut dire « Les Démons ». Même si la perspective en est modifiée, ça ne change rien à la folie des personnages.
Ce qui domine de très haut, une fois qu’on l’a refermé, c’est à coup sûr la dénonciation violente de cette folie destructrice contenue dans l’utopie véhiculée par le petit groupe de conspirateurs dirigé par Verkhovensky, et mû par les théories de Chigaliov. Toute la seconde moitié des Possédés est un pamphlet dirigé contre la folie criminelle de Netchaïev et de tous ses semblables. Faut-il les appeler « communistes », « socialistes », « nihilistes » ? Ou plus simplement : « association de malfaiteurs » ?
Je pencherais volontiers vers la dernière hypothèse (il est vrai que l'enrichissement personnel n'est le but d'aucun "révolutionnaire"). En me disant que Dostoïevski nous parle d'un temps, après tout, pas aussi lointain qu'on pourrait le penser.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, dostoïevski, les possédés, les démons, bolchéviks, nihilisme, révolutionnaires, lénine, staline, netchaïev, chigaliov, communisme, socialisme, catéchisme du révolutionnaire, la mort de staline, bande dessinée, nury robin, état soviétique, confession de stavroguine, boris de schloezer, association de malfaiteurs
lundi, 23 mars 2015
UN TRISTE SIRE ...
… ET UN ODIEUX PERSONNAGE
Je ne connais pas Laurent Obertone. Il vient de publier La France Big Brother, que je ne lirai pas : cela fait belle lurette que je suis au courant. Je n’oublie pas ma lecture de 1984, il y a longtemps, où apparaît le « Grand Frère », cette simple anticipation que George Orwell appliquait alors au régime stalinien, mais qui, le progrès technique aidant, est devenu le modèle de développement de grands groupes industriels (Apple, Google, etc. …), jusqu’à modeler de A à Z ce qu’il est convenu d’appeler encore une « civilisation occidentale ». 1984 apparaîtrait presque comme l'ébauche grossière et prémonitoire de ce modèle, qui s'est, depuis, merveilleusement perfectionné.
Sans même parler des « Grandes Oreilles » mises en place par la CIA, la NSA et les officines d’espionnage de tous les pays (Edward Snowden, ...), ces firmes ont substitué aux polices secrètes du « Petit Père des Peuples » (PPP, à ne pas confondre avec les Partenariats Public-Privé, ruineux pour les finances publiques, instaurés par Nicolas Sarkozy) l’ordre numérique et marchand qui surveille nos comportements grâce à des logiciels et algorithmes de plus en plus sophistiqués et intrusifs.
Je n'apprends rien à personne : le moindre pas de la fourmi dans sa fourmilière est cartographié, mis en mémoire, retraçable, inoubliable, ineffaçable. La police n'a plus besoin de poser des questions à des personnes, plus d'interrogatoire à mener : les réponses n'attendent qu'une requête de sa part pour parvenir.
Avouez que le profilage commercial de l’internaute consommateur et le stockage ad libitum de ses « données personnelles » dans une « ferme de serveurs » aux fins de constituer un réservoir infini de « Big Data », c’est tout de même moins terroriste que le KGB ou le NKVD de Staline.
Est-ce moins totalitaire ? Je pose la question. Je réponds que, tout bien considéré, une autre forme de totalitarisme pointe ici le bout de l'oreille. Au moins le bout : le nec plus ultra en matière de totalitarisme, celui auquel les masses adhèrent avec enthousiasme.
Est-ce moins totalitaire ? Laurent Joffrin, lui, le cogérant et directeur de la publication et de la rédaction (tout ça !) du journal Libération, répond par une affirmative épanouie, décomplexée, et pour tout dire d’un optimisme enfin libéré de toute entrave : nos chères démocraties n'ont strictement rien à voir avec ça. Exactement ce que Philippe Muray nommait « L'Empire du Bien ». L'insupportable et invivable Empire du Bien. Précisément le fonds de commerce du « journaliste » Laurent Joffrin (il a la carte, mais ...).
Laurent Joffrin ignore de toute la hauteur de sa superbe (et de sa suffisance satisfaite, voir le portrait, ci-contre, qu'il aime afficher dans son journal), le fichage généralisé des individus qui usent des technologies numériques en général et de l'informatique en particulier. Il n'y voit aucune atteinte aux libertés. Il doit se dire : « Ça ne me pose aucun problème, je n'ai rien à me reprocher ». S'il raisonne ainsi, il a de drôles de lunettes.
suffisance satisfaite, voir le portrait, ci-contre, qu'il aime afficher dans son journal), le fichage généralisé des individus qui usent des technologies numériques en général et de l'informatique en particulier. Il n'y voit aucune atteinte aux libertés. Il doit se dire : « Ça ne me pose aucun problème, je n'ai rien à me reprocher ». S'il raisonne ainsi, il a de drôles de lunettes.
Dire que Laurent Joffrin, Mouchard de son vrai nom (on se demande bien pourquoi il en a honte, c'est un joli nom, Mouchard, pour un journaliste), n’aime pas Laurent Obertone, c’est un euphémisme. Il y a peut-être des raisons de ne pas aimer Laurent Obertone, si on se réfère à ce que j’ai trouvé sur le monsieur en pianotant devant l’ordinateur. Je n’ai ni le temps ni l’envie de creuser la question. Il faut juste retenir que Laurent Joffrin se paie une page de publicité gratuite en plantant ses ergots de coq dévasté par le multiculturalisme dans le cadavre bientôt froid de son ennemi. C'est dans son journal qu'on la trouve, sous la forme d'une "chronique des livres parus".
Donc, Laurent Joffrin n’aime pas Laurent Obertone (c’est aussi un pseudo, paraît-il). Raison ou pas, mon propos est ailleurs. Il se trouve qu’il mentionne en passant, dans son papier, « l’excellente émission d’Alain Finkielkraut » (« Répliques », le samedi matin à 9 heures sur France Culture). Inutile de dire qu'il la trouve excellente parce qu'il y est invité. Il se trouve que j’ai écouté le début de cette émission. Juste le début.
Or il écrit, dans la « recension » (le mot « assassinat » serait plus exact, puisqu'il l'intitule d'une façon qui se veut originale et humoristique, et qui est juste infamante et grotesque, voir ci-dessous) qu’il en propose dans Libération de samedi 21 mars : « Il a, ainsi, pu expliquer, une heure durant, sur une radio nationale, que le système médiatique aux mains de la pensée unique l’empêchait de parler ». Je m’inscris en faux, monsieur Joffrin. Je vous prends ici en flagrant délit de mensonge.

Je ne connais pas Laurent Obertone. Je doute fort, cependant, qu'il ressemble en quoi que ce soit à l'illustre chef de guerre des barbares.
Si Laurent Obertone a été empêché de parler, ce n’est pas à cause du « système médiatique », c’est parce qu’un certain Laurent Joffrin n'a cessé de lui couper la parole dès qu’il ouvrait la bouche pour exposer ses idées. Si celles-ci sont aussi nauséeuses que le pense Joffrin, la moindre des courtoisies à l'égard de l’auditeur que je suis, pour qu'il s'en rende compte par lui-même, c'est de laisser le monsieur étaler en détail ce qui fait son ignominie supposée : sinon, je n’ai aucun moyen de savoir à quoi m’en tenir, à part acheter le livre.
Laurent Obertone n’a strictement rien pu développer. J’ai dit que j’ai écouté le début de « Répliques ». En effet, quand j’ai jugé, au bout d'un quart d'heure, que, vraiment, monsieur Joffrin s’était rendu assez odieux, j’ai coupé. Comment puis-je encore acheter le torchon publié sous l'autorité de Laurent Joffrin ? Peut-être parce que j'y trouve, de loin en loin, de véritables et importantes informations. Que j'estime trop cher payées.
Non seulement l’odieux monsieur Joffrin n’a cessé de couper la parole de l’interlocuteur, mais dans l’article cité ci-dessus, il ment effrontément en affirmant qu’Obertone « a pu expliquer, une heure duant … ». Vous êtes un odieux menteur, monsieur Joffrin, je suis là pour en témoigner. Et ce faisant, vous êtes à vous tout seul une illustration exemplaire de la validité du reproche que Laurent Obertone, selon vous, fait au « système médiatique ».
La peste soit de ces voix que leur notoriété autorise à s’exprimer sur les ondes ou dans les journaux, et à empêcher de le faire tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Je pense à Edwy Plenel, à Caroline Fourest, à quelques autres, qui viennent jouer les professeurs de morale sur France Culture. Laurent Joffrin appartient à cette même espèce nuisible qui se cramponne aux lambeaux des valeurs qui ont fait la démocratie, la République française, et dont il ne restera bientôt plus que le souvenir.
De derrière ce rempart en mie de pain, ces petits flics de la pensée (assez minables dans leur démarche, il faut le dire) lancent incantations, imprécations et foudres sur ceux qui osent rouler un peu à côté des rails des certitudes orthodoxes, émettre le moindre doute sur la validité du modèle qui les nourrit, remettre tant soit peu en question le bien-fondé des certitudes et du modèle.
Laurent Joffrin, avec ses semblables, tente de disqualifier, de ridiculiser l’adversaire en caricaturant son message (ici, Laurent Obertone est dénoncé pour l'amalgame qu'il fait entre nos régimes démocratiques et le totalitarisme policier élaboré par Staline). Exemple : « Dans cette société totalitaire, en effet, on a le front de penser, en général, que les hommes sont égaux en droit, que le racisme est condamnable et que les femmes peuvent prétendre aux mêmes droits que les hommes ». Un peu lourd, vous ne trouvez pas ?
Ça lui permet, et d'une, de faire ronfler une fois de plus les grands mots de la doxa, et de deux, de ne pas faire l'effort d'entrer dans les détails, le CQFD servant de point de départ à son raisonnement. En logique, cela s’appelle une « pétition de principe », le raisonnement typique du fraudeur et du démagogue, qui consiste à dénaturer les arguments de l'adversaire pour mieux les anéantir et le faire huer par le public qu'on a ainsi mis de son côté, conquis par la force de l'évidence.
Comme ses semblables, non content de faire semblant, outrageusement semblant, Laurent Joffrin pratique allègrement la dénégation du réel, au nom, dit-il, des grands principes. L’odieux, ici, est qu’il fait semblant d’oublier que le propre d’une idéologie, c’est de se présenter comme une évidence incontestable, de ne pas se reconnaître comme idéologie, mais de s'affirmer comme vérité. Laurent Joffrin est finalement le parfait exemple de l’idéologue qui, parce qu’il en tire les moyens de sa subsistance, se tient dans le système comme un rat dans son fromage.
Encore quelqu'un qui ne doit pas aimer les livres de Michel Houellebecq.
On a compris que je n'irai pas à l'enterrement de Laurent Joffrin : je ne veux pas entendre l'éloge que prononcera François Hollande à la mémoire de ce grand « Patron de Presse ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal libération, laurent joffrin, laurent obertone, la france big brother, totalitarisme, philippe muray, l'empire du bien, george orwell 1984, staline, stalinisme, kgb, nkvd, cia, nsa, edward snowden, big data, alain finkielkraut répliques, france culture, edwy plenel, caroline fourest, michel houellebecq
mardi, 03 février 2015
LITTLE TULIP
1
Je ne pensais pas pouvoir un jour être de nouveau secoué par un album de bandes dessinées comme je l’ai été en d’autres temps par Tintin au Tibet (de qui-vous-savez), La Ballade de la mer salée (Hugo Pratt), C’était la Guerre des tranchées (Tardi), Sarajevo Tango (Hermann) et quelques autres (le dernier en date étant Notre Mère la guerre, de Maël et Kriss). Eh bien si, secoué, je l’étais en refermant ce Little Tulip de Boucq et Charyn.

Ce bouquin est en soi un éloge du dessin en général. Et du tatouage en particulier. Je me dis que ça devrait plaire à certain. Sans s. Je lui dis bonjour.
Secoué, je l’étais déjà en refermant mon Libé quotidien en août dernier, quand la BD y paraissait en feuilleton. Je m’étais juré d’acheter l’album à parution. C’est loupé, j'ai oublié : j’ai dû me contenter du deuxième tirage. J’enragerai quand je verrai la cote grimper dans le BDM. Tant pis pour moi. De toute façon, j’ai aussi loupé le Charlie Hebdo du 7 janvier (celui avec Houellebecq en « une », 200.000 € sur eBay, il paraît, je n’ai pas vérifié, quelqu'un qui avait du pognon à claquer, il s'en foutait de savoir que Charlie Hebdo était devenu "pas très bon" - euphémisme).
Boucq, je le connaissais depuis Mormoil, dont j’avais la collection complète (7 malheureux numéros, j’avoue que j’ai un peu oublié ce qu’il y avait dedans, je me souviens juste de la couverture où Bardot, généreusement caricaturée par Mulatier, y allait de sa bulle ahurie : « Mords-moi le quoi ? »).
J’aimais bien une série de Pilote où Boucq développait les aventures d’un citadin lambda, mais en prenant strictement au pied de la lettre l’expression « jungle urbaine ». C’était tout à fait réussi, marrant, surprenant. Une ville "forêt vierge", les bus à l'avenant, un délire bien homogène, quoi, entre le foutage de gueule et l'analyse de civilisation, de celle qui prend en compte le discours publicitaire, vous savez, celui qui vous fait vivre « l'aventure au coin de la rue » (Bruckner et Finkielkraut, 1979). J’aimais avant tout la virtuosité, l'incroyable précision de son trait, qui s’apparente de près ou de loin à la « ligne claire ».
Charyn, en revanche, j'avais juste entendu son nom comme ça, en passant. Bon, j’apprends que c’est un écrivain américain prolifique. J’apprends surtout qu’il n’en est pas à son coup d’essai avec Boucq. Je me suis promis d’aller voir de plus près de quoi il retourne avec ce bonhomme dont l’âge approche de la huitième dizaine et qui vous percute le sternum avec une histoire dessinée à la pointe affûtée d’un poignard. Je veux en savoir plus sur tout ce qu’a pu produire ce tandem depuis 1986. Et que j’ai soigneusement loupé. J’aime ce genre de surprises, celles qui vous disent qu’il vous reste des merveilles à découvrir. En même temps que ça vous laisse l'impression amère d'être passé à côté de quelque chose de géant au moment où ça se passait.
Car Little Tulip est une merveille à couper le souffle. Un bijou de BD. Et d’une prémonition proprement hallucinante, au vu des événements de Paris en janvier, comme le montre la vignette ci-dessous.

Simple curiosité : j'aimerais savoir qui est la personne dont Boucq a tiré ici le portrait.
Je ne vais pas résumer l’histoire, juste situer le cadre du récit. Paul/Pavel est « portraitiste-robot » pour la police new-yorkaise. Il assiste à l’entretien entre un inspecteur et un témoin et dessine ce qu’il « voit » quand il entend la description d’un délinquant ou d’un criminel. Ses portraits sont d’une ressemblance qui stupéfie les témoins. La police aimerait surtout mettre fin à la série de viols-meurtres dont se rend coupable un certain « Bad Santa », qui signe ses forfaits d’un bonnet de Père Noël, et compte pour cela sur l’étrange pouvoir graphique de Paul/Pavel. La suite de l'histoire montrera le problème sur lequel, cette fois, il bute pour « voir ».
C’est qu’il ne vient pas de n’importe où, Pavel/Paul. Il a sept ans et le génie du dessin. La petite famille américaine a émigré à Moscou avant la 2ème guerre mondiale. Elle vit petitement. Le père, un artiste, rêvait de cinéma et voulait travailler avec Eisenstein. Ce qu'il a fait.

"C'est l'esprit qui crée les formes" : ma parole, Jérôme Charyn a lu Bergson, l' "élan vital" qui se fraie un chemin dans la matière pour aboutir à la forme qui lui est propre, tout ça.
Paul/Pavel, 6 ans, très doué, est son meilleur élève. En 1947, les parents sont accusés d’espionnage et la famille est envoyée à la Kolyma, dont le nom générique est "Goulag". C’est des allers-retours entre l'effrayant camp de Magadan et New York, entre le passé et le présent, qu’est composé le récit.
On apprendra que le père est mort, que la mère appartient au « harem » du « Comte », un « pakhan » puissant. Les « pakhanys » sont de redoutables bandits, auxquels les autorités staliniennes laissent le soin de faire régner l’ordre dans le camp. Tout marche bien tant que tout le monde respecte les règles.
Faut-il dès lors se dire que l’ordre, qu'il soit terroriste ou démocratique, vaut mieux que le désordre ? Je n'en sais rien. Mais à observer quelques situations présentes, dans diverses contrées riantes de notre belle planète, on pourrait conclure que ce ne serait en aucun cas fortuit.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, bande dessinée, boucq charyn, little tulip, france, staline, la kolyma, new york, tintin au tibeet, hergé, la ballade de la mer salée, hugo pratt, notre mère la guerre, maël et kriss, c'était la guerre des tranchées, tardi, sarajevo tango, hermann, journal libération, charlie hebdo, houellebecq, boucq, mormoil, pilote, bruckner et finkielkraut, au coin de la rue l'aventure, bd ligne claire, bd
samedi, 31 janvier 2015
L'ISLAM N'AIME PAS LA FRANCE (2)
2
Si les signes vous fâchent, combien davantage vous fâcheront les choses signifiées : je ne sors pas de là. Les mots sont inoffensifs. Ce n’est pas comme les relations entre humains : là c’est sûr, ça peut dégénérer. En fait, je vais vous dire, tout dépend du rapport que chacun entretient avec son propre langage, avec ses propres mots. Tout dépend de la façon dont on croit en eux. Dont on y adhère. Dont on s'identifie à eux.
Le problème surgit quand on ne fait plus qu'un avec eux, qu'on y est soudé. "Raison garder", ça veut dire mettre un peu de distance entre ses mots et soi-même. Prendre un peu de recul. Ce qui veut dire : modérer sa croyance, ne pas la prendre pour La Vérité. On dit aussi "relativiser". Or, pour prendre sa croyance pour une croyance, croyez-moi, il faut avoir fait un effort puissant sur soi-même, et sur des générations. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors ça c’est sûr, c’est clair et net : il y a les uns, mais il y a aussi les autres.
Appelons ça « les forces en présence ». D’un côté, les fronts bas. De l’autre, les cerveaux disponibles pour autre chose que les publicités Coca Cola. Ce clivage découle de deux modes d’évolution distincts : les uns se sont arrêtés en route, les autres ont continué à avancer. Les uns ? Ceux qui voulaient installer leur pouvoir sur des terres à occuper. Les autres ? Ceux qui voulaient inventer une patrie désirable.
Les uns ? En gros l’Islam (de l'Indus à l'Espagne, ce fut fulgurant). Les autres ? En gros la chrétienté (ce fut un travail long, souterrain et obstiné). La fulgurance de la conquête territoriale contre l'obstination de l'extension de la connaissance : je trouve que le contraste fait diablement sens. Disons même que c'est une opposition.
Pour l’Islam, un beau jour, je ne sais plus quelles autorités, au 10ème ou 11ème siècle, après l'expansion foudroyante de la foi "nouvelle", ont décrété : « A partir d’aujourd’hui, il est interdit de commenter, et donc d’interpréter le Coran ». Les musulmans du monde entier se sont dès lors contentés d’apprendre le Coran par cœur, pour le réciter sans réfléchir (Coran veut dire « récitation ». D'autres disent « lecture »).
Les 114 sourates (seul Corto Maltese et Hugo Pratt osent en inventer une 115ème) ont dès lors contenu la totalité de la Vérité. Besoin de plus rien d'autre : tout est là, on vous dit. Une légende prétend que l'incendiaire de la bibliothèque d'Alexandrie donna cet ordre : « Brûlez les livres conformes au Coran, ils sont inutiles ; quant aux autres, ils sont impies, et comme tels, il faut les brûler ». Totalité, totalisant, totalitaire : une seule et même famille de mots.
Remarquez que beaucoup d’Américains (témoins de Jéhovah et autres sectes protestantes intégristes façon George W. Bush) n’ont rien à leur envier, et croient dur comme fer que la Genèse biblique est juste un reportage fidèle et scrupuleux. Oui monsieur, la Genèse est un documentaire.
Pour les créationnistes (c’est leur nom), pas d’évolution. Ils sont aussi dangereux les uns que les autres (cf. Irak en 2003, puis aujourd’hui). Sans parler de Poutine. Mikhaïl Gorbatchev, pourtant fossoyeur malgré lui de l'URSS : « L'Amérique s'est égarée dans les profondeurs de la jungle et nous entraîne avec elle » (Le Progrès, 30 janvier). Je crains fort qu'il ait raison. C'est fondamentalisme contre fondamentalisme. Si les démocrates laissent les extrémistes de tous bords prendre la direction des opérations, il faut s'attendre au pire.
On appelle cette maladie mentale « prendre le mot au pied de la lettre ». Ce qui veut dire : prendre les mots pour des choses. Les « speech acts », inventés pas JL Austin sont tout simplement des forfaitures : aucune parole adulte n'est un acte. Penser qu’il peut exister un quelconque « blasphème », c’est retourner à l'infantilisme de la pensée magique. A l’âge de pierre. C’est valider l’incantation comme moyen de maîtriser le réel.
Et il n’y a pas à tortiller : la civilisation, elle, se bâtit sur la mise à distance entre le mot et la chose. Les spécialistes appellent ça "interprétation", "exégèse", "glose", "commentaire", "scolie". Il y a même une "science" pour ça : l'herméneutique. Pour résumer : la liberté de l'esprit, et non la littéralité de la lettre.
Pendant les mêmes siècles, et même après, dans toute la chrétienté, l’effervescence de la foi et de la connaissance : des milliers, des millions de fourmis écrivantes ont continué à s’agiter dans l’énorme fourmilière que constituaient les innombrables monastères, et à produire de la copie, du commentaire, de la glose, de l’exégèse des textes « sacrés ».
Quand la pensée, y compris religieuse, cesse de travailler, elle s’arrête. La pensée musulmane s’est arrêtée voilà des centaines d’années. La pensée chrétienne ne s’est jamais interrompue. C'est la pensée chrétienne qui a abouti, pour le meilleur et pour le pire, à la science moderne. Voilà, à mon avis, pourquoi votre fille est muette, et pourquoi une caricature du prophète Mahomet met le feu au consulat français de Karachi et à huit églises au Niger (pardon : aux dernières nouvelles, on en comptait quarante-cinq). L'islam, pas plus que le Jdanov et le Lyssenko de Staline, pas plus que les créationnistes américains, n'aime ni la science, ni les scientifiques. Il veut garder la main sur la VÉRITÉ.
Qu’observe-t-on, en terre d’Islam, sur la longue durée ? Que reste-t-il, en terre d’Islam, des populations qui ne se cognent pas le front par terre à l’appel du muezzin ? Si peu que rien. Quelques vagues minorités, à peine tolérées, quand elle ne sont pas carrément persécutées.
Et je ne parle même pas des abominations commises par les nouveaux Robespierre musulmans sur les non-musulmans (ou les mauvais musulmans) en Irak et Syrie. La Turquie laïque elle-même a évacué les « infidèles », en commençant par les Arméniens (mais les autres, peu ou prou, y sont aussi passés). Les coptes d’Egypte doivent peut-être à leur nombre d’avoir survécu. Les Arabes chrétiens ? Combien de divisions ?
L’Islam, une religion de tolérance et d’humanité, vraiment ? C'est comme la météo : ça dépend s'il y a du vent et si il pleut (Fernand Raynaud, "Le Fût du canon"). Non content de manifester sa haine de l’histoire préislamique (destruction des Bouddhas de Bamiyan, bâtons dans les roues des archéologues en Arabie saoudite, …), et donc de la culture au sens large, mais aussi de la modernité, l’Islam actuel, selon toute apparence, est une religion jalousement monopolistique. L'intolérance au pouvoir. Beaucoup d’adeptes ne veulent pas qu’on leur fasse une place : ils veulent toute la place.
J’entends déjà les bonnes âmes et les connaisseurs s’insurger : « Mais vous faites erreur. D’abord, il n’y a pas un Islam, mais une pluralité hétérogène. Ensuite, la plupart des musulmans sont pacifiques. Ce sont des musulmans qui sont les premières victimes ». Certes, mais observez la marche des choses. Prêtez attention à ce qui se passe sur la longue durée. Restriction. Evincement. Et finalement : processus invariable d’épuration religieuse.
Pour vous faire une idée de la tendance générale de l’Islam depuis un demi-siècle, lisez par exemple les pages que Robert Solé consacre à l’Egypte de Nasser dans les années 1950-60, et regardez ce qui s’y passe aujourd’hui. Tiens, où sont-elles passées, toutes les jolies femmes maquillées, élégantes, qui déambulaient en mini-jupe dans les rues du Caire ? Et il n’y a pas que l’Egypte. Le mot d'ordre : cachez les femmes ! Dire que nos féministes exigent toujours plus d'égalité, quand les Saoudiennes aimeraient bien être autorisée à conduire une voiture ! Mais la féministe est-elle seulement un peu lucide ?
Pendant ce temps, le gouvernement français ânonne un "ABCD de l'égalité" destiné à la communauté musulmane de France. Mais bien sûr il ne peut pas le dire comme ça : le Conseil Constitutionnel veille au grain. Résultat 1 : lettre morte dans les quartiers où les filles qui ne s'habillent pas en vêtements amples se font traiter de putes (quand ce n'est pas violer). Résultat 2 : les milieux aimablement qualifiés d' « extrême-droite catholique » descendent dans la rue pour dénoncer, non sans quelque raison, l'indifférenciation sexuelle et l'homosexualisation rampante de la société. Quand tout le monde se sent visé par une mesure très spécifique (le machisme à tout crin en vigueur dans les quartiers à majorité maghrébine), la mesure fait chou blanc.
Les gens informés vous diront que les pouvoirs arabes en place sont pour quelque chose dans cette évolution vers toujours plus de fermeture et de régression. Que, pour faire leurs petites affaires à la tête des Etats, ils ont laissé les religieux prendre en charge tout le social, l’entraide, la gestion du quotidien. Pourvu qu’ils ne se mêlent pas de politique, ils ont eu les mains libres. Moubarak et Ben Ali sont même allés jusqu’à leur construire plein de mosquées. En Algérie, même tableau, cette fois au nom de l’arabisation et de la décolonisation.
L’Islam est-il soluble dans la République ? Ma réponse est non. Pour une raison elle-même très nette :

la religion est omniprésente dans les esprits et dans les sociétés arabes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel Guerrin dans sa chronique remarquable du Monde daté 24 janvier.
Il est plus que probable qu'une collectivité européenne en grande partie déchristianisée, où l'athéisme, l'agnosticisme et l'indifférence spirituelle (c'en est au point que le mot "laïcité" a depuis longtemps perdu toute signification) se disputent la plus haute marche du podium, est incompatible avec des gens qui, quoi qu'il fassent et où qu'ils soient, se trimballent avec, cousus dans leur chair à vif, leur dieu, leur prophète, leur Livre et leur tapis de prière. Et qui, à la moindre remarque, à la moindre critique, aimeraient vous voir rôtir en enfer parce qu'ils se sont sentis « offensés » par vos « blasphèmes ».
L'islam a d'ores et déjà réussi à introduire son altérité radicale dans la loi française (nécessité de légiférer sur le voile), quand ce n'est pas dans la rue (port du niqab). Et ça, on me dira tout ce qu'on voudra, ce n'est pas acceptable : c'est de l'ingérence. Combien sont-ils, au total, les Abdelwahab Meddeb, les Tareq Oubrou, capables d'adhérer à l'idée de République et d'un islam moderne ? En dehors des discours bêlants des hommes politiques, de leurs appels qui sonnent creux aux « valeurs de la république » et de leurs supplications à ne pas pratiquer d'amalgames, la France est singulièrement dépourvue d'arguments pour être un jour aimée de l'islam.
Et disons-le dans la foulée, si l'on en croit la tournure prise par les événements un peu partout sur la planète, l'actualité récente dans le monde arabe et le visage que cette religion s'est donné dans bien des endroits à commencer par la France, l'islam n'est pas parti pour aimer la France, la République et les Lumières. Il va falloir se faire une raison : deux représentations du monde radicalement hétérogènes, peut-être incompatibles. Il faudrait que nos responsables (mais le sont-ils ?) aient le courage d'en tirer les conséquences.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : je préviens que je dénie fermement à quiconque le droit de me traiter d'islamophobe. D'abord parce que ce n'est pas vrai. Ensuite parce que c'est faux. Enfin parce que ce serait un mensonge. Bref : une diffamation.
Note : comme je n'ai ni l'intention, ni la capacité d'écrire un Traité savant sur la question, on comprendra que ces propos un peu schématiques comportent quelques approximations. Je raisonne à partir de là où je me situe : porte-parole de rien et de personne. Les propos tenus dans ce blog sont de première main. Si certains jugent que je caricature, je dis : « C'est possible. Et alors ? ».
09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : religion musulmane, islam, soumission, allah, mahomet, coca cola, coran, corto maltese, hugo pratt, bibliothèque d'alexandrie, témoins de jéovah, george w. bush, vladimir poutine, mikhaïl gorbatchev, journal le progrès, urss, jdanov, lyssenko, staline, stalinisme, bouddhas bamiyan, journal le monde, michel guerrin, blasphème, tareq oubrou, abdelwahab meddeb
lundi, 26 mai 2014
KUNDERA, VIEILLARD JUVENILE
LA FÊTE DE L’INSIGNIFIANCE

J’ai fait une exception à ma règle (voir hier) pour Milan Kundera, dont Gallimard vient de publier La Fête de l’insignifiance. Même que j’ai entendu la libraire de « Vivement dimanche » (rue du Chariot d’or) dire qu’elle l’avait trouvé décevant. Eh bien moi, sans crier au chef d’œuvre, je trouve ce bouquin rigolo. Et rigolo parce que désinvolte et acrobatique. Le livre apparemment léger d’un romancier qui n’a plus rien à prouver, puisqu’il a vu son œuvre (enfin presque toute) publiée dans la consacrante collection de la Pléiade, si ce n’est pas une preuve …
Un monsieur de quatre-vingt-cinq ans qui trouve le moyen de s’amuser et d’en faire profiter les lecteurs. Un livre qui ne tient pas debout, à la fin duquel Staline, déguisé en chasseur, débarque dans le Jardin du Luxembourg pour tirer à coups de fusil sur Kalinine en train, comme d’habitude, de se soulager la vessie contre la statue d’une grande dame de France. Tout ça sous le regard interloqué des personnages bien actuels du roman, Ramon, Alain, Charles et D’Ardelo.
Pour parler franc, il y a fort longtemps que je n’avais pas lu Milan Kundera. Je suis donc bien incapable d’affirmer, comme le claironne la quatrième de couverture, que « Kundera réalise enfin pleinement son vieux rêve esthétique dans ce roman qu’on peut ainsi voir comme un résumé surprenant de toute son œuvre ». Un résumé en cent quarante pages. Il aurait fallu que je révise avant.
Je parlerais volontiers d’un livre foutraque et « déménagé » (à Lyon, on dit « détrancané »), qui se moque de faire cohabiter les morts et les vivants. Je trouve ça éminemment réjouissant. Un coup, c’est Staline terrorisant le petit (et prostatique) Kalinine et tout le soviet suprême (en particulier Krouchtchev), qui n’ont d’autre solution pour crier leur fureur d’être dominés et impuissants que de se réfugier dans les chiottes, où le dictateur, sans qu’ils le sachent, se débrouille pour les entendre.
Le délire sur le personnage de Kalinine vaut son pesant de détour et de déconne, car Staline ira jusqu’à débaptiser Königsberg pour que la ville prenne le nom de Kaliningrad (la fameuse enclave entre Pologne et pays baltes). Or, ironie de l’histoire, c’est la ville où Immanuel Kant (l’inventeur du « Ding an sich », auquel Staline oppose le Schopenhauer de la « volonté » et de la « représentation ») a passé toute sa vie, invariable et réglée comme du papier à musique.
Staline, ce terroriste sanguinaire à la tête d’une URSS terrifiante, eh bien il s’amuse, lançant ses paradoxes et ses questions, auxquelles nul ne se permettrait d’oser répondre. Les pantomimes auxquelles il se livre ont quelque chose de léger, presque printanier, comme un effluve d’enfance retrouvée. C’est d’autant plus insoutenable.
Un autre coup, c’est la mère morte d’Alain qui lui parle comme si elle était là et bien là. Cette mère qui a voulu mourir pour l’empêcher de naître. La scène du suicide qui finit en meurtre gratuit, je la trouve ironique, certes, mais saisissante. Elle saute du pont pour mourir, et un petit con veut la priver de la mort qu’elle a choisie ? Elle se débrouille alors pour le noyer, avant de retourner vers le mari honni, dont la haine a laissé en elle le germe d’un être dont elle ne voulait à aucun prix : Alain.
Ici je ne suis pas d’accord avec l’auteur : il dit quelque part que naître est un acte. C’est idiot : nul être humain n’a jamais demandé à naître, et c’est mentir que de faire croire qu’on l’a voulu. Le moment qui suit la mort a induit et suscité toutes les craintes, toutes les superstitions et, disons-le, toutes les religions. Il est étrange que le moment qui précède notre entrée sur la scène du monde n’ait jamais donné lieu à des développements mythologiques aussi considérables, à part les élucubrations psychanalytiques sur le « désir d’enfant » et « l’enfant fantasmé ». Mais Kundera sait tout cela.
Pour ce qui est des personnages dont les maigres tribulations festonnent le roman de leurs guirlandes falotes et ballottantes au gré d’une soirée mondaine ou d’une cuite entre amis, inutile de s’y attarder. Ce sont quatre hommes dont la vie est plutôt derrière eux, mais reste encombrée de vieux fatras d’histoires qui leur collent à la mémoire.
Le personnage de Quaquelique est plus nouveau et plus intéressant. La vraie figure de l’insignifiance, c’est lui. Personne ne le voit, personne ne le remarque, et pourtant, quand Ramon cherche Julie dans les salons, au motif que, quand elle l’a quitté, juste avant, « les mouvements de son derrière le saluaient et l’invitaient », il ne la trouve plus.
Bon dieu mais c’est bien sûr : elle est partie avec l’insignifiant Quaquelique, comme la suite le confirme. Eh oui, c’est celui qui n’a l’air de rien qui a emporté le morceau. Mais comment fait-il pour damer le pion au dragueur impénitent qui, comme un paon faisant la roue, éblouissait la dame de ses bouquets d'éloquence étincelants ? Moralité, n'essayez pas d'être brillants, messieurs.
Les nombreuses facettes offertes par cet ouvrage apparemment insignifiant voudraient qu’on s’y attarde pour en préciser les éclats. Je m’en garderai. Je citerai juste pour finir un passage (p. 85) où monsieur Milan Kundera montre à tout le monde, sans avoir l’air d’y toucher, comment on fait, et ce que ça veut dire, « savoir écrire ».
« Connaissant les bonnes manières, les messieurs levèrent leurs verres, les réchauffèrent pendant un long moment dans leurs paumes, gardèrent ensuite une gorgée dans la bouche, se montrèrent l’un à l’autre leurs visages qui exprimèrent d’abord une grande concentration, puis une admiration étonnée, et finirent par proclamer à haute voix leur enchantement. Tout cela dura à peine une minute, jusqu’à ce que cette fête du goût soit brutalement interrompue par leur conversation, et Ramon, qui les observait, eut l’impression d’assister à des funérailles où trois fossoyeurs inhumaient le goût sublime du vin en jetant sur son cercueil la terre et la poussière de leur parlote. » Pas besoin de commentaire, je pense.
Faut-il dire que Kundera est un grand pessimiste ? Mais pour quoi faire ? J’ai plus envie de voir dans ce livre le regard désenchanté d’un vieux monsieur. Je ne sais pas pourquoi, je pense au Manoel de Oliveira dernière manière, au dernier Alain Resnais, ces gens que l’âge semble libérer de toute contingence et de toute convenance, et qui offrent, en dîner d’adieu, des œuvres atypiques, qui peuvent donc être déroutantes. J'ai lu quelque part que Adieu au langage, film présenté à Cannes par Jean-Luc Godard (qui a quatre-vingt quatre ans), a quelque chose de testamentaire.
Et s'il fallait à tout prix dénicher une moralité à cette fable, j'irais direct à la page 96 : « Nous avons compris depuis longtemps qu'il n'était plus possible de renverser ce monde, ni de le remodeler, ni d'arrêter sa malheureuse course en avant. Il n'y avait qu'une seule résistance possible : ne pas le prendre au sérieux ». Quasiment une déclaration de philosophie générale.
Milan Kundera, dans La Fête de l’insignifiance, s’amuse comme un petit fou. J’ai, en repensant à ma lecture, une impression funambulesque, comme un narrateur de corde, comme un danseur sans vertige au-dessus des abysses que l'époque a d'ores et déjà creusés sous nos pieds.
Un petit livre souverain. Je pense que Philippe Muray aurait adoré la belle tenue morale de ce petit livre souverain.
Voilà ce que je dis, moi.
Et voilà que je me rends compte que je n'ai pas parlé des « excusards » ! Vache de mouche ! Il va peut-être falloir que j'y revienne, parce que ça aussi, c'est une trouvaille rigolote (quoiqu'un peu caricaturale).
*******
Remarque sur le résultat des européennes : je me dis que la France, avec un tiers de députés Front National à Bruxelles, n'est pas partie pour voir son influence s'accroître. Je voudrais aussi savoir comment il se fait que les Français de l'étranger (3,6% du corps électoral) élisent 15 députés européens (20%) ? Bizarre autant qu'étrange. Rectif. : Pardon, je retire ce dernier point, j'ai juste répété une connerie de journaliste. Après consultation du site du Ministère, les « Français-hors-de-France », si j'ai bien lu, sont rattachés à la région Île-de-France.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, milan kundera, la fête de l'insignifiance, gallimard, collection la pléiade, staline, kalinine, kaliningrad, krouchtchev, königsberg, emmanuel kant, urss, librairie vivement dimanche
dimanche, 02 juin 2013
QUI EST NORMAL ?

MAGNIFIQUE ET RECONNAISSABLE PORTRAIT EN PHOTOMONTAGE DU GRAND PHOTOGRAPHE
ERWIN BLUMENFELD.
***
Finalement, qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire, « normal » ? Qu’est-ce qui se cache dans la cave ou le grenier de ce mot pour que certains lui en aient tellement voulu qu’ils ont tout fait pour le faire disparaître, et qu’ils y sont à peu près parvenus ? Plusieurs réponses à ces questions. Pour ma part, j’en vois deux.
Pour la première, il faut se référer aux anciennes cartes d’identité, qui comportaient en fin de liste une rubrique intitulée « signe particulier ». Si vous n’aviez pas les yeux vairons, une bosse dans le dos ou une polydactylie, le fonctionnaire préfectoral remplissait la rubrique d’un seul mot : « néant ». Voilà ce que c’est, « être normal » : « signe particulier : néant ».
« Particulier », c’est ce qui se distingue de la masse, ce qui sort de l’ordinaire, ce qui est unique et ne ressemble à rien de connu. « Particulier » s’oppose donc à « général », terme qui renvoie à tous les éléments et les caractéristiques partagés par tous les individus composant une population. Voilà : « signe particulier : néant », c’est une autre manière de dire « tout le monde ».
Bon, ça, ça vaut quand on reste à distance, car c’est vrai qu’il suffit de s’approcher un peu pour voir que, même si « tout le monde » pourrait être « n’importe qui », ils se ressemblent trop peu pour qu’on puisse les confondre : « n’importe qui » ne ressemble pas à « tout le monde », quand on les regarde d’assez près.
Au fond, ce qui fait du mal à l’individu, c’est la question de la distance focale : au « grand angle », vous ne voyez que de la masse, au « téléobjectif », vous ne voyez que des individus, parfois même dans le détail. Je pense au fabuleux travelling vertical de Autant en emporte le vent, dans la rue principale de cette ville du Sud, qui part d’un gros plan sur un blessé étendu, et qui arrive au plan d’ensemble qui montre les milliers (centaines ?) de blessés alignés.

COMBIEN SONT-ILS ICI ?
DANS L'ISLAM, L'INDIVIDU EXISTE A PEINE, PUISQU'IL S'ABOLIT EN ALLAH. PENDANT CE TEMPS, L'OCCIDENT ENCORE CHRETIEN INVENTE LES DROITS DE L'HOMME : UNE INCOMPATIBILITÉ RADICALE. CHEZ LES CHRETIENS, EN CONSEQUENCE, PAS D'ATTENTAT-SUICIDE. ON M'OBJECTERA SAMSON ("que je meure avec les Philistins!"), MAIS SAMSON ETAIT JUIF.
Dans un « plan d’ensemble », l’individu cesse d’exister, car là c’est la statistique qui prend le pouvoir. Et quand on est dans la statistique, l’individu devient l’objet de mesures de mesure : de décisions officielles destinées à le « mesurer ». Et la principale mesure de l’individu dans la statistique consiste en un écart par rapport à la moyenne obtenue.
Tant que l'écart ne s'écarte pas trop de la moyenne tout va bien. Regardez les courbes figurant dans le "Carnet de santé" qui accompagne toute naissance : le petit grandit-il correctement ? Mange-t-il suffisamment ? Remplacez le mot « moyenne » par le mot « norme », et vous avez des chances de comprendre l’enjeu caché du mot. Le mot "moyenne" beaucoup plus neutre, a supplanté le mot "norme". C'est bien sûr une immense avancée.
L’essence de la norme, en effet, est statistique. Prenez la taille moyenne des individus, leur poids moyen, l’envergure moyenne de leurs bras et la longueur moyenne de leurs jambes, leur tour de tête moyen, la pointure moyenne de leurs pieds et de leurs mains. Faites du « bertillonnage », comme on disait à l'époque où monsieur Alphonse Bertillon (1853-1914) inventa l'anthropométrie judiciaire.

FICHE ANTHROPOMETRIQUE REALISEE PAR LA POLICE DU TSAR DANS LES ANNEES 1900-1910, CONCERNANT UN CERTAIN JOSEPH VISSARIONOVITCH DJOUGACHVILI, PLUS CONNU SOUS LE NOM DE
STALINE
Relativisez le résultat de vos opérations, en fonction du sexe des personnes (les dimensions masculines, quand on parle de moyennes, sont supérieures, au grand dam des associations féministes, certes, mais c’est comme ça, « c’est injuste et fou, mais que voulez-vous qu’on y fasse ? », c'est dans Le Bistrot, de Georges Brassens), et voilà : vous êtes en mesure de les habiller de pied en cap, pour l'hiver, pour l'été et pour les demi-saisons.
Que dis-je ? Vous définissez les normes non seulement de tous les habits, mais encore de tout le mobilier, tables, chaises, stylos, dans leur hauteur, leur longueur, leur largeur. Encore plus fort : vous calibrez toute l’architecture. Comment sont définies largeur et hauteur des portes et des étages des immeubles où nous habitons ? La largeur des sièges de nos voitures ? C’est comme les dimensions de nos vélos et de nos smartphones : on a fait une moyenne des dimensions humaines. C'est la deuxième réponse aux questions du début.
Que ce soit injuste envers les personnes trop grandes ou trop petites, trop lourdes ou trop légères, c'est certain. Pensez seulement à la hauteur où est située la fente où on glisse les pièces pour un ticket de bus. Mais à qui s'en prendre de cette injustice ? Et puis, il existe des gens dévoués (appelons ça des compensations ?), comme le montre le mariage, en 2010 ou 2011, de Bao Xishun, berger de 236 centimètres, et de Xia Shujuan, Chinoise de 1,68 mètre. Certains diront peut-être cependant, à l'instar d'O. : « Ils sont fous, ces Chinois ! ».

Moralité, le théorème est le suivant : est normal l’individu dont les dimensions ou les caractéristiques sont contenues dans la fourchette d’une moyenne établie scientifiquement, selon les lois statistiques. Conclusion logique : tous les autres peuvent à bon droit être considérés comme anormaux. Qu'est-ce que c'est, cette panique à l'idée de mettre le mot exact sur la chose ? Mon Dieu, vous osez appeler un chat un chat ? Quelle folle témérité, Dieu me damne et ventre saint-gris !
Tout dépend ensuite, évidemment, de la façon dont les gens et la société (pas la même chose) considèrent les anormaux et leur font une place. Car Georges Brassens (encore lui !) le chante très bien : « Mais les braves gens n'aiment pas que L'on suive une autre route qu'eux ». C'est un autre problème.
Mais il n'y a aucune raison de se cacher derrière son petit doigt et d'appeler autrement qu'anormales les personnes qui crèvent les plafonds ou les planchers de la moyenne de la population, que ce soit par leur taille ou leur poids. Ou autre chose. Il y a tant de gens qui sont si fiers d'être HORS-NORME ! C'est tout à fait curieux, d'ailleurs. Pourquoi "hors-norme" est-il si flatteur ? Pourquoi "anormal" est-il si tabou ? Elles sont pas mignonnes, mes questions ?
A bas l'euphémisme et autres précautions oratoires politiquement correctes ! Puisqu'il s'agit de gérer les populations (on est dans une société de masse, ce n'est pas moi qui le dis), il faut être exact et précis, et mettre sur la chose le mot qui la désigne. Partant de là, tout ce qui n'est pas dans la norme est anormal. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir honte de ça. Et de le dire.
Je sens que je vais encore me faire appeler Arthur !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, erwin blumenfeld, adolf hitler, photomontage, normal, anormal, normalité, signe particulier, carte d'identité, autant en emporte le vent, cinéma, la mecque, pèlerinage, islam, musulman, individu, chrétien, moyenne, statistique, staline, anthropométrie judiciaire, georges brassens, le bistrot
dimanche, 09 décembre 2012
L'HOMME QUI FIT FUMER LA FEMME
Pensée du jour :

QUAND UN AVEUGLE PREND DES PHOTOS, VOILA CE QUE CA DONNE
IL S'APPELLE EVGEN BAVCAR, IL EST NE EN SLOVENIE
(authentique, évidemment, et il sait visiblement ce que c'est, une femme nue !)
« Rien n'est plus étrange que la mer. Elle part, elle vient, repart, revient, elle se berce ; et elle fait des songes. Elle rêve des îles, des ports et des soleils couchants ; au sud, à l'horizon, elle rêve Alexandrie, mirage nacré, impalpable vapeur, jeu d'étincelles ; au nord, houleuse et couleur de hareng, elle rêve de grands clairs de lune, et les phares de la côte anglaise. Elle rêve les jonques et les lanternes vénitiennes, les éponges et les madrépores, elle rêve de tout, elle se nourrit de reflets et se nourrit de coquillages, des baleines mortes et des cadavres de marins ; elle enfante surtout les nuages, formes mouvantes commes les sculptures de Brancusi, qui s'entre-effacent et s'entre-engendrent à la façon des musiques de Mozart : la mer est un sculpteur abstrait ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé de l’épisode précédent (d'avant-hier, en fait) : le petit EDWARD BERNAYS est devenu grand en écrivant Propaganda (1928), un livre de chevet pour GOEBBELS, HITLER, STALINE, et un « credo » pour tout publicitaire qui se respecte un peu.

SALE ENGEANCE : ÇA MEURT A 103 ANS !!!
Chargé de vendre la cigarette à toute la gent féminine (et pas « gente », qui est un adjectif qualificatif, comme l'ignorent les ignares), il « libère » la femme en établissant un lien entre la « Torch of Freedom » de la Statue de la Liberté et la cigarette allumée, que seront dès lors autorisées à arborer toutes les femmes américaines.
Soit dit en passant, on ne m'enlèvera pas de l'idée que le BOUT DE SEIN joue pour l'imaginaire des hommes un rôle assez voisin de celui du GLAND (selon la psychanalyse) pour l'imaginaire des femmes, et que l'incandescence du bout de la cigarette a quelque chose à voir avec le BOUT DE SEIN, dans l'imaginaire masculin. On nage en plein érotisme, comme on le voit, par exemple avec la photo de la pin-up à poils (de moustache) ci-dessous.

 Oui, il faut préciser que la torche que la Liberté tient dans la main droite s’appelle en américain : « Torch of Freedom ». C’est comme ça que la cigarette allumée, délicatement tenue par deux doigts d’une exquise main féminine, devint à son tour la « Torche de la Liberté ». Et vive la métaphore ! Tout est dans la nomination, on vous dit.
Oui, il faut préciser que la torche que la Liberté tient dans la main droite s’appelle en américain : « Torch of Freedom ». C’est comme ça que la cigarette allumée, délicatement tenue par deux doigts d’une exquise main féminine, devint à son tour la « Torche de la Liberté ». Et vive la métaphore ! Tout est dans la nomination, on vous dit.
Ben oui, il suffit de donner à la chose désagréable le nom adéquat pour faire passer sans douleur la dite chose : appelez donc votre plan de licenciements massifs « Plan de Sauvegarde de l’Emploi », et soudain vous verrez, tout change. On appelle ça la magie de l'EUPHEMISME.  VICTOR KLEMPERER a longuement étudié ça sous le règne d’HITLER (dans LTI, la langue du 3ème Reich, une lecture indispensable).
VICTOR KLEMPERER a longuement étudié ça sous le règne d’HITLER (dans LTI, la langue du 3ème Reich, une lecture indispensable).
GEORGE ORWELL, avec sa "novlangue" (dans 1984), a lui aussi bien cerné le problème ("l'esclavage, c'est la liberté"). C'est pourquoi on peut se demander si la théorie de SIGMUND FREUD n'a pas nourri indirectement le système hitlérien, à commencer par sa dimension de propagande ? Il y a de quoi se demander, non ? Mais pour revenir à la campagne publicitaire d'EDWARD BERNAYS, ça ne suffisait pas.
a lui aussi bien cerné le problème ("l'esclavage, c'est la liberté"). C'est pourquoi on peut se demander si la théorie de SIGMUND FREUD n'a pas nourri indirectement le système hitlérien, à commencer par sa dimension de propagande ? Il y a de quoi se demander, non ? Mais pour revenir à la campagne publicitaire d'EDWARD BERNAYS, ça ne suffisait pas.
Pour que l’événement fasse date, pour que la campagne atteigne efficacement son objectif, il faut frapper les imaginations, il faut que toute la presse en parle, il faut que tout le pays en parle, il faut du spectaculaire et du scandaleux. Et c’est là que le savoir-faire d’EDWARD BERNAYS va faire merveille.
Chaque année, la ville de New York organise une « manifestation-spectacle ». « New York Easter Parade », ça s’appelle. Un événement annuel de portée nationale, qui a lieu depuis 1880. On va stipendier une cohorte d’accortes bougresses artistement vêtues, on va prévenir en douce les photographes et autres journalistes qu’il va se passer quelque chose et qu’ils doivent se tenir prêts.

NEW YORK EASTER PARADE 2012 !!!!! ÇA CONTINUE !!!!
Et le jour du « Easter Sunday » 1929, quand la troupe des jolies femmes sort des sacs à main une cigarette, que chacune la porte à ses lèvres pulpeuses et, comble du culot, en allume l’extrémité, tout est prêt, EDWARD BERNAYS peut dire que sa campagne est un succès et qu’il a mérité son gros chèque. Les images scandaleuses s’étalent en « une » des journaux, de l’Atlantique au Pacifique.
Les femmes peuvent désormais se proclamer « libérées » par la grâce d’une magistrale campagne de publicité. On est en 1929. L’industrie du tabac peut se frotter les mains. « La moitié du ciel » (les femmes, selon MAO TSE TOUNG) va faire pleuvoir les pépètes, pésètes et autres picaillons dans son porte-monnaie largement ouvert sur les profondeurs abyssales des comptes en banque des actionnaires enchantés. Le « marché », en un clic, a tout simplement doublé de surface.
Bon, alors, le lecteur va me dire maintenant : « Mais qu’est-ce qui te permet, blogueur excessif, de considérer EDWARD BERNAYS comme un quasi-génie ? ». Bonne question. Qu’est-ce qu’elle prouve, la campagne pro-tabac de 1929 ? Qu’est-ce qui fait de son auteur un révolutionnaire ? Tiens, juste un avant-goût : le premier paragraphe de Propaganda.

Au moins, on se dit qi'il ne prend pas de gants, EDWARD BERNAYS. Et ça n'est que le tout début de 110 pages qui décoiffent (je ne compte pas la préface). J'attire juste l'attention sur "gouvernement invisible".
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, art, france, société, culture, alexandre vialatte, littérature, humour, edward bernays, propagande, publicité, public relations, goebbels, hitler, staline, communication, statue de la liberté, sigmund freud, victor klemperer, lti, new york, mao tse toung, grammaire, langue française, propaganda
vendredi, 31 août 2012
CELINE LE MAUDIT
Pensée du jour : « On a tout essayé pour trouver du nouveau : le roman sans histoire, le roman sans personnages, le roman ennuyeux, le roman sans talent, peut-être même le roman sans texte. La bonne volonté a fait rage. Peine perdue, on n'est parvenu qu'à créer le roman sans lecteur ».
ALEXANDRE VIALATTE
Je viens de finir le dernier roman d’HENRI GODARD, intitulé Céline. Eh bien je crache le morceau : le héros meurt à la fin. J’espère qu’on ne m’en voudra pas. Un 1er juillet 1961. La « Céline » du titre n’a rien à voir avec celle d’HUGUES AUFRAY (« Dis-moi, Céline, qu’est-il donc devenu, ce joli fiancé qu’on n’a jamais revu ? »). La Céline dont je parle, c’est la grand-mère de DESTOUCHES. Car ce « Céline » s’appelle DESTOUCHES, prénom LOUIS-FERDINAND. Né un 27 mai 1894. Nom de plume : CÉLINE. Monsieur a écrit des livres. Et quels livres, nom de Dieu !
Oui, ce « roman » est une biographie. Même si ça mériterait l’appellation « roman », à cause du bonhomme. Mais HENRI GODARD est un savant, pas un romancier. Pour preuve que c’est un savant, il lui faut quarante pages en tout petits caractères à la fin pour loger les notes, vous savez, ce qui prouve qu’il n’a rien inventé. Attention, 1449 notes, pas une de plus, pas une de moins. J’ai compté. Pour indiquer que rien de ce qu’il avance n’a échappé à la vérification. Tout est sourcé, qu’on se le dise. On se dit qu'il connaît son bonhomme jusqu'au fond des poches.

PROFITEZ-EN, C'EST PAS TOUS LES JOURS QUE QUELQU'UN LE FAIT RIGOLER
Quand Gallimard a pris la décision de publier CÉLINE dans la Pléiade (le © du premier volume date de 1962), ses éditeurs claquaient des miches et faisaient dans leur froc (en chœur, si ça se trouve, imaginez la scène des miches qui claquent des mains en cadence) à propos de Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit : le Parti Communiste était à 22 %.
C’était encore le printemps de la « guerre froide ». Et le PCF, qui était alors à son zénith, n’aimait pas CÉLINE, mais alors, on peut dire, pas du tout. Même que ROGER VAILLAND raconte qu’il avait empêché ses camarades de cellule, en 43 ou 44, de l’assassiner purement et simplement. Et qu'il regrettait (plusieurs années après) de les avoir empêchés. Le groupe se réunissait dans l’appartement juste en dessous de chez lui. Et CÉLINE se targuera du fait qu’il aurait facilement pu les dénoncer. Ce qu’il n’a pas fait. C’est sans doute vrai.
Il faut dire que CÉLINE n’a jamais fait grand-chose pour se faire aimer, que ce soit des communistes, des gens en général, et même de ses lecteurs : adopter l’exclamation et la suspension comme style est un bon répulsif pour des lecteurs, même bienveillants. Se faire haïr du lecteur qu’on espère avoir, avouez quand même qu’il faut oser. Même aujourd’hui, pour lire CÉLINE, il faut au moins l’avoir décidé. GODARD se penche sur le paradoxe.
C’est sûr, CÉLINE n’est pas le premier client venu. Auteur sulfureux. Au point qu'on n’a pas oublié l’action sournoise qui l'a fait désinscrire, en 2011, de la liste des célébrations nationales celle de LOUIS-FERDINAND CÉLINE, à la satisfaction de CLAUDE LANZMANN, ARNO KLARSFELD et quelques autres, mais au grand dam de son promoteur, HENRI GODARD. Que l’on avait sollicité officiellement. Mais ce savant n’est pas un homme politique. Et puis ça lui servira de leçon. Il n’avait qu’à s’occuper de Sainte THERESE DE LISIEUX, ou alors, à la rigueur, de PIERRE DE BERULLE.

Car choisir CÉLINE, c’est au moins prendre des risques. Pensez : un auteur antisémite. Aujourd’hui, regardez les faits divers. MOHAMED MERAH tue trois militaires français d’origine maghrébine ou exotique, on en parle et l’événement fait sensation, c’est certain. Mais qu’il tue, quelques jours après, quatre juifs devant une école confessionnelle, alors là, vous pouvez être sûr que la machine médiatique s’emballe et que, dans le vacarme, on n’entend plus hurler qu’à l’antisémitisme. Alors pensez, un auteur qui a écrit des pamphlets antisémites !
Remarquez, le cas d’HENRI BÉRAUD n’est pas très éloigné de celui de CÉLINE. Demandez à ROLAND THÉVENET, qui a fouillé l’animal jusqu'à la racine du poil, depuis le temps qu’il le fréquente. Il a même publié Béraud de Lyon. Que lui ont reproché les épurateurs, à la Libération ? De ne pas avoir été membre du « parti des fusillés », le parti communiste qui, jusqu'au 22 juin 1941 (rupture par HITLER du pacte germano-soviétique, et entrée en guerre contre l'URSS), prêchait l’entente cordiale avec les Allemands, avant de virer de bord à 180° le 23 juin ? De quoi se méfier des cocos, non ? A la place de BÉRAUD, j'en aurais fait autant.

Il ne les aimait certes pas, les cocos. Mais a-t-il pour autant aimé les nazis ? Franchement ? Bon, c'est vrai, il écrit dans Gringoire, le 23 janvier 1941 : « Il faut être antisémite ». Bien des comptes (beaucoup de mauvais : 8775 exécutions sommaires, selon une source plausible) se sont réglés lors de l’ « épuration ». BÉRAUD a payé une facture beaucoup trop salée pour lui. On s'est hâté de lui tailler un costar beaucoup trop large pour ses épaules. Victime de la mythologie gaulliste de « la France résistante ». Il faut se méfier des justiciers en général, et en particulier des justiciers de circonstance (ceux qui sont d'autant plus féroces qu'ils ont quelque chose à se reprocher). Les improvisés « résistants » du dernier moment. 
Alors, c'est certain, HENRI BÉRAUD n'a pas la dimension littéraire de CÉLINE. Il a dû gagner sa vie comme journaliste, et sa prose s'en ressent. Mais franchement, quoique moins spectaculaire, il n'en est pas moins un écrivain très estimable. C'est même mieux que « mérite un détour » : c'est « vaut le voyage ». Mais chut ! Cela ne doit pas être dit. Alors ne le répétez pas. Il n'est pas encore sorti du purgatoire.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, henri godard, roman, romancier, louis-ferdinand céline, biographie, gallimard, la pléiade, voyage au bout de la nuit, mort à crédit, pcf, parti communiste, claude lanzmann, arno klarsfeld, mohamed merah, roland thévenet, henri béraud, béraud de lyon, libération, allemands, occupation, nazis, staline, justicier, résistants
vendredi, 17 août 2012
A BAS LES HERETIQUES ! (4)
Pensée du jour : « Frappé d'une balle qui, pénétrant dans la poitrine, traversait le poumon et sortait par le dos, cet officier a survécu à cette mortelle blessure ». Général Trochu
On apprend qu’un certain VIGILANCE fut condamné parce qu’il condamnait le culte des saints, la vénération de leurs reliques et le célibat. Cet homme devait se tenir honorablement quand il était à table ou au lit. On apprend qu’il ne faut surtout pas confondre les « vaudois » et les « valésiens » : alors que les premiers, très banalement, exécutent à l’instant même où ils le prononcent leur vœu de pauvreté, les seconds n’admettent dans leurs rangs que des eunuques, sauf quelques hommes « entiers », à qui ils interdisaient l’usage de la viande jusqu’à ce qu’ils se fussent mutilés.
Je ne vais pas insister sur les appellations fleuries dont Notre Sainte Mère l’Eglise Apostolique et Romaine a affublé les innombrables croyants de la VRAIE FOI (ils se déclaraient tous catholiques) qui avaient le malheur, soit d’ajouter, soit de retrancher, soit encore de modifier si peu que ce fût le moindre cil, la virgule la plus modeste ou l’accent le moins grave au plus mince article de la dite foi.
Car ce sont, sachons-le, les théologiens officiels de l’Eglise qui ont baptisé chaque hérésie du nom qu'elle porte. Et leur imagination lexicale fut sans bornes, comme essaie de le montrer la présente série de notes, qui pourtant ne donnent de l’ensemble que la minuscule partie émergée de l’iceberg théologique et doctrinal. Ils ont fait montre, au cours de siècles, d'une véritable constance dans l'invention poétique.
Je me demande s’il n’y a pas un germe du petit père STALINE (JOSEPH VISSARIONOVITCH DJOUGACHVILI) dans le centralisme catholique. Ou alors du jacobinisme. A force de larguer à grands coups de conciles et de tatanes dans le derrière, hors de la communauté des croyants, les Coptes (ou Cophtes), les Syriaques, les Orthodoxes, et autres variantes locales de ce que les autorités appelaient la VRAIE FOI, le catholicisme romain ressemble à un arbre qui se serait élagué lui-même.
Jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un moignon de tronc, avec certes quelques racines, mais dépourvu de tout branchage et de tout feuillage. Jusqu’à devenir un arbre sec. Un arbre mort. Certes, cette vigilance dogmatique et doctrinale a donné à l’appareil clérical une puissance nonpareille à une certaine époque (entre autres, en faisant affluer les picaillons dans les coffres de la maison-mère). Mais elle a fini par assécher la source même de son esprit.
Reste qu’il est amusant de penser que des foultitudes de petites gens se sont ingéniées à faire chier la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (naguère présidée par Monsieur RATZINGER, alias BENOÎT XVI), à justifier la rémunération d’un innombrable et compact agrégat de fonctionnaires aussi pontificaux que sourcilleux, et à donner du boulot pendant des siècles aux dizaines de milliers de membres d’une corporation qu’on pourrait appeler des « contrôleurs de conformité » (autrement dit des flics de la pensée et de la conscience), ne serait-ce qu'en stimulant leur créativité poétique.
Car il y a indéniablement une force poétique dans les noms de baptême accordés par Rome à tout ce qui faisait mine de s'écarter de la ligne. Que pensez-vous de caucaubardite, nom qui fut donné à une branche des eutychiens ? Des manifestaires, ainsi nommés parce qu'ils croyaient criminel de dissimuler leur doctrine quand ils étaient interrogés ? Des tropites, pour qui le Verbe divin, du fait de son incarnation, cesse d'être une personne divine ? Des rebaptisants, qui renouvelaient le baptême de gens déjà baptisés, mais par des gens qu'ils considéraient comme hérétiques ?
N'y a-t-il pas une authentique imagination poétique pour nommer psatyriens les égarés qui pensaient que Jésus Christ n'était pas Dieu, mais une créature ? Parherméneutes, ceux qui interprétaient à leur guise les Ecritures en faisant foin « des explications de l'Eglise et des docteurs orthodoxes » ? Aquatiques, ceux qui « regardaient l'eau comme un principe coéternel à Dieu » ? Et les pneumatiques ? Et les condormants ? Et les familistes ? Et les jovinianistes ? Et les ethnophrones ? Tout ça déborde d'une inventivité poétique proprement héliconienne, ne trouvez-vous pas ?
Passons sur les naturalistes, qui expliquent les miracles par des causes naturelles ; sur les mutilés de Russie, qui pratiquaient l'automutilation, et dont les lubies menaçaient les marins de la flotte impériale ; sur les métangismonites, qui soutenaient que « le Verbe est dans son Père comme un vaisseau dans un autre ». On reste confondu devant des extravagances, je devrais dire des vésanies aussi manifestes.
Le tort des hérétiques, donc ? Leur imagination. Car il en fallait, pour imaginer que la Sainte Trinité est formée de trois substances égales (trithéistes) ou que les sacrements sont inutiles, au motif que « des effets incorporels ne peuvent être communiqués par une cause matérielle et sensible » (ascodroupites). Les inquisiteurs ne furent que le paroxysme fanatisé de cette POLICE CATHOLIQUE chargée de faire le ménage dans le troupeau.
La réflexion que m’inspire la notion d’hérésie définie par les autorités catholiques, c’est qu’elle suppose un sentiment très aiguisé de la hiérarchie, quasi-militaire, parmi les croyants. Grosso modo, l’Eglise ne peut faire aucune confiance dans les fidèles de base (le vulgum pecus) pour ce qui est de la vérité de la foi : dès qu’on leur laisse la bride sur le cou, les croyants partent dans tous les sens et, surtout, ils se permettent d’improviser des articles de foi qui n’ont pas reçu le visa des autorités romaines. Il ne faut pas rigoler : il y a la brebis de base, qui n'a qu'à suivre, puis les brebis en chef, puis les chef-brebis, etc. ... jusqu'au pape.
Car si on laissait faire, ce serait l’anarchie. Il est donc nécessaire, pour guider tout le troupeau mondial dans la même direction, de fixer d’en haut le contenu de la foi. C’est d’ailleurs la question du « libre examen » qui (entre autres) va creuser le fossé le plus profond entre catholiques et protestants, en accordant à tout croyant le droit de décider lui-même de sa relation à Dieu.
Quand chacun peut décider pour son propre compte du contenu et des modalités de sa foi, on assiste à l’atomisation de la grande Eglise en petites chapelles éparpillées et autonomes. Exactement ce qui s’est passé avec la prolifération des sectes protestantes. C'est un certain JOSEPH SMITH qui a fondé la secte des mormons. Un certain CHARLES TAZE RUSSELL la secte des témoins de Jéhovah (vous savez, ceux qui vont toujours par deux, mais qui n'entrent jamais, tout comme les testicules). Un certain LAFAYETTE RONALD HUBBARD la scientologie, la secte mercantile qui voudrait passer pour une Eglise, et qui tente de se faire admettre comme religion.
En fait, je vais vous dire, c'est la multiplication des Papes qu’a reçu pour mission de prévenir et d’empêcher la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Et la besogne n’a pas manqué. La multiplication des pains suffit aux catholiques.
Les aphthartodocètes furent-ils d’authentiques eutychiens ? L’hérésie colarbasienne eut-elle tort de considérer l’alphabet grec comme la perfection et la plénitude de la Vérité (à cause de : « Je suis l’α et l’ω » (l’alpha et l’oméga)) ? Les saccophores n’étaient-ils qu’une bande d’hypocrites ? En tout cas, personnellement, j’assure qu’aucun conflit de m’oppose aux corrupticoles, aux hétérousiens, aux gomaristes, et autres métangismonites, pas plus qu’aux hypsistariens, aux infralapsaires et autres mammillaires, chez qui le jeune homme qui voulait épouser une jeune fille n’avait pourtant qu’à lui « mettre la main sur le sein », une véritable incitation à peloter les jolies femmes dans la rue.
Voilà ce que je dis, moi.
Suitetfin demain.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hérésie, religion, société, foi, secte, catholicisme, protestantisme, église romaine, luther, calvin, vaudois, théologie, staline, coptes, syriaques, orthodoxes, ratzingeer, benoît xvi, congrégation pour la doctrine de la foi, sainte trinité, mormons, témoins de jéhovah, scientologie, lafayette ronald hubbard, évangile, ancien testament, poésie, littérature
vendredi, 06 juillet 2012
UN PARFUM DE TROISIEME REICH (1)
Bérurier, vous savez, c’est, pour le commissaire San Antonio, comme un alter-ego, mais ce que San Antonio est en propre, jeune premier et séduisant, Bérurier l’est en sale, et le plus souvent répugnant. N’empêche que FREDERIC DARD a élaboré un sacré personnage : gras du bide, la braguette ouverte, c’est lui qui s’arrache les poils du nez et laisse échapper une larme suite à l’opération.

LE "GRAVOS"
Dans Votez Bérurier (Fleuve Noir n° 56, 1964), comme il y a une élection municipale dans le village de Bellecombe, où le commissaire enquête, l’inspecteur, incognito, se porte candidat, et son discours de candidature débute sur ces fortes paroles : « Bellecombais, Bellecombaises… ». L’amateur que je suis raffole de ces petites facéties de l’écrivain, même si l’adjoint de San Antonio se permet de faire passer les messieurs avant les dames, sans quoi l'effet du jeu de mots serait raté. Mais Bérurier n’est pas un homme politique.
Car oui, l’homme politique, élevé dans la langue de bois maternelle et le « politiquement correct », inverse et déclare : « Les Françaises et les Français… ». Le maire de Paris : « Les Parisiennes et les Parisiens… », de Marseille : « Les Marseillaises et les Marseillais… ». Qu’y a-t-il là de politiquement correct, me dira-t-on ?
Eh bien, tout simplement qu'en bonne grammaire, le masculin est « générique », alors que le féminin est « marqué ». On dit aussi : le masculin l’emporte sur le féminin, mais c’est mal vu et C'EST EXACTEMENT ÇA, le politiquement correct : cette formule est une insulte à l’égalité de l’homme et de la femme. Inutile (ou utile au contraire) de dire que l’idée même d’insulte est proprement ridicule.
La pensée choisit peut-être les mots capables de l'exprimer, c'est bien possible, mais aujourd'hui, les mots médiatisés façonnent la pensée des masses. Sinon, je ne comprends pas comment NICOLAS SARKOZY a pu être élu en 2007, pas plus que FRANÇOIS HOLLANDE en 2012. On appelle ça la PROPAGANDE (lisez Propaganda, d'EDWARD BERNAYS, le neveu de SIGMUND FREUD, un des principaux inventeurs de la gestion des populations au vingtième siècle).

VICTOR KLEMPERER, L'HUMBLE ET NOBLE
SCRIBE DE LA LANGUE HITLERIENNE
VICTOR KLEMPERER a écrit un ouvrage mémorable sur la langue du III° Reich : LTI – Notes d’un philologue, paru en 1947 (édition Pocket, collection Agora, n° 202), où LTI signifie, en français, Langue du Troisième Reich (« Lingua Tertii Imperii »). George Orwell, en 1948 (dans le livre plus célèbre que lu 1984), imagina la « Novlangue », autrement dit la réécriture de l’histoire et de la réalité (voir les retouches de photos officielles sous STALINE).
Le point commun de toutes ces conquêtes impériales de la langue de tous, celle que nous parlons, c’est la généralisation de l’euphémisme : on ne dit plus « élève borné » ou « cancre », mais « apprenant à apprentissage différé », car il ne faut plus humilier personne, dans notre société d’égalité (handicapés, femmes, homosexuels, arabes, noirs, juifs et tutti quanti), ce qui est un progrès indéniable et décisif, n’est-ce pas.
Cela veut dire qu’on a le droit d’être con ou salaud (on est en démocratie), mais personne n’a le droit de le dire, sous peine de correctionnelle (on est sous l’œil des miradors et des gardes-chiourme, il paraît que c’est compatible avec la démocratie, si, si !). Il est désormais interdit de porter un jugement. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il soit encore permis d'exercer son jugement, comme nous l'ont enseigné les LUMIERES.
Mais il faut aussi compter avec la liste toujours plus longue des interdits : le vrai et juste combat des minorités américaines (les noirs, pour tout dire) pour la reconnaissance de leurs droits a abouti paradoxalement à installer une POLICE DE LA LANGUE (on ne dit plus un noir, mais un Africain-Américain, alors même qu'entre eux, les noirs s'interpellent "hey, nigga" ; on ne dit plus un nain, mot affreux, mais une « personne contrariée dans sa croissance verticale »), en attendant la POLICE DE LA PENSEE, qui s’est déjà imposée dans le paysage.
On ne doit plus, aux Etats-Unis, dire "un noir", mais un "africain-américain". Il n'y a plus de "bombardements", mais des "frappes", éventuellement "chirurgicales". Il n'y a plus de "victimes civiles", mais des "dommages collatéraux". On ne parle ni de "rigueur", ni d'"austérité", mais "du sérieux dans la gestion comptable des deniers publics". Je pourrais continuer longtemps.
Attention, mon frère, aux mots que tu prends pour parler des handicapés, des femmes, des homosexuels, des arabes, des noirs, des juifs (surtout des juifs, mais ils sont talonnés, pour ce qui est des moyens de pression) et des tutti quanti.
FRANÇOIS RABELAIS, en son temps, eut des problèmes avec les autorités et la justice, mais jamais pour une histoire de mots : ce sont les idées qui sont ou non porteuses de force, subversive ou non. De nos jours, la police a resserré son étreinte : il ne s’agit plus d’idées subversives – puisque plus RIEN n’est désormais subversif (c’est la société tout entière qui se subvertit elle-même en permanence), du fait même que TOUT est en soi subversif (se prétend tel, ou est célébré comme tel, évidemment). Du coup, le policier et le juge s'en prennent aux mots mêmes.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : san antonio, bérurier, littérature, politique, novlangue, frédéric dard, votez bérurier, fleuve noir, politiquement correct, political correctness, nicolas sarkozy, françois hollande, propagande, edward bernays, sigmund freud, victor klemperer, lti, staline, george orwell, handicapés, femmes, homosexuels, arabes, juifs, noirs, euphémisme, françois rabelais
mardi, 17 janvier 2012
CHERIE, QUI MANIPULE-T-ON, CE SOIR ?
Résumé et sommaire : la démocratie s’est inspirée des totalitarismes. En douceur, elle s’est imprégnée de totalitaire sur plusieurs points : eugénisme, abrutissement télévisuel, contrôle des populations par toutes sortes de moyens : caméras, puces électroniques, facebook, téléphones portables, G. P. S., etc.
Etre manipulé, c’est donc être gouverné sans le savoir. Etre gouverné sans savoir par qui. Sans savoir comment. Sans s’en rendre compte. On me dira que les Allemands sous Hitler et les Russes sous Staline savaient qu’ils étaient gouvernés. Ô combien. Et qu’ils auraient souhaité l’être moins, sans doute.
Mais remplacez la police politique et la délation par l’œil des caméras de surveillance et l’oreille des puces électroniques (pour ne rien dire des puces RFID), le résultat sera aussi vigoureux, mais aura été obtenu en douceur, s’il vous plaît. On a éliminé la violence des procédés, mais on arrive quand même au résultat souhaité. Avec l’adhésion des populations, s’il vous plaît.
Cette adhésion n’est pas le moins intéressant, car elle montre que la police n’est plus seulement une force extérieure visible de coercition, mais loge aussi à présent dans une case de toutes les têtes individuelles. Dans un tel système, la police a été intériorisée. Chacun porte en lui-même son flic. Comme le téléphone et l’ordinateur, la police est devenue portable. On la porte sur soi. On la porte en soi.
Et ça n’a pas grand-chose à voir avec ce que la psychanalyse appelle le « surmoi », tu sais, ce paquet d'interdit que l'éducation a pour mission de te transmettre dès ton âge le plus tendre, paquet qui sert à t'occuper les mains de l'esprit pour t'empêcher de faire n'importe quoi. La police intérieure n’érige pas seulement des proscriptions, mais aussi des prescriptions.
Ça veut dire qu'elle te dit ce que tu dois faire. Des choses que tu as l'impression d'avoir envie de les faire, mais que c'est rien que des obligations. Mais des obligations que tu t'es même pas rendu compte qu'elles sont entrées en toi, et que tu sais encore moins comment.
L’une des caractéristiques du régime totalitaire, selon Hannah Arendt, c’est le règne des polices secrètes, polices politiques etc. Il paraît qu'il y a en Syrie, aujourd'hui, pas moins de sept services faits pour ça, dont les attributions se chevauchent pour qu'ils puissent se faire concurrence et se surveiller plus commodément.
Regardez l’Angleterre en 2011, les émeutes, les pillages. Eh bien la police en est toujours à courir après les pillards, à les identifier, à les condamner sévèrement. Grâce aux caméras. Vous me direz que ce n’est pas bien de piller. Mais ce n’était pas bien vu non plus de dire du mal de Staline. Du moins de son vivant.
Nous sommes en démocratie, oui. Quelque chose me dit pourtant que si l’on voulait regarder d’assez près (et sans passion, s’il vous plaît) les points de ressemblance entre notre monde merveilleux et certaines caractéristiques de l’hitlérisme et du stalinisme, ceux-ci seraient moins honnis des manuels d’histoire, et notre monde merveilleux serait moins ovationné. Que se passerait-il si les gens commençaient à se dire : « l’esprit d’Hitler est en nous » ? Ça ferait une sacrée Pentecôte, vous ne croyez pas ? Et sans les langues de feu de l’Esprit Saint.
C’est la raison de l’ambiguïté foncière de Beauvois et Joule. Tenus par leur rigueur « scientifique » à ne pas sortir de leur champ, ils ne font qu’effleurer cette question. Pourtant, il y a peu de chances que Beauvois et Joule ignorent le nom et l’œuvre d'Edward Bernays, père fondateur de la manipulation des foules.
Qui connaît cet immense bienfaiteur de la « démocratie » américaine ?
« La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans les sociétés démocratiques. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays ».
Voilà ce qu’il dit, Edward Bernays. En 1928. C’est exactement le premier paragraphe de son livre Propaganda. Ce neveu devenu américain de Sigmund Freud a su mettre à profit la découverte principale de son tonton (l’inconscient), et s’en servir pour élaborer sa théorie pour « la manipulation consciente (…) des masses ».
Une réussite de Bernays est d'avoir, lors d'une campagne pour le compte de la marque de cigarettes Lucky Strike, amené la masse des Américaines à fumer, y compris sur et à commencer par la voie publique. Parce que zut, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les hommes qui ... Je propose en passant de restituer, chaque fois qu'il est utilisé, à la place du terme tout innocent de publicité, le mot propagande, plus franc et plus près de la réalité manipulatoire. Dites-vous ça chaque fois que le mot publicité apparaît sur l'écran de la télé.
La question à laquelle s’est efforcé de répondre Bernays se situe en amont de celle que je me posais hier ici même : si 60.000.000 de Français (environ, ne chipotons pas) étaient vraiment libres, quel miracle faudrait-il imaginer pour qu’ils désirent et décident, au même moment, de faire la même chose que tout le monde (supermarché, plage, télévision, …), comme ça se passe dans la réalité ?
On imagine bien le tableau : si, au même moment, 60.000.000 de désirs et de décisions différents surgissent, émanant d’individus parfaitement autonomes et libres, ça ne va pas tarder à être le chaos. Pour Bernays, c'est clair : la liberté est une facteur de risque, car elle amène le chaos. Ça va partir dans tous les sens, comme dans un mouvement brownien. Ça va devenir rapidement « ingérable », comme on dit. A côté de ce cataclysme, l’anarchie ressemblerait à de la natation à peu près synchronisée. Il a donc fallu l’inventer, le miracle.
Parce que, précisément, ce n’est pas un miracle. Ou, dit autrement, c’est un miracle minutieusement conçu et fabriqué. Par Edward Bernays. Le sous-titre de son Propaganda, est « Comment manipuler l’opinion en démocratie » (éditions Zones-La Découvertes, 2007, 12 euros). L’auteur a le mérite de la franchise, et n’y va pas par quatre chemins. Ce n’est pas un aveu naïf. C’est la proclamation claire et nette d’une doctrine explicite. Edward Bernays entend être utile à son pays, et pour cela à faire triompher son idée du Bien.
« Théoriquement, chaque citoyen peut voter pour qui il veut. (…)Les électeurs américains se sont cependant vite aperçus que, faute d’organisation et de direction, la dispersion de leurs voix entre, pourquoi pas, des milliers de candidats ne pouvait que produire la confusion. Le gouvernement invisible a surgi presque du jour au lendemain, sous forme de partis politiques rudimentaires. » Cela s’appelle limiter les risques de centrifugation.
Dire que la lecture de ce petit livre (100 pages + la préface) est instructive ne dirait pas grand-chose. Le projet de l’auteur ne souffre pas l’ambiguïté : il s’agit de prescrire « un code de conduite sociale standardisé », d’user de « techniques servant à enrégimenter l’opinion ».
Pour que ça fonctionne, « la société accepte de laisser à la classe dirigeante et à la propagande le soin d’organiser la libre concurrence ». C’est-y pas merveilleux ? Chaque terme compte : « …organiser la libre concurrence … ». Il s’agit de mettre un peu d’ordre dans la loi de la jungle. En contournant au passage ceux qui sont élus pour écrire les lois.
Voilà ce que je dis, moi.
A finir, si vous le voulez bien.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hitler, staline, liberté, manipulation, opinion publique, psychanalyse, surmoi, hannah arendt, beauvois et joule, petit traité de manipulation, edward bernays, sigmund freud, propagande, publicité, puce électronique, caméra de surveillance, contrôler l'opinion, propaganda bernays, démocratie

