mercredi, 16 mars 2022
LA SERVITUDE ÉLECTRIQUE
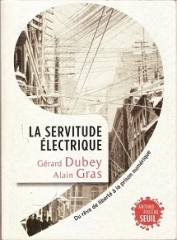
Impressions de lecture.
Je viens de refermer (7 mars) La Servitude électrique, de Gérard Dubey et Alain Gras (Seuil, 2021). Le premier est sociologue, le second est socio-anthropologue — je passe sur les détails additionnels. Ceux qui suivent un peu ce blog doivent se demander ce qui m'a pris, sachant la couleur souvent désobligeante des propos que je tiens sur les "sciences" humaines en général, et en particulier sur les "spécialistes" et autres "experts" patentés qui pondent à tour de bras ouvrages savants ou articles de revues "scientifiques", interventions décisives dans les pages "débats" ou "idées" du journal Le Monde, qui en est friand, voire gourmand.
Certains sont même invités plus souvent qu'à leur tour à venir postillonner doctement les microbes de leurs "sciences" dans les micros de la radio ou de la télévision, dans le but éminemment vertueux (défense de rire) de nous aider à comprendre ce qui se passe de par le vaste monde et jusqu'aux tréfonds intimes de nos chaumières. Autant le déclarer d'entrée de jeu, ce n'est pas le livre de Dubey et Gras qui me fera changer d'avis.
C'est le titre du livre (La Servitude électrique) qui a déclenché mon geste d'achat, en ce qu'il laisse entrevoir tous les malheurs qui s'abattent sur les pauvres humains quand ils sont privés d'électricité. Il me suffit de penser aux Ukrainiens de Marioupol ou d'Irpin qui, sous les bombardements de leurs cousins russes, sont coupés de toute ressource en eau, gaz et électricité depuis x semaines. On peut aussi avoir une pensée pour les habitants de Sarajevo, qui furent privés de presque tout lorsque Slobodan Milosevic a lâché ses chiens de guerre sur la Croatie et la Bosnie pour réaliser son rêve de "Grande Serbie".
La question est : « Que deviendrions-nous, si toute ressource électrique nous était un jour coupée ? » (il faudra peut-être mettre le verbe au futur). La réponse à cette question est évidente : « Nous retournerions deux siècles en arrière, mais démunis de tous les savoir-faire, gestes, habitudes qui semblaient naturels à nos ancêtres ! Et surtout les savoir-faire qui constituaient l'essentiel des apprentissages concrets (= ni scolaires, ni intellectuels, ni culturels, etc.) qui permettaient à chacun de se débrouiller dans son environnement et dans sa réalité ». Vu d'ici, ça voudrait dire retour à la préhistoire, chaos, catastrophe, désastre, etc. Et sans doute barbarie.
Car l'usage constant d'appareils mus par des moteurs et/ou par l'électricité nous a désappris les savoirs fondamentaux qui ont fabriqué toutes les cultures humaines depuis des dizaines de siècles. C'est la raison pour laquelle j'avais trouvé le titre de Dubey et Gras particulièrement bien venu, tant il est vrai que l'électricité figure au premier plan parmi les piliers de ce qu'on appelle le "Développement" ou la "Modernité".
C'est ce qu'avait bien vu le camarade Lénine qui, dans son discours au huitième Congrès des Soviets en 1919, a lancé le slogan : « Le socialisme, c'est les Soviets plus l'électricité », qui n'est pas pour rien dans le dévoiement de l'idéal communiste en capitalisme d'Etat, avec l'aristocratie d'une Nomenklatura de privilégiés qui n'ont eu aucun mal à se reconvertir en "oligarques" quand on a vu se démembrer l'empire soviétique.
Chez nous, aujourd'hui, c'est un constat d'une telle banalité que je ne m'y attarde pas : la force de l'électricité est partout présente, dans la vie quotidienne de tout le monde, mais aussi à la base de toute la machine économique comme aux origines de nos moyens actuels de communication. Imagine-t-on même un meeting politique sans micros ni haut-parleurs ?
Bon, pas besoin d'un long prêche : tout le monde est convaincu du désastre absolu qui s'abattrait sur la civilisation entière si la source électrique venait à se tarir, une civilisation dont la puissance n'a pas d'égale historique, une civilisation fertile en inventions de toutes sortes, une civilisation qui s'est rendue capable de rendre la vie humaine plus facile, plus agréable, plus longue, plus confortable, plus ..., plus ....
Mais une civilisation qui a déposé toute son existence physique, voire toute son âme, entre les mains de cette "fée". Mais une civilisation d'une fragilité extrême, toujours à la merci d'une panne, d'un accident, d'une tempête, que sais-je encore. Mais une civilisation qui s'est en quelque sorte elle-même réduite en esclavage, puisqu'en tout et pour tout elle s'est mise dans la dépendance la plus étroite d'une puissance qui lui échappe en partie, puisque l'on n'a pas encore trouvé le moyen de bâtir des greniers où l'on stockerait l'électricité de la même manière que le foin, le blé, etc.
J'ai donc acheté La Servitude électrique, me fiant à la clarté séduisante du titre, et m'attendant à découvrir des développements d'idées profondes sur le sujet. J'ai déchanté. Pour faire simple, je dirai, pour donner au lecteur éventuel une idée de l'impression générale que m'a laissée le bouquin : « Pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué ? ». Je ne doute pas de la compétence des deux auteurs dans leur spécialité et dans leur démarche, et peut-être ont-ils voulu donner à leur travail le cachet de sérieux universitaire qui fait estimer des égaux et collègues.
En lisant des ouvrages de spécialistes de telle ou telle "science humaine", j’ai trop souvent l’impression que les auteurs se paient de mots. Je veux dire que trop souvent le discours des sciences humaines ressemble au nom de famille de l’O.S.S.117 de Jean Bruce (qui reste l'inventeur du personnage) : « Bonisseur de la Bath », autrement dit, en bon argot de l'époque, « doué pour le bagou infatigable du camelot bavard ». Et je dois l’avouer : je ne supporte plus.
Mais pourquoi diable leur manière d'aborder et de traiter le sujet m'a-t-elle souvent horripilé ? J'avoue que je ne suis pas encore parvenu à répondre à cette question de façon satisfaisante. Il faudra que je relise leur bouquin quand j'aurai assez de courage. D'accord, je ne suis pas spécialiste de la question, mais il ne me semble pas que les éditions du Seuil, en créant leur collection "Anthropocène", aient eu l'intention de s'adresser aux seuls savants.
Et si je ne nie pas que le sujet du livre réclame l'exposé de considérations techniques, je n'en démords pas : rien n'oblige l'économiste, le philosophe, le psychanalyste, le sociologue, bref, le science-humaniste, qu'il soit de base ou d'élite, à user d'un langage amphigourique, voire inintelligible, pour diffuser le fruit de ses réflexions. Il est vrai que les auteurs ne jargonnent pas constamment. Comment dire ? Peut-être compliquent-ils les choses dans leur façon de disposer les idées et de recourir à des concepts, car à plusieurs reprises, je me suis demandé pourquoi ils se mettaient à parler de ceci, de cela.
Et pourtant, ça ne commence pas trop mal : « Nous vivons de l'électricité comme de l'air qu'on respire, sans nous poser de questions, ni mesurer les conditions et le prix de ce confort. D'où l'incompréhension, puis l'impatience lorsque la panne interrompt brusquement le cours normal des choses mais aussi l'angoisse qui saisit les penseurs du capitalisme, autant que les simples citoyens, d'un risque dont on ne connaît pas la taille » (p.8). Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas, bien que je me demande ce que viennent faire ici les "penseurs du capitalisme" : s'agissant de panne, j'attendrais plutôt les "entrepreneurs" (les penseurs ne sont jamais en panne, qu'on se le dise). Mais passons.
Passons aussi sur "le célèbre William Jevons" dont la "célébrité", en dehors d'un cercle d'initiés, m'a bien fait rire (comment ? vous ne connaissez pas William Jevons ?). Je suis d'accord avec « le qualificatif de thermo-industrielle » (p.12) pour désigner notre civilisation, avec le « macro-système technique » (p.12 ; quoique, franchement, M.S.T. !......), avec le fait que « La course aux énergies renouvelables confie à l'électricité le soin de sauver le monde » (p.15) et avec le caractère illusoire et fragile du sentiment de confort et de sécurité que procure la possibilité d'appuyer sur des boutons pour obliger mille esclaves mécaniques à exécuter des tâches qui nous répugnent, ou pire : dont nous avons perdu le savoir-faire antique.
D'accord encore pour admettre que cette puissance n'est pas sans contreparties et conséquences désagréables. Je les appellerais "externalités négatives", si messieurs les économistes m'y autorisent : avec cette précision que l'énergie qui allume nos lampes et anime nos lave-linge est produite très loin de son lieu d'utilisation. Elle est donc invisible aux yeux de l'usager. Et même quand on regarde les tours de refroidissement de la centrale du Bugey depuis l'esplanade du Gros-Caillou, on ne fait pas le lien avec le four électrique où mijotent le gratin dauphinois et le rosbif qui nous attendent pour le repas de midi. Pareil pour la centrale au charbon ou au pétrole.
Allez, d'accord aussi sur la pile de Volta (inventée autour des années 1800). C'est tout à fait étonnant, mais, depuis Volta, aucune invention décisive n'est venue modifier les données de base du problème que pose le stockage de l'électricité. Certes on a amélioré la conception, on a trouvé des composants de plus en plus performants, mais comme je l'ai dit plus haut, on n'a pas trouvé le grenier capable de tenir à notre libre disposition le flux électrique. Comme le disent les auteurs de La Servitude électrique : « Ce sont seulement des aménagements sur les substances en jeu, métaux et électrolytes, qui marquent le développement de l'objet technique. La philosophie des sciences constaterait tout simplement une invariance du paradigme [c’est moi qui souligne] » (p.100). "Invariance du paradigme", bon dieu, mais c'est bien sûr ! J'ai trouvé où le fleuve Jargon prend sa source !
Soyons juste : certains passages du livre apportent de véritables informations cruciales, tout au moins aux yeux du lecteur moyennement informé que je suis. On trouve ça page 164, où l'on parle d'éoliennes de 200 m. de haut (en mer). C'est d'abord une citation : « Les terres rares interviennent dans la composition des générateurs dits "synchrones" dans lesquels le rotor est un aimant permanent. Ainsi, pour une puissance de 1 MW fournie par le générateur, il faut environ 600 kg d'aimants contenant près de 200 kg de terres rares. Une éolienne offshore pouvant atteindre 10 MW de puissance nécessite donc à elle seule plus d'une tonne de terres rares » (p.164). C'est dans un rapport officiel. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ça jette un sacré froid sur les éoliennes, non ?
D'autant que les auteurs ajoutent : « L'adjectif "rare" indique leur infime présence au milieu d'autres minerais, par exemple "seulement" 16 tonnes de roche pour un kilo de césium, mais 1200 tonnes pour un kilo de lutécium, tout cela pour nos écrans LCD, lampes LED, batteries, etc., et intermédiaires électroniques en général » (p.164-165). Ben voilà, c'est pas difficile, elle est là, messieurs Dubey et Gras, la substance qu'il me faut : ça au moins c'est du solide, qui m'autorise à penser qu'on n'est pas près de voir la fin de l'extractivisme. Avis aux amateurs d'Iphones, de smartphones et autre 5G. Qu’attendent les jeunes qui s’empressent aux manifs "climat" pour piétiner sauvagement leurs propres Iphones ?
Dommage que, quelques pages plus loin, on trouve cette salade : « L'éolien et le solaire, en effet, mettent en pleine lumière le dilemme du choix à faire librement entre beauté et utilité. La première est certes construite mais habitée philosophiquement par la controverse, elle n'est pas mesurable, alors que la seconde est socialement définie à un moment donné par la parole dominante » (p.180). Faut-y vous l'envelopper, Madame Michu ? Vous comprenez mieux ma réticence ?
J'ai ensuite un peu de mal à suivre les considérations et les chaînes de raisonnement qui accompagnent l' « encapsulage » dû au numérique, si ce n'est l'idée que le dit numérique achève de nous couper de la réalité réelle des choses et des gens, ainsi que quelques émergences : « Le pouvoir introuvable de la cybernétique est surtout le symptôme d'un pouvoir qui se rend invisible à mesure qu'il se privatise et se sépare de la société » (p.247). Ce que je comprends ici, c'est que les pouvoirs, que ce soient les autorités publiques ou des instances privées, s'ils ne comprennent pas mieux que vous et moi l'énormité du pouvoir de la cybernétique, du moins en ont-ils l'usage, et en font-ils usage.
Tiens, encore une info que j'ignorais: « La dalle de verre des smartphones est recouverte d'une substance qui accumule les charges électriques (à base d'indium, un métal rare). Le contact du doigt sur la dalle suffit à provoquer un transfert de charge, le doigt absorbant "le courant de fuite". Le déficit de charge est quantifié avec précision par les capteurs situés aux quatre coins de la plaque » (p.280). Suit malheureusement une salade sur « l'appétence du corps à faire signe vers autrui, à être en relation », puis sur « cette ouverture primordiale du corps, jusqu'à en faire l'un des plus puissants instruments de contrôle jamais imaginés » (p.281). La peste soit des psycho-sociologues et de leur bla-bla !
Bon, on s'achemine vers la fin de l'ouvrage de Gérard Dubey et Alain Gras, oscillant entre les truismes (« Cette délocalisation du travail fait directement obstacle à la formation de collectifs. » (p.298), sans doute pour parler de la dislocation des "corps intermédiaires", partis ou syndicats) et quelques épiphanies goûteuses à souhait, du genre de : « Au temps intermittent d'une électricité "terrestre" répond ainsi une "histoire désorientée", qui réinvestit la multiplicité des temps sociaux » (p.319), où il nous est proposé, par exemple, de « désencapsuler le temps » [pourquoi pas juste "décapsuler" ?] (p.320), et où l'on nous annonce l'ère d'une « ontophanie numérique » (p.324). Je l'ai dit au début de ce billet : pourquoi faire simple quand il est plus rigolo de faire compliqué ?
Alors qu'est-ce que je retiens de la lecture de ce curieux bouquin ? C'est que, au-delà de l'obstacle langagier et conceptuel et si j'ai bien compris ce que j'ai cru comprendre, les auteurs se rangent du côté d'un écologisme critique, mais finalement optimiste. Ils se présentent en effet, pour conclure « en sismologues plutôt qu'en collapsologues » (p.335).
Je regrette seulement que, pour un sujet passionnant porté par ce titre génial (La Servitude électrique), on ne fasse pas un effort de lisibilité pour se rendre accessible au plus grand nombre, et pour cela qu'on fasse emprunter au lecteur bien des déviations, dont pour ma part je me serais volontiers passé du détour. Je regrette aussi qu’un sujet aussi brûlant ne soit pas défendu de façon plus percutante.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : Je garantis l'authenticité de la subjectivité de tout ce qui est écrit ci-dessus, exception faite des citations, parfaitement objectives quant à elles, quoique sélectionnées par mes soins.
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, la servitude électrique, gérard dubey, alain gras, sociologie, anthropologie, collapsologie, centrale nucléaire bugey, lénine, les soviets plus l'électricité, socialisme, journal le monde, ukraine, marioupol, irpin
mercredi, 27 mai 2015
« POSSÉDÉS » ou « DÉMONS » ?
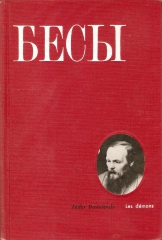 Ci-contre, l'édition "club" : lire "bessy" (ou "biessy ?"), qui veut dire "Les Démons".
Ci-contre, l'édition "club" : lire "bessy" (ou "biessy ?"), qui veut dire "Les Démons".
2/2
La deuxième moitié du livre nous fait prendre pied sur le terrain politique. Verkhovensky fils (Piotr Stépanovitch) est le chef d’une section clandestine de révolutionnaires. Il fait croire à ces exaltés tant soit peu nihilistes que celle-ci n’est qu’une cellule dans un vaste réseau dirigé depuis l’étranger par une sorte de Comité Central.
La réunion (intitulée « Chez les nôtres ») a quelque chose de proprement stupéfiant de prescience du régime qu’instaureront beaucoup plus tard Lénine, puis Staline. Sorties du cerveau de Chigaliov (le théoricien qui forme avec l'activiste Verkhovensky la transposition dans le roman du nihiliste frapadingue et historique Netchaïev) et expliquées par « le professeur boiteux », on lit des choses comme : « Partant de la liberté illimitée, j’aboutis au despotisme illimité ».
Plus fort encore : « Pour résoudre définitivement la question sociale, il propose de partager l’humanité en deux parts inégales. Un dixième obtiendra la liberté absolue et une autorité illimitée sur les neuf autres dixièmes qui devront perdre leur personnalité et devenir en quelque sorte un troupeau ; maintenus dans une soumission sans bornes, ils atteindront, en passant par une série de transformations, à l’état d’innocence primitive, quelque chose comme l’Eden primitif, tout en étant astreints au travail ».
Et Verkhovensky explique plus tard à Stavroguine : « Son projet est remarquable (…). [Chigaliov] établit l’espionnage. Chez lui, tous les membres de la société s’épient mutuellement et sont tenus de rapporter tout ce qu’ils apprennent. Chacun appartient à tous, et tous appartiennent à chacun. Tous les hommes sont esclaves et égaux dans l’esclavage ». Ah bon ? Ça vous rappelle quelque chose ?
Et puis encore : « La soif d’instruction est déjà une soif aristocratique. A peine laisse-t-on s’installer la famille ou l’amour, que naît aussitôt le désir de propriété. Nous tuerons ce désir : nous développerons l’ivrognerie, la calomnie, la délation ; nous plongerons les hommes dans une débauche inouïe, nous détruirons dans l’œuf tout génie ».
Allez, une dernière pour la route : « Seul le nécessaire est nécessaire, telle doit être dorénavant la devise de l’humanité. Mais il faudra aussi lui accorder de temps en temps quelques convulsions ; et nous, les chefs, nous y pourvoirons. Les esclaves doivent avoir des maîtres. Obéissance complète, dépersonnalisation absolue ; mais tous les trente ans, Chigaliov autorise les convulsions ; et alors tous se jetteront les une sur les autres et s’entre-dévoreront ; mais jusqu’à une certaine limite seulement, uniquement pour vaincre l’ennui. L’ennui est un sentiment aristocratique. La société de Chigaliov ne connaîtra plus les désirs ». Précisons que Stavroguine, qui écoute ce galimatias, se demande si l'autre n'est pas carrément cintré ou complètement ivre.
Que Chigaliov (à moins que ce ne soit Verkhovensky) et son programme transposent (en caricaturant ?) le hélas trop authentique et historique Netchaïev et son Catéchisme du révolutionnaire ne fait guère de doute. Intéressant de savoir aussi que Lénine s’inspira de celui-ci pour concevoir dès 1902, puis organiser le parti bolchévik qui allait prendre le pouvoir quinze ans plus tard, avec les suites bien connues, mises en musique par Staline et consort.
Pour confirmation, on se reportera à la remarquable bande dessinée La Mort de Staline, de Fabien Nury et Thierry Robin, pour se faire une idée de l’ambiance terrifiante qui régnait au sommet de l’Etat soviétique, y compris et surtout parmi les plus proches du pouvoir suprême, qui savaient comment ils étaient arrivés là, et qui avaient donc toutes les raisons de redouter le pire à tout instant de la part de leurs meilleurs « amis ».

Molotov, Krouchtchev : ils se les caillent sur le balcon, parce que Béria a fait poser des micros partout à l'intérieur. Ça ne les empêche pas de préparer l'avenir d'un certain nombre de leurs « amis » : « De très longues listes, où l'on n'oubliera personne ». Il n'y a pas que dehors qu'il fait très froid. Brrr ...
Le projet de ce petit noyau de révolutionnaires, à qui l’on a fait croire que la même chose se passerait partout dans les campagnes russes, est de gâcher la « fête » voulue par Julie Mikhaïlovna, épouse du gouverneur Von Lembke, une sorte de fantoche et de mari falot, et de semer le trouble dans la ville par tous les moyens, dans l’espoir de provoquer l’insurrection qui balaierait l’ordre établi.
On ne résume pas Les Possédés. Il faudrait encore citer le personnage de Lébiadkine, vaguement officier en retraite et diplômé d’ivrognerie, qui bat sa sœur, laide, boiteuse et plus qu’à moitié folle. On apprendra que celle-ci (Maria Timopheïevna) a été épousée autrefois, par bravade et par Nicolaï Vsévolodovitch (c'est un zeugma), fils de Varvara Petrovna Stavroguine.
Ce personnage, qui occupe dans le roman une place centrale, on découvre dans un chapitre censuré (« La Confession de Stavroguine », ou « Chez Tikhone »), qu’il a longtemps été complètement barré, désespéré, capable de prendre au pied de la lettre, dans une réunion mondaine, le nommé Gaganov affirmant : « On ne me mène pas par le bout du nez », le saisissant aussitôt par l’appendice nasal et lui faisant traverser le salon.
La vie ne lui est de rien, semble-t-il, aussi incapable de s’aimer que d’aimer Lisaveta Nicolaïevna. On comprend, dans sa « confession », qu’il a sans doute violé une fillette, qu’il n’empêche pas ensuite de se pendre après qu'elle lui a déclaré : « J’ai tué Dieu ». Et pourtant, le comploteur Piotr Stépanovitch l’admire tel un demi-dieu, qu’il rêve de voir sur le trône de Russie en tant que « tsarévitch Ivan ». Allez comprendre. Je garde après lecture le sentiment que Stavroguine est un personnage romanesque incohérent (un peu à l'image du livre pris dans son entier).
Lébiadkine et sa sœur seront assassinés, soi-disant par l’ancien forçat évadé Fédka qui croyait trouver une forte somme. Les assassins présumés ont tenté de dissimuler leur forfait en mettant le feu à la maison au cours de l’incendie qui a détruit tout un quartier de la ville, mais la maison, isolée au milieu d’un terrain vague, a refusé de brûler. Fédka sera lui-même retrouvé mort, sur un chemin.
Il semblerait aussi que Dostoïevski a voulu régler quelques comptes avec l'écrivain Tourgueniev, qui s'est paraît-il offusqué du portrait dressé par l'auteur de l'écrivain Karmazinov, qui le présente sous un jour très peu sympathique. Entre « amis », n'est-ce pas.
Alors maintenant, quel est le vrai titre du livre ? J’avais depuis longtemps dans mes rayons Les Démons, dans une édition « club ». Et puis j’ai découvert que ce livre et le « poche » que je viens d’acheter (traduction de Boris de Schloezer) à 1,60 € ne font qu’un. Enfer et damnation. Il paraît qu’il faut dire « Les Démons ». Même si la perspective en est modifiée, ça ne change rien à la folie des personnages.
Ce qui domine de très haut, une fois qu’on l’a refermé, c’est à coup sûr la dénonciation violente de cette folie destructrice contenue dans l’utopie véhiculée par le petit groupe de conspirateurs dirigé par Verkhovensky, et mû par les théories de Chigaliov. Toute la seconde moitié des Possédés est un pamphlet dirigé contre la folie criminelle de Netchaïev et de tous ses semblables. Faut-il les appeler « communistes », « socialistes », « nihilistes » ? Ou plus simplement : « association de malfaiteurs » ?
Je pencherais volontiers vers la dernière hypothèse (il est vrai que l'enrichissement personnel n'est le but d'aucun "révolutionnaire"). En me disant que Dostoïevski nous parle d'un temps, après tout, pas aussi lointain qu'on pourrait le penser.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, dostoïevski, les possédés, les démons, bolchéviks, nihilisme, révolutionnaires, lénine, staline, netchaïev, chigaliov, communisme, socialisme, catéchisme du révolutionnaire, la mort de staline, bande dessinée, nury robin, état soviétique, confession de stavroguine, boris de schloezer, association de malfaiteurs
lundi, 17 mars 2014
POLITIQUES EN DECOMPOSITION
Préambule : Non, la France n'est pas en déclin. La preuve ? Elle revient des Jeux Paralympiques de Sotchi avec un nombre respectable de médailles. Conclusion, la France possède les handicapés et les infirmes parmi les plus forts du monde. Moralité : qui critiquera les performances dont est capable notre « cher et vieux pays » ? Qu'on se le dise : le handicapé porte l'avenir radieux de la France. Vive la France infirme ! Françaises, Français, en avant !
****
LA CLASSE POLITIQUE FRANÇAISE EN ETAT DE DECOMPOSITION AVANCEE
Il y a longtemps qu’il n’y a plus de vie proprement politique en France. On le savait déjà, et je n’apprends rien à personne. Monsieur BHL, alias le trois fois entarté, alias monsieur Bernard-Henri, alias monsieur chemises amidonnées, alias monsieur Arielle Dombasle, avait commis, voilà des temps, un petit ouvrage intitulé Ce Grand cadavre à la renverse. Consacré à l’agonie du socialisme au sein même du Parti « Socialiste » (je pouffe).
Il avait raison, le philosophe garanti 100 % beurre de TF1. Mais il aurait pu – donc dû – étendre son analyse à l’ensemble du champ politique national. Car j’espère que tout le monde conviendra que l’état de liquéfaction des idées et des hommes politiques de notre pays a atteint aujourd’hui un degré que je me demande s’il peut encore aller « plus vite, plus haut, plus fort » (« citius, altius, fortius », vous savez, la formule de la formidable imposture olympique).
Je me fous des querelles de personnes (Valls-Taubira, Copé-Fillon, on n’a aucun mal à en dénicher). Je me fous des statuts de l’UMP lancés à grand bruit pour annoncer que tout le monde se rassemble en bon ordre derrière le parti, le chef, le drapeau. Cette sinistre comédie ne trompe plus personne depuis longtemps.
Je me fous de TOUT ce que dit un homme ou une femme politique (j’ai failli écrire « poilitique ») quand il est invité sur un plateau, au motif que, quelle que soit la question, il récitera sa « doxa », bien cornaqué qu’il aura été en amont par ses conseillers en communication (Stéphane Fouks, le copain d’Alain Bauer et de Manuel Valls, et consort). Je me fous de leurs ambitions, de leur appétit de pouvoir, de leur obsession de la conquête des « places » (Michelet, en 1848, en parlait déjà de façon éclairante, fût-ce pour lui-même au Collège de France).
Mais j’hallucine carrément quand je constate leur aveuglement sur l’état de la barque que tous veulent conduire. Je radote sûrement, mais leur manière à tous de pousser Marine Le Pen aux avant-postes au moyen d’imprécations fabriquées contre l’ennemi (PS si on est UMP et inversement, comme si ces deux compères n’étaient pas de vulgaires complices qui se disputent simplement la taille des parts du gâteau, dispute camouflée sous les « éléments de langage » tout faits, prêts à l’emploi et stéréotypés, concoctés dans des officines de « com. »), de vaticinations élucubrées sur la base de ce qu’ils croient savoir des « attentes des Françaises et des Français », me semble le plus sûr moyen de rebuter ce qu’il reste de bon sens à la majorité de la population. Cela fait longtemps qu'il n'y a plus de lutte politique entre le PS et l'UMP.
Les luttes pour le pouvoir qui font rage à « droite » et à « gauche », qu’on considère volontiers comme des querelles de personnes, ne veulent donc dire qu’une chose : plus personne, sauf quelques rares exceptions (Juppé ? Je dis ça, mais ...), ne prétend gouverner parce qu’il a le « sens de l’Etat », mais parce qu’il a de l’appétit pour une « place », qui lui donnera autorité institutionnelle, rayonnement de prestige et rentabilité matérielle (Chirac n’a jamais payé de loyer, il a occupé les palais de la République - Mairie de Paris (1977-1995), Elysée (1995-2005) - comme un rat fait dans un fromage).
Accessoirement, il n’y a pas à tortiller du derrière pour espérer échapper à ça : ça signifie qu’il n’y a plus de nation française. J’admire quant à moi quelques individus qui sont (ou plutôt : « ont été », hélas) capables de regarder au-dessus d’eux-mêmes. Aujourd’hui où chacun est de plus en plus réduit à lui-même, j’attends qu’on me dise qui est désireux de s’élever au-dessus de sa petite personne.
Que montrent les politiques au pouvoir ou qui attendent d’y parvenir ? Des qualités de tacticiens tout au plus. Or c’est bien connu dans le domaine des échecs : le pur tacticien se fait piler à plate couture. Ce dont est capable le grand joueur, c’est une vision stratégique. Ce que requiert la tactique, c’est juste de l’habileté manœuvrière, peut-être de l’imagination, disons une certaine forme d’intelligence, je veux bien. Ce qui manquera toujours à la tactique pure, c’est la vision stratégique. Et pour ça, il faut s’être élevé au-dessus de sa petite personne. Là est le problème.
Ce n’est pas un hasard si cette sous-littérature qu’on ennoblit pompeusement en l’appelant « autofiction » est devenue en France le nec plus ultra de ce qui s’appela autrefois « littérature ».
Pourtant c’est facile de ne pas confondre. Dites-moi que ce n’est pas une preuve de déclin ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sotchi, jeux paralympiques, politique, société, france, bhl, bernard-henri lévy, arielle dombasle, parti socialiste, ps, ce grand cadavre à la renverse, socialisme, manuel valls, christiane taubira, jean-françois copé, françois fillon, nicolas sarkozy, ump, stéphane fouks, alain bauer, marine le pen, éléments de langage, alain juppé
lundi, 24 juin 2013
PARLONS DE PHILIPPE MURAY

PAYSANNE, PEUT-ÊTRE L'EPOUSE DU PAYSAN D'HIER (FAUTEUIL), PAR AUGUST SANDER
***
Parlons-en donc, de l’occulte et de l’occultisme. Philippe Muray, dans son livre Le 19ème siècle à travers les âges, en fait une ritournelle, qui tourne, à mon avis, à l’incantatoire et à l’obsessionnel. Il évoque évidemment les piliers de la « pensée occultiste » du 19ème : Mme Blavatski (Isis dévoilée, La Doctrine secrète), Pierre Leroux (inspirateur du Spiridion de George Sand, seul roman exalté par Renan, qui détestait les romans), Allan Kardec (Le Livre des Esprits, Le Livre des Médiums), Eliphas Levi (Philosophie occulte), Fulcanelli (Les Demeures philosophales, Le Mystère des cathédrales), etc.
tourne, à mon avis, à l’incantatoire et à l’obsessionnel. Il évoque évidemment les piliers de la « pensée occultiste » du 19ème : Mme Blavatski (Isis dévoilée, La Doctrine secrète), Pierre Leroux (inspirateur du Spiridion de George Sand, seul roman exalté par Renan, qui détestait les romans), Allan Kardec (Le Livre des Esprits, Le Livre des Médiums), Eliphas Levi (Philosophie occulte), Fulcanelli (Les Demeures philosophales, Le Mystère des cathédrales), etc.
D’autre part, il ne cesse de parler de tous les courants « socialistes » (Saint-Simon, Fourier, Proudhon, ...) qui fermentent ou bouillonnent au fond de la marmite de ce qu’il appelle le « progressisme ». Il fait de Hugo, de Michelet, de Renan (et quelques autres) les « Maîtres Autels » ou les Grands Prêtres de la « religion » qui est appelée à supplanter le règne tyrannique du christianisme.
Cette religion emprunte à divers horizons du monde d’alors, spécialement aux croyances asiatiques en général et indiennes en particulier. Là où je crois que Philippe Muray a raison, c’est quand il parle de « syncrétisme » : toutes les religions sont invitées à se fondre en une seule, dans le creuset d’une nouvelle religiosité (plutôt que d’une religion), assez vague et vaseuse pour réunir un consensus unanime de l'humanité tout entière (croit-on).
Le fondement de tout ça est la conviction que l’humanité, sans autre transcendance qu’elle-même, possède en elle-même les moyens de se sauver. Enfin débarrassée des oripeaux catholiques et de l’attirail prétendument universel (sens du mot « catholique ») qui accaparaient injustement toute la légitimité de l’autorité dans la direction des esprits, l’humanité peut enfin s’élancer vers un salut qu’elle ne devra qu’à elle-même et à ses propres mérites.
Philippe Muray, tout au long de son livre, fait avancer ses deux navires amiraux de front : le Socialisme et l’Occultisme, regroupés sous une même bannière (le « progressisme »), voguent de conserve, depuis le « charnier natal » (ah, « routiers et capitaines, vol de gerfauts, rêve brutal ») jusqu’à leur port de destination, comme si leurs destins respectifs étaient indissolublement liés.
Et si j’ai un reproche à faire au concept qui sert de base au livre, c’est celui-là : le « socialoccultisme », tout bien considéré, me laisse diantrement sceptique. Pour une première raison, relativement simple, c’est que le limon que charrie l'Amazone des pensées socialistes du 19ème siècle représente une masse tellement disproportionnée par rapport aux divers ruisseaux occultistes qui se sont jetés dedans tout au long, que je ne pense pas qu’il ait eu le moins du monde besoin de ces minuscules, et somme toute ridicules, affluents.
Que l’occultisme ait fait voile vers le « progressisme » (anti-catholique) des pensées socialistes est une chose. Qu’il ait en quoi que ce soit contribué à l’émergence des « consciences de classe » et à la formulation d’un quelconque progrès social, en est une autre, et tout à fait différente. J’admettrais à la rigueur que les deux soupes aient mijoté dans le même chaudron au départ, mais je doute fortement que les occultistes aient exercé quelque action sur les mouvements politiques et sociaux qui ont conduit à l’instauration de la 3ème République. Les soupes n'ont pas attendu très longtemps avant de séparer leurs substances.
La deuxième raison de mon scepticisme tient à la composition même du livre. Philippe Muray pointe sans doute avec raison que Brejnev faisait appel à un voyante-guérisseuse, dans la dernière ligne droite qui a conduit la tête du communisme dans le mur de Berlin quand celui-ci s’est effondré, mais il peine beaucoup à retracer le fil généalogique (et disons-le : logique) qui ferait comprendre de quel lien organique serait faite la parenté, s’il y en avait une. La juxtaposition (coïncidence, concomitance, si vous voulez) ne saurait tenir lieu de lien logique. Que a et b soient simultanés n'implique pas que a soit cause de b et inversement.
Les deux vaisseaux (l’Occulte et le Socialiste), peut-être qu’ils « voguent de conserve », mais leurs trajectoires, non seulement ne se confondent jamais, mais finissent par diverger. Quelques bulles d’aveux de Muray éclatent d’ailleurs à la surface quand il écrit que tel occultiste (j’ai oublié qui) se fait carrément prendre pour une pomme et foutre de sa gueule chez les gens normaux.
Peut-être qu’il y a un « bouillon » primordial où cohabitent et mijotent tourneurs de tables et imagineurs et organiseurs de sociétés idéales. Mais à mon avis, la mayonnaise ne prend pas : les deux substances se séparent avec le temps, comme l’huile et l’eau dans la bouteille. Même le géant de la synthèse syncrétiste dix-neuviémiste et du tournage de guéridon spiritiste – Victor Hugo en personne – suscite les tapotements déférents de mentons, les index respectueux tapotant les tempes, et les ricanements des plus irrévérencieux des admirateurs.
C’est là qu’intervient la méthode d’exposition de Philippe Muray : enfoncer le clou, enfoncer le clou, enfoncer le clou. Pour cela, il martèle sa formule « socialocculte » à longueur de pages. J'ai parlé de ton incantatoire. Et pour tout dire, ce qui apparaît le mieux dans l’effort de démonstration, c’est le martèlement de l’idée centrale, comme le bruit des bogies sur les rails dans les trains d’autrefois. A coups de formules, a coups de listes : qu’est-ce qu’il y a comme liste de noms, par exemple ! Peut-être davantage dans la première partie.
Et ce n’est pas le recours au sexuel par Lacan interposé (« tout acte sexuel est un acte manqué ») qui peut arranger le tableau et renforcer la conviction du lecteur. L’idée du ratage sexuel, assumée par le catholique mais niée par le socialoccultiste, me laisse dubitatif. Et faut-il le dire : faute d’une argumentation en bonne et due forme.
Ce livre est un livre fort, écrit par un intellectuel de toute première force, mais qui vacille quand le lecteur y cherche des appuis concrets, des arguments qui aient l’air de preuves, du solide quoi. Car Muray peut bien aller chercher les correspondances des auteurs qu’il cite, les aspects les plus méconnus de leurs œuvres ou de leur vie, ce qui me manque, à l’arrivée, c’est le vrai ciment.
Je le dis d’autant plus volontiers que, n’ayant jamais érigé une statue de bronze à Philippe Muray, je n’ai pas à la déboulonner. C’est un livre de littérature, écrit par un grand écrivain. Il m’est arrivé de le comparer à Masse et puissance, d’Elias Canetti. Mais c’est une erreur. Canetti, lui, a construit sa vie autour et à partir de l’idée de « masse », qu'il a portée pendant quarante ans avant d'en faire un livre.
Muray a une intuition, fulgurante si l’on veut : l’inconscient du rationalisme révolutionnaire (figuré par toutes les tendances de l’occulte) habite secrètement l’idée de Progrès Social et d’amélioration du sort de l’humanité (figurée par toutes les tendances du socialisme). J’espère que les inconditionnels de Philippe Muray me pardonneront, mais je crois vraiment qu’il remplace, dans ce livre malgré tout formidable, la faiblesse de l’idée par la prolifération de la formule, du style et de l’expression.
Et par un poids écrasant d’érudition, cela va sans dire.
Moralité de tout ça : méfiez-vous de tous ceux qui se déclarent prêts à faire le bonheur de l'humanité.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, allemagne, hommes du 20ème siècle, littérature, philippe muray, le 19ème siècle à travers les âges, mme blavatsky, allan kardec, george sand, éliphas lévi, fulcanelli, occultisme, spiritisme, saint-simon, proudhon, charles fourier, victor hugo, michelet, religion, église catholique, socialisme, masse et puissance, elias canetti
vendredi, 07 septembre 2012
QUEL ULTRALIBERAL ETES-VOUS ?
Sonnet du jour :
« Vase olivâtre et vain d'où l'âme est envolée,
Crâne, tu tournes un bon regard indulgent
Vers nous, et souris de ta bouche crénelée.
Mais tu regrettes ton corps, tes cheveux d'argent,
Tes lèvres qui s'ouvraient à la parole ailée.
Et l'orbite creuse où mon regard va plongeant,
Bâille à l'ombre et soupire et s'ennuie esseulée,
Très nette, vide box d'un cheval voyageant.
Tu n'es plus qu'argile et mort. Tes blanches molaires
Sur les tons mats de l'os brillent de flammes claires,
Tels les cuivres fourbis par un larbin soigneux.
Et, presse-papier lourd, sur le haut d'une armoire
Serrant de l'occiput les feuillets du grimoire,
Contre le vent rôdeur tu rechignes, hargneux.»
ALFRED JARRY, Les trois meubles du mage surannés.
Nous avons pu voir, hier, mes bien chers frères, combien tranchée était l’opposition entre monsieur DEDROITE et monsieur DEGAUCHE en matière économique. Enfin, pas si tranchée que ça, puisque monsieur DEGÔCHE a renoncé à faire la révolution et à organiser la redistribution des richesses sur les bases d’une certaine justice. De son côté, monsieur DEDROITE ne dédaigne pas, à l’occasion, de mettre un peu d’eau sociale dans son vin capitaliste. A condition de ne pas exagérer. Notons en passant que monsieur DEDROITE se définit plutôt par un "pour", et monsieur DEGAUCHE par un "contre". L'un a un but, l'autre a un idéal.
Aujourd’hui, je vais tâcher de montrer que l’opposition est tout aussi virulente entre monsieur DEDROITE et monsieur DEGÔCHE, mais curieusement, ils ont troqué leurs costumes et enfourché le cheval de l’autre. On ne parle plus d’économie. Aujourd’hui, en effet, on va les voir s’affronter sur les questions dites de société. Inversion radicale des rôles. Ce qui nous promet quelques ricanements.
En effet, autant monsieur DEDROITE est à fond pour la liberté quand il s’agit d’entreprendre, de vendre, d’acheter, de spéculer, de s’enrichir, autant son humeur s’assombrit quand on s’avise de s’en prendre aux VALEURS. Pas touche à l’AUTORITÉ, par exemple. Celle de l’Etat, en particulier, ne se négocie pas. Elle doit s’exercer jusque dans les confins et les recoins des banlieues défavorisées, vampirisées par les mauvais garçons, les gangs et le trafic de drogue. Pour monsieur DEDROITE, l’autorité doit procurer la SÉCURITÉ. Mot-clé.
Monsieur DEGÔCHE voit les choses un peu autrement. Sans nier la nécessité (ni la légitimité) de l’autorité, il mise sur le contact, la relation et la négociation. Sur l' « adhésion au pacte social ». Il compte sur la proximité, comme il avait en son temps baptisé une forme de police mise en place dans les « quartiers » (il suffit de le dire comme ça pour savoir de quels quartiers on parle, c'est assez drôle).
Il faut avouer que ça ne marchait pas mal, que c’était efficace en termes d’ordre public, la « police de proximité ». L’ancien Guide Suprême de la France (allez, je le nomme au moins une fois : le tout petit NICOLAS SARKOZY, le mec aux talonnettes), en caricaturant la chose (« un policier n’est pas payé pour jouer au foot avec des voyous »), a fait « peter les galons » (comme on disait quand j’étais au service militaire).
Il a trompeté qu’il allait tout passer au kärcher, il a blackboulé la « proximité » pour envoyer les CRS qui, en matière de « contact avec la population », s’y connaissaient bien mieux. C’est bien connu. Et il a demandé aux flics de « faire du résultat », de « faire du chiffre » (faisant passer la réalité du terrain loin derrière la statistique, parce que la réalité, ça fait moins d'effets d'annonce dans la presse).
Résultat ? Crispation des flics sur l’autorité de l’uniforme, respect à sens unique, tutoiement obligatoire, gardes à vue comme s’il en pleuvait, recours massif au délit d’ « outrage et rébellion », bref, du grand art. La subtilité du sarkozysme (si ça existe). Car le problème de ce monsieur DEDROITE, c’est sa fascination pour l’intimidation, le muscle, la parade et la démonstration de force, exactement comme certains clubs de hooligans du PSG : mettez un uniforme bleu à un hooligan, quelle différence avec un vrai flic, d'après vous ? Ah bon, j’exagère ?
Autre sujet de crispations antagonistes entre messieurs DEDROITE et DEGAUCHE : la frontière entre Etats. Le premier tient à son inviolabilité (on appelle ça le « souverainisme »). Même quand il est européaniste convaincu, il tient à ce que la frontière, même reportée à la limite de l’ « espace Schengen », soit bien gardée (non, je ne me lancerai pas dans la digression, qui me tend pourtant les bras, sur Lampedusa, la frontière gréco-turque, etc.).
Monsieur DEGAUCHE, au contraire, favorise la porosité des frontières autant qu’il peut, et milite même pour leur abolition (« Ouvrez les frontières », chantent AMADOU et MARIAM, qui ne sont pas européens, mais qui y ont beaucoup de complices). Le premier remplit des charters ou des bateaux à destination des pays d’origine de tous ceux qui n’ont rien à faire sur le sol national.
Le second, c’est d’abord un grand cœur, une grande âme. Et ce cœur et cette âme se penchent avec compassion et altruisme sur le sort infâme que la nation ose réserver aux étrangers. Ce rocher espagnol inhabitable, qu'il soit couvert de réfugiés africains, quelle honte pour l'Etat espagnol ! Honte à MANUEL VALLS, qui ose se prétendre de gauche, et qui arrache des Roms à leur immonde favela !
Monsieur DEDROITE s’insurge contre les intrusions. Monsieur DEGAUCHE s’insurge, et même milite, contre les extrusions. Disons-le : monsieur DEGAUCHE trouve sa vocation dans le "comité d'accueil". Et quand il y a des enfants dans l'affaire, il tonitrue. C’est logique.
Le premier est crispé, pas forcément sur la couleur de peau, disons sur une certaine idée de sa propre identité. Il tient à faire la différence entre être d’ici et être d’ailleurs. Ce n'est pas si bête, pourtant. Il faut dire que ça lui fend quand même le cœur, à monsieur DEDROITE, de sortir au terminus du RER à Gagny (dans le 9-3) et de se croire débarqué à Bamako. On ne peut pas seulement lui en tenir grief. Disons qu'il y a au moins matière à réflexion, et qu'on ne peut pas lui jeter la pierre sans y avoir un peu réfléchi.
Monsieur DEGAUCHE, lui, a appelé « diversité » la libre circulation et l’installation d’étrangers sur le sol national, il s’en félicite, il s’en réjouit. Il s’en fait même un programme, un objectif à atteindre : c’est le joyeux « métissage », l’euphorisante « créolisation », dont il se promet mille merveilles de civilisation, dans « la patrie des droits de l’homme », comme il aime à se gargariser. Il s'extasie devant les "sans-papiers". Il s'émeut face aux "sans-logis". Mais que fait l'Etat, nom de Dieu ?
Bilan paradoxal provisoire : autant monsieur DEDROITE se montre libéral tant qu’il s’agit de produire, d’acheter, de vendre et de faire circuler des marchandises d’un bout à l’autre de la planète, autant il se montre rigide, voire inflexible dès qu’il s’agit d’une certaine idée de l’ordre social et de la nation. Autant les choses ne connaissent pas de frontières, autant, s’agissant des gens et des personnes, il s’en tient à l’adage : « Chacun chez soi ». Il veut rester lui-même. C’est humain.
Contradiction identique pour monsieur DEGAUCHE : lui qui, s’agissant d’économie, voudrait réprimer l’ « argent roi », les « paradis fiscaux » et l’exploitation (éhontée, disons-le avec force) de l’homme par l’homme (la formule a, notons-le, totalement déserté les discours) et qui appelle à une redistribution des richesses, et par la force si nécessaire, lui, dès qu’il s’agit des gens et des personnes dans la société, il se sent fondre de bienveillance. Et il appelle ça « humanisme ».
Je ne peux pas m’empêcher de les trouver bizarres, ces contradictions. C’est vrai, quoi, comment peut-on être, et parfois de façon caricaturale, une fois souple et une fois rigide ? Tolérant et intransigeant ? Prenez ceux qu’on appelle les « libertariens » aux Etats-Unis. Eux, ils sont cohérents : ils prônent la disparition de l’Etat et de toute régulation, mais s’agissant du social et du sociétal (puisque sociétal il y a, paraît-il), ils sont tout aussi tolérants et ouverts.
Mais ce n’est pas fini. Ça continue demain. Attention les yeux.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, poésie, minutes de sable mémorial, politique, économie, société, capitalisme, gauche, droite, révolution, socialisme, parti socialiste, françois hollande, nicolas sarkozy, autorité, ordre public, enrichissement, spéculation, quartiers, police, président, crs, police de proximité, karcher, hooligans, psg, souverainisme, europe, espace schengen, amadou et mariam, manuel valls, roms, favela, droits de l'homme, humanisme

