mardi, 03 mai 2022
MATIÈRE A RÉFLEXION
Le prix des choses, et combien vaut un travailleur.
« Nous sommes revenus dans un monde de rareté. Nous avons un problème de ressources, d'énergie, de matières premières, de transport, de composants, et même d'emploi. A cela s'ajoutent les sanctions contre la Russie et la transition énergétique. La production mondiale de lithium doit être multipliée par 40 pour équiper nos véhicules électriques. Tout cela crée de l'inflation, comme à l'époque des années 1970-1990. Cela va conduire à une remontée des taux d'intérêt, qui imposera des contraintes budgétaires et donc la fin du "quoi qu'il en coûte". Cela change complètement l'action publique.
Si nous avions aujourd'hui une parfaite indexation des salaires sur les prix et une parfaite indexation des prix sur les coûts des entreprises, nous nous dirigerions vers 20 % d'inflation. Celle que nous avons en Europe aujourd'hui, qui n'est pas loin de 8 % n'est que l'effet mécanique des matières premières. Il n'y a eu aucun effet boule de neige. Le risque est donc devant nous. »
Nous deviendrons sobres, que nous le voulions ou non.
« La transition énergétique, c'est quatre points de PIB d'investissement en plus, un tiers pour décarboner l'énergie, un tiers pour décarboner l'industrie et un tiers pour rénover les logements. De plus, on détruit du capital. Un site qui passe à l'hydrogène investit en détruisant ses vieux fourneaux et en en achetant de nouveaux, sans produire plus. Si l'on veut investir quatre points de PIB, Il faut donc consommer quatre points de PIB de moins. Il n'y a pas le choix. La sobriété va s'imposer à nous. Il y a trois façons d'y parvenir : soit par le comportement, soit par les prix, soit par la fiscalité, parce que l'Etat lèvera des impôts pour financer les investissements qu'il doit effectuer pour la transition. Il va falloir que l'on consomme quatre points de moins pour faire de la place à l'investissement, que ce soit volontairement ou de force. »
Compétences, enseignement, formation.
« Le problème des compétences (le capital humain, les enfants, l'enseignement à l'école, la rémunération des enseignants, le lycée professionnel, la formation professionnelle) tire tous les autres : celui de l'emploi — 67 % des Français en âge de travailler ont un emploi contre 80 % de Suédois. Celui de l'industrie — 70 % des écarts du poids de l'industrie dans les pays de l'OCDE s'expliquent par les compétences de la population. Celui des comptes publics — on a peu d'emplois, donc de recettes fiscales, du fait du chômage. Les dépenses de l'Etat sont liées à la population, les recettes à l'emploi. Les pays comme la France qui ont peu d'emplois ont structurellement un problème fiscal. »
***
Voilà. Ce sont les propos tenus au Club de l'économie du Monde le 28 avril (voir le journal Le Monde daté 30 avril) par l'un des quatre invités, monsieur Patrick Artus, les autres invités étant Jérôme Fourquet, Pascale Coton et Geoffroy Roux de Bézieux. Mine de rien, Artus délivre quelques informations significatives. C'est en général ce que j'apprécie dans ses interventions : ni rêveur, ni doctrinaire, ni conceptuel. Avec lui, on est dans le concret : non seulement il maîtrise la théorie économique, mais il en propose une analyse des effets que celle-ci entraîne dans la réalité.
Des propos qui méritent qu'on y réfléchisse, en particulier le paragraphe qui concerne l'éducation et la formation (et en bout de course, les compétences) : selon moi, ce que la société investit dans l'enseignement et la formation reflète exactement l'ambition que cette société a de s'élever au-dessus d'elle-même. A cet égard, mon diagnostic est assez noir pour que je refuse d'en faire état ici.
Pour la sobriété, ceux qui suivent les travaux de Jean-Marc Jancovici sont déjà au courant. Le mot "sobriété" est d'ailleurs sans doute un euphémisme, pour désigner le sort qui attend tous ceux qui, aujourd'hui, bénéficient d'un minimum de confort électrique, d'agréments domestiques et de diverses facilités motorisées — confort, agréments et facilités qu'il faudrait plutôt appeler luxe, pour faire la différence avec ceux qui en sont dépourvus. Ou je me trompe, ou la sobriété qui sera celle de l'humanité dans des temps à venir peut-être pas si lointains ressemblera fort à la rudesse des conditions de vie qui fut celle de nos ancêtres.
09:00 Publié dans DEMORALISATION, ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, journal le monde, club de l'économie du monde, patrick artus, pascale coton, geoffroy roux de bézieux, jérôme fourquet, ocde
lundi, 07 mai 2018
L'ORDURE OGM
Retour, un peu plus récent que de précédents billets sur le même thème remis en ligne (voir 15 au 19 avril), sur un problème qui commence à dater, mais aussi et surtout à convaincre que le débat scientifique devient un piège diabolique, quand il est instrumentalisé par des transnationales, qui n'ont pour souci que de retarder par tous les moyens et le plus longtemps possible d'éventuelles décisions politiques de réglementation, de régulation, voire d'interdiction de leurs produits innovants.
La force de frappe financière et juridique (ça va ensemble) des grandes firmes industrielles doit avoir quelque chose de proprement décourageant pour des gens qui considèrent comme valide le principe de précaution, au prétexte qu'on leur oppose selon lequel il est une entrave aux "Progrès de la Science". Entre les mains des firmes, le "débat scientifique" est, en même temps qu'un argument presque imparable, une pure proposition dilatoire, destinée à lui laisser gagner le temps nécessaire pour installer son produit dans la réalité des pratiques, de rendre son usage irréversible. Ce qu'on appelle la "politique du fait accompli".
Et je ne me fais guère d'illusion sur la possibilité, dans de telles situations, d'obtenir l'inversion de la charge de la preuve : au lieu que les autorités décisionnaires obligent des scientifiques neutres et indépendants à faire la preuve de la nocivité des produits inventés par les grandes firmes avant d'en réguler la vente ou de les interdire, il faut exiger au contraire que ce soient ces dernières qui fassent la preuve (et pas la preuve par copinage et "fondations" complices) de l'innocuité de leurs produits AVANT que ceux-ci soient mis sur le marché (comme l'industrie pharmaceutique le pratique, ou plutôt semble le pratiquer, ou pour mieux dire : fait semblant de le pratiquer, pendant que les "autorités" ferment les yeux).
24 mai 2016
Donc, Bayer propose aux actionnaires de Monsanto de leur verser au total 55 milliards d’euros s’ils veulent bien lui vendre leurs actions – à 37 % au-dessus du cours de Bourse. Le mouvement naturel du capitalisme est (pour aller vite) depuis longtemps de concentrer la puissance (je veux dire : la richesse, le prestige, et puis aussi ce qu'on appelle du drôle de nom de ... Liberté (plus on est riche, aujourd'hui, plus on est libre) ! Cela pour éliminer la concurrence et établir dans la mesure du possible une situation de monopole. Cela pour dicter la loi et maximiser les profits en fixant les prix. Cela se passant sur un soi-disant « marché », où la fable de la « concurrence libre et non faussée » raconte au bon peuple le conte de fées du « juste prix ».
Monsanto et Bayer se tirent la bourre dans le domaine de la chimie, plus précisément de l’agrochimie, et encore plus précisément dans le domaine des OGM. Ne parlons pas du glyphosate, ce composant principal de l’insecticide-vedette de Monsanto, dont la France est spécialement friande.
Stéphane Foucart, qui intitule « Un savant à notre goût » sa chronique « Planète » du Monde daté 24 mai, évoque le cas de M. Boobis (« consultant pour des organisations financées par des entreprises commercialisant le fameux glyphosate »), un scientifique qui est à l’origine du message très rassurant sur le sujet, en totale contradiction avec les conclusions du CIRC, collège de spécialistes du cancer, exempts de ce qu’il est convenu d’appeler « conflits d’intérêts ».
C’est un truc « controversé », vous savez, ce genre de trucs sur lesquels diverses agences (CIRC, EFSA, OMS, …) composées de savants très savants s’étripent par « rapports » interposés ? Tant qu’il y a « controverse » entre scientifiques (difficile parfois de distinguer entre ceux financés par de l'argent public et ceux dont les laboratoires sont financés par des "fondations" intéressées à ce que les résultats répondent à leurs objectifs bien précis – qui oserait parler ici de "conflits d'intérêts ?), au moins les politiques, responsables et autres décideurs ne sont pas mis en face de cruelles décisions à prendre pour protéger la santé des simples citoyens. Et pendant que les abeilles meurent en masse, les actionnaires se frottent les mains. Faire régner le doute, c'est tout un métier, et qui peut rapporter gros à ceux qui l'exercent : voir à ce sujet l'excellent livre d'Oreskes et Conway Les Marchands de doute.
Ne parlons que des OGM. Sont-ils indispensables ? Sont-ils nocifs ? Laissons les scientifiques débattre de cette grave question. Quand on y verra plus clair, il sera bien temps de prendre une décision. En attendant, laissons la « controverse » prospérer, croître et embellir. Et n’approfondissons pas trop la question de savoir si les scientifiques embarqués dans les diverses agences en bisbille sont ou non financièrement et personnellement intéressés au prorata des résultats des recherches qu’ils mènent, telles qu’ils apparaissent dans les « rapports » publiés. Laissons de côté la question de savoir dans quelle mesure ils sont vraiment désintéressés.
[Sont-ils indispensables ? Sont-ils nocifs ? Voilà bien deux questions désarmantes de naïveté. Une question – un peu moins naïve – consiste à s'interroger sur les motivations réelles et profondes de la transnationale à mettre sur le marché des produits innovants. La réponse est simple et désespérante : les motivations ne sont jamais humanistes, généreuses et universalistes, et n'ont jamais visé à faire progresser l'humanité sur la voie de la voie du Progrès, mais à enrichir ceux qui ont mis la chose au point et ceux qui ont placé leur argent dans l'affaire en espérant que ça leur rapporte un maximum. Fabriquer les formes du monde à venir et s'en faire le propriétaire et le bénéficiaire, si possible "ad vitam aeternam". Ajouté le 6 mai 2018.]
Se laisser hypnotiser par la « controverse » scientifique sur les OGM, c’est suivre un chiffon rouge qui vous détourne de l’essentiel. Le plus grave n’est peut-être pas dans le « Roundupready » de Monsanto (bien que ça ne soit pas très sympathique). Le plus grave est dans les brevets qui posent la griffe d’une grande transnationale sur l’agriculture mondiale, c’est-à-dire sur l’alimentation de l’humanité. Je veux dire dans la confiscation, dans l’accaparement, par des gens surtout occupés de profits et de dividendes, des ressources collectives concernant un besoin essentiel des hommes.
La « controverse » scientifique sur les OGM est l’arbre (un de plus !) qui empêche de voir l’immense forêt de la Grande Privatisation de Tout. La logique ici à l’œuvre aboutit à installer une barrière de péage devant tous les gestes de la vie quotidienne qui sont encore à l’abri de la dictature du « Marché ». Un certain nombre de gens qui voient un intérêt financier potentiel dans tout ce qui ne leur rapporte encore rien ont bien l’intention de s’approprier tout le vivant.
L’ordure OGM est moins dans les manipulations génétiques et les éventuels risques qu'elles font courir à la santé humaine que dans les panneaux « Propriété Privée, Défense d’entrer » que des troupes de bandits en costumes trois-pièces sont en train de planter devant tout ce qui ressemble au Bien Commun, après avoir obtenu des instances politiques que la LOI soit mise à leur service.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ogm, monsanto, bayer, bayercropscience, économie, glyphosate, roundup, roundupready, privatisation, boobis, circ, efsa, cancer, stéphane foucart, journal le monde, industrie agroalimentaire, agrochimie, industrie chimique, écologie
mardi, 01 mai 2018
EN ATTENDANT L'EFFONDREMENT 2
23 juin 2015
2/3
 C’est drôle, je n’ai pas très envie de dire du mal d'un livre qui traite d’un thème essentiel, grave, urgent, vital, et pourtant j’ai du mal à en dire du bien. A bien y regarder, je crois bien que ça tient à sa conception terriblement américaine. Je veux dire : importée des méthodes et des façons d’analyser telles que pratiquées aux Etats-Unis. L'appareil des notes impressionne (elles sont au nombre de 429 pour 250 pages de texte !), mais confirme l'empreinte américaine, omniprésente. En plus, ça a un côté horripilant, à cause de la dernière partie. Je vous explique.
C’est drôle, je n’ai pas très envie de dire du mal d'un livre qui traite d’un thème essentiel, grave, urgent, vital, et pourtant j’ai du mal à en dire du bien. A bien y regarder, je crois bien que ça tient à sa conception terriblement américaine. Je veux dire : importée des méthodes et des façons d’analyser telles que pratiquées aux Etats-Unis. L'appareil des notes impressionne (elles sont au nombre de 429 pour 250 pages de texte !), mais confirme l'empreinte américaine, omniprésente. En plus, ça a un côté horripilant, à cause de la dernière partie. Je vous explique.
La première partie (un constat en bonne et due forme), jusqu’à la page 133, est absolument parfaite, impeccable, irréprochable, faisant un décompte méticuleux et hallucinant des folies qui constituent, de la moelle des os à la texture de la peau, notre civilisation « thermo-industrielle ». Les auteurs y montrent l’explosion exponentielle (à partir de 1950) de tous les chiffres qui dessinent le bilan général de l’action humaine sur le « système-terre » (Isabelle Stengers aurait dit « Gaïa », il me semble avoir aperçu le mot quelque part, mais pas le nom de la dame, je peux me tromper). Le tableau des pages 33-34 ne parle pas : il hurle.
Comme je disais hier, c'est l'addition de tous les facteurs qui épouvante : le réchauffement, c'est d'accord, est le facteur le plus global. Mais c'est quand vous y ajoutez tout le reste que vous prenez peur : la déforestation, les effets des poisons chimiques nouvellement sortis des laboratoires et qui imprègnent l'air que nous respirons, les eaux et les vins que nous buvons, les végétaux et les viandes que nous mastiquons, les continents de microplastique qui se concentrent au milieu des océans de la planète, l'acidification de la surface des océans (quid des planctons ?) et l'agonie des récifs coralliens (cf. le récent cri d'alarme au sujet de la Grande Barrière de corail en Australie), liste non limitative. Zieutez plutôt le cumul ci-dessous.
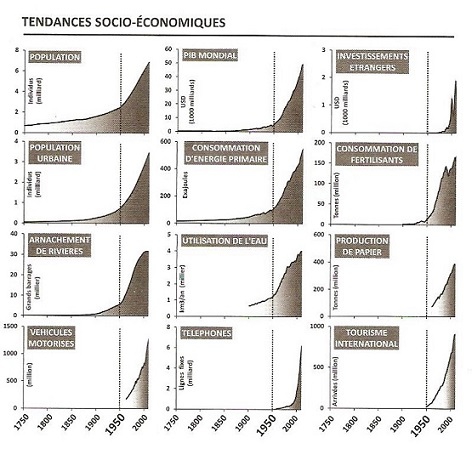
La page 33. Le monde actuel commence en 1950. Il faut se dire qu'une exponentielle n'est pas exactement une asymptote.
Ils montrent ensuite l’épuisement matériel irréversible en combustibles fossiles, auquel conduit notre façon de bouffer notre planète pour alimenter nos machines : éliminer en quelques centaines d'années (mettons depuis 1750) un capital qui s'est formé en plusieurs millions d'années, on peut se poser des questions sur la rationalité humaine. Quand se manifesteront les « pics » de production des différentes ressources fossiles ? Inutile de s'en préoccuper, puisque, de toute façon, le résultat sera là tôt ou tard et que c’est notre façon de faire qui le produira nécessairement. L'extraction est mauvaise dans son principe même, alors imaginez sept milliards d'extracteurs. Tout le monde sait, mais tout le monde (moi compris) fait semblant de ne pas savoir, puisqu'il vit comme d'habitude : comme le dit le pape François dans son encyclique, c'est le mode de vie à l'occidentale qui épuise les ressources (je cite en substance).
Le mode de vie « occidental » (pour ne pas parler de l' « américain ») est désirable, agréable et confortable aussi longtemps qu’il reste réservé à un tout petit nombre, mettons cinq cents millions : c’est son extension à sept milliards d’humains (au nom de quoi en seraient-ils privés, en effet ?) qui transforme ce mode de vie en folie et en catastrophe. Illustration lumineuse de la notion d'effet pervers : nous devons la "bombe démographique" à la médecine, cette science et cet art qui guérit les maladies et réduit la mortalité des malades, des femmes qui accouchent et des bébés qui naissent. Et nous devons à l'exigence d'égalité, de justice et de démocratie la généralisation suicidaire d'un mode de vie américanoïde à tous les milliards d'humains qui peuplent la Terre.
Seul moyen de sauver la planète (si c'est vraiment ça qu'on veut) : cesser de vivre comme des nababs et de se payer sur la bête. Revenir à la raison, à l'extrême sobriété, à la restriction prévoyante et à l'humilité. Si on demandait de lever le doigt à ceux qui sont prêts à le faire (se défaire du frigo, du lave-linge, etc. ...), probable que ... (et moi le premier). Probable que l'humanité attendra d'avoir le pistolet sur la tempe. Mais c'est aussi l'humanité qui tiendra le pistolet : ça veut dire quoi, au fait, "l'humanité" ? Le problème, c'est que le pistolet chargé est déjà braqué, qu'il y a déjà le doigt sur la détente, mais que personne ne veut le voir.
Les auteurs évoquent ensuite les raisons de l’inertie et de la rigidité du système mis en place, qui rend difficile, voire impossible une correction de trajectoire, en se référant au formidable [j'émets aujourd'hui des réserves, 30 avril 2018] petit livre de Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (PUG, 1987) : comment modifier l'opinion des gens en obtenant d'eux par certaines techniques, comme l' "amorçage" ou le "pied-dans-la-porte", des gestes et comportements qui, a priori, les rebutaient. Comment amener les gens à admettre et défendre des idées qui n'étaient pas les leurs, avant que d'adroites manœuvres ne les amènent à changer d'avis sans même qu'ils se rendent compte qu'ils en ont changé ni comment ça s'est fait (prêts à soutenir qu'ils ont toujours pensé comme ça). L'essentiel est là : ne pas être conscient de la manœuvre, c'est proprement être manipulé.
système mis en place, qui rend difficile, voire impossible une correction de trajectoire, en se référant au formidable [j'émets aujourd'hui des réserves, 30 avril 2018] petit livre de Jean-Léon Beauvois et Robert-Vincent Joule, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (PUG, 1987) : comment modifier l'opinion des gens en obtenant d'eux par certaines techniques, comme l' "amorçage" ou le "pied-dans-la-porte", des gestes et comportements qui, a priori, les rebutaient. Comment amener les gens à admettre et défendre des idées qui n'étaient pas les leurs, avant que d'adroites manœuvres ne les amènent à changer d'avis sans même qu'ils se rendent compte qu'ils en ont changé ni comment ça s'est fait (prêts à soutenir qu'ils ont toujours pensé comme ça). L'essentiel est là : ne pas être conscient de la manœuvre, c'est proprement être manipulé.
Le défaut du livre est que les auteurs, au nom des « valeurs », des grands « principes » et des grands sentiments (les Lumières, la démocratie, ...), refusent d'aller au bout de la simple logique des procédés analysés, et d'aller jusqu'aux conclusions concrètes absolument cyniques que le capitalisme en a tirées pour sa plus grande prospérité. Beauvois et Joule se gardent bien de remettre en question la légitimité du système. Ils semblent eux-mêmes effrayés de leur audace. Industriels et publicitaires, eux, n'ont pas de ces pudeurs effarouchées pour appuyer à fond sur les mécanismes qui permettent d'agir sur les attitudes et même les comportements des foules sans que celles-ci en soient seulement conscientes.
A moins que Beauvois et Joule ne soient pris dans la gelée d'un indécrottable angélisme : manipuler, certes, mais avec une intention toujours louable, et jamais maligne. Ils chantent, avec Frère Laurent (c'est dans Roméo et Juliette, de Berlioz, version Charles Munch si possible) : « Grand Dieu, qui vois au fond de l'âme, Tu sais si mes vœux étaient purs. Grand Dieu, D'un rayon de ta flamme, Touche ces cœurs sombres et durs ». Que les choses seraient simples, si les hommes n'étaient habités que de bonnes intentions. « Que la vie serait belle en toute circonstance, Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards » (eh oui, toujours Tonton Georges).
Servigne et Stevens font aussi une place aux actions féroces et puissantes de lobbying auxquelles se livrent les grandes firmes quand il s’agit de défendre leurs intérêts. Ils montrent ensuite que plus un système est complexe, plus il est fragile, s’appuyant sur l’exemple du Boeing 747, composé de 6.000.000 de pièces, que leur fournissent 6.500 entreprises réparties dans 100 pays, ce qui occasionne « 360.000 transactions commerciales chaque mois ». Ils s’aventurent aussi dans le domaine de la finance internationale, dont les règlements, touchant en particulier les "fonds propres" des banques, fixés à Bâle en 1988, 2004 et 2010 (I, II, III), sont devenus si complexes qu’il est difficile de s’y retrouver.
Je ne sais d’ailleurs pas bien ce qu’ils réglementent, quand on sait que le "trading à haute fréquence" est capable de produire des catastrophes boursières en quelques minutes, ou que « le marché des produits dérivés s’élevait à 710.000 milliards en décembre 2013, soit approximativement 10 fois la taille du PIB mondial » (p. 110). Cela signifie, si j'ai bien compris, que 90% du fric échangé à la Bourse mondiale reposent sur un socle qui a autant de consistance que l'air ambiant : du vent ! Surtout que c'est ce vent, quand il se met à souffler en tempête, qui est capable de réduire à néant tout l'édifice de l'économie mondiale, comme on l'a vu en 2007-2008. Plus vertigineux que la "Directissime" de la face nord de l'Eiger, ouverte en 1966 par Harlin, qui y a laissé la peau. Les auteurs évoquent pour finir le fil du rasoir sur lequel évoluent les circuits d’approvisionnement et l’état déplorable de toute une série d’infrastructures, y compris des routes aux Etats-Unis.
de la face nord de l'Eiger, ouverte en 1966 par Harlin, qui y a laissé la peau. Les auteurs évoquent pour finir le fil du rasoir sur lequel évoluent les circuits d’approvisionnement et l’état déplorable de toute une série d’infrastructures, y compris des routes aux Etats-Unis.
Voilà le panorama de la planète telle qu’elle se présente aujourd’hui. Je l’ai dit : la première partie du livre de Servigne et Stevens est parfaite. C'est ensuite que ça se gâte. D’abord parce que les quarante pages de la deuxième partie font vraiment disproportionné (la première s'achève à la page 133, la deuxième à 173, quarante pages !). Les auteurs s’y interrogent sur la fiabilité des modèles qui permettraient d’établir un calendrier de la catastrophe future. Pas grand-chose à dire : c'est de la futurologie. Est-ce mieux que la collapsologie ?
Après avoir tenté de réhabiliter les droits de l’intuition dans la perception de l’état du monde, en citant Hans Jonas (« davantage prêter l’oreille à la prophétie de malheur qu’à la prophétie de bonheur » (p. 143), sans contextualiser le propos), ils se demandent quelle confiance on peut accorder aux modèles prédictifs. Ne nous attardons pas : les deux modèles convergent en direction d’un avenir peu reluisant, le « Rapport au Club de Rome » (Meadows) restant le plus net dans le pronostic négatif. Exit la deuxième partie, décidément bien légère. Comme si Servigne et Stevens faisaient juste une politesse à des modèles existants mais qui n'ont à leurs yeux aucune validité, étant entendu que ce qu'ils s'apprêtent à proposer dans leur troisième partie est infiniment plus crédible.
Et c'est là que le bât blesse : le problème de ce bouquin n’est nulle part ailleurs que dans cette troisième partie, destinée à établir les fondements de la discipline dont ils se veulent les initiateurs. Celle intitulée précisément « Collapsologie ». D’après cette « science » (comme disent les auteurs), un effondrement se produit toujours en plusieurs étapes : 1-financier ; 2-économique ; 3-politique ; 4-social ; 5-culturel. Ensuite, je suppose que les hyènes et les vautours se partagent les morceaux qui restent.
Ce schéma a quelque chose de comique, d'abord par son aspect systématique (façon "recette à suivre pour un effondrement dans les règles"), mais aussi en ce qu’il me rappelle les cinq étapes du processus de « dénationalisation » imaginé par Ismaïl Kadaré dans La Niche de la honte : 1-suppression physique de la rébellion, puis 2-de son idée, puis 3-de la culture, de l’art et des coutumes, puis 4-de la langue, enfin 5-de la mémoire nationale : les catégories sont différentes, mais le schéma est le même. C'est le processus que les Ottomans de Kadaré enclenchaient quand une rébellion faisait mine de défier l’ordre impérial [par "Ottomans", il faut évidemment entendre "système soviétique", qu'il s'agisse de l'original ou de sa caricature albanaise (Enver Hojda), dans laquelle a vécu Kadaré (ajouté le 29 avril 2018)]. A croire que Servigne et Stevens ont lu La Niche de la honte (voir mon billet du 17 juin). Sauf que l’effondrement était sciemment provoqué par la "Sublime Porte", qui restait ensuite intacte.
L'humanité n'aura pas cette chance.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, écologie, défense de l'environnement, pablo servigne, raphaël stevens, comment tout peut s'effondrer, états-unis, isabelle stengers, civilisation thermo-industrielle, combustibles fossiles, civilisation occidentale, beauvois joule, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, jean-léon beauvois, robert-vincent joule, presses universitaires de grenoble, boeing 747, accords de bâle i, bâle ii, bâle iii, trading haute fréquence, directissime eiger, hans jonas, rapport au club de rome, rapport meadows, empire ottoman, ismaïl kadaré, la niche de la honte, sublime porte, hector berlioz, roméo et juliette, frère laurent
samedi, 07 avril 2018
5-LA PLANÈTE DES RICHES
30 décembre 2017
Des nouvelles de l'état du monde (17).
5/5
Inégalités, planète et nombre.
Au fait, pourquoi a-t-on appelé les années 1945-1975 les « Trente Glorieuses », la célèbre formule de Jean Fourastié ? On nous parle complaisamment de l’incomparable prospérité qu’ont connue les pays développés et du taux de croissance faramineux de l’activité économique. C’est vrai, évidemment. Je fais juste remarquer que cette prospérité et cette croissance sont concomitantes de cette autre vérité incontestable : ce furent sans doute les années les moins inégalitaires de l’histoire, comme cela apparaît clairement dans Le Capital au XXI° siècle de Thomas Piketty. Prospérité, croissance et redistribution dans un même bateau ! Bon dieu, mais c’est bien sûr ! Il suffisait d’y penser !
Sans être économiste, j'ai tendance à me dire que ce n'est pas une simple coïncidence et que, pour que les entreprises marchent du tonnerre de Dieu, il suffirait peut-être de donner aux populations le pouvoir d’achat qui permettrait à la machine économique de tourner à plein régime. De l'intérêt bien compris, en somme. Cesser de draguer et de gaver l'actionnaire (le soi-disant investisseur, mais vrai spéculateur : à vrai dire, trois mots devenus interchangeables, ou pas loin) pour mettre un peu d'huile dans les rouages de la vie des laborieux, pour qu'ils aient chaque matin envie de retourner au charbon parce que ça vaut le coup. Au lieu de se demander, comme beaucoup font actuellement, de quelle humeur sera la guillotine ce matin.
La voilà, la solution : modérer les inégalités de richesse, c’est bon pour tout le monde ! Pas le communisme, non, surtout pas cette façon militaire et policière de niveler par le bas : juste une redistribution convenable pour la prospérité de tous, avec des inégalités qui puissent avoir des airs acceptables. Des inégalités un tantinet justifiées (par le talent, le mérite, le travail, bref : des "valeurs", mais des vraies, pas des abstractions). Ce qu'il faut retenir ? Que pendant trente ans, les pays industrialisés ont magnifiquement crû et embelli en partageant (approximativement) les richesses produites entre ceux qui en fournissaient les moyens et ceux qui les produisaient par leur travail.
Et ça n’a pas si mal marché, en fin de compte, tant que l’activité est restée concentrée sur une quinzaine de pays industrialisés. Allez, soyons sympa : les trente-cinq membres de l’OCDE. Tant qu’ils sont restés entre eux, et aussi longtemps qu’a duré la croissance de ces marchés, jusqu'à ce qu'une majorité de gens aient acquis les premiers éléments du confort qui est le nôtre aujourd'hui. Bon, c'est vrai que, pendant tout ce temps, la prédation des ressources a continué joyeusement, mais enfin à destination d'un nombre limité de pays : trente-cinq pays, ça ne fait pas une planète. On pourrait se dire que ce qui a marché pour quelques-uns, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas pour tout le monde. Très belle idée, c'est sûr, mais il y a une sacrée arête en travers de ce gosier.
Car c'est vrai qu'on voyait bien, déjà, les dégâts que ça faisait. Bon, le principe de la pollution, s'il commençait à être bien identifié par quelques illuminés (Pierre Fournier et La Gueule ouverte, les premiers écolos, "nucléaire non merci", Malville, Philippe Lebreton, alias professeur Mollo-Mollo, ...), était tout aussi largement nié par les "autorités compétentes" qu'il était concrètement à l'œuvre. Mais tant que c'était dans les ailleurs que c'était pollué, vous comprenez ... avant qu'on se rende compte que ça se passait aussi chez nous (air, terre, eau, etc.). M'enfin, du moment que les affaires prospéraient ... on ne chipotait pas trop.
Malheureusement, une fois les marchés à saturation, il a bien fallu en ouvrir d’autres et, pour cela, donner un peu de pouvoir d'achat à ces "autres", pour qu'ils puissent acheter. C’est peut-être cette logique qui a lancé la mondialisation, avec son cortège de délocalisations et de concurrence de toutes les mains d’œuvre (mot d’ordre : alignement sur le plus bas salaire : Bangla Desh par exemple).
Je saute des étapes, mais l'axe directionnel est à peu près là. Bon, c'est vrai, pour assister comme aujourd'hui à la montée fulgurante des inégalités, il faut qu'il se soit passé quelque chose d'autre : il faudrait se demander aussi ce qui a permis une telle confiscation de la création de richesses par un petit nombre de cumulards infernaux. Sans doute le couple diabolique Reagan / Thatcher. Paul Jorion, de son côté, voit dans cette concentration de richesses une des principales menaces qui guettent.
Il serait aussi intéressant de se demander dans quelle mesure la saturation de marchés déjà gavés n'a pas été pour quelque chose dans la course à l'innovation à tout prix et dans tous les domaines, concurrence exacerbée oblige. Je dis ça en passant, mais il y aurait peut-être de quoi s'arrêter un moment.
Toujours est-il que, après le pouvoir d'achat, les "autres" ont voulu davantage, comme par exemple ce qu'on appelle des "transferts de technologie" : il a fallu exporter les savoir-faire, les techniques, les compétences, pour "conquérir" des marchés. Tant et si bien que les "autres", à commencer par la Chine, sont devenus des concurrents à part entière. Pas de chance, hein ! C'est la logique même du profit qui a donné à l'Occident la prééminence, et qui lui a, du même mouvement, ôté cette prééminence, en même temps que l'initiative et la créativité, l'invention et l'innovation. L'Occident a livré aux "autres" les secrets qui avaient fait sa domination. A quelques détails près, je trouverais presque qu'il y a quelque chose de christique dans cette façon de donner de soi. Sauf que ...
Sauf que, étendez aux deux cents pays du monde la façon de produire et de consommer des trente-cinq privilégiés, et le monde n’y résiste pas. Cela veut dire que, de toute façon, le "modèle économique" inventé en Europe, en plus d'être carrément inéquitable, n'était pas raisonnable. Et une fois que l'Amérique protestante et mercantile s'en est emparée, il s'est montré carrément déraisonnable et sans frein. Alors vous pensez, une fois étendu à tous les pays en quête de croissance, de confort et de bien-être, le modèle, il est devenu définitivement insensé, impraticable et suicidaire.
Alimenter en matière, puis en produits de consommation une aussi grosse machine à produire et à consommer revient à piocher sans mesure dans le capital. Pour simplement dire qu’elle fonctionne, cette économie-là est obligée de vendre les bijoux de famille : je veux dire la nature. Cette humanité-là dilapide, pille les ressources, elle tue la poule aux œufs d’or.
Le problème, avec les êtres vivants, c’est que ce sont des prédateurs, tous sans exception. A partir du moment où il faut vous nourrir pour « persévérer dans votre être », vous prenez le carburant qu’il vous faut où il se trouve : le plus disponible, le plus nutritif, le plus facile, le plus près, le plus faible. La preuve, regardez l'immigration du loup des Abruzzes, d'abord discrète et précautionneuse, qui s'est progressivement fait dévastatrice chez les brebis (les écolos peuvent gueuler, c'est quand même la vérité). Le scénario est toujours le même : prendre, manger, déféquer. Prédation, consommation, déjection. Où que vous regardiez, quand vous avez à faire au vivant, c’est le cycle, quasiment mécanique, aujourd’hui encore. Ni vous ni moi ne faisons exception à la règle, à la différence que notre ingéniosité nous a faits les royaux prédateurs de tout, y compris du loup, heureusement.
Aussi longtemps que vous avez par-ci par-là un bonhomme qui prélève dans son environnement de quoi « persévérer dans son être », qui consomme et qui abandonne ses déchets là où il les a faits, l’environnement est content : il fait ce pour quoi la nature du lieu l’a fait, il accueille un étranger pour un temps, et il possède tout ce qu’il faut pour digérer (recycler) ce qu’il laisse en partant. La question du nombre est primordiale. Comme disait l’autre (peu importe cet autre) : « Quand il y en a un, ça va, c’est quand il y en a beaucoup que ça pose problème ». Rien de plus vrai en l’occurrence. Comme disait Fernand Raynaud dans je ne sais plus quel sketch : « Vous prenez dix sages, vous les serrez, vous obtenez un fou ». Mais quel âge faut-il avoir pour se souvenir de Fernand Raynaud ?
L’humain c’est ça : clairsemé, il passe inaperçu ; serré, il prend des maladies. Tout seul ou presque, c’est à peine si on s’aperçoit de sa présence : il laisse si peu de traces qu’il faut quelques dizaines de milliers d’années pour que des fondus en dénichent dans des sols improbables : ici une molaire, là une mandibule, ailleurs un tibia ou une calotte crânienne. Quand, avec le nombre, il commence à en laisser beaucoup, on appelle ça des déchets. Car c’est quand il se concentre que ça ne va plus. La première chose à prévoir, quand on organise un rassemblement populaire, en même temps que le ravitaillement, c'est l’emplacement des « feuillées », vous savez, ces chiottes de campagne rustiques où règne la convivialité, sinon gare aux conséquences diverses.
Pour les véhicules à moteur, c’est pareil : l’époque des De Dion-Bouton, Delahaye, Hotchkiss, Rosengar, Delage (véhicules polluants s’il en est) fait figure d’âge d’or et de folklore vintage. Rien à voir avec aujourd’hui, où les habitants de New Dehli (Inde) sont obligés d’installer un brumisateur géant pour faire retomber au sol les particules fines offertes par les pots d’échappement. Et ceux de la vallée de Chamonix bénissent tous les jours le percement du tunnel, qui leur apporte fidèlement les fumées toxiques quotidiennement sorties des pots d’échappement de milliers de poids lourds (582.000 chambres à gaz roulantes sur l’année 2012 : je pense à l’usage qui était fait des camions et des pots d’échappement dans certains camps nazis). Mille mercis, le Nombre !
J’ai entendu je ne sais plus qui soutenir je ne sais plus où que la planète est idéalement faite pour cinq cents millions d’humains. On en est à sept milliards (en comptant les femmes et les petits enfants, comme faisait maître François Rabelais). Soit dit en passant, mille mercis à la Médecine, pour la grenade démographique qu’elle a dégoupillée et qui n’a pas fini d’exploser (les Nigériennes font six ou sept enfants chacune, dans un pays très pauvre qui compte 20 millions d'habitants : qu'adviendra-t-il en 2050, où on en prévoit 79 millions ?). Les grandes âmes entonnent régulièrement leur refrain préféré : « La Terre pourrait nourrir dix milliards d’individus … ». Il faut à peine les pousser pour qu’ils ajoutent : « … si … ». Si quoi ? Réponse : « Si l’on procède à un partage équitable des ressources ». Equitable ! Tu l’as dit, bouffi !!!
Équitable ? Même Bill Gates le philanthrope ne veut pas être équitable. Il veut faire le Bien, et que tout le monde le sache, c'est différent. Il veut écraser les pauvres de sa Bonté. En vérité qui, à part quelques gogos de consommateurs bobos, tient à favoriser un commerce équitable ? Eh bien voilà, c’est tout simple : c'est la raison pour laquelle personne n’est pas plus en mesure de lutter contre les inégalités que contre les atteintes irréversibles à l'état de la planète. Tout ce qui est au sommet de la pile est trop heureux de respirer un bon air pur, de se sentir du côté du Bien et d’orienter les décisions dans le sens favorable au maintien du statu quo. Tout ce qui est en bas a juste le tort d’être en bas : on respire moins bien, on est trop serré et on a trop de poids sur les épaules et pas assez sur les décisions pour faire bouger quoi que ce soit. Édifier un monde juste ? Vous n’y pensez pas ! Qui est là pour vous entendre ?
Car accessoirement, voilà aussi la raison pour laquelle la nature elle-même est mal partie : le pillage n’est pas près de s’arrêter. L'état économique des gens et l'état écologique de la planète sont promis au même sort. Ils sont indissolublement liés et, selon toute apparence, pas pour le meilleur. Une consolation quand même : quand tout sera fini, il n'y aura plus personne, après coup, pour pointer son "gros doigt grondeur" sur les cancres pour dire : « Personne ne pourra dire qu’on ne savait pas ». Il n'y aura plus un seul donneur de leçon.
On respire presque bien à cette idée.
Voilà ce que je dis, moi.
20:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la planète des riches, lutte contre les inégalités, laurent joffrin, journal libération, journal le monde, warren buffett, gérard filoche, parti socialiste, benoît hamon, crif, érinnyes, twitter, journalistes, ultralibéralisme, boris vian, une bonn'paire de claque, écologie, pierre bourdieuthomas piketty, le capital au 21° siècle, cahuc et zylberberg le négationnisme économique, 15000 scientifiques, bernard maris, paul jorion, économistes atterrés, georgius en revenant de la revue, hcr, cicr, ccfd, unicef, msf, anne fretel, france culture, bande dessinée, hermann, hermann sarajevo tango, onu, boutros ghali, sarajevo, pierre fournier la gueule ouverte, philippe lebreton, professeur mollo-mollo, centrale de malville, économie, science économique, politique, société
mardi, 25 avril 2017
CHRONIQUES DE PAUL JORION
 2/2
2/2
Mais si Paul Jorion ne tient pas le discours aveugle que je dénonçais hier, il n'en reste pas moins, à sa façon, un optimiste indécrottable, car il ne se résigne pas à subir, et demeure, envers et contre tout, comme on dit, une "force de proposition". Il pense en effet qu’on peut encore inverser un cours des choses qui, selon moi, a bien des aspects irrémédiables.
C'est cet optimiste qui ne cesse pourtant de répéter, dans ses interventions, que les gens qui font le système économique actuel n'accepteront de faire quelque chose pour sauver la planète qu'à la seule condition que ça leur rapportera quelque chose. Contre cet aveuglement, Jorion croit aux vertus de l'action individuelle et de l'action de groupe. Bien lui en fasse : pourquoi pas, après tout ? Je crois que c'est se faire bien des illusions sur le pouvoir de l'individu "acteur", dont se gargarisent bien des sociologues de l'école "moderne".
Il suffit pour s'en rendre compte d'examiner les propositions de Paul Jorion, dans le dernier chapitre (Que faire ?), qui sont les suivantes : 1 – Faire du respect de l’environnement une donnée économique. 2 – Restaurer la régulation. 3 – Rétablir une authentique science économique. 4 – Faire de l’Etat providence une fin en soi. 5 – Casser la machine à concentrer la richesse. 5 – Envisager autrement la question du travail et de l’emploi. 6 – Donner tout son rôle à l’opinion publique. 7 – Faire du socialisme (non stalinien) un objectif à atteindre.
Autant dire un programme révolutionnaire, qui prend carrément de front les tenants du système qui, de leur côté, ont tous les moyens en main pour s'y opposer. L’environnement ? En plus du réchauffement climatique, comptons sur la déforestation, l’acidification des océans, l’empoisonnement des hommes par toutes sortes de substances chimiques mutagènes, etc. La régulation ? Pour vaincre toutes les résistances, on verra dans 50 ou 100 ans. La science économique ? Il faudrait commencer par déboulonner les doctrines libérales qui font autorité dans l’Université et dans tous les « think tanks » possibles et imaginables (appelons ça la "pensée dominante", voire la "pensée unique"). L’Etat providence ? Qui aujourd’hui, à part Jorion et quelques autres "économistes atterrés", ne tire pas dessus à boulets rouges ? Interdire la concentration de la richesse ? Je crois que les « versements d’intérêts », les « dividendes » et les « bonus extravagants » (p. 223) ont encore de très beaux jours devant eux.
Bref, on dira que je ne vois que les obstacles, que je suis défaitiste, et tout ça. Soit, mais qu’on me montre, par exemple, les progrès accomplis en Europe pour lutter contre la concurrence salariale ou fiscale entre les pays qui la composent, ou contre la généralisation de l'emploi du glyphosate ou des néonicotinoïdes dans l'agriculture. L’Irlande avec son impôt dérisoire sur les sociétés, le Luxembourg avec ses « rescrits fiscaux », la Bulgarie avec ses travailleurs détachés « low cost », on n’en finirait pas d’énumérer les maux de l'ultralibéralisme économique qui déferlent sur le continent, et qui font de chacun des pays un rival, voire un adversaire de tous les autres. Quel beau modèle d'"Union", en vérité !
La raison du pessimisme qui me fait trouver chimérique le dernier chapitre du livre de Paul Jorion tient peut-être à un tempérament, mais elle tient aussi à quelques lectures (Jacques Ellul, Günther Anders - qui assume les yeux ouverts le renoncement à tout espoir, entre autres). J'avais eu la même impression en lisant La Richesse cachée des nations, de Gabriel Zucman : diagnostic impeccable sur le mal et sur ses causes, propositions et solutions totalement irréalistes. C'est le cas de tous ceux qui, dans le troisième temps de leur raisonnement (vous savez : constat / causes / solutions), commencent à balancer par paquets entiers les "il faut", "on doit" et autres formules comminatoires et vaines. Il y a là du Don Quichotte. Car la raison de mon pessimisme tient encore au regard que je porte sur le rapport des forces en présence et à la conception que je me suis faite, à tort ou à raison, de la notion de système.
En particulier, je me dis qu’un système (défini comme réseau serré d'interactions, de relations étroites et d’interdépendances multiples) a le plus grand mal à se critiquer lui-même, et encore plus à se corriger lui-même. Il suffit de voir la façon dont le système capitaliste a proprement digéré toutes les critiques qui lui ont été faites depuis ses origines, et annihilé tous les efforts faits, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour l'inciter ou le contraindre à changer. La plasticité de ce système semble sans limite : il s'adapte à tout, il avale tous ses contradicteurs, tous ses opposants, et même tous ses ennemis. Il s'est sans cesse renforcé des attaques de ses adversaires, et a jusqu'ici fait son miel de tous les pollens destructeurs envoyés contre lui comme des missiles.
Pour prendre un exemple minuscule qui illustre la chose à merveille, je pense à la micro-controverse qui eut lieu (en 1996) entre Pierre Bourdieu et le journaliste Daniel Schneidermann, qui l’avait invité à son émission télé Arrêt sur image. On peut dire que la télévision est une sorte de quintessence de la "société spectaculaire-marchande". A ce titre, l’émission ayant bien frustré le sociologue, il écrivit pour Le Monde diplomatique un article intitulé "Peut-on critiquer la télévision à la télévision ?", dans lequel il développait une argumentation serrée et pertinente. La réplique du journaliste, dans le numéro suivant, avait été assez basse pour s’en prendre à la personne même de Bourdieu, allant même jusqu'à insinuer, si je me souviens bien, que le sociologue est habité par le fantasme suggéré par la deuxième syllabe de son nom.
Conclusion : la télévision est un système, lui-même puissant instrument entre les mains du capitalisme, et en tant que tel, elle n’a rien à craindre de qui que ce soit pour continuer à exister. Elle digère tout, puisqu'elle transforme tout ce qui passe par elle en pur spectacle. Accepter d'aller sur un un plateau de télé, c'est devenir par le fait même un rouage du système. C'est apporter sa caution à son organisation (jusqu'à Poutou gardant le sourire pendant que Ruquier et son équipe se foutent de sa gueule ; on peut préférer Dupont-Aignan, n'acceptant l'invitation de telle chaîne que pour pouvoir, tel Maurice Clavel en son temps ("Messieurs les censeurs, bonsoir !"), faire son éclat en quittant le plateau brutalement, mais pour quel bénéfice réel ?).
Tiens, à propos de spectacle, je pense aussi à Guy Debord qui, après avoir voulu détruire en la mettant à nu la dite « société spectaculaire-marchande » dans ses œuvres, à commencer par La Société du spectacle, son maître livre, a laissé des archives que l’Etat français à intégrées sans aucun mal à ses collections institutionnelles au titre de « trésor national ». Ces paradoxes ne sont qu’apparents : tout ce qui fait système est invulnérable aux initiatives individuelles les plus « antisystèmes », et celui-ci se montre en mesure d'augmenter ses propres forces en faisant siennes jusqu'à la substance et à la dynamique de ses plus féroces opposants.
Cela ne m’empêche pas de saluer bien bas la combativité de Paul Jorion. Je ne sais plus qui (Albert Jacquard ?) a dit : « On ne peut pas changer le monde, mais le peu qu’on peut faire, le tout petit peu qu’on peut faire, il faut le faire ». C’est avoir la foi chevillée au corps. Et j’avoue que je n’aimerais pas voir le jour où Paul Jorion baissera les bras.
Cet homme éclaire le chemin.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, capitalisme, paul jorion, se débarrasser du capitalisme est une question de survie, éditions fayard, jacques ellul, günther anders, pierre bourdieu, daniel schneidermann, arrêt sur image, dupont-aignan, philippe oputou, laurent ruquier, guy debord, debord la société du spectacle
lundi, 24 avril 2017
CHRONIQUES DE PAUL JORION
 1/2
1/2
Dans la vie, il n’y a pas que Saint-Simon, le cardinal de Retz (qui écrit lui-même parfois Rais) et leurs Mémoires. Je viens de lire le dernier livre paru de Paul Jorion. Il aime les titres à rallonge. Après Penser l’économie avec Keynes (billet des 28-29 sept. 2015) et Le Dernier qui s’en va éteint la lumière (billet des 28-29 mars 2016), voici Se Débarrasser du capitalisme est une question de survie. Il y rassemble un assez gros ensemble de chroniques (environ quatre-vingts) parues ici et là – principalement dans Le Monde, de 2008 (les subprimes) à aujourd’hui. Ce qui ressort principalement, une fois le livre refermé, c’est la prodigieuse cohérence du regard que l’auteur porte sur les choses de l’économie (j’excepte les quelques dernières chroniques, de portée plus « morale » ou « philosophique »).
Une chose est sûre : l’économie n’est pas une science. Un ensemble de techniques et de recettes ne suffit pas à faire une science. L'économie est définitivement infoutue de constituer une science, puisqu'il lui manque l'essentiel : la capacité de prédire la survenue d'un phénomène. Les principaux acteurs actuels de l'économie (financiarisée) se foutent pas mal de la réalité, puisqu'ils sont seulement des joueurs, et qu'ils ne font que parier. Pour preuve, les échanges financiers sur les matières premières atteignent à l'occasion quarante fois le volume effectivement produit.
J’étais convaincu de tout cela avant même de connaître les travaux de Paul Jorion, pour la simple raison que les économistes, en même temps qu’ils font de l’économie, font en même temps, qu’ils le veuillent ou non, de la politique, puisque les modèles de systèmes économiques auxquels ils se réfèrent sont aussi, par force, des propositions d’organisation sociale et politique. Il ne saurait y avoir d’économie sans politique (de même, il n'y a pas d'historiens neutres, idem dans d’autres « sciences humaines »), puisqu'elle touche aux intérêts des personnes, donc a quelque chose à voir avec le pouvoir et sa distribution dans la société.
Cette évidence, qui fait l’objet d’une dénégation catégorique de la part des économistes « orthodoxes », amène Jorion à ne jamais écrire "science" économique sans guillemets. On n’est pas étonné non plus de voir l’auteur descendre en flamme, dans sa chronique du 27 septembre 2016, pp. 198-201, le livre de Cahuc et Zylberberg, Le Négationnisme économique (voir mon billet sur ce bouquin infâme au 4 octobre 2016), vulgaires bandits qui osent affirmer que l’économie est une science exacte, à égalité avec les vraies sciences « dures », authentiquement expérimentales, et qui se sert pour cela effrontément du livre de Naomi Oreskes et Erick Conway, Les Marchands de doute (voir billet des 26-27 février 2015). Le culot de Cahuc et Zylberberg consiste à faire faire une pirouette complète à l'argumentation d'Oreskes et Conway pour la retourner comme un gant - magie magie - en leur faveur. C'est à peu de choses près la définition psychiatrique de la perversion.
Jorion dénonce à bon droit l’arrogance des théories dominantes à présenter comme des mesures purement techniques des convictions foncièrement idéologiques, qui reposent en fin de compte sur le postulat que c’est l’homme qui est fait pour (et par) l’économie, et non l’économie qui doit avoir en vue le seul bonheur de l’humanité. Les théories économiques ne peuvent être politiquement neutres, étant par nature porteuses d'idéologie implicite. Le tour de passe-passe consiste à affubler l'idéologie du masque de la technique pure.
C’est sûr que quand Paul Jorion attaque les subtilités techniques de certains instruments économiques, je suis largué. Par exemple, si j’ai bien compris qu’il y a quelque chose de « diabolique », disons de profondément dangereux dans les « Credit Default Swaps » (CDS), mes connaissances en économie sont trop sommaires pour me permettre de remonter tout le fil de l’analyse qui mène à cette conclusion. De même pour ce qui différencie le CDO du CDO synthétique (instrument de dette) et diverses autres notions. Quoi qu'il en soit, je garde intactes les conclusions.
Après une introduction visant à légitimer la publication des chroniques en volume, Jorion répond aux questions de la revue Sciences critiques en 2016. A ce sujet, j’ai dit mon désaccord avec l’auteur (7 avril dernier) en ce qui concerne la façon dont il innocente la technique de ses conséquences désastreuses, refusant de voir en elle autre chose qu’une preuve du génie propre à l’humanité, au motif qu’il ne faut pas confondre l’instrument et l’usage qui en est fait par l’homme. Je réponds que si c'était le cas, cela voudrait dire que l'homme aurait inventé ses outils techniques sans jamais anticiper leurs destinations possibles. A-t-on idée ? C'est fort peu vraisemblable : fabriquerait-on en effet des outils, si l'on n'avait pas déjà une petite idée de ce à quoi ils pourraient servir ? Comme le dit Günther Anders, ce qui peut être fait sera fait. La conception et la fabrication de l'outil est inséparable de son usage, et même de tous ses usages possibles.
Ensuite, Jorion a regroupé ses textes en quatre chapitres, où ils se suivent dans l’ordre chronologique de parution : 1 - Que s’est-il passé ? 2 - Pourquoi cela s’est-il passé ? 3 - Les grands points de faiblesse. 4 - Que faire ? Un « épilogue » clôt l’ouvrage. On ne saurait être plus clair et pédagogique.
L’impression qu’a produite sur moi la lecture de ce livre, c’est que le monde actuel subit l'impitoyable dictature de l’économie. On assiste à la grande compétition de tous contre tous dans laquelle, face à une folle financiarisation qui s’est emballée comme un cheval furieux, le salaire et le salarié sont la seule et unique « variable d’ajustement » qui, si l’on considère le travail comme un « coût » et non comme un investissement ou comme une avance sur la valeur produite, tend à aligner sur les miséreux du Bangladesh (« Sommes-nous assez compétitifs face au Bangladesh ? », chronique du 17 mai 2016, p.253) la rémunération de tous ceux qui, y compris dans les pays « riches », ne possèdent que leur force de travail.
Globalement, le monde est moins pauvre, mais nous n’avons pas fini de voir exploser chez nous le nombre des pauvres. Les optimistes refusent de voir l'essentiel et de désigner les vrais responsables (huit individus possédant autant que la moitié pauvre de l'humanité), et font diversion en appelant ça "rééquilibrage", ajoutant à l'occasion "la roue tourne" ou "ce n'est que justice".
Ils refusent de voir à qui le crime profite, et profitera de plus en plus.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, politique, science économique, paul jorion, penser l'économie avec keynes, jorion le dernier qui s'en va éteint la lumière, se débarrasser du capitalisme est une question de surviebarrasse, john maynard keynes, journal le monde, crise des suprimes, cahuc et zylberberg, le négationnisme économique, naomi oreskes, erick conway, oreskes les marchands de doute, credit default swaps, cds
mardi, 04 octobre 2016
CAHUC ET ZYLBERBERG, OU ...
… OU LE BANDITISME ÉCONOMIQUE
Un certain Cahuc et un certain Zylberberg, deux économistes paraît-il, ont joint leurs fanatismes doctrinaires pour confectionner Le Négationnisme économique, un titre qui illustre à merveille un ouvrage déjà ancien de Viviane Forrester (L’Horreur économique, qui dénonçait les méfaits et la folie de l'économie ultralibérale, dont nos deux auteurs sont, comme bien on pense, de fervents thuriféraires), en même temps que l’imposture arrogante qui habite tout le courant des économistes faussaires, dont les théories tiennent aujourd’hui le haut du pavé dans les universités du monde entier, particulièrement aux Etats-Unis, et qui font régner leur ordre militaire dans la pensée économique. Le Négationnisme économique, de Cahuc et Zylberberg ? Un vrai Coran, une authentique Charia, une fatwa véritable, édictée par deux ayatollahs enragés.
Des faussaires qui, détenant le pouvoir et dictant leur Vérité au monde, ont l’incroyable culot de se présenter comme les victimes des contestataires qu'ils persécutent (les « économistes atterrés », par exemple, ou Paul Jorion, dont ils ont eu la peau à l’université libre de Bruxelles), parce que ceux-ci ont le toupet de mettre en doute le bien-fondé de la doxa ultralibérale, celle même qui conduit les peuples de l’Europe à leur perte (voir le traitement infligé à la Grèce).
Je ne lirai pas le livre de Pierre Cahuc et André Zylberberg. Il me suffit d’avoir entendu le premier, invité l’autre jour sur une antenne du service public, débiter longuement ses certitudes en acier trempé, pour être dissuadé d’en faire la dépense.
Autant le dire d’entrée : l’insupportable klaxon publicitaire que les auteurs ont placé dans ce titre (le mot « négationnisme », qui claque aussi fort au vent médiatique que « crime contre l'humanité ») dénonce à lui seul leur volonté de frapper l’opinion publique à l’estomac (comme jadis la littérature, sous la plume de Julien Gracq). Vous dites « négationnisme » ? « Position idéologique qui consiste à nier l’existence des chambres à gaz utilisées par les nazis dans les camps d’extermination » (Grand Robert 2001, qui fait apparaître le mot en 1990, sans doute au moment de la loi criminalisant la chose, je n'ai pas vérifié). Une transposition brutale du terme de l'univers de l'extermination nazie dans le domaine de l'économie ordinaire, voilà la première imposture.
La deuxième, dans les propos du sieur Cahuc, consiste à se placer sous l’égide protectrice du formidable livre de Naomi Oreskes et Patrick Conway, Les Marchands de doute (j’en ai parlé ici), et d'amalgamer les économistes hétérodoxes aux industriels du tabac, qui soudoyaient des scientifiques peu regardants pour nier « scientifiquement » les risques que la substance fait courir à ses usagers. Comme si les "économistes atterrés" avaient les mêmes intentions inavouables, les mêmes prétentions, mais surtout les mêmes moyens financiers de pression que les Philippe Morris et consort.
La troisième et plus grosse imposture, celle qui disqualifie toute la démarche des deux auteurs, c’est quand Cahuc soutient mordicus que le premier tort des « atterrés » et de toute cette engeance est de présenter la science économique comme une simple « science humaine » (ce que la ’pataphysique qualifie de « science inexacte »), et non comme une « science dure », ce qu’elle est indubitablement, selon lui.
Alors comme ça, monsieur Cahuc, l’économie serait une science exacte ? Une « science expérimentale » ? Avec protocole expérimental en double aveugle et tout le toutim ? C’est évidemment se foutre du monde, monsieur Cahuc. Et pour une raison simple : les sciences exactes ont une particularité, celle d’être capables de prédire ce qui va se produire, c’est-à-dire, si possible, avant que cela se soit produit.
Alors monsieur Cahuc, puisque vous êtes si fort, allez-y ! Allez-y donc ! Prédisez ! J’attends. Mais je peux toujours attendre. Combien de vos semblables ont prédit dès 2007 la « crise des subprimes » ? Je peux citer deux noms : Paul Jorion et Nouriel Roubini, qui, en se contentant d'observer les mécanismes à l'oeuvre dans le marché immobilier américain, et en disposant exactement des mêmes données que tout le monde (mais sans doute en les sélectionnant différemment), ont annoncé la catastrophe. Il y en a sans doute d’autres qui ont alors vu juste. En revanche, la crise de 2008 est tombée brutalement sur la tête de tous les autres savants « économistes orthodoxes », vous savez, ceux pour lesquels vous militez avec tant d’assurance, monsieur Cahuc.
Conclusion : les économistes « orthodoxes » sont aveugles, sourds, paralytiques (et malheureusement pas muets) et ne sont capables d’expliquer les phénomènes que le lendemain de leur survenue. Les économistes orthodoxes sont de vulgaires idéologues, donc des propagandistes. Comme l’écrit Bernard Maris dans Houellebecq économiste : « L’économiste est celui qui est toujours capable d’expliquer ex post pourquoi il s’est, une fois de plus, trompé ». Ajoutant : « Discipline qui, de science n’eut que le nom, et de rationalité que ses contradictions, l’économie se révélera l’incroyable charlatanerie idéologique qui fut aussi la morale d’un temps ». Et ce n’est pas moi qui le dis, c’est un orfèvre en la matière. Assassiné un certain 7 janvier.
Prétendre que l’économie est une science exacte est un énorme bluff, pour la raison simple qu’il n’y a pas d’économie sans choix et décisions politiques, et que les événements politiques sont éminemment imprévisibles et imprédictibles. En fait de « négationnisme économique », Cahuc et Zylberberg en connaissent un fameux rayon de bicyclette, et leur ouvrage est une éclatante et exacte illustration de la perversion qu’ils dénoncent. Le négationnisme ici est de nier qu'il y ait une once de politique dans l'économie.
Contre ce banditisme économique, le verdict d’Ubu est sans appel : « A la trappe, Cahuc, Zylberberg et leurs complices ! ». Il n'y a pas de controverse : c'est une guerre.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : je viens d'entendre, sur la même radio de service public, un certain Jean-Marc Daniel, adepte lui aussi de la scientificité de l'économie. Il a une comparaison résolument - involontairement - comique, faisant de l'économie une science analogue à la géologie, qui est classée parmi les sciences dures. Au prétexte que les géologues connaissent les sols, leur nature et leurs caractéristiques dans leurs moindres détails, en largeur et dans la profondeur, mais sont incapables de prédire la date du « Big One » qui anéantira la Californie, dit-il. Pareil pour l'économie. Cette objection, qui semble solide comme un roc, est encore un énorme bluff. Les économistes, à commencer par les ultralibéraux, sont d'invétérés joueurs de poker.
Car les géologues savent qu'ils sont dans la science dure tant qu'ils analysent de la matière inerte (de la matière morte si l'on veut, comme dans la médecine légale), mais ils refusent comme des ânes butés d'annoncer le moment exact d'événements futurs (séismes, éruptions, etc.), comme aucun médecin ne se hasarderait à dire à quelle date et à quelle heure le malade mourra. Le médecin ne décèle les causes de la mort que quand elle s'est produite. Encore une fois, la raison de cette timidité est d'une simplicité et d'une justesse angéliques : les géologues reconnaissent bien volontiers qu'ils sont incapables de prédire des dates de séismes parce qu'ils savent (et disent) qu'ils ne savent pas tout. Ils ne disposent pas de l'intégralité des données qui leur permettraient une telle prédiction, qui perdrait alors son caractère prophétique pour devenir une prévision, comme on peut affirmer que l'eau portée à 100°C entrera en ébullition (au niveau de la mer).
Pour prédire un événement ou un phénomène, il faut disposer en effet de TOUTES les données (d'où la rigueur des protocoles en double aveugle), et les géologues reconnaissent bien volontiers qu'ils n'auront jamais en main la TOTALITÉ des données nécessaires pour les autoriser à prévoir les résultats des mouvements qui agitent en permanence notre planète vivante, tant que celle-ci sera vivante. De même, les spécialistes d'astrophysique se gardent d'exprimer des certitudes : ils en sont à chercher des preuves de vie sur des exoplanètes dont l'essentiel leur échappe. Quand les économistes se décideront-ils à présenter des preuves ? Le jour des calendes grecques, sachant que dans le calendrier grec, il n'y a pas de calendes. Si l'humanité reste humaine, si la planète humaine reste vivante, les économistes ne disposeront JAMAIS de la totalité des données qui leur donnerait la clé de l'avenir. Car Monseigneur le Temps et son Altesse la Vie leur échappent.
Quand les économistes orthodoxes accepteront-ils de reconnaître qu'ils ne disposent pas d'assez de données pour faire de leur domaine une science exacte ? L'économie ne sera jamais une science exacte : tant qu'il y aura de l'humain, il y aura du politique dans l'économique, éternellement inséparables. Éternellement imprévisibles. La vie n'est pas scientifique.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, économistes, pierre cahuc, andré zylberberg, le négationnisme économique, viviane forrester l'horreur économique, économistes atterrés, paul jorion, négationnisme, naomi oreskes, patrick conway, les marchands de doute, philippe morris tabac, nouriel roubini, bernard maris, houellebecq économiste, jean-marc daniel, france culture, ubu, à la trappe, michel houellebecq
mardi, 29 mars 2016
LE DERNIER PAUL JORION
 2
2
Résumé : je disais que je n’avais rien contre la formule « fascisme de l’économie », que je crois bien avoir entendu Paul Jorion prononcer dans un de ses billets « Le temps qu’il fait » du vendredi.
Je n’ai rien contre cette vision des choses : depuis quelques années maintenant, la religion (terrorisme, islam, djihad, attentats, Daech) et l’économie (chômage, entreprise, partenaires sociaux, MEDEF, Code du travail, etc.), en envahissant les journaux écrits ou télévisés, nous empestent, nous empoisonnent, nous asphyxient, nous assiègent et nous font subir un harcèlement moral et idéologique de tous les instants. Qu'est-ce que c'est, aujourd'hui, que notre vie ? Les médias nous bombardent de ce qu'elle n'est pas, comme s'ils voulaient nous en déposséder.
Comme si le diamètre de l'image du monde qui nous parvient par le canal des médias s'était rétrécie, étriquée, rabougrie. Comme si l'on était conduit par nos moyens d'information à "zoomer" sur une minuscule partie du monde, en occultant d'énormes et multiformes pans de la réalité (disons, presque tout le reste). Qu’est-ce qui s’est passé pour que ces thèmes soient devenus à ce point obsessionnels (au sens étymologique : "assiégeants") ? D'accord avec Jorion, donc.
Mais là où je n’arrive plus à suivre l’auteur dans ses pérégrinations intellectuelles ou philosophiques, c’est quand il consacre tout un chapitre à la démonstration du caractère totalement illusoire de ces piliers de civilisation que sont pour nous l’intention et la volonté dans la préparation de l’action (politique ou autre), puis tout un autre chapitre à la démonstration que nous avons eu tort de donner une telle place à la raison, qui ne mérite aucunement une telle confiance.
Bien sûr, Freud et la psychanalyse nous ont appris que nos intentions, notre volonté, nos décisions sont largement tributaires des forces chaotiques qui font semblant de dormir dans notre inconscient et en réalité orientent indéniablement nos trajectoires ; bien sûr, nous sommes à même aujourd’hui de mesurer l’ampleur des dégâts que peut entraîner la raison quand on lui laisse la bride sur le cou et qu’on lui fait une confiance aveugle. Comme le dit Hermann Broch, il nous restera toujours sur les bras un « résidu irrationnel » : autant s’en accommoder.
Ces deux chapitres, quoi qu’il en soit, me semblent soit enfoncer des portes ouvertes, soit tomber à côté de la plaque. Le problème, avec l'idée que l'intention, la volonté, la raison sont de pures illusions, c'est qu'elles font partie intégrante du socle sur lequel toute la civilisation est bâtie. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire, de cette civilisation fondée sur du vent ? Le dernier chapitre tente de répondre : laissons les choses aller à leur terme. Là, Paul Jorion laisse libre cours à l’anticipation et, disons-le, à l'imagination. On sait que Michel Houellebecq, dans La Possibilité d’une île, place tout son espoir dans le clonage humain pour voir enfin l’espèce humaine accéder à une forme d’immortalité.
C’est d’une façon différente, quoique cousine, que Jorion envisage sans trop se formaliser la perspective d’une telle immortalité, mais lui, il l'imagine à partir du « grand remplacement » du genre humain par des robots si intelligents que ce sont eux, et non plus les hommes, qui se reproduiront et qui liront et apprécieront Shakespeare et porteront la culture. Dans la foulée, et sans regrets exagérés (au moins en apparence), il se prépare à faire, pour son compte, le « deuil du genre humain ». Vous l'imaginez, la Terre débarrassée de toute présence humaine, et mais dont la surface grouillerait de machines perpétuant à jamais, en la mimant, l'espèce humaine ? J'ai un peu de mal à le concevoir.
Je n’ai rien contre le noir pessimisme que suppose une telle perspective : peu ou prou, comme disent les Dupondt : « C’est mon opinion et je la partage ». Je ne vois pas quelle force pourrait s'opposer au ratiboisage programmé de la surface de la planète.

Quant aux machines et aux robots, faudra-t-il se résoudre à les "aimer", comme le soutient un auteur cité par Paul Jorion ? Mais alors, c’est toute la démarche du bouquin qui pose question : à quoi bon s’emberlificoter les boyaux de la tête avec des rafales de Nietzsche, de Hegel et de quelques autres (j'ai d'ailleurs du mal à faire le lien entre toutes les références, qui vont de l'encyclique "Laudato si'" du pape François au Sophocle d’Œdipe à Colone, en passant par Alain Supiot et plusieurs œuvres précédentes de l'auteur lui-même), si c’est pour retomber sur cette évidence : ce sont les passions qui conduisent les hommes ? Ça, on le savait déjà, monsieur Jorion.
Je ne suis pas sûr que votre livre, en faisant ainsi table rase, éclaircisse quoi que ce soit. Je ne veux pas dire qu'on y attendrait des propositions ouvrant sur un horizon : l'affaire est entendue.
Toutefois, si le procès est clos, la sentence n'est pas encore rendue. Paul Jorion pense que si : dans ces conditions, je lui demanderais volontiers comment il fait pour tenir.
Voilà ce que je dis, moi.
Notes :
1 – Paul Jorion cite, à la toute fin de son livre, celui de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer (commenté ici du 22 au 24 juin 2015) : « les auteurs ont rassemblé, comme ils le soulignent – et à la différence de leurs prédécesseurs – les preuves de l'effondrement, non pas dans un domaine spécifique, correspondant dans la plupart des cas à la sphère d'investigation d'une discipline ou d'une sous-discipline, mais dans l'ensemble des domaines où des effets se conjuguent pour sceller l'extinction de notre espèce » (p.266).
J'avais en effet été frappé par l'accumulation des signes indubitables d'un affolement planétaire : tout ce qui était de l’ordre du constat apparaissait irréfutable et effrayant. Mais j'étais resté médusé devant la niaiserie de la "solution" que les auteurs proposaient, que je résumerais par le slogan : "Il faut changer les mentalités", – solution inopérante, puisque purement incantatoire, inspirée des travaux des psychosociologues, vous savez, tous les « spécialistes » qui travaillent d’arrache-pied à l’amélioration constante des techniques de conditionnement des esprits et de manipulation des foules. Jorion relève la même faiblesse en citant la phrase : « Il est temps de passer à l'âge adulte » (p.267), qui atteint, disons-le moins gentiment que lui, le comble de la courgerie radieuse.
2 – Quelques remarques : a) Paul Jorion, p.61, parle des générations futures, et du peu de considérations dont elles sont l’objet de la part des plus anciennes. Je répondrai deux choses. La première est une citation que je crois empruntée à Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas la Terre de nos parents : nous l’empruntons à nos enfants ». Autrement dit, ce souci ne date pas d’hier. La seconde est la suivante : j’espère que le souci de la préservation de la planète n’a pas besoin de penser aux générations futures pour s’exercer, et que soi-même dans le présent (dans l’urgence de sa propre préservation) est en soi une raison pour refuser certaines conditions inacceptables qui sont faites à l’être humain. L'appel à l'argument "générations futures" est purement rhétorique.
b) On trouve p.42 cette phrase : « Nous avons été incapables, en des dizaines de milliers d’années, de nous débarrasser de la guerre». Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que les paléontologues font remonter les premières guerres à l’époque où l’homme a inventé, pour succéder à l’existence précaire de chasseur-cueilleur, la sédentarité, le regroupement en unités humaines plus vastes, l’élevage et l’agriculture, c’est-à-dire à l’âge du néolithique, peu ou prou dix mille ans avant nous. Pas tellement plus : dix ou douze mille ans de guerres, ce n’est déjà pas mal.
c) Carrément anecdotique : « La raison est en fait, toujours selon Nietzsche, l’ultime "deus ex machina", l’artifice dérisoire d’un dieu sorti de nulle part, si ce n’est de la plate-forme actionnée par des poulies qui le fait descendre de l’architrave sur la scène ». Sauf erreur ou ignorance de ma part, on ne trouve pas d’architrave dans un théâtre : à la rigueur ce qu’on appelle les « cintres » ?
lundi, 28 mars 2016
LE DERNIER PAUL JORION
 1
1
Je viens de refermer le dernier livre de Paul Jorion, Le Dernier qui s’en va éteint la lumière, qui vient de paraître (Fayard). J’ai beaucoup de respect pour cet anthropologue qui a un temps travaillé dans la finance, un des très rares « spécialistes » (avec, entre autres, Nouriel Roubini) à avoir, avant le krach, jugé délirant le fonctionnement du système des prêts à taux variables aux Etats-Unis (mais aussi de la titrisation de la dette et autres innovations innovantes), et prévu que tout ça ne pouvait que mal finir - ce qui n'a pas manqué d'arriver, prouvant ainsi qu'un tout petit nombre d'économistes examine les faits de façon assez méthodique pour les comprendre et voir où ils nous mènent, alors que le grand troupeau des professionnels de l'économie sont dans l'idéologie régnante la plus exubérante, la plus frivole et la plus péremptoire.
Ce contre quoi se bat Paul Jorion (feu Bernard Maris était du même avis), c’est la prétention d’une pléiade d’économistes (Pierre Cahuc est le dernier Trissotin - ah l'inénarrable et comminatoire : « Lisez les revues académiques, jeune homme ! » -, et Philippe Aghion le dernier Diafoirus - ah, la « destruction créatrice » de Hayek, servie sur un plateau - que j’ai entendus dégoiser leurs gandoises et leurs gognandises [comme on disait à Lyon] dans mes oreilles) à s’affirmer détenteurs d’une « science » qu’ils s’efforcent de présenter comme « exacte », à égalité avec des sciences "dures" comme la chimie ou l'astrophysique. Il faut les traiter pour ce qu’ils sont : de gros menteurs.
Les théories visant à présenter l’économie comme exclusivement constituée de techniques et de mécanismes objectifs sont des fumisteries, des filouteries : la grande truanderie. Bien sûr qu'il y a des mécanismes, des techniques, mais il n’y a pas d’économie sans politique, pour la simple raison qu’il n’existe pas de rapports économiques qui ne soient, en même temps, et par le fait même, des rapports de force. Le mensonge commence aussitôt que l'on présente l'économie comme une machine : non, l'économie n'est pas une machine, et ceux qui en promeuvent la modélisation mathématique sont des salopards.
Le pire, c’est que ce sont eux qui règnent sans partage sur l'esprit des gouvernants et sur l’enseignement de l’économie, que ce sont eux qui endoctrinent les étudiants des filières économiques, futurs banquiers et décideurs, qu’ils trustent les « prix simili-Nobel » (en réalité : « prix de la Banque de Suède », créé dans les années 1960, puisqu’il n’y a que cinq authentiques « prix Nobel »), bref : c’est eux qui détiennent le pouvoir.
Paul Jorion fait ce qu’il peut pour s’opposer à ce pouvoir. A ses dépens, comme le montre sa récente éviction du poste d’enseignement qu’il occupait à la Frije Universiteit Brussel. Les adeptes de l’économie « scientifique » surveillent leurs plates-bandes comme le lait sur le feu. Ils n’aiment pas voir de petits pillandres (à Lyon, c’est ainsi qu’on désignait les vauriens, dans les autrefois) venir les piétiner.
J’attendais beaucoup de la lecture de Le Dernier qui s’en va éteint la lumière. A cause, entre autres, de son sous-titre : « Essai sur l’extinction de l’humanité ». Je suis désolé de dire que j’ai dû déchanter. Remarquez que si j’avais commencé par lire la table des matières, ça m’aurait mis la puce à l’oreille.
Commençons par reconnaître la parfaite pertinence de tout ce que l’auteur reprend des idées qu’il défend mordicus depuis des années, selon lesquelles les dérives pathologiques du capitalisme, et en particulier de la finance, mènent le monde – alors là on a le choix : dans le mur, dans une impasse, vers le précipice, à l’abîme, etc. Les habitués du blog de Paul Jorion se retrouveront en pays connu, tout au moins jusqu’à la fin du surdimensionné deuxième chapitre (un tiers du total), intitulé « Pourquoi nous ne réagissons pas ». C’est ensuite que ça se gâte.
Le livre démarre de façon curieuse. L’auteur affirme en effet ceci : « Mon objectif, ici, n’est pas de convaincre que le genre humain est menacé d’extinction : je considère la chose comme acquise » (p.47). Personnellement, j’aurais aimé un minimum de précisions sur la chose. Ayant construit son raisonnement sur cette base, il clôt son livre au cinquième et dernier chapitre, sur une interrogation : « Faire le deuil du genre humain ? ». Mais ce ne sont ni le point de départ ni le point d’arrivée qui me chiffonnent. Ce sont les considérations qui accompagnent le cheminement de l’auteur, dont je me demande ce qu’elles viennent faire ici.
Autant je suis prêt à suivre Paul Jorion dans tout ce qu’il dit de l’économie, de la finance folle, et du sombre avenir qui, par leur action destructrice, attend l’humanité, autant sa visite dans les arrière-boutiques intellectuelles de notre civilisation me semble taper à côté de la cible. Je me trompe peut-être du tout au tout. Je n'y peux rien, c'est le sentiment que j'ai éprouvé à la lecture. Je me disais : ma parole, dans quelle galère s'embarque-t-il ?
Je suis d’accord pour dénoncer le règne actuel de l’économie toute-puissante, ainsi que l’infernale compétition qu’elle entraîne entre les nations (pour la domination ou la simple survie ou, comme la France, contre le déclassement). D’accord aussi pour voir là une forme de dictature, voire quelque chose de totalitaire. Il me semble avoir entendu Paul Jorion lui-même prononcer l’expression « fascisme de l’économie ».
« Fascisme de l’économie » ne me semble pas une formule exagérée.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul jorion, économie, nouriel roubini, le dernier qui s'en va éteint la lumière, bernard maris, pierre cahuc, philippe aghion, trissotin, diafoirus, friedrich von hayek, prix nobel d'économie, prix d'économie de la banque de suède, lyon, france, société, politique
mardi, 29 septembre 2015
KEYNES LU PAR PAUL JORION
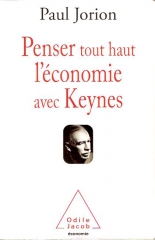 2/2
2/2
Le deuxième point (chapitre 15 et préc.) concerne la fixation des prix. L’auteur analyse jusque dans le détail les diverses hypothèses formulées par divers théoriciens de l’économie, soulignant que le problème est plus complexe qu’on ne le présente généralement, et qu’il n’y a pas qu’un seul mécanisme qui entre en ligne de compte. Je retiens un point essentiel (je crois) de cette analyse : le prix d’un bien ou d’un service ne dépend pas seulement de la « loi de l’offre et de la demande » (qui est tout sauf une loi), car un autre facteur intervient : le « rapport de force » (chapitre 14).
Il analyse longuement le statut et les implications du CDS (Credit-Default Swap) : il s’agit pour le prêteur d’une manière de s’assurer contre les « événements de crédit » et contre les éventuels « non-versements d’intérêts ». C’est un « instrument de dette », qui peut être échangé et qui dès lors, j’imagine, suit une cote. Interviennent alors, comme dans les assurances, les statistiques et le calcul des probabilités dans la fixation du taux d’intérêt et de la prime de crédit.
Il y a des choses, dans ce chapitre, qui m’échappent carrément, du genre : « Je n’ai encore évoqué jusqu’ici que la fonctionnalité a priori légitime du credit-default swap de constituer un marché de la prime de crédit implicite au taux d’intérêt d’un instrument de dette considérée comme un produit financier autonome » (p.231). Débrouillez-vous. Une carence lexicale doublée d’une carence syntaxique, je suppose. Je retiens seulement que plus le risque augmente, plus diminue la perception de ce risque par les acteurs du marché. J’imagine que cette infirmité est liée à la perspective de se gaver bientôt. Je verrais bien comme une table de jeu avec ses parieurs fiévreux autour.
A ce sujet, j’aime assez l’humour de Paul Jorion : quand il se met à expliquer ce qu’il considère comme l’ « usine à gaz » que Keynes a nichée au cœur de son maître-livre (Théorie générale …), il lance : « Le lecteur s’en sera déjà convaincu s’il est parvenu jusqu’ici dans sa lecture » (p.251, je souligne).
Tout ça pour dire que ce qu’on appelle complaisamment le « keynésianisme » ne constitue, aux yeux de l’auteur, que « la partie morte » de l’œuvre de Keynes, qui n’a, au demeurant, pas été écrite par lui mais par un nommé Hicks, dans un souci de simplification avalisé par le maître, qui voyait là l’occasion d’élargir son public.
Keynes était farouchement opposé à l’adossement de quelque monnaie que ce soit à quelque métal précieux que ce soit (étalon-or), et favorable à la « commodity money », que Jorion traduit par « monnaie marchandise ». Il appelait à la fondation d’une « Union monétaire internationale » (qui a inspiré la position britannique lors des négociations de Bretton Woods). L’auteur cite le biographe de Keynes, Skidelski : « Si les propositions de Keynes en 1919 avaient été appliquées, il est improbable que Hitler serait devenu chancelier allemand » (p.272). On dira : "avec des si ...". Certes, mais.
Keynes, adepte de longue date du plein emploi (facteur de cohésion sociale) avertissait par ailleurs de la menace représentée par le chômage structurel, provoqué par les innovations technologiques. N’ai-je pas entendu récemment un économiste (Daniel Cohen) s’alarmer de la numérisation tous azimuts des tâches dans l’entreprise, au motif qu'elle « détruit les organisations ». Il résumait la pensée d’un de ces fanatiques de la numérisation à outrance en lui faisant dire que, si par hasard il faisait la même chose deux jours de suite, il fallait impérativement qu’il invente le logiciel qui supprimerait son propre poste de travail. On n’a pas fini d’inventorier les dégâts et merveilles d’une telle façon de concevoir le travail humain.
Pour conclure, je suis incapable de dire si ce livre permettra de refonder une « science économique » authentiquement digne du nom de « science », c’est-à-dire débarrassée de tous les oripeaux dogmatiques dont l’ont farcie les idéologues de l’ultralibéralisme « décomplexé ». Visiblement, ce n’est pas gagné. J’entendais encore ce matin (27/09) un certain Bujon de l’Estang s’efforcer, sur un ton pontifiant, docte et péremptoire, de ridiculiser les illuminés qui persistent à voir dans l’économie une « science molle », ce qu’elle est pourtant, très précisément, puisqu'elle n'a aucune capacité prédictive.
Paul Jorion n’est certainement pas un prophète. Tout au plus y a-t-il de l’utopie dans sa démarche : ce que remettent en question ses observations, ce n’est rien d’autre qu’un système, autrement dit un énorme ensemble infiniment complexe d'acteurs et de facteurs organisés par des relations de solidarité : on ne fait pas bouger un tel ensemble avec le dos de la cuiller. Le rapport des forces en présence est incommensurable. Paul Jorion est un petit Poucet. Rien que la façon dont est enseignée l’économie dans les écoles et universités aurait de quoi rendre pessimiste : Jorion ne vient-il pas de se faire jeter, pour des motifs obscurs, de la chaire qu’il occupait à la « Vrije Universiteit Brussel » ?
Je signale que la plupart des « prix de la banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel », décerné pour la première fois en 1969 (appellation faite pour susciter l’imposture du raccourci « prix Nobel d’économie ») ont été attribués, pour la plupart, à des idéologues de l’économie ultralibérale, dont les théories encombrent tous les manuels scolaires. C’est David contre Goliath.
Cela me fait penser à ces journalistes égarés qui parlent des « lobbies écologistes » qui agissent en sous-main à Bruxelles, et qui font semblant d’oublier que les quelques actions vertes en direction des institutions européennes pèsent d’un ridicule poids financier, idéologique et communicationnel face aux vrais poids lourds de toutes les influences stratégiques des grands groupes transnationaux, qui financent massivement des « think tanks » pour qu’ils produisent ad nauseam des argumentaires calibrés au quart de poil pour impressionner et enfumer les "staffs" qui entourent ceux qui signent les décisions (pardon pour la longueur de phrase).
Paul Jorion a sans doute raison. Certes, je ne suis pas en mesure de juger, mais quand je vois la mafia des économistes « officiels » se liguer contre « le premier qui dit la vérité » (Guy Béart), je n’hésite pas à lui accorder crédit. Là où il se trompe peut-être, c'est quand il pense qu'on pourrait sauver la situation. Je pose la question : peut-on croire que du travail reviendra en France ? Franchement, j'en doute.
Je n'ai pas tout compris à son livre. J'en ai pris ce que j'ai pu ou cru comprendre. Bien que je sois assez pessimiste sur ce que l'avenir nous réserve, je lance à Paul Jorion cet appel : « Tenez bon ! ».
Voilà ce que je dis, moi.
lundi, 28 septembre 2015
KEYNES LU PAR PAUL JORION
Paul Jorion s'est appuyé les trente volumes des œuvres de John Maynard Keynes pour en avoir le cœur net sur les théories de cet économiste célébrissime. Cela a donné ce livre.
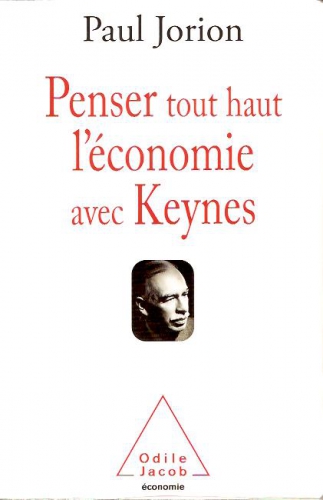 1/2
1/2
Penser tout haut l’économie avec Keynes (Odile Jacob, septembre 2015).
Paul Jorion est aujourd’hui connu pour être l’un des très rares spécialistes de la pensée économique à avoir prédit, dès 2004, la désormais célèbre « crise des subprimes ». Je viens de lire son dernier bouquin : Penser tout haut l’économie avec Keynes.
Il paraît que le titre (compliqué : je ne comprends pas « penser tout haut ») prévu par l’auteur a été modifié par l’éditeur. Quoi qu’il en soit, c’est un livre passionnant, mais difficile pour qui n’a pas fait des études d’économie et, en l’espèce, d’économie financière. C’est mon cas. Et je redis que je déteste, dans n’importe quelle discipline du savoir, le spécialiste qui jargonne dans le seul but d’intimider le public ou le lecteur.
Ce n’est pas le cas de Paul Jorion, qui sait s’exprimer en français vulgaire (au sens latin), et dont j’apprécie le blog, en particulier, tous les vendredis, la vidéo astucieusement intitulée « Le temps qu’il fait ». C’est sur sa recommandation que j’ai lu récemment La Gouvernance par les nombres, d’Alain Supiot (voir ici même, 9 et 10 septembre), lecture importante que je me félicite d’avoir faite et que je le remercie d'avoir suggérée.
L’avantage décisif de Paul Jorion sur les économistes, c’est qu’il n’est pas économiste. Au départ, il est « anthropologue de l’économie », et c’est en tant que tel qu’il examine l’économie. Il est probable que s’il avait été élevé dans le sérail, il ne serait pas devenu le trublion de cette pseudo-science, le poil à gratter, ou le caillou dans la chaussure des tenants officiels de la « science » économique (systématiquement orthographiée entre guillemets, pour bien marquer ce qu’il en pense).
L’objectif de l’auteur, dans son livre sur Keynes, est double : 1) aller fouiller dans les œuvres du célèbre économiste (et dans diverses autres sources), pour exposer exactement dans ses détails et ses fondements la théorie qu’il a élaborée, et que thuriféraires et adversaires actuels font semblant de bien connaître ; 2) poser les bases d’une théorie enfin débarrassée des doctrines scientistes qui constituent aujourd’hui l’essentiel de l’économie qu’on enseigne dans les écoles et universités, et qui n’est rien d’autre qu’une idéologie dogmatique au service des puissants.
Pour résumer : qu’on en finisse avec un mythe « keynésien » que tout le monde brandit à tort et à travers comme étendard ou comme épouvantail (suivant qu’on est « de gauche » ou « de droite »), et puis qu’on arrive à entrevoir la possibilité de refonder la « science » économique sur le socle dont elle n’aurait jamais dû descendre : la politique.
Toute l'imposture de la prétendue « science » économique est dans l'escamotage de toute considération politique dans ses corps de doctrine, et dans son auto-promotion au même rang que les "sciences exactes" : du fond des éprouvettes de son laboratoire, elle prétend se contenter de décrire des phénomènes d'ordre mécanique. Plus le mensonge est gros, plus ça passe.
Jorion le dit bien dans une petite vidéo : pour Keynes, il n’y a pas de solution économique à un problème économique : affirmation magnifique ! Il ne cesse de dénoncer le passage prestidigitalesque de l' « Economie Politique » à la « science » économique, aux alentours de 1870, une « science » qui, fondée sur les mathématiques et le calcul différentiel, emmène le monde à sa perte tout en promettant le paradis. C’est la grande qualité de Keynes, qu’il souligne a contrario, de n’avoir jamais perdu de vue que ce n’est pas la société qui est faite pour l’économie, mais l’inverse.
Son objectif, dans ses recherches théoriques, a toujours consisté (Jorion ne cesse de le rappeler) à viser, sinon le consensus total, du moins le plus petit « dissensus » possible. L’idée semble tout à fait raisonnable et équilibrée : que l’on s’entende sur une façon de vivre ensemble (ah, « le vivrensemble » !) en limitant au maximum les occasions des inévitables oppositions et divisions. La philosophie économique de Keynes est d’inspiration humaniste, et l’auteur la fait visiblement sienne.
Paul Jorion n’est pas fasciné par le personnage, dont il analyse froidement aussi bien les traits de génie que les bourdes. Il analyse dans l'ordre les ouvrages de Keynes, soulignant les trouvailles les plus marquantes, retraçant les grandes étapes de son parcours intellectuel (et social : quand il est mort, il avait accumulé une fortune considérable), depuis ses études à Eton puis Cambridge et le groupe « Bloomsbury » où il évoluait, jusqu’à son grand œuvre : la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936). A noter que Keynes avait dénoncé dès 1919, dans Les Conséquences économiques de la paix, les catastrophes qui devaient découler des conditions revanchardes faites à l’Allemagne après sa défaite. Mais Cassandre aussi prophétisait dans le désert.
Je ne vais pas tenter de résumer le livre de Paul Jorion, de toute façon ce serait raté. Je me contenterai d’évoquer quelques points de ce que je crois avoir compris : la difficulté rencontrée à la lecture semble moins liée à un jargon prétentieux qu’à l’extrême technicité (bien qu’il s’en défende : « Précisons, quitte à être un peu technique dans notre explication … » p.225) de considérations mettant en jeu des notions qui me sont tout sauf familières. Les deux thèmes principaux abordés par l’auteur, situés dans la deuxième partie (consacrée à la Théorie générale …, le grand livre de Keynes), essaient d’élucider, en se débarrassant des préjugés et dogmes en vigueur, comment sont fixés, d’une part les taux d’intérêt, d’autre part les prix.
Le premier point figure au chapitre 12 : « Keynes et le mystère du taux d’intérêt ». Comment se fixent les taux d’intérêt ? Pour parler franchement, je n’en sais rien. Pour parler plus franchement, ce que j’en sais tient à un slogan publicitaire d’il y a longtemps : « Votre argent m’intéresse ». Intuitivement, j’avais tendance à ajouter : « Parce qu’il me permet d’en gagner encore plus ». L’intuition m’indique que, si quelqu’un a de l’argent à me prêter, c’est qu’à la sortie, il ne sera pas appauvri.
L’analyse que fait Paul Jorion de ce « mécanisme » est infiniment trop subtile pour moi, dans un domaine dont j’ignore à peu près tout. Ce que je crois pouvoir retenir de ce chapitre, c’est que le prêteur s’approprie quelque chose à quoi, en toute justice, il n’a pas droit. Ensuite, que l’auteur dénonce l’imposture de Keynes qui, par un tour de passe-passe, donne soudain la priorité à la « préférence pour la liquidité » sur l’ « efficacité marginale du capital », tout cela ne me parle guère. Il explique quand même que Keynes, qui « se défendait contre les implications révolutionnaires de ses propres théories » (p.189), délaissait « une explication matérialiste au bénéfice d’une explication idéaliste » (p.190). Passez muscade.
Ce que je crois pouvoir retenir, c’est que Paul Jorion critique ici le théoricien, au motif qu’il truque lui-même sa théorie, et très sciemment, probablement en fonction de ses propres intérêts (de spéculateur avisé). Car jusque-là, il déroulait sa théorie selon une logique imperturbable.
Je ne m’étendrai pas.
Voilà ce que je dis, moi.
vendredi, 04 septembre 2015
PIKETTY ET LE CAPITALISME 2
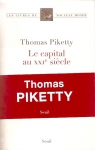 MES LECTURES DE PLAGE 4
MES LECTURES DE PLAGE 4
THOMAS PIKETTY : LE CAPITAL AU XXI° SIÈCLE
2/2
J’avais commencé à évoquer Le Capital au 21ème siècle, très gros ouvrage de Thomas Piketty, en terminant sur la courbe exponentielle que suit depuis quarante ans le montant des plus grosses fortunes actuelles, à commencer par le centile supérieur du décile supérieur (le 1 % supérieur des 10 % supérieurs).
Dans un système qui permet de telles aberrations, qui peut encore penser à la ridicule notion de « juste répartition des richesses » ? Piketty indique dans un joli tableau (p. 691) que le nombre de milliardaires dans le monde, entre 1987 et 2013, est passé de 140 à 1400 (10 fois plus). Dans le même temps, leur patrimoine total est passé de 300 milliards de dollars à 5400 (18 fois plus). Tout ça en à peine un quart de siècle. Vous avez dit « normal » ?
L’énorme masse de données (masse de chiffres qu'il a regroupés en « séries ») qui a servi de base au travail de Thomas Piketty lui a permis de reconstituer historiquement l’évolution des écarts de richesse depuis 1800. L’enseignement principal qu’il en tire est l’incroyable basculement qui s’est produit au 20ème siècle, à partir de 1914 et jusqu’en 1950. L’auteur ne cesse de revenir sur le fait qu’au temps de la Belle Epoque (qui clôt le 19ème siècle, grosso modo 1890-1913), les écarts de fortune étaient astronomiques, tels qu’ils ne s’étaient jamais vus. Et que les crises violentes de toutes sortes qui ont déchiré le monde de 1914 à 1945 les ont ratatinés.
Il explique qu’en période de croissance faible, ce sont les patrimoines qui bénéficient le plus. Tout le 19ème siècle a fonctionné ainsi, pour atteindre des sommets au tournant du 20ème. Les revenus du travail ne sauraient prétendre rivaliser. Il revient (de manière même un peu insistante) sur le discours par lequel Vautrin, dans Le Père Goriot, essaie de convaincre Rastignac d’épouser Victorine Taillefer : même en faisant de brillantes études de droit, sa situation n’arrivera jamais à la cheville de celle qu’il aurait alors, Victorine devant hériter de son père richissime (le salopard de L'Auberge rouge). Rien à faire : entre un gros héritage et une vie de travail, il n’y a pas photo. Mais Rastignac refuse.
Cette organisation se prolonge jusqu’à 1914. A partir de ce moment, le siècle va tomber dans d’incessantes et tragiques convulsions (je suis heureux de savoir que Piketty voit dans la Première Guerre le début du long « suicide » du continent européen) : entre les guerres, les crises économiques ou politiques et l’inflation, les patrimoines se font laminer : fini les héritiers, les rentiers.
Après la deuxième guerre mondiale, après cette colossale remise à niveau des conditions économiques, un système plus redistributif se met en place, principalement grâce à la progressivité de l’impôt sur le revenu, à peu près partout sur le continent. Les Trente Glorieuses constituent la période historique la moins inégalitaire que celui-ci ait connu. C’est aussi la (brève) période au cours de laquelle les revenus du travail ont dépassé ceux du capital dans le revenu national. La période où la méritocratie a donc fonctionné à plein et où l’individu pouvait, à force de travail, faire la preuve de ses compétences et de ses aptitudes, améliorer sa situation à proportion, voire arriver à s'enrichir.
Viennent les années 1970, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, la dérégulation des mouvements de capitaux, la fin de la convertibilité du dollar, enfin tout un tas de circonstances nouvelles (libérales, néolibérales, ultralibérales …), qui inversent la tendance et font repartir à la hausse les écarts de situation. Disons-le : qui accroissent de nouveau les inégalités. Et parfois démesurément, en particulier au profit du centile supérieur (0,1 %) de la population [2 ans après je corrige : il faut lire le "millile" supérieur]. Quatre décennies et demie plus tard, constatons les dégâts.
Piketty résume la cause principale de cette effarante montée des inégalités dans la formule r > g : « r » étant le rendement privé du capital, « g » figurant la croissance (production et salaires) : quand le rendement du capital (5%) est supérieur à la croissance (1%), « L’entrepreneur tend inévitablement à se transformer en rentier » (p. 942). C’est évident : si l’on a une croissance de 1 % par an, pendant que le capital rapporte 5 % à son propriétaire, le capital augmente dans la mesure exacte où ce dernier est en mesure de ne pas en dépenser tout le revenu, pour réinvestir le surplus. Et plus le capital initial est important, plus l'enrichissement est spectaculaire.
On a tout compris : pour être riche, il vaut mieux être gosse de riche. Piketty voit dans la formule r > g la contradiction principale du capitalisme aujourd’hui, cause du creusement de plus en plus abyssal du fossé séparant les plus riches des plus pauvres, une source de divergences qui produiront un jour ou l’autre, inévitablement, des convulsions sociales et politiques. La formule r > g conduit à la guerre civile ou à la révolution.
Je me rappelle – c’était il y a longtemps, quand je lisais encore Le Monde diplomatique – que ce journal avait intitulé un de ses grands articles « Les riches n’ont plus besoin des pauvres ». Ce que je vois, dans la tendance actuelle qui guide le monde, c’est la grande confiscation des conditions du bonheur de tous au profit du tout petit nombre d’une nouvelle race des seigneurs, gourmande jusqu’à la folie, insatiable jusqu'à la fureur, gloutonne jusqu'à l'extravagance.
Je me dis aussi que tout ce système fonctionne aux dépens de la planète : ne vient-on pas de nous informer au courant du mois d'août que l’humanité a épuisé les ressources renouvelables que la Terre peut fournir en un an, et qu'à partir de cette date, elle vit "à crédit", sachant que la date est plus précoce chaque année ? Bon je ne sais pas par quels calculs abscons on en arrive à fixer la date de l’année où l’humanité se met à « vivre à crédit ». Quoi qu’il en soit, une telle façon de fonctionner n’est évidemment pas viable à long terme. Il n'y a pas besoin d'être catastrophiste pour l'affirmer.
Il va de soi que je n’ai fait qu’à peine effleurer ici l’énorme livre de Thomas Piketty. Certes, ce n’est pas de la littérature, mais un livre d’histoire : la prose est du genre indigeste, et ce d’autant plus que l’auteur s’efforce davantage d’être clair et exact qu’élégant dans le style. La prose s’alourdit même parfois, comme à plaisir : abondance des incises, des parenthèses, des « nous y reviendrons » et des « ou tout du moins ». Par-dessus le marché, le lecteur doit affronter la Grande Armada des notes de bas de page. Mais bon, Piketty ne s’attend sans doute pas à obtenir le Goncourt avec son ouvrage.
Le poids du livre (1.126 gr.) s’explique par la nécessité où se trouvait l’auteur de le mettre à l’abri des réfutations et des attaques, au moyen d’une argumentation fournie, aussi inattaquable que possible, et d’une vérification méticuleuse de l’exactitude de la masse des données auxquelles il se réfère. Il y avait aussi la nécessité d’être irréprochable sur le plan méthodologique.
En plus, pour moi qui ne suis pas économiste, je remercie l'auteur de se refuser à jargonner, et de s'efforcer de mettre à la portée du lecteur lambda un ensemble de notions aussi complexe.
En plus, j'avoue que j'ai été bluffé par le nombre (et la clarté) des graphiques et tableaux : cela suppose en amont d'avoir brassé une quantité impressionnante de matière (données, documentation, archives, ...), pour établir les « séries » de chiffres que l'auteur en a tirées.
Thomas Piketty (comme sa maison d'édition) a sans doute été surpris par le succès de son bouquin. Vu l’emballement médiatique qu’il a suscité outre-Atlantique, il a dû pouvoir se dire : « Mission accomplie ».
Thomas Piketty peut à bon droit être fier de la besogne abattue.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas piketty, le capital au 21ème siècle, capitalisme, économie, inégalités, vautrin, le père goriot, rastignac, victorine taillefer, balzac l'auberge rouge, trente glorieuses, première guerre mondiale, ronald reagan, margaret thatcher, dérégulation, le monde diplomatique
dimanche, 05 juillet 2015
CABU ET L'EDUCATION SEXUELLE
A propos de la Grèce, on peut écouter l'entretien qu'Arnaud Leparmentier a eu avec Thomas Piketty, qu'on trouve sur lemonde.fr.
Et ICI (durée 25'35", - augmentée de la publicité très niaise, mais ceci est un pléonasme, même s'agissant des pubs les plus subtiles ou les plus tordues).
Bien que Leparmentier soit horripilant, à sans arrêt couper la parole à l'invité. Tous ces gens qui veulent montrer qui est le chef sont pathétiques.
Piketty se livre à une démonstration éclatante de l'aveuglement dogmatique des institutions économiques (FMI), des institutions financières et des institutions politiques européennes à commencer par l'éléphant Merkel dans le magasin de porcelaine.
Et Piketty fait des propositions qui ont au moins l'apparence du bon sens. Comme il le dit, les responsables européens, en même temps qu'ils incarnent un massif déni de démocratie, sont des apprentis sorciers, qui prennent le risque de faire couler tout le navire européen.
**********************************************
On trouve cette planche dans Charlie mensuel, avril 1975.
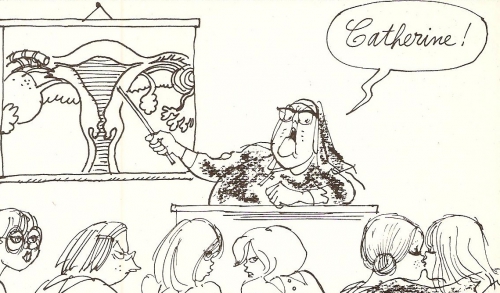
Deux filles qui se papouillent le museau, une religieuse "enseignant" les choses du sexe : une synthèse de l'époque, en quelque sorte.
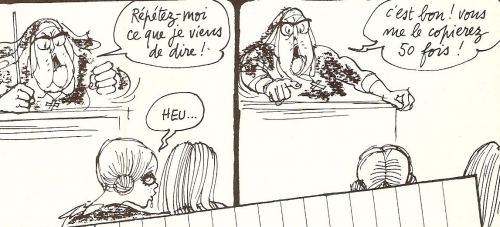
On sent combien toute la délicieuse poésie lyrique et les élans mystiques du sentiment amoureux jaillissent du cours d'éducation sexuelle. Vous aurez noté la goutte à la lippe inférieure de Catherine.
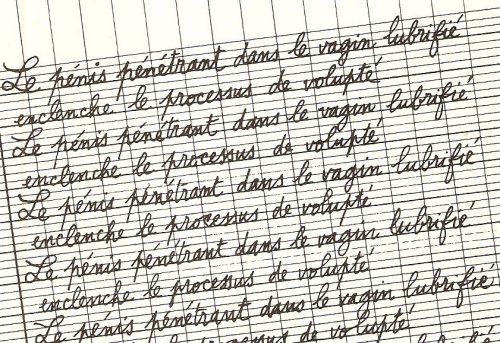
09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cabu, humour, société, éducation sexuelle, bande dessinée, charlie mensuel, charlie hebdo, grèce, grexit, tsipras, thomas piketty, arnaud leparmentier, lemonde.fr, le capital au 21è siècle, économie, journal le monde
vendredi, 25 avril 2014
EUROPEENNES : VOTEZ PROUT !
La Grèce va mieux. Youpi !

Le Monde daté du 23 avril nous invite à l'optimisme. C'est dans son supplément

Mais catastrophe ! Le même jour, dans le corps du journal cette fois, dans la rubrique « International », voilà ce qu'on lit (page 5) :

Avec, extraite de l'article, une citation synthétisant un point essentiel :

Je suis perdu. Dites-moi, je vous en supplie, qui il faut croire. Est-ce Le Monde ? Ou alors est-ce Le Monde ? Quelle main faut-il serrer ? La droite, qui se félicite de la bonne santé des banques ? La gauche, qui présente un bilan de la mauvaise santé des individus ? Eh bien ça dépend de ce qu'on regarde, les vrais gens ou l'argent. Mais on risque de se démancher la vision et de se mettre à loucher.
Belle image de ce qu'est l'Europe : entre les gens et l'argent, l'Europe a fait son choix. Les gens ? Peuvent crever ! L'argent ? Faut le sauver ! Le Monde, lui, se contente de relever, d'enregistrer et de juxtaposer les deux informations. Neutre, on vous dit ! Neutre jusqu'à la moelle des os. Plus neutre, tu meurs ! Comme un Grec ! Stoïque !
Brice Couturier, chroniqueur sur France Culture, a lui aussi fait son choix : il se félicite de la santé retrouvée des banques grecques. Il s'est rangé fièrement du côté de l'Europe. Tant pis pour les Grecs concrets. Brice Couturier n'aime pas les gens.
A la place des Portugais, je me méfierais : la "troïka" s'intéresse de près aux finances (donc aux banques) du Portugal. Faites gaffe, le peuple ! Faites gaffe les vrais gens ! Faites gaffe, les individus vivants ! Quand la structure se porte à merveille et que l'individu agonise, il y eut un temps où il y avait des Hannah Arendt pour appeler ça "totalitarisme".
Une belle preuve que l'Europe telle qu'elle se fait aujourd'hui n'a pas de plus grand ennemi que la chair et les os des peuples, quand ils se permettent de péter de travers. Et même plus simplement quand ils se permettent d'exister. Et je ne parle pas de l'Ukraine.
Un seul bulletin dans l'urne aux européennes : votez
PROUT !
Et ce n'est pas le rapport que vient de publier Transparency International qui risque de me faire changer d'avis (mes excuses pour le choix du site auquel renvoie le lien : j'ai pris le premier venu, et j'ignore tout du PRCF, même si je me doute "d'où il parle").
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce, europe, crise financière, france culture, brice couturier, élections européennes, presse, journaux, journal le monde, économie, entreprise, système de santé, banques
lundi, 10 décembre 2012
EDWARD BERNAYS, HERAUT, ZERO OU HEROS ?
Pensée du jour :

PHOTOGRAPHIE DE GUILLAUME HERBAUT, ENVIRONS DE TCHERNOBYL
« "Il y a beaucoup de choses dans le grand chosier", écrit Littré au mot "chosier", qui n'a jamais été employé qu'une fois dans la littérature française. Précisément dans cette expression-là. Par Rabelais, si j'ai bonne mémoire. Et Littré reste vague dans sa définition. Mais il n'a pas besoin d'être précis. Tout le monde comprend que dans le grand chosier il ne saurait y avoir que beaucoup de choses ».
ALEXANDRE VIALATTE
NB : la mémoire de VIALATTE (cf. Antiquité du grand chosier, éditions Julliard, tiens, à ce propos, coucou, J.) lui joue des tours, voici "in extenso" la notice de LITTRÉ : « chosier, s.m. Usité seulement dans cette locution proverbiale : va, va, quand tu seras grand, tu verras qu'il y a bien des choses dans un chosier. Cela se dit pour indiquer à un enfant et même à une grande personne qu'il y a bien des choses dont on ne peut rendre compte ».
Comme disait ma grand-mère, un peu de culture éloigne de l'absolu, beaucoup de culture en rapproche.
***
Résumé : je demandais ce qui faisait d’EDWARD BERNAYS (mort à 103 ans !!), le roi de la manipulation des foules et de l’opinion publique, un génie révolutionnaire du 20èmesiècle. Son rôle est loin d’être négligeable dans l’avènement du culte de la marchandise, promue au rang d’unique idole devant laquelle l’humanité est appelée à se prosterner.

Ben voilà : il a pioché dans deux univers radicalement différents pour élaborer une théorie radicalement nouvelle. D’un côté, les analyses de GUSTAVE LE BON sur la psychologie des foules (soit dit en passant, cet homme mériterait aussi qu’on s’intéresse à lui). De l’autre, les motivations inconscientes qui font agir les individus, mises au jour par le tonton SIGMUND FREUD de BERNAYS, avec la psychanalyse.
Pour EDWARD BERNAYS, ce qui meut une foule n’a rien à voir avec ce qui peut mouvoir un individu, et d’autre part et surtout, en aucune manière, ce qui meut la foule n’est lié à ce qu’il y a en elle de rationnel, mais dépend du « ÇA ». Dans la théorie de FREUD, le « ça » est la partie la plus enfouie de l’individu, et partant la moins contrôlée par le « moi » et le « surmoi ».
Sans entrer dans les détails, comparons simplement le « ça » à une sorte de réservoir de pulsions et de motivations secrètes, méconnues de l'individu, qui n’attendent qu’un déclic pour se manifester. Ce qui fait bouger une foule, selon BERNAYS, est situé au-dessous du seuil de la conscience. FREUD appelait ça le « subconscient ».
Aujourd’hui, les agences de publicité maîtrisent parfaitement la chose et ont élaboré en conséquence des questionnaires susceptibles de renouveler le répertoire des arguments et des images susceptibles de déclencher l’acte d’achat en allant fouiller dans les motivations secrètes que les gens portent dans leur tête, sans le savoir. Cela porte le nom d’ « enquête de motivations ».

C'EST SÛR, CET EXEMPLAIRE A BEAUCOUP VECU (année de publication) !
L’excellent GEORGES PEREC les nomme (on est en 1965, dans Les Choses, prix Renaudot, me semble-t-il) « études de motivations ». Dans ce bouquin mémorable, Jérôme et Sylvie participent à l’installation balbutiante dans le paysage social de ces lointains ancêtres des sinistres et obsédants SONDAGES (qui a tiré de son chapeau que 61 % de Français sont favorables au mariage homosexuel ? L'IFOP de madame LAURENCE PARISOT).

IL FUMAIT BEAUCOUP TROP. IL EN EST MORT.
Mais à l’époque de BERNAYS (il publie Propaganda en 1928), comme je l’ai dit précédemment, la publicité balbutiait, se contentant de vanter les mérites pratiques, la fonctionnalité et l’adéquation du produit à l’usage auquel il était destiné. Elle parlait au côté rationnel des gens. Elle avait un côté terriblement objectif. Autrement dit : dépassé.
C’est en cela que le travail de BERNAYS est révolutionnaire : il a répondu à la grave question que tous les gouvernements du monde se posent : « Comment amener des masses de gens à se comporter comme le voudraient les dirigeants, sans transformer la société en caserne militaire ? ».
Son idée principale consiste à se fixer comme objectif de vendre à des masses de gens des masses de produits AVANT que les produits précédents aient cessé de fonctionner. Tiens c’est drôle : l’idée est à peu près contemporaine de l’invention du concept d’ « obsolescence programmée ». Comme dit quelqu’un : EDWARD BERNAYS a fait beaucoup pour que l’Amérique passe d’une « économie du besoin » à une « économie du désir ». Comme c’est bien dit.
Et pour donner envie aux gens d’acheter des choses dont ils n’ont aucun besoin (sinon dans un futur bien vague), il faut aller chercher en eux la source de leur envie. C’est ainsi que, selon GEORGES PEREC, toujours dans Les Choses, toujours en 1965, Jérôme et Sylvie sont déjà atteints de la maladie du désir, qui a désormais cancérisé la planète : « Dans le monde qui était le leur, il était presque de règle de désirer toujours plus qu’on ne pouvait acquérir ». Ah ! La maladie du désir ! Plus grave que la "maladie d'amour" que chante le désolant MICHEL SARDOU.

Jérôme et Sylvie ont été contaminés (peut-être) par leur activité professionnelle. Il faut dire qu’ils passent leurs journées à poser des questions à des foules de gens : « Pourquoi les aspirateurs-balais se vendent-ils si mal ? Que pense-t-on, dans les milieux de modeste extraction, de la chicorée ? Aime-t-on la purée toute faite, et pourquoi ? Parce qu’elle est légère ? Parce qu’elle est onctueuse ? Parce qu’elle est si facile à faire : un geste et hop ? (…) ». La liste figure pages 29-30 (dans mon exemplaire, imprimé en 1965 !). Avouez qu’il y a de quoi se laisser gangrener.

LE BOULOT DE JERÔME ET SYLVIE
GEORGES PEREC ADORE LA LISTE, L'ENUMERATION, L'ACCUMULATION, ... LA PARATAXE, QUOI
La maladie de tous les désirs qu’on n’a pas eu le temps de désirer. Voilà le monde qui nous a faits. Voilà le monde qui nous habite. Qui occupe indûment notre territoire intérieur, que nous le voulions ou non. Et nous en devons une bonne part au sinistre EDWARD BERNAYS.
Accessoirement, l'efficacité pratique des campagnes de propagande menées par EDWARD BERNAYS prouve l'effroyable justesse de sa théorie, exposée dès 1928 dans Propaganda. Et par voie de conséquence, l'incontestable VÉRITÉ manifestée dans la psychanalyse. La propagande comme preuve irréfutable que SIGMUND FREUD a tout vu juste, avouez que c'est drôle, comme retour de boomerang !
Et ça prouve aussi que tous ceux qui fouillent dans l'âme humaine (les sociologues, les psychologues, les ethnologues et tous les x...logues, je veux dire concernant les « Sciences » de l'Homme) ne se contentent pas d'établir de simples connaissances, qui s'avèreraient utiles, mais élaborent et fabriquent des instruments de domination dont tous les pouvoirs se servent allègrement pour s'établir et perdurer (= mentir et manipuler). En particulier un pouvoir que je n'ai pas cité ici : le « management » (faire adhérer tous les "collaborateurs" au "projet d'entreprise"), le fléau de la "gestion" des hommes selon le modèle envoyé par ... les Américains.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, guillaume herbaut, tchernobyl, alexandre vialatte, littérature, littré, antiquité du grand chosier, edward bernays, publicité, propagande, gustave le bon, sigmund freud, georges perec, les choses, prix renaudot, sondages, ifop, sofres, laurence parisot, études de motivation, france, économie, propaganda, gouvernement, michel sardou, sciences humaines, société
lundi, 22 octobre 2012
PETIT RETOUR EN ARRIERE
Pensée du jour : « Presque tous les désirs des pauvres sont punis de prison ».
LOUIS-FERDINAND CELINE
On ne se rappelle déjà plus ce qu'on a fait il y a six mois (enfin presque, on ne va pas chipoter). Mais si, HOLLANDE, le Parti Socialiste et toute la fièvre du « changement c'est maintenant».

On ne se rappelle déjà plus qu'on était content de ne plus voir la trombine de SARKOZY dans tous les coins des plateaux de télévision et des couvertures de magazines, et de ne plus entendre la voix pleine de certitude et de volontarisme de NICOLAS. Six mois que nous n'entendons plus le matamore déclarer : « Vous allez voir ce que vous allez voir».

AVANT LE PREMIER TOUR ...
Et qu'on a vu qu'on n'a rien vu. Et c'est tellement vrai qu'on n'a toujours rien vu que ça commence à se savoir, et même à se voir. Vous dire que je l'avais bien prévu, ce serait paraître prétentieux, n'est-ce pas : ça ne se fait pas. Et pourtant si, je l'avais vu, du fond de mon bocal viscéralement abstentionniste.

... ET APRES !
Je le savais, qu'après les sévices infligés au "Service Public à la Française" par le grand éradicateur du Bien Commun, on allait voir ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire rien.
Pour une raison relativement connue et banale, mais qui me semble cruciale : sans même parler de tous les lobbies qui s'en donnent à coeur joie autour des ministres, dans les couloirs de l'Assemblée Nationale, du Sénat et des Institutions Européennes, on le sait, que les politiques n'ont plus guère de pouvoir sur la réalité.

AVANT LE DEUXIEME TOUR ...
On le sait, que ce ne sont plus les forces politiques des sociétés qui gouvernent le monde, mais que les leviers de commande sont fermement détenus par les forces économiques, au premier rang desquelles viennent les forces financières. Cela fait déjà quelque temps que ce n'est plus le politique qui organise la vie des sociétés. HANNAH ARENDT, pour qui l'action politique était le summum de la civilisation humaine, doit se retourner dans sa tombe.

... ET APRES !
Je le savais, que tout ce qui sortait de la bouche de SARKOZY était de la parade musculaire et que tout ce qui sortait de la bouche de HOLLANDE était du bluff. Mais tout ça, ça relevait du « A chacun son style ! », et de rien d'autre. La "com" de SARKOZY reposait sur le muscle. Celle de HOLLANDE sur le verbe. Pour agir sur les esprits, ça change peut-être beaucoup. Pour agir sur la réalité, cela ne change pas un iota.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, littérature, louis-ferdinand céline, françois hollande, nicolas sarkozy, président de la république, parti socialiste, gauche, droite, élection présidentielle, élections législative, économie, finance, assemblée nationale, sénat, europe, action politique
vendredi, 07 septembre 2012
QUEL ULTRALIBERAL ETES-VOUS ?
Sonnet du jour :
« Vase olivâtre et vain d'où l'âme est envolée,
Crâne, tu tournes un bon regard indulgent
Vers nous, et souris de ta bouche crénelée.
Mais tu regrettes ton corps, tes cheveux d'argent,
Tes lèvres qui s'ouvraient à la parole ailée.
Et l'orbite creuse où mon regard va plongeant,
Bâille à l'ombre et soupire et s'ennuie esseulée,
Très nette, vide box d'un cheval voyageant.
Tu n'es plus qu'argile et mort. Tes blanches molaires
Sur les tons mats de l'os brillent de flammes claires,
Tels les cuivres fourbis par un larbin soigneux.
Et, presse-papier lourd, sur le haut d'une armoire
Serrant de l'occiput les feuillets du grimoire,
Contre le vent rôdeur tu rechignes, hargneux.»
ALFRED JARRY, Les trois meubles du mage surannés.
Nous avons pu voir, hier, mes bien chers frères, combien tranchée était l’opposition entre monsieur DEDROITE et monsieur DEGAUCHE en matière économique. Enfin, pas si tranchée que ça, puisque monsieur DEGÔCHE a renoncé à faire la révolution et à organiser la redistribution des richesses sur les bases d’une certaine justice. De son côté, monsieur DEDROITE ne dédaigne pas, à l’occasion, de mettre un peu d’eau sociale dans son vin capitaliste. A condition de ne pas exagérer. Notons en passant que monsieur DEDROITE se définit plutôt par un "pour", et monsieur DEGAUCHE par un "contre". L'un a un but, l'autre a un idéal.
Aujourd’hui, je vais tâcher de montrer que l’opposition est tout aussi virulente entre monsieur DEDROITE et monsieur DEGÔCHE, mais curieusement, ils ont troqué leurs costumes et enfourché le cheval de l’autre. On ne parle plus d’économie. Aujourd’hui, en effet, on va les voir s’affronter sur les questions dites de société. Inversion radicale des rôles. Ce qui nous promet quelques ricanements.
En effet, autant monsieur DEDROITE est à fond pour la liberté quand il s’agit d’entreprendre, de vendre, d’acheter, de spéculer, de s’enrichir, autant son humeur s’assombrit quand on s’avise de s’en prendre aux VALEURS. Pas touche à l’AUTORITÉ, par exemple. Celle de l’Etat, en particulier, ne se négocie pas. Elle doit s’exercer jusque dans les confins et les recoins des banlieues défavorisées, vampirisées par les mauvais garçons, les gangs et le trafic de drogue. Pour monsieur DEDROITE, l’autorité doit procurer la SÉCURITÉ. Mot-clé.
Monsieur DEGÔCHE voit les choses un peu autrement. Sans nier la nécessité (ni la légitimité) de l’autorité, il mise sur le contact, la relation et la négociation. Sur l' « adhésion au pacte social ». Il compte sur la proximité, comme il avait en son temps baptisé une forme de police mise en place dans les « quartiers » (il suffit de le dire comme ça pour savoir de quels quartiers on parle, c'est assez drôle).
Il faut avouer que ça ne marchait pas mal, que c’était efficace en termes d’ordre public, la « police de proximité ». L’ancien Guide Suprême de la France (allez, je le nomme au moins une fois : le tout petit NICOLAS SARKOZY, le mec aux talonnettes), en caricaturant la chose (« un policier n’est pas payé pour jouer au foot avec des voyous »), a fait « peter les galons » (comme on disait quand j’étais au service militaire).
Il a trompeté qu’il allait tout passer au kärcher, il a blackboulé la « proximité » pour envoyer les CRS qui, en matière de « contact avec la population », s’y connaissaient bien mieux. C’est bien connu. Et il a demandé aux flics de « faire du résultat », de « faire du chiffre » (faisant passer la réalité du terrain loin derrière la statistique, parce que la réalité, ça fait moins d'effets d'annonce dans la presse).
Résultat ? Crispation des flics sur l’autorité de l’uniforme, respect à sens unique, tutoiement obligatoire, gardes à vue comme s’il en pleuvait, recours massif au délit d’ « outrage et rébellion », bref, du grand art. La subtilité du sarkozysme (si ça existe). Car le problème de ce monsieur DEDROITE, c’est sa fascination pour l’intimidation, le muscle, la parade et la démonstration de force, exactement comme certains clubs de hooligans du PSG : mettez un uniforme bleu à un hooligan, quelle différence avec un vrai flic, d'après vous ? Ah bon, j’exagère ?
Autre sujet de crispations antagonistes entre messieurs DEDROITE et DEGAUCHE : la frontière entre Etats. Le premier tient à son inviolabilité (on appelle ça le « souverainisme »). Même quand il est européaniste convaincu, il tient à ce que la frontière, même reportée à la limite de l’ « espace Schengen », soit bien gardée (non, je ne me lancerai pas dans la digression, qui me tend pourtant les bras, sur Lampedusa, la frontière gréco-turque, etc.).
Monsieur DEGAUCHE, au contraire, favorise la porosité des frontières autant qu’il peut, et milite même pour leur abolition (« Ouvrez les frontières », chantent AMADOU et MARIAM, qui ne sont pas européens, mais qui y ont beaucoup de complices). Le premier remplit des charters ou des bateaux à destination des pays d’origine de tous ceux qui n’ont rien à faire sur le sol national.
Le second, c’est d’abord un grand cœur, une grande âme. Et ce cœur et cette âme se penchent avec compassion et altruisme sur le sort infâme que la nation ose réserver aux étrangers. Ce rocher espagnol inhabitable, qu'il soit couvert de réfugiés africains, quelle honte pour l'Etat espagnol ! Honte à MANUEL VALLS, qui ose se prétendre de gauche, et qui arrache des Roms à leur immonde favela !
Monsieur DEDROITE s’insurge contre les intrusions. Monsieur DEGAUCHE s’insurge, et même milite, contre les extrusions. Disons-le : monsieur DEGAUCHE trouve sa vocation dans le "comité d'accueil". Et quand il y a des enfants dans l'affaire, il tonitrue. C’est logique.
Le premier est crispé, pas forcément sur la couleur de peau, disons sur une certaine idée de sa propre identité. Il tient à faire la différence entre être d’ici et être d’ailleurs. Ce n'est pas si bête, pourtant. Il faut dire que ça lui fend quand même le cœur, à monsieur DEDROITE, de sortir au terminus du RER à Gagny (dans le 9-3) et de se croire débarqué à Bamako. On ne peut pas seulement lui en tenir grief. Disons qu'il y a au moins matière à réflexion, et qu'on ne peut pas lui jeter la pierre sans y avoir un peu réfléchi.
Monsieur DEGAUCHE, lui, a appelé « diversité » la libre circulation et l’installation d’étrangers sur le sol national, il s’en félicite, il s’en réjouit. Il s’en fait même un programme, un objectif à atteindre : c’est le joyeux « métissage », l’euphorisante « créolisation », dont il se promet mille merveilles de civilisation, dans « la patrie des droits de l’homme », comme il aime à se gargariser. Il s'extasie devant les "sans-papiers". Il s'émeut face aux "sans-logis". Mais que fait l'Etat, nom de Dieu ?
Bilan paradoxal provisoire : autant monsieur DEDROITE se montre libéral tant qu’il s’agit de produire, d’acheter, de vendre et de faire circuler des marchandises d’un bout à l’autre de la planète, autant il se montre rigide, voire inflexible dès qu’il s’agit d’une certaine idée de l’ordre social et de la nation. Autant les choses ne connaissent pas de frontières, autant, s’agissant des gens et des personnes, il s’en tient à l’adage : « Chacun chez soi ». Il veut rester lui-même. C’est humain.
Contradiction identique pour monsieur DEGAUCHE : lui qui, s’agissant d’économie, voudrait réprimer l’ « argent roi », les « paradis fiscaux » et l’exploitation (éhontée, disons-le avec force) de l’homme par l’homme (la formule a, notons-le, totalement déserté les discours) et qui appelle à une redistribution des richesses, et par la force si nécessaire, lui, dès qu’il s’agit des gens et des personnes dans la société, il se sent fondre de bienveillance. Et il appelle ça « humanisme ».
Je ne peux pas m’empêcher de les trouver bizarres, ces contradictions. C’est vrai, quoi, comment peut-on être, et parfois de façon caricaturale, une fois souple et une fois rigide ? Tolérant et intransigeant ? Prenez ceux qu’on appelle les « libertariens » aux Etats-Unis. Eux, ils sont cohérents : ils prônent la disparition de l’Etat et de toute régulation, mais s’agissant du social et du sociétal (puisque sociétal il y a, paraît-il), ils sont tout aussi tolérants et ouverts.
Mais ce n’est pas fini. Ça continue demain. Attention les yeux.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, poésie, minutes de sable mémorial, politique, économie, société, capitalisme, gauche, droite, révolution, socialisme, parti socialiste, françois hollande, nicolas sarkozy, autorité, ordre public, enrichissement, spéculation, quartiers, police, président, crs, police de proximité, karcher, hooligans, psg, souverainisme, europe, espace schengen, amadou et mariam, manuel valls, roms, favela, droits de l'homme, humanisme
jeudi, 06 septembre 2012
QUEL ULTRALIBERAL ÊTES-VOUS ?
Pensée du jour : « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament », écrit RENÉ CHAR dans Feuillets d'Hypnos (fragment 62). HANNAH ARENDT fait de la formule la phrase inaugurale de La Crise de la culture.
Le fond doctrinal du libéral, chacun en sera d’accord, c’est l’autonomie accordée aux individus par la société. Qui dit liberté, dit par là même responsabilité de l’individu. Plus on est libre, plus on est responsable. Il n’y a pas à tortiller. Enfin, on me l’a dit. Et – théoriquement – plus épais et consistants sont les comptes à rendre.
J’observe cependant que les contradictions ne manquent pas. Je me propose de me pencher sur quelques curieux paradoxes. Ainsi, dans le domaine économique, catalogue-t-on A DROITE (politiquement) des gens qui soutiennent mordicus la liberté d’entreprendre, d’embaucher et de débaucher les travailleurs au gré des conjonctures. Ce qu’on appelle la « flexibilité » du marché du travail. Pour que l’affaire marche, on a bien compris, il faut que le patron ait les mains libres. Plus il les a libres, les mains, mieux c’est. Et on le comprend.
C’est vrai que pour qu’une affaire marche, il est nécessaire d’équilibrer les charges : comme disait le dernier Guide Suprême de la France, celui qui a été battu lors du dernier Combat des Chefs, il faut penser aux trois acteurs : l’actionnaire (le propriétaire qui attend le retour sur investissement) ; le dirigeant, qui prépare l’avenir en adaptant la production au marché et en modernisant sans cesse l’outil de travail ; le travailleur (comme c’est devenu un gros mot, je dirai plus loin le dernier acteur cité), qui font tourner l’outil de travail avec leur « force de travail ».
En face, on étiquette A GAUCHE des gens qui, spontanément ou non, préoccupés par le sort fait au dernier acteur cité, qui n’a en sa possession que sa force de travail (selon la grille marxiste, mais on ne peut pas dire que ce soit faux), se portent à son secours pour le protéger d’un rapace (c’est l’actionnaire) qui incite un tyran (c’est le dirigeant) à toujours réduire les coûts. Demandons-nous en passant pourquoi le rapace et le tyran rangent le travail du dernier acteur cité dans la colonne des coûts, et non celle des investissements. Passons.
On voit tout de suite le conflit des deux intérêts : Monsieur DEDROITE actionnaire veut que sa poche se gonfle le plus possible ; le dirigeant y a par nature intérêt, sinon, s’il n’est pas le propriétaire, celui-ci, mécontent, l’éjecte. Monsieur DEGAUCHE veut empêcher le dirigeant de nuire sans mesure au dernier acteur cité.
Pour décrire les choses simplement, disons que Monsieur DEDROITE veut que la machine tourne, Monsieur DEGAUCHE lutte contre l’esclavage. A l'un la "réalité" concrète, à l'autre le brassage d'idées.
Notons en passant que Monsieur DEGAUCHE, concrètement (et bizarrement), s’en prend très rarement au propriétaire-actionnaire, sauf en campagne électorale (« Mon ennemi, c’est la finance ! », lança bravement, mais étourdiment, FRANÇOIS HOLLANDE). Pour une raison simple : il faudrait inscrire au programme du parti la destruction du SYSTEME qui fait de l’actionnaire la source de l’économie. Et cela n’est pas au programme, mais alors pas du tout. Car cela s’appelle la révolution.
Oui, je parle, on l’a compris, de la gauche « responsable », de la gauche « de gouvernement ». Cet homme de gauche-là ne veut surtout pas détruire le système. Il en aime les pantoufles. Je traduis en français : depuis 1983, le Parti Socialiste s’est converti à l’économie de marché. Fini le militant en bras de chemise et la clope au bec : la rue de Solférino ne laisse entrer dans ses murs que des costumes trois-pièces armés d’attachés-cases et sortant de l’ENA. Le Parti Socialiste n'est plus à gauche, mais à GÔCHE. Et ça change tout.
L’économie de marché (autrement dit la jungle de l’offre et de la demande), elle place à son sommet et (!!!) à sa base l’actionnaire. Renverser cet ordre, seuls de dangereux utopistes osent en rêver. Qui rêvent en douce de grimper au sommet de leur échelle de l’Egalité.
Donc, l’homme de gôche a renoncé à la révolution, donc il accepte le règne de l’actionnaire. On voit par là qu’entre l’actionnaire-marteau et l’homme de gauche-enclume (une enclume pas toujours au service du dernier acteur cité), le dirigeant a intérêt à avoir pris des leçons de diplomatie auprès des intrigants florentins du 16ème siècle ; des leçons de méthode auprès des grands stratèges (CLAUSEWITZ, SUN TSU) ; des leçons de ruse auprès des vizirs arabes. S’il veut sauver sa peau.
Résumons-nous : l’homme de droite réclame le maximum de liberté (d’entreprendre) ; l’homme de gauche réclame le maximum de justice (sociale). « Liberté n’est pas licence ». Paraît-il. L’homme de droite, en économie, est favorable au « libéralisme », qui permet à l’entrepreneur de s’enrichir. L’homme de gauche, pour l’empêcher de se servir du dernier acteur cité comme d’un simple citron à presser, exige que l’économie soit « administrée ». La liberté s’oppose à la régulation, comme le pôle nord au pôle sud. Et lycée de versailles.
Je résume ce qui précède : l’Entrepreneur est contre l’Etat et pour la Liberté. La Sécurité Sociale et le Code du Travail sont contre l’Esclavage qui découle de cette Liberté. En très gros. J’espère que vous suivez. Je schématise, mais il y a de ça.
Entre la liberté (d’entreprendre) et la protection (sociale), c’est une sourde et permanente lutte pour pousser le curseur du « bon » côté. En ce moment, on pourrait dire par exemple que l’esclavage a le vent en poupe. Et que l’Etat est devenu le toutou de l’Entreprise : « Donne la papatte, allez, fais le beau, JEAN-MARC AYRAULT ». Et JEAN-MARC AYRAULT donne la patte, fait le beau et remue la queue. C’était l’autre jour au MEDEF.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre : promis, demain, étonnant renversement de perspective et de rôle.
Dernière minute pour les Lyonnais : a lieu ce soir le vernissage d'une exposition. La galerie Gilbert Riou (1, place d'Ainay, 18 heures) montre des oeuvres tout à fait estimables d'AGATHE DAVID, qui s'est inspirée des Psaumes de David pour faire surgir des souvenirs de bestiaires, de la botanique et des livres d'heures.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené char, hannah arendt, feuillets d'hypnos, la crise de la culture, littérature, poésie, économie, libéralisme, ultralibéralisme, politique de droite, politique de gauche, libre entreprise, nicolas sarkozy, françois hollande, ump, parti socialiste, actionnaire, rue de solférino, ena, économie de marché, clausewitz, sun tsu, sécurité sociale, code du travail, jean-marc ayrault, medef
dimanche, 15 juillet 2012
DES EMPLOIS, PAR PITIE !
Résumé : si de vrais industriels investissent dans de vraies industries, ça les enrichit, parce que ce qu’ils veulent d’abord, c'est s'enrichir, mais il y a des retombées favorables au plus grand nombre, parce que ça donne du boulot. Pour une raison très simple : le travail productif produit de la richesse.
Voyons Peugeot, maintenant. Qu’est-ce qu’il fait, Monsieur Peugeot ? Il ferme l’usine d’Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Ses usines sont en « surcapacité ». Encore un joli euphémisme. Ça veut dire quoi, « surcapacité » ? Moi, je traduis par « inutilité ». Ben oui, quoi, une usine qui produit trop, c’est une usine qui ne vend pas assez. Ça veut dire qu’il n’y a pas assez de gens qui achètent des voitures. Cela veut dire que les voitures produites ne trouvent pas preneurs. Et donc ne servent à rien. Dès lors, pourquoi s'acharner ?
Il faut savoir que le parc automobile français est chargé (au 1er janvier 2012) à raison d’à peu près 500 voitures pour 1000 habitants. En France, au 1er janvier 2012, il y a un peu plus de 38.000.000 de véhicules immatriculés, pour 65.000.000 d’habitants. Plus d'un pour deux habitants. Faire mieux serait inquiétant pour la couche d'ozone. En Chine, le parc automobile compte environ 40 véhicules pour 1000 habitants, et 100.000.000 de voitures en circulation. Conclusion ? Il reste de la marge. Pas en France, on est bien d'accord ? En Chine.
Dans ces conditions, essayons d’imaginer ce qui va se passer en France : Peugeot va supprimer 8000 emplois. Ça fera 8000 salaires en moins. Donc moins de gens pour acheter des voitures. Appelons ça un cercle vicieux, et n’en parlons plus. Et c’est un processus. Je veux dire que c’est comme un haut fourneau ou comme un super-porte-containers : il faut du temps pour remettre en route ou pour changer de cap. Il y en a qui disent : inverser la tendance.
En ce moment, réjouissons-nous et profitons bien du fait qu’il n’y a encore que 4.000.000 de chômeurs, à peu près 10 % de la population active. Combien de temps pour rejoindre l’Espagne avec ses 20 % ? Je ne sais pas, mais c'est parti pour. J’ai parlé de processus, et celui qui est à présent en cours n’est pas difficile à identifier : c’est un processus de paupérisation. La vieille histoire des vases communicants : pendant que l’économie de la France se satisfait de se contracter de - 0,2 % (parce qu'elle craignait pire), celle de la Chine patine avec une croissance de seulement + 7 % (comme le déplorent quelques amusants journalistes, enfin, pas si amusants que ça).
« Rien ne se perd, rien ne se crée » disait, je crois bien, LAVOISIER. Pour faire bonne mesure, il ajoutait : « Tout se transforme ». Rien ne se crée : la richesse de quelqu’un est forcément prise dans la poche de quelqu’un. Et plus quelqu’un est riche, plus nombreuses sont les poches qu’il a vidées. C’est de la mécanique des fluides, pour ainsi dire.
La France va arriver à 20 % de chômeurs (et pourquoi pas davantage, après tout ?). Heureusement, Zorro est arrivé. Je veux dire que la France va être sauvée. Vous devinez par qui ? Par Monsieur Baccalauréat. Si, si ! C'est même en "Une" du Monde. Un titre comme on en trouve un par siècle, et qui prouve que Le Monde a TOUT compris du monde dans lequel il vit (cela veut dire, évidemment, RIEN COMPRIS DU TOUT).
Pensez, à la date du Samedi 14 juillet, il titre triomphalement : "OBJECTIF ATTEINT : 85 % D'UNE GENERATION AU NIVEAU DU BAC". "Objectif atteint". Cela résonne comme : " Mission accomplie, mon Général". "Objectif atteint", on en frémit de fierté nationale et d'orgueil cocardier. Ainsi, articule avec peine le lecteur ému aux larmes, la France est capable de "se fixer des objectifs". Mieux, se dit-il avec des trémolos dans la voix, la France est capable "d'atteindre des objectifs". Que demande le peuple ?
Que demande le peuple ? Il voudrait simplement savoir un peu plus précisément ce qu'ils savent, les bacheliers. Ce dont ils sont capables. Et, très accessoirement, ce qu'ils ont envie de faire. Je sais, je généralise bêtement.
Alors, trêve de plaisanterie, cette Grande Conférence Sociale ? Quoi de neuf ? RIEN. On va forcément vouloir faire comme si : comme si on voulait poser des petites rustines sur des trous plus grands qu’elles. En gros, je vais vous dire, on va réfléchir à ce qu’on va pouvoir prélever dans la poche des gens qui ont encore un travail pour venir en aide aux cohortes toujours plus nombreuses de ceux qui n’en ont pas. Cela s'appellera TVA sociale ou augmentation de la CSG, prenez-le comme vous voudrez, on en reviendra forcément toujours à ça.
Il n’y a pas besoin d’être con comme un « économiste » (j'aime assez la formule, et vous ?) pour ne pas avoir envie de se raconter des histoires. Si personne n’est assez fort pour pousser la France à se REINDUSTRIALISER, et pour que la France, à nouveau, produise elle-même des richesses, ce qu’il faudrait dire aux gens, c’est de faire très attention, et de bien regarder le trou béant dont ils sont en train de s’approcher, pour qu’ils ne se trompent pas de pied au moment où ils le mettront dedans.
Alors moi, c’est sûr, j’aimerais bien que la Grande Conférence Sociale débouche sur du concret. En l’état actuel des choses, malheureusement, je crains fort qu’il s’agisse moins de peser sur la réalité (la production industrielle de richesses) que de parler pour rassurer et pour donner à espérer. Cette conférence est une simple machine à fabriquer de l'incantation au kilomètre, comme de la saucisse.
Les participants participent et les partenaires sociaux partenarisent à qui mieux-mieux : ils font des bulles en espérant je ne sais comment que les gens croiront dur comme fer que le vent qu'ils font va devenir une mayonnaise bien prise. En attendant, ils espèrent donner à espérer aux gens qu'ils représentent, qu'ils emploient ou qu'ils administrent. Ils espèrent raconter l'histoire assez bien pour que les gens y croient.
Comment s’appelle-t-il, ce « responsable » politique qui vient de déclarer qu’il fallait d’urgence s’efforcer de rendre le territoire français séduisant pour les investisseurs étrangers ? C'est vrai ça, qu'est-ce qu'il a contre des investisseurs français ? Peut-être qu'il n'y en a pas ? Et n’est-ce pas une façon de croiser les doigts et d’espérer un miracle venu d'ailleurs ?
C’est sûr, FRANÇOIS HOLLANDE va prochainement, devant les caméras, et en présence de toutes les Françaises et de tous les Français, « guérir des écrouelles » un chômeur en fin de droits. A quand, après ceux de Saint LOUIS, le miracle de Saint FRANÇOIS ?
Et juste après, promis-juré, le Président HOLLANDE, il marche A LA FOIS sur les mains et sur les eaux.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, économie, grande conférence sociale, françois hollande, parti socialiste, jean-marc ayrault, peugeot, aulnay sous bois, chômage, travail productif, chine, délocalisation, paupérisation, lavoisier, rien ne se perd ne se crée, zorro, le monde, presse, baccalauréat, tva sociale, augmentation csg, réindustriallisation
samedi, 14 juillet 2012
DES EMPLOIS, S'IL VOUS PLAÎT
Tiens, avant de commencer, à propos de MOHAMED MEHRA : je n'ai aucun scoop à diffuser, seulement une question. Les flics qui étaient sur place étaient des superflics, surentraînés, supercompétents. Les plus pointus, n'est-ce pas ? Comment se fait-il qu'aucun tireur d'élite, un sniper, vous savez, ces gars capables de percer une pièce d'un euro à 1000 mètres, n'a été en mesure de BLESSER MEHRA (épaule, jambe, ou autre) ? Ma question, c'est : quelqu'un a-t-il donné l'ordre d'abattre MOHAMED MEHRA ? Fin du préambule.
Résumé de l'épisode précédent : les contrats industriels avec « transferts de technologie », signé avec la Chine (et d’autres) ont vidé la France d’une bonne part de sa capacité de « production de richesses ».
Les (ir)responsables politiques et industriels français ont ainsi rêvé d’une division mondiale du travail : les boulots de pauvres (production, fabrication, saleté) dans les pays pauvres. Les boulots nobles (= col blanc, créativité à fortes retombées sonnantes) devaient continuer à enrichir les pays riches. Le boulot noble, ce n’est pas celui qui salit les mains, n’est-ce pas ? C’est celui qui trace sur le papier les équations, les lignes, les projets. On appelle ça la CONCEPTION. Des industries sans usines, on vous dit. Et des usines sans ouvriers.
Toutes les entreprises d’une certaine taille ont un Bureau de Recherche et Développement (abrégé en R & D). C’est là qu’on pense le futur. C’est là qu’il y a de l’espionnage industriel (pardon, il faut dire « intelligence économique »). Mais les Chinois, ils ont compris : ils produisent (ainsi que les Indiens) dix ou trente (ou cent, ou mille) fois plus d’ingénieurs que la France. Et la France n’a plus les moyens (mais a-t-elle seulement l'envie ?) d’éduquer correctement ses jeunes. Vous devinez l’avenir ? Moi, oui, et pourtant je ne suis pas devin.
Moralité, les richesses, il faut les PRODUIRE. Je ne sors pas de là. Si vous ne les produisez pas, vous devez les acheter (pour les besoins vrais, mais aussi les « besoins » que les publicitaires nous ont fait découvrir qu'on avait). La France doit acheter ce qu’elle ne produit pas, et dont elle a cependant besoin (ou « besoin »). Exemple, le pétrole, les ananas, l’huile (oui !), mais aussi, les écrans plats, les iphones et tout le toutim.
Or, tout tend à prouver que la France a renoncé à produire. Je connais quelqu’un (vaguement apparenté) dont le métier a consisté, pendant des années, à vendre des machines-outils à la Bulgarie, à la Turquie, voire plus loin. Je peux vous dire que ça a bien marché, et pendant des années, et qu'avec ça, il a bien gagné sa vie. Des machines-outils qui venaient d’usines parfaitement françaises, mais dont plus personne ne voulait. Il y a bien eu un choix du renoncement à produire de la richesse.
Alors revenons à la Grande Conférence Sociale de FRANÇOIS HOLLANDE et au souriceau fripé dont la montagne va accoucher. Qu’est-ce qui va se passer ? Ceux qui ont RAISON, c’est ceux qui disent qu’il faut réindustrialiser la France. Il faut remettre en route les hauts fourneaux. Il faut que les usines automobiles Peugeot, Citroën et Renault produisent en France. Il faut …, il faut …, il faut … Enfin, il faudrait. Même qu'il faudrait peut-être. Va savoir.
Vous avez compris. Qu’est-ce qui va se passer ? Mais c’est tout vu, voyons ! Monsieur LAKSHMI MITTAL, milliardaire indien qui possède pas mal de hauts fourneaux en Europe, a décidé d’en arrêter pas mal, dont celui de Florange, qui a cessé depuis longtemps d’alimenter les poches de sa famille des 30 % de bénéfices qu’il avait décidé d’y déposer régulièrement. A votre avis, est-ce qu’il a très envie de le voir redémarrer ? La réponse est NON.
Un haut-fourneau, attention, en soi, c’est une usine verticale, avec ses 70 mètres de hauteur, qui fonctionne 24 heures sur 24, et avec des dimensions pareilles, ça manque de souplesse : on ne peut pas l’arrêter et le remettre en route comme une plaque de cuisson. Il réclame des délais respectables pour les changements de régime.
Ça se conduirait plutôt comme un super-porte-containers : pour prendre le prochain virage, il convient d’anticiper quelques dizaines de kilomètres avant (j’exagère sûrement). Et les virages industriels, ça prend plusieurs dizaines d’années. Il vaut mieux ne pas se tromper d’angle d’attaque. Et là, je regrette qu’on n’ait plus la possibilité juridique de brandir la tête des « responsables » au bout d’une pique. Si possible avec du persil dans les narines.
Parce que, franchement, vous ne sentez pas un peu de moutarde vous les chatouiller, les narines, quand vous vous dites que la situation actuelle, vous la devez à des décideurs d'il y a vingt et trente ans. Pour eux, c'était un rêve : une industrie sans usines, des usines sans ouvriers. Et qui dit "sans ouvriers", dit "sans emmerdeurs syndicaux". La solution ? Elle tenait dans trois mots : ROBOTISATION, INFORMATISATION, DELOCALISATION. En disant aux pays alors pauvres : démerdez-vous avec la production et les mains sales, nous gardons toutes les tâches de conception. A haute valeur ajoutée.
Moralité : nous avons perdu les ignobles tâches de production de richesses. Mais ça ne nous a pas empêché de perdre les nobles tâches de conception, conditions de la production de richesses. Enfin, pour le moment, pas toutes.
Car, pour pousser le pion de la conception généralisée et arriver au Graal d'un emploi noble pour tout le monde, il faut un énorme effort collectif pour élever le niveau de formation des jeunes. Or, j'exagère à peine en affirmant que le système éducatif français n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut, et qu'il menace ruine. A commencer par les filières techniques, qui ont été passées au lance-flammes. Quand ce n'est pas au lance-flammes qu'on les a passées, c'est au broyeur, voire au sani-broyeur.
La preuve de la déconfiture nationale ? Cette année, 85 % des jeunes français ont suivi une classe de terminale (certains ont suivi de très loin). Et 77 % des jeunes français ont obtenu ce que l'on n'appelle plus depuis très longtemps une "peau d'âne". Je plains, certes, les 23 % qui ne l'ont pas obtenue, mais je pense qu'ils étaient très, très, très NULS. Qu'est-ce qu'il faut être, et qu'est-ce qu'il faut NE PAS FAIRE, pour rater le cadeau Bonux ? Disons : pour rater le Père Noël (c'est plus consensuel, le cadeau Bonux ne survivant que dans le sketch de COLUCHE) ?
J'ai gardé une oreille dans le système éducatif, et j'y en reçois quelques échos qui me font dire qu'il faut vraiment être très, très, très CON pour ne pas avoir le bac. Avec de futures pareilles recrues (qui n'ont acquis à l'école qu'un goût très, très, très modéré pour le travail et l'effort), la future industrie productive française, que le monde entier nous envie, n'a qu'à bien se tenir. Ce qui en reste debout ne s'en remettra pas.
Subséquemment et par voie de conséquence, c'est très logiquement le moment de redresser la tête, de bomber fièrement le torse, de se dresser sur ses ergots, les pieds dans le tas de fumier, d'inspirer un grand coup, et de chanter à tue-tête un retentissant COCORICO. Avant d'entonner martialement une Marseillaise endiablée. Ben oui quoi : c'est le QUATORZE JUILLET. C'est le moment d'être fiers de notre grande nation. Et moi, qu'on se le dise, j'ai la fibre patriotique. Enfin, je l'ai eue.
C'est pourquoi, chers concitoyens, je vous dis : Vive la République, Vive la France ! Et le reste.
Voilà ce que je dis, moi.
Suitetfin demain.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mohamed mehra, économie, société, politique, grande conférence sociale, françois hollande, parti socialiste, gouvernement, industrie, emplois productifs, marseillaise, cocorico, patriotisme, 14 juillet, baccalauréat
jeudi, 12 juillet 2012
NOUS-VOU-LONS !!! DES-EM-PLOIS !!! (2)
Résumé : les prophètes (économistes, politiciens,…) des années 1980 annonçaient la grande division mondiale du travail : la production, les mains sales et les bas salaires aux pays pauvres, la conception, les tâches nobles et la valeur ajoutée aux pays riches. Des patrons rêvaient ouvertement pour l’Europe d’industries sans usines, et d’usines sans ouvriers. On voit aujourd'hui la grandeur et la justesse de vision de ces penseurs.
Les conseils d’administration ont donc commencé à ordonner aux directeurs et aux présidents de réduire à tout prix le « coût de la main d’œuvre ». Car le bonhomme qui travaille, ce n’est pas un investissement, c’est un COÛT. L’homme, en termes comptables, est dans la colonne « débit ». Qu’est-ce qu’ils ont fait, les présidents et les directeurs ? Ils ont construit des usines en Chine (je schématise). Cette opération porte le joli nom de « délocalisation ». Tout le monde s’émerveille du taux de croissance de la Chine, de l’Inde et du Brésil, mais il n’y a strictement rien de miraculeux là-dedans.
Tout a été calculé. Sur les bilans des grandes entreprises occidentales, qui ne donnaient pas une assez grande place aux DIVIDENDES : « Quoi, hurle la veuve écossaise (tapez « scottish widow », juste pour voir), seulement du 6 % de rentabilité de mes actions chéries ? Je veux du 15 % par an, vous entendez ! ».

JE NE SAIS PAS SI ELLE EST ECOSSAISE,
EN TOUT CAS, ELLE EST VEUVE ... ET VORACE !
ET ELLE TISSE SA TOILE.
Et le fonds spéculatif, qui fait marcher les actions de la veuve écossaise et qui siège au conseil d’administration agite son bâton, et le président-directeur éjectable, il obtempère. Et il cherche le pays où il pourra payer l’ouvrier productif LE MOINS POSSIBLE. Pour pouvoir offrir du 15 % par an à la veuve écossaise.
En gros, voilà le tuyau de descente des emplois productifs sur lesquels la voracité des « investisseurs » (le mot est un trop joli mensonge pour désigner la voracité de spéculateurs effrénés) n’a cessé de tirer la chasse d’eau depuis trente ans (ah, qui chantera la bienfaisante action de REAGAN et THATCHER ?).

ASSEZ SALAUD POUR CHOPER ALZHEIMER
ET POUVOIR DIRE QU'IL A TOUT OUBLIE
L’économie chinoise se porte bien ? On peut remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la vente du travail productif occidental au capitalisme chinois. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : l’économie occidentale a été vendue à la Chine, sous la pression spéculative des « fonds de pension », donc des veuves écossaises.
Le problème, avec la Chine, c’est qu’il y avait foule à la porte d’entrée (les salauds et les cons appellent ça la « concurrence » ou la « compétition internationale »). Une concurrence féroce. Les Chinois n’avaient qu’à pointer le doigt pour désigner le vainqueur, les autres ne mouftaient pas, ils restaient à plat ventre, espérant des lendemains meilleurs.
Et les Chinois qui, ne l’oublions pas, sont les inventeurs et les maîtres absolus du jeu de Go, n’ont pas eu trop d’efforts à faire pour que la concurrence (sans doute « libre et non faussée », comme on dit dans notre Europe cramponnée aux principes ultralibéraux) accepte d’opérer des « transferts de technologie » (traduction en clair : le vol de la propriété intellectuelle, pour laquelle certains font encore semblant de se battre aujourd’hui).

AU JEU DE GO, IL S'AGIT D'ETOUFFER L'ADVERSAIRE
« Transfert de technologie », c’est un euphémisme extraordinaire. Tu crois que tu exportes des biens, mais en réalité, tu exportes toutes les recettes qui te permettaient de les fabriquer. Et qui vont permettre à ton client, dans pas longtemps, de devenir ton concurrent. Je dis n’importe quoi, mais supposons que tu exportes ton TGV, celui avec son bogie insurpassé qui lui permet d’aller à 515 km / h (record du monde sur rail).
Le contrat implique un « transfert de technologie » ? Cela veut simplement dire que, pour avoir le contrat, tu abandonnes à ton client la propriété (on appelle ça « concession ») des centaines de brevets que tu as mis au point à tes frais et avec tes méninges (on appelle ça des « bureaux d’études »).

CE N'EST PAS UNE COPIE CONFORME, MAIS BON, PAS BESOIN D'INSISTER
Et qu’avec un peu d’ingéniosité et de formation, des ingénieurs, les Chinois te vendront bientôt des TGV plus performants et beaucoup moins chers que les tiens. Où croyez-vous qu’ils l’ont trouvée, la croissance, les Chinois ? Les Occidentaux, tout simplement, la leur ont offerte sur un plateau. Et vous cherchez encore la cause du chômage en Europe ? Et vous avez encore l'espoir qu'on peut y remédier ? Mais où avez-vous la tête, ma parole ?
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grande conférence sociale, françois hollande, parti socialiste, politique, économie, économie financière, spéculation, capitalisme, industrie, ouvriers, europe, main d'oeuvre, chine, veuve écossaise, reagan, thatcher, hedge funds, transferts de technologie, tgv
lundi, 02 juillet 2012
DES (MAUVAISES) NOUVELLES DE LA FRANCE
J’espère que vous n’avez pas mis trop de temps à vous rendre compte que, sous HOLLANDE, ça n’a pas duré pour qu’il en aille tout autrement que sous SARKOZY, c’est-à-dire, évidemment, que tout est comme avant et que rien n’a changé.
Une seule chose a disparu du paysage, et c’est déjà un drôle de soulagement : le plaisir de sale gosse de NICOLAS SARKOZY qui consistait, patiemment, jour après jour, à dénicher une nouvelle fourmilière pour y foutre un grand coup de tatane, à seule fin de jouir en ricanant méchamment du spectacle du grouillement innombrable et affolé des insectes. La fourmilière pouvait s'appeler "carte judiciaire", "RGPP", "Hôpital public", "Ecole", "Police", peu importait. Reste à voir comment HOLLANDE va réparer tout ça.
C’est vrai que SARKOZY avait érigé en méthode de gouvernement l’ébahissement permanent des foules : « Oh non, quand même, ça, il n’osera pas ! – Ben si, qu’est-ce que vous croyez ? ». C’en était très curieux, d’ailleurs, de voir SARKOZY dans son déguisement de président, trop grand pour lui. C’était ça le plus sidérant : le voir déguisé en président, avide de voir les visages des Français sidérés, ahuris, jour après jour, de voir une fourmilière après l’autre démolie à coups de bottes par le sale gosse caractériel.
Dans le fond, SARKOZY, pendant cinq ans, a fait diversion. Il a inventé le quinquennat de la diversion : pendant qu’il s’agitait au premier plan, les bottes cloutées de ses cabinets ministériels attaquaient une nouvelle fourmilière, en prévoyant déjà leur cible suivante, et en se demandant s’ils allaient l’attaquer de la pointe ou du talon. On va pouvoir quitter des yeux l’écran et sortir de la salle pour aller se soulager la vessie. Est-ce que ce sera reposant pour autant ? Pas sûr, Arthur.
Ah si, quand même, avec la présidence HOLLANDE, ce sera plus reposant pour les journalistes. Les rédacteurs en chef ont déjà cessé d’éditorialiser à tout va au moindre battement de cil de l’époux de CARLA, que j’avais presque envie (dans mes temps morts) d’appeler « monsieur BRUNI ». Et ils ont cessé d'envoyer leurs journalistes en rafales de grappes d'escadrilles aux trousses de l'agité de la focale. C’est sûr, FRANÇOIS HOLLANDE souffre moins pathologiquement de n’être pas constamment au centre des conversations.
Mais franchement, vous croyez qu’il va faire mieux que le sidérateur professionnel qui l’a précédé ? Les finances, l’activité industrielle, le « pouvoir d’achat des Françaises-et-des-Français », vous croyez que ça va s’arranger ? Personnellement, je dis que non, et que le pire est à venir.
Pour une bonne raison (qui est très mauvaise en soi), c’est que la logique du spéculateur est une logique proprement USURAIRE. Ceux que les « journalistes » économiques (si on peut nommer cette engeance) appellent mensongèrement des « investisseurs », ne sont rien d’autre que des usuriers, de la même espèce que l’affreux Gobseck inventé (et observé) par BALZAC. Avec les dettes souveraines, ils ont trouvé un prodigieux gisement à se faire du gras.

Je signale à ceux qui ne se tiendraient pas au courant que le taux maximum possible (défini par l'Etat, au-delà c'est de l'usure), pratiqué par les banques, en France, pour un emprunt de 1524 euros (c’est précis), est de 20,65 %, soit 1,72 % par mois. Et que ça passe à 19,5 %, jusqu’à 3000 €, pour les crédits renouvelables (vous savez, les "revolvings"). Donc ça reste juteux (pour qui ?). Le Figaro.fr du 9 mai 2012 indique que la Grèce pourrait emprunter « sur les marchés » au joli taux (à dix ans) de 22 %. CQFD.
Les prétendus « investisseurs » des « journalistes » sont bel et bien des USURIERS à qui toutes les autorités politiques du monde ont décidé de laisser impunément la bride sur le cou. Et qu’on se le dise, depuis que l’Etat français n’a plus le droit d’emprunter à 0 % auprès de sa banque centrale, depuis la scandaleuse loi de GISCARD et POMPIDOU (1973), l’Etat français a été obligé de se tourner vers les USURIERS pour financer les salaires et les retraites des fonctionnaires, mais aussi les cadeaux fiscaux faits à droite et à gauche.
Sans que ça l'empêche de brader les bijoux de famille de l'Etat lui-même (patrimoine immobilier, autoroutes, privatisation des grands services publics, mis au rencart au nom de la très européenne "concurrence libre et non faussée", etc.).

CE CROCHU-LÀ EST PEINT PAR QUENTIN METSYS
Je note que ni MITTERRAND ni JOSPIN n’ont touché à cette loi scélérate. Gauche et droite sont un seul et même bateau. Cette loi a passé autour du cou de tous les dirigeants politiques, quelles que fussent leurs couleurs et leurs paroles, un nœud coulant, dont on s’aperçoit aujourd’hui qu’il est passé autour du cou de tous les contribuables.
Tout ça pour dire que, avec HOLLANDE ou SARKOZY à la barre, c’est kif-kif bourricot et du pareil au même. Et qu’ils obéissent au doigt et à l’œil, sous peine d’étranglement, à la sacro-sainte « loi du marché », qu’on peut tout bonnement appeler la LOI DE LA JUNGLE. L’un comme l’autre, ils sont au garde-à-vous, le petit doigt sur la couture du pantalon, en attendant les verdicts éminemment « rationnels » (!!!!!) de Wall Street et des entreprises qui gagnent leur vie en vendant des opinions (on les appelle couramment des « agences de notation »).
Non, je ne suis pas optimiste. « Tu vas pas mourir de rire, Et c’est pas rien de le dire » (Mickey 3 D).
Voilà ce que je dis, moi.
10:40 Publié dans DANS LES JOURNAUX, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, europe, hollande, parti socialiste, sarkozy, président, ump, finances publiques, financiers, agences de notation, banques, banquiers, usuriers, taux d'usure, usuraire, le figaro, grèce, giscard, pompidou, mitterrand, jospin, loi de la jungle, wall street, standard and poor's, moody's, fitch, économie, économistes, journalisme, presse, les échos, financial times
mercredi, 06 juin 2012
EURO URGENCE
Je glisse ce billet impromptu parce qu'il faut très vite diffuser la vidéo de cette conférence de MYRET ZAKI et ETIENNE CHOUARD, pour faire connaître à tout le monde les vrais ressorts de la guerre de l'euro qui est en train de se livrer, et qui a bien des chances de ruiner l'Europe. Attention : ça dure deux heures et demie. Mais ça en vaut la peine !!! Le titre exact est "L'Etat et les banques : les dessous d'un hold-up historique". C'est du brutal. Pour ceux qui n'ont pas le temps, n'allez pas jusqu'à l'intervention de ETIENNE CHOUARD, un peu trop exalté à mon avis, et concentrez-vous sur le quart d'heure de MYRET ZAKI. A mon avis, PAUL JORION lui-même est dépassé. C'est dire où on en est.
11:52 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : myret zaki, éienne chouard, économie, ultralibéralisme, banque, finance internationale, spéculation, union européenne, guerre économique
jeudi, 26 mai 2011
L'IMPOSTURE ECONOMISTE
Dans le zoo fou qu’est devenue la planète, l’économiste occupe une pace de choix. Que dis-je : l'animal tient le haut du pavé du centre de l'échiquier. Comme ils disent eux-mêmes, ils sont « incontournables ». Ce sont, disent-ils, des « spécialistes ». Leur spécialité, c’est l’économie. Une « science », paraît-il. Drôle de science quand même. La science, on sait ce que c’est, le Grand Robert le dit : « connaissance exacte et approfondie ». « Exacte » ? Alors l’économie N’EST PAS UNE SCIENCE. Qu’il y ait des invariants, c’est certain : plus on fabrique de la monnaie, plus les prix augmentent ; quand on détient un monopole, on s’enrichit plus que quand la vraie concurrence fait rage ; etc. J'ai quelques notions quand même, faut pas croire. Mais un des caractères infaillibles qui définit une science, c’est qu’elle est capable de PREDIRE les phénomènes (si tu es à 0 mètre, et si tu mets de l'eau sur du feu, elle bouillira à cent degrés Celsius, par exemple).
Ça crève donc les yeux : l’économie n’est considérée comme une science que par un abus de langage, un mensonge soigneusement entretenu par la corporation des économistes. Drôle de corporation, à vrai dire. Il se trouve que j’écoute de temps en temps l’émission du samedi matin à 8 heures sur France Culture, intitulée « L’Economie en questions ». Ils sont quatre ou cinq, ils sont appelés des « experts », ils discutent de deux sujets principaux. Et s’il y a un invariant, il est ici. Pendant une quarantaine de minutes, ces « experts », tous très savants, c’est certain, débattent. Oui, parfaitement : il DEBATTENT. C'est précisément là qu'est l'os. ILS DEBATTENT. Suivant les sujets, il leur arrive même de s’engueuler. Voilà l’abus de langage : ces « experts » dans la « science économique », ils sont rarement d’accord, d’une part sur l’analyse à faire d’un phénomène, d’autre part sur les solutions à apporter aux problèmes et les perspectives. Si c'était une science, il n'y aurait pas de débats aussi vifs (et ce ne sont pas les vitupérations du bibendum plein de suffisance arrogante CLAUDE ALLEGRE qui peuvent me convaincre du contraire). Ecoutez un peu, un jour où vous n'avez rien de mieux à faire, ça devient toujours assez drôle, quand ce n’est pas franchement burlesque, quand ces grands spécialistes attaquent la partie « IL FAUT » du débat.
NOURIEL ROUBINI, cet économiste américain d’origine iranienne, s’est terriblement singularisé, début 2008, en prédisant la catastrophe des prêts hypothécaires aux Etats-Unis (« subprimes »). Tous ses collègues l'appelaient Cassandre : à présent, c'est plus un Cassandre, c'est un grand savant. Combien sont-ils dans le monde ? En France, on connaît maintenant PAUL JORION (l’homme au blog), qui avait aussi prévu la crise de 2008. Il prédisait hier la désintégration de l’Europe. Faut-il espérer qu’il se trompe ? De tels économistes, il doit y en avoir quelques autres dans le monde. Mais ils sont l’exception : dans l’ensemble, la profession se trompe régulièrement, incapable de seulement anticiper les événements. Or la profession, ce sont les « experts », et les « experts », ils sont où ? Ils enseignent l’économie, pardi. Ils forment de futurs économistes. Certains deviendront profs à leur tour, et la boucle est bouclée. C’est comme le poisson rouge dans son bocal : il tourne en rond. On serait dans les biotechnologies, on appellerait ça le « clonage ». On n’est pas près d’en sortir.
Je ne m’attarderai pas sur la folie furieuse de l’économie financière, sur la dictature des marchés et des « agences de notation », sur la récente et la peut-être future catastrophe. Je ne suis pas « expert », moi. Je me contente de regarder (et de subir, comme tout un chacun) la voracité de ce tout petit monde qui fait la loi au reste du monde. Je m’intéresse quand même à son fonctionnement, après tout, je suis concerné. J’ai donc mon mot à dire. Des gens plus qualifiés s’y intéressent aussi. ALBERT JACQUARD : J’Accuse l’économie triomphante ; VIVIANE FORRESTER : L’Horreur économique ; EMMANUEL TODD : Illusion économique ; et j’ajoute, pour faire bonne mesure, l’économiste JOHN KENNETH GALBRAITH : Les Mensonges de l’économie. Il n’a pas été Prix Nobel d’économie, celui-là ? Sauf qu’en fait de Prix Nobel (c’est-à-dire ceux fondés par ALFRED NOBEL en personne), il y en a CINQ et pas un de plus : médecine, chimie, physique, paix, littérature. Prix Nobel d’économie : inconnu au bataillon ! Oui, il existe un Prix d’économie, décerné (depuis 1968 ?), par la Banque de Suède, que les journalistes traduisent (faut-il qu’ils soient paresseux !) Prix Nobel. Là encore, donc, un simple ABUS DE LANGAGE. L'économie est bourrée d'abus de langage.
Bref, les quatre auteurs ci-dessus (dont un Prix « Nobel » donc) s’en prennent à l’économie en tant que telle. Todd, par exemple, parle en 1998 du « projet d’une impossible monnaie européenne » (c’est moi qui souligne). Lui aussi, il croit que l'Europe va se désintégrer ? Peut-on parler d’économie quand on n’est pas un « expert » ? La réponse est définitivement OUI ! C’est comme en psychanalyse, où vous avez JACQUES LACAN d’un côté, et de l’autre des gens comme DIDIER ANZIEU. L’un jargonne à qui mieux-mieux, et ça intimide, et ça impressionne les gogos. L’autre explique des choses complexes dans une langue claire qui cherche avant tout à être comprise. La plupart des économistes jargonnent, avec l’intention bien arrêtée de maintenir le profane hors du cercle des initiés. Mais tous ces gens, finalement, n’ont aucune certitude, mais aussi aucun compte à rendre (mais quel responsable, aujourd’hui a des comptes à rendre ?). Ils peuvent, crise après crise, continuer à SE TROMPER (soyons indulgents : en CHANGEANT D'ERREUR à chaque fois, en adoptant une erreur différente, parce que nous, on a oublié la précédente, et c'est bien, parce que, comme ça, tout le monde croit ce qu'ils disent A PRESENT) dans les mêmes médias : voyez le petit ALAIN MINC qui, en tant que « consultant » (ça veut dire « expert » je suppose) grassement rétribué, continue à « conseiller » les puissants.
Moi, ce que je comprends, dans les diverses (et opposées) théories économiques, c’est que le fait même qu’il y ait des théories économiques est en soi une IMPOSTURE. (Je ne reviens pas sur celle que constitue le mot « science ».) Parlons de DOCTRINE, ce sera plus honnête. Le mot « théorie » est fait pour impressionner, rien de plus. En fait, ce que ne disent pas les « experts », c’est que dans leurs « théories », il y a moins d’ ECONOMIE que de POLITIQUE. Les fantoches « politiques » (vous direz que j’abuse des guillemets, mais il les faut) qui défilent sur les écrans et dans les journaux sont précisément cela : des FANTOCHES. Ils nous font croire qu’ils font de la politique, alors que la politique, elle se fait aux derniers étages des GOLDMAN SACHS et autres multinationales, elle se fait dans ces merveilleux endroits répartis sur toute la planète, monde sur lequel l’argent ne se couche jamais (bien content de ma formule). On appelle ça les « bourses » (c’est cruel pour les mâles, mais il est vrai qu’une bourse, ça se remplit et ça se vide : pardon. Il y a bien dans ma belle ville une rue Vide-bourse !).
Sarkozy et ses complices du G 8 font semblant d’être des acteurs, d’avoir du pouvoir, pire : ils nous font croire qu’ils savent ce qu’il font, et qu’ils feront ce qu’ils disent. En réalité, ils courent derrière, en essayant de nous convaincre que « la politique a repris le dessus », et qu’ils sont les meneurs de cet Amoco Cadiz. C’est à cette tâche constante (marteler, bourrer le crâne) que se consacre l’industrie télévisuelle et une bonne part de la presse papier (presse-papier ?). Quand, le soir même de son élection, NICOLAS SARKOZY va passer la soirée au désormais célèbre Fouquet’s, ce n’est pas parce qu’il est ami de quelques milliardaires. Il n’est pas le chef, ce soir-là : il est le LARBIN. Les gars autour de la table, disent : « C’est bien que tu sois élu. Maintenant, tu vas pouvoir faire NOTRE POLITIQUE ». Dites-moi si je me trompe : est-ce que ce n’est pas comme ça que ça s’est passé effectivement ?
Allez : la vie est belle et c’est tant mieux (il faudra que je trouve une formule plus personnelle. « Et c’est ainsi qu’Allah est grand », par exemple. Ah mais je m’aperçois qu’ALEXANDRE VIALATTE me l’a ôtée de la bouche, il y a déjà quelques décennies).
10:57 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, économie, société, politique, nicolas sarkozy, science, débat, claude allègre, nouriel roubini, paul jorion, alexandre vialatte, et c'est ainsi qu'allah est grand

