samedi, 20 juillet 2019
VIALATTE ET LA CHALEUR
Parcourant, en façon de révision estivale, les chroniques d'Alexandre Vialatte compilées par sa grande amie Ferny Besson et publiées par la maison Julliard (treize volumes, je crois), il m'arrive de tomber, une fois de plus ébahi (mais c'est toujours une fois de plus et toujours ébahi), sur quelque aperçu saisissant de bon sens et de vérité, à propos de quelque curiosité littéraire ou esthétique, condensé dans une formule définitive.
Cette fois, c’est dans Pas de H pour Natalie (Julliard, 1995) que j’ai trouvé la pépite. A propos de Céline, ce pestiféré. Il est en train de parler des grands maîtres en littérature. Qui sont marqués d’une propriété étonnante : ils sont « réconfortants », ils offrent un « schnaps aux autres hommes », il y a, dans leur écriture « quelque chose de roboratif ».
Attention : « Ce réconfort peut se trouver dans le plus noir pessimisme s’il est inspiré par autre chose qu’une mécanique à fabriquer des mots. Quoi de plus décourageant, objectivement, que Céline ? Quoi de plus amer que sa vision des hommes ? Quoi de plus malodorant que ses châteaux de bouse de vache qui se reflètent dans un flot de purin ? Mais ils sont si monumentaux, il a fallu pour les bâtir tant d’enthousiasme, de verve, de génie créateur, qu’il emporte l’admiration, le rire, le déchaînement lyrique ».
Et c’est là que je fais mon pointer de pure race, vous savez, ce chasseur qui, quand il renifle le faisan blotti dans le buisson, s'immobilise de façon si soudaine qu'il semble changé en statue de pierre : je marque l'arrêt, pile en sursaut : « D’autant plus qu’une telle amertume ne peut être le fait que d’une égale déception, et pour être tellement déçu il faut s’être fait des hommes une idée bien grandiose. Il faut les avoir trop aimés. »
Là je dis : admirable de justesse. A peine quelques mots, et voilà Céline tout entier, avec sa littérature du dépit amoureux, de la rage du déçu qui ne cesse d’injurier son idéal, parce qu’il lui en veut à mort de n'avoir pas tenu ses promesses, pire : de s'être désintégré sous ses yeux, laissant l'adolescent exalté devant le cadavre puant du paradis promis. Une leçon d'analyse littéraire : au cœur du sujet, sans contorsions cérébrales.
Et Vialatte élargit son propos : « Résumons-nous : si, comme le disait Gide, ce ne sont pas les bons sentiments qui font la bonne littérature, c'est tout de même, de façon ou d'autre, le cœur qui passionne le débat. Il faut que le lecteur sente derrière le talent je ne sais quelle épaisseur ou quelle chaleur humaine, quelle vitalité contagieuse, quel "amour" disait Goethe (j'aimerais dire "allégresse").
Il y a des œuvres et des auteurs, qu'on touche comme des serpents ou comme des mécaniques ; ils refroidissent la main comme le fer ou le boa. Je crois que les grands auteurs sont les grands mammifères : ils ont le sang chaud, le poil fourni, la robe luisante. Touchez-les en hiver, la main revient réchauffée.
Pourquoi tant d’œuvres passent-elles si vite malgré le vernis du badigeon, ou même le papier à fleurettes, malgré le talent pour employer le mot qui convient ? C'est qu'il est tendu sur du vide, sur un lattis, ou sur un mur lépreux. On ne sent pas, sous cette pellicule, le frémissement du cuir, la chaleur animale. Si vous tapez dessus, le papier crève. Au contraire, attrapez Dickens, Rabelais, Saint-Simon ou Montaigne ; frappez fortement sur la croupe, et c'est comme un grand cheval qui se met à marcher ; la vapeur lui sort des naseaux, son pas égal et fort fait résonner le village ; montez dessus et vous irez loin. »
Alexandre Vialatte évoque ensuite, pour illustrer son espèce de théorie littéraire (Vialatte n'a pas de théorie littéraire, mais une attitude morale, en fin de compte), la personne de Marie-Aimée Méraville, qui vient d'être enterrée à Condat : « Courageuse, modeste, auvergnate », femme obscure et bel écrivain qui a enseigné toute sa vie à Saint-Flour, pour qui il éprouve de l'admiration, pour la raison même qu'il vient de développer. « Je ne sais, mais la plupart des morts tendent aux vivants, du fond de la tombe, une main glacée. Méraville leur tend une main chaude. » Le vrai lecteur est une caméra thermique.
On n'arrive pas à définir ce qui donne à une œuvre l'animation de l'existence palpitante. Mais quand on est en présence, on le sait, point, c'est tout. Mine de rien, en quelques mots, Alexandre Vialatte vient de répondre à la vieille question : « Qu'est-ce que la littérature ? – C'est la chaleur animale. »
***
"Considérations sur la tombe de Marie-Aimée Méraville" est paru dans La Montagne le 24 septembre 1963.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, littérature française, pas de h pour natalie, marie-aimée méraville, dickens, rabelais, saint-simon, montaigne, louis-ferdinand céline, ferny besson, éditions julliard
vendredi, 02 février 2018
LE DÉBAT FAIT RAGE
La France (non : la ville de Paris) doit-elle accepter que le "Bouquet of tulipes", cadeau fait par l'artiste Jeff Koons en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 (?), soit installé entre le Musée d'Art Moderne et le Palais de Tokyo ?
LE DÉBAT FAIT RAGE;
Faut-il rééditer Mein Kampf, d'Adolf Hitler ?
LE DÉBAT FAIT RAGE.
Faut-il autoriser ou non la "gestation pour autrui" pour les couples de lesbiennes ?
LE DEBAT FAIT RAGE.
Les hommes ont-ils le droit d'importuner les femmes dont ils apprécient la physionomie, l'allure, l'apparence ou la plastique ?
LE DÉBAT FAIT RAGE.
L'éditeur français qui possède le plus beau catalogue de littérature du vingtième siècle a-t-il le droit de rééditer Bagatelles pour un massacre, le gros pamphlet antisémite de Louis-Ferdinand Céline ?
LE DÉBAT FAIT RAGE.
Est-il légitime que l'on fasse figurer, dans le livre 2018 des commémorations nationales, les noms de Charles Maurras, antisémite notoire, et de Jacques Chardonne, collaborationniste notoire (ajoutons le Simon de Montfort de la croisade contre les Albigeois, 1208-1229) ?
LE DÉBAT FAIT RAGE.
Cette liste n'est pas limitative.
******************
D'une manière générale, les débats font rage en France.
Je propose, comme réponse à la question « Qu'est-ce que l'identité de la France ? »,
le hashtag
« #balancetondébatfaitrage ».
Cela donnera aux bouches des exaltés de tout bord une raison renforcée de lancer des flammes. Cela donnera à toutes sortes de phraseurs (espèce animale déjà surabondante et encore en voie de prolifération : le phraseur, espèce envahissante, invasive et irrespirable) – intellectuels venus de l'université et faisant autorité, ou militants moralisateurs d'associations menant tous les combats des "justes causes" – encore plus d'occasions et de raisons de graver dans le château de sable du bronze de la presse quotidienne, les grandes formules définitives de leurs convictions ardentes.
******************
Un point commun unit tous ces "débatfaitrage" : lecteur perspicace, sauras-tu le retrouver dans le tableau ?
16:06 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeff koons, bouquet de tulipes, art contemporain, mein kampf, adolf hitler, gpa, location d'utérus, gestation pour autrui, lesbiennes, lgbt, droit d'importuner, balance ton porc, harcèlement sexuel, catherine deneuve, gallimard, louis-ferdinand céline, bagatelles pour un massacre, charles maurras, jacques chardonne, simon de montfort, croisade des albigeois, commémorations nationales, identité française, le débat fait rage, antisémitisme, palais de tokyo koons
lundi, 04 juillet 2016
AU FOND DES OUBLIETTES
Je peste assez régulièrement contre les politiciens qui persistent à plonger depuis des décennies la France dans des réalités qui ne sont que bourbiers marécageux. Et je supporte d'autant moins leur hypocrisie quintessentielle qu'ils passent leur temps à brandir bien haut l’étendard purement fictionnel des principes et des « valeurs » de la « République ».
Or je viens de tomber sur quelques citations qui m’ont donné l’impression de me retrouver en terrain connu, dans une atmosphère soudain fraternelle. Jugez plutôt : « Républicains, oui, nous le sommes. Et c’est pour cela justement que, dans certaines figures barbouillées de mensonge et d’effroi, nous refusons de reconnaître l’austère visage jacobin. La République, ça ? Allons donc ! la République, cette puante macédoine de faisans, de mendiants, de prévaricateurs ? … L’héritage des "grands ancêtres", ce refuge de la combine, de l’injustice, de l’impunité ? Ah, messieurs, vous voulez rire ! ». Rudement bien tapé, et en plein milieu de la cible ! Et avec le style, s’il vous plaît ! Cette plume porte des griffes au bout de son génie.
Ceci est écrit en 1934, figure dans Pavés rouges, ouvrage d’un auteur qui ne figure même pas dans Le Nouveau dictionnaire des auteurs – pour dire si les pouvoirs en place ont tenu grandes ouvertes les oubliettes de l’histoire pour un homme jugé si indésirable que, au moment de la Libération, il a été condamné à mort, avant que sa peine soit commuée, sans doute à la demande de François Mauriac, en travaux forcés à perpétuité.
Quel est ce danger public ? Ce « traître à la patrie » ? Il s’appelle Henri Béraud. Disons-le : un grand écrivain. Un des grands scandales, une forfaiture, une injustice commise par l’histoire officielle de la littérature telle qu'elle s'est écrite au second vingtième siècle. Qu’avait-il fait, Henri Béraud, pendant la guerre, pour mériter une telle vindicte de la part des vainqueurs ? On se dit que ça devait être très grave : collaboré avec les nazis, pour le moins. Il a bien failli finir comme Paul Chack, cet authentique nazi français, dont je garde pourtant bon souvenir de quelques livres dans la veine héroïque (Ceux du blocus, Hoang Tham, pirate, La Bataille de Lépante), et qui a fini fusillé au fort de Montrouge.
Henri Béraud ? Vraiment rien à voir. Tiens, la preuve, il allait jusqu’à écrire, après la défaite de 1940 : « Une douleur qui n’a point de nom frappe notre peuple. A cette heure, les restes de tous les chevaliers et de tous les paysans de France ont tressailli sous la terre. Ceux qui pendant vingt siècles ont fait ce pays entendent sur leurs ossements frapper le pas lourd de l’étranger … Je pense à tous ceux qui, saoulés de paroles vaines, ont osé souhaiter la victoire de nos ennemis, sans songer, les malheureux, que cette victoire les chargera des chaînes les plus pesantes et les mieux rivées ». Si ce n'est pas d'un patriote, cette envolée, alors moi je suis chèvre. C'est que lui, Béraud, il a connu la boue, les rats et les poux des tranchées. La mort, il l'a vue de près. Et la guerre lui a volé sept ans de sa vie (« sept ans de caserne », dira-t-il).
Et en plein 1942, même pas peur, il récidive : « Si devant l’Allemagne en armes et sûre de sa force, vous trahissez vos morts en penchant des fronts d’esclaves, l’Allemagne haussera les épaules et n’aura pour vous que mépris. Tiens-toi droit ! disions-nous à nos fils. Un Français de 1942 doit être Français et rien que Français … Nous voulons des Français debout … Debout, camarade, et tiens-toi droit ! ». Non mais vous vous rendez compte ? Dire ça en face à l'occupant ? Est-il sérieux de l’accuser d’ « intelligence avec l’ennemi » ? Non seulement ça a du style, mais il fallait oser ! J'appelle ça « Avoir de la gueule ».
Allez, je crache le morceau : je tire ces citations de l’excellente (quoique non sans faiblesses) biographie d’Henri Béraud par Jean Butin (Henri Béraud, Horvath, 1979). La mise au placard de cet auteur majeur de la première moitié du 20ème siècle permet de faire oublier en même temps qu’il fut un immense journaliste-reporter, à l’égal d’Albert Londres, dont il était l’ami, qui a donné son nom à la plus belle récompense dont rêvent les journalistes en France. Il n’y a pas de « prix Henri Béraud ». Et ça permet de faire oublier qu’on lui doit le prix Goncourt de 1922 (Le Vitriol de lune). En littérature aussi, c'était quelqu'un. Mais que peut un individu face à la doxa de l'opinion dominante ?
On peut lui reprocher diverses peccadilles, comme celle d’avoir été antisémite, mais qui ne l’était pas, à l’époque ? Aujourd'hui c'est tellement mal vu que tout le monde est philosémite ! Ce n’est pas Henri Béraud qui a écrit Bagatelles pour un massacre. Mais s’il n’aimait pas les juifs, il détestait aussi cordialement les Anglais (qui se sont pourtant fait massacrer dans la Somme en 1916). Ah oui, il avait encore le tort d’aimer Pétain. Comme à peu près 40.000.000 d’autres Français du temps. Il avait sûrement plein d'autres défauts. Ceux qui avaient fait les bons choix lui ont fait payer l'addition ... et au-delà.
Mais pour en parler plus à fond, je dois laisser la parole à mon ami Solko, qui sait par cœur tout son Béraud, jusque dans le moindre détail.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, henri béraud, jean butin, henri béraud éditions horvath, république, pamphlet, polémiste, pavés rouges béraud, nouveau dictionnaire des auteurs, traître à la patrie, françois mauriac, paul chack, ceux du blocus, hoang tham pirate, la bataille de lépante paul chack, nazisme, occupation allemande, libération de paris, épuration 1944, patriotisme, prix albert londres, louis-ferdinand céline, bagatelles pour un massacre
jeudi, 31 décembre 2015
LE REGARD DE PHILIPPE MURAY

Je tombe, dans la lecture de Ultima necat II (1986-1988), le Journal de Philippe Muray, sur un passage hautement délectable où l’auteur manifeste tout l’acéré du regard qu’il convient de jeter sur la comédie médiatique qui se joue inlassablement depuis la prise de pouvoir de la télévision (et des écrans en général) sur les populations. Muray, c’est le moins qu’on puisse dire, garde ses distances avec le siècle. Le passage en question nous fait remonter au 26 avril 1987, à l’époque de la gloire de Bernard Pivot et d’ « Apostrophes ». BHL est déjà ce qu’il est resté : une baudruche.
« La petite séquence de cet « Apostrophes » d’il y a quinze jours était parfaite comme apologue. Pivot invite Bardèche et Lévy qu’il met côte à côte (le bourreau d’il y a quarante ans et sa victime – mais le bourreau est devenu un vieillard gâteux rabougri que la victime, fringante, va se payer). Règle : Pivot n’invite un « célinien » que s’il est vraiment vieux, débile, collabo, etc. (ou alors universitaire aseptisé : Godard ; ou bon gros goy con : Vitoux). A côté de Bardèche, donc, l’homme « moral » (Lévy : l’imposture incarnée, l’ignoblerie image d’Epinal, Mafia sous discours de Vertu surgelée ; Lévy c’est le Parrain pieux brûlant un cierge à la Madone pour le repos de l’âme de celui qu’il vient de refroidir), l’homme des médias, c’est-à-dire le héros du kitsch sans réplique et des bonnes intentions perpétuelles (en privé, bien sûr, totalement escroc, langage de gang, etc.). Bardèche débite ses énormités d’un autre âge, ses conneries cuites et recuites ; l’homme moral fait semblant de monter sur ses grands chevaux ; et finalement, parce que l’homme moral n’a pas (ne peut pas avoir) de pensée, il est obligé de m’utiliser, de me citer, de se servir de mon Céline contre Bardèche. On se demande alors pourquoi, à la place du collabo salaud répugnant et de l’homme moral creux et faux, on ne m’a pas invité, moi, qui sers d’argument, donc qui suis quelque chose (mais à condition de rester absent, hors écran, sans image), alors que Bardèche n’est que le souvenir d’un vieux crime et Lévy la trace sale de l’imposture actuelle. »
Tout cela est on ne peut plus juste, et au surplus, bien envoyé. On savait déjà que Pivot aurait pu chausser son nez d’un accessoire rouge, tant il a joué les clowns télévisuels. Quant à BHL, je ne m’abaisserai pas à essuyer les semelles de ma prose sur ce paillasson.
D’autant qu’une note ajoutée par l’auteur le 16 octobre 1988 précise : « Sachant tout cela, je suis quand même tombé dans le piège quelques mois plus tard ! Ne pas oublier que Lévy, à l’époque de cette émission, est en train de piller (mais je ne l’ai su qu’en mai 88) un autre de mes livres pour écrire son roman sur Baudelaire, et s’apprête à publier, pour l’étouffer, mon propre roman ». Bernard-Henri Lévy est décidément un petit monsieur détestable.
J’en voudrais presque à Michel Houellebecq de s’être prêté à la pauvre comédie exhibitionniste de la fabrication d’Ennemis publics, ce livre dont il sort de façon à peu près honorable, pendant que le pseudo-philosophe étale, étale, étale, étale, …
Voilà ce que je dis, moi.
Note : je trouve tout à fait honnête, voire estimable, la biographie de Céline par Henri Godard (Gallimard). Pour le reste, si l'universitaire est "aseptisé", c'est par fonction. Pour savoir si la personne l'est aussi, il faudrait la connaître.
09:05 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, philippe muray, bhl, bernard-henri lévy, bernard pivot, maurice bardèche, louis-ferdinand céline, émission apostrophes, michel houellebecq, bhl houellebecq ennemis publics, les deniers jours de charles baudelaire
jeudi, 10 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 5/9

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS
ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
5/9
Du siècle de la haine.
Comme dit Günther Anders, l’homme, cédant à la tentation de l’ « ὕϐρις » (hubris = démesure) contenue dans la maîtrise de moyens techniques toujours plus puissants, a fini par fabriquer un monde dont il a perdu la maîtrise. Un monde incommensurable avec les moyens proprement et pauvrement humains. Un monde qui a échappé à l'emprise humaine, qui me fait penser au cheval fou lancé sur le marché des Deux Cavaliers de l’orage de Jean Giono, qui détruit tout sur son passage, et que seul le poing formidable de Marceau Jason, d’un seul coup définitif, parvient à stopper en lui brisant le crâne.
Mais existe-t-il un Marceau Jason, pour arrêter le siècle fou ? Restera sans doute le poing dans la gueule. Le 20ème siècle, j’ai enfin commencé à le voir sous son vrai visage : le siècle qui éprouve de la haine pour l’homme. Le siècle de la déshumanisation du monde et de la fin de l’individu, d’émergence pourtant bien récente. Ce que raconte déjà Céline en 1932 dans le Voyage ..., lorsque Bardamu se fait embaucher chez Ford (« Nous n'avons pas besoin d'imaginatifs dans notre usine. C'est de chimpanzés que nous avons besoin »).
Le siècle de la défaite de l’humanité face aux moyens et aux innovations techniques aussi proliférants que la cellule cancéreuse. Le siècle de la défaite aussi face à la marchandisation de tout, y compris du vivant. Le siècle de la défaite, enfin, face à toutes sortes de volontés avides d’exercer le pouvoir sur les semblables. 1) Triomphe de la technique ; 2) triomphe de l’économie ; 3) volonté de pouvoir, le tout a formé, dans une osmose tout à fait logique, un triumvirat de haines conjointes pour combattre l’humanité de l’homme. Pour combattre le sens de la vie.
La technique (alias "l'innovation") à tout prix, le profit à tout prix, le pouvoir à tout prix : voilà la trilogie infernale qui meut le 20ème siècle, le premier qui a montré ce dont est capable l’industrie quand elle est mise au service de la guerre et de la mort, le « grand siècle » des suicides successifs de l’humanité en tant qu’espèce. Quand la machine est lancée et tant qu’elle a du carburant, il n’y a pas de raison qu’elle s’arrête. Le 20ème siècle est un attentat aveugle.
Le 20ème siècle est un long attentat-suicide. Le 20ème siècle est un crime contre l'humanité. Que voulez-vous qu'il fasse, l'art, dans ces conditions ? Ceux qui attendent de la "Culture" un quelconque salut sont des menteurs, ou bien ils font semblant. L'art, la culture, il faut s'en convaincre, n'ont aucun pouvoir : l'art et la culture sont toujours des effets, jamais des causes. Ils n'ont aucune chance de modifier directement la réalité. Surtout au moment où ils sont réduits à n'être que des produits de consommation. Dans l'histoire de l'humanité, l'art a toujours été "en plus", un luxe, après que les besoins vitaux avaient été comblés. L'art et la culture ont toujours été produits dans des collectivités humaines assez prospères pour se considérer comme abouties. Quand la civilisation se dégrade, on ne comprendrait pas que la Culture ne suive pas le mouvement.
Je me suis demandé de quoi pesaient, face à ce champ de ruine, les trésors d’imagination et d’inventivité, l’incessante et considérable créativité dont l’homme a fait preuve au cours de ce siècle damné. Cela vaut-il vraiment la peine, si ça débouche sur des calamités à chaque fois pires que les précédentes ? Un drôle de siècle, en vérité, où l’on a de plus en plus TROUVÉ, tout en sachant de moins en moins ce que l’on GAGNAIT à ces trouvailles (si, mais quoi d’autre, à part le confort, la facilité, l’oisiveté ?). Et en prenant soin d’ignorer ou d’occulter ce qu’on y PERDAIT (la nature, la société, ...). Malheureux ceux qui croient qu’on peut ainsi gagner quelque chose sans perdre ailleurs l'équivalent. Trouver toujours du nouveau est devenu un but en soi. Un Graal matérialiste. Une Dulcinée attendant toutes sortes de Don Quichotte, dans son Toboso crasseux.
Comme dit Baudelaire dans le dernier vers du dernier poème des Fleurs du Mal : « Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau ». Ce slogan devenu l’emblème de la modernité oublie cependant que la 8ème et dernière section du poème où il est inséré (« Le Voyage ») est tout entière placée sous une brutale invocation, puisqu’elle commence ainsi : « Ô Mort, vieux capitaine, … ».
Cette invocation prémonitoire à la mort jette une lumière terrible sur notre obsession de plus en plus effrénée de la nouveauté, de l’innovation permanente, qui est en réalité comme un tsunami silencieux, mais de tous les instants, jeté sur nos points de repère et nos institutions. Ah, les prosternés devant l’idole du « Monde qui change », qu’ils sont pitoyables et dangereux, ces amoureux de la mort !
Voilà qui devrait nous amener à réfléchir et à y regarder à deux fois, au lieu de nous précipiter comme des moutons carnassiers sur la moindre nouveauté (voir ce qui s’est passé dernièrement, lors de la sortie de l’iPhone 6 d’Apple).
Et puis je me suis demandé de quoi pesait, face aux puissants acteurs et facteurs de la catastrophe, le fourmillement des bonnes volontés qui se portaient au secours des malheureux, des démunis, des victimes. Et quand j’ai vu le rapport des forces en présence, je me suis dit que tout ce dévouement avait quelque chose de pathétique, comme un brave cœur qui aurait l’idée de se mettre à vider l’océan avec une petite cuillère au moment précis où la marée monte. J'ai pensé à ça en écoutant, dans l'émission Terre à Terre du 5 décembre, Martin Pigeon parler à Ruth Stégassy de son action - pathétique de faiblesse - contre l'influence omniprésente et presque toute-puissante des lobbies au cœur des institutions européennes, dans le bocal bruxellois.
Alors, l’art, dans ce sombre panorama ? Dans quel état voulez-vous qu’il soit, l’art ? Que voulez-vous qu’il fasse, l’art ? Libérer ? Faire découvrir ? Embellir ? Décrire ? Rassurer ? Transporter ? Elever ? Fouler aux pieds ? Exprimer ? Provoquer ? Enseigner ? Transgresser ? Transmettre ? Décorer ? Railler ? Enrichir l’imaginaire ? Contester ? Consoler ? Materner ? Faire la morale ? Faire passer un bon moment ? Symboliser ? Former la jeunesse ? Distraire ? Corriger la réalité ? Eveiller le sens esthétique ? Occulter ? Choquer ? Nier ? Faire oublier ? Travailler à l’édification des foules ? (pour la préface de Pierre et Jean, de Maupassant, voir billet d'hier).
Voilà, vous avez compris : l’art au 20ème siècle, c’est devenu tout ça à la fois, un véhicule à l’image de son époque : méchant, aveugle et fou. L’époque a, comme on dit, « pété un câble », fracassant toutes les boussoles. L’art a donc, à son tour, forcément, « pété un câble », obligeant les artistes à perdre le nord, à « débloquer », à ne plus savoir où ils se trouvent, perdus au fond d’une fourmilière étendue aux dimensions du monde.
Beaucoup d'entre eux se sont mis avec enthousiasme à cette nouvelle tâche qu’on leur assignait : « pédaler dans la choucroute » (on peut remplacer le plat alsacien, au choix, par l'ingrédient principal du couscous ou par le petit pot de lait fermenté inventé par les Bulgares).
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, drapeau tricolore, art contemporain, musique contemporaine, günther anders, jean giono, deux cavaliers de l'orage, marceau jason, louis-ferdinand céline, voyage au bout de la nuit, bardamu, baudelaire, les fleurs du mal, le voyage, ô mort vieux capitaine, tsunami, émission terre à terre france culture, ruth stégassy, martin pigeon
mercredi, 15 avril 2015
ENNEMIS PUBLICS 2 (MH et BH)
2/4
 Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.
Attention, la lecture d’Ennemis publics n’a pas bouleversé mes hiérarchies : corriger des images et nuancer les couleurs ne saurait modifier une silhouette autrement qu’à la marge. Je considère toujours BHL comme une tête de nœud envahie par l’image qu’il s’est faite de son moi, un bonimenteur toujours prêt à cameloter sa marchandise en plein vent derrière un étal de produits miracles, genre épluche-légumes ou liquide-vaisselle surpuissant. Mais seulement quand l'objectif d'un photographe est là pour enregistrer.
De même, je considère toujours Houellebecq comme un esprit d’une lucidité éminente sur le monde et lui-même. Un des rares à porter un regard neutre sur le merdier dans lequel plonge la civilisation. Une lucidité augmentée d’une franchise étonnante, parfois à la limite de l'impudeur, comme s'il n'en avait rien à foutre. Mais Houellebecq semble guidé de l'intérieur par une nécessité personnelle qui va bien au-delà de sa personne. Le livre esquisse deux façons d’être et de se représenter : ce n’est pas demain la veille qu’un humain se montrera objectif devant son miroir. Le duo/tandem/duel, ici, reste "costume d'époque" (BH) contre (partiellement) "déshabillé" (MH).
La grande différence entre les deux hommes, j’ai en effet l’impression de pouvoir la situer, précisément, dans leur rapport avec le miroir dans lequel ils se regardent et se dépeignent. BHL est peut-être bien plus intelligent que Houellebecq, je ne sais pas, c’est possible. Et ça m'est égal.
Ce qui est sûr, c’est que cet homme est littéralement bouffé par son intelligence, ou plutôt par l’image qu’il s’en est faite. Intellectuellement brillant, c’est incontestable, BHL porte apparemment à bout de bras – si ce n’est aux nues – l'infirmité du fantasme de sa propre intelligence. La preuve, c’est qu’il se prend pour un philosophe. Peut-être pour un penseur.
De même, Bernard-Henri Lévy n’est pas écrasé seulement par le massif cerveau en plâtre qui met fin à ses jours dans l’histoire dessinée par Castaza (cf. hier), mais aussi, littéralement, par la masse des lectures qu’il a faites, par l’énormité de la culture qu’il a accumulée. Je ne cite pas les auteurs auxquels il se réfère : ça n’arrête pas, c’est comme un robinet qu’on a oublié de fermer avant de partir en vacances. BHL est en quelque sorte un dégât des eaux.
Sous la plume de BHL, le Nom Propre prolifère comme le champignon de Champignac dans Z comme Zorglub et L’Ombre du Z. Le même délire onomastique que Yannick Haenel dans Je Cherche l’Italie (cf. mes billets des 14-15 mars), ou Philippe Sollers, très régulièrement à l’oral (pour l’écrit, je n’en sais foutrement rien, parce que devinez).

Le cerveau de BHL doit être bien infirme de quelque part pour éprouver ce besoin maladif de marcher avec autant de béquilles. Personne ne lui a dit qu’il était assez grand pour penser par lui-même ? S’il n’a plus toutes ses références, il a peut-être peur de s’écrouler. Il a besoin du dictionnaire des philosophes et du Who’s who pour mettre un pied devant l’autre. « Le pauvre homme », s’apitoyait Orgon dans (et à propos de) Tartuffe.
Même délire onomastique en ce qui concerne les lieux où l’homme a posé les semelles, du genre : « Je suis de retour à New York, cher Michel, ... » (p. 185), « Je vous écris de Calcutta », « J’étais alors à Bahia », ... Afin que nul n'en ignore : la planète n’a pas de secret pour le philosophe. Délire identique encore pour énumérer les régions où l’intellectuel d’action s’est posé en hélicoptère et en chevalier ardent : Bosnie, Darfour, Tchétchénie, … (notez le zeugma, mais je ne garantis pas l'hélicoptère, c'est « just for fun »).
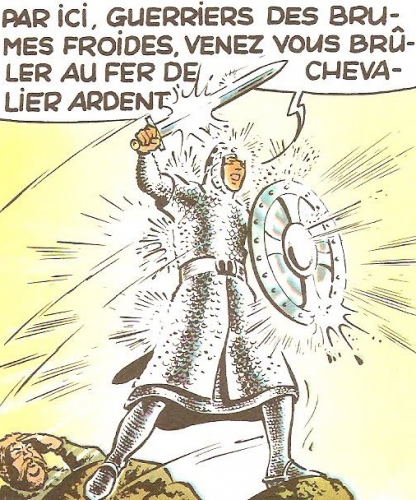
BHL dans ses rêves, Volsungs le barde en est ébloui.
Les Noms Propres ? Comme si la vie de Bernard-Henri Lévy ressemblait en fin de compte à une transposition de la litanie des saints. Il est infoutu de laisser son personnage au vestiaire : il l’emmène partout, un peu comme faisait Alfred Jarry avec son Père Ubu, dont il avait adopté quand il était en société le parler saccadé détachant chaque syllabe (voir le personnage dans Les Faux-monnayeurs, d'André Gide).
Mais Jarry s’affichait, sciemment et tout entier, comme un pur artifice. Il n'y avait pas tromperie sur la marchandise : c'est sans doute de ça qu'il est mort. BHL, lui, quand il sort dans le monde hostile (forcément), dégaine la marionnette qui lui sert à ventriloquer : il est sa propre marionnette. Ça protège.
Alors, le point commun de toutes ces références nominales ? Ce sont des « Grands » ou des « Noms qui frappent », voire des « Autorités », parce que tout le monde les a entendus dans les médias, je veux dire des flashes, des étendards, des pancartes, parfois des banderoles. C’est juste fait pour noyer l'adversaire, pour impressionner : qui oserait ouvrir sa gueule devant ce chapelet ?
Les hooligans, au foot, sont plus souvent dans l’intimidation que dans la violence (mais ça leur arrive). BHL est constamment dans l’intimidation (mais n’hésite pas à menacer un journaliste de lui casser la figure). On finit par se demander : « Mais bon sang, qu’est-ce qui lui manque, pour qu’il éprouve ce besoin de montrer ses muscles ? ». Ce qui ressort aussi de ce salmigondis de noms propres dont BHL soûle son correspondant et le lecteur, c’est, je crois, qu’il se prend pour Malraux. Ou alors Sartre. Peut-être les deux.
Tiens, puisque j'évoque Sartre, j'ajouterai que le "bocal" de BHL est "agité" (coucou, Céline) de deux grands fantasmes : penser le monde aussi superbement (!) que Sartre, agir sur le monde avec autant de « panache » (!) que Malraux (« Ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un », André Breton). J’ai l’impression à certains moments qu’il se prend pour ses modèles, comme s’il y était aliéné. Rêve-t-il d’être à lui tout seul une synthèse accomplie de l’expérience humaine ? Si possible sous le coup de l’urgence (dernièrement les chrétiens d’orient) ? Il a besoin de causes pour exister. Et il doit se dire qu'on n’existe jamais autant que dans le regard des autres. D'où les "causes". Quelles que soient les conséquences.
Être sur tous les fronts, ne renoncer à rien. C’est lui qui l’écrit (p. 287) : « Ne pas choisir, voilà la règle », avant d’embrayer sur les bienfaits de l’opportunisme et de la piraterie. Ne pas choisir : c'était donc ça ! Peut-être le seul véritable aveu qu'il nous livre ici. Le problème, c’est que vouloir être partout, c’est risquer de n’être bon, voire de n’exister nulle part. Du coup, j’en viens à me dire qu’après tout, il est bien possible que BHL n’existe pas, tout simplement.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq bhl ennemis publics, bernard-henri lévy, éditions flammarion, éditions grasset, franquin, bande dessinée, champignac, spirou et fantasio, z comme zorglub, l'ombre du z, yannick haenel, je cherche l'italie, philippe sollers, molière tartuffe, françois craenhals, chevalier ardent, alfred jarry, père ubu, andré gide, les faux monnayeurs, andré malraux, jean-paul sartre, louis-ferdinand céline, l'agité du bocal, andré breton
mercredi, 21 mai 2014
HENRI GODARD ET CELINE
CELINE LE PESTIFÉRÉ
Henri Godard n’a pas eu de chance dans la vie. Etudiant en Lettres, il aurait pu tomber sur les sonnets de Louise Labé, la poésie de Jean-Baptiste Rousseau ou les œuvres de Jean-Baptiste Gresset. Autrement dit, des sujets pépères, tranquilles, sans risque. Mais non, à vingt ans, la marmite de potion magique dans laquelle il se précipite n’est autre que celle des écrits de Louis-Ferdinand Céline.
Et pas n’importe quel titre. Tout de suite c’est D’un Château l’autre. Toute de suite l'essentiel. Vous savez, le bouquin où le pestiféré raconte Sigmaringen (qu'il orthographie « Siegmaringen » par dérision), Pétain fini. Accessoirement, le bébé Philippe Druillet (il raconte ça dans son récent Délirium) y a été soigné par le docteur Destouches (= Céline), parce que son nazi de père s'y était aussi réfugié.
On est alors en 1957. Godard a vingt ans. Résultat, quand, en 2011, Henri Godard propose le nom de Céline et qu’une main administrative, ne voyant aucun obstacle à la chose, inscrit ce nom parmi les célébrations culturelles nationales prévues (c'est alors le cinquantenaire de sa mort), monsieur Serge Klarsfeld, brandissant l'étendard de la « lutte contre l'antisémitisme », obtient en deux jours de Frédéric Mitterrand, alors ministre de la culture, qu’il le raie d’un trait de plume. Rien que le nom de Céline est honni des juifs. Henri Godard n’a pas de chance. Qu'on se le dise : monsieur Serge Klarsfeld est au nombre de ceux qui font la police de la pensée.
Remarquez, ça finira par devenir une habitude chez les amateurs de pestiférés : tout récemment, une vente aux enchères d’objets nazis n’a-t-elle pas été interdite par le conseil des ventes, sur recommandation d’Aurélie Filipetti, ministre de la culture, elle-même interpellée par le vice-président du « Conseil Représentatif des Institutions Juives de France » (Crif), monsieur Jonathan Arfi qui, la vente étant tout à fait légale, se référait à des « valeurs morales ».
Rebelote et censure identique il y a quelques jours, mais cette fois à la demande du responsable d’un « Comité de vigilance contre l’antisémitisme » ! Aux chiottes la légalité ! Vive les « valeurs morales » ! Celles qui sont du bon côté, évidemment ! Ah mais ! Quand on met ces choses bout à bout, ça finit par faire beaucoup. En période d'Inquisition, tout le monde ouvre le parapluie (« barabli », comme on dit en alsacien).
Il ne me viendrait pas à l’idée de me porter acquéreur d’un objet au motif qu’il porte une croix gammée. Il faut être un brin azimuté pour aimer ça. Mais l’idée d'interdire aux amateurs confits dans le culte nostalgique du troisième Reich de satisfaire leur goût bizarre ne peut, à mon avis, germer que dans des cerveaux aussi malades que ceux-ci. Il faut déjà être vigoureusement cintré de la voûte pour avoir l'idée de créer quelque « comité de vigilance » pour protéger les juifs en France aujourd'hui ! Vive la paranoïa au pouvoir ! Pour être une bonne victime, il faut le crier le plus fort possible.
C’est fou quand on pense au nombre de cinglés/victimes qui ont comme principale raison de vivre (dont ils ont fait une raison sociale : « les associations ») de passer leur temps à scruter les mouvements de leurs ennemis (les réacs, les fachos), de pousser les hauts cris dès qu’ils voient le plumet d’un cimier s’agiter au vent et d’appeler les autorités, au nom du Code Pénal et de la Morale, à faire peser la griffe de la Loi (ou plutôt des gens au pouvoir) sur les téméraires qui osent les défier.
Dieudonné est une autre victime récente de cette folie punitive. Je ne cultive aucunement le Dieudonné, ni en pot ni en plein champ, mais ces fulminations haineuses me laissent ahuri et pantois (au fait, quelqu'un a-t-il des nouvelles de la "quenelle" ?). C'est à se demander de quel côté est le Bien, de quel côté le Mal.
Qu’on se le dise, les flics des brigades « ANTI- » (anti-islamophobes, anti-homophobes, anti-antisémites, anti-sexistes, anti-fascistes, etc.) n’ont pas les yeux qui se croisent les bras, ils veillent de toutes leurs antennes et montent au créneau comme un seul homme à la moindre alerte. Et les autorités n’ont rien de plus pressé que de céder à leurs demandes, faites en l’occurrence au nom de la mémoire de l’Holocauste.
Henri Godard était bien gentil, finalement, en ne dénonçant, en 2011, qu’ « une forme de censure ». Je doute quant à moi que cette vigilance chatouilleuse et que cette intolérance exacerbée soient d’une quelconque efficacité contre une montée éventuelle du racisme et de l’antisémitisme. Je ferme la parenthèse.

S’intéresser à un pestiféré comme Céline comme l’a fait Henri Godard, c’est aimer vivre dangereusement. Roland Thévenet (un homme exaspérant et carrément indispensable) en a fait l’expérience, mais lui, c’était à propos de Henri Béraud, autre pestiféré de la Libération, injustement accusé de « collaboration », condamné à mort, gracié in extremis, que je ne place pas – littérairement, s’entend – au niveau de l’auteur de Voyage au bout de la nuit. Alors que le génie de Céline brille dans la collection Pléiade, le talent indéniable de Béraud croupit dans les oubliettes de l’histoire.
 Dire que Henri Godard a consacré sa vie à Céline serait exagéré, mais enfin, il ne dira pas que l’auteur n’a pas occupé une place centrale dans son travail universitaire. J’ai lu, lorsqu’elle a paru, la biographie (ci-contre) qu’il lui a consacrée (Gallimard, 2011) : c’est juste excellent. Je conseille à tous ceux qui sont curieux de savoir à quoi s’en tenir cette lecture roborative, rigoureuse, et même intransigeante avec Céline lui-même.
Dire que Henri Godard a consacré sa vie à Céline serait exagéré, mais enfin, il ne dira pas que l’auteur n’a pas occupé une place centrale dans son travail universitaire. J’ai lu, lorsqu’elle a paru, la biographie (ci-contre) qu’il lui a consacrée (Gallimard, 2011) : c’est juste excellent. Je conseille à tous ceux qui sont curieux de savoir à quoi s’en tenir cette lecture roborative, rigoureuse, et même intransigeante avec Céline lui-même.

Et puis je viens de lire A Travers Céline, la littérature (Gallimard, 2014). Le propos est évidemment tout autre. Henri Godard y raconte comment Céline est devenu inséparable de son parcours personnel. C’est là qu’il raconte la stupéfaction qui fut la sienne à la lecture de D’un Château l’autre (en 1957). Une stupéfaction du Tonnerre de Dieu. Je sais, pour l’avoir vécu, que certaines lectures, faites à un moment décisif, peuvent faire bifurquer une trajectoire individuelle. Ici, Godard peut dire que D'un Château l'autre a décidé de l’orientation de son existence.
Godard n’hésite pas à intituler son premier chapitre « Coup de foudre ». Il n’y a aucune raison de douter que c’en fut un véritable. Quand ça vous arrive à vingt ans, ça ne pardonne pas. Mais il raconte aussi comment, dix ans plus tard, il reçut un choc aussi violent en découvrant par le menu la substance de Bagatelles pour un massacre, long pamphlet de 1937 débordant d’une stupéfiante rage antisémite. Il compte le nombre d’occurrences du mot « juif » : « A eux tous, ils ne surgissaient pas moins de trente-sept fois en à peine quatre pages » (p. 75).
J’ai mis le nez dans les Bagatelles … Eh bien honnêtement, je trouve surtout que c’est de la bien mauvaise littérature. Et puis c’est quoi, ces arguments de « ballets-mimes » dont le bouquin est parsemé ? Je sais bien que Lucette Almanzor-Destouches, son épouse, était danseuse, et qu’elle donnait des cours dans la maison de Meudon, mais je ne vois pas bien l’intérêt, sauf le fait que la traduction en mots des ambiances et des mouvements des danseurs prend un aspect ridicule. Je n'y peux rien. Disons-le, Bagatelles ... m'est tombé des mains.

Alors je comprends bien que Henri Godard se soit senti tiraillé : d’un côté neuf chefs d’œuvre de la littérature française ; de l’autre la traînée d’immondices que le grand écrivain a incontestablement laissée derrière lui. Est-ce que celle-ci est une raison d’occulter ceux-là ? Je dis que non. Il faut savoir ce que l’on regarde. Et ce qu'on garde. Et regarder ce qui en vaut la peine. Appelons cela un clivage si vous voulez.
Je pense à Jean Richepin et à ses « Oiseaux de passage », que Georges Brassens a mis en musique : « Ce qui vient d’eux à vous, c’est leur fiente ». Voilà : les pamphlets sont à considérer comme autant de déjections excrétées de l’anus de Céline. Sans aller jusqu’à appeler « fouille-merde » les horrifiés et les scandalisés qui répugnent à Céline dans son ensemble au seul motif de ses pamphlets antisémites, j’ai envie de percevoir dans l'affichage de ce dégoût un prétexte à justifier une médiocrité de béotien. Le béotien est une figure de la bêtise. Et une bonne conscience à bon compte. Et le conformisme qui tient compagnie à la lâcheté.
Si j'écrivais, des lecteurs aussi fatigués, aussi paresseux, je n'en voudrais à aucun prix ! Et ne parlons pas de la mauvaise foi et de l'hypocrisie.
De toute façon, je garde cette idée formidable de Henri Godard, qui dit quelque part que Céline écrit pour mettre celui qui ouvre son bouquin au défi de le lire et, quand il l'a ouvert, d'aller au bout de sa lecture. Pas de meilleure définition de l'œuvre : Céline écrit à rebrousse-poil de son lecteur.
Le tigre de la provocation est tapi dans le moteur profond des ténèbres de l'écriture de Louis-Ferdinand Céline.
Voilà ce que je dis, moi.
Je mentionne pour mémoire La Mort de L.-F. Céline, l'excellent petit livre, beaucoup plus militant, que Dominique de Roux avait consacré à Céline, après avoir été le maître d'œuvre, me semble-t-il, de deux Cahiers de l'Herne qu'il avait élevés à son grand homme.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, louis-ferdinand céline, henri godard, antisémitisme, juif, klarsfeld, d'un château l'autre, philippe druillet, délirium, frédéric mitterrand, crif, nazisme, dieudonné, henri béraud, roland thévenet, solko, voyage au bout de la nuit, à travers céline la littérature, bagatelles pour un massacre, lucette almanzor, dominique de roux, la mort de l.-f. céline, les cahiers de l'herne
samedi, 28 décembre 2013
IRRECUPERABLE 2
LE MAUVAIS SUJET NON REPENTI (suite)
J’en étais resté à l’ordre moral que s’efforcent de faire régner « les associations », à l’autorité qu’elles tentent d’acquérir, d’une part, en faisant pression sur les responsables politiques pour en obtenir des législations favorables à leurs intérêts, d’autre part, une fois la loi modifiée en leur faveur, de porter les coupables d’infractions à cette loi devant les juges correctionnels pour qu’ils soient dûment punis d’avoir osé attenter aux dits intérêts.
Le plus ancien de ces groupes de pression est peut-être la LICRA : d’après M. Wikipedia, elle est née en 1932, après deux ébauches de 1927 et 1931. C’est un assassinat commis par un juif en plein Paris sur un responsable supposé des pogroms qui affectaient alors l’Ukraine, qui a servi de motif à un certain Bernard Lecache. L’association ainsi créée s’est d’abord appelée Ligue Contre l’Antisémitisme, le mot « racisme » fut ajouté ensuite, sans doute pour élargir l’action de défense à d’autres que des juifs, pour qu’elle paraisse moins unilatérale, donc plus impartiale.
Je ne suis pas prêt à suivre des gens comme Dieudonné M’Bala M’Bala ou Alain Soral sur la piste glissante où ils font la danse du ventre en tendant le bras droit vers le bas et posant la main gauche sur l’épaule. Il paraît que ça s’appelle le « salut de la quenelle » ou, encore plus simplement, « la quenelle ». Le geste est-il antisémite ? Je n’en sais rien et, à la limite, je m’en fiche.
Toujours est-il que certains individus de confession juive l’interprètent ainsi, au point d’organiser des expéditions punitives musclées contre des individus qu’ils ont vu (ou dont on leur a dit que) faire le geste sur les réseaux sociaux. Six d’entre eux viennent d’être mis en examen à Villeurbanne. On en est là.
Mais si je trouve le geste stupide et ridicule, cela reste un simple « geste ». Je veux dire que ce n’est pas un « acte ». Il faut différencier les deux. C'est à la rigueur une provocation. L’expédition punitive menée par des gens qui se présentent comme des « justiciers » de la communauté juive, en revanche, est un acte. C’est même un délit.
Tout ça pour dire que je trouve étonnant, au point d’en être éberlué, qu’on puisse incriminer des auteurs de gestes et de paroles, aussi bêtes et méchants que soient ces gestes et ces paroles. C’est vrai que la « quenelle » n’est pas interdite par la loi, mais le « bras » ou le « doigt d’honneur » le sont-ils ? Tiens, essayez d’en faire un en public face à un haut responsable (préfet, président,…), pour voir.
Les paroles maintenant. Faites comme Edgar Morin (accompagné de Sami Naïr et Danielle Sallenave), signez une tribune dans Le Monde daté 4 juin 2002 intitulée Israël-Palestine : le cancer, où vous dénoncez l’attitude de l’Etat israélien à l’égard des Palestiniens, adoptant à leur égard les procédés mêmes utilisés à l’encontre des juifs au cours de l’histoire, singulièrement sous le règne des nazis : ghettoïsation, persécution, …
Apprêtez-vous alors à subir l’accusation infamante d’ « antisémitisme », portée par deux « associations » : France-Israël et Avocats sans frontières. Il vous faudra aller jusqu’en Cour de Cassation pour être enfin blanchi. Heureusement. C'est un petit exemple du pouvoir de nuisance des « associations ». Leur caractère nuisible est lié à ce qui a motivé leur création : l'arbitraire et le capricieux de leurs dirigeants est à la à la fois leur origine et un corollaire.
Maintenant, quant à moi, je me demande si je ne suis pas antisémite. Non que j’aie quoi que ce soit à reprocher aux juifs en tant que juifs. Pas plus que je n’ai à m’en féliciter. J'ai lu les Bagatelles pour un massacre de Louis-Ferdinand Céline, et j'ai la conviction que l'antisémitisme féroce qui dégouline à presque chaque ligne est le symptôme aigu d'une maladie mentale. Mais ne suis-je pas, comme Edgar Morin, effaré d'observer la volonté d’une partie non négligeable du peuple israélien de perpétuer la guerre qui dure depuis plus de soixante ans en Palestine ?
Ben oui quoi, c’est bien l’électeur majoritaire d’Israël qui porte très régulièrement au pouvoir des gens cramponnés à l’idée que toute cette terre leur appartient. Les plus intégristes de ces malades sont convaincus qu’il est légitime de coloniser la Cisjordanie, et de dégoûter ses habitants arabes au point de les faire déguerpir jusqu’au dernier.
Chaque implantation de colonie juive en territoire arabe est à considérer comme une déclaration de guerre. Peut-on encore rêver un gouvernement israélien modéré ? Peut-on rêver, symétriquement, un Hezbollah pacifique, un Hamas non-violent, si ce ne sont pas des oxymores ? Ecoutez les cours précis et désespérants de monsieur Henri Laurens au Collège de France, où il reconstitue méticuleusement l’histoire du Proche Orient depuis la 2ème guerre mondiale, et vous serez persuadé de l’inextricabilité de l’écheveau et de l’insolubilité du problème.
En attendant, je persiste à trouver profondément injuste l’attitude d’Israël. Si c’est ça, être antisémite, alors … ça voudrait dire que ce sont « les associations » qui ont raison. Ce serait quand même fort de café, non ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antisémitisme, licra, juif, israël, palestine, palestiniens, edgar morin, dieudonné, wikipedia, alain soral, bras d'honneur, sami naïr, danielle sallenave, journal le monde, israël palestine le cancer, apartheid, france-israël, avocats sans frontières, bagatelles pour un massacre, louis-ferdinand céline, hezbollah, hamas, henri laurens
dimanche, 19 mai 2013
AU-DESSOUS DU VOLCAN 1

Je viens de relire le livre de Malcolm Lowry. Quand je l’avais lu – ça remonte à lure de lurette –, ç’avait été une commotion. Une véritable épreuve à traverser à la nage sans avoir appris à nager. A vrai dire, l’idée de commotion était ce que j’avais gardé de ce livre incroyable. Le titre a été retraduit en Sous le Volcan, mais je trouve que ça fait trop forge de Vulcain sous l'Etna, en train de forger le (si si, je vous jure) foudre de Jupiter.
A la réflexion, si je compare avec Ulysse de James Joyce, qui est unanimement célébré par tout ce qui compte dans le monde en matière d'autorité littéraire comme le nec plus ultra de la création littéraire au vingtième siècle, à égalité avec La Recherche et Le Voyage, j'ai bien envie de placer le Volcan de Lowry au-dessus du roman de Joyce, tant celui-ci m'apparaît comme un artefact intellectuel.
Extraordinaire si l'on veut, mais quand même un produit extrêmement cérébral, alors que le Volcan consiste en un plongeon héroïque et poétique jusque dans les tréfonds de l'existence et de la souffrance humaines. Pourquoi cérébral, me demandera-t-on ? A cause du parti-pris d'expérience formelle, qui révèle presque toujours un goût pour les joutes virtuoses et les défis intellectuels, avec sous-entendu : « Essaie d'en faire autant, tiens, t'es même pas cap ! ». Il y a là-dedans de la performance, de l'exploit sportif. C'est donc un peu gratuit, donc un peu vain.
Ce qui pourrait constituer la parenté des deux livres, ce serait peut-être d'illustrer deux voies de recherche possibles, qui sont aussi deux impasses littéraires, sauf qu'à mon avis, Lowry sait parfaitement qu'il se trouve dans une impasse, ce dont, pour Joyce, plus orgueilleux et sûr de sa supériorité, je ne suis pas sûr.
Une personne qui m’est proche, quand elle a reçu du livre Au-dessous du volcan l’autorisation de le lire enfin, après plusieurs tentatives infructueuses où il lui avait interdit de poursuivre au-delà de la page 12, m’a dit que pour sa part, c’était une plainte d’une immense tristesse qui lui parvenait de ses profondeurs.
Pour moi, la tristesse est un mot bien vague. Est-ce le sentiment éprouvé par le lecteur au spectacle de ce qui arrive au Consul Geoffrey Firmin ? Ou une tristesse qui émanerait de la narration elle-même, comme un effet esthétique voulu et élaboré par l’auteur ? Quoi qu’il en soit, curieusement, ce n’est pas cet aspect qui m’a procuré, quand j’ai refermé le livre, cette sorte d’enthousiasme et de jubilation qu’il ne m’a été donné qu’exceptionnellement d’éprouver (Le Temps retrouvé et Moby Dick font partie des derniers en date). Etrange, n’est-ce pas ?
Je parle bien sûr d’une émotion spécifiquement littéraire, du genre de ce qu’on ressent après avoir lu ce qu’on appelle un chef d’œuvre, un de ces Everest de la littérature qui donnent au lecteur – je ne trouve pas d’autre mot – un sentiment de gratitude. Je veux dire un de ces livres après lesquels on peut à bon droit se féliciter d’avoir vécu jusque-là, ne serait-ce que parce qu’il existe et qu’il parvient à ce miracle : procurer de la joie. Je pèse mes mots.
C’est vrai qu’a priori, Au-dessous du volcan n’est pas de ces livres qui prédisposent à l’optimisme. Mais je ne suis pas sûr que la littérature ait à jouer le rôle d’antidépresseur, non plus que de pousse-au-crime, ni d’encouragement au suicide. La littérature telle que je l’entends a pour objet de créer de la beauté, en s’efforçant de fabriquer un cadre et de donner un sens à l’existence humaine. Une œuvre d’art chargée à ras bord d’un poids de « vraie vie ». Et pas ailleurs, mais bien ici. De ce point de vue, la lecture du livre de Malcolm Lowry comble le lecteur que je suis.
Comme dans Les Passantes de Georges Brassens ou La Vierge à l’enfant et deux anges de Fra Filippo Lippi (visible aux Offices), l’adéquation miraculeuse (inexplicable) de la chose et du moyen par lequel elle est exprimée. Bon, j’arrête avec les comparaisons vaseuses, c’est juste pour dire le principe : quelque chose de rigoureusement unique se passe quand ce que veut dire un bonhomme entre en résonance parfaite avec sa façon de le dire. Quand l'unicité du fond qu'il y a mis épouse idéalement la forme qu'il a façonnée.
Ne serait-ce que pour ça, Au-dessous du volcan est un livre unique.
Voilà ce que je dis, moi.
mardi, 02 avril 2013
DE L'EXPANSION DE L'UNIVERS (ARTISTIQUE)

LE REVOLVER "1892", CALIBRE 8 mm
(après le Mauser C96, le Luger P08, et même le Webley 455 britannique, sans parler du Colt 1911, les performances balistiques de la munition furent considérées, avec raison, comme des plus médiocres, même si l'arme reste classée en 1ère catégorie)
***
On a vu que l’artiste actuel essaie de se faire passer pour un scientifique, dont il imite l’activité de recherche, sans pouvoir prétendre au même degré de scientificité que lui. Il ne parle plus de ses « œuvres », ni même de ses « ouvrages », mais du terme très neutre de « travail ». Il la joue modeste. Il a compris que c'est son intérêt, même si cette modestie cache un immense orgueil.
Il va de soi qu’une telle évolution ouvre la voie à une foule de gamins qui auraient reculé devant l’effort et l’abnégation que suppose le métier. Et comme il faut donner du boulot à toute la surpopulation, il n’y a pas trente-six moyens.
Tiens, prenez la grande question : « Qu’est-ce qui est beau ? Qu’est-ce qui est laid ? ». Ajoutez-y : « Qu’est-ce qui est de l’art ? Qu’est-ce qui n’est pas de l’art ? ». Question subsidiaire : « Qu’est-ce qu’un artiste ? Qu’est-ce qui n’est pas un artiste ? ». Là, on est au cœur du sujet. La réponse à cette rafale de questions simples est d’une simplicité raphaélique du fait de la pléthore d'artistes potentiels :
TOUT EST BEAU
TOUT EST DE L’ART
TOUT LE MONDE EST ARTISTE
TOUT LE MONDE IL EST BEAU IL EST GENTIL.
Ça ouvre plein de possibilités, même aux élèves les plus nuls. C'est ça, la démocratisation. Ou plutôt l'extrémisme démocratique. Et cela repose sur ce principe à marteler fortement : « On a tous le droit ! ».
En musique, c’est tellement évident qu’il n’y a pas trop lieu d’insister. Depuis les recherches du petit Pierre Schaeffer, la question est résolue sans ambiguïté : tous les bruits produits dans la nature et hors de la nature sont désormais de la musique. A égalité. Ah mais !
Seuls quelques vieux ronchons s'attachent encore aux beaux instruments de bois ou de cuivre. Seuls quelques orfèvres de la lutherie façonnent amoureusement de tels objets, qui ne doivent de ne pas avoir été guillotinés qu'au fait qu'ils sont dépourvus d'un cou formant transition entre un tronc et une tête.
Les ci-devant « instruments de musique » (notez la particule nobiliaire), c'est donc bien clair, ne produisent que des bruits parmi des myriades d’autres : le monopole qu’ils ont exercé depuis l’aube de l’humanité est un scandale auquel il a heureusement été mis fin, après des millénaires de dictature élitiste et arrogante.
Et le public ne s’est progressivement accoutumé (et encore !) à la « musique contemporaine » que parce qu’on lui a fait ingurgiter de force, au gavoir à canards, pendant trente ans, une foule de concerts sandwiches, où les organisateurs, dépensant des trésors d’ingéniosité dans la programmation, introduisaient une tranche de jambon contemporain entre deux tranches de pain classiques, plus ou moins beurrées pour aider à avaler.
Notez que la stratégie s'est révélée d'une grande habileté. D'abord on y va mollo : quelques espagnolades, un peu de flamenco et de gamelan balinais. Il faut à ce stade s'appeler Varèse pour marier de vieux sons dans des partouzes tout à fait neuves, bien faites pour émoustiller les sens de quelques vieux blasés avides d'érections nouvelles, et pour horrifier dans le même temps l'âme intègre de tous les autres, restés des auditeurs candides.
Ensuite le système des douze sons égaux. Ensuite on pousse les vieux instruments dans leurs derniers retranchements, jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme (du violon), en leur tapant dessus, en les engueulant comme du poisson pourri, en leur faisant dire des horreurs dont ils ont honte (je me rappelle un concert dirigé par Ivo Malec en personne, quelle triste expérience pour un jeune musicien plein d'espoir !). Quel triste spectacle que de voir un violoncelliste fouetter son instrument de son archet, pendant que ses voisins de quatuor passent un doigt mouillé sur le bord d'un verre a pied en cristal à moitié rempli) !
Ensuite viennent tous les instruments du monde, appelés à la rescousse. Ensuite viennent les moyens offerts par l'électricité, l'électronique et l'informatique : rendez-vous compte, tous ces sons potentiels, on ne pouvait pas les laisser au chômage, il fallait leur trouver un emploi. Pour couronner le tout débarquent en trombe tous les bruits du monde (Pierre Schaeffer et suiveurs), j'en ai déjà parlé.
Moralité : la musique occidentale explore à tout-va et dans l'enthousiasme des contrées sonores inconnues, pose le pied sur des planètes improbables, découvre des continents sur lesquels se jettent des armées d'oreilles saturées de sons du passé. En musique, comme en bien d'autres matières, l'Occident est un collectionneur monomaniaque effréné, un dangereux psychopathe atteint de kleptomanie compulsive aiguë, à l'instar d'un certain Aristide Filoselle (Le Secret de la Licorne, p. 59).

En littérature, si c’est moins évident, c’est juste parce que – du moins en France – les tendances expérimentales n’attirent que des groupuscules faméliques de militants de la nouveauté, portant des visages émaciés, graves et fiévreux : eux seuls ont assez de foi fervente et fidèle pour crier au génie quand Pierre Guyotat publie Eden Eden Eden ou Tombeau pour cinq cent mille soldats.
C’est sûr qu’après Ulysse de James Joyce, Mort à crédit de Céline, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry et quelques autres, l’idée d’imposer la sacro-sainte, obligatoire et quasi-statutaire « rupture », dans une surenchère du meilleur aloi dans le travail sur les moyens d’expression romanesque, est devenue pour le moins difficile à mettre en œuvre.
Le minuscule Philippe Sollers a sans doute voulu faire rigoler ses copains de la cour de récréation, quand il a écrit, sans majuscules ni ponctuation (juste parce que Céline s'était proclamé le cinglé en chef des points d'exclamation et de suspension), son livre sobrement intitulé H. Quoi, illisible ? Expérience, on vous dit ! La barre étant placée excessivement haut, quels éditeurs, quels lecteurs auraient assez d'entraînement et de détente des reins pour ne pas la faire tomber en tentant de franchir l’obstacle ?
Quant à la poésie, ce n’est même pas la peine d’en parler : est-ce qu’un poète existe, quand il est rare qu'ils touche 300 lecteurs ? D’autant que la cuisine des poètes actifs après la guerre s’est muée en une infinité de laboratoires secrets, où des alchimistes vaguement barbus se sont mis à extraire de leurs cornues la quintessence de liqueurs mystérieuses, dont l’amateur éventuel ne saurait imaginer l’effet qu’elles produiront une fois ingurgitées.
Je dirai même que le jus qu’on recueillait parfois à la sortie du serpentin de cet alambic forcené était carrément imbuvable. Je me souviens d’un « poème » d’un nommé Jean-Marc, qui commençait par cet inoubliable groupe nominal péremptoire, voire comminatoire : « Les cafards noirs de la lampe à souder ». L'expression, je ne sais pourquoi, s'est gravée. Jean-Marc, si tu me reconnais dans la rue, merci de ne pas me voir.
Remarque, j’ai bien dû pondre quelques horreurs comparables. Quand on est dans l’expérimental, c’est quasiment forcé. Quand on explore des voies nouvelles, on tombe fatalement sur bien des impasses et autres voies sans issue (via sin salida) : il y a donc beaucoup de déchet. La gangue autour de la pépite, quoi. Mais il y a des jours où l'on se dit que non, vraiment, ça fait un peu épais de gangue avant d'arriver à la pépite. C'est vrai, quoi, la vie est courte.
Le gros morceau de l’expérimental reste cependant, détachés loin devant le peloton étiré des principaux moyens d’expression, les « arts plastiques ». Normal, les arts plastiques, ça saute aux yeux, ça envahit votre espace visuel sans vous demander.
Le problème, avec les arts plastiques, c'est qu'ils sont devenus affreusement tributaires du langage (voire de la linguistique), de la pensée, de la formulation, de la capacité de l'artiste à transposer dans l'univers des mots l'esprit de ce qu'il veut donner à voir. Et le cortex cérébral de la théorie esthétique (ou sociale, ou morale, ou politique, ...) alourdit à tel point le crâne de l'art vers l'arrière que celui-ci en tombe sur le cul.
Je ne veux pas trop insister : j’ai déjà donné. Allez juste un aperçu du talent du petit Jan Berdyszak, « only for fun».

AVEC TOUTES NOS SINCERES FELICITATIONS AU PETIT JAN BERDYSZAK !
Je veux juste marquer deux particularités qui découlent de ce qui précède, concernant la création artistique : l’extrémisme démocratique et l’extrémisme totalitaire. Contrairement aux apparences, ce sont deux frères jumeaux, et de la pire espèce : l’espèce monozygote.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, le 1892 d'ordonnance, revolver, arme à feu, art contemporain, musique, art, artiste, pierre schaeffer, instrument de musique, edgar varèse, ivo malec, tintin, les dupondt, le secret de la licorne, pierre guyotat, eden eden eden, tombeau pour cinq cent mille soldats, ulysse, james joyce, mort à crédit, louis-ferdinand céline, malcolm lowrynau-dessous du volcan, philippe sollers, poésie, littérature, arts plastiques
samedi, 10 novembre 2012
VOUS AVEZ DIT LACAN ? (fin)
Pensée du jour :
« Cette chronique ne cesse de se préoccuper de l'homme, de le poursuivre, de le piéger, de le traquer à travers l'apparence, de chercher à tracer son portrait éternel. Tout au moins son ombre chinoise ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé : le style écrit de JACQUES LACAN, c’est bien connu, est une sorte d’Everest pour un lecteur ordinaire. C’était tout à fait concerté et volontaire de sa part. C’en était au point que même ses collègues psychanalystes le trouvaient illisible, et qu’il a dû, dans certaines circonstances que ROUDINESCO expose, faire un (petit) effort de lisibilité.
L’autre aspect négatif de LACAN que je retiens du livre de ROUDINESCO, c’est le caractère très moyennement sympathique du personnage. L’une des principales raisons est l’obsession de l’argent. L’auteur écrit : « A sa mort, à la différence de Balthazar Claës [drôle de renvoi au personnage de La Recherche de l’absolu (BALZAC), mais la 8ème partie du livre porte précisément ce titre], Lacan était donc richissime : en or, en patrimoine, en argent liquide, en collections de livres, d’objets d’art et de tableaux » (p.514). Richissime !
Je me rappelle avoir lu dans le temps (dans la revue Actuel, 2ème mouture) un article insolent sur maître LACAN, illustré entre autres d’un dessin le représentant brassant plein de billets de banque dans un grand tiroir ouvert. Il y avait donc du vrai.
Une de ses filles est d’ailleurs, si je me souviens bien, devenue conseil en immobilier, pendant qu’un fils opérait dans la finance. Sa fille préférée, JUDITH, à la suite de je ne sais plus quel micmac, n’a porté son nom que deux ans, intervalle entre la démarche administrative pour avaliser la filiation et son mariage avec le redoutable JACQUES-ALAIN MILLER, dont elle a adopté le patronyme.
Cette richesse énorme, il la devait à son incomparable maîtrise dans la discipline psychanalytique et à l’incontestable (voire incroyable) succès rencontré par son enseignement auprès de différentes générations d’analystes. Les gens (y compris des célébrités parisiennes) se bousculaient à son séminaire.
Mais cette richesse, il la devait aussi à l’une des raisons qui l’ont coupé des autorités de la profession : la durée de la séance. L’IPA (l’association internationale) tenait à des séances uniformément étendues sur trois quarts d’heure. LACAN inventa la « durée variable », autrement dit les séances réduites à quelques minutes à la fin, voire interrompues au bout de quelques instants.
On se pose forcément la question de l'escroquerie (ce n'est pas la même chose de recevoir 15 patients et d'en recevoir 60 ou 80 dans la journée ; on pense aux "gagneuses" de Barbès qui épongeaient autrefois le micheton à la chaîne et à 100 balles).
Une autre raison est à chercher du côté de la certitude absolue qu’il a de son propre génie, et de la confiance infinie qu’il a en lui-même. Plongé dans sa recherche, plus rien d’autre n’existe que celle-ci. On peut se dire que BALZAC ou CÉLINE non plus ne doutaient de rien.
Mais cela peut rendre les relations délicates : LACAN n’hésite pas à réveiller ANDRÉ WEISS en pleine nuit pour le supplier de lui donner la solution de l’énigme que celui-ci lui a posée pendant la soirée (les « trois prisonniers », intéressant, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, parce qu’il faudrait encore développer). C’est sûr que cela comporte un aspect fascinant.
Qu’est-ce que je retiens d’autre, de la lecture d’un ouvrage consacré à un homme qui a, en son temps, défrayé la chronique ? J’ai connu un homme (que je suis très heureux d’avoir perdu de vue) qui a croisé LACAN. C’était à l’hôtel Pigonnet (catégorie *****, oui, 5 étoiles), à Aix-en-Provence.
Je n’ai pas retenu toutes les circonstances, mais au moment où il était assis dans le salon de réception, il a vu un monsieur descendre l’escalier, se diriger vers l’Accueil pour je ne sais plus quoi. C’était JACQUES LACAN, et d'une, et il était à poil, et de deux. Ma foi, pourquoi pas ? Quand on est riche et célèbre, on peut se permettre l’excentricité, au motif que le riche est plus libre que le pauvre.
Je retiens encore le fait que, si une foule de gens reconnaissent que LACAN a renouvelé en profondeur la lecture de l’œuvre de SIGMUND FREUD, c’est en bonne partie parce qu’il a énormément travaillé les philosophes (et avec eux) de son temps : HUSSERL, JASPERS, KOYRÉ, KOJÈVE, HEIDEGGER, et d’autres plus anciens, dont HEGEL.
Ce sont ses lectures et échanges philosophiques qui ont nourri ce renouvellement. ROUDINESCO pointe d’ailleurs les trois sources de l’inspiration lacanienne : médicale (c’est un médecin), intellectuelle et artistique (copain de DALI et d’ANDRÉ MASSON, passés par le surréalisme). A cet égard, la biographie de LACAN par ROUDINESCO (je dis ça, moi qui n’ai guère de points communs avec la psychanalyse) est un excellent travail de reconstitution d’une démarche et d’une trajectoire, tant pour la vie que pour l’œuvre du personnage.
J’ajouterai pour finir que ce n’est pas un livre sans faiblesses. Celle que je considère comme principale est dans la composition elle-même. Plus on descend le cours du temps, plus l’exposé perd en esprit de synthèse, et tombe un peu, disons-le, dans l’anecdotique, pour ne pas dire le « people ». Et plus on se perd dans des détails qui s’étalent indûment.
Si je peux avancer une explication : l’auteur est entré dans le circuit parisien organisé autour de LACAN à une certaine époque. Et ce dont elle-même a été témoin direct (ou presque) prend une ampleur que n’ont pas des sources plus anciennes (écrits et entretiens divers). Le synthétique résulte d’un travail de reconstruction a posteriori, comme « en laboratoire », le dilué venant d’un relatif manque de recul, dû à la présence "in vivo".
Et le moment où la biographie donne l’impression de s’effilocher et de tirer en longueur, je le situe quand l’auteur devient elle-même partie prenante. Qu’elle soit entrée dans le jeu n’a rien d’étonnant : elle est la fille de JENNY AUBRY (née WEISS, puis épouse ROUDINESCO, puis ...). Le monde est petit, comme on l’a vu avec DIDIER ANZIEU, le fils de MARGUERITE PANTAINE, qui a, sous le nom d’ « Aimée », servi de marchepied (de paillasson ?) à JACQUES LACAN.
Dernière remarque, inspirée par le dernier chapitre, intitulé « France freudienne : état des lieux ». Impressionnant, franchement. Il y avait la SPP et l’APF (je ne détaille pas, le P est pour "psychanalyse", le F pour Freud), augmentées de l’OPLF et du Collège de psychanalystes. Ce sont des associations professionnelles. Ajoutons l’EFP fondée par LACAN. Je me contente d’énumérer la suite : ECF, AF, CFRP, Cercle freudien, CCAF, EF, FAP, CP, Coût freudien (sic !), GRP, Errata, ELP, Psychanalyse actuelle.
Et moi qui croyais que le pompon de la scission et autres formes de scissiparité était détenu haut la main par les sectes trotskistes ! Quel désappointement ! Je vais être obligé désormais de changer de cible, et sans même avoir à caricaturer : la cible se caricature elle-même !!! Parce que la liste ci-dessus s’allonge dès la page suivante : entre 1985 et 1993, pas moins de « quatorze associations supplémentaires ont vu le jour. Six d’entre elles sont des créations nouvelles, deux sont le résultat de scissions, et six sont des lieux fédératifs » (p. 552).
Vous voulez une image du sac de nœuds ? Une représentation du nœud de vipères ? Du merdier ? De la confusion générale ? De l’imbroglio ? De l’enchevêtrement ? Alors, mieux que les sectes trotskistes, ouvrez la caisse aux psychanalystes, regardez-les grouiller, ... et vous serez servis.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, alexandre vialatte, littérature, jacques lacan, psychanalyse, psychanalyste, élisabeth roudinesco, la recherche de l'absolu, honoré de balzac, revue actuel, judith miller, jacques-alain miller, école freudienne de paris, louis-ferdinand céline, sigmund freud, heidegger, husserl, jaspers, kojève, salavador dali, andré masson, jenny aubry, didier anzieu
lundi, 05 novembre 2012
BALZAC 4 PAR MAUROIS
Pensée du jour : « L'homme se sent petit devant l'animal. Le rhinocéros le rend timide, le loup craintif, le chien de garde rapide. L'homme a pour le chat et le basset des indulgences qu'il n'aurait pas pour le sous-préfet le plus distingué ».
ALEXANDRE VIALATTE
J’ai rarement lu des biographies. Pourquoi ? Je n’en sais rien. Peut-être parce que, pendant très longtemps, j’ai été hanté par le fantôme de Lagarde et Michard, augmenté du spectre de GUSTAVE LANSON, vous savez, « Untel, sa vie, son œuvre », les dates qu’il fallait enregistrer sans se poser de question, sans avoir besoin de comprendre. C’est vrai, ça, et c’est une vraie question : « Peut-on expliquer l’œuvre de CÉLINE par la vie de LOUIS DESTOUCHES [le vrai nom de CÉLINE] ? ».
Peut-être aussi m’étais-je convaincu, en opposition avec le tandem imposé par cette grille de lecture « la vie et l’œuvre », que seule cette dernière méritait d’être cultivée pour elle-même, « œuvre » devant être comprise comme « œuvre d’art » ; et ce qui se passe pour les peintres devant se passer de la même manière pour tout artiste : ce qui reste accroché aux cimaises des musées, ce n’est pas la biographie de RAPHAËL ou de POUSSIN, ce sont leurs tableaux.
Ce qui est sûr, c’est que nulle paroi étanche ne sépare le biographique du catalogue des œuvres : il faut bien que l’auteur, s’il est passé à la postérité, ait puisé la matière de ses livres ailleurs que dans l’imitation de ce qui s’est fait avant lui, sinon la postérité aurait préféré l’original à la copie, et il serait tombé dans l’oubli.
C’est exactement ce qui s’est passé dans la peinture et dans la musique : dans les histoires qu’on en a rédigées, les historiens (parfois à tort) ne gardent que les principaux noms qui jalonnent la trajectoire de quelque chose qu’on appellera Histoire de la peinture et Histoire de la musique. Les épigones et les petits maîtres, ceux qui passent au second plan et que ne connaissent que les spécialistes, sont ceux qui, après coup, se révèlent n’avoir rien écrit, peint ou composé de vraiment neuf.
Là, des biographies, j’en ai lu trois, coup sur coup. Je ne me reconnais pas. Comment se fait-ce ? Qu’est-ce qui m’a pris ? Mystère. J’ai commencé par celle de LOUIS-FERDINAND CÉLINE. J’en ai parlé il n’y a pas si longtemps. HENRI GODARD est sans doute celui qui connaît le mieux le bonhomme dans le monde contemporain. Il sait travailler.
Son livre est horriblement documenté, et monstrueusement intéressant. Sans rien taire des côtés sombres de son personnage, de ses faiblesses, et pour tout dire, de sa folie furieuse et géniale, il livre les données d’une vie sans chercher à en dévoiler le mystère inentamable. Ma foi, je suis sorti de la lecture de ce pavé content de ma dépense (25,5 €, Gallimard, 2011, 530 pages à lire), pour ce qui est du rapport qualité / prix.
La biographie de HONORÉ DE BALZAC par ANDRÉ MAUROIS (Hachette, 1965, 622 pages à lire, appendices compris, acheté 4 € au « Livre à Lili », rue Belfort, début octobre), m’a de nouveau projeté sur la planète BALZAC. Un continent, un océan, une planète, je ne sais pas au juste. En tout cas un bonhomme hors du commun, qui, curieusement, s’est très tôt considéré comme hors du commun, et surtout, n’a jamais, depuis l’adolescence, douté de son génie.
Mais qui est devenu un génie à force de travail forcené, toujours poussé par l’urgence de payer ses dettes. Fascinant. C’est d’ailleurs un peu le reproche que je ferais à ANDRÉ MAUROIS, qui cède un peu, tout au long de son ouvrage, à la tentation de l’admiration pour une sorte de colosse d’énergie, et d’une fascination pour l’aspect « course de vitesse avec la mort » présentée par la vie de BALZAC.
C’est en tout ca l’image qui s’en dégage. Sans que ce soit nuisible à l’exactitude, puisque, là encore, les faiblesses du personnage apparaissent en pleine lumière, sans rien ôter jamais à l’impression de puissance créatrice, qui en apparaît dès lors comme tant soit peu magique, pour ne pas dire extraterrestre.
Ce que MAUROIS fait bien partager, et en cela, il faut lui savoir gré, c’est que La Comédie humaine n’est pas sortie de nulle part, et qu’en 1833 (BALZAC a 34 ans), c’est chez un écrivain expérimenté que l’idée prend naissance. Un projet gigantesque, démesuré à l’échelle d’un seul homme. L’esprit encyclopédique de la Renaissance s’appelait PIC DE LA MIRANDOLE.
Eh bien, HONORÉ DE BALZAC est exactement le Pic de la Mirandole du roman mondial au 19ème siècle. L’époque actuelle est, à cet égard, dans un lamentable et désolant état de rabougrissement (« Il vaut mieux être un éléphant qu’un rat … Qu’un rat bougri surtout », dit Obélix à la page 33 du Combat des chefs) pour comprendre la dimension quelque part surhumaine de BALZAC. Ce en quoi on ne peut que suivre MAUROIS dans sa dévotion à Prométhée (titre de son bouquin sur l’auteur : Prométhée ou la vie de Balzac).
J’avais commencé mon pèlerinage à BALZAC par la lecture d’un pavé horriblement savant d’un grand universitaire (mais très lisible, malgré l’épaisseur) : Le Monde de Balzac, par PIERRE BARBÉRIS, Arthaud, 1973, 575 pages à lire, 10 € au « Livre à Lili », rue Belfort. L’auteur, qui a publié sa grande thèse Balzac et le mal du siècle en 1970 chez Gallimard, se donne pour tâche d’organiser la lecture du monument monumental qu’est La Comédie humaine.
Il a tout lu, correspondance comprise, de ce qui concerne l’œuvre (alors que MAUROIS met en valeur les Lettres à l’étrangère et autres lettres intimes, à valeur exclusivement biographique, quoique …), et offre au lecteur curieux, même débutant, des points de repère d’une robustesse à même d’impressionner. Je ne suis malheureusement pas sûr que ce genre d’ouvrage se prête à la diffusion en supermarché et au tirage de masse.
Et pourtant, je remercie l’universitaire sérieux, car il me rend familiers les personnages de La Comédie humaine, qui sont autant d’avatars, finalement, de leur inventeur. Et pour dire combien certains ont acquis une existence plus vraie que la réalité, une anecdote suffira : à quelques jours de sa mort, BALZAC aurait déclaré à un proche : « Il n’y a que Bianchon qui pourrait me tirer de là ». Il faut savoir que Bianchon, c’est LE médecin de La Comédie humaine, qui fait des apparitions (fugitives ou marquées) dans un nombre incroyable des romans du cycle. Elle n’est pas belle, l’histoire ?
Comme quoi, en définitive, ce n’est pas nul, de s’intéresser à la vie des grands auteurs. Oui, amende honorable, ça s’appelle. Vaut mieux tard que jamais, non ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, humour, chroniques de la montagne, biographie, lagarde et michard, gustave lanson, louis-ferdinand céline, roman, peinture, musique, raphaël, poussin, musée, histoire littéraire, oeuvre d'art, histoire, culture, henri godard, honoré de balzac, andré maurois, pic de la mirandole, obélix, le combat des chefs, pierre barbéris, la comédie humaine, madame hanska
lundi, 22 octobre 2012
PETIT RETOUR EN ARRIERE
Pensée du jour : « Presque tous les désirs des pauvres sont punis de prison ».
LOUIS-FERDINAND CELINE
On ne se rappelle déjà plus ce qu'on a fait il y a six mois (enfin presque, on ne va pas chipoter). Mais si, HOLLANDE, le Parti Socialiste et toute la fièvre du « changement c'est maintenant».

On ne se rappelle déjà plus qu'on était content de ne plus voir la trombine de SARKOZY dans tous les coins des plateaux de télévision et des couvertures de magazines, et de ne plus entendre la voix pleine de certitude et de volontarisme de NICOLAS. Six mois que nous n'entendons plus le matamore déclarer : « Vous allez voir ce que vous allez voir».

AVANT LE PREMIER TOUR ...
Et qu'on a vu qu'on n'a rien vu. Et c'est tellement vrai qu'on n'a toujours rien vu que ça commence à se savoir, et même à se voir. Vous dire que je l'avais bien prévu, ce serait paraître prétentieux, n'est-ce pas : ça ne se fait pas. Et pourtant si, je l'avais vu, du fond de mon bocal viscéralement abstentionniste.

... ET APRES !
Je le savais, qu'après les sévices infligés au "Service Public à la Française" par le grand éradicateur du Bien Commun, on allait voir ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire rien.
Pour une raison relativement connue et banale, mais qui me semble cruciale : sans même parler de tous les lobbies qui s'en donnent à coeur joie autour des ministres, dans les couloirs de l'Assemblée Nationale, du Sénat et des Institutions Européennes, on le sait, que les politiques n'ont plus guère de pouvoir sur la réalité.

AVANT LE DEUXIEME TOUR ...
On le sait, que ce ne sont plus les forces politiques des sociétés qui gouvernent le monde, mais que les leviers de commande sont fermement détenus par les forces économiques, au premier rang desquelles viennent les forces financières. Cela fait déjà quelque temps que ce n'est plus le politique qui organise la vie des sociétés. HANNAH ARENDT, pour qui l'action politique était le summum de la civilisation humaine, doit se retourner dans sa tombe.

... ET APRES !
Je le savais, que tout ce qui sortait de la bouche de SARKOZY était de la parade musculaire et que tout ce qui sortait de la bouche de HOLLANDE était du bluff. Mais tout ça, ça relevait du « A chacun son style ! », et de rien d'autre. La "com" de SARKOZY reposait sur le muscle. Celle de HOLLANDE sur le verbe. Pour agir sur les esprits, ça change peut-être beaucoup. Pour agir sur la réalité, cela ne change pas un iota.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : politique, littérature, louis-ferdinand céline, françois hollande, nicolas sarkozy, président de la république, parti socialiste, gauche, droite, élection présidentielle, élections législative, économie, finance, assemblée nationale, sénat, europe, action politique
dimanche, 02 septembre 2012
CELINE ET LE STYLE
Pensée du jour : « Que fait l'homme du XX° siècle ? Il détache la vignette. Au rasoir, aux ciseaux, parfois avec ses ongles. Il laisse pousser ses ongles exprès. Il passe une lame sous la vignette et fait levier. C'est pour essayer de l'arracher. Mais elle tient bon. On ne la cueille pas à si peu de frais. Elle est fixée par deux prolongements latéraux, gommés, au paquet de pharmacie. On a gagné si on la détache et si on réussit à la coller ensuite presque complète sur une ordonnance de médecin. Ce n'est pas facile : où serait le plaisir ? Mais si on réussit, les Assurances Sociales, impressionnées, remboursent à l'homme du XX° siècle un prix écrit sur la vignette en caractères lilliputiens. C'est pourquoi l'homme du XX° siècle s'acharne et s'y prend de cent façons ».
ALEXANDRE VIALATTE
Nous parlions bien de LOUIS-FERDINAND CÉLINE, n'est-ce pas ?
Vous voulez que je vous dise mon sentiment ? Si CÉLINE n’avait pas été habité par la FOLIE DU STYLE, il n’aurait jamais été antisémite. Ça vous coupe la chique, hein ? Mais j'ajoute aussitôt qu'il n’aurait jamais été écrivain non plus. Vous me direz : "Avec des si ...". Certes. Je n'explique rien : je réfléchis. Enfin, j'essaie.  Et il n'aurait jamais érigé le monument littéraire qui a révolutionné (je pèse mes mots) la façon de lire comme celle d'écrire.
Et il n'aurait jamais érigé le monument littéraire qui a révolutionné (je pèse mes mots) la façon de lire comme celle d'écrire.
Et je dis bien la « folie du style » : Voyage au bout de la nuit, c’est finalement un bouquin à part. Un galop d'essai "raisonnable". Très beau galop, cela va sans dire, mais aussi une base de départ. Il date de 1932. Les phrases se tiennent encore bien. Elles ne méritent pas encore l'asile d'aliénés. Ci-contre, ARLETTY, une bonne copine.
Il découvre tout le potentiel de son style dans Mort à crédit (que je trouve, personnellement, beaucoup plus puissant que Voyage), qui date de 1936. C'est là qu'il commence à la hacher menu, frénétiquement, la phrase française. CÉLINE a inventé le charcutage en littérature.
Sans l'antisémitisme, CÉLINE n'aurait jamais été un écrivain de génie. Voilà ma conviction. Parce que la littérature de CÉLINE est une littérature de la haine. Et qu'il a inventé le style littéraire de la haine. Son style, comme sa haine des juifs, il les jette à la face du monde. La haine du monde tel qu'il est. Qui le met en fureur. La haine du monde et des gens, c'est le fondement des livres de LOUIS-FERDINAND CÉLINE. D'où lui vient cette furie ? Mystère. Elle se constate plus qu'elle ne s'explique.
Il ne s'est jamais remis du fait que le monde est mal fait. Cette haine vient d'une terrible déception ? Pure hypothèse. Une empathie mortellement déçue ? Un amour de l'humanité, irrémédiablement rebuté ? Pures hypothèses. Tenez, j'irai jusqu'à me demander si CÉLINE n'est pas une sorte de JEAN-JACQUES ROUSSEAU modifié par la guerre de 14-18 : "J'avais les meilleures et plus pures intentions du monde, et le monde me les a fracassées" (on entend "l'homme est né bon, et la société l'a perverti").
Je me demande si ce n'est pas l'histoire de la brutalité d'un passage d'une enfance heureuse à un âge adulte brutalement désillusionné. Attention, il a vingt ans quand il monte au front et à la mitraille. « C'est du brutal ! », à la différence qu'on n'est pas dans la cuisine des Tontons flingueurs. Il a vu la guerre de près, et il en porte les traces définitives (névrites et invalidité partielle du bras droit ; vertiges dits "de Ménière" et acouphènes permanents, et pour payer cette note, la médaille militaire et les honneurs).
Tout ça dégrise à tout jamais le plus aviné des hommes. Et il semblerait (d'après HENRI GODARD) qu'il n'a jamais bu une goutte d'alcool, alors vous pensez. Mais c'est le biographe qui émet l'hypothèse que CÉLINE, à partir de ce moment, nourrit l'idée que le monde a une DETTE envers lui. Qu'il est, en quelque sorte, créancier. Alors, de la créance virtuelle à la haine réelle ?
Il se pense en victime du genre humain. Pas moins. Car sa haine, il ne la reconnaîtra jamais comme telle. Il la retourne en haine du monde (ingrat et mauvais payeur ?) contre lui. C'est assez tôt, étonnamment, qu'il s'attend à être assassiné d'un jour à l'autre. HENRI GODARD aborde bien le sujet, à travers la correspondance. Et tout se passe comme s'il faisait tout pour que la menace se concrétise.
Pour tout dire : comme s'il faisait tout pour donner des bases bien réelles et concrètes à sa paranoïa. Pour que les faits confirment sa folie. Il a, certes, un réflexe de survie, pour assurer le quotidien : il ne manque pas de réalisme. Mais j'ai l'impression qu'il ne demande qu'une chose : qu'on le haïsse. Et qu'il n'a qu'une envie : que quelqu'un manifeste l'intention de l'éliminer. Pour justifier sa propre haine. La haine de CÉLINE, je la vois comme ça : retournée en folie du style.
La haine aussi du style classique, de la belle phrase, de la « période » qui coule équilibrée en rythmes larges, protase, apodose et tout le toutim.  HENRI GODARD en parle très bien : quand le bonhomme estime que son manuscrit est au point, un autre travail commence. Celui qui consiste à pulvériser méticuleusement les phrases à coups de "poings" d'exclamation et de "poings" de suspension.
HENRI GODARD en parle très bien : quand le bonhomme estime que son manuscrit est au point, un autre travail commence. Celui qui consiste à pulvériser méticuleusement les phrases à coups de "poings" d'exclamation et de "poings" de suspension.
C'est à l'estomac qu'il veut percuter le lecteur. Il fait tout pour que le lecteur ait envie d'aller au bout du livre MALGRÉ LE STYLE. Que dis-je : en surmontant le repoussoir du style. Il dresse le plus d'obstacles possible pour que le lecteur se donne du mal. Le pari, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, est peut-être tordu, mais absolument fascinant. En tout cas, ça m'épastrouille, et ça me laisse le cul par terre. Ci-dessus, MICHEL SIMON et ARLETTY avec l'écrivain.
« le dimanche, je vous ai dit, vous aviez une petite chance de pas être vu ... de passer à travers vous rendre compte ... mais la semaine vous étiez cueilli, certain ! avant même le deuxième platane !... ficelé !... guéri !... par les Fritz, Helvètes, ou maquis !... vous demandiez pas !... ruisseau, pas ruisseau !... somnambule, voilà, somnambule en domaine magique ... à vous amuser idéal !... cueillir ! bouquets d'azalées, myrtilles, mille-pertuis, fleurs des fées !... et cyclamens !... Marion y avait été cueillir !... ci !... là !... et reconnaître ! ... et il en était revenu !... merveille !... c'était un dimanche ... et indemne ! » D'un Château l'autre (1957).
Et c’est en 1937, donc après avoir fini Mort à crédit, après une immersion sans précédent dans le « délire » de l’écriture – sur le délire (le terme est de lui), il ne variera jamais d’un accent aigu ou d'un point sur un i – et dont la réception par le public et la critique l’a amèrement déçu, qu’il bâcle Bagatelles pour un massacre, sa première énorme furie antijuive. Une vengeance ? Pour non-paiement de la dette ?
immersion sans précédent dans le « délire » de l’écriture – sur le délire (le terme est de lui), il ne variera jamais d’un accent aigu ou d'un point sur un i – et dont la réception par le public et la critique l’a amèrement déçu, qu’il bâcle Bagatelles pour un massacre, sa première énorme furie antijuive. Une vengeance ? Pour non-paiement de la dette ?
Je dis « bâcle », parce qu’écrit en six mois. Et HENRI GODARD le dit bien, et de façon plus savante que moi. Mort à crédit, c’est quatre ans. Bagatelles, dit le biographe, est écrit à la diable, au fil des jours et de la plume. En six mois. Franchement, je peux le dire : à part quelques pages à sauver à cause du style, ce n’est pas un livre. Enfin, moi je ne peux pas. Un livre, c’est autre chose. Mais il faut savoir le vif succès qui l'a accueilli à parution.
 L’énigme de l’antisémitisme célinien n’en est finalement pas une. La clé, c’est l’obsession du style. C’est mon hypothèse. Revendiquée par lui-même au demeurant. L’antisémitisme, il n’est ni cause ni conséquence : il est CONCOMITANT. Inséparable. L'oeuvre de CÉLINE plonge ses racines dans le même sous-sol que son antisémitisme. J’ai l’impression que c’est aussi l'hypothèse d’HENRI GODARD, même s’il marche sur des œufs pour aborder le sujet. Et on le comprend. Le bon grain et l'ivraie tirent leur sève du même sol. Et si je me souviens bien de la parabole, Jésus Christ recommande d'attendre que tout ait poussé pour faire le tri. Rien n'empêche personne de faire le tri.
L’énigme de l’antisémitisme célinien n’en est finalement pas une. La clé, c’est l’obsession du style. C’est mon hypothèse. Revendiquée par lui-même au demeurant. L’antisémitisme, il n’est ni cause ni conséquence : il est CONCOMITANT. Inséparable. L'oeuvre de CÉLINE plonge ses racines dans le même sous-sol que son antisémitisme. J’ai l’impression que c’est aussi l'hypothèse d’HENRI GODARD, même s’il marche sur des œufs pour aborder le sujet. Et on le comprend. Le bon grain et l'ivraie tirent leur sève du même sol. Et si je me souviens bien de la parabole, Jésus Christ recommande d'attendre que tout ait poussé pour faire le tri. Rien n'empêche personne de faire le tri.
Et le style de CÉLINE, je dirai, pour résumer, que c’est un style furibond. Furibard. Fulminant. Tonitruant. Haineux. Si la rage avait un style, elle aurait pris la plume de LOUIS-FERDINAND. Première fois, depuis la plus haute antiquité, qu’un auteur éprouve de la haine pour les nombreux lecteurs qu'il a envie de conquérir. Bille en tête.
Première fois, depuis la plus haute antiquité, qu’un auteur éprouve de la haine pour les nombreux lecteurs qu'il a envie de conquérir. Bille en tête.
« Ce sont les lapins qui ont été étonnés ». Les Lettres de mon moulin commencent comme ça. C’est du ALPHONSE DAUDET. On appelait ça la « captatio benevolentiae ». Traduit en français normal, cela veut dire « caresser l’auditoire dans le sens du poil ». C’est du traditionnel.
Ce n’est pas du CÉLINE. Lui, il prend son lecteur à rebrousse. A rebours. C'est comme caresser un hérisson à rebrousse-piquants. Lui, son truc, c'est de bouleverser la rhétorique. De lui faire dire ce qu'elle refusait d'avouer. Et de faire chier le lecteur qui, fasciné en refermant le bouquin, dira : « Ah le salaud ! Il m'a bien possédé ! ». Parce que le lecteur n'a pas pu le lâcher avant la fin.
HENRI GODARD, Céline, éditions Gallimard.
Grand merci, monsieur GODARD. Votre livre ne dit pas tout. Quel livre le peut ? Même la Bible. Mais, à quelqu'un qui veut savoir à quoi s'en tenir sans fioritures, sans baratin idéologique de quelque bord que ce soit, il est indispensable. Et je le crois d'une rigueur impeccable, en même temps que d'une science méticuleuse. J'ai, quant à moi, pris un plaisir immense et non dissimulé à la lecture du roman qu'est cette biographie remarquable de LOUIS-FERDINAND CÉLINE.
Si j'ai un regret à formuler, monsieur GODARD, c'est que, après avoir montré le poids dont ont pesé les parents, le père en particulier, qui se débrouille en toutes circonstances pour avoir des informations sur son fils, vous les abandonniez brutalement, ces parents, en rase campagne. Je trouve cela un peu injuste.
Il faut attendre en effet je ne sais plus quelle page pour apprendre que le papa est mort en 1932. Ce qui me manque, dans votre livre, monsieur GODARD ? Que s'est-il passé entre les parents et leur fils, pendant et après l'Angleterre, après 1918 ? Qu'est-ce qu'ils deviennent, eux ? Leurs relations avec LOUIS ? Comment s'est opéré l'éloignement ? Comment ont-ils suivi son parcours médical ?
Les questions se posent d'autant plus que LOUIS, auparavant, s'est efforcé d'apparaître en toute occasion, en fils obéissant, comme le montrent vos citations de lettres. Il me semble qu'il y a là une solution de continuité qui demande à être effacée, tout comme les traces des travaux secrets de l'abbé Faria dans les profondeurs du château d'If.
Si vous pouviez me répondre, je vous assure que j'en serais fort aise. Merci d'avance.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, style, alexandre vialatte, louis-ferdinand céline, voyage au bout de la nuit, mort à crédit, haine, henri godard, bagatelles pour un massacre, antisémitisme, création, artiste
vendredi, 31 août 2012
CELINE LE MAUDIT
Pensée du jour : « On a tout essayé pour trouver du nouveau : le roman sans histoire, le roman sans personnages, le roman ennuyeux, le roman sans talent, peut-être même le roman sans texte. La bonne volonté a fait rage. Peine perdue, on n'est parvenu qu'à créer le roman sans lecteur ».
ALEXANDRE VIALATTE
Je viens de finir le dernier roman d’HENRI GODARD, intitulé Céline. Eh bien je crache le morceau : le héros meurt à la fin. J’espère qu’on ne m’en voudra pas. Un 1er juillet 1961. La « Céline » du titre n’a rien à voir avec celle d’HUGUES AUFRAY (« Dis-moi, Céline, qu’est-il donc devenu, ce joli fiancé qu’on n’a jamais revu ? »). La Céline dont je parle, c’est la grand-mère de DESTOUCHES. Car ce « Céline » s’appelle DESTOUCHES, prénom LOUIS-FERDINAND. Né un 27 mai 1894. Nom de plume : CÉLINE. Monsieur a écrit des livres. Et quels livres, nom de Dieu !
Oui, ce « roman » est une biographie. Même si ça mériterait l’appellation « roman », à cause du bonhomme. Mais HENRI GODARD est un savant, pas un romancier. Pour preuve que c’est un savant, il lui faut quarante pages en tout petits caractères à la fin pour loger les notes, vous savez, ce qui prouve qu’il n’a rien inventé. Attention, 1449 notes, pas une de plus, pas une de moins. J’ai compté. Pour indiquer que rien de ce qu’il avance n’a échappé à la vérification. Tout est sourcé, qu’on se le dise. On se dit qu'il connaît son bonhomme jusqu'au fond des poches.

PROFITEZ-EN, C'EST PAS TOUS LES JOURS QUE QUELQU'UN LE FAIT RIGOLER
Quand Gallimard a pris la décision de publier CÉLINE dans la Pléiade (le © du premier volume date de 1962), ses éditeurs claquaient des miches et faisaient dans leur froc (en chœur, si ça se trouve, imaginez la scène des miches qui claquent des mains en cadence) à propos de Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit : le Parti Communiste était à 22 %.
C’était encore le printemps de la « guerre froide ». Et le PCF, qui était alors à son zénith, n’aimait pas CÉLINE, mais alors, on peut dire, pas du tout. Même que ROGER VAILLAND raconte qu’il avait empêché ses camarades de cellule, en 43 ou 44, de l’assassiner purement et simplement. Et qu'il regrettait (plusieurs années après) de les avoir empêchés. Le groupe se réunissait dans l’appartement juste en dessous de chez lui. Et CÉLINE se targuera du fait qu’il aurait facilement pu les dénoncer. Ce qu’il n’a pas fait. C’est sans doute vrai.
Il faut dire que CÉLINE n’a jamais fait grand-chose pour se faire aimer, que ce soit des communistes, des gens en général, et même de ses lecteurs : adopter l’exclamation et la suspension comme style est un bon répulsif pour des lecteurs, même bienveillants. Se faire haïr du lecteur qu’on espère avoir, avouez quand même qu’il faut oser. Même aujourd’hui, pour lire CÉLINE, il faut au moins l’avoir décidé. GODARD se penche sur le paradoxe.
C’est sûr, CÉLINE n’est pas le premier client venu. Auteur sulfureux. Au point qu'on n’a pas oublié l’action sournoise qui l'a fait désinscrire, en 2011, de la liste des célébrations nationales celle de LOUIS-FERDINAND CÉLINE, à la satisfaction de CLAUDE LANZMANN, ARNO KLARSFELD et quelques autres, mais au grand dam de son promoteur, HENRI GODARD. Que l’on avait sollicité officiellement. Mais ce savant n’est pas un homme politique. Et puis ça lui servira de leçon. Il n’avait qu’à s’occuper de Sainte THERESE DE LISIEUX, ou alors, à la rigueur, de PIERRE DE BERULLE.

Car choisir CÉLINE, c’est au moins prendre des risques. Pensez : un auteur antisémite. Aujourd’hui, regardez les faits divers. MOHAMED MERAH tue trois militaires français d’origine maghrébine ou exotique, on en parle et l’événement fait sensation, c’est certain. Mais qu’il tue, quelques jours après, quatre juifs devant une école confessionnelle, alors là, vous pouvez être sûr que la machine médiatique s’emballe et que, dans le vacarme, on n’entend plus hurler qu’à l’antisémitisme. Alors pensez, un auteur qui a écrit des pamphlets antisémites !
Remarquez, le cas d’HENRI BÉRAUD n’est pas très éloigné de celui de CÉLINE. Demandez à ROLAND THÉVENET, qui a fouillé l’animal jusqu'à la racine du poil, depuis le temps qu’il le fréquente. Il a même publié Béraud de Lyon. Que lui ont reproché les épurateurs, à la Libération ? De ne pas avoir été membre du « parti des fusillés », le parti communiste qui, jusqu'au 22 juin 1941 (rupture par HITLER du pacte germano-soviétique, et entrée en guerre contre l'URSS), prêchait l’entente cordiale avec les Allemands, avant de virer de bord à 180° le 23 juin ? De quoi se méfier des cocos, non ? A la place de BÉRAUD, j'en aurais fait autant.

Il ne les aimait certes pas, les cocos. Mais a-t-il pour autant aimé les nazis ? Franchement ? Bon, c'est vrai, il écrit dans Gringoire, le 23 janvier 1941 : « Il faut être antisémite ». Bien des comptes (beaucoup de mauvais : 8775 exécutions sommaires, selon une source plausible) se sont réglés lors de l’ « épuration ». BÉRAUD a payé une facture beaucoup trop salée pour lui. On s'est hâté de lui tailler un costar beaucoup trop large pour ses épaules. Victime de la mythologie gaulliste de « la France résistante ». Il faut se méfier des justiciers en général, et en particulier des justiciers de circonstance (ceux qui sont d'autant plus féroces qu'ils ont quelque chose à se reprocher). Les improvisés « résistants » du dernier moment. 
Alors, c'est certain, HENRI BÉRAUD n'a pas la dimension littéraire de CÉLINE. Il a dû gagner sa vie comme journaliste, et sa prose s'en ressent. Mais franchement, quoique moins spectaculaire, il n'en est pas moins un écrivain très estimable. C'est même mieux que « mérite un détour » : c'est « vaut le voyage ». Mais chut ! Cela ne doit pas être dit. Alors ne le répétez pas. Il n'est pas encore sorti du purgatoire.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, henri godard, roman, romancier, louis-ferdinand céline, biographie, gallimard, la pléiade, voyage au bout de la nuit, mort à crédit, pcf, parti communiste, claude lanzmann, arno klarsfeld, mohamed merah, roland thévenet, henri béraud, béraud de lyon, libération, allemands, occupation, nazis, staline, justicier, résistants
jeudi, 30 août 2012
CHOURMO, SUITETFIN
Pensée du jour : « Il prend la plume, il va écrire à un ami ; il se rappelle soudain que cet ami est mort ; c'est pourtant avec lui qu'il partage les trois quarts des choses. A tel autre ; il est mort aussi. Et tel, et tel. Ils sont rangés sous terre, comme les livres, une fois lus, sur des rayons. L'humanité est une bibliothèque dont presque tous les livres sont lus. L'humanité est aux archives ».
ALEXANDRE VIALATTE
Nous parlions donc de Chourmo, de JEAN-CLAUDE IZZO. Ce qu’on savait, c’est que le père de Guitou, Gino, est mort (de mort violente), et que Gélou (son vrai prénom n’est jamais donné, et je déteste les diminutifs, les "bibiche", les "mon cœur", et autres niaiseries suspectes ; à la rigueur, votre sœur Gisèle, appelez-la Sophie, et n’en parlons plus, ça reste intéressant et affectueux) s’est maquée avec Alex, et que Guitou ne peut pas encadrer Alex, et qu’Alex le brutalise à l’occasion.
Mais comment le lecteur (Fabio Montale dit "je", c’est pratique : chaque rebondissement, c’est d’abord lui qui l’encaisse) aurait-il pu deviner qu’Alex, son nom complet, c’est Alexandre Narni, et que ce type est (avec Antoine Balducci) le porte-flingue de Sartanario, un parrain de la Camorra napolitaine (la même que dénonce ROBERTO SAVIANO dans Gomorra), et que c’est lui qui a dézingué, au tout début du bouquin, Hocine Draoui et, dans la foulée, Guitou ?
Même Gélou, sa propre compagne depuis 10 ans, croit qu’il est dans le marketing économique. En fait de marketing économique, c'est de l'arnaque à tous les étages. Sartanario le camorriste, vous savez quoi ? Il prête de l’argent (à blanchir) à qui veut monter une entreprise, mais à 25 %, et Alex est chargé de faire rentrer l’argent bonifié et de punir les mauvais payeurs. Mais le truc, à un taux pareil, c'est qu'il ne peut y avoir que des mauvais payeurs (voir le restaurant de Gino). La différence avec le Gobseck de BALZAC, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance de dette : il y a le flingue d'Alex. On apprend d'ailleurs que c'est lui qui avait tué Gino, le légitime de Gélou.
Le pire, c’est que Guitou n’était même pas le fils de Gino, mais bien du truand Alex (andre Narni), dont on apprend qu’il a donc tué son propre rejeton, mais qu'il l’ignorait parce que Gélou ne lui avait jamais dit que c’était lui, le père (c’est vrai que seule la mère sait qui est le père, et encore, pas toujours).
Vous voyez le nœud ? Quasiment gordien, le nœud, non ? "Gordien", ça fait très bien, dans un paysage. Personne ne sait ce que c’est, donc tout le monde respecte. Et ignore généralement comment Alexandre l'a réglé (Le Grand, c'est d'un coup d'épée, Narni, d'un coup de pistolet). N’empêche, qu’est-ce qu’elle prend sur la calebasse en rien de temps, la frangine à Fabio Montale ! Son fils a été tué par son mec, qui est un tueur à gages. De quoi disjoncter bien net ? Eh bien non.
Eh ben oui que eh bien non, parce que tout le monde se retrouve dans le zen d’un temple bouddhiste, où Cûc, la femme d’Adrien Fabre, le père du Mathias qui a prêté la chambre à Guitou (j'espère que vous suivez), la même Cûc qui a pris le temps de faire une pipe à Montale, où Cûc, disais-je, a caché Mathias et Naïma.
C’est vrai que c’est sûr que c’est garanti, que là, ils étaient en sécurité : comment le camorriste napolitain aurait l'idée de fouiner chez les bouddhistes ? J’ai oublié de préciser qu’Adrien Fabre a assisté à l’exécution du début, et qu’il a été lui-même exécuté (il devenait de plus en plus tiède) : il devait sa brillante carrière d’architecte à l’argent sale et à l'influence secrète de la Camorra sur les marchés publics.
C'est le genre de livre optimiste, qui rétablit l’ordre du monde à la fin. Oui, parce que les méchants sont punis. Parce que Fabio Montale, quand il est au volant de la Saab, faut pas le chercher. Ou alors, il faut le suivre sur la route du col de la Gineste, en Safrane noire, par la D 559, avec la ferme intention de faire un tir au pigeon. A fond les manettes. La poursuite finale est assez bien écrite, où Montale se demande s'il préfèrera les spaghettis à la matricciana, une soupe de haricots et une daube bien marinée. Tout en taquinant à mort le frein et le changement de vitesses.
Au moment fatidique, la Safrane des méchants « me doubla et poursuivit sa route. Contre la rambarde en béton. Culbuta. Et partit dans les airs. Les quatre roues face au ciel. Cinq cents mètres plus bas, les rochers, et la mer ». L’ordre est donc rétabli, et d’autant mieux que les deux flics qui suivaient tant bien que mal dans leur R 21 minable et antique, rappliquent aussitôt pour lui dire que le commissaire Loubet avait bien fait les choses et que, de toute façon, les truands étaient cuits.
Quoi, j’ai raconté la fin ? Et alors ? Ceux qui l’ont lu, de toute façon, ils savent (à condition de s'en souvenir). Et ceux qui n’ont pas encore lu la trilogie marseillaise de JEAN-CLAUDE IZZO, c'est sans doute qu'ils n’en ont rien à battre, sinon, ce serait fait depuis longtemps.

UNE TÊTE DE PERE TRANQUILLE, NON ?
MOI, JE LE VERRAIS BIEN PROF D'ALLEMAND
Et puis en plus, ça montre qu’un livre dont la seule chose à faire est de ne surtout pas raconter la fin, c’est un livre dont le seul intérêt est dans le dénouement. Or, quand on raconte le dénouement et que ça dégoûte la personne, c'est qu'on est dans la littérature de consommation. S'il connaît la fin avant, le lecteur n'a plus besoin d'ouvrir le livre. C’est ça, la littérature policière. Et ça vaut, évidemment, pour le cinéma.
SIMENON écrivait neuf livres par an, assis à sa table tous les matins. Avec sa pile de crayons taillés la veille au soir. CELINE a mis quatre ans pour terminer Voyage au bout de la nuit. En tout il a écrit SEPT romans. En mettant, comme il dit, sa « peau sur la table ». SIMENON, il en a écrit 368. Et il s'est bien conservé. Vous la voyez, la différence ?
Le polar, c’est un mécanisme avant d’être de la littérature. THOMAS NARCEJAC (de BOILEAU & NARCEJAC, donc un connaisseur) le reconnaît : l’auteur de polar ne doit pas péter plus haut que son cul. Parce que son bouquin, c’est comme une rivière qui remonterait vers sa source : il est élaboré et construit à partir de la fin. Tout le reste de l’effort d'écriture, c’est de faire le plus d’effet possible sur le lecteur. Il fait des livres qui s'auto-détruisent.
Un grand livre, c'est le contraire : ça se développe dans le sens que la nature impose à l’eau : de la source à la mer. CELINE lui-même est saisi d’étonnement devant les rigoles, rus, ruisseaux, rivières et fleuves qui se mettent à couler et qui s’imposent à lui quand il écrit Féerie pour une autre fois, et qui font gonfler le volume des volumes. Il part dans les directions qui se présentent. Et surtout, il ne sait pas où il va aboutir.
L’intrigue de Le Rouge et le noir, c’est quoi ? Un jeune ambitieux séduit une aristocrate, puis une aristocrate, avant de tenter de tuer la première. Franchement, pas de quoi fouetter un chat. Juste un fait divers. Qu'est-ce que c'est, Madame Bovary ? Quelques adultères et un suicide à la campagne. Ça veut simplement dire que STENDHAL et FLAUBERT ont mis du gras, du muscle et du nerf autour des os du squelette, et que ça donne des êtres vivants. Mais attention, ça ne veut pas dire qu’il faut mépriser le polar. « Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. » Appelons ça « hiérarchie des valeurs », si vous n’y voyez pas d’inconvénient. J’ai dit un gros mot ?
Reste un truc, dans Chourmo, qui me chiffonne (pas trop) : le "je" de Fabio Montale sert à l’auteur pour des retours sur le passé amoureux de l’ancien flic qui a raté pas mal de choses. Bon, on a compris, il s’agit de « donner de l’épaisseur au personnage ». Moi je veux bien. Mais ça me fait un peu l’effet de l’usage du Front National dans le bouquin : ça n’apporte pas grand-chose, et même, ça fait perdre du temps. Bon, peut-être que le gars était payé à la page ?
C'est comme Honorine et Fonfon, je veux dire les personnages secondaires, dans le polar (tous les polars) : IZZO n'a pas tort de donner un peu de profondeur de champ à la photo. Mais s'il leur accordait plus d'importance, le centre de gravité du bouquin se déplacerait en direction de la grande littérature. Dans le polar, pour que l'intrigue avance (puisque c'est elle l'essentiel), il ne faut pas que les personnages en aient trop, de l'épaisseur. Côté psychologie, il faut en rester au dessin esquissé. Bon, finalement, admettons que l'auteur s'en sort bien. Le contrat est rempli.
Il reste aussi le tableau de Marseille, qu’on regarde de l’intérieur, en caméra subjective : « Je pris la rue Sainte-Barbe, sans mettre mon clignotant, mais sans accélérer non plus. Rue Colbert ensuite, puis rue Méry et rue Caisserie, vers les Vieux Quartiers, le territoire de mon enfance ». On suit bien. On passe par la rue de Lorette, dans le Panier. Place des Treize-Coins, juste derrière l’hôtel de police.
Le problème du polar, c’est que les ficelles, presque forcément, comme elles sont beaucoup plus épaisses, sont beaucoup plus visibles. Et que c’est pour ça qu'il appartient à ma catégorie des amours, disons, intermittentes. De la petite littérature. Même si ça donne de gros pavés, genre MICHAEL CONNALLY (Le Poète, La Blonde en béton, Le Cadavre dans la Rolls, ...) ou JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ (Le Concile de pierre, Le Vol des cigognes, ...). Je ne méprise pas du tout, mais « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, roman policier, polar, jean-claude izzo, chourmo, trilogie marseillaise, camorra napolitaine, marseille, fabio montale, roberto saviano, gomorra, balzac, safrane, georges simenon, louis-ferdinand céline, boielau narcejac, michael connally, jean-christophe grangé
samedi, 25 août 2012
LA METHODE VIALATTE 4/5
Pensée du jour : « Voilà un homme [à propos du Prince de Ligne]. Le reste est plèbe et fibre épaisse, imbécile, et nous vivons dans cet affreux malaise d'une affreuse civilisation qui sécrète elle-même les poisons dont elle mourra, par voie de suicide évidemment, sans trop tarder. Par auto-intoxication. Comme le scorpion qui se pique la nuque avec sa queue ».
Alexandre Vialatte
***
Résumé : je disais donc que la vie n’est qu’une digression. Mais j’en viens à mon sujet initial.
Oui, il s’agit bien d’en venir, enfin, à Alexandre Vialatte. Au sourire désolé qu’il pose sur l’époque dans laquelle il est obligé de vivre, à l’angle des rues Léon-Maurice Nordman et de la Santé (l’hôpital Cochin n’est pas loin à droite, la prison est en face). Quand il n'est pas dans son Auvergne. C’est à Paris. Il parle plus de la prison (qu’il a sous ses fenêtres) que de l’hôpital (un peu à l’écart de son champ de vision). On est dans le 13ème, au seuil du 14ème.
« Les pigeons de Paris, au vol lourd, tournent autour des toits de la Santé et se posent sur le rebord des fenêtres des cellules ; peint en blanc. Et numéroté : 128, 129, 130, ... Seraient-ce les colombes de la Paix ? Sur l'un des rebords il y a un petit pot bleu. En bas tournent les C.R.S., les sergents de ville, ou la garde mobile, la mitraillette braquée. En haut rêvent les détenus.
Ils rêvent, ils font des songes. »
Oh, l’époque où il vit, il la voit, il l’entend, il la renifle, il l'ausculte, il en a examiné les moindres coutures, et à son gré, le tissu se découd un peu trop vite. Il voudrait ralentir la chute. La culture, la civilisation (« La civilisation ne cesse de s'effondrer sous l'énergique poussée des hommes »). La langue (« Il ne faut pas de h à Nathalie »). La grammaire, ah, la grammaire (« Pas de subjonctif après après que ») ! La création littéraire. Son éloge incessant du labeur de moine pieux du bon écrivain. L'exaltation de l’artiste peintre maître de son art. La profondeur de son regard sur l’homme qui, par son travail, fait aux hommes le don d'une oeuvre.
Et l'acuité du regard qu'il porte sur la défaite humaine face à l’avènement du règne intraitable des recettes, des concepts et des coups de pub. Devant la victoire de l’idée sur l’œuvre, et du coup de pub sur le talent. L’idée, on la doit à Marcel Duchamp. L’art confondu à la publicité, à Andy Warhol. Les deux meurtriers en chef de tout ce qui, en d’autres temps, s’est appelé « art ». C'est grâce à tout ça qu'on lui doit cette célèbre phrase :
« ON N'ARRÊTE PAS LE PROGRES : IL S'ARRÊTE TOUT SEUL ».
La défaite devant le merchandising et le packaging. Le parking et le pressing. Le profiting et le n’importequ’ing. La cotation en bourse. La veuve écossaise. Les valeurs sonnantes. La Rolex à cinquante ans, le bling-bling. Accessoirement la tyrannie exercée par le succès des fausses gloires. L’inconsistance de la « surface médiatique », une surface sans profondeur, ça va de soi. La vanité des sunlights et le toc des plateaux de télévision. Ce qu'il appelle quelque part le « règne du faux ». A son époque, ce n’étaient déjà plus seulement des vues de l’esprit ou des anticipations, mais les stigmates incontestables d'une avancée irrésistible.
Vialatte a observé tout ça. Et nommé. Et envoyé à la poubelle. Avec la souveraine élégance de l’esprit dont il ne s’est jamais départi. C’est de là que lui vient le sourire désolé qui ne quitte jamais sa prose. Il sait que Rome assiégé ne pourra rien contre les barbares qui se pressent sous ses murs. Mais qu'on ne compte pas sur lui pour les laisser entrer : tout ce qu'il écrit a de la tenue.
Aucune brèche dans la muraille du style. Cette colonne vertébrale sert à se tenir bien droit. Mais en même temps une bonhomie dépourvue de prétention. Les fureurs injuriantes d’un CÉLINE ne sont pas de sa planète à lui, mais son pessimisme n'a rien à lui envier. Rien que lorsqu'il définit l'homme : « Animal à chapeau mou qui attend l'autobus 27, au coin de la rue de la Glacière ».
Je vais vous dire un truc définitif : Vialatte est un sourire désolé posé sur le monde sinistré qui l’entoure.
L’Amérique domine ? Il s’en attriste, certes, mais il refuse obstinément de le laisser paraître. Si, bien sûr, les bulles de colère éclatent à la surface, mais c'est difficile à repérer, car c’est toujours une colère courtoise, civilisée, exprimée dans les formes. Littéraires, évidemment. Et surtout qui n’a jamais l’air d’une colère.
Il se sait impuissant contre le « mouvement de l’histoire » et contre la régression tant redoutée vers la barbarie. De ce point de vue, il me fait penser à Claude Lévi-Strauss, celui de Regarder, écouter, lire (en 1993, il a 85 ans, et il meurt centenaire en 2009, il a eu le temps d'en voir).
Comme Vialatte, Lévi-Strauss voit. Sur la fin, il sait toute la saloperie qui est en train d’arriver et qui réduit à néant tout l’effort d’élévation qui fut celui de l’homme depuis ses origines. Il ne joue pas les prophètes. Il voit agoniser un monde qui fut beau. Pas que beau (excusez-moi, mais là, c’est justifié), mais non sans grandeurs diverses. Et voyant cela, il se tourne vers l’essentiel de ce qui constitue SA culture (la mienne aussi), à lui qui a tant œuvré pour les cultures des autres, des « primitifs », comme on disait.
Dans Regarder écouter lire, Lévi-Strauss se tourne vers Poussin, Rameau, Diderot. Il ne se désole pas de l’état du monde tel qu’il est ou sera. Simplement, lui, l’anthropologue et l’ethnologue de peuplades en voie de disparition (et souvent déjà disparues) choisit de s’incliner devant trois statues en or massif, dont chacune figure à elle seule la majesté, la puissance, le génie de l'art français classique, dans la peinture, la musique et la littérature : Poussin, Rameau, Diderot.
Oh, nulle contrition dans son propos. Il assume toujours (hélas !) Roman Jakobson, l'aridité, la sécheresse universitaires de la linguistique et de l’anthropologie structurales. Mais je veux être convaincu que, en écrivant ce livre, Lévi-Strauss s’est rendu compte du destin tragique de SA culture (la mienne aussi), et qu’il y a, dans Regarder écouter lire, au moins en négatif, la manifestation d’un regret.
Sa façon de célébrer, pour finir, trois génies français d'un lointain passé désigne, au moyen même de tout le reste qu'il ne dit pas, le délabrement qu'il ressent de la culture de son époque. La célébration de cet art français vaut condamnation de ce qui se répand au présent sous le nom de culture.
Le problème, c'est qu'il a participé à la démolition structuraliste. Rien que le fait de décider que, grâce aux structures des contes, de la parenté ou de je ne sais quoi, on va pouvoir mettre l'humanité entière dans un grand sac unique, ce n'est finalement qu'une idéologie. Et je veux me dire que Lévi-Strauss s'est rendu compte de ce à quoi à servi le structuralisme : le nivellement de tout. La destruction de tous les critères (parce qu'un critère permet un jugement). Il ne faut plus juger. Cela veut dire qu'il ne faut plus différencier. L'autre est devenu le même. Le Mal, c'est le critère de jugement. Il faudra bien que j'y revienne, à cette folie.
Alexandre Vialatte lui, n’a jamais été structuraliste : il a donc eu moins à se faire pardonner. Il n'a jamais été un homme de la théorie englobante. Disons que, s’il a souri désolément, c’est d’une autre manière, plus directe et franche peut-être. La "pensée du jour" qui ouvre cette note espère en être une vive illustration. Il lui arrive même, à Vialatte, d'être terrible de noirceur.
On ne peut pas lui donner tort, tant le vingtième siècle a détruit : la première guerre de destruction des hommes (14-18), la première guerre de destruction des femmes et des enfants (39-45), mais aussi, tout au long du siècle, et de plus en plus arrogante, la première guerre de destruction américaine, pacifique et commerciale des racines des peuples, et le rouleau compresseur n'a pas fini d'avancer.
Pas de théorie donc chez Vialatte, certes, mais une méthode. Et sa méthode, il en fait cadeau : « Je ne vends pas la recette, je la donne ». Ecrivain, il a prouvé aux éclairés qu’il sait écrire des romans (Battling le ténébreux, et surtout Les Fruits du Congo, si vous ne connaissez pas, jetez-vous). Peu connu, mais estimé de confrères qui comptent, il livre donc sa recette à tous ceux – et ils sont nombreux – qui se proposent d’écrire : « Commencez par n’importe quoi », dit-il martialement.
Et plus loin : « Pour la conclusion, même principe : concluez sur n’importe quoi ». Ainsi, vous avez votre première page et la dernière. Quant au reste : « Mais que doit-on mettre entre la préface et l’épilogue ? Qu’on ne me le demande jamais, car je ne l’ai jamais su ». Voilà qui a le mérite de la netteté, même si ça n’arrange pas le débutant. Et l’on peut être sûr qu’il est sincère.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, fantaisie, digression, prison de la santé, paris, auvergne, grammaire, style, écrivain, marcel duchamp, andy warhol, art, publicité, télévision, louis-ferdinand céline, claude lévi-strauss, regarder écouter lire, nicolas poussin, diderot, jean-philippe rameau
vendredi, 24 août 2012
LA METHODE VIALATTE 3/5
Pensée du jour : « Tout y est dans le ton, dans le timbre, dans l'accent. C'est une immense leçon de style. Il n'est que style. Mais cherchez-y le style et vous ne l'y trouverez pas. C'est un serviteur invisible. Il a dressé la table, allumé les lumières, ordonné les fleurs dans les vases. Il est parti, ne nous laissant que la fête. Elle tient toute dans un éclairage. Le style est une fête donnée par un absent ».
Alexandre Vialatte, parlant de Jacques Chardonne (la formule magique est soulignée par moi).
***
Résumé : les livres, c’est comme les voyages. Certains écrivent des sommes écrasantes comme des systèmes solaires. D’autres se contentent de musarder au gré des chemins creux. Le véritable dilettante (c'est celui qui aime avant tout se délecter, comme son nom l'indique) est capable de bouleverser son programme à cause du son lumineux de la cloche qu’il vient d’entendre au loin, alors que la nuit va tomber.
Je dirai, pour introduire mon introduction (je ne veux pas fixer de date pour la conclusion, parce que, finalement, tant qu’on est en vie, on ne se croit jamais arrivé à la conclusion), que la digression est la vie, parce que la vie, à tout prendre, est une plus ou moins longue digression entre deux points d’une histoire qui la dépasse par tous les bouts.
Finalement, combien de gens arrivés à l’article de la mort ont l’impression de n’avoir pas vraiment achevé l'introduction, encore moins ébauché le développement ? Tout au moins de ne pas les avoir écrits comme ils auraient voulu, rétrospectivement ? Et qui voudraient tout réécrire ? Combien de paragraphes de leur vie voudraient-ils corriger ? Combien de phrases à supprimer ? Combien de vocables à mieux choisir ?
Dans le fond, chacun de nous n’est-il pas, en soi, une digression ? Une digression qui se déroule à son insu et qui ne se voit dans son entier (et encore, par temps clair : il faut au moins qu’on puisse voir le Mont Blanc depuis le Gros-Caillou, 154 km exactement en ligne droite, j'ai mesuré, moi-même en personne) qu’au moment où elle s’achève ?
C’est pourquoi, en attendant que se referme sur moi-même la parenthèse ouverte depuis lurette par l’homme et la femme qui m’ont occasionné, je ballotte aujourd’hui avec une sérénité somme toute appréciable au gré de mon petit cours d'eau, en me cramponnant à ma coquille de noix : « La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu’un bouchon, j’ai dansé sur les flots Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes, Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots ». Ceci pour dire que s’il y a errance, c'est le bateau qui est ivre. Je me sens accompagné par quelque autorité en la matière. Cette compagnie me tient.
Je ne sais pas si mon rafiot avance dans le courant principal, ou si, rejeté sur le côté du fleuve, paralysé par divers courants et tourbillons, je ne finirai pas comme les conquistadors montés sur l’un des radeaux d’Aguirre (Klaus Kinski), dans le sublime film de Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu (1972).
La digression, c’est la vie : « Va petit mousse, Où le vent te pousse, Où te portent les flots. Sur ton navire, Vogue ou chavire, Vogue ou chavire jusqu’au fond des flots » (Planquette, Les Cloches de Corneville). Louis-Ferdinand Céline aimait cette opérette.
Vous voulez en trouver une preuve en vous-même ? Par vous-même ? Souvenez-vous juste du moindre de vos repas entre copains ou en famille : à table, on cause, non ? Au bout d’une demi-heure, quelqu’un s’avise de se demander d’où on est parti.
Vous vous rappelez forcément ces moments : vous êtes partis du président Fallières (supposons), et vous en êtes arrivés au tigre du Bengale (ou à la pomme de Newton), après être passés par vos dernières vacances au camping de Sisteron, la folie de Khadafi, les « allées couvertes » du Cap Sizun, le prix du carburant, l’irruption de loups des Abruzzes dans le parc du Mercantour et l’invention de Lucy par Yves Coppens en 1974, au son d'une chanson des Beatles. Peut-être même l'entrée de René Caillé à Tombouctou le 20 avril 1828, qui vaut celle d'Alexandra David-Néel à Lhassa, le 28 janvier 1924. Presque cent ans plus tard. C'est normal, c'est une femme, et on est au 20 ème siècle.
Vous vous dites que vous tenez, dans ces errances conviviales, un compendium de l’histoire humaine, que je résumerai par une seule question : « Comment en est-on arrivé là ? ». C’est sûr, une conversation de table résume à chaque fois, à sa manière, l’histoire de l’humanité. Pour peu qu’on insiste un peu. Qu’on sache remonter au point de départ (pour Vialatte, le point de départ, c'est forcément « la plus haute antiquité »). Qu'on ait le souci de retourner dans les détails de la chose.
Que voulez-vous ? L’homme, dans sa caverne comme devant son poste, en a une vive conscience. Il aime à se demander comment il en est arrivé là. Et il tente laborieusement de reconstituer la trajectoire sinueuse, le cheminement biscornu observable depuis qu’il est parti. Parfois. Pas toujours. Parions que cette tentative de reconstitution est à l’origine de la littérature. Mais ne nous laissons pas impressionner par les plus lourds que l’air.
J’entends à l'instant dans mon casque une interpellation vibrante : « Bon alors, blogueur à rallonge, ta "méthode Vialatte", elle va finir par arriver, ou il faut aller la chercher ? », (je cite textuellement, bien sûr, je ne me permettrais pas, pensez). Sache, lecteur pressé d’arriver au bout (au bout de quoi, je le demande ?), que le fleuve, dans ses méandres les plus acrobatiques et ses détours les plus sophistiqués, ne perd jamais de vue la mer dans laquelle il jettera tôt ou tard son être tout entier.
Mon propos étant intitulé La Méthode Vialatte, j’ose affirmer que ce n’est pas pour rien, et que je n’ai garde de l’oublier. C’est pour demain, la révélation. Je le jure. A moins que … une digression se présente. De toute façon, Alfred de Musset l’a dit : Il ne faut jurer de rien (1836). J'obtempère : je jure donc de ne jurer de rien.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, société, jacques chardonne, dilettante, digression, méandre, mont blanc, gros caillou, arthur rimbaud, le bateau ivre, aguirre la colère de dieu, klaus kinski, werner herzog, planquette, les cloches de corneville, opérette, louis-ferdinand céline, tigre du bengale, yves coppens, alfred de musset
lundi, 06 août 2012
QUOI DE NOUVEAU DANS LES NOUVELLES ?
Le soleil est revenu, hier matin. Du coup, il a fait chaud. Très chaud. Est-ce que ce sera bon pour la vigne ? Parlons de la SYRIE.
Je n’aimerais pas vivre en Syrie en ce moment. Les plages sont polluées et il y fait beaucoup trop chaud. Rendez-vous compte, 40 ° l’après-midi. Et puis le sable y est de qualité assez moyenne. Et puis la clim de l’hôtel marche seulement quand elle l’a décidé. Et puis le champagne qu’on y sert est d’origine douteuse, je veux dire chinoise. Et puis ils ne savent pas ce que ça veut dire, servir frais. L’Iran a bien essayé de remédier au problème, mais leur produit ne contenait ni alcool ni bulles.
Pour tout dire, leur ruse a été vite éventée : ils prétendaient faire rentrer des devises en recyclant la pisse de leurs chameaux. Mais y a-t-il seulement des chameaux en Iran ? C’était peut-être de l’huile de vidange passée en centrifugeuse, il paraît qu’ils en ont beaucoup là-bas, des centrifugeuses. Et puis, dans les hôtels syriens, le personnel, très courtois et stylé au demeurant, n’est pas formé correctement. Pensez donc, accomplir son service sans gants blancs. A croire qu’ils préfèrent se salir les mains à des besognes inavouables.
Et puis, en Syrie, l’hygiène corporelle laisse à désirer. Bon, je comprends bien leur souci d’économiser l’eau, mais ça finit par sentir la chair en décomposition, ce qui n’est pas bon pour le tourisme. On ne peut rien contre l’odeur de cadavre, sous ces latitudes.
Bon, j’arrête. Ce n’est pas que ça n’aurait pas été amusant. J’aurais mis BACHAR EL ASSAD en maître-nageur implacable d’une piscine olympique remplie d’une eau vaguement rougie, et ajustant à la kalachnikov le premier qui se laisserait aller à pisser dans l’eau. Et puis je me suis dit que ça devenait laborieux, lourd, voire fâcheux. Au sens de MOLIERE. Pourtant, l’humour noir, je suis à fond pour.

IL EST PAS MIMI, EN MAÎTRE-NAGEUR ?
L’humour noir, c’est un souverain antidote au poison sentimentaliste, à la dégoulinade humanitaire, au grand épanchement douloureux étalé par tous ceux qui sont, pour leur bonheur et leur sécurité, très loin de ce qui s’appelle un « champ de bataille ». Tous ceux qui peuvent donc éprouver des « bons sentiments », et surtout le faire savoir. Et tout ce qui est antidote, surtout pour la tête, je suis pour : ce n'est pas pour rien que j'ai baptisé ce blog ALEXIPHARMAQUE. Contrepoison, si vous préférez. Contre tous ceux qui proclament : « Voyez comme je suis bon ! ».
Rappelons-nous ce que LOUIS-FERDINAND CÉLINE découvrit à Paris, en décembre 1914, hospitalisé au Val-de-Grâce après les deux graves blessures reçues à Poelkapelle (une balle ricochante (= avec ébarbures de plomb) et un éclat d’obus non loin du rocher, autrement appelée partie pétreuse de l’os temporal) : l’insouciance, la veulerie et le mépris de « l’arrière » et des « planqués » pour la mort de ceux qui étaient au front. On peut dire que ça lui a ouvert les écoutilles.
Les apitoiements de toutes les bonnes âmes sur les victimes civiles de la guerre de Syrie, sont le meilleur moyen de ne rien comprendre à ce qui se passe en réalité. Franchement, dans le monde, qui est prêt à se déclarer, à froid, partisan de la guerre et adversaire de la paix ? Tout le monde est d’accord pour que le sang ne coule pas. Tout le monde est pour la paix. TOUT LE MONDE EST POUR LA PAIX.
Seulement voilà, le sang coule quand même. Acroire qu'il ne peut pas s'empêcher. Je serais à la place des grands sentiments humanitaires, je serais profondément vexé, et j’annoncerais à grands renforts de trompettes que, pour punir les couleurs de sang (couleurs = ceux qui le font couler, ndlr), je me lance dans une grande BOUDERIE. Ils seraient tous bien attrapés, comme dirait le petit Nicolas, de SEMPÉ et GOSCINNY. Et que je ne cesserai que quand, … que lorsque, … que si … Et voilà tout. C’est vrai, il faut savoir leur parler, aux dictateurs.
La vérité ? Je ne la connais certes pas, mais je me dis que si le sang continue à couler malgré les bouderies de vierge effarouchée de KOFI ANNAN et de l'ONU (je suis injuste : on ne peut raisonnablement en vouloir à un combattant qu’on envoie au combat avec des menottes aux mains, rappelons-nous Srebrenica, et l’interdiction faite aux casques bleus de s’opposer par la force aux troupes fanatisées de RATKO MLADIC), c’est bien que des volontés (et des stratégies) extrêmement puissantes sont en train de s’affronter sur le terrain syrien, et que le vulgum pecus dont je fais partie en est réduit au rôle de spectateur paralytique.
Et ça, je ne peux plus. Je ne peux plus jouer ce rôle du « saule pleureur de victimes innocentes ». Trop c’est trop. Trop de victimes. Je ne peux plus m’apitoyer. Personne ne peut m’obliger à passer ma vie à pleurer sur le sort des victimes. Devant ma radio ou ma télévision. En tant qu’individu individuel, je ne peux que proclamer fièrement mon incapacité à agir sur les événements qui font l’histoire, et ma fierté à me proclamer « spectateur 100 % pur gros porc ». A ma grande honte. Mais, à la réflexion, la honte se dissipe.
D’ailleurs, franchement, le feuilleton syrien me saoule au point que j’ai décidé de quitter la salle de projection avant la fin. Je suis désolé pour vous qui mourez, vous qui souffrez, vous qui êtes torturés à mort, vous qui avez perdu un fils, une jambe ou la tête. Je ne peux strictement rien pour vous. Toute cette affaire n’est pas de mon ressort. Je ne suis pas décideur. Elle ne me concerne donc pas. Du ressort de quel citoyen de base est-elle, d’ailleurs ? L’ « opinion publique » ? Laissez-moi rire. C’est bon pour l’Orphée aux Enfers d’OFFENBACH, une œuvre qui va gaillardement sur ses 160 ans :
« Qui je suis ? Du théâtre antique
J’ai perfectionné le chœur ;
Je suis l’Opinion Publique,
Un personnage symbolique,
Ce qu’on appelle un raisonneur.
Le chœur antique en confidence
Se chargeait d’expliquer aux gens
Ce qu’ils avaient compris d’avance
Quand ils étaient intelligents.
Moi je fais mieux, j’agis moi-même,
Et, prenant part à l’action,
De la palme ou de l’anathème
Je fais la distribution. »
En gros, OFFENBACH a mis sur la scène cette voix de mazzo-soprano pour qu'elle figure l'énorme BLA-BLA ambiant. L’opinion publique n'existe pas. C'est un bruit de fond. Ce sont les journaux, les radios, les télévisions qui la font, l’opinion publique. A la limite, les journaux, les radios et les télévisions (ajoutons internet), je leur en veux de me mettre ce spectacle sous les yeux et les oreilles. De me l’imposer, leur opinion publique.
Qu’est-ce que ce bourrage de crâne peut finir par créer dans le dit crâne ? C'est fait pour terrasser de terreur. Je vais vous dire : c'est fait pour inspirer la peur, la culpabilité, la certitude de l’impuissance devant le réel que d’autres nous façonnent à leur gré. Et pour finir, la soumission à je ne sais quelle fatalité.
Je vois bien ce qui risque d’arriver, avec l’histoire syrienne : chaos, islamisme, guerre totale, vu le nombre de pays importants impliqués dans l’affaire, mais je vais vous dire : comme je n’y peux rien, j’estime avoir le droit, que dis-je, j’estime avoir le DEVOIR DE M’EN FOUTRE. Expliquez-moi à tire-larigot que l’ordre du monde se joue là, et pas ailleurs.
Que ce qui est imposé aux Syriens est terrible. Eh bien je vais vous dire, l’ordre du monde, JE LE COMPISSE, JE LE CONCHIE. A quoi ressemblerait le monde, aujourd'hui, si SARKOZY n'avait pas envoyé ses Rafales sur Benghazi ? Qu'est-ce qui peut m'obliger, moi, citoyen basique, à ne pas supporter les morts d'ailleurs ? En quoi il me concerne, franchement, l'ordre du monde ?
Pour une raison qui n’est peut-être pas excellente : pendant que la caméra mondiale est braquée en permanence sur la Syrie, il n’y a plus personne pour regarder les violences en Somalie, le viol industriel qui règne au nord-ouest de la République Démocratique du Congo, les violences au Sud-Soudan, j’arrête là. Quel être raisonnable aurait la prétention de croire qu'on peut faire régner l'ordre et la paix sur notre planète ?
Ce qui m’étonne, c’est que les foules spectatrices soient toujours convaincues, qu’il est possible de sauver les autres (« Mais faites quelque chose ! », entend-on depuis les débuts de cette autre atrocité que constitue l'action humanitaire). Donc qu’il faut les sauver. Comme SARKOZY qui, en déclenchant la foudre contre KHADAFI, a réussi à déstabiliser gravement tous les pays de la région sahélienne. Là encore, je ne peux que conspuer cette maxime chère à ma tante A. (voir hier) : « Quand on veut, on peut ».
Vous comprenez pourquoi je me suis tourné vers la ’pataphysique ? C’est parce que

Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : météo, syrie, été, champagne, iran, centrifugeuse, guerre, bachar el assad, molière, les fâcheux, humour noir, alexipharmaque, louis-ferdinand céline, le petit nicolas, sempé et goscinny, kofi annan, onu, ratko mladic, orphée aux enfers, jacques offenbach, sarkozy, khadafi, pataphysique
dimanche, 11 décembre 2011
J'AI LU "ULYSSE" DE JAMES JOYCE
Ne vous étonnez pas si l’entrée en matière est tortueuse et sinusoïdale. C’est qu’il s’agit de bien situer les choses, n’est-ce pas. En entrant dans le salon, vous n’aimeriez pas non plus constater que la lampe ne trône pas au milieu de son napperon et que les tableaux au mur piquent du nez. Je n’irai pas jusqu’à réclamer que tout soit tenu comme le palier de la pension où loge Harry Haller, le personnage du Loup des steppes, de Hermann Hesse : la logeuse est vraiment trop maniaque.
Sinon, vous pouvez vous dire qu’Erroll Garner rendait quasiment fous son bassiste et son batteur (mettons Eddie Calhoun et Denzil Best, pour cette fois) en commençant chacun de ses morceaux par des introductions où il errait pendant des temps variables entre diverses tonalités, avant de tomber sur la bonne, comme s’il l’avait vraiment cherchée. Du côté des « sidemen », ça fumait ! Loin de moi la prétention de me comparer, évidemment.
Alors voilà, selon Thomas Mann, la littérature du XXème siècle repose sur un trépied : Marcel Proust, et La Recherche du temps perdu ; Louis-Ferdinand Céline et Voyage au bout de la nuit, avec tout ce qui suit ; James Joyce, et Ulysse. J'avais lu les deux premiers, pas le troisième, jusqu'à, somme toute, une époque assez récente. J'hésitais, parce que le livre était entouré d'une aura sulfureuse. Vous connaissez mon rigorisme moral et le puritanisme altier de ma pudeur cénobitique. Il paraît que c'est parce que c'est plein de saletés et d'obscénités que l'auteur a beaucoup couru après les éditeurs pour être publié.
Donc, par acquit de conscience, j’ai acheté la nouvelle traduction de Ulysse, de James Joyce, celle que Gallimard a publiée en 2004 sous la direction de JACQUES AUBERT, qui était, voire est encore professeur à l’Université Lyon II. J’avais croisé JACQUES AUBERT il y a bien longtemps au monastère de La Tourette, à Eveux, célèbre pour avoir été conçu et dessiné par CHARLES-EDOUARD JEANNERET-GRIS, dit LE CORBUSIER. C’était dans les murs du centre THOMAS MORE.
C’est un très beau monastère, la preuve, le parc est vaste et magnifique. C’était à l’occasion d’un séminaire de DENIS VASSE. Oui, je l’avoue, j’ai traîné la coque de mon rafiot dans ces eaux-là, qui n’avaient pas l’air d’être trop hostiles à des barcasses novices comme la mienne. Je précise que, pour ce qui est de la psychanalyse – car c’est bien de cela qu’il s’agit – je le suis resté, novice, indécrottablement, au point de me demander parfois ce que je suis allé faire par là.
Bon, sans entrer dans trop de détails, j’étais tombé sur l’annonce d’un sujet qui m’intéressait, parce qu’il concernait un travail que je me proposais à l’époque de mener à bien, et que j’en attendais des informations utiles. Je dis bien : à l’époque. Drôle d’ambiance, je vous jure. Le psychanalyste, qui formait le gros de l’infanterie, grouillait pire que vermine, l’université avait délégué un beau bataillon de savants, dont je connaissais quelques-uns, et l’hôpital n’était pas en reste, avec une très présentable escadrille de médecins et infirmières. Oui, qu’est-ce que je faisais là ?
Je n’ai pas regretté, néanmoins. Oui, les repas servis à la cantine étaient d’une qualité tout à fait honorable, et les conversations réellement décontractées. Je n’avais pas encore chanté en compagnie de Michel Cusin, futur président de Lyon II (décédé il y a un ou deux ans, hélas) et collègue de Jacques Aubert, aussi brillant que lui. C’était sous la direction de Bernard Tétu, dans les Choeurs de l'orchestre de Lyon.
Il y avait encore Claude Burgelin, homme subtil, agréable et modeste. Sa femme, psychanalyste, qui écrit sous le nom de Béatrice de Jurquet (je conseille La Traversée des lignes, et Le Jardin des batailles), était présente. Il y avait enfin Adolphe Haberer, lui aussi de Lyon II. Oui, je sais, ça va finir par faire beaucoup de majuscules, mais c’est qu’il y a beaucoup de noms de personnes.
Denis Vasse, il faut quand même dire que c’était lui le maître des cérémonies. Il est possible que certains diraient « gourou ». Ce qui est sûr, c’est qu’avec lui aux commandes, l’auditoire avait intérêt à s’accrocher. Ce n’est pas n’importe qui, cet homme-là. Bien qu’il soit jésuite (oui oui, S. J.), il a écrit un des livres les plus merveilleux qu’il m’ait été donné de lire.
C’est L’Ombilic et la voix. Sous-titre : « Deux enfants en analyse ». C’est du costaud. Beaucoup trop costaud pour moi sur le plan technique : quand ça part dans le dur du psychanalytique, je le dis honnêtement, je suis complètement dépassé. Mais ce livre, je ne l’ai pas lu comme un exposé aride, non, je l’ai lu comme un roman. C’est le récit de deux aventures, des enfants emmurés au départ dans quelque chose que je ne saisis pas.
L’art (je ne trouve pas d’autre mot) de l’auteur est de faire alterner l’aridité des exposés et l’intensité des dialogues tenus au cours des séances entre l’enfant et lui. Et l’on perçoit, au fil du temps, qu’un petit être humain voit se fendiller une carapace, et sent l’air commencer à circuler autour de lui et en lui. L’impression qui s’en dégage, quand tu fermes le livre, est très puissante. La force vient sans doute aussi du fait que le texte est accompagné des dessins des gamins, et là, plus de doute : entre les premiers et les derniers, quelque chose de vital s’est passé. Bref, je ne comprends pas tout, mais ça percute fort. Je pourrai une autre fois dire quelques petites choses des deux séminaires auxquels j’ai participé.
Bref, tout ça pour dire que Jacques Aubert fit une communication. Dont je ne me souviens pas du premier, et encore moins du dernier mot. Mais de grande classe. Car c’est un homme très discret, mais de toute première force, et d’une envergure majestueuse. Tout ce qu’il faut faire pour arriver au but, c’est incroyable. Mais vous voyez que je ne pouvais pas faire autrement.
Voilà ce que je dis, moi.
Promis, demain, on arrive au livre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ulysse, james joyce, hermann hesse, le loup des steppes, erroll garner, thomas mann, marcel proust, louis-ferdinand céline, la recherche du temps perdu, voyage au bout de la nuit, jacques aubert, valéry larbaud, le corbusier, denis vasse, michel cusin, bernard tétu, claude burgelin, béatrice de jurquet, psychanalyse, l'ombilic et la voix

