dimanche, 19 novembre 2023
L'ANTIQUITÉ DE VIALATTE ...
... DATE DE LA PLUS HAUTE ANTIQUITÉ.
Certains amateurs des Chroniques de La Montagne (je pense, allez savoir pourquoi, à Philippe Meyer) font de la formule une sorte de signature, voire un timbre-poste qui sert d'immatriculation au style d'Alexandre Vialatte. En fait, il y a loin de la coupe au lèvres. En révisant les treize volumes de ma collection Julliard, voici ce que j'ai trouvé. Eh bien je peux vous dire que, tout bien compté, ça ne fait pas lourd, quoique je ne prétende aucunement avoir fait le tour de la question, et sans doute loin de là. Comme quoi, la formule inaugurée comme "post-it" par Vialatte fut en son temps une authentique trouvaille de style. Je dirais presque une clé : celle qui ouvre la porte de l'entrée en matière.
***
L'habitation date de la plus haute Antiquité.
Le Bonheur date de la plus haute Antiquité.
Le premier de l'an date de la plus haute Antiquité.
L'homme date des temps les plus anciens.
La femme remonte à la plus haute Antiquité.
La femme remonte, comme je l'ai déjà dit, à la plus haute Antiquité.
La majesté date de la plus haute Antiquité.
L'industrie date de la plus haute antiquité [sic] (Caïn avait déjà une pioche).
L'homme et la femme datent de la plus haute Antiquité.
Les pharmaciens datent de la plus haute antiquité [sic].
Les fleurs remontent à la plus haute antiquité.
La parole date de la plus haute Antiquité.
Note : D'autres formules, germées sous la plume d'Alexandre Vialatte, sont devenues des sortes de classiques. Je pense à : « le progrès fait rage », « résumons-nous » et autres bijoux. Mais Vialatte est aussi l'auteur de nombreuses Enumérations (je mets la majuscule). Ces énumérations commencent de façon parfaitement logique puis, de fil en aiguille, l'auteur y mêle avec jubilation le bric et le broc, le zig et le zag, le tic et le toc, le mic et le mac, le plick et le plock, le ram et le dam, bref : à l'arrivée, il y a le grand Tout, ce lieu improbable où se trouve résumé l'univers dans son imperturbable unité et sa complexité définitivement buissonnière.
Re-note : le mot "antiquité" est en général orné d'une majuscule à l'entrée. Mais pas toujours. J'ai scrupuleusement respecté l'orthographe du texte fourni par les soins de Ferny Besson, chère au cœur d'Alexandre Vialatte, aux éditions Julliard.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, presse, journalistes, philippe meyer, éditions julliard, date de la plus haute antiquité, ferny besson
vendredi, 12 mars 2021
LE SALUT DANS VIALATTE
J'ai entendu un conférencier annoncer que le soleil mourrait dans soixante-six trillions d'années. Un auditeur se leva, défait : "Combien dites-vous ? Soixante trillions ? — Non, j'ai dit soixante-six, dit le conférencier. — Ah ! bon, soupira l'homme, j'avais compris soixante." Et il se rassit, soulagé.
***
"C'est se conduire en rékéké, dit un proverbe congolais, que d'étouffer le roukoukou dans sa coquille."
***
Ceux qui s'en vont, au lieu de partir dans le temps, ont l'air de partir dans l'espace. Ils semblent s'effacer au loin, comme sur un bateau qui s'en va. Comme s'ils étaient allés en Chine. Ils habitent un autre pays, un pays incompréhensible, plein de tombes et de fantômes bienveillants ; avec des rues qui portent leur nom ; des places où on voit leur statue ; comme si c'était là leur vraie vie et que l'autre n'ait été qu'un spectacle futile. Ils ont tous le même âge, étrange, extra-terrestre, et en même temps tous les âges qu'ils ont eus sur terre. Le petit aviateur carbonisé apparaît soudain aussi vieux que le vieux poète, et le vieux poète contemporain de ses plus anciennes photographies. Ils se promènent fraternellement dans une espèce de grand jardin. La mort est une ville de province peuplée d'habitants silencieux ; une petite sous-préfecture sans gare, oubliée des trains et des cars, dont les habitants nous attendent. D'autres fois je les vois dans la nuit d'un noir faubourg, mal éclairé, moucheté de lumières jaunes et tremblantes. Vieux pays, vieux jardins à la porte rouillée qu'ouvre seule la clef du souvenir.
***
Chacun a son idée : on vient de voir ces jours-ci une dame qui avait tué son fils pour que son mari tue son oncle afin de faire mourir son grand-père dont elle aurait hérité les millions. Le processus a flanché en route. Non que l'idée en soi fût mauvaise, mais l'assassinat, comme la guerre, est un art tout d'exécution.
***
J'ai entendu parler deux dames. C'était la fête du mari d'une des deux. « Que lui offrir ? demandait cette épouse. — Une cravate, proposait l'autre dame. — Il n'aime que celles qu'il a choisies. — Une boîte de cigares ? — Il ne fume pas. — Un livre ? — Il en a déjà un. »
***
On a tort et on exagère. C'est parce qu'on a mauvaise conscience. D'abord il y a des juges qui n'entendent pas du tout : les magistrats ont besoin de sommeil, comme tous les hommes, surtout ceux qui travaillent beaucoup. (On sait l'histoire de ce juge alarmé qui alla consulter son médecin « parce qu'il avait des insomnies pendant l'audience »).
***
On ne peut prendre au sérieux que ce qu'on sent plus grand que soi.
***
La Seine est un fleuve historique. Et la Providence a voulu qu'elle arrose notre capitale. Si bien que le fleuve le plus célèbre de la France passe par sa plus illustre ville (c'est ce qu'on appelle le miracle français). Elle y coule entre deux remparts de vieilles pierres, de vieux livres et de jeunes peupliers, irisée de taches de mazout sur lesquelles flotte une épluchure de mandarine. Des bateaux la sillonnent, ornés de petits drapeaux. Des photographes la photographient. Les bains Deligny la rendent utile. Des hommes petits, ronds et velus y suivent sur le tremplin du plongeoir des femmes en forme de pointe Bic, de coupe-papier ou d'armoire bretonne. De longs barbus y font la planche. Leur barbe flotte au bout de leur menton comme une éponge en fibre végétale pour l'entretien des faïences sanitaires.
Sous les ponts, les clochards, à plat ventre, rampent lentement, le bras tendu, vers un litre de rouge. L'eau sent le comptable suicidé.
Le soleil brille.
Et c'est ainsi qu'Allah est grand.
***
Note : ces quelques passages, guillerets ou mélancoliques, de la prose de l'illustre maître ont été picorés dans L'Eléphant est irréfutable, publié aux éditions Fayard en 1980, par les excellents soins de Ferny Besson, avec une préface de Pierre Daninos.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, l'éléphant est irréfutable, éditions fayard, littérature, littérature française, ferny besson
samedi, 20 juillet 2019
VIALATTE ET LA CHALEUR
Parcourant, en façon de révision estivale, les chroniques d'Alexandre Vialatte compilées par sa grande amie Ferny Besson et publiées par la maison Julliard (treize volumes, je crois), il m'arrive de tomber, une fois de plus ébahi (mais c'est toujours une fois de plus et toujours ébahi), sur quelque aperçu saisissant de bon sens et de vérité, à propos de quelque curiosité littéraire ou esthétique, condensé dans une formule définitive.
Cette fois, c’est dans Pas de H pour Natalie (Julliard, 1995) que j’ai trouvé la pépite. A propos de Céline, ce pestiféré. Il est en train de parler des grands maîtres en littérature. Qui sont marqués d’une propriété étonnante : ils sont « réconfortants », ils offrent un « schnaps aux autres hommes », il y a, dans leur écriture « quelque chose de roboratif ».
Attention : « Ce réconfort peut se trouver dans le plus noir pessimisme s’il est inspiré par autre chose qu’une mécanique à fabriquer des mots. Quoi de plus décourageant, objectivement, que Céline ? Quoi de plus amer que sa vision des hommes ? Quoi de plus malodorant que ses châteaux de bouse de vache qui se reflètent dans un flot de purin ? Mais ils sont si monumentaux, il a fallu pour les bâtir tant d’enthousiasme, de verve, de génie créateur, qu’il emporte l’admiration, le rire, le déchaînement lyrique ».
Et c’est là que je fais mon pointer de pure race, vous savez, ce chasseur qui, quand il renifle le faisan blotti dans le buisson, s'immobilise de façon si soudaine qu'il semble changé en statue de pierre : je marque l'arrêt, pile en sursaut : « D’autant plus qu’une telle amertume ne peut être le fait que d’une égale déception, et pour être tellement déçu il faut s’être fait des hommes une idée bien grandiose. Il faut les avoir trop aimés. »
Là je dis : admirable de justesse. A peine quelques mots, et voilà Céline tout entier, avec sa littérature du dépit amoureux, de la rage du déçu qui ne cesse d’injurier son idéal, parce qu’il lui en veut à mort de n'avoir pas tenu ses promesses, pire : de s'être désintégré sous ses yeux, laissant l'adolescent exalté devant le cadavre puant du paradis promis. Une leçon d'analyse littéraire : au cœur du sujet, sans contorsions cérébrales.
Et Vialatte élargit son propos : « Résumons-nous : si, comme le disait Gide, ce ne sont pas les bons sentiments qui font la bonne littérature, c'est tout de même, de façon ou d'autre, le cœur qui passionne le débat. Il faut que le lecteur sente derrière le talent je ne sais quelle épaisseur ou quelle chaleur humaine, quelle vitalité contagieuse, quel "amour" disait Goethe (j'aimerais dire "allégresse").
Il y a des œuvres et des auteurs, qu'on touche comme des serpents ou comme des mécaniques ; ils refroidissent la main comme le fer ou le boa. Je crois que les grands auteurs sont les grands mammifères : ils ont le sang chaud, le poil fourni, la robe luisante. Touchez-les en hiver, la main revient réchauffée.
Pourquoi tant d’œuvres passent-elles si vite malgré le vernis du badigeon, ou même le papier à fleurettes, malgré le talent pour employer le mot qui convient ? C'est qu'il est tendu sur du vide, sur un lattis, ou sur un mur lépreux. On ne sent pas, sous cette pellicule, le frémissement du cuir, la chaleur animale. Si vous tapez dessus, le papier crève. Au contraire, attrapez Dickens, Rabelais, Saint-Simon ou Montaigne ; frappez fortement sur la croupe, et c'est comme un grand cheval qui se met à marcher ; la vapeur lui sort des naseaux, son pas égal et fort fait résonner le village ; montez dessus et vous irez loin. »
Alexandre Vialatte évoque ensuite, pour illustrer son espèce de théorie littéraire (Vialatte n'a pas de théorie littéraire, mais une attitude morale, en fin de compte), la personne de Marie-Aimée Méraville, qui vient d'être enterrée à Condat : « Courageuse, modeste, auvergnate », femme obscure et bel écrivain qui a enseigné toute sa vie à Saint-Flour, pour qui il éprouve de l'admiration, pour la raison même qu'il vient de développer. « Je ne sais, mais la plupart des morts tendent aux vivants, du fond de la tombe, une main glacée. Méraville leur tend une main chaude. » Le vrai lecteur est une caméra thermique.
On n'arrive pas à définir ce qui donne à une œuvre l'animation de l'existence palpitante. Mais quand on est en présence, on le sait, point, c'est tout. Mine de rien, en quelques mots, Alexandre Vialatte vient de répondre à la vieille question : « Qu'est-ce que la littérature ? – C'est la chaleur animale. »
***
"Considérations sur la tombe de Marie-Aimée Méraville" est paru dans La Montagne le 24 septembre 1963.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, littérature française, pas de h pour natalie, marie-aimée méraville, dickens, rabelais, saint-simon, montaigne, louis-ferdinand céline, ferny besson, éditions julliard
dimanche, 05 mars 2017
DÉLICE DE VIALATTE
 Vient de paraître Résumons-nous, (éditions Robert Laffont,
Vient de paraître Résumons-nous, (éditions Robert Laffont,
 collection Bouquins) volume de 1300 et quelques pages des chroniques écrites par Alexandre Vialatte à destination de plusieurs supports. Je connaissais évidemment Bananes de Königsberg (1985, préface de Ferny Besson) et Almanach des quatre saisons (1981, préface de Jean Dutourd), réédités ici et publiés en leur temps par les soins et la diligence de la grande amie Ferny Besson (éditions Julliard). Quand les deux gros volumes des Chroniques de La Montagne avaient paru chez Bouquins / Laffont, j'avais littéralement sauté dessus, au point d'en faire ma seule exclusive compagnie lors d'une expédition lointaine. J'ai cependant conservé pieusement les Julliard.
collection Bouquins) volume de 1300 et quelques pages des chroniques écrites par Alexandre Vialatte à destination de plusieurs supports. Je connaissais évidemment Bananes de Königsberg (1985, préface de Ferny Besson) et Almanach des quatre saisons (1981, préface de Jean Dutourd), réédités ici et publiés en leur temps par les soins et la diligence de la grande amie Ferny Besson (éditions Julliard). Quand les deux gros volumes des Chroniques de La Montagne avaient paru chez Bouquins / Laffont, j'avais littéralement sauté dessus, au point d'en faire ma seule exclusive compagnie lors d'une expédition lointaine. J'ai cependant conservé pieusement les Julliard.
J’ai commencé par me plonger dans le recueil des articles parus dans Le Spectacle du monde entre 1962 et 1971 (mes parents furent un de ces temps abonnés à la revue, mais je confesse que j'étais alors passé complètement à côté de ces articles : je devais être un peu trop vert pour saisir la méthode et la subtilité de la langue de Vialatte, même si je n'ai pas trop tardé à m'y mettre).
Dire combien je me régale depuis quelques dizaines d’années avec la prose de Vialatte relèverait du pléonasme, voire de la simple balourdise. Hommage à un grand homme de la langue française. Ce plaisir n’a pas pris une ride. Mieux : il se bonifie et s’intensifie avec le temps. Je recommande les références savantes à Phorcypeute l'Enumérateur, Hermogène le Guttural, Phyte l'Environnaire, et même le vicomte Amable de Vieuval. Elles valent les trouvailles des "proverbes bantous" et de l'uzvarèche.
« La femme remonte à la plus haute antiquité. Phorcypeute l’Enumérateur la cite déjà dans ses ouvrages. Le vicomte Amable de Vieuval fait mention d’elle avec vivacité dans son Tableau des chemins de fer suisses, suivi d’un Eloge du printemps et Casanova la raconte avec la plus grande affection. Elle a su provoquer le lyrisme d’Hermogène le Guttural et de Phyte l’Environnaire. Horace la vante et Pétrarque l’exalte, le Dr Gaucher l’étudie. C’est l’effet de sa grande importance, car elle joue un rôle capital dans la suite des générations et le déroulement même de l’histoire.
Faut-il rappeler Marguerite de Bourgogne, Hélène de Troie, Emilienne d’Alençon ? Citer Mme Steinheil ou la belle Otéro ? Leurs noms sont dans toutes les mémoires. On montre encore dans les sous-sols du musée Grévin la petite baignoire-sabot en zinc, munie d’un couvercle à charnières, dans laquelle Charlotte Corday immola le cruel Marat. Mme Roland faisait les discours de son mari. La femme de Poetus montrait à son époux comment il faut s’ouvrir les veines. Mme Tolstoï exhortait le sien à écrire d’excellents romans plutôt que de faire de mauvaises bottes [historique].
Sans la femme, l’enfant serait sans mère, le père sans fille, le beau-frère sans belle-sœur, l’oncle sans nièce, l’époux sans veuve. Supprimez-la, l’opéra perd son charme, l’écran ses bustes les plus beaux. Sans elle, au Grand Café il n’y aurait plus de caissière, même à l’heure de l’apéritif, entre deux pots de sansevieria de valeur moyenne. L’homme vivrait comme un orphelin. Recueilli par charité dans d’immenses internats par les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul ou les Frères des écoles chrétiennes, il mènerait dans de grandes casernes une existence d’enfant trouvé, sans autre distraction que la promenade du jeudi, sous l’œil indifférent d’un gardien en casquette, dont les réprimandes salariées ne sauraient remplacer les discussions de famille. De longs troupeaux de quinquagénaires rasés sans soin et brossés sans vigueur se traîneraient sur les routes nationales, rêvant vainement de retrouver aux grandes vacances, pour jouer au croquet et boire du chocolat, des cousines en jupe à plis plats, dans de vieux jardins ornés d’ocubas et de tilleuls. Le soir ramènerait l’homme à son orphelinat. Il y jouerait aux cartes, il fumerait du tabac, il parierait aux courses, il boirait du vin rouge, il sombrerait dans des plaisirs grossiers. Les droits de la femme ne seraient plus défendus. Les travaux de George Sand perdraient toute importance. Des chauves barbus devraient remplacer au pied levé le jury du prix Femina, et manger des petits-fours en buvant du thé tiède. Avec la femme, au contraire, tout s’anime, tout se passionne, la vie reprend ses droits. Elle se marie, elle divorce, elle enfante, elle trompe le boulanger avec le pharmacien ; elle renverse les ministères, elle jette ses enfants par la fenêtre, elle tricote des layettes bleu-pâle sur la ligne Italie-Nation. Enveloppée d’un manteau de vison, elle porte en tête des cortèges politiques une pancarte d’un mètre-carré, qui proclame : « Nous voulons du pain ». Elle tape le courrier de l’homme, elle le porte à signer, il signe, elle l’embrasse, elle l’épouse ; de temps en temps elle le vitriole. L’homme assiste impuissant, l’œil vide, à toutes ces manifestations. Elle lui dispute le bureau et l’usine, elle lui a chipé son pantalon. De conquête en conquête, elle en est arrivée à avoir le droit de travailler quatre-vingt-dix heures par semaine.
C’est un progrès considérable et apprécié.
D’où vient la femme ? Du même jardin que l’homme. Louis XIV avait chargé l’évêque de Beauvais, si j’ai bonne mémoire, d’en retrouver l’emplacement exact. L’évêque le situa à peu près au confluent du Tigre et de l’Euphrate. C’est de là que la femme s’est répandue partout. Sous toutes ses formes. Elles sont nombreuses. Jean Dubuffet, qui aime les contours tremblés, lui donne souvent la figure du Danemark, dont la silhouette l’avait frappé dans son enfance sur les cartes géographiques. Mais l’époque en impose bien d’autres, telles que la ligne haricot vert, la ligne diabolo, la ligne corde à nœuds (la ligne saucisson est innée). Autant en emporte la mode. Bref, la femme est épisodique.
Le Dr Garnier, dans son ttraité du mariage légal, la définit par son opposition à l’homme. « L’homme, lit-il [sic], est altier, pileux, dominateur ; sa texture fibreuse et compacte ; ses cheveux raides, sa barbe noire et bien fournie ; sa poitrine fortement velue exhale le feu qui l’embrase. » La femme a « la figure plus courte et le caractère plus timide, les genoux plus gros, la graisse plus blanche, et le foie plus volumineux ». On voit par là que le Dr Garnier a pris l’homme pour Garibaldi. Sa description de la femme en perd en vraisemblance, ou au moins en portée générale.
Il paraîtra plus équitable de constater que la femme, au moins au XX° siècle, se compose d’une âme immortelle et d’un manteau de renard en chèvre façon loup. Le "drapé en vrille" et "l’ourlet explosif" lui donnent une silhouette étonnante ; sa bouche enduite de Top Secret "va du beige rosé au rouge vibrant". Des substituts de beauté la frottent, la "désincrustent", la hachent, la raclent, la flagellent, la pincent, la rabotent, la triturent, la battent en neige, la roulent dans la farine, et la déroulent sans un faux-pli. Puis la font sécher sur une corde.
(…) ».
Sans commentaire.
Merci, monsieur Vialatte.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : les publicitaires n'ont honte de rien. Un ramassis de tâcherons de je sais plus quelle basse extraction avaient piqué sans vergogne à Vialatte le "truc" des deux dernières phrases, comme on le voit ci-dessous :

Je me souviens que le réjouissant dans l'affaire avait été les hauts cris poussés par les féministes qui, n'ayant honte de rien non plus, prétendent parler "au nom de toutes les femmes", et qui étaient à cette occasion montées à l'assaut de cette publicité, au motif qu'elle "portait atteinte à la dignité des femmes", alors qu'on sait que toute publicité est, par essence et par nature, une atteinte à la dignité humaine en général. Mais on sait malheureusement qu'un militant, quelle que soit la cause qu'il brandit, a pour métier de tirer toute la couverture à lui. Une revue « bête et méchante » aujourd'hui disparue avait même fait du thème un slogan : « La publicité nous prend pour des cons, la publicité nous rend cons ».
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, résumons-nous, chroniques de la montagne vialatte, proverbe bantou, uzvarèche, phorcypeute l'énumérateur, ferny besson, éditions julliard, bouquins laffont, bananes de königsberg, almanach des quatre saisons vialatte
mardi, 04 août 2015
UN ZESTE DE VIALATTE
 « La parole date de la plus haute Antiquité. Qui ne se rappelle les tournois d’éloquence des Grecs et des Troyens devant les murs de Troie ? Les guerriers se sont lancé de magnifiques insultes. Les rois nègres, naguère, de colline à colline, s’entre-vitupéraient dans le style le plus grandiose. Les Peaux-Rouges. Les Apaches. Les automobilistes. Voire les marxistes-léninistes. Et même les époux en colère. Ils se traitaient, et se traitent même parfois encore, de chiens, de fils de chien, de fromage mou, de vipères lubriques, que sais-je ? D’affreux. De déviationnistes des droite. Les Arabes disent à leur ennemi : "Qu’Allah te change en vespasienne !". Les cochers de fiacres traitaient leurs clients de "veaux frisés", de "profil d’œuf", de "moules à confetti". Les paysans citaient de nombreuses maximes, les monarques avaient l’habitude de prononcer des paroles historiques, et les mourants des mots de la fin. »
« La parole date de la plus haute Antiquité. Qui ne se rappelle les tournois d’éloquence des Grecs et des Troyens devant les murs de Troie ? Les guerriers se sont lancé de magnifiques insultes. Les rois nègres, naguère, de colline à colline, s’entre-vitupéraient dans le style le plus grandiose. Les Peaux-Rouges. Les Apaches. Les automobilistes. Voire les marxistes-léninistes. Et même les époux en colère. Ils se traitaient, et se traitent même parfois encore, de chiens, de fils de chien, de fromage mou, de vipères lubriques, que sais-je ? D’affreux. De déviationnistes des droite. Les Arabes disent à leur ennemi : "Qu’Allah te change en vespasienne !". Les cochers de fiacres traitaient leurs clients de "veaux frisés", de "profil d’œuf", de "moules à confetti". Les paysans citaient de nombreuses maximes, les monarques avaient l’habitude de prononcer des paroles historiques, et les mourants des mots de la fin. »
Alexandre Vialatte, « Chronique de la parole et parfois de la pensée ». Dans La porte de Bath-Rabbim, textes choisis et préfacés par Ferny Besson, Julliard, 1986.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, france, alexandre vialatte, chroniques de la montagnela porte de bath-rabbim, ferny besson, humour
dimanche, 02 août 2015
UN ZESTE DE VIALATTE
 « Cette chronique traitant de nos provinces, je chanterai Chatel-Guyon, ses fastes, ses prestiges et ses grands écrivains. Chatel-Guyon fut le Mont-Oriol de Maupassant. Le docteur Baraduc le lança médicalement, des financiers financièrement ; et les banquiers firent de ce village d’Auvergne la "capitale de l’Intestin". On dit que ce fut dans des flots de vin et qu’ils signaient les contrats au champagne (littéralement : en y trempant leur plume) ! C’est trop beau pour qu’on n’y croie pas ! De thermales, les eaux devinrent thermalistiques ; le bain de pieds s’appela "pédiluve", l’entérite se rengorgea, l’amibiase créa un snobisme, le lavement devint si technique sous des masques si distingués que rien ne l’empêcha plus de guérir des altesses, des étoiles et des bachagas.
« Cette chronique traitant de nos provinces, je chanterai Chatel-Guyon, ses fastes, ses prestiges et ses grands écrivains. Chatel-Guyon fut le Mont-Oriol de Maupassant. Le docteur Baraduc le lança médicalement, des financiers financièrement ; et les banquiers firent de ce village d’Auvergne la "capitale de l’Intestin". On dit que ce fut dans des flots de vin et qu’ils signaient les contrats au champagne (littéralement : en y trempant leur plume) ! C’est trop beau pour qu’on n’y croie pas ! De thermales, les eaux devinrent thermalistiques ; le bain de pieds s’appela "pédiluve", l’entérite se rengorgea, l’amibiase créa un snobisme, le lavement devint si technique sous des masques si distingués que rien ne l’empêcha plus de guérir des altesses, des étoiles et des bachagas.
Le tambour de ville, pour suivre le progrès, dut se faire motoriser : il n’opère plus qu’à bicyclette, avec une caisse inamovible et des baguettes à manivelle. Sur bâti fixe. Il lit d’une main, tourne de l’autre, les deux baguettes jouent en même temps. C’est un vrai lapin mécanique. Et s’il voulait, il pédalerait par-dessus le marché ! Rien ne l’en empêche, tout l’y convie. En revanche, il y a perdu ses rra (le moelleux du grondement, le crescendo du tonnerre, le filé, le mourant du son, tout ce qui charmait si fort les oreilles délicates). Il ne donne plus que des fla. Le char du progrès avance sur le cadavre de l’art. »
Alexandre Vialatte, « La capitale de l’intestin », N.R.F., décembre 1951.
Dans Profitons de l’ornithorynque, textes choisis par Ferny Besson, préface de Claude Duneton.
Note : le mot "bachaga" existe. Il désigne, en arabe, un "haut dignitaire". Vialatte, ici, ne nous refait donc pas le coup de l' "uzvarèche".
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, profitons de l'ornithorynque, ferny besson, claude duneton, nrf
vendredi, 31 juillet 2015
UN ZESTE DE VIALATTE
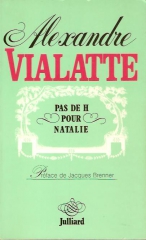 Même si ça peut sembler incongru, je comparerais volontiers chaque plongée dans les chroniques de maître Vialatte à celles que je fais régulièrement dans les albums de Gaston Lagaffe, la créature de maître Franquin : il suffit de quelques pages pour que le lecteur se mette à jubiler. Un ton et une tournure d’esprit absolument uniques, joints à la virtuosité du trait. Deux auteurs qui savent à merveille vous tenir en état de surprise permanente, à l'exact antipode de ce que Vialatte nomme quelque part (chronique "Des hauts et des bas" par Sempé) « le crime de l'uniformité ». Regardez par exemple ce paragraphe qui clôt diverses considérations, dont un éloge de Le Fond et la forme (tome II), de Jean Dutourd. On trouve ça dans Pas de h pour Natalie (Fayard, 1995).
Même si ça peut sembler incongru, je comparerais volontiers chaque plongée dans les chroniques de maître Vialatte à celles que je fais régulièrement dans les albums de Gaston Lagaffe, la créature de maître Franquin : il suffit de quelques pages pour que le lecteur se mette à jubiler. Un ton et une tournure d’esprit absolument uniques, joints à la virtuosité du trait. Deux auteurs qui savent à merveille vous tenir en état de surprise permanente, à l'exact antipode de ce que Vialatte nomme quelque part (chronique "Des hauts et des bas" par Sempé) « le crime de l'uniformité ». Regardez par exemple ce paragraphe qui clôt diverses considérations, dont un éloge de Le Fond et la forme (tome II), de Jean Dutourd. On trouve ça dans Pas de h pour Natalie (Fayard, 1995).
« Je ne saurais terminer sans des conseils utiles : faites ramoner dès maintenant vos cheminées et réclamez une fiche de contrôle ; soyez vertueux et sensible ; ouvrez toujours les boîtes d’asperges "par le fond" ; si votre chat n’aime pas le mou, donnez –lui du caviar ; ne mentez qu’avec précision ; si vous engraissez de la ceinture, renversez la tête en arrière, vous rétablirez l’équilibre. Relisez Le Fond et la forme, votre fond en aura plus de forme, votre forme en aura plus de fond. Ne battez pas votre femme avec une barre de fer ; vous seriez puni par les juges d’Angleterre, car c’est un geste de goujat ; usez plutôt d’une canne flexible et résistante, vous serez approuvé par la Bible et par les proverbes arabes.
Et c’est ainsi qu’Allah est grand. »
Alexandre Vialatte, La Montagne, 17 mai 1960.
On me dira ce qu’on voudra, ce genre d’allègre espièglerie ne peut se trouver que sous la plume d’un grand de la littérature.
Mais là je n’apprends rien à personne.
Voilà ce que je dis, moi.
 Note : quoi qu'on puisse en penser, Vialatte orthographie le prénom Natalie conformément à l'étymologie latine. On lit d'ailleurs dans l'irremplaçable Fleur des saints, cette bible écrite par Omer Englebert (Albin Michel), à la date du 27 juillet (où l'on fête toutes les Natalie) : « Ils furent décapités [en 852], écrit Euloge, dans l'ordre suivant : Félix, Georges, Liliose, Aurèle et Natalie (ou Noële) [sic] ». Eh oui, Noëlle et Nat(h)alie, c'est du pareil au même. C'est un des sujets de la dernière chronique du volume, "Chronique de l'h de Natalie". C'est sûr, Vialatte est du genre conservateur.
Note : quoi qu'on puisse en penser, Vialatte orthographie le prénom Natalie conformément à l'étymologie latine. On lit d'ailleurs dans l'irremplaçable Fleur des saints, cette bible écrite par Omer Englebert (Albin Michel), à la date du 27 juillet (où l'on fête toutes les Natalie) : « Ils furent décapités [en 852], écrit Euloge, dans l'ordre suivant : Félix, Georges, Liliose, Aurèle et Natalie (ou Noële) [sic] ». Eh oui, Noëlle et Nat(h)alie, c'est du pareil au même. C'est un des sujets de la dernière chronique du volume, "Chronique de l'h de Natalie". C'est sûr, Vialatte est du genre conservateur.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, pas de h pour natalie, chroniques de la montagne, ferny besson, jean dutourd, le fond et la forme, sempé, des hauts et des bas, franquin, gaston lagaffe, omer englebert, la fleur des saintséditions albin michel
jeudi, 30 juillet 2015
UN ZESTE DE VIALATTE
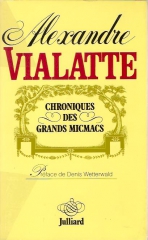 C’est l’été. Il est temps de rouvrir les Chroniques de Vialatte. Et pour commencer, Chroniques des grands micmacs, amoureusement choisies par Ferny Besson (Fayard, 1989, je suppose que Ferny, c'est plus glamour que la Fernande qu'a chantée Georges Brassens). Première leçon : l’art du paragraphe.
C’est l’été. Il est temps de rouvrir les Chroniques de Vialatte. Et pour commencer, Chroniques des grands micmacs, amoureusement choisies par Ferny Besson (Fayard, 1989, je suppose que Ferny, c'est plus glamour que la Fernande qu'a chantée Georges Brassens). Première leçon : l’art du paragraphe.
« Chronique des grands progrès et des mauvais conseils.
Quand le soleil, il n’y a pas si longtemps, se levait sur l’océan indien, il éclairait un petit bateau commandé par Henry de Monfreid, alors âgé de quelque quatre-vingts ans. Le petit mousse en avait soixante-dix. C’était un vieillard madécasse. Monfreid l’avait choisi lui-même. Ce septuagénaire maritime était sourd comme un pot. Il n’entendait pas le vent. C’était d’ailleurs sans importance. Il n’eût su dire, de toute façon, d’où il venait, ignorant toute géographie, toute marine et tout point cardinal. Il ne distinguait pas entre le nord et le sud. Peut-être savait-il faire la soupe. La tempête s’empara de tout ça, le lança à dix mètres de haut, le rattrapa au creux de la vague, le renvoya aux cieux, le battit, le pétrit, le roula, le massa, le secoua, le boxa, l’étira et le rasa. Sur quoi les ténèbres tombèrent. Au bout de huit jours, quand le soleil revint, le petit mousse n’avait rien entendu, et le bateau continuait sa course sur la vaste étendue des mers.»
Qu'est-ce que vous dites de ça ? Et pour lier avec l'idée qui va suivre, Vialatte soigne la transition :
«C’est ce qui prouve qu’il n’y a plus de vieillards. Les journaux confirment la chose. Le vieillard d’aujourd’hui ne connaît plus sa force. »
Alexandre Vialatte, La Montagne, 10 décembre 1967.
Plus loin, dans le même article, on trouve cette phrase magnifique, après l’évocation de Sabor V, un robot qui sait tout faire, y compris se gratter l’omoplate, boire et fumer : « Bref, s’il n’y avait pas l’homme, ce serait un grand progrès ». Tout est dit.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, chroniques des grands micmacs, ferny besson, éditions fayard, georges brassens, quand je pense à fernande
dimanche, 06 juillet 2014
VOUS REPRENDREZ DU VIALATTE ?
 Allez, encore un peu d’Alexandre Vialatte. Toujours tiré de Profitons de l’ornithorynque (Julliard, 1991). L’admirable très long paragraphe qui suit constitue la moitié (approximativement) de la chronique intitulée « Eva Peron » (La Montagne, 12 avril 1960), et recueillie par la grande amie de l’auteur, Ferny Besson.
Allez, encore un peu d’Alexandre Vialatte. Toujours tiré de Profitons de l’ornithorynque (Julliard, 1991). L’admirable très long paragraphe qui suit constitue la moitié (approximativement) de la chronique intitulée « Eva Peron » (La Montagne, 12 avril 1960), et recueillie par la grande amie de l’auteur, Ferny Besson.
Le ciel est gris, la conjoncture est molle, la civilisation s’affaisse comme un soufflé. Autrefois on vantait l’art d’un film, maintenant on vante son prix de revient ; autrefois on parlait du talent d’un poète, maintenant de la marque de son auto ; autrefois on habitait des maisons. C’étaient des endroits faits pour l’homme qui procuraient à chaque activité le paysage qui lui était naturel ; les oignons séchaient au grenier, le vin mûrissait à la cave, la mauvaise marche du perron cassait la jambe au visiteur insupportable, les rats avaient un champ raisonnable mais limité pour faire rouler les noix sur le plancher du grenier entre la malle en poil de chèvre et l’ombrelle de la bisaïeule ; le saucisson pendait à la solive,les enfants trouvaient aisément quelque niche naturelle pour jouer à Guignol ; on savait où mettre ses souliers, sa pipe, son grand-père, son vélo. Maintenant il n’y a plus de maisons, mais des taudis ou des chambres d’hôtel, et ce placard nu, cette tombe, ce désert de la soif, bref cette aventure saharienne qu’on a appelée H.L.M., où l’homme meurt de claustrophobie, par un record du paradoxe, au sein d’un vide illimité. J’ai vu un rat de quatre cent dix grammes y périr en une heure quatorze sur un sol en fibrociment. D’ennui. De dégoût. D’écœurement. De solitude métaphysique. Je l’ai vu maigrir progressivement, perdre ses joues, pencher la tête, fermer les yeux, raidir les pattes. Est-ce raisonnable ? On vous explique que ces surfaces arides sont très faciles à balayer ; plus fort : qu’il n’y a même pas à le faire ! Mais l’homme passe-t-il sa vie à ne pas balayer ? Victor Hugo écrivait-il ses Mémoires pour qu’ils soient faciles à épousseter ? Ou même ses Odes ?... C’est une logique qui dépasse mes moyens. Mais après tout … j’ai vu un homme vendre une règle à calcul en expliquant qu’elle était faite d’une matière imperméable ! J’ai même vu acheter cet engin par des mères de famille nombreuse qui ne descendaient jamais sous l’eau, même en scaphandre, et qui ne s’en serviraient jamais, même une fois revenues au soleil. Après quoi on peut tout admettre. Et cependant je persiste à penser qu’on achète des logements afin de les habiter et non de ne pas les balayer. Sinon on achèterait un trottoir en asphalte. Et d’ailleurs on se lasse vite de ne pas balayer. C’est un plaisir qu’on épuise en deux jours. L’homme, qui n’est pas plus bête qu’un autre (pas moins non plus) (mais enfin pas plus), s’aperçoit vite, au demeurant, qu’il y a bien plus à balayer sur une surface parfaitement lisse, où les rainures n’absorbent rien, que sur un plancher raviné par les ans. On ne devrait construire que du vieux. En prévoyant l’espace vital des choses qui réclament de la place, du temps, des soins et de la piété : le vin qui veut vieillir, le fromage qui veut vivre, et la grand-mère qui veut le manger. Les mettra-t-on au frigidaire ? à l’hôpital ? Quelle indécence ! Voilà pourtant où va la civilisation. Elle ne vit plus qu’en état de guerre. Dès qu’un homme d’Etat parle de paix, on sait que c’est pour lui faire la guerre. Il y a toujours quelque Corée, quelque Tibet ou quelque Irak [tiens, déjà en 1960] où on la garde à la glacière ; c’est la guerre froide ; ou alors sur le coin du fourneau ; c’est la guerre tiède ; on la retire à moitié, on la remet, on l’enlève, on la réchauffe un peu ; plus elle est vieille, meilleure elle est, comme le civet ; quand elle réduit, on lui ajoute un petit oignon, un verre de vin, un brin de laurier, un filet d’eau bouillante, et ça se remet à faire des bulles. Voilà pourtant la vie que nous menons. La civilisation est couverte de plaies. Qu’on entretient en les grattant ; comme l’eczéma.
Est-ce que c'est pas bien tapé, ça ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, france, littérature française, style, humour, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, journal la montagne, profitons de l'ornithorynque, ferny besson, éditions jullliard
vendredi, 15 juin 2012
UN PEU DE VIALATTE CHAQUE JOUR
J’ai déjà dit tout le bien qu’il est conseillé de penser de Monsieur ALEXANDRE VIALATTE, l’auteur immarcescible des Chroniques de La Montagne (898 textes publiés chaque lundi, à quelques très rares exceptions près, de 1952 à 1971, dans le journal de Clermont-Ferrand, disponibles en Laffont « Bouquins »). Je dis « conseillé », parce que – et on peut le regretter – il n’existe ni sanction, ni mesure de rétorsion contre les écervelés qui, endurcis dans une attitude confinant à un lamentable obscurantisme, se refuseraient à rendre un culte à l’ « Auvergnat absolu ».
Mais la vénération a d’autres raisons de s’exercer que les seules Chroniques de la Montagne, dont FERNY BESSON, la fidèle entre les fidèles, a publié une bonne partie dans une douzaine de volumes (Julliard) délicieux, dotés de titres parfaitement homothétiques avec le contenu et l’esprit des dites chroniques. Citons L’Eléphant est irréfutable, Profitons de l’ornithorynque et Eloge du homard et autres insectes utiles, pour rester dans la référence animale.
A ce propos, je précise que l’ornithorynque est un mammifère « monotrème » mot forgé à partir du grec, signifiant « un seul trou », car le même conduit sert à excréter les liquides, les matières et les œufs portant la descendance, mais aussi permet à la femelle d’accueillir le mâle ; pourquoi se compliquer l’anatomie quand on peut faire simple, n’est-ce pas ? N’est-ce pas aussi que c’est rafraîchissant de savoir de telles choses ?
Parmi d’autres originalités cultivées par ALEXANDRE VIALATTE, il eut celle d’habiter, au dernier numéro pair (158) de la rue Léon-Maurice Nordmann (Paris, 13ème), un immeuble donnant juste sur la prison de la Santé (Paris, 12ème), dont il n’était séparé que par la bien nommée rue de la Santé (l’hôpital Cochin est tout à fait voisin, mais j’ignore qui, de l’hôpital, de la prison ou de la rue, eut la préséance dans la dénomination).
Parmi les autres raisons d’admirer ALEXANDRE VIALATTE, il y a ses romans, dont le formidable Les Fruits du Congo. J’en parlerai une autre fois, si vous le permettez. Je m’arrêterai aujourd’hui, certes sur des chroniques, mais d’un autre genre : celles qui furent publiées dans Marie-Claire (eh oui !) dans les années 1960, sous le titre « L’Almanach d’Alexandre Vialatte », et que l’impeccable FERNY BESSON a publiées (Julliard) sous le titre rigolo Almanach des quatre saisons (12 chapitres correspondant aux mois de l’année), et dans lesquelles il démontre combien il sait parler aux femmes : « Ail : mangez-en beaucoup. Il rajeunit l’organisme et éloigne les importuns ».
« Janvier est le premier mois de l’année depuis une décision de Charles IX ». Voilà comment ça commence. Car il faut le savoir, avant l’ « Edit de Roussillon » (promulgué le 9 août 1564 au château de Roussillon, et entré en vigueur le 1er janvier 1567), c’était l’anarchie dans le royaume de France, et en plus, sans tenir compte des guerres de religion. Pensez, dans le diocèse de Lyon, l’année commençait à Noël, dans celui de Vienne, le 25 mars, ailleurs c’était le 1er mars, ailleurs c’était à Pâques. Impossible de s’y retrouver. Remarquez, maintenant, comment expliquer les « sept-, oct-, nov-, déc- des quatre derniers mois de l’année ? Réponse : on ne saurait satisfaire tout le monde.
« C’est en janvier, sous le Roi-Soleil, que l’homme inventa la machine à écrire, et que Landru, qui reste dans l’histoire comme le type du faux affectueux, brûla sa dernière victime dans un poêle à trois trous sans valeur commerciale : le vent soufflait et l’ombre de sa barbe dansait sur le mur de la cuisine. » Le fantastique, comme on le voit, n’est jamais loin. Un art éminemment visuel.
Ses recommandations aux dames pour le mois de janvier sont très simples : ne pas croire qu’à la Saint-Charlemagne, les censeurs de lycée ont pour coutume de manger un mauvais élève ; ne pas s’adresser à son percepteur dans la langue chaldéenne ; éviter les loups qui rôdent dans la forêt en hiver ; après une journée fatigante, faire un bœuf mode à la cocotte-minute, et gagner ainsi trois heures qu’elles pourront consacrer à un repos réparateur : « Une bonne lessive, au même moment, peut vous faire gagner deux grandes heures ; en achetant un prêt-à-porter vous gagnerez quarante-cinq minutes. Vous finirez pas avoir trop de temps ».
Voilà : une dose de VIALATTE tous les jours, c’est d’abord et avant tout une question d’HYGIENE. Et la forme littéraire qu’il a adoptée s’y prête à merveille. Comme le disait, lors des Assises Internationales du Roman, un écrivain (ROBERTO ALAJMO), le fragment est, idéalement, « de la littérature de cabinet ». Profitez de votre halte quotidienne dans « les lieux » pour soignez vos neurones et vos zygomatiques intérieurs.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, humour, pataphysique, chroniques de la montagne, bouquins laffont, ferny besson, profitons de l'ornithorynque, éloge du homard, l'éléphant est irréfutable, mammifères, monotrème, les fruits du congo, almanach des quatre saisons, éditions julliard

