dimanche, 19 novembre 2023
L'ANTIQUITÉ DE VIALATTE ...
... DATE DE LA PLUS HAUTE ANTIQUITÉ.
Certains amateurs des Chroniques de La Montagne (je pense, allez savoir pourquoi, à Philippe Meyer) font de la formule une sorte de signature, voire un timbre-poste qui sert d'immatriculation au style d'Alexandre Vialatte. En fait, il y a loin de la coupe au lèvres. En révisant les treize volumes de ma collection Julliard, voici ce que j'ai trouvé. Eh bien je peux vous dire que, tout bien compté, ça ne fait pas lourd, quoique je ne prétende aucunement avoir fait le tour de la question, et sans doute loin de là. Comme quoi, la formule inaugurée comme "post-it" par Vialatte fut en son temps une authentique trouvaille de style. Je dirais presque une clé : celle qui ouvre la porte de l'entrée en matière.
***
L'habitation date de la plus haute Antiquité.
Le Bonheur date de la plus haute Antiquité.
Le premier de l'an date de la plus haute Antiquité.
L'homme date des temps les plus anciens.
La femme remonte à la plus haute Antiquité.
La femme remonte, comme je l'ai déjà dit, à la plus haute Antiquité.
La majesté date de la plus haute Antiquité.
L'industrie date de la plus haute antiquité [sic] (Caïn avait déjà une pioche).
L'homme et la femme datent de la plus haute Antiquité.
Les pharmaciens datent de la plus haute antiquité [sic].
Les fleurs remontent à la plus haute antiquité.
La parole date de la plus haute Antiquité.
Note : D'autres formules, germées sous la plume d'Alexandre Vialatte, sont devenues des sortes de classiques. Je pense à : « le progrès fait rage », « résumons-nous » et autres bijoux. Mais Vialatte est aussi l'auteur de nombreuses Enumérations (je mets la majuscule). Ces énumérations commencent de façon parfaitement logique puis, de fil en aiguille, l'auteur y mêle avec jubilation le bric et le broc, le zig et le zag, le tic et le toc, le mic et le mac, le plick et le plock, le ram et le dam, bref : à l'arrivée, il y a le grand Tout, ce lieu improbable où se trouve résumé l'univers dans son imperturbable unité et sa complexité définitivement buissonnière.
Re-note : le mot "antiquité" est en général orné d'une majuscule à l'entrée. Mais pas toujours. J'ai scrupuleusement respecté l'orthographe du texte fourni par les soins de Ferny Besson, chère au cœur d'Alexandre Vialatte, aux éditions Julliard.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, presse, journalistes, philippe meyer, éditions julliard, date de la plus haute antiquité, ferny besson
samedi, 18 novembre 2023
L'HOMME DE VIALATTE 3
L'homme n'est que poussière. C'est dire l'importance du plumeau. (L'éléphant est irréfutable)
Quand on rencontre l'homme, on est tout de suite frappé par sa silhouette décidée : il porte un petit chapeau fendu par le milieu, il marche sur les pattes de derrière. Un litre sort parfois de sa poche, un croûton de pain, une saucisse de Toulouse roulée dans un papier journal ; et d'autres fois (s'il est du sexe féminin) il apparaît dans quelque music-hall, au sommet d'un escalier d'or, enveloppée d'une gaze vaporeuse qui lui fait un halo laiteux, et vêtu de bijoux scintillants complétés de quelques plumes d'autruche. (idem)
L'homme ne descend pas, il remonte. Il remonte au tarsier, une sorte de rat avec des mains prenantes et des oreilles pointues. Tel est le dernier état de la science.(idem)
Quand, pour la première fois du monde, l'homme se dressa sur ses pattes de derrière, encore tout chiffonné du plissement hercynien, et jeta un oeil hébété sur la nature environnante, il commença par bâtir ses villes à la campagne pour être plus près des lapins, des mammouths, des ours blancs et autres mammifères dont il était obligé de se nourrir. (Pas de H pour Natalie)
L'homme, au mois d'août, s'évade de ses logements cubiques pour retrouver à la campagne les maisons inconfortables du bonheur. (idem)
L'homme entre un jour dans la vieillesse comme dans un appartement vide à l'éclairage crépusculaire. Par la fenêtre, en bas, il voit passer la vie, grossie de ses souvenirs et de ses songes. Mais il ne la voit plus que par la fenêtre, improbable et fantomatique. Puis il s'efface lui-même et se déguise en souvenir. (idem)
Aux dernières nouvelles, l'homme s'ennuie. Surtout en Hollande et en Suisse. Où il a cependant toutes sortes de fromages. Qu'il ripoline le soir et qu'il lave le matin pour orner des vitrines brillantes. Mais enfin il s'ennuie parmi sa propreté. (idem)
L'homme n'est pas pareil à lui-même et ne cesse de s'en distinguer. (Dernières nouvelles de l'homme)
L'homme se prouve par le chapeau mou, qui le distingue des autres primates. Mais, même prouvé par le chapeau mou, l'homme a beau être réellement homme, l'Italien l'est encore plus que lui. D'abord parce qu'il ajoute des plumes au chapeau mou, des plumes vertes qui font lyrique. Rien n'est plus beau que de le voir se marier dans cette parure ornithologique. En chantant Sole mio. On dirait l'oiseau-lyre. (Chroniques des immenses possibilités)
L'homme date d'une si lointaine époque qu'il est affreusement fatigué. L'appendicite, les guerres mondiales, le souci d'une nombreuse famille lui ont fait les idées floues et le genou hésitant. (idem)
Que fait l'homme par ce froid sec en ce mois de février ? Il naît sous le signe du Verseau ... Et il a bien raison. C'est le vrai moment de le faire. Le délai expire aujourd'hui. (idem)
L'homme, autrefois, s'intéressait à l'homme. Il se passionnait pour son voisin. Il l'étudiait à fond, il connaissait ses vices, son casier judiciaire et son état de fortune. Il lui prêtait sde l'argent à 80 %. Il lui écrivait des lettres anonymes. Il l'y accusait d'avoir tué son vieux père pour lui voler un saucisson pur porc. Et d'être trompé par sa femme. Il lui accrochait dans le dos un poisson en papier : c'était la loi du 1er avril. Aujourd'hui, c'est l'indifférence : on laisse traîner un garagiste accidenté par une auto pendant huit heures dans un fossé plein d'escargots ; on n'accroche plus de poisson en papier peint aux basques de son chef de bureau. Bref, il semble que l'homme ait perdu tout esprit, tout altruisme et toute initiative. (Chroniques des grands micmacs)
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, littérature, alexandre vialatte, humour, chroniques de la montagne, éditions julliard, chroniques des immenses possibilités, dernières nouvelles de l'homme, pas de h pour natalie, l'éléphant est irréfutable
jeudi, 16 novembre 2023
L'HOMME DE VIALATTE 2
L'homme serait un roseau pensant. Disons plutôt un roseau pensif ... Ou même songeur ... Disons un salsifis songeur. Car la pensée paraît tout de même plus dense que les produits de la cervelle humaine, et le roseau est plus racé que l'homme. Soyons sincères : l'homme est un champignon rêveur ; un concombre qui a des visions ; un salsifis qui souffre de marottes.
Où va l'homme ? De plus en plus loin.
L'homme ne saurait avoir un fils sans lui acheter un abécédaire, bientôt un casque de Martien. Pour le payer, il faut que l'homme travaille, pour être correct il doit mettre une jaquette, pour y mieux voir un lorgnon à ruban. Résumons-nous : il se transforme en lui-même, tel que le présentent tous les manuels d'école primaire. Il attend l'autobus 28 en feutre mou.
"L'homme, dit la Bible, est en exil sur cette terre". Et l'opinion publique ajoute : "Surtout dans le XIIIè arrondissement".
Dernières nouvelles de l'homme (Julliard, 1978).
L'homme date des temps les plus anciens. Les manuscrits du Moyen Âge mentionnent déjà son existence. Sur des images à fond doré. Ils le représentent chassant le loup, le canard, ou même la sarcelle, en culotte rouge et un petit chapeau vert décoré d'une plume de poulet. Ou alors entouré de licornes. Et aussi mangé par des lions. Ou pliant le genou devant une dame. Ou attaquant des châteaux forts sur des lacs suisses, avec une petite culotte bouffante, des manches gigot, des piques très compliquées, des pertuisanes dont le fer a l'air d'ne lettre arabe, des canons, des boulets en pierre, sur des radeaux que les assiégés repoussent du pied en brandissant des couteaux de cuisine.
L'homme compte, assurent les zoologues, parmi les plus jolies productions de la nature. surtout quant il a un grand nez et qu'il fait un discours, juché sur un tonneau. Ou quand il se met des plumes sur la tête, comme le Peau-Rouge et le bersaglier. Et aussi quand il est chinois. Parce que alors il a des idées chinoises, et les idées chinoises sont tout à fait gracieuses. L'esprit chinois s'abandonne toujours à l'inspiration poétique.
Eloge du homard et autres insectes utiles (Julliard, 1987).
L'homme s'est, de tout temps, intéressé à l'homme. A ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il voudrait qu'il fasse. Il lui écrit des lettres anonymes, Il le trapine en justice. Il "este" contre lui, comme disent les mots croisés. Il lui déclare des guerres mondiales, il le pend, il le brûle, il veut savoir ce qu'il fait, ce que mijote le voisin, ce qu'en a dit sa belle -soeur, pourquoi le mariage s'est fait, pourquoi il ne s'est pas fait, où le sous-préfet est allé en vacances, et pourquoi la chaisière a mis un chapeau neuf. Toutes ces choses le passionnent. Il cherche à les savoir. Telle est l'origine de la presse.
Que devient l'homme ? On le garde encore, disait notre dernière chronique. Provisoirement. Pour la bonne bouche. On vient même d'en retrouver un qui datait de la guerre de Cent Ans. Un Anglais. A Boissy-le-Roi. En cherchant de l'eau. Et la locomotive de l'express 414 a rapporté sur son tampon, en gare de Nîmes, la tête d'un octogénaire dont le corps était resté en travers de la voie, à dix kilomètres de là : à Vergez. C'était un retraité. Les gens du quai podes cris. Mais la tendance serait plutôt de supprimer l'homme. Ses besoins contrarient le progrès. C'est le dernier obstacle qui reste au bonheur de l'humanité. Comme un jardin peut se passer de fleurs, l'homme peut peut-être se passer de lui-même ? Toute la question est là. L'expérience est en cours.
L'homme descend de moins en moins du singe. Il s'y était pourtant habitué. On y était fait. Une fois le pli pris, on aimait bien descendre du singe. La nuit j'avais des rêves grandioses : mon grand-père me revenait dans le sang ; attaché par la queue au sommet des palmiers, je me balançais à des hauteurs vertigineuses et je traversais l'Afrique en sautant d'arbre en arbre. Je me cachais dans la forêt vierge et j'effrayais l'explorateur à la façon de l'orang-outan (ou du gorille ?) en me tapant sur les pectoraux, ce qui produit dans ces solitudes une espèce de roulement de tonnerre plus effrayant que le "hoquet du Pygmée". Je n'avais plus peur que du serpent à lunettes. Je me faisais des grimaces dans un miroir à barbe. Adieu beau rêve !
Profitons de l'ornithorynque (Julliard, 1991).
mardi, 14 novembre 2023
L'HOMME DE VIALATTE 1
L'homme est devenu cosmique. Il se sent entraîné par la giration des étoiles. Il tourne autour d'axes invisibles. Toutes les douze heures, à cheval sur l'équateur, il se retrouve à vol d'oiseau à plus de 12.500 kilomètres de lui-même. Le grabataire, le paralytique, ne font pas moins de 40.000 kilomètres par jour.
L'homme tel qu'on peut le voir de nos jours, nettoyant son auto avec un chiffon jaune, ou mordu à la fesse dans un jardin de banlieue par le "chien méchant" d'un cousin riche, cet homme remonte à la plus haute Antiquité.
L'homme est de la race des œufs dont on fait les omelettes.
L'homme, quoi qu'il fasse, finit toujours par se trouver en caleçon au fond d'un placard.
L'homme est devenu environnaire. Il a été remplacé par un trou.
L'homme reste le roi de la création. Il est debout sur la terre, qui tourne au milieu de toutes les choses qui tombent. Il est très beau à voir ainsi, parce qu'il a des souliers qui brillent. Il les fait luire avec un velours de coton.
L'homme assaille l'homme de ses questions : "Comment puis-je connaître le bonheur ?", "Que faire pour atteindre la paix ?", "Où se trouve la vérité ?", "Où sont les lavabos ?". Autant de questions qui prouvent son ignorance.
L'homme se compose essentiellement d'un chapeau mou et d'un pardessus demi-saison. Mais il n'y a là qu'une vérité moyenne. Aux courses, par exemple, il porte un melon gris.
L'homme a grand besoin du serpent de mer et de l'éléphant. L'homme ne saurait se passer des monstres. Comment connaîtrait-il sa taille sans la girafe et l'arteron ?
L'homme n'est réellement beau que sur les monuments, entouré de tous ses accessoires : le télégraphe optique, la boîte de la marmotte, le hérisson du petit Savoyard.
Alexandre Vialatte
Antiquité du grand chosier (Julliard, 1984).
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, humour, antiquité du grand chosier
lundi, 17 janvier 2022
ET C'EST AINSI QU'ALLAH ...

***
« Le temps est gris, on ne peut pas s'empêcher de rêvasser. Mille idées vous passent par la tête, qu'on a envie d'attraper par la queue. C'est une tentation très dangereuse. Car de songe en idée, on finit par penser. Et il n'y a rien de plus fatigant. Ni de plus vain. Car on ne pense pas juste. Ou alors une fois sur cent mille. Par quelque hasard prodigieux.
Ce qui n'a d'ailleurs pas d'importance. Car l'idée fausse est souvent plus féconde : l'idée fausse que la terre est plate permet fort bien de caler une chaise ou de bâtir une chaumière normande avec une poutre où accrocher les saucissons. L'idée juste que la terre est en forme de poire, ou mieux de pomme de terre nouvelle, compliquerait au contraire les choses à un tel point que l'homme ne pourrait jamais s'asseoir ni manger le saucisson dans une chaumière normande, si le maçon voulait en tenir compte. Ce qui priverait l'existence de toute jovialité. Aussi le président Krüger était-il sagement inspiré, il n'y a pas soixante ans de la chose, d'interdire l'accès du Transvaal à tous les trublions faisant le tour du monde, voulaient donner à Pretoria des conférences par lesquelles ils risquaient de prouver que la terre est ronde. Il fut ferme et ne céda pas. C'est pourquoi il a sa statue devant son ancienne petite maison. En redingote, en gibus, en marbre. Avec un haut-de-forme évidé pour permettre aux oiseaux d'y boire. C'était du moins ce que demandait sa femme. Elle voulait faire de lui une fontaine pour les hirondelles. Je ne sais plus bien si on l'a exaucée. Quoi qu'il en soit, ces raisonnements précis prouvent à merveille qu'une idée excellente n'a pas besoin d'être juste ou fausse, mais bien seulement d'être féconde ».
Alexandre Vialatte, Et c'est ainsi qu'Allah est grand, Fayard, 1979.
vendredi, 14 janvier 2022
ET C'EST AINSI QU'ALLAH ...
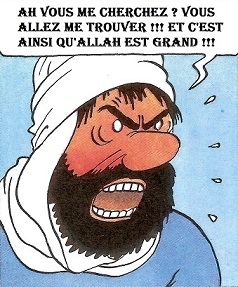
Voici l'état dans lequel le capitaine Haddock se met face au "balloon dog" de Jeff Koons installé dans les ors et les stucs d'un salon de Versailles. On le comprend.

***
DES NOUVELLES DE L'ARCON - 3.
« Malheureusement, moins la peinture est prise au sérieux par le peintre, plus il se prend lui-même au sérieux. Moins on sait la grammaire et plus on philosophe. Le peintre veut être un penseur. J'ai vu une exposition de jeunes génies où le programme tenait toute la place. Ils étaient "contre la morale". "Naturellement", ajoutaient-ils. C'était le premier point de ce programme. Ils y tenaient férocement. Mais qui leur faisait obstacle ? et qui ce détail intéresse-t-il ? Surtout en fait de peinture abstraite ! J'ai essayé de trouver leurs losanges immoraux et leurs circonférences coupables. Il ne m'en est pas venu de frisson d'art. Et leurs melons ! D'abord. Qu'est-ce qu'un melon immoral ?... C'est celui qui nourrira Hitler, Néron, Landru ? Le melon moral étant réservé à Pasteur, à Jeanne d'Arc, à saint Vincent de Paul ? Mais comment savoir à l'avance qui un melon va nourrir ? Il ne le dit à personne, et rien ne ressemble plus qu'un melon dévergondé à un melon plein de vertus chrétiennes. On voit par là qu'il est difficile en peinture de remplacer le talent par le vice ; surtout dans la représentation abstraite du hareng saur. Pourquoi, dès lors, vouloir tellement être immoral ? La morale n'a jamais vraiment gêné les peintres. Non plus d'ailleurs que les autres classes de la société. Alors ? Alors je m'y perds. Peut-être les peintres sont-ils las d'être jugés au nom de la morale ? Parce qu'ils trouvent la chose immorale ? Mais, s'ils sont contre la morale, pourquoi se plaignent-ils d'être jugés immoralement ? En agissant immoralement, on agit comme ils le désirent ! A moins que, semblables à tout le monde, ils n'admettent que pour eux le droit d'être immoraux ? C'est une position si banale, si courante, si universelle, qu'il est bien superflu de le crier sur les toits. Sauf si l'on a, évidemment, le besoin le plus grand et le plus naïf de déplacer le problème de la peinture. On change alors de champ de bataille. Battu d'avance à Sète, au moins craignant de l'être, on va se battre à Perpignan. Mais ce n'est jamais à Perpignan qu'on a gagné la bataille de Sète ».
***
Bon, d'accord, ce n'est pas ici le meilleur Vialatte, vous savez, le Vialatte jubilatoire dont la plume allègre, espiègle et guillerette avance « à sauts et à gambades ». Sans doute le souci de raisonner et d'argumenter alourdit le propos, qui frise l'argutie spécieuse. Je retiens quant à moi les trois premières lignes du paragraphe : " ... moins la peinture est prise au sérieux par le peintre, plus il se prend lui-même au sérieux. (...) Le peintre veut être un penseur". Et puis ceci : "... il est difficile en peinture de remplacer le talent par le vice".
Ce Vialatte-là est rejoint en 1977 par l'ami Reiser qui, dans Charlie Hebdo, après une visite à la Xème Biennale d'art contemporain de Paris, assaisonne son reportage de grands « N'IMPORTE QUOI » et parle de « L'ART RIGOLO », où l'artiste n'est plus sommé de maîtriser une technique, mais d' « AVOIR DES IDÉES ».
09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, L'ARCON, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, et c'est ainsi qu'allah est grand, chroniques de la montagne, art contemporain, arcon, bande dessinée, hergé, les aventures de tintin et milou, le crabe aux pinces d'or, jeff koons balloon dog, reiser, charlie hebdo
dimanche, 27 octobre 2019
POURQUOI "OMBRE CHINOISE " ?
« Cette chronique ne cesse de se préoccuper de l'homme, de le poursuivre, de le piéger, de le traquer à travers l'apparence, de chercher à tracer son portrait éternel. Tout au moins son ombre chinoise ».
ALEXANDRE VIALATTE
Portrait éternel de l'homme. Tout au moins son ombre chinoise.
J'ignore (je veux ignorer : ce serait si facile de savoir) pour quelle obscure ou claire raison on qualifie de "chinoise" toute ombre rétroéclairée formant une silhouette sur un écran translucide.
Je me fiche éperdument de la réponse. Parce que, bien souvent, l'image, bizarre et attirante, pose une énigme : qui me dira, nom de diable, ce que ça représente ? Il faudrait au moins, pour cela, être entré dans le domicile.
Par exemple, j'ai pris nombre de photos des vitrines (angle Mail / Chariot d'Or) dédiées à des ateliers d'aveugles : je n'ai jamais pu faire le lien entre l'aveugle annoncé et l'image collectée.
Il reste que l'ombre chinoise, construite dans les rez-de-chaussée par une source lumineuse située au fond de la pièce, vous pose (pas toujours) une devinette.
L'image ci-dessus m'en pose une, et pas la première : j'ai pris dans cette baie vitrée bien des photos énigmatiques, au gré des changements d'installations. Je suis en paix : j'ai renoncé à expliquer les ombres chinoises que je croise dans la rue.
Parce que le décor de la vie des gens en ombre chinoise, quel merveilleux détour narratif pour l'imagination !
09:00 Publié dans FAÇON DE REGARDER | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, ombre chinoise, alexandre vialatte, chroniques de la montagne
mercredi, 25 septembre 2019
LA MÉTHODE VIALATTE
J’avais osé intituler ici « la méthode Vialatte », au mois d’août 2012, un long, trop long délire (réparti sur cinq jours, s'il vous plaît), en digressant interminablement, en circumnaviguant pesamment, en un mot : en tournant longuement autour du pot, autant dire que j'étais tombé dedans pour ne plus en sortir. Inutile d’ajouter que la densité de matière solide à la sortie du tuyau tendait vers zéro : c’était du pipi de chat, du jus de chaussette, résumons-nous : c’était de la pisse d’âne.

Non, je ne dirai pas de qui est ce fragment de gravure sur bois.
J'espère avoir fait quelques progrès depuis ces temps cornus, spiraloïdes et macroglosses, quand, semblable à un œuf, une citrouille ou un fulgurant météore, ce blog roulait sur cette terre, où il faisait ce qu'il lui plaisait.
 Mais il se trouve que, au cours de mes révisions estivales des Chroniques de La Montagne, qui me ravissent dès que j’ouvre n’importe lequel des treize volumes Julliard, je suis tombé, à la page 155 de Et c’est ainsi qu’Allah est grand (Julliard, 1979), sur un article qui expose benoîtement la méthode que je cherchais méticuleusement naguère à obscurcir de la fumée cotonneuse d’un galimatias directement traduit du volapük. Et ce, alors même que je m'étais promis d'expliquer comment s'y prenait Alexandre Vialatte pour frapper l'attention et marquer la mémoire du lecteur de façon si particulière. Je m’empresse donc de laisser la parole à quelqu'un qui est, pour le coup, un auteur.
Mais il se trouve que, au cours de mes révisions estivales des Chroniques de La Montagne, qui me ravissent dès que j’ouvre n’importe lequel des treize volumes Julliard, je suis tombé, à la page 155 de Et c’est ainsi qu’Allah est grand (Julliard, 1979), sur un article qui expose benoîtement la méthode que je cherchais méticuleusement naguère à obscurcir de la fumée cotonneuse d’un galimatias directement traduit du volapük. Et ce, alors même que je m'étais promis d'expliquer comment s'y prenait Alexandre Vialatte pour frapper l'attention et marquer la mémoire du lecteur de façon si particulière. Je m’empresse donc de laisser la parole à quelqu'un qui est, pour le coup, un auteur.
« "J’ai oublié mon écureuil chez le brocanteur", dit le gros commissaire [désolé, monsieur Vialatte, Béru est avant tout inspecteur principal, excusez-moi de vous avoir interrompu] Bérurier dans un roman de San Antonio. Cette phrase, détachée de son contexte, prend des proportions étonnantes. Placée par l’isolement dans l’optique du fragment, de la maxime, du paradigme, du précepte, bref du proverbe intraduisible, elle s’enrichit de mystère et de folles résonances, comme ces statues qu’on sort du fond de la mer, plus belles d’avoir été tronquées. Elle a l’air de traduire on ne sait quelle situation ou quelle vérité générale, universellement applicable, elle prend l’importance d’un passe-partout. Elle peut même faire un détecteur de vérités.
Qui de nous, en effet, à bien regarder les choses, n’a "oublié son écureuil chez le brocanteur", sa dignité chez le marchand de vin, son parapluie dans le couloir du métro, son cœur à Heidelberg (c’est une chanson allemande), son chagrin dans le whisky ou son âme dans le ruisseau ? Cet "écureuil" est universel, on peut lui faire symboliser toute chose, il aura toujours son "brocanteur", qu’on peut remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. Cette méthode peut fournir un volume de proverbes, une sagesse, une philosophie et même plusieurs poèmes lyriques. On voit par là que tout est dans tout.
Et même réciproquement disait un philosophe. (Et il y aurait témérité à le contredire.) Il en résulte qu’on peut prendre la vérité, ou tout autre chose, par n’importe où, et tout suivra ; il n’y a qu’à tirer un peu sec, ou adroitement, sur le bout de la laine, tout l’écheveau, ou le nœud, y passera. (C’est ce que font les psychanalystes.) Si vous avez à parler d’un sujet, commencez donc par n’importe où. Voilà qui facilite les choses. Beaucoup de gens, qui sont pleins d’idées, ne savent jamais par où commencer. Commencez par n’importe quoi, le Soleil, la machine Singer, que sais-je, le président Fallières. Au besoin, vous pouvez même toujours vous servir du même commencement ; par exemple : "Le Soleil date de la plus haute antiquité." Si vous dites la même chose du président Fallières, ajoutez vite : "Il existait bien avant moi." Parti de prémisses si fermes et si catégoriques, pour arriver au sujet même (disons le tigre du Bengale, la femme fatale ou la pomme de Newton), vous serez obligé de l’extérieur à faire de tels rétablissements de l’esprit et de l’imagination que vous trouverez en route mille idées à la fois plaisantes et instructives qui ne vous seraient jamais venues sans cela. Je ne vends pas la recette, je la donne. Cette contrainte extérieure, qui est comme celle de la rime, vous aidera, loin de vous entraver. C’est la nécessité de la rime qui a fait naître les plus beaux vers. C’est l’élan que vous donne la barre fixe qui vous fera faire le saut du lion. Si le jarret la coince bien (il ne faut pas la lâcher ! du moins avant d’avoir la hauteur nécessaire). Cramponnez-vous bien aux prémisses, ne lâchez pas le président Fallières (ou le Soleil, ou la machine à coudre), avant de sentir que vous n’en avez plus besoin, visez bien le terrain d’arrivée (femme fatale ou pomme de Newton) et vous retomberez sur vos pieds après une courbe des plus belles, imposée de l’extérieur par les lois de la pesanteur.
Pour la conclusion, même principe : concluez sur n’importe quoi. Qui aura été fixé d’avance. Voyez les sermons du grand siècle. Ils finissaient toujours sur un Ave Maria, quel qu’en eût été le développement. C’était la "chute à l’Ave Maria" ; et on jugeait le prédicateur sur la souplesse de l’éloquence avec laquelle il amenait sa prière. Le naturel naît de la contrainte. Le naturel n’est pas naturel. C’est la grande leçon de La Fontaine. L’aisance s’ajoute. On n’arrache pas "naturellement" deux cents kilos sans faire une tête de crapaud qui fume ; c’est par l’artifice du travail qu’on parvient à le faire en souplesse. Le naturel est artificiel. »
L’article se poursuit, mais dérive quelque peu, sans doute pour se conformer au principe énoncé ci-dessus en l’illustrant. On a compris l’essentiel : n’importe quoi au début, n’importe quoi à la fin et, entre les deux, ce que vous voulez. Je soupçonne fort, d'ailleurs, Alexandre Vialatte d’avoir très souvent appliqué la méthode ainsi détaillée (« la recette ») dans la conduite de ses chroniques. Parent du Bolbina d’Henri Bosco, il y a du jongleur chez Alexandre Vialatte : il lance dans l’air une foule de boules, d'étoiles et de bulles de savon lumineuses qu'il est bien forcé de rattraper quand elles retombent, qu'il fait remonter d'une impulsion vers le ciel, et qui dessinent la spirale d'une galaxie dont il est le noyau invisible et le créateur habile (ça, c'est bien senti, non ?). On voit que ça mousse, on se demande comment ça se fait, mais il n’y a rien, et c’est magique. Ou plutôt, c'est de la prestidigitation.
"Rétablissements de l'esprit et de l'imagination" : en partant à l'aventure, en créant sous votre plume l'inconnu que vous redoutez et qui vous est nécessaire, vous créez objectivement une contrainte "extérieure" (sans doute inspirée de la règle d'un jeu surréaliste des origines ou des amusements oulipiens de Queneau et Le Lionnais) qui vous oblige à inventer le lien entre cet "alien" et le sujet que vous vous êtes proposé. C'est de l'ordre du geste, c'est de la gymnastique, voire de l'acrobatie (j'aime beaucoup les "deux cents kilos" qui annoncent la "tête de crapaud qui fume"). Disons-le : c'est du style !
Voilà ce que je dis, moi.
Note : l’intégrale des Chroniques de La Montagne (Robert Laffont, coll. Bouquins, an 2000) nous apprend que cet article est paru dans le journal auvergnat le 17 décembre 1967.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, éditions julliard, henri bosco bolbina, collection bouquins, la méthode vialatte, littérature française
mercredi, 25 mai 2016
LE MIRACLE VIALATTE
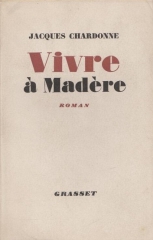 Chaque fois que je rouvre les Chroniques d'Alexandre Vialatte, il se passe le même phénomène qu'avec les Gaston Lagaffe : quelques pages suffisent pour retrouver le même sentiment délectable que la fois précédente. Ce n'est pas que je puisse comparer : Franquin et Vialatte ne jouent pas sur le même terrain. C'est juste qu'il faut que je parcoure dans les deux cas un peu de chemin pour toujours retrouver la même jubilation, celle que j'éprouve à me retrouver devant un paysage qui me va comme un gant.
Chaque fois que je rouvre les Chroniques d'Alexandre Vialatte, il se passe le même phénomène qu'avec les Gaston Lagaffe : quelques pages suffisent pour retrouver le même sentiment délectable que la fois précédente. Ce n'est pas que je puisse comparer : Franquin et Vialatte ne jouent pas sur le même terrain. C'est juste qu'il faut que je parcoure dans les deux cas un peu de chemin pour toujours retrouver la même jubilation, celle que j'éprouve à me retrouver devant un paysage qui me va comme un gant.
Je suis jaloux. Je n’écrirai jamais comme ça. En 1953, Jacques Chardonne publie Vivre à Madère. Alexandre Vialatte aime les livres de Chardonne depuis longtemps. Quand il rend compte de celui-ci, dans une de ses Chroniques de La Montagne, il se surpasse. J’ai déjà cité ce paragraphe en d’autres temps, ici même. Je viens de le relire. Je n’hésite pas : ce paragraphe a du génie. Il vient de commenter le livre de son ami, dont il dit : « Vivre à Madère m’a tout l’air d’être un chef d’œuvre, la fleur d’un goût, d’un style, d’une civilisation ».
Et puis vient le paragraphe miraculeux :
« Tout est dans le ton, dans le timbre, dans le style. C’est une immense leçon de style. Cherchez-l’y cependant, vous ne l’y trouverez pas. C’est un serviteur invisible. Il a dressé la table, allumé les lumières, disposé les fleurs dans les vases. Il est parti. Il ne vous a laissé que la fête, elle tient toute dans un éclairage. Le style doit être une fête donnée par un absent ».
Pas un milligramme de graisse. Allez-y, essayez d'écrire la dernière phrase ! Moi, elle me laisse sur le cul, tant elle découle, fluide, de ce qui la précède.
Si quelqu’un peut lire cela sans être frappé par la perfection de la chose, je le plains. Je ne veux pas ajouter d'inutiles superlatifs : la chose se suffit à elle-même. Cela s'appelle la littérature. Seul regret : dommage que l’édition « Bouquins » des Chroniques de La Montagne ne comporte pas le nom de Chardonne. Est-ce une coquille ? Est-ce un oubli de l’auteur ?
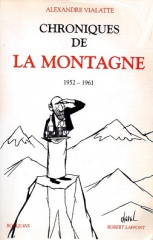
Je n’en sais rien. Oublions cela, et délectons-nous.
Voilà ce que je dis, moi.
La chronique en question est datée du 21 avril 1953. Son titre est « Requins et tables solunaires ». On la trouve à la page 47 et suivantes des Chroniques de La Montagne, Robert Laffont, collection "Bouquins", 2000.
lundi, 03 août 2015
UN ZESTE DE VIALATTE
 « Qui ne disparaît ? Nous vivons par hasard.
« Qui ne disparaît ? Nous vivons par hasard.
J’avais dix-huit-mois quand ma mère vit mes deux pieds qui dépassaient d’une lessiveuse. On connaît la bonté des mères. Elle les saisit immédiatement, me sortit de l’eau, me fit sécher au four et me replaça debout sur la route de la vie. C’est à cette circonstance fortuite que je dois de pouvoir signer mes différents travaux. Sans elle on eût été forcé de les donner sous un pseudonyme, ou de les publier comme posthumes, ou sous le manteau de l’anonymat. »
Alexandre Vialatte, « La clef des songes », La Montagne, 23 août 1970.
Dans Profitons de l’ornithorynque, Julliard, 1991.
Note : je cite le tout début de la chronique en question.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, france, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, profitons de l'ornithorynque, éditions julliard, humour
dimanche, 02 août 2015
UN ZESTE DE VIALATTE
 « Cette chronique traitant de nos provinces, je chanterai Chatel-Guyon, ses fastes, ses prestiges et ses grands écrivains. Chatel-Guyon fut le Mont-Oriol de Maupassant. Le docteur Baraduc le lança médicalement, des financiers financièrement ; et les banquiers firent de ce village d’Auvergne la "capitale de l’Intestin". On dit que ce fut dans des flots de vin et qu’ils signaient les contrats au champagne (littéralement : en y trempant leur plume) ! C’est trop beau pour qu’on n’y croie pas ! De thermales, les eaux devinrent thermalistiques ; le bain de pieds s’appela "pédiluve", l’entérite se rengorgea, l’amibiase créa un snobisme, le lavement devint si technique sous des masques si distingués que rien ne l’empêcha plus de guérir des altesses, des étoiles et des bachagas.
« Cette chronique traitant de nos provinces, je chanterai Chatel-Guyon, ses fastes, ses prestiges et ses grands écrivains. Chatel-Guyon fut le Mont-Oriol de Maupassant. Le docteur Baraduc le lança médicalement, des financiers financièrement ; et les banquiers firent de ce village d’Auvergne la "capitale de l’Intestin". On dit que ce fut dans des flots de vin et qu’ils signaient les contrats au champagne (littéralement : en y trempant leur plume) ! C’est trop beau pour qu’on n’y croie pas ! De thermales, les eaux devinrent thermalistiques ; le bain de pieds s’appela "pédiluve", l’entérite se rengorgea, l’amibiase créa un snobisme, le lavement devint si technique sous des masques si distingués que rien ne l’empêcha plus de guérir des altesses, des étoiles et des bachagas.
Le tambour de ville, pour suivre le progrès, dut se faire motoriser : il n’opère plus qu’à bicyclette, avec une caisse inamovible et des baguettes à manivelle. Sur bâti fixe. Il lit d’une main, tourne de l’autre, les deux baguettes jouent en même temps. C’est un vrai lapin mécanique. Et s’il voulait, il pédalerait par-dessus le marché ! Rien ne l’en empêche, tout l’y convie. En revanche, il y a perdu ses rra (le moelleux du grondement, le crescendo du tonnerre, le filé, le mourant du son, tout ce qui charmait si fort les oreilles délicates). Il ne donne plus que des fla. Le char du progrès avance sur le cadavre de l’art. »
Alexandre Vialatte, « La capitale de l’intestin », N.R.F., décembre 1951.
Dans Profitons de l’ornithorynque, textes choisis par Ferny Besson, préface de Claude Duneton.
Note : le mot "bachaga" existe. Il désigne, en arabe, un "haut dignitaire". Vialatte, ici, ne nous refait donc pas le coup de l' "uzvarèche".
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, profitons de l'ornithorynque, ferny besson, claude duneton, nrf
samedi, 01 août 2015
UN ZESTE DE VIALATTE
Il arrive à Alexandre Vialatte de se payer la tête des gens qui font profession de sérieux, ceux qui intellectualisent, ceux qui se paient de mots pour y faire entrer, croient-ils, la réalité ordinaire du monde, ceux qui n’abordent celle-ci que sassée à travers le filtre de concepts dûment érigés par leurs soins, en termes si possible abscons, abstrus, voire aporétiques. Aujourd’hui (La Montagne, 12 juin 1957), grâce au livre de Jean-François Revel (Pourquoi des philosophes ?), il passe les philosophes (et autres phraseurs, savantasses et abstracteurs de quinte essence) par sa moulinette à restituer le bon sens.
« "Pourquoi des philosophes ?", demande M. Revel. Pour fabriquer du poétique ! En transformant une chose commune en chose savante du seul fait qu’ils se penchent sur elle ; en élevant la platitude à la hauteur du scientifique par la vertu du charabia, ils la métamorphosent – c’est acte poétique – ils lui confèrent le charme de l’exotique, ils en font une chose inconnue qui fascine par la nouveauté. Ils ont mis au musée la mouche la plus banale, celle qui bourdonne dans le coin du placard de tout le monde autour d’un morceau de chèvreton ; et ensuite ils l’ont dessinée, placée dans des albums avec un numéro, et appelée en latin Musca domestica ; elle est si ressemblante, me dit Adrien Mitton, si scientifiquement ressemblante que le profane ne la reconnaît pas (celle qu’il connaît ne sait pas le latin). Mais c’est une affaire d’habitude. Au bout de peu de temps, constate-t-il, c’est la vraie mouche qui ne se ressemble pas ».
J’avoue que j’aurais aimé écrire « en élevant la platitude à la hauteur du scientifique par la vertu du charabia ». Je n’aurais pas pu : la place était prise.
Pas à dire : la racine de Vialatte s'enfonce avec élégance dans la terre paysanne du vieux temps. Qu'ils s'appellent Trissotin ou Diafoirus, les cuistres ne sont pas de sa tribu.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, jean françoi revel, pourquoi des philosophes, trissotin, diafoirus
vendredi, 31 juillet 2015
UN ZESTE DE VIALATTE
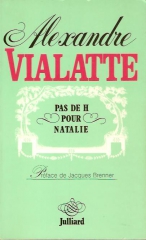 Même si ça peut sembler incongru, je comparerais volontiers chaque plongée dans les chroniques de maître Vialatte à celles que je fais régulièrement dans les albums de Gaston Lagaffe, la créature de maître Franquin : il suffit de quelques pages pour que le lecteur se mette à jubiler. Un ton et une tournure d’esprit absolument uniques, joints à la virtuosité du trait. Deux auteurs qui savent à merveille vous tenir en état de surprise permanente, à l'exact antipode de ce que Vialatte nomme quelque part (chronique "Des hauts et des bas" par Sempé) « le crime de l'uniformité ». Regardez par exemple ce paragraphe qui clôt diverses considérations, dont un éloge de Le Fond et la forme (tome II), de Jean Dutourd. On trouve ça dans Pas de h pour Natalie (Fayard, 1995).
Même si ça peut sembler incongru, je comparerais volontiers chaque plongée dans les chroniques de maître Vialatte à celles que je fais régulièrement dans les albums de Gaston Lagaffe, la créature de maître Franquin : il suffit de quelques pages pour que le lecteur se mette à jubiler. Un ton et une tournure d’esprit absolument uniques, joints à la virtuosité du trait. Deux auteurs qui savent à merveille vous tenir en état de surprise permanente, à l'exact antipode de ce que Vialatte nomme quelque part (chronique "Des hauts et des bas" par Sempé) « le crime de l'uniformité ». Regardez par exemple ce paragraphe qui clôt diverses considérations, dont un éloge de Le Fond et la forme (tome II), de Jean Dutourd. On trouve ça dans Pas de h pour Natalie (Fayard, 1995).
« Je ne saurais terminer sans des conseils utiles : faites ramoner dès maintenant vos cheminées et réclamez une fiche de contrôle ; soyez vertueux et sensible ; ouvrez toujours les boîtes d’asperges "par le fond" ; si votre chat n’aime pas le mou, donnez –lui du caviar ; ne mentez qu’avec précision ; si vous engraissez de la ceinture, renversez la tête en arrière, vous rétablirez l’équilibre. Relisez Le Fond et la forme, votre fond en aura plus de forme, votre forme en aura plus de fond. Ne battez pas votre femme avec une barre de fer ; vous seriez puni par les juges d’Angleterre, car c’est un geste de goujat ; usez plutôt d’une canne flexible et résistante, vous serez approuvé par la Bible et par les proverbes arabes.
Et c’est ainsi qu’Allah est grand. »
Alexandre Vialatte, La Montagne, 17 mai 1960.
On me dira ce qu’on voudra, ce genre d’allègre espièglerie ne peut se trouver que sous la plume d’un grand de la littérature.
Mais là je n’apprends rien à personne.
Voilà ce que je dis, moi.
 Note : quoi qu'on puisse en penser, Vialatte orthographie le prénom Natalie conformément à l'étymologie latine. On lit d'ailleurs dans l'irremplaçable Fleur des saints, cette bible écrite par Omer Englebert (Albin Michel), à la date du 27 juillet (où l'on fête toutes les Natalie) : « Ils furent décapités [en 852], écrit Euloge, dans l'ordre suivant : Félix, Georges, Liliose, Aurèle et Natalie (ou Noële) [sic] ». Eh oui, Noëlle et Nat(h)alie, c'est du pareil au même. C'est un des sujets de la dernière chronique du volume, "Chronique de l'h de Natalie". C'est sûr, Vialatte est du genre conservateur.
Note : quoi qu'on puisse en penser, Vialatte orthographie le prénom Natalie conformément à l'étymologie latine. On lit d'ailleurs dans l'irremplaçable Fleur des saints, cette bible écrite par Omer Englebert (Albin Michel), à la date du 27 juillet (où l'on fête toutes les Natalie) : « Ils furent décapités [en 852], écrit Euloge, dans l'ordre suivant : Félix, Georges, Liliose, Aurèle et Natalie (ou Noële) [sic] ». Eh oui, Noëlle et Nat(h)alie, c'est du pareil au même. C'est un des sujets de la dernière chronique du volume, "Chronique de l'h de Natalie". C'est sûr, Vialatte est du genre conservateur.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, pas de h pour natalie, chroniques de la montagne, ferny besson, jean dutourd, le fond et la forme, sempé, des hauts et des bas, franquin, gaston lagaffe, omer englebert, la fleur des saintséditions albin michel
jeudi, 30 juillet 2015
UN ZESTE DE VIALATTE
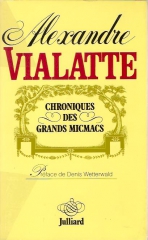 C’est l’été. Il est temps de rouvrir les Chroniques de Vialatte. Et pour commencer, Chroniques des grands micmacs, amoureusement choisies par Ferny Besson (Fayard, 1989, je suppose que Ferny, c'est plus glamour que la Fernande qu'a chantée Georges Brassens). Première leçon : l’art du paragraphe.
C’est l’été. Il est temps de rouvrir les Chroniques de Vialatte. Et pour commencer, Chroniques des grands micmacs, amoureusement choisies par Ferny Besson (Fayard, 1989, je suppose que Ferny, c'est plus glamour que la Fernande qu'a chantée Georges Brassens). Première leçon : l’art du paragraphe.
« Chronique des grands progrès et des mauvais conseils.
Quand le soleil, il n’y a pas si longtemps, se levait sur l’océan indien, il éclairait un petit bateau commandé par Henry de Monfreid, alors âgé de quelque quatre-vingts ans. Le petit mousse en avait soixante-dix. C’était un vieillard madécasse. Monfreid l’avait choisi lui-même. Ce septuagénaire maritime était sourd comme un pot. Il n’entendait pas le vent. C’était d’ailleurs sans importance. Il n’eût su dire, de toute façon, d’où il venait, ignorant toute géographie, toute marine et tout point cardinal. Il ne distinguait pas entre le nord et le sud. Peut-être savait-il faire la soupe. La tempête s’empara de tout ça, le lança à dix mètres de haut, le rattrapa au creux de la vague, le renvoya aux cieux, le battit, le pétrit, le roula, le massa, le secoua, le boxa, l’étira et le rasa. Sur quoi les ténèbres tombèrent. Au bout de huit jours, quand le soleil revint, le petit mousse n’avait rien entendu, et le bateau continuait sa course sur la vaste étendue des mers.»
Qu'est-ce que vous dites de ça ? Et pour lier avec l'idée qui va suivre, Vialatte soigne la transition :
«C’est ce qui prouve qu’il n’y a plus de vieillards. Les journaux confirment la chose. Le vieillard d’aujourd’hui ne connaît plus sa force. »
Alexandre Vialatte, La Montagne, 10 décembre 1967.
Plus loin, dans le même article, on trouve cette phrase magnifique, après l’évocation de Sabor V, un robot qui sait tout faire, y compris se gratter l’omoplate, boire et fumer : « Bref, s’il n’y avait pas l’homme, ce serait un grand progrès ». Tout est dit.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, chroniques des grands micmacs, ferny besson, éditions fayard, georges brassens, quand je pense à fernande
dimanche, 01 mars 2015
MORT DE LA MÉLODIE
2/3
Une exception notable : la chanson (à texte, chansonnette, variété, rengaine, pop, ce que vous voulez, mais obéissant à la loi « paroles-et-musique »). A cela une raison : il est impératif de plaire si l’on veut vendre, seule condition de survie. Or ce qui plaît, selon toute apparence, c'est précisément la mélodie. Vous me direz que ce qui plaît au grand nombre, c'est sûrement du bas de gamme. Indigne des esprits de qualité. C'est du vulgaire commerce, n'est-ce pas. La mélodie, c'est bon pour le peuple, n'est-ce pas.
Pour le reste, de la musique savante aux musiques « festives » (pour dance floors) ou « de banlieue » (rap, slam), question mélodie, c’est nada, nib de nib, peau de balle et balai de crin. Ou alors il faut 10 ans de Conservatoire pour être capable d’en reconnaître le souvenir qui traîne ici ou là, savamment dissimulé.
Finis, les airs capables de s’incruster dans la mémoire de ceux qui les entendent, heureux ensuite de les chanter sous la douche, au volant, en marchant dans la rue ou en s'efforçant de repérer les boîtes de sardines à l’ancienne « Connétable » sur les rayons du supermarché. Et je m’interroge : comment se fait-ce ? Que diable signifié-ce ? Est-ce être complètement momifié, carrément fossilisé ou culturellement moisi que de déplorer amèrement cette disparition de la mélodie ? Qui a kidnappé la mélodie ?
Même si la musique, depuis le début de l’histoire humaine, n’en a pas toujours comporté, ou de très rudimentaires, celle qui s’est déposée dans ma mémoire, celle qui me constitue et qui n’est pas pour rien dans la formation de mon esprit tel qu'il existe présentement, repose principalement sur la mélodie.
Et du vaste fatras mélodique qui encombre mon cerveau, ne cessent de surgir à l'improviste, par réminiscence ou association, les airs les plus divers, les plus imprévus, et ça va du grégorien à la dernière chanson à la mode entendue à la radio. Je n’en démords pas : c'en est au point qu'une musique sans mélodie me semble aujourd'hui, au minimum, une incongruité.
Dans sa chronique du 1er septembre 1964, dont je citais le début il y a peu (« Ça faisait longtemps »), Alexandre Vialatte écrit ceci au sujet des romans que son métier de critique l’amène à lire au fur et à mesure des parutions : « Ce qu’il y a de curieux, c’est que ces romans reflètent encore un univers civilisé à une époque où la planète n’obéit plus à aucune règle, où elle ne fait plus que céder partout à des pressions purement cosmiques, zoologiques, au séisme, au volcan, à la bestialité, et n’est plus gouvernée, sauf en de rares endroits, que par la famine et le massacre, le raz de marée, l’imposture, la haine, le racisme et l’anthropophagie, présentés sous des mots savants, comme des systèmes cohérents et logiques.
Jamais siècle ne fut livré à une plus noire barbarie ». Il constatait (il y a cinquante ans) l’effarant divorce que le 20ème siècle avait consommé entre le livre et le journal. Entre la littérature et les événements de la réalité. Entre l'art et la vie quotidienne.
J’ai l’air de sauter du coq à l’âne ? Peut-être. Mais voilà : je suis tenté de faire un parallèle entre cette barbarie dont se désole le grand écrivain, cet homme à la haute culture (s’il voyait où on en est aujourd’hui !) et le séisme qui a ébranlé l’Europe jusqu’à ses fondations culturelles et artistiques. La figure a à peu près disparu de la peinture. La règle métrique a disparu de la poésie. La mélodie a disparu de la musique. C’est particulièrement flagrant aujourd’hui, et dans toutes sortes de musiques.
Le 20ème siècle est un siècle de cataclysmes politiques, je n’insiste pas. Mais il a aussi connu des cataclysmes esthétiques. Je ne m'attarderai pas trop sur ce qui s’est passé dans la peinture et dans la poésie, pour voir ce qu'il en est dans la musique. Juste le temps d’observer que ce qui caractérise les changements, c’est selon moi, disons la mise à distance du destinataire. Il faut le reconnaître : depuis le début du siècle dernier, le destinataire des œuvres a disparu du paysage de leurs créateurs. Ceux-ci ont coupé les ponts avec les gens auxquels leur travail s'adresse.
Les peintres, les compositeurs et les poètes ont inversé la charge de l’effort, en empêchant les récepteurs d’accéder directement à leurs œuvres, d’adhérer spontanément à ce qu’ils voient, entendent, lisent. Les créateurs se sont enfermés dans des laboratoires. Moderne alchimiste, chacun d’eux a inventé sa recette pour fabriquer son or. A charge pour le public de comprendre au bout de quel circuit alambiqué tombaient les gouttes de l’alcool ainsi produit.
Cette mise à distance du spectateur, de l’auditeur, de l’amateur, consiste en un refus de la perception directe, de la sensation immédiate. Le message envoyé par l’artiste au destinataire est assez clair : « A toi de te mettre à ma portée ». Et tant pis pour celui qui ne « comprend » pas. Je trouve ahurissant le discours hautain et arrogant, suintant le mépris, de tous ceux qui, se piquant de modernité, regardent de très haut les commentaires laissés par des gens simples sur les pages du « livre d'or » de certaines expositions, du genre "mon chien" ou "un gamin de cinq ans en ferait autant". Aucune remise en question, chez ces artistes, mais une certitude : aux autres de gravir la pente qui mène à leur œuvre.
On pourrait aussi voir dans cette façon de faire un moyen pour les milieux de l’art de compenser l’énorme mouvement de démocratisation culturelle qui a traversé tout le siècle. De sélectionner sa propre élite. Un moyen de conserver la distinction entre l’élite des amateurs et le vulgum pecus des béotiens, ceux qui ne « comprennent » pas.
Avec la vague bien connue de snobisme de tous ceux qui font semblant d’être dans le coup. J’ignore si c’est toujours le cas, mais j’étais frappé par un fait, à l’époque où je fréquentais beaucoup les expositions d’avant-garde : les visiteurs qui n’étaient pas entièrement vêtus de noir faisaient figure d’exotiques. J’étais un exotique.
Et je me demande si ce mouvement de mise à distance des publics par rapport aux œuvres n’est pas conforme à ce qui se passe dans tous les domaines où se conditionne l’existence du plus grand nombre : d’un côté les masses manœuvrables, de l’autre les connaisseurs, les experts, les spécialistes. Vous comprenez, le monde est devenu tellement complexe, mon bon monsieur. Vous n’avez plus qu’à vous en remettre à ceux qui savent pour la gestion des choses qui vous concernent : vous n’avez plus de prise sur elles.
Artiste, homme politique, c’est devenu des circuits à part entière. Si vous n’avez pas le diplôme pour être admis dans le réseau, vous fermez votre gueule.
Je n’ai pas le diplôme, j’ouvre ma gueule : j’ai tout faux.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, rap, slam, conservatoire de musique, alexandre vialatte, chroniques de la montagne
mercredi, 18 février 2015
QU'EST-CE QU'UN AEGAGROPILE ?
Cette chronique ne parlera de rien. Parce que je n’ai pas le temps de penser. On ne pense pas sans avoir du temps. A moins d’avoir l’esprit très vif. Comme le rat, ou les chansonniers. Et aussi le cheval d’Elberfeld qui calculait les racines carrées. Le rat, lui, démonte les engrenages quad ils l’empêchent d’arriver jusqu’au lard. Il flaire les pièges. Il a des moustaches qui le renseignent, très sensibles de l’extrémité. Les chansonniers, eux, n’en ont pas : ils ont l’habitude, qui compense. Mais l’homme moyen ne pense pas très vite ; il n’a ni moustache ni réflexe, sa pensée a besoin du temps. Et aussi d’un certain obstacle autour duquel elle s’agglomère, qu’elle essaie de digérer ; qui l’arrête, la provoque. Elle se forme comme les « moutons » sous le lit de la grand-mère dans une maison bourgeoise : de brimborions agglutinés ; de poussières venues d’un peu partout, dans un endroit inaccessible ; de temps qui passe et de balai qui ne passe pas.
Comme les moutons et les aegagropiles (j’aime bien parler des aegagropiles ; ils font chercher dans le dictionnaire et il n’y a pas de plus grande volupté ; on y prend un plaisir extrême) ; les aegagropiles se forment dans l’intestin des animaux qui se lèchent les poils : le chat, la chèvre, le cheval. Ces poils se collent dans l’intestin autour de quelque calcul ou de quelque grain de sable. Ils finissent par former des boules. Des concrétions brillantes. Parfois énormes, et le cheval en crève. Le philosophe aussi ; plus lentement : à force de se lécher les poils il forme des pensées énormes ; il en meurt ; mais plus tard d’autres les utilisent, on les retrouve dans le commerce ; on en joue au billard ; ses disciples en font en matière synthétique ; en plastique jaune ou en papier mâché ; qui ont autant de succès que ceux du maître.
Alexandre Vialatte,
Chroniques de La Montagne,
19 octobre 1965.
Mon ami Gilles m’avait montré, dans le temps, un de ces objets : bizarre, doux au toucher, léger, velu et apparemment indestructible tant il était dur. Cela sortait de l’estomac d’un veau, vous savez, un de ces animaux élevés en batterie, qui s’ennuient tellement qu’ils lèchent le voisin de leur langue râpeuse. La boule en question (il n’avait pas prononcé le mot « aegagropile »), faite de poils, de matières diverses et de sécrétion, avait l’aspect d’un galet assez rond, brunâtre, un peu aplati, d’une dimension capable de remplir une large main.

Ça m’avait laissé pantois.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : le dictionnaire indique l'orthographe "égagropile".
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, aegagropile, alexandre vialatte, égagropile, chroniques de la montagne, humour
dimanche, 15 février 2015
ÇA FAISAIT LONGTEMPS
De l'art et de l'élégance avec lesquels Alexandre Vialatte fait exploser les niaiseries qui planent avec autorité dans l'air du temps.
***********************************
J’aimerais apporter en étrennes, à tous les lecteurs de La Montagne, de nouvelles preuves de l’existence de Dieu et de plusieurs appartements vacants. Quels sont, en effet, les premiers besoins de l’homme ? Dieu et un appartement libre. Et d’ailleurs on ne peut pas trouver d’appartement si Dieu ne s’en mêle pas plus ou moins. L’inconfort gagne tous les jours. Nous ne vivons plus à la belle époque où le progrès n’avait pas encore supprimé les agréments, les commodités et jusqu’aux conditions de la vie. L’air de nos rues tue le rat, affaiblit le basset, et asphyxierait le sergent de ville si on ne le juchait sur des tours de bois blanc. L’eau de nos rivières empoisonne le poisson et nos mers salissent le baigneur. Nos solitudes sont envahies.
Nos oreilles assourdies, notre pain trafiqué, nos cigarettes cancérigènes, notre corps comprimé par la foule, nos rues bouchées par les autos, nos autos arrêtées par les autres autos, et nous cherchons vainement un toit. Si nous voulons en trouver un, il faut que la Providence s’en mêle.
Aussi devons-nous remercier deux fois Minou Drouet qui nous apporte de nouvelles preuves de l’existence d’une divinité qui est si nécessaire par elle-même et pour trouver un appartement. Elle en a eu la révélation en regardant Greta Garbo sur son écran de télévision.
« S’il n’y avait pas d’autres preuves de l’existence de Dieu, a-t-elle noté dans son journal intime, Greta Garbo suffirait à la prouver. » Et, en effet, on est saisi d’admiration comme devant une chose impossible, devant ces yeux qui ont fait tourner tant de têtes, ces pieds qui ont fait tant de kilomètres, ces mains qui ont gagné tant de millions, ce pouce qui s’oppose aux autres doigts comme chez l’homme et les grands singes, à l’exclusion de toute autre espèce de vertébrés, de sorte qu’ils peuvent prendre des chèques, allumer des cigarettes blondes, mettre du sucre dans une tasse et faire tout comme une grande personne ; ces poumons qui entretiennent l’oxygénation du sang ; ce cœur qui fonctionne sans moteur à la façon d’une pompe aspirante et foulante ; cet estomac qui digère le caviar, la truffe, le whisky, les cocktails, et tous les aliments d’une façon générale, par inspiration naturelle, sans que personne lui ait jamais appris ; ces membres inférieurs qui permettent à l’ensemble de progresser à la surface du sol sans le secours d’aucune mécanique, grâce à un ensemble de muscle, de nerfs et d’articulations si adroitement agencés qu’on en est comme dans le ravissement ; et cet équilibre du corps qui assure aux grandes actrices, aux caissiers, aux comptables, et même à l’homme, pour dire les choses en gros, la possibilité de marcher verticalement qu’on demanderait à la carpe, au mille-pattes ou au grabataire. C’est ainsi que Greta Garbo prouva Dieu à Minou Drouet par les merveilles de sa nature.
On se demande ce qu’eût dit Minou si elle avait vu l’éléphant. Et le tatou. Et les tatusiens. Qui mangent sans dents ! Et la grande tatusie. Et le gypaète barbu. Et tous ces animaux que Dieu créa en cachette pour échapper aux réflexions des grandes personnes. L’écrevisse, le homard ; et le grand singe à fesses bleues qui traverse l’Afrique en large en se rattrapant par la queue à la cime des palétuviers ! Et l’Auvergnat ! qui est moins agile, mais plus têtu. Et la mercière de rues pluvieuses ! qui vit de la vente d’un lacet brun tous les dix ans. Et Fantômas ! … Tout est merveille de la nature. (…)
Alexandre Vialatte,
Chroniques de La Montagne,
15 janvier 1967.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, chroniques de la montagne, littérature, greta garbo, minou drouet, fantômas, humour, dieu
samedi, 14 février 2015
ÇA FAISAIT LONGTEMPS
Le temps qu’il fera cette semaine ne sera pas toujours celui qu’on attendrait. Meilleur qu’on ne pourrait le craindre, il sera souvent moins bon qu’on ne pourrait l’espérer. Le thermomètre descendra dans certaines sous-préfectures jusqu’à des chiffres qui flatteraient des villes beaucoup plus importantes, voire des capitales étrangères. Le savoir-vivre empêchera d’en tirer vanité. La calvitie étant envin vaincue, comme il appert de la lecture de la plupart des journaux du matin et du soit, les chauves auront gros intérêt à laisser repousser leurs cheveux pour éviter les sinusites ; ils s’attacheront à garder les pieds secs en utilisant des taxis, en mettant des snow-boots, ou même tout simplement, quand la distance n’est pas trop grande, en traversant la chaussée sur les mains.
Alexandre Vialatte,
Chroniques de La Montagne,
6 février 1962.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, humour
dimanche, 06 juillet 2014
VOUS REPRENDREZ DU VIALATTE ?
 Allez, encore un peu d’Alexandre Vialatte. Toujours tiré de Profitons de l’ornithorynque (Julliard, 1991). L’admirable très long paragraphe qui suit constitue la moitié (approximativement) de la chronique intitulée « Eva Peron » (La Montagne, 12 avril 1960), et recueillie par la grande amie de l’auteur, Ferny Besson.
Allez, encore un peu d’Alexandre Vialatte. Toujours tiré de Profitons de l’ornithorynque (Julliard, 1991). L’admirable très long paragraphe qui suit constitue la moitié (approximativement) de la chronique intitulée « Eva Peron » (La Montagne, 12 avril 1960), et recueillie par la grande amie de l’auteur, Ferny Besson.
Le ciel est gris, la conjoncture est molle, la civilisation s’affaisse comme un soufflé. Autrefois on vantait l’art d’un film, maintenant on vante son prix de revient ; autrefois on parlait du talent d’un poète, maintenant de la marque de son auto ; autrefois on habitait des maisons. C’étaient des endroits faits pour l’homme qui procuraient à chaque activité le paysage qui lui était naturel ; les oignons séchaient au grenier, le vin mûrissait à la cave, la mauvaise marche du perron cassait la jambe au visiteur insupportable, les rats avaient un champ raisonnable mais limité pour faire rouler les noix sur le plancher du grenier entre la malle en poil de chèvre et l’ombrelle de la bisaïeule ; le saucisson pendait à la solive,les enfants trouvaient aisément quelque niche naturelle pour jouer à Guignol ; on savait où mettre ses souliers, sa pipe, son grand-père, son vélo. Maintenant il n’y a plus de maisons, mais des taudis ou des chambres d’hôtel, et ce placard nu, cette tombe, ce désert de la soif, bref cette aventure saharienne qu’on a appelée H.L.M., où l’homme meurt de claustrophobie, par un record du paradoxe, au sein d’un vide illimité. J’ai vu un rat de quatre cent dix grammes y périr en une heure quatorze sur un sol en fibrociment. D’ennui. De dégoût. D’écœurement. De solitude métaphysique. Je l’ai vu maigrir progressivement, perdre ses joues, pencher la tête, fermer les yeux, raidir les pattes. Est-ce raisonnable ? On vous explique que ces surfaces arides sont très faciles à balayer ; plus fort : qu’il n’y a même pas à le faire ! Mais l’homme passe-t-il sa vie à ne pas balayer ? Victor Hugo écrivait-il ses Mémoires pour qu’ils soient faciles à épousseter ? Ou même ses Odes ?... C’est une logique qui dépasse mes moyens. Mais après tout … j’ai vu un homme vendre une règle à calcul en expliquant qu’elle était faite d’une matière imperméable ! J’ai même vu acheter cet engin par des mères de famille nombreuse qui ne descendaient jamais sous l’eau, même en scaphandre, et qui ne s’en serviraient jamais, même une fois revenues au soleil. Après quoi on peut tout admettre. Et cependant je persiste à penser qu’on achète des logements afin de les habiter et non de ne pas les balayer. Sinon on achèterait un trottoir en asphalte. Et d’ailleurs on se lasse vite de ne pas balayer. C’est un plaisir qu’on épuise en deux jours. L’homme, qui n’est pas plus bête qu’un autre (pas moins non plus) (mais enfin pas plus), s’aperçoit vite, au demeurant, qu’il y a bien plus à balayer sur une surface parfaitement lisse, où les rainures n’absorbent rien, que sur un plancher raviné par les ans. On ne devrait construire que du vieux. En prévoyant l’espace vital des choses qui réclament de la place, du temps, des soins et de la piété : le vin qui veut vieillir, le fromage qui veut vivre, et la grand-mère qui veut le manger. Les mettra-t-on au frigidaire ? à l’hôpital ? Quelle indécence ! Voilà pourtant où va la civilisation. Elle ne vit plus qu’en état de guerre. Dès qu’un homme d’Etat parle de paix, on sait que c’est pour lui faire la guerre. Il y a toujours quelque Corée, quelque Tibet ou quelque Irak [tiens, déjà en 1960] où on la garde à la glacière ; c’est la guerre froide ; ou alors sur le coin du fourneau ; c’est la guerre tiède ; on la retire à moitié, on la remet, on l’enlève, on la réchauffe un peu ; plus elle est vieille, meilleure elle est, comme le civet ; quand elle réduit, on lui ajoute un petit oignon, un verre de vin, un brin de laurier, un filet d’eau bouillante, et ça se remet à faire des bulles. Voilà pourtant la vie que nous menons. La civilisation est couverte de plaies. Qu’on entretient en les grattant ; comme l’eczéma.
Est-ce que c'est pas bien tapé, ça ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, france, littérature française, style, humour, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, journal la montagne, profitons de l'ornithorynque, ferny besson, éditions jullliard
samedi, 05 juillet 2014
L'ECLAT ET LA BLANCHEUR
La vie, naguère, était dictée par le décalogue, l’opinion des voisins, les snobismes locaux et les ouvrages de la baronne Staffe. Elle laissait assez de place à l’homme pour se livrer, par le moyen de quelque gymkhana exécuté entre ces tabous, à la vertu, au dévouement, à l’adultère mondain, au dressage des bassets, à l’assassinat des caissières, au trépas sur les champs de bataille, bref pour avoir une âme immortelle et en faire un usage grandiose et personnel. L’homme avait le droit d’être sublime ou sordide. Sa vie était un jeu dramatique et passionnant.
Adieu ces libertés et ces exaltations ! L’homme a perdu le loisir charmant de falsifier un testament, de lire Montaigne ou de tuer des petites filles. Il ne s’agit plus aujourd’hui que d’obtenir la blancheur Cerfeuil, de sourire Kibrille et de vivre Marie-Chose. On n’a plus le temps que d’être un client. Et d’obéir aux magazines. La conduite de l’homme est dictée par le réfrigérateur Machin, le bloc-évier, la poubelle à pédale. Il est vaincu par ses conquêtes. C’est le bagnard de l’appareil électroménager.
Son cerveau a été savamment remplacé par le prospectus publicitaire. Il pense Kimousse, Kiastik, Kipenspourvou. Sa vie se résume dans un bulletin de commandes. Elle a le style du jargon de prestige des périodiques et des marchands de « cités heureuses ». La femme n’a plus qu’à se laisser guider.
*****
 Je ne mets toujours pas les guillemets, qui s'imposent théoriquement. Ces lignes d'Alexandre Vialatte, parues dans La Montagne le 18 février 1968, sont toujours tirées de Profitons de l'ornithorynque (Julliard, 1991).
Je ne mets toujours pas les guillemets, qui s'imposent théoriquement. Ces lignes d'Alexandre Vialatte, parues dans La Montagne le 18 février 1968, sont toujours tirées de Profitons de l'ornithorynque (Julliard, 1991).
Eh oui, on n'a plus le temps que d'être un client.
Pour dire que Vialatte n'avait rien à apprendre de Guy Debord, des intellectuels en général et des situationnistes en particulier. Il n'avait rien à apprendre des révolutionnaires : il se contentait de regarder. Sans se raconter d'histoires. Et sans brandir l'étendard compliqué et systématique de la théorie. La « société du spectacle », Vialatte, il sait ce que c'est. Je respecte Guy Debord. J'admire Alexandre Vialatte. Au motif que, si Guy Debord a raison, c'est Alexandre Vialatte qui dit vrai. Même Günther Anders, qui ne dit pas autre chose, est plus compliqué.
intellectuels en général et des situationnistes en particulier. Il n'avait rien à apprendre des révolutionnaires : il se contentait de regarder. Sans se raconter d'histoires. Et sans brandir l'étendard compliqué et systématique de la théorie. La « société du spectacle », Vialatte, il sait ce que c'est. Je respecte Guy Debord. J'admire Alexandre Vialatte. Au motif que, si Guy Debord a raison, c'est Alexandre Vialatte qui dit vrai. Même Günther Anders, qui ne dit pas autre chose, est plus compliqué.
Cela fait une différence. Je veux dire entre celui qui se pose en penseur, contempteur et réformateur du monde, et celui qui se contente de vivre la vie qui lui a été donnée, qu'il essaie de comprendre, sans pour autant la disséquer, en se contentant de la vivre le plus plaisamment possible, et d'en exprimer dans un français impeccable la « substantificque mouelle » coulée de sa propre expérience. Sans s'en laisser conter par les baratineurs, bonimenteurs et autres camelots : humain, simplement humain.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, france, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, profitons de l'ornithorynque, guy debord, la société du spectacle
vendredi, 04 juillet 2014
LES FEMMES FRIGIDES
Celui [le mystère] des « femmes frigides » n’est pas moins ténébreux. Je n’ai jamais su exactement ce que c’était qu’une « femme frigide ». C’est un vocable énigmatique qui me fait à peu près le même effet que les mots « verdure » ou « arthritisme » lorsque j’avais quatre ou cinq ans. Les médecins savent ces choses savantes, les grandes personnes. De tout façon, la presse signale un « mystère de la femme frigide ». Et elle a bien raison ; car c’est un phénomène d’un caractère si saisonnier qu’on ne parvient pas à s’expliquer la chose ; c’est un mystère intermittent : tantôt il n’y a pas de femme frigide, et par conséquent pas de mystère, tantôt les journaux en sont pleins. Surtout quand ils manquent de Spoutniks ou de « conférence au sommet », ou quand Joanovici ne part pas pour la Suisse ; ce ne sont plus que photos de femmes frigides, graphiques, diagrammes, toutes les femmes sont frigides ; d’ailleurs, sur les photos, on ne s’en rendrait pas compte, elles n’ont pas l’air de délinquantes, elles ressemblent à toutes les autres, on dirait des femmes non frigides ; il paraît qu’elles le sont quand même ; c’est ce qui prouve bien qu’on est en plein mystère. Mais ce que je préfère ce sont les coupes de femmes frigides. Au trait blanc sur fond noir, avec des pointillés. C’est très intéressant ; ça fait très scientifique. On se sent en plein dans le vrai de la chose, la vraie médecine, la vraie physiologie. On se sent pénétré par la science ; malgré soi. On n’y comprend rien ; et puis on n’a pas le temps de tout lire ; et c’est affreusement ennuyeux (il ne faut pas lire), mais on voit les schémas. Et alors on sent qu’on apprend. Quoi ? On ne sait pas. Mais enfin on apprend. A l’état pur. Sans aucun objet. Comment dire ? C’est un état d’âme : l’état d’âme d’un homme qui s’instruit. On s’instruit jusqu’aux yeux. J’aime bien les femmes frigides.
*****
Ben voilà. Je sais, j’aurais dû mettre des guillemets et tout écrire en italiques. Ces considérations datent de 1958. On les trouve dans le numéro de mai de la NRF.
Les vrais amateurs ont reconnu depuis le début qu’elles ne peuvent avoir été signées que par Alexandre Vialatte. Cette chronique a été recueillie par Ferny Besson dans Profitons de l'ornithorynque, éditions Julliard, 1991. Qui me rendra Antiquité du grand chosier, que j'eus la faiblesse de lui prêter, sans doute un jour de beuverie excessive ?

******
Ainsi, on apprend le retour du petit fouteur de merde en chef monté sur talonnettes. Je ne veux plus écrire son nom ni publier l'effigie de sa trombine. Le chef de file de ceux qui veulent foutre par terre l'institution judiciaire quand celle-ci ne se prosterne pas devant eux : les gorets hurlent qu'on les égorge, avant d'avoir senti le fil de la lame. Le chef de file des malfrats qui ne conçoivent les institutions de la République qu'au service de leurs intérêts personnels. La politique réduite au coup de menton. La politique réduite à la promotion narcissique de quelque Nabot-Léon qui a le culot monstre de se prendre pour un homme d'Etat et qui, dans la foulée, accuse des magistrats de n'obéir qu'à des besoins de vindicte personnelle quand ils ont l'audace ahurissante de s'en prendre à son auguste personne. Faut-il que les Français soient nuls à chier pour avoir été neuf millions à gober avidement à la télé les rodomontades, les bravades et les mensonges de ce jean-foutre ! Qui aurait dit que la France s'apprêtait à retomber de Charybde (le mou du bulbe qui nous gouverne) en Scylla (l'agité du bocal, qui se rêve de nouveau en calife à la place du calife) ?
Que préférez-vous, du mou du bulbe ou de l'agité du bocal ?
Mais qui, maintenant, pour nous préserver du pire ? On va faire comme Diogène, une lanterne à la main en plein jour : « Je cherche un homme ».
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, femmes frigides, frigidité, nouvelle revue française, nrf, sexualité, nicolas sarkozy, politique, société, france, corruption
mercredi, 28 mai 2014
SAINT VIALATTE, PRIEZ POUR NOUS
Je reproduis ci-dessous un paragraphe d’une chronique d’Alexandre Vialatte que le journal La Montagne a publiée le 1er décembre 1964 : « Aussi le livre de Conchon a-t-il été mal accueilli par toute une partie de la critique. Parce qu’il appelle certaines choses par leur nom. C’est un crime qui ne se pardonne pas. Car, si nous en sommes là (avant d’être plus loin), c’est pour avoir accepté patiemment, et souvent avec enthousiasme, avec lâcheté ou avec perfidie, d’appeler les choses par le nom qu’elles n’ont pas, que dis-je, de leur donner le nom des choses contraires ». Ce grand monsieur avait sans doute lu 1984. Quelqu'un d'influent pourrait-il faire passer ce message à François Hollande, Nicolas Sarkozy et consort ?
L’article évoque le sujet du livre de Georges Conchon, qui a reçu le prix Goncourt en 1964, L’Etat sauvage. : « Des enfants de huit ans qui font boire de l’essence à de paisibles pharmaciens parce qu’ils sont blancs, et les ouvrent ensuite avec un couteau à conserves pour mettre le feu à l’intérieur. Des noirs découpés très lentement au moyen de tessons de bouteille par des congénères irrités qu’ils ne soient pas analphabètes ». Rien de nouveau, donc, sous le soleil des tropiques. Le Centrafrique, le Sud-Soudan, le Nigéria d'aujourd'hui valent bien le Katanga d'avant-hier.
Certains esprits irréfléchis aussi bien que légers classent Alexandre Vialatte parmi les humoristes.
Mais Alexandre Vialatte est beaucoup mieux que ça : il est aussi humoriste.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, georges conchon, l'état sauvage, prix goncourt, chroniques de la montagne, george orwell, 1984, humour, françois hollande, nicolas sarkozy, politique, société, france
vendredi, 18 janvier 2013
ODE AU GAFFOPHONE
Pensée du jour :

ASTANIHKYI, "COME SINGING", COMANCHE, PAR EDWARD S. CURTIS
(je salue le dernier Indien à apparaître dans cette série de photos)
« Le kangourou date de la plus haute antiquité. Scientifiquement, il se compose, comme l’Auvergnat, de la tête, du tronc et des membres ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé : nous avions laissé Gaston Lagaffe au moment où il vient d’inventer le bien nommé GAFFOPHONE.
 Cet extraordinaire instrument mérite qu’on lui consacre quelques instants. Pour le créer, FRANQUIN s’est inspiré d’une harpe africaine exposée en Belgique. Quant à l’entourage de Gaston, il peut s’attendre aux pires catastrophes, dès l’instant où passe, dans son esprit le démon qu’on appelle une IDÉE.
Cet extraordinaire instrument mérite qu’on lui consacre quelques instants. Pour le créer, FRANQUIN s’est inspiré d’une harpe africaine exposée en Belgique. Quant à l’entourage de Gaston, il peut s’attendre aux pires catastrophes, dès l’instant où passe, dans son esprit le démon qu’on appelle une IDÉE.

Le gaffophone sort en droite ligne de ce genre d’instant privilégié. En s’inspirant d’un instrument africain, qu’il a néanmoins « perfectionné » (« au secours », disent déjà les voisins), il arrive à créer, sans amplification électrique : « Une vibration du tonnerre avec une résonance maximum ». Autant dire qu’il n’y a pas besoin d’attendre le deuxième essai pour obtenir un coup de maître concluant, dépassant même les espérances. Disons que FRANQUIN a fait inventer par Gaston un « instrument de destruction massive ».
 Peut-être même a-t-il regretté qu'il n'existât pas dans la réalité, car Spirou lança, auprès de ses lecteurs, un concours de fabrication concrète d’instruments. Résultat : un Néerlandais envoya au journal, par le train, un engin de 125 kilos. Ce ne fut pas le seul. Pour dire son incroyable audience, mais aussi l’incroyable popularité acquise rapidement par le personnage tout à fait génial d’ANDRÉ FRANQUIN, à qui il arrive de faire du gaffophone une arme antimilitariste : il n’aime guère l’armée, semble-t-il.
Peut-être même a-t-il regretté qu'il n'existât pas dans la réalité, car Spirou lança, auprès de ses lecteurs, un concours de fabrication concrète d’instruments. Résultat : un Néerlandais envoya au journal, par le train, un engin de 125 kilos. Ce ne fut pas le seul. Pour dire son incroyable audience, mais aussi l’incroyable popularité acquise rapidement par le personnage tout à fait génial d’ANDRÉ FRANQUIN, à qui il arrive de faire du gaffophone une arme antimilitariste : il n’aime guère l’armée, semble-t-il.

Mais tout arrive, y compris l’inimaginable : le gaffophone peut rendre service. D’accord, c’est tout à fait involontaire de la part de Gaston, mais le résultat est là, rapide, soigné, gratuit : le client est ravi, et l’ouvrier récalcitrant n’y comprend rien. Gaston est passé pas loin.

MIEUX QUE LES ARTIFICIERS SUR LES GRANDES BARRES DE LA DUCHÈRE
La règle est tout de même, en général, le gros dégât, sinon ça ne vaudrait pas le coup. Qu’il sévisse au journal ou à la campagne, les effets sont garantis : si le son fait fuir les taupes chez le voisin, comme s’en réjouit le paysan, il ne limite pas ses effets aux taupes.

Il est évident que le personnel de bureau fait tout pour se débarrasser de l’instrument, mais rien à faire. Que Lebrac introduise des termites à l’intérieur, c’est tout l’immeuble qui menace de s’effondrer, bouffé par les bestioles qui n’ont pas voulu du bois musical.

L'EXPRESSIVITÉ DU TRAIT ABSOLUMENT VIRTUOSE DE FRANQUIN EST EVIDEMMENT UN DES FACTEURS ESSENTIELS DE L'EFFET PRODUIT
Que Fantasio fasse venir des déménageurs pour obliger Gaston à débarrasser l'immeuble Spirou, quitte à faire un cadeau au musée de l’homme, c’est d’abord susciter la curiosité amusée de ceux-ci, qui voudraient bien savoir ce que c’est, c’est ensuite faire prendre au camion de très gros risques, comme il aurait dû s’y attendre. Voici ce qui lui arrive, au camion.

Quand arrive la 600ème planche, je veux dire la 600ème gaffe, toute l’équipe décide de fêter la rondeur du nombre atteint. MAIS Gaston ne s’en offusque qu’un court instant. ET décide de participer à sa façon à la fête, et de lui donner un certain « retentissement ». Pour l’occasion, avec ses complices Bertrand et Jules-de-chez-Smith-en-face, il décide d’électrifier les instruments de leur orchestre. Gaston, qu’on se le dise, n’est jamais à court de ressources.

Je réserve pour la fin la planche 467, qui démontre, d’une certaine manière, le caractère intouchable du gaffophone, j’allais dire sa valeur SACRÉE. Et si Fantasio m’avait demandé mon avis, je lui aurais volontiers dit, comme EDITH PIAF disant à Manuel de ne pas y aller (N’y va pas, Manuel) : « N’y va pas, Fantasio ! ».

Et une fois la démonstration faite, j’aurais ajouté : « Je te l’avais bien dit, de pas y aller ! ».

ADMIREZ L'ART DU MONTAGE DES DIALOGUES.
L'ART DE L'ELLIPSE AUSSI.
Je compte ANDRÉ FRANQUIN parmi les bienfaiteurs de l’humanité, pour avoir inventé un personnage aussi inassimilable que celui qu’avait imaginé HERMAN MELVILLE en écrivant Bartleby (vous savez : « I would prefer not to »). Mais comme son versant ensoleillé, un versant éminemment jovial, positif et sociable. Exactement le contraire de ce personnage sombre, négatif et suicidaire.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, alexandre vialatte, littérature, chroniques de la montagne, humour, bande dessinée, andré franquin, gaston lagaffe, gaffophone, musique, fantaisie, antimilitariste, sacré, édith piaf, journal spirou, spirou et fantasio, herman melville, bartleby, i would prefer not to
lundi, 14 janvier 2013
ODE A GASTON
Pensée du jour :
« Nous n’avons plus le sens du pompeux. Sans quoi, comme je le faisais remarquer si justement dans ma dernière chronique, nous ferions de notre sous-préfet, tels les Mossi de la Haute-Volta, le héros d’un grand psychodrame destiné, tous les vendredis, à l’empêcher de partir pour la guerre, et qui se jouerait devant la sous-préfecture. Rien ne serait plus majestueux. Mais nous n’avons plus le sens de la cérémonie ».
ALEXANDRE VIALATTE
Un des plus beaux héros de bande dessinée qui furent un jour inventés est, à n’en pas douter, l’énorme, l’immense, le démesuré GASTON LAGAFFE. Un personnage créé par ANDRÉ FRANQUIN, qui, après une entrée quasi-clandestine, illumina progressivement la revue Spirou de son aura au rayonnement éblouissant, à partir du 28 février 1957.
Je ne vais pas refaire après tant d’autres l’éloge de Gaston Lagaffe. On ne peut plus dire du bien de Gaston Lagaffe. Je le dis clairement : il est désormais impossible d’ajouter quelque fétu que ce soit à la meule, que dis-je, à la montagne des hommages. Le fétu serait perdu comme l’aiguille dans la botte de foin.
Je ne viens pas au secours d’une ambulance. Je viens ici déposer mon gravier au pied du monument, comme j’ai vu les mots hâtifs tracés sur des bouts de papier lestés d’un petit caillou couronnant en majesté la belle tombe, toujours pieusement et nombreusement visitée, du poète espagnol ANTONIO MACHADO à Collioure.
Gaston, on me dira ce qu’on voudra, au bout de trois planches, il me dilate déjà les viscères, au bout de cinq (j’aime les nombres impairs), je suis plié en deux (zut, c'est un nombre pair). Au bout de sept, je n’en peux plus, je demande grâce. La première vertu zygomatique de Gaston est dans l'ingéniosité qu'il met en oeuvre pour aboutir à la SIESTE. La deuxième vertu de Gaston est dans la GAFFE, bien évidemment. La troisième vertu de Gaston est l’INVENTION, si possible improbable. Les vertus 2 et 3 découlent souvent l’une de l’autre.
Qu’on se le dise : le rêve de tout homme honnête avec lui-même est dans l’inaction consécutive à la décision de faire une bonne sieste. La sieste, en plus d'être une soustraction aux activités du monde, est un désordre. Gaston y est comme un poisson dans l’eau.
Et comme un grain de sable dans la machine productive, qu’il fasse un reportage au zoo ou qu’il fasse rissoler on ne sait pas bien quoi (peut-être des sardines à la confiture de fraise) au fond d’une caverne creusée au cœur des archives de Spirou, en compagnie de son transistor, de son chat et de sa mouette rieuse, dans l’harmonie parfaitement régressive d’un ventre maternel d’un nouveau genre.
Le grain de sable agit en général seul, car c’est son seul esprit qui prend l’initiative des catastrophes, mais FRANQUIN ne rechigne pas à l’assortir de divers complices. Je viens d’en citer deux, mais il y a aussi Jules-de-chez-Smith-en-face et Bertrand qui viennent prêter leur savoir-faire en la matière. A eux cinq, ils représentent à peu près la puissance de feu du porte-avions Enterprise, fleuron de l’US Navy.
Autour de notre grain de sable explosif, une pléiade de personnages dansent une sarabande endiablée. D’abord ceux qui se définissent comme « hors-Spirou », au premier rang desquels l’agent Longtarin (sujet principal : une voiture improbable, jaune et noire) et M. de Mesmaeker (sujet principal : des « contrats » qui resteront à jamais jamais signés). Les avanies que leur fait subir Gaston (jamais dans une mauvaise intention, notez-le) ne se comptent plus.
Plus en retrait, les talents de Gaston s’exercent aux dépens de l’armée, dont les scrogneugneus sont toujours présentés de façon à ce que les dégâts qu'il leur occasionne apparaissent comme une manifestation de la justice immanente. Mais on voit aussi son ingéniosité à l’œuvre quand il va à la campagne ou à la plage (pauvres lapins, quand même !).
Quant à l’équipe de Spirou, qui constitue le centre des principales victimes des bonnes intentions de Gaston, on s’intéressera en priorité à Fantasio, Prunelle, Lebrac, Bertje, Monsieur Boulier, quelques autres, plus intermittents (la femme de ménage aux prises avec la mallette antivol imaginée par notre héros). Je situe à part Moiselle Jeanne, qui en pince méchamment pour notre anarchiste à tout faire. Le champ d’épandage des gaffes semble, sous le crayon d’ANDRÉ FRANQUIN, extensible à l’infini.
L’invention, chez Gaston Lagaffe, est permanente, tous azimuts et portée à incandescence. Au premier plan de la photo des créations catastrophiques de notre garçon de bureau préféré, j’ai tendance à placer un instrument de musique, encore qu’on ne sache pas très bien, au sujet de ce qui sort du dit instrument, s’il s’agit de musique ou d’un tremblement de terre. Les amateurs ont déjà reconnu le GAFFOPHONE.
Un instrument naturel qui fait des dégâts démesurés par rapport à ses capacités physiques. Gaston a inventé le seul instrument exponentiel au monde. Mais le personnage lui-même est exponentiel. Il s'appelle GASTON LAGAFFE.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, edward s. curtis, indiens d'amérique du nord, amérindiens, apsaroke, alexandre vialatte, littérature, chroniques de la montagne, humour, bande dessinée, andré franquin, gaston lagaffe, journal spirou, l'art de la sieste, gaffeur, antonio machado, poète, poésie, collioure
dimanche, 18 novembre 2012
BD ET LIBERTE D'EXPRESSION
Pensée du jour :

"SILHOUETTE" N°36
« L'oiseau a quelque chose d'étrange. Il fait des choses extraordinaires : l'urubu nettoie les poubelles, l'agami surveille les poulets,le gypaète est barbu, l'albatros pond des oeufs dont le petit bout est aussi gros que l'autre (et l'autre aussi petit que le premier), la huppe pupule, le milan huite et le rhinocéros barète (encore n'est-ce pas un véritable oiseau) ».
ALEXANDRE VIALATTE
Quand la BD devint « pour adultes » et mensuelle, j’ai encore suivi le mouvement. Ce furent Charlie (mensuel), Métal hurlant, Circus, A suivre, Pilote (mensuel), Fluide glacial (qui paraît toujours, mais bon, je me suis fatigué).  Et tout ça depuis le n° 1 jusqu’au dernier (enfin, pas toujours). Ça me fait encore des piles presque jusqu’au plafond, rien qu’avec ce que j’ai gardé, pour vous dire. Il va de soi que j’ai suivi Hara Kiri hebdo jusqu’à l'ultra-célèbre et immortel « Bal tragique à Colombey : 1 mort » (16 novembre 1970), et Charlie hebdo qui lui a immédiatement emboîté le pas, après l'interdiction pour crime de lèse-DE GAULLE.
Et tout ça depuis le n° 1 jusqu’au dernier (enfin, pas toujours). Ça me fait encore des piles presque jusqu’au plafond, rien qu’avec ce que j’ai gardé, pour vous dire. Il va de soi que j’ai suivi Hara Kiri hebdo jusqu’à l'ultra-célèbre et immortel « Bal tragique à Colombey : 1 mort » (16 novembre 1970), et Charlie hebdo qui lui a immédiatement emboîté le pas, après l'interdiction pour crime de lèse-DE GAULLE.
Je garde une tendresse pour des revues plus éphémères de cette époque, parce qu’elles faisaient souffler un vent de liberté devenu totalement inimaginable aujourd’hui. Personne, à part le ministre de l’Intérieur, n’aurait alors eu l’idée de faire à sa place la police des moeurs ou la police de la pensée : aujourd’hui, les flics de toute obédience (sous couvert d’ "associations" religieuses, sexuelles, raciales…) font régner leur intolérance. Attention, c’est parti pour une petite parenthèse !
Dans les médias (je veux dire tout ce qui est de l’imprimé, du son ou de l’image fixe ou animée), c’est le CURÉ qui a pris le pouvoir et revêtu l’uniforme du FLIC augmenté du Père Fouettard : le CURÉ RELIGIEUX (TOUS les prêtres, imams, rabbins), le CURÉ RACIAL (TOUTES les associations antiracistes), le CURÉ SEXUEL (TOUS les hétérophobes dénonciateurs de « phobies » qu’ils fabriquent pour les besoins de leur « cause », je ne vois pas pourquoi je n’en inventerais pas à mon tour). Quel nouveau PHILIPPE MURAY inventera un anticléricalisme à la hauteur de cette agression de tous les azimuts et de tous les instants ?
Ce n’est plus « Big Brother is watching you » (1984), c’est l’œil omniprésent du « curé punisseur » qui, telle une caméra de surveillance universelle, vous guette à tous les coins de rue pour vous envoyer en correctionnelle si vous avez la mauvaise idée de lever le doigt pour dire ce qui vous semble être de bon sens, par exemple au sujet du mariage et de l’adoption homosexuels.

LA PROPAGANDE DES ANTI-LIBERTÉ A LE VENT EN POUPE :
J'APPELLE ÇA CRIMINALISER LA VIE SOCIALE
(Le Monde, dimanche 18 - lundi 19 novembre 2012)
Une intolérance qui se couvre du manteau de la « tolérance » et du « respect » (GEORGE ORWELL appelait ça la novlangue : « L’esclavage, c’est la liberté »), pourvu qu’ils en soient les seuls bénéficiaires. Une intolérance qui se couvre par ailleurs (mais ça va avec) de l'indispensable tunique de la VICTIME. Et le crime qui crée la victime, aujourd’hui, s’apparente presque toujours à la « discrimination », et concerne le plus souvent les gens à couleur de peau exogène, ou à sexualité marginale, ou encore à religion importée. La race, le sexe, la bondieuserie. Le tiercé gagnant.

COMMENT CROYEZ-VOUS QUE LES "ASSOCIATIONS" (LGBT OU RELIGIEUSES)ACCUEILLERAIENT CETTE COUVERTURE AUJOURD'HUI ?
(décembre 1977)
Je vais te dire : fais un beau mélange de tout ça, et tu as le magnifique couvercle d’un magnifique ORDRE MORAL qui s’abat sur toi pour te cuire à l’étouffée. Même Charlie-Hebdo (attention, celui ressuscité par PHILIPPE VAL en 1992, qui n’a pas grand-chose à voir avec le premier, né en 1970), fait un pet de travers tous les 36 du mois par peur des bombes et des procès, et quand il le fait, la merde n’est jamais bien loin, prête à exploser. C'est bien le signe que des forces de l'ordre (racial, sexuel, religieux) convergent et se coalisent contre l'expression libre, non ? De quel côté est-elle, l'intolérance ?
Ce « meilleur des mondes », PHILIPPE MURAY l’appelait l’ « envie de pénal ». Moi qui n’ai pas la classe du grand PHILIPPE MURAY, je me contente de l’appeler « curé punisseur ». C’est le même uniforme gris. Mais même les nobles imprécations de PHILIPPE MURAY n’ont pas suffi à empêcher le flot malodorant des hordes de gendarmes « antiracistes », « antisexistes », « antihomophobiques », « anti-islamophobiques » de tout submerger.

UNE REVUE PUBLIEE PAR DES FEMMES FEMINISTES (septembre 1978, dessin LIZ BIJL)
COMBIEN DE BOUCLIERS LEVÉS ET DE PROCES, SI C'ETAIT AUJOURDHUI ????
Je reviens à mes revues de BD plus éphémères. Pour dire ce qu'était la liberté d'expression à l'époque, je montre quelques couvertures. Parmi les comètes, je citerai Ah ! Nana ! : 9 numéros, avec la géniale NICOLE CLAVELOUX (ah ! son extraordinaire Alice au pays des merveilles) et l’austère CHANTAL MONTELLIER, un féminisme pas encore coincé dans un intégrisme « genriste » à la JUDITH BUTLER. Je citerai Surprise (5 numéros), publié par le dessinateur actuel de Libé, WILLEM, avec une curieuse BD, Ici, on ne nous voit pas.

Je citerai Mormoil, avec la couverture magnifique du n°3 et sa superbe BRIGITTE BARDOT en prototype, archétype et modèle de l’idiote, croquée par MORCHOISNE, en train de dire : « Mords-moi le quoi ? ». Je citerai Tousse-Bourin, qui a révélé CABANES, Le Canard sauvage, avec DESCLOZEAUX, qui loue aujourd’hui ses services aux chroniques gastronomiques du Monde.

VOUS AVEZ NOTÉ : HONORABLE REVUE DE BANDES DESSINEES EXOTIQUES
Je citerai Piranha, Le Cri qui tue, la revue d’ATOSS TAKEMOTO, qui me permet d’affirmer que j’ai été parmi les premiers lecteurs de mangas publiés en France, longtemps avant que ça s’appelle « manga ». Je citerai enfin Virus, et une pléiade d’autres (Carton, Microbe, Aïe, Le Crobard, on n’en finirait pas, et je ne parle que de ce que j’ai connu), encore plus éphémères.
Ce n’était pas le « bon temps », c’est sûr, et je n’ai pas de nostalgie. J’observe juste une drôle d’inversion des rôles entre le politique et le sociétal : ce qui était politique était tabou aux yeux du pouvoir et toute incartade réprimée, alors que ce qu’on n’appelait pas encore le « sociétal » (autrement dit « les mœurs ») était laissé totalement libre (enfin, quand je dis "totalement", il s'en faut de beaucoup ...).
Aujourd’hui, c’est l’inverse : des hommes politiques et de l’ordre social, vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez, et même n’importe quoi, ça fait comme la pluie sur les plumes du canard (il n’y a plus de politique, il n’y a plus que de la « com », et les « susceptibilités » se sont muées en édredons et matelas pour abriter l'amour-propre devenu invulnérable, parce qu'inexistant, pour cause d'absence radicale de convictions).
Au sujet du « sociétal » (qu’on a cessé d’appeler les « mœurs »), en revanche, l’armée des CURÉS PUNISSEURS (religieux et sexuels et raciaux) se charge de vous fermer la gueule (regardez : même Libé se fait attaquer pour son titre sur BERNARD ARNAULT : « Casse-toi, riche con ! ». Pour une fois qu'ils étaient drôles !).
Moi, j'admire le peuple norvégien pour son attitude exemplaire après les atroces meurtres d'ANDERS BERING BREIVIK, et je vomis les loups qui ont déchiré en effigie RICHARD MILLET après la parution de son brûlot - ANNIE ERNAUX, JEAN-MARIE-GUSTAVE LE CLEZIO et TAHAR BEN JELLOUN venant tout à fait en tête -, ils méritent de retourner se réduire en la bouillie moralisatrice et policière d'où ils n'auraient jamais dû sortir pour empuantir l'air des hommes libres !!!
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : photographie, alexandre vialatte, chroniques de la montagne, littérature, bande dessinée, hara kiri, hara kiri hebdo, charlie hebdo, métal hurlant, circus, à suivre, pilote mensuel, fluide glacial, bal tragique à colombey, de gaulle, humour, ordre moral, propagande, philippe muray, anticléricalisme, religion, intolérance, racisme, homophobie, sexisme, phobie, 1984, novlangue, george orwell, liberté d'expression, inceste, bd, ah nana, nicole claveloux, chantal montellier, brigitte bardot, mormoil, morchoisne, cabanes, desclozeaux, bernard arnault, libération, anders breivik, richard millet, annie ernaux, le clézio, féminisme, homosexualité, philippe val


