vendredi, 02 février 2018
LE DÉBAT FAIT RAGE
La France (non : la ville de Paris) doit-elle accepter que le "Bouquet of tulipes", cadeau fait par l'artiste Jeff Koons en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 (?), soit installé entre le Musée d'Art Moderne et le Palais de Tokyo ?
LE DÉBAT FAIT RAGE;
Faut-il rééditer Mein Kampf, d'Adolf Hitler ?
LE DÉBAT FAIT RAGE.
Faut-il autoriser ou non la "gestation pour autrui" pour les couples de lesbiennes ?
LE DEBAT FAIT RAGE.
Les hommes ont-ils le droit d'importuner les femmes dont ils apprécient la physionomie, l'allure, l'apparence ou la plastique ?
LE DÉBAT FAIT RAGE.
L'éditeur français qui possède le plus beau catalogue de littérature du vingtième siècle a-t-il le droit de rééditer Bagatelles pour un massacre, le gros pamphlet antisémite de Louis-Ferdinand Céline ?
LE DÉBAT FAIT RAGE.
Est-il légitime que l'on fasse figurer, dans le livre 2018 des commémorations nationales, les noms de Charles Maurras, antisémite notoire, et de Jacques Chardonne, collaborationniste notoire (ajoutons le Simon de Montfort de la croisade contre les Albigeois, 1208-1229) ?
LE DÉBAT FAIT RAGE.
Cette liste n'est pas limitative.
******************
D'une manière générale, les débats font rage en France.
Je propose, comme réponse à la question « Qu'est-ce que l'identité de la France ? »,
le hashtag
« #balancetondébatfaitrage ».
Cela donnera aux bouches des exaltés de tout bord une raison renforcée de lancer des flammes. Cela donnera à toutes sortes de phraseurs (espèce animale déjà surabondante et encore en voie de prolifération : le phraseur, espèce envahissante, invasive et irrespirable) – intellectuels venus de l'université et faisant autorité, ou militants moralisateurs d'associations menant tous les combats des "justes causes" – encore plus d'occasions et de raisons de graver dans le château de sable du bronze de la presse quotidienne, les grandes formules définitives de leurs convictions ardentes.
******************
Un point commun unit tous ces "débatfaitrage" : lecteur perspicace, sauras-tu le retrouver dans le tableau ?
16:06 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeff koons, bouquet de tulipes, art contemporain, mein kampf, adolf hitler, gpa, location d'utérus, gestation pour autrui, lesbiennes, lgbt, droit d'importuner, balance ton porc, harcèlement sexuel, catherine deneuve, gallimard, louis-ferdinand céline, bagatelles pour un massacre, charles maurras, jacques chardonne, simon de montfort, croisade des albigeois, commémorations nationales, identité française, le débat fait rage, antisémitisme, palais de tokyo koons
mercredi, 25 mai 2016
LE MIRACLE VIALATTE
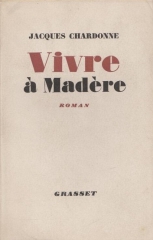 Chaque fois que je rouvre les Chroniques d'Alexandre Vialatte, il se passe le même phénomène qu'avec les Gaston Lagaffe : quelques pages suffisent pour retrouver le même sentiment délectable que la fois précédente. Ce n'est pas que je puisse comparer : Franquin et Vialatte ne jouent pas sur le même terrain. C'est juste qu'il faut que je parcoure dans les deux cas un peu de chemin pour toujours retrouver la même jubilation, celle que j'éprouve à me retrouver devant un paysage qui me va comme un gant.
Chaque fois que je rouvre les Chroniques d'Alexandre Vialatte, il se passe le même phénomène qu'avec les Gaston Lagaffe : quelques pages suffisent pour retrouver le même sentiment délectable que la fois précédente. Ce n'est pas que je puisse comparer : Franquin et Vialatte ne jouent pas sur le même terrain. C'est juste qu'il faut que je parcoure dans les deux cas un peu de chemin pour toujours retrouver la même jubilation, celle que j'éprouve à me retrouver devant un paysage qui me va comme un gant.
Je suis jaloux. Je n’écrirai jamais comme ça. En 1953, Jacques Chardonne publie Vivre à Madère. Alexandre Vialatte aime les livres de Chardonne depuis longtemps. Quand il rend compte de celui-ci, dans une de ses Chroniques de La Montagne, il se surpasse. J’ai déjà cité ce paragraphe en d’autres temps, ici même. Je viens de le relire. Je n’hésite pas : ce paragraphe a du génie. Il vient de commenter le livre de son ami, dont il dit : « Vivre à Madère m’a tout l’air d’être un chef d’œuvre, la fleur d’un goût, d’un style, d’une civilisation ».
Et puis vient le paragraphe miraculeux :
« Tout est dans le ton, dans le timbre, dans le style. C’est une immense leçon de style. Cherchez-l’y cependant, vous ne l’y trouverez pas. C’est un serviteur invisible. Il a dressé la table, allumé les lumières, disposé les fleurs dans les vases. Il est parti. Il ne vous a laissé que la fête, elle tient toute dans un éclairage. Le style doit être une fête donnée par un absent ».
Pas un milligramme de graisse. Allez-y, essayez d'écrire la dernière phrase ! Moi, elle me laisse sur le cul, tant elle découle, fluide, de ce qui la précède.
Si quelqu’un peut lire cela sans être frappé par la perfection de la chose, je le plains. Je ne veux pas ajouter d'inutiles superlatifs : la chose se suffit à elle-même. Cela s'appelle la littérature. Seul regret : dommage que l’édition « Bouquins » des Chroniques de La Montagne ne comporte pas le nom de Chardonne. Est-ce une coquille ? Est-ce un oubli de l’auteur ?
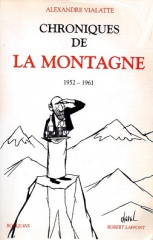
Je n’en sais rien. Oublions cela, et délectons-nous.
Voilà ce que je dis, moi.
La chronique en question est datée du 21 avril 1953. Son titre est « Requins et tables solunaires ». On la trouve à la page 47 et suivantes des Chroniques de La Montagne, Robert Laffont, collection "Bouquins", 2000.
dimanche, 26 août 2012
LA METHODE VIALATTE 5/5
Pensée du jour : « Il y a un style de l'almanach Vermot. Et sans doute, ça ressemble à la nouille ; mais en plus fort ; ça la transcende ; ça la défie ; ce n'est même plus la nouille sans sel, c'est réellement la nouille sans nouille au beurre sans beurre. Du vide de nouille dans l'absence de beurre. Bref, c'est du trou de macaroni. Essayez de parler de Landru sans dire qu'il a brûlé ses femmes, ou de Ruskin sans un mot de la religion du beau ! Ils y arrivent ! Et ils s'y ébrouent. Ils donnent le rien de toutes choses dans le détail. C'est peu de dire qu'ils le donnent, ils le modulent, ils le festonnent, ils l'ouvragent. C'est étonnant. Le lecteur bien doué arrive ainsi à ne rien savoir d'à peu près tout avec des précisions affreuses ».
Alexandre Vialatte
Résumé : Alexandre Vialatte porte sur le monde et sur l’époque un regard désolé, avec un sourire fraternel et amusé qui en corrige le fatalisme d’un semblant de tendresse. Pour écrire, conseille-t-il, « commencez par n’importe quoi » et « concluez sur n’importe quoi ».
Si je voulais faire le savant (je m'en garderai bien), je dirais que Vialatte est un écrivain du paradigmatique. Or, il faut le savoir, le paradigmatique est l’ennemi juré du syntagmatique. Je traduis : le détail plutôt que le global. Je l'ai dit il y a peu. Au paradigme l'unité de base. Au syntagme la vue d'ensemble, la phrase.
Pour faire simple, Vialatte, c'est la préférence donnée au substituable sur l'enchaînable. A la liberté improvisée de la trouvaille sur la discipline rectiligne de la logique rationnelle. Axe vertical contre axe horizontal. Bref, le mot et ses semblables, plutôt que la phrase et sa logique. La perception par les sens plutôt que les généralités abstraites. Ce qui ne l'empêche pas de garder l'uniforme de la syntaxe dans un état impeccable, et de prendre plaisir à tourner des phrases compliquées. Ne serait-ce que pour embêter les gens.
Je préfère moi aussi le paradigme du livreur de lait, avec ses bidons accrochés à son vélo (on a peine à imaginer, mais je jure que c'est vrai, parce que je l'ai vu, c'était la laiterie de la rue du Garet), aux syntagmes de la Critique de la raison pure. L'image plutôt que le concept. Le particulier plutôt que le général. Pourquoi ? C’est très simple : l’humain est l’hôte naturel du particulier. Et la victime du général. L'ami précis du spécifique et la cible globale du générique.
C'est exactement pour cette raison que la 'pataphysique, science du particulier qui se propose de mettre au jour les lois qui gouvernent les exceptions (essayez d'imaginer), est une véritable urgence humaine, et que Vialatte fut un lecteur attentif d'Alfred Jarry qui, à travers Ubu et Faustroll, en fut l'inventeur.
L’individu plutôt que la statistique. Dès que se pointe le général (mettons le sociologue), l’humain disparaît, réduit à sa quantité. A son nombre. Plus précisément : l'unique est éliminé. L'individu écrasé. Voyez la catastrophe des sondages. Les mensondages, qui me découpent en morceaux (avec des décimales) pour me faire dire leur vérité : 37,8 % (ou 17,2 %) de moi-même sont d'accord (ou pas d'accord).
Où voulez-vous que je les trouve, mes 37,8 % (ou 17,2 %) ? Dans le bras ? Dans la fesse ? Non, ce n'est pas possible. C'est comme la natalité en France : 2,1 enfant par femme, nous dit-on. Qu'est-ce que c'est, 0,1 enfant ? Il faut une mentalité de sous-chef comptable pour raisonner ainsi, pour être obsédé par la moyenne à calculer. Sans parler de la fiabilité des chiffres qu'on lui a donné à passer dans sa moulinette, au sous-chef comptable. Et dire que les populations du globe sont gérées de cette façon, par des chefs comptables qui se fient aveuglément aux chiffres qu'on leur fait mouliner.
Voilà pourquoi la chronique de Vialatte dont je parle commence par la citation tirée d’un San Antonio : « J’ai oublié mon écureuil chez le brocanteur », que j’ai donnée ici il y a quelque temps. Il fait de cette phrase anodine (pas tant que ça) l’emblème d’une méthode d’écriture : « Cet "écureuil" est universel, on peut lui faire symboliser toute chose, il aura toujours son "brocanteur", qu’on peut remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. Cette méthode peut fournir un volume de proverbes, une sagesse, une philosophie et même plusieurs poèmes lyriques. On voit par là [c'est une de ses formules préférées] que tout est dans tout ». Il a bien raison. Remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. C'est tellement bien dit. Tout est dans tout, peut-être, mais pas n'importe comment.
Substituer au hasard un mot à un autre, c'est exactement ce qui se passe dans le cadavre exquis, cette invention des surréalistes (le jeu des "petits papiers", vous savez, qu'on se passe autour de la table, et qui produisit l'inaugural « Le cadavre exquis boira le vin nouveau » : sujet-adjectif-verbe-COD-adjectif). Vialatte excelle à tirer du procédé (substitution sur l'axe paradimatique, excusez-moi) des effets d'une grande drôlerie. L'exercice lui ouvre la porte à la surprise et à l'inattendu (« des vérités nouvelles »).
Jean-Sébastien Bach répète à l'envi (c'était un humble) que quelqu’un qui ferait l'effort de s’appliquer autant que lui arriverait au même résultat que lui. Sa méthode pour bien jouer du clavier ? Rien de plus simple : « Il faut poser le bon doigt sur la bonne touche au bon moment ». Le propre du génie, c’est de paraître évident à celui qui le possède. Ben oui, il a toujours vécu avec. C'est une excuse. Pas une explication.
« Il en résulte qu’on peut prendre la vérité, ou toute autre chose, par n’importe où, et tout suivra ; il n’y a qu’à tirer un peu sec, ou adroitement, sur le bout de la laine, tout l’écheveau, ou le nœud, y passera. (…) Si vous avez à parler d’un sujet, commencez donc par n’importe où. Voilà qui facilite les choses (…) : le soleil, la machine Singer, que sais-je, le président Fallières. Au besoin, vous pouvez même toujours vous servir du même commencement ; par exemple : "Le soleil date de la plus haute antiquité". »
Et c’est là qu’on arrive au cœur de la méthode Vialatte : « Parti de prémisses si fermes et si catégoriques, pour arriver au sujet même (disons le tigre du Bengale, la femme fatale ou la pomme de Newton), vous serez obligé de l’extérieur à faire de tels rétablissements de l’esprit et de l’imagination que vous trouverez en route mille idées à la fois plaisantes et instructives qui ne vous seraient jamais venues sans cela ».
La clé de voûte de la méthode Vialatte est là, dans l'effort constant et puissant de « rétablissement » de l'esprit. Un vigoureux rétablissement de gymnaste qui soit à même de le surprendre lui-même. Il faut le savoir, c'est un vrai sportif. Qui improvise pour s'enrichir. Le « rétablissement » sert à retomber sur ses pieds, et à éviter le n'importe quoi, maladie typiquement surréaliste (vous savez, le truc piqué par André Breton au poète Reverdy : la poésie naît du rapprochement incongru de deux réalités éloignées). La preuve que c'est une maladie, c'est que la publicité en a fait son carburant principal.
Voilà, vous savez tout : si Alexandre Vialatte est un grand écrivain, c’est qu’il attend d’être surpris par ce qu'il va poser sur le papier. Parce que la réalité présente ne le satisfait pas. Parce qu’il attend de découvrir au fil de la plume ce dont lui-même est capable, et qu'il ignorait posséder. En commençant par n'importe quoi, il se met à l'épreuve.
Imaginez un auteur de polars qui met son héros dans une situation inextricable, et qui se demande comment il va faire pour l'en sortir dans le prochain épisode du feuilleton (il faut qu'il reste vivant). Lui aussi procède par un rétablissement de l'esprit. Vialatte, c'est pareil, il lui faut de l'inédit. Parce que la route sur laquelle il marche, il la trace et la goudronne au fur et à mesure. En se demandant où elle le fera aboutir. Le monde qui est le sien sort de sa plume au moment où il écrit. Il ne sait pas, en avançant le premier pied, quel sera son point d’arrivée. Et c’est ça qui compte, évidemment.
Et ça explique qu’il n’ait jamais été un ethnologue à la façon de Lévi-Strauss, mais le meilleur anthropologue autodidacte qui soit. Et même un amoureux de la littérature. Qui décoche, de sa patte aux griffes rentrées, un mot feutré sur les fausses gloires médiatiques du moment (qui se souvient de Minou Drouet (qu'il faisait semblant, quelque part, de confondre avec Françoise Sagan, en inversant les prénoms) ce feu de paille littéraire à sensation de 1955 ?), mais qui consacre de longues pages à célébrer Chardonne, Gadenne, Hellens, Frédérique (que des discrets !), et une palanquée d'autres qu’il estime dignes d’hommage.
Le n’importe quoi de la conclusion « aura été fixé d’avance », naturellement. Les orateurs du grand siècle finissaient tous leurs sermons sur un « Ave Maria » : l’admiration allait à ceux dont l’art et la technique amenaient la prière à Marie avec le plus de souplesse et d’évidence. Et Vialatte ajoute : « Le naturel naît de la contrainte. Le naturel n’est pas naturel. C’est la grande leçon de La Fontaine. L’aisance s’ajoute. On n’arrache pas "naturellement" deux cents kilos sans faire une tête de crapaud qui fume ; c’est par l’artifice qu’on parvient à le faire en souplesse. Le naturel est artificiel ». CQFD. Qui arriverait aussi "naturellement" à cet oxymore ?
Je regrette de n’avoir jamais vu Alexandre Vialatte faire le saut de l’ange, qu’il exécutait, selon les témoins, à la perfection, à la piscine Deligny, oui, celle qui a bizarrement coulé au fond de la Seine en 1993, et que j’ai fréquentée avec mon ami Hans-Joachim Bühler dans l’ancien temps, un 15 août, dans un Paris totalement silencieux et désert.
Nous étions venus en stop depuis Neustadt-an-der-Weinstrasse, dans le Rheinland Pfalz. En fait, la maison était à Mussbach, juste à côté. Neustadt, c’était le chef Queyrel. Les parents de HA-JO habitaient Richard-Wagner Strasse 11 (ne cherchez pas, la rue a été débaptisée, je suis tombé sur un bec). Un jardin. Un barbecue.
Et puis : « Ich bin kein mädchen dass man einmal kusst », m'avait-elle lancé, l’idiote invitée, révoltée par mes manières. L'uppercut m’est resté. Abattu, je n’avais pas tardé à me rabattre. La loi de l'offre et de la demande, il faut la mettre en oeuvre. Cela aussi exige un « rétablissement de l'esprit ». Pas seulement. C’était en quelle année, bon dieu ?
Voilà ce que je me demande encore, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, almanach vermot, pataphysique, alfred jarry, ubu, faustroll, jean-sébastien bach, surréalisme, andré breton, reverdy, imagination, publicité, statistiques, san antonio, claude lévi-strauss, jacques chardonne, paul gadenne, piscine deligny
vendredi, 24 août 2012
LA METHODE VIALATTE 3/5
Pensée du jour : « Tout y est dans le ton, dans le timbre, dans l'accent. C'est une immense leçon de style. Il n'est que style. Mais cherchez-y le style et vous ne l'y trouverez pas. C'est un serviteur invisible. Il a dressé la table, allumé les lumières, ordonné les fleurs dans les vases. Il est parti, ne nous laissant que la fête. Elle tient toute dans un éclairage. Le style est une fête donnée par un absent ».
Alexandre Vialatte, parlant de Jacques Chardonne (la formule magique est soulignée par moi).
***
Résumé : les livres, c’est comme les voyages. Certains écrivent des sommes écrasantes comme des systèmes solaires. D’autres se contentent de musarder au gré des chemins creux. Le véritable dilettante (c'est celui qui aime avant tout se délecter, comme son nom l'indique) est capable de bouleverser son programme à cause du son lumineux de la cloche qu’il vient d’entendre au loin, alors que la nuit va tomber.
Je dirai, pour introduire mon introduction (je ne veux pas fixer de date pour la conclusion, parce que, finalement, tant qu’on est en vie, on ne se croit jamais arrivé à la conclusion), que la digression est la vie, parce que la vie, à tout prendre, est une plus ou moins longue digression entre deux points d’une histoire qui la dépasse par tous les bouts.
Finalement, combien de gens arrivés à l’article de la mort ont l’impression de n’avoir pas vraiment achevé l'introduction, encore moins ébauché le développement ? Tout au moins de ne pas les avoir écrits comme ils auraient voulu, rétrospectivement ? Et qui voudraient tout réécrire ? Combien de paragraphes de leur vie voudraient-ils corriger ? Combien de phrases à supprimer ? Combien de vocables à mieux choisir ?
Dans le fond, chacun de nous n’est-il pas, en soi, une digression ? Une digression qui se déroule à son insu et qui ne se voit dans son entier (et encore, par temps clair : il faut au moins qu’on puisse voir le Mont Blanc depuis le Gros-Caillou, 154 km exactement en ligne droite, j'ai mesuré, moi-même en personne) qu’au moment où elle s’achève ?
C’est pourquoi, en attendant que se referme sur moi-même la parenthèse ouverte depuis lurette par l’homme et la femme qui m’ont occasionné, je ballotte aujourd’hui avec une sérénité somme toute appréciable au gré de mon petit cours d'eau, en me cramponnant à ma coquille de noix : « La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu’un bouchon, j’ai dansé sur les flots Qu’on appelle rouleurs éternels de victimes, Dix nuits, sans regretter l’œil niais des falots ». Ceci pour dire que s’il y a errance, c'est le bateau qui est ivre. Je me sens accompagné par quelque autorité en la matière. Cette compagnie me tient.
Je ne sais pas si mon rafiot avance dans le courant principal, ou si, rejeté sur le côté du fleuve, paralysé par divers courants et tourbillons, je ne finirai pas comme les conquistadors montés sur l’un des radeaux d’Aguirre (Klaus Kinski), dans le sublime film de Werner Herzog, Aguirre, la colère de Dieu (1972).
La digression, c’est la vie : « Va petit mousse, Où le vent te pousse, Où te portent les flots. Sur ton navire, Vogue ou chavire, Vogue ou chavire jusqu’au fond des flots » (Planquette, Les Cloches de Corneville). Louis-Ferdinand Céline aimait cette opérette.
Vous voulez en trouver une preuve en vous-même ? Par vous-même ? Souvenez-vous juste du moindre de vos repas entre copains ou en famille : à table, on cause, non ? Au bout d’une demi-heure, quelqu’un s’avise de se demander d’où on est parti.
Vous vous rappelez forcément ces moments : vous êtes partis du président Fallières (supposons), et vous en êtes arrivés au tigre du Bengale (ou à la pomme de Newton), après être passés par vos dernières vacances au camping de Sisteron, la folie de Khadafi, les « allées couvertes » du Cap Sizun, le prix du carburant, l’irruption de loups des Abruzzes dans le parc du Mercantour et l’invention de Lucy par Yves Coppens en 1974, au son d'une chanson des Beatles. Peut-être même l'entrée de René Caillé à Tombouctou le 20 avril 1828, qui vaut celle d'Alexandra David-Néel à Lhassa, le 28 janvier 1924. Presque cent ans plus tard. C'est normal, c'est une femme, et on est au 20 ème siècle.
Vous vous dites que vous tenez, dans ces errances conviviales, un compendium de l’histoire humaine, que je résumerai par une seule question : « Comment en est-on arrivé là ? ». C’est sûr, une conversation de table résume à chaque fois, à sa manière, l’histoire de l’humanité. Pour peu qu’on insiste un peu. Qu’on sache remonter au point de départ (pour Vialatte, le point de départ, c'est forcément « la plus haute antiquité »). Qu'on ait le souci de retourner dans les détails de la chose.
Que voulez-vous ? L’homme, dans sa caverne comme devant son poste, en a une vive conscience. Il aime à se demander comment il en est arrivé là. Et il tente laborieusement de reconstituer la trajectoire sinueuse, le cheminement biscornu observable depuis qu’il est parti. Parfois. Pas toujours. Parions que cette tentative de reconstitution est à l’origine de la littérature. Mais ne nous laissons pas impressionner par les plus lourds que l’air.
J’entends à l'instant dans mon casque une interpellation vibrante : « Bon alors, blogueur à rallonge, ta "méthode Vialatte", elle va finir par arriver, ou il faut aller la chercher ? », (je cite textuellement, bien sûr, je ne me permettrais pas, pensez). Sache, lecteur pressé d’arriver au bout (au bout de quoi, je le demande ?), que le fleuve, dans ses méandres les plus acrobatiques et ses détours les plus sophistiqués, ne perd jamais de vue la mer dans laquelle il jettera tôt ou tard son être tout entier.
Mon propos étant intitulé La Méthode Vialatte, j’ose affirmer que ce n’est pas pour rien, et que je n’ai garde de l’oublier. C’est pour demain, la révélation. Je le jure. A moins que … une digression se présente. De toute façon, Alfred de Musset l’a dit : Il ne faut jurer de rien (1836). J'obtempère : je jure donc de ne jurer de rien.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, société, jacques chardonne, dilettante, digression, méandre, mont blanc, gros caillou, arthur rimbaud, le bateau ivre, aguirre la colère de dieu, klaus kinski, werner herzog, planquette, les cloches de corneville, opérette, louis-ferdinand céline, tigre du bengale, yves coppens, alfred de musset

