dimanche, 30 juin 2019
VARÈSE AVAIT TOUT COMPRIS
IL N'Y A PAS DE MUSIQUE SANS SONS,
MAIS IL Y A DES SONS SANS MUSIQUE.
Précision : j'ai pris Varèse pour faire le titre, mais il va de soi que le propos de ce billet s'adresse à tous les compositeurs du 20ème siècle, et même au-delà, aux autres artistes. L'idée générale est la suivante : pour avoir une idée de l'état moral de la civilisation actuelle et du soi-disant "Progrès" qui la guide et l'anime, regardez les œuvres des artistes, et écoutez les œuvres des compositeurs de musique savante.
***
Pelléas et Mélisande-1907, Le Sacre du printemps-1913, Désert-1954 : Claude Debussy, Igor Stravinsky, Edgar Varèse. Autant de scandales éclatés dans la France de la première moitié du 20ème siècle. Fontaine-1917, c’est l'urinoir signé R. Mutt, alias de Marcel Duchamp. Et vlan, encore un scandale. Merda d’artista-1961, c’est Piero Manzoni. Le gobelet d’urine, c’est je ne sais plus qui. Cloaca (la machine à faire caca), c'est Wim Delvoye en 2000. Derniers scandales en date : le « Vagin de la reine », d’Anish Kapoor à Versailles, les « Tulipes » de Jeff Koons, le « plug anal » de Paul Mc Carthy au milieu de la place Vendôme, j’arrête là.
Au théâtre, à l’opéra, on ne compte plus les metteurs en scène qui ont « dépoussiéré » les œuvres majeures du répertoire à coups d’attentats contre les « routines » d’un public « paresseux » et « encroûté », pour « nettoyer les écuries d’Augias » ou « faire souffler un vent nouveau » (rayer la mention inutile). Tiens, dans le Don Giovanni donné ces temps-ci à Strasbourg, Leporello met du poison dans les plats, Donna Anna jette du vin à la figure du séducteur et le Commandeur devient barman : vous le sentez, « l'air frais et vivifiant » ?
Dans le domaine esthétique tout entier, l’histoire du 20ème siècle est jalonnée par les pierres blanches des scandales. Les milieux artistiques, qu’on disait conservateurs, se sont mis au goût du jour et ont adopté le langage cérébral qui convient pour donner à toutes sortes de nouveautés le poids de l’intellect. On s’est mis à idolâtrer les avant-gardes et à guetter l’inouï et le jamais vu. Tous les arts sont touchés par ce phénomène, mais je parlerai ici principalement du domaine musical.
Les beaux esprits qui se font des piquouses à l’air du temps, et tombent dans tous les panneaux pour avoir l’air bien informés, en tirent argument pour en conclure que, quand une œuvre est novatrice, elle commence par « heurter les sensibilités », mais finit toujours par devenir un « classique », sur le refrain : « On s’habitue à tout ». C'est parfois vrai, mais loin d’être la règle (tiens, pour voir si vous le trouvez « classique », essayez la "première" de Déserts de Varèse (27'15") en 1954, et accrochez-vous, je parie que le Sacre de Stravinsky prendra des airs de Mozart. Frank Zappa admirait Varèse).
Ce qui est amusant, c'est que Varèse, qui avait peut-être prévu l'accueil "festif", se débrouille pour qu'il y ait par épisodes plus de bruit sur la scène que dans la salle.
Et le public, dans tout ça ? Eh bien le public, lui, dans sa plus grande partie, est resté sur place. Pendant que les arts (musique, peinture, etc.) montaient dans le TGV et prenaient la voie rectiligne et scintillante de la modernité, le public en restait au pas mesuré du laboureur à sa charrue, derrière son cheval, les sabots dans la glèbe. Et la technique ne l’a pas aidé, on peut le dire, à accélérer l’allure, contrairement à ce qu’on pourrait penser a priori.
Car la technique au 20ème siècle, en plus de donner des moyens révolutionnaires aux compositeurs (qui se sont jetés dessus comme des prédateurs affamés : onde Martenot, Theremine, magnétophone, sampler, etc.), a apporté au public tout ce qu’il fallait pour entretenir son naturel conservatisme esthétique. D’abord la radio, puis la télévision, qui caressent forcément l’auditeur dans le sens du poil ; mais aussi la conservation (enregistrement) et la reproduction (disques) de la musique en train de se faire : ça paraît inconcevable aujourd’hui, mais il fallait auparavant sortir de chez soi pour entendre de la musique, ou alors la pratiquer soi-même pour en faire à la maison.
Du coup, la musique en train de se donner en concert en direct a perdu de sa prégnance et de sa surface commerciale (je ne parle pas du rap). Ce qu’on appelle « musique contemporaine » est devenu une option parmi cent cinquante autres, puisque, grâce à la technique, toutes les musiques sont devenues « contemporaines ».
Et par la vertu des moyens de reproduction, toutes les musiques ont acquis les vertus domestiques de la consommation individuelle, voire solitaire, pour ne pas dire égoïste. Et les étiquettes (on pourrait dire « compartiments », « cases », « ghettos », …), dans les rayons « musique » de la FNAC, se sont mises à proliférer et se multiplier. Pierre Bouteiller avait mis un "s" à "musique" quand il dirigeait l'antenne musicale publique (ceci pour dire que l'élite intellectuelle se fait volontiers la messagère de tout ce qui voudrait la voir morte et en enfer).
Pour ce qui est des musiques savantes, je veux parler des avant-gardes, tout ce beau monde a décidé d’oublier le grand public et d’en revenir à la bonne vieille doctrine de « l’art pour l’art » : moi l’artiste, moi le compositeur, j'oublie que la musique est faite pour être entendue et appréciée par des oreilles humaines, je suis désormais l'explorateur des possibles, l’expérimentateur des formes, le chercheur en blouse blanche, je combine et fabrique au fond de mon laboratoire, j’en sors pour offrir mes trouvailles au monde, et tant pis pour les mélomanes, qui n’ont qu’à me suivre, s’ils ne sont pas trop fossilisés dans une tradition paralysante. Une petite élite d’amateurs préoccupés de « vivre avec leur temps », ça me suffira.
Aparté : j’ai longtemps fait partie de ces gens-là. Je n’en éprouve ni honte ni fierté : cela fut. Cela n'est plus. J'en ai gardé de fort rares prédilections. Mais le plus souvent, je suis obligé de fermer les écoutilles, en me demandant pourquoi les compositeurs modernes et d'aujourd'hui ont banni de leurs préoccupations l'intention de procurer à leurs auditeurs une émotion musicale. Comme s'il était interdit désormais au public d'éprouver du plaisir, et pourquoi pas, de la jouissance. Dans l'immense majorité de sa production, la musique contemporaine déteste le plaisir. (ajouté le 5 juillet)
Le grand public a réagi avec bon sens et à-propos : il a déserté les salles, se disant qu’on ne paie pas son billet d’entrée pour se faire marcher sur les tympans par des bataillons de sons chaussés de bottes à clous (ou inversement, pour chercher dans une botte de foin trois pets inodores qui se courent après). Les directeurs de salles et programmateurs de concerts ont fini par comprendre. En sadiques modérés, ils ont adopté la stratégie du sandwich : une tranche de Stockhausen entre une Quatrième de Beethoven et une Ouverture de Mozart, convaincus qu’à la longue le public s’y fera : « Nous avons les moyens de vous faire aimer la contemporaine » (dit - presque - le SS "Papa Schulz"-Francis Blanche dans Babette s'en va-t-en guerre).
Mais globalement, disons-le, le grand public a résisté à ce qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'est un fait : pour entrer dans la musique contemporaine, il faut quelques clés. En particulier, il ne faut pas ignorer que la musique a quelque chose à voir avec le mouvement de l'histoire. Il faut se faire une idée des grandes "problématiques" touchant la tonalité, la mélodie, les timbres, les instruments, la notion d'œuvre (pièces aléatoires de Boucourechliev et autres), l'auditoire (cf. le célèbre 4'33" de Jogn Cage) et autres fantaisies théoriques.
Or le grand public n'avait pas une vue très claire des bouleversements intervenus dans la réalité globale du monde. L'époque, et donc la musique étaient radicalement nouvelles. Quelques révolutions bien réelles avaient eu lieu, changeant de fond en comble les conditions de l'existence et des productions esthétiques. Que peut-on chanter, que peut-on écrire, après deux guerres mondiales, après la bombe atomique, après Auschwitz ? Sûrement pas l'adagio d'Albinoni. L'histoire était passée par là.
En vociférant contre le compositeur qui, selon lui, massacre la "musique", le grand public se trompe de cible (idem en peinture : "Un gamin de cinq ans en ferait autant") : c’est contre l’époque capable d'engendrer de tels monstres, que devraient s’élever les récriminations. Bizarrement, l'auditeur supporte aisément la réalité générale dans laquelle il vit, mais hurle contre des objets esthétiques qui n'en sont que les produits.
Il faut s'en convaincre : la musique contemporaine a tout compris du temps dans lequel elle est composée : elle porte très naturellement les clameurs politiques, les tumultes guerriers, les misères noires, les drames affreux, le chaos sensoriel et l'anarchie conceptuelle qui ont pris les commandes de l'humanité. Il n'y a plus des sons proprement musicaux et spécifiquement organisés sortis d'instruments fabriqués pour ça.
Tous les sons sont devenus égaux, y compris ceux qu'on appelait "bruits" avant que Pierre Schaeffer n'en fasse des "objets musicaux". Par exemple, j'avais assisté à une répétition où les jeunes violonistes, obéissant à Ivo Malec, devaient frapper (pas trop fort, mais "a tempo") le bois de l'instrument avec le bois de l'archet ("Musique nouvelle", Lyon, 1981). Bien des compositeurs sont arrivés à faire pire. Le 20ème siècle ne pouvait pas espérer mieux pour le domaine musical que ce champ de batailles.
La musique faite au 20ème siècle, qui porte tous les bruits et toutes les fureurs du monde, ressemble trait pour trait au siècle où elle a vu le jour (oui, je sais qu'on est au 21ème). Pleine de vacarmes, d'horreurs et de tortures sans précédent, elle est en parfaite adéquation avec lui. C'est l'attitude face au siècle qui doit façonner l'attitude face aux arts, et c'est encore loin d'être le cas. Comme s'il y avait une césure entre les deux. A moins que l'auditeur ne vive dans une bulle protectrice.
Berg, Schönberg, Prokofiev, Partch, Ligeti, Stockhausen, Boulez, Gubaidulina, Barraqué, Schwarz, Xénakis, Penderecki, Nancarrow, Zimmermann, Webern, Boucourechliev, Cage, Berio, Kagel, Greif et tous les autres, ils ont tout compris au siècle, et ils ont composé la musique qui entrait le plus fort en résonance avec lui. Et le grand public, sans même s'en rendre compte, étranger à toutes ces musiques de son temps, vit hors de son propre siècle.
Le grand public n’a pas compris que s’il juge insupportable beaucoup de la musique contemporaine, c’est parce que c’est le siècle qui est insupportable, et que la musique ne fait que l'exprimer. Alors que lui, grand public, qui veut continuer à supporter l'existence, continue à vivre comme si étaient réunies comme avant toutes les conditions pour vivre harmonieusement. Le grand public a mis la tête dans le sable. Les tumultes, les rages, les catastrophes peuvent bien se déchaîner, le grand public se déchaîne quant à lui contre les œuvres qui, dans leur forme ou dans leur contenu, le mettent face à cette réalité sauvage.
Le monde est enragé, mais « la vie continue ». La réalité peut devenir atroce, mais il faut pouvoir continuer à dormir le cœur en paix et à passer des repas tranquilles. Et si, pour mon compte personnel, je déteste une majeure partie de ce qui se fait en musique savante aujourd’hui, c’est parce que je l'inclus dans le tableau d'ensemble. Je sais que notre temps est de moins en moins présentable et habitable (ce qui ne m'empêche pas de jouir de ma petite existence).
J’ai une fois pour toutes cessé d’adhérer à l’ignoble fiction du « Progrès », et cette antipathie va aussi, bien évidemment, aux œuvres qui en sont le fruit. Je coupe le son lorsque viennent les « mercredis de la contemporaine » sur France Musique, sauf en de très rares occasions où, en pleine célébration du culte des sons, du bruit et de la fureur, je vois se dessiner le visage d’une vraie mélodie qui me susurre à l’oreille : « Non, tout n’est pas perdu ».
Voilà ce que je dis, moi.
***
Quelques phrases d'un baratin que j'avais pondu ici même le 9 décembre 2015. Je n'ai guère progressé.
Qui adhère avec enthousiasme à l’époque, est logiquement gourmand d’art contemporain, de musique contemporaine. Qui est rebuté par l’art contemporain, en toute logique, devrait diriger sa vindicte contre l’époque dont celui-ci est issu, et non pas seulement contre l'art qu'elle produit..
L’art contemporain découle de son époque. Tout ce qui apparaît minable dans l’art contemporain découle logiquement du minable de l’époque qui le produit. Ce n’est pas l’art qui pèche : c’est l’époque. Nous avons l’art que notre époque a mérité. Quand la laideur triomphe, c’est que l’époque désire la laideur.
Mais si l’on admet que c’est l’époque qui produit cet art déféqué, c’est moins l’art qui est à dénoncer que l’époque qui l’a vu et fait naître, tout entière.
Mais il y a une certaine continuité. Ajouté le 9 août 2019.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, edgar varèse, stockhausen, france musique, france musique, claude debussy, pelléas et mélisande, igor stravinsky, le sacre du printemps, varèse déserts 1954, marcel duchamp, ready-made, merda d'artista, jeff koons, paul mc carthy, wolfgang amadeus mozart, don giovanni, art contemporain, arcon, pierre bouteiller, john cage, boucourechliev, pierre schaeffer, traité des objets musicaux
dimanche, 20 janvier 2019
HOUELLEBECQ
Je termine aujourd'hui ma "grande révision" des romans de Michel Houellebecq. Voici celui par lequel je suis finalement entré dans cette œuvre, unique dans la littérature française d'aujourd'hui. Des quatre billets d'origine (17 au 20 août 2011), j'ai fait un seul, trop long certes, mais dont j'ai éliminé énormément de graisse superflue. Il reste peut-être quelques bourrelets.

Une amie avait prêté à H. La Carte et le territoire, le petit dernier de l’auteur controversé. Le livre était là, sur la table, inoccupé, il s’ennuyait. Je l’ai ouvert – avec réticence. Autant l’avouer : je craignais le pire. Eh bien tenez-vous bien, je n’ai pas regretté. Franchement, c’est une heureuse surprise. J’ai donc lu récemment La Carte et le territoire. J’ai trouvé ce livre réjouissant.
L’action se passe aujourd’hui, ou peu s’en faut : il ne faut pas compter sur une reconstitution historique. Et l’époque, on entend la détestation. On sent que le narrateur ne peut pas la sentir. Et pour moi, ça tombe bien, c’est une attitude que non seulement je comprends, mais que je partage. Ce qui est vraiment bien, c’est que Michel Houellebecq, non seulement ne dit jamais « je » comme dans ces pseudo-romans que sont les soi-disant « auto-fictions », mais encore met en scène un personnage qui s’appelle Michel Houellebecq, qui meurt atrocement, soit dit en passant, dans la troisième partie.
Le personnage principal, c’est l’artiste Jed Martin, fils de l’architecte Jean-Pierre Martin, à la riche et belle carrière d’architecte, qui a pris sa retraite, un jour. Le roman commence sur l’impossibilité de finir le tableau dont le sujet consiste en Jeff Koons et Damien Hirst, les deux artistes les plus chers du marché de l’art contemporain. Déjà, cette impossibilité de finir un pareil tableau me rend le livre sympathique. Ça ne suffit pas, mais ça aide. D’autant que le futur tableau s’intitule « Jeff Koons et Damien Hirst se partageant le marché de l’art ».
Damien Hirst a réalisé l’œuvre d’art la plus chère de tous les temps, avec un véritable crâne humain recouvert de (environ) 8000 diamants authentiques. Il a, par cette « invention », gagné son bras de fer avec Jeff Koons. Ce dernier a dû chercher longtemps le moyen de se replacer au sommet du podium mais, apparemment, il n’a pas trouvé. Moralité : l’argent a eu la peau du sexe (cheval de bataille de Koons autour de 1992, voir la série de photos kitsch où Koons exhibe in vivo son membre à l'œuvre dans la Cicciolina extatique).
Dit autrement : la marchandise a triomphé de la morale, puisque pour « heurter les sensibilités », exhiber une copulation in vivo est dépassé : il faut maintenant des diamants, et des diamants comme s’il en pleuvait. Et ça ne heurte même plus personne. C’est sans doute ce dont Michel Houellebecq est convaincu, au moins apparemment, car ce tableau, que Jed Martin finira d’ailleurs par détruire, symbolise l’escroquerie cynique et arrogante que constituent désormais, d'une part la gratuité obscène, voire pornographique (et je ne parle pas forcément de sexe), de certains "gestes artistiques" contemporains (Koons vs Hirst), d'autre part l’étalage sans vergogne des montagnes de fric (Arnaud vs Pinault) sous le nez même de ceux que l’ultralibéralisme racle jusqu’à l’os.

Koons et Pinault : deux hommes d'affaires.
"La carte et le territoire" est une expression qu’on rencontre deux ou trois fois dans les Essais de Philippe Muray (Les Belles Lettres, 2010), ainsi que dans Festivus festivus (Fayard, 2005, p.389) : « La fameuse distinction de la carte et du territoire était encore rassurante : c'était la distinction du réel et de l'imaginaire ; mais il n'y a plus de territoire, et c'est le peuple de la carte qui s'exprime. Sans drôlerie, comme de juste. Sans imagination. Ou qui ne s'exprime pas du tout, d'ailleurs ». Cela ouvre comme un horizon, une sorte de profondeur de champ, sur notre monde désormais entièrement artificialisé.
Jed Martin a été photographe avant de virer peintre. Il a commencé par « trois cents photos de quincaillerie », avec « écrous, boulons et clefs à molette », tout ça en « lumière neutre », sur « fond de velours gris moyen ». Puis il a l’illumination, un jour où, sur une aire d’autoroute, son père lui demande d’acheter la carte Michelin du département. Ils sont dans la Creuse. Le passage vaut, comme on dit dans le Guide Michelin, le détour.
« Cette carte était sublime ; bouleversé, il se mit à trembler devant le présentoir. Jamais il n’avait contemplé d’objet aussi magnifique, aussi riche d’émotion que cette carte Michelin au 150.000ème de la Creuse, Haute-Vienne. L’essence de la modernité, de l’appréhension scientifique et technique du monde, s’y trouvait mêlée avec l’essence de la vie animale. » C’est le coup de foudre. On ne comprend pas bien, mais le roman, c’est aussi ça.
Donc Jed Martin est tombé amoureux des cartes Michelin. Il se fait une sorte de nom avec ses photos de cartes. Le titre de son exposition est d’ailleurs : « La carte est plus intéressante que le territoire ». Cela tombe bien : la Compagnie Financière Michelin est intéressée par cette mise en valeur inattendue. Et puis c'est l'occasion pour lui de tomber un peu amoureux d’Olga. Bref, je ne vais pas vous le refaire. Le premier thème du livre, c’est d’abord l’état du monde, pas brillant, on l’a vu.
Le deuxième thème, c’est le monde de l’esthétique, ou plutôt le monde de la beauté. Le père est architecte : la beauté qu’il élabore reste lestée par l’ « utile », le fonctionnel, le monde concret. Il conçoit des stations balnéaires. Il peut y avoir de l’art dans l’architecture, mais par principe, ça n’encourage pas l’oiseau à déployer ses ailes, ou alors il s’agit d’un oiseau attaché au sol, trop lourd pour voler, en quelque sorte. D’ailleurs le père ne se gêne pas pour qualifier de « totalitaires » les élucubrations urbanistiques de Le Corbusier, sorte d'Albert Speer des démocraties, au sujet de Paris ou Rio de Janeiro.
Jed, quant à lui, est un artiste. Il part de ses « objets de quincaillerie », dont l’exposition forme un « hommage au travail humain ». Il prend ensuite de l’altitude, avec les cartes Michelin, pour regarder le monde d’en haut, avec tout le sens conféré par les dessins, les formes, et puis surtout les noms.
Puis il devient peintre, avec des tableaux qui représentent le monde, ou plutôt qui essaient de dégager une signification du spectacle du monde. Les titres disent quelque chose : « Bill Gates et Steve Jobs s’entretenant du futur de l’informatique », « Aimée, escort-girl », « L’architecte Jean-Pierre Martin quittant la direction de son entreprise ».
Wong Fu Xin, un essayiste chinois qui a travaillé sur le peintre, le voit « désireux de donner une vision exhaustive du secteur productif de la société de son temps ». Le roman, à travers le personnage de Jed Martin, parle bien du monde. Et il en dit quelque chose, qui a quelque chose à voir avec l’étriqué qui enserre l’humanité depuis que l’économique (pour ne pas dire le financier) est seul aux manettes.
« Je veux rendre compte du monde… Je veux simplement rendre compte du monde ». C’est ce que répète Jed Martin qui, ayant pris de l’âge et marqué le monde de l’art de son empreinte, est interviewé pour la revue Art press. Pour dire, la dernière partie de son œuvre consistera, le matin, à poser son caméscope, à cadrer, par exemple « une branche de hêtre agitée par le vent », ou « une touffe d’herbe, le sommet d’un buisson d’orties, ou une surface de terre meuble et détrempée entre deux flaques ». Il déclenche, et vient récupérer son matériel le soir ou le lendemain. Il en tire par montage des « œuvres », « qui constituent sans nul doute la tentative la plus aboutie, dans l’art occidental, pour représenter le point de vue végétal sur le monde ». Le point de vue végétal sur le monde : cette trouvaille m’enchante.
Il y aura aussi ces composants électroniques, qu’il asperge d’acide sulfurique pour « accélérer le processus de décomposition ». A la suite d’un long travail qu’il est inutile de détailler, il aboutit à de « longs plans hypnotiques où les objets industriels semblent se noyer, progressivement submergés par la prolifération des couches végétales ».
Il fera subir un sort analogue à des photographies laissées à « la dégradation naturelle », puis à des « figurines jouets, représentations schématiques d’êtres humains ». On aura constaté que la place de l’homme, dans tout ça, est si réduite qu’elle a pour ainsi dire disparu.
Un autre thème apparaît au début de la troisième partie. Enfin, pas un « thème » : on change de roman, du moins en apparence. On était dans la « littérature », on entre dans le polar. L’écrivain Michel Houellebecq et son chien sont retrouvés, enfin, quand je dis « retrouvés », c’est beaucoup dire, car il n’y a plus que leurs têtes qui trônent sur des fauteuils, par la police, éparpillés aux quatre coins de la pièce, pas exactement « façon puzzle », comme dit Bernard Blier dans un des films français les plus célèbres de tous les temps. La façon dont les restes sont disposés évoque les toiles de Jackson Pollock, « mais un Pollock qui aurait travaillé presque en monochrome ».
L’assassinat a duré à peu près sept heures, selon les enquêteurs. Cette scène de crime m’a fait penser à Un Lieu incertain de Fred Vargas, où on lit : « Comme si le corps avait éclaté ». La police patauge, au sens propre, jusqu’à ce que Jed Martin fasse part à Jasselin, le policier, de la disparition du tableau « Michel Houellebecq écrivain » dont il lui avait fait cadeau.
Il y a des idées marrantes, dans cette troisième partie. Par exemple, l’auteur pensait-il à François Bégaudeau en créant un « brigadier Bégaudeau » qui face à la scène de crime se met à osciller sur lui-même : « il fallait juste aller le coucher c’est tout, dans un lit d’hôpital ou même chez lui, mais avec des tranquillisants forts » ? Par exemple, pensait-il à la « trilogie marseillaise » de Jean-Claude Izzo, en faisant boire à ses flics du whisky Lagavulin, comme celui que préfère Fabio Montale ? « Il est impossible d'envisager un travail de police sérieux sans une réserve d'alcool de bonne qualité (...) ».
« L’affaire est résolue », s’écrie Jasselin quand Jed Martin estime la valeur de son tableau à 900.000 euros. Il faut dire que l’exposition organisée par Franz a fait du peintre un homme très riche, qui peut acheter du jour au lendemain un vaste domaine. Trois ans plus tard, quand l’assassin est retrouvé (mort), le tableau est estimé à 12.000.000. Jed Martin est devenu une « valeur ». Il peut tout se permettre.
Le dernier pan de ce livre que je voudrais retenir, c’est la relation au père, qui quadrille pour ainsi dire le roman. Et c’est un des beaux aspects du livre. Le père intervient comme une ponctuation. Le mot « intervient » est d’ailleurs impropre : disons qu’il est là, présent à intervalles réguliers, tous les 25 décembre pour être précis, c’est le jour de l’année où ils prennent un repas en commun, et un repas de fête, qui plus est. En général, ce n’est pas très gai. Mais ce n’est pas lugubre non plus. L’événement est présenté comme allant de soi : le fils passe avec son père le réveillon de Noël. C’est tout simple, ça ne se discute pas.
C’est d’ailleurs intéressant, cette relation entre le fils et son père, car la mère est à peu près absente, simplement mentionnée comme un souvenir, mais un souvenir anodin. On apprend qu’à la vérité, elle s’est suicidée au cyanure. Cette absence de la mère change de l’habituelle dégoulinade de maternite aiguë dont sont atteints bon nombre de nos contemporains.
Jed Martin est étonné quand son père déclare, au cours de leur premier repas du roman, « dans une brasserie de l’avenue Bosquet appelée Chez Papa », avoir lu deux romans de Michel Houellebecq : « C’est un bon auteur, il me semble. C’est agréable à lire, et il a une vision assez juste de la société. ». C’est vrai qu’ « il y a une petite bibliothèque à la maison de retraite ». Il a donc du temps pour lire.
Le deuxième repas qu’ils partagent se passe chez le fils. D’abord en silence, au point que Jed s’assoupit. Et puis soudain : « Jed se figea. Ça y est, se dit-il. Ça y est, nous y voilà ; après des années, il va parler. » Cela ne viendra pas tout de suite, mais le père se met à parler. De lui, de son histoire, du choix de l’architecture, de l’organisation sociale, de la mère et de William Morris, le peintre d’un seul tableau (La Reine Guenièvre), de genre préraphaélite. Aussi architecte. Une belle scène, économe de moyens. Jean-Pierre Martin est malade, il le sait. Cette conversation lui tient donc lieu de testament, de chaîne de transmission, avant sa disparition prochaine. Et le fils recueille ce legs avec une grande attention.
Eh bien voilà. C’est La Carte et le territoire, écrit par Michel Houellebecq, écrivain.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, llittérature, michel houellebecq, france, la carte et le territoire, jeff koons, damien hirst, art contemporain, philippe muray, festivus festivus, guide michelinle corbusier, bill gates, steve jobs, art press
vendredi, 02 février 2018
LE DÉBAT FAIT RAGE
La France (non : la ville de Paris) doit-elle accepter que le "Bouquet of tulipes", cadeau fait par l'artiste Jeff Koons en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 (?), soit installé entre le Musée d'Art Moderne et le Palais de Tokyo ?
LE DÉBAT FAIT RAGE;
Faut-il rééditer Mein Kampf, d'Adolf Hitler ?
LE DÉBAT FAIT RAGE.
Faut-il autoriser ou non la "gestation pour autrui" pour les couples de lesbiennes ?
LE DEBAT FAIT RAGE.
Les hommes ont-ils le droit d'importuner les femmes dont ils apprécient la physionomie, l'allure, l'apparence ou la plastique ?
LE DÉBAT FAIT RAGE.
L'éditeur français qui possède le plus beau catalogue de littérature du vingtième siècle a-t-il le droit de rééditer Bagatelles pour un massacre, le gros pamphlet antisémite de Louis-Ferdinand Céline ?
LE DÉBAT FAIT RAGE.
Est-il légitime que l'on fasse figurer, dans le livre 2018 des commémorations nationales, les noms de Charles Maurras, antisémite notoire, et de Jacques Chardonne, collaborationniste notoire (ajoutons le Simon de Montfort de la croisade contre les Albigeois, 1208-1229) ?
LE DÉBAT FAIT RAGE.
Cette liste n'est pas limitative.
******************
D'une manière générale, les débats font rage en France.
Je propose, comme réponse à la question « Qu'est-ce que l'identité de la France ? »,
le hashtag
« #balancetondébatfaitrage ».
Cela donnera aux bouches des exaltés de tout bord une raison renforcée de lancer des flammes. Cela donnera à toutes sortes de phraseurs (espèce animale déjà surabondante et encore en voie de prolifération : le phraseur, espèce envahissante, invasive et irrespirable) – intellectuels venus de l'université et faisant autorité, ou militants moralisateurs d'associations menant tous les combats des "justes causes" – encore plus d'occasions et de raisons de graver dans le château de sable du bronze de la presse quotidienne, les grandes formules définitives de leurs convictions ardentes.
******************
Un point commun unit tous ces "débatfaitrage" : lecteur perspicace, sauras-tu le retrouver dans le tableau ?
16:06 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeff koons, bouquet de tulipes, art contemporain, mein kampf, adolf hitler, gpa, location d'utérus, gestation pour autrui, lesbiennes, lgbt, droit d'importuner, balance ton porc, harcèlement sexuel, catherine deneuve, gallimard, louis-ferdinand céline, bagatelles pour un massacre, charles maurras, jacques chardonne, simon de montfort, croisade des albigeois, commémorations nationales, identité française, le débat fait rage, antisémitisme, palais de tokyo koons
samedi, 30 avril 2016
CHRISTOPHER LASCH ET L'ARCON
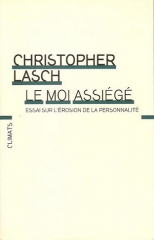 2
2
Alors maintenant, comment Christopher Lasch analyse-t-il l’évolution des pratiques picturales après 1950 ?
« Les équipements d’enregistrement modernes monopolisent la représentation de la réalité, mais ils brouillent également la distinction entre réalité et illusion, entre le monde subjectif et celui des objets, gênant par là même les artistes lorsqu’il s’agit de se réfugier dans le fait brut du moi, comme le disait Roth. Pas plus le moi que son environnement n’est plus un fait brut. » Christopher Lasch, Le Moi assiégé, p. 135. On a déjà croisé une telle idée. On sait qu'elle vient de Guy Debord et de sa Société du spectacle : tout au long de notre existence, toutes nos perceptions (enfin, la plupart) nous parviennent aujourd'hui médiatisées sur un écran où se projettent des images élaborées par d’autres instances que nous-mêmes. Nous n'avons plus d'expérience directe du monde.
« L’artiste romantique projetait des mots et des images dans le vide, en espérant imposer l’ordre au chaos. L’artiste postmoderne et postromantique les voit comme des instruments de surveillance et de contrôle. » C’est l’écrivain William Burroughs qui inspire ici Lasch.
Mais surveillance et contrôle ont été rendus possibles par la généralisation des sciences dites « humaines », au premier rang desquelles on trouve bien sûr la psychologie et la sociologie : « L’observation scientifique et sociologique abolit le sujet en faisant de lui le "sujet" d’expériences censées faire apparaître sa réaction à divers stimuli, ses préférences et ses fantasmes privés. Sur la foi de ses découvertes, la science construit un profil composite des besoins humains sur lesquels elle pourra baser un système (envahissant bien que pas ouvertement oppressif) de régulations comportementales » (p.141). "Régulations comportementales" ? On ne peut être plus clair, me semble-t-il, sur le processus d'asservissement des individus par un système devenu complètement anonyme, du fait que tout ce qui sert à connaître l'homme (les sciences humaines) fournira plus tard des outils perfectionnés pour le contrôler.
L’auteur puise la substance de ce raisonnement chez l’Anglais J.G. Ballard. La préoccupation que ce dernier exprime dans ses romans n’est autre que le processus d’onirisation de la vie, qui résulte de la « saturation de l’environnement par les images et l’effacement consécutif du sujet », tel qu’on peut en voir la manifestation dans le travail d’artistes comme Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Jasper Johns, Robert Morris.


Que ce soient une vignette de BD (Lichtenstein), une aiguille et son fil ou une pince à linge (Oldenburg), l’agrandissement démesuré (x 1000 ou 10000, pour le moins) de l’objet lui fait perdre sa matérialité utilitaire et le coupe de toute réalité concrète. Ce qui fait perdre toute possibilité pour l'œuvre d'art de signifier quoi que ce soit. Sans parler de l'infinie dérision dont de telles œuvres sont porteuses. Il se produit le même phénomène de déréalisation dans la multiplication de la boîte de Campbell Soup ou du portrait de Marylin (Warhol). Il est désormais admis que l’ « œuvre d’art » vole de ses propres ailes, loin de toute basse réalité, offrant au gré des caprices de l’artiste tel objet trivial à l’adoration des foules. On peut voir là une forme de prosternation devant le dérisoire : Clement Greenberg « croyait quant à lui que l’art ne devait jamais tenter de renvoyer à quoi que ce soit en dehors de lui-même ».
Un tel courant a pour conséquence (c’est peut-être le but poursuivi par ces artistes) de dépersonnaliser l’œuvre d’art et d’éliminer la subjectivité (Sol Lewitt), tendant à « brouiller la frontière entre illusion et réalité ». Cette conception de la création artistique procède évidemment des coups inauguraux que Marcel Duchamp, en son temps, a portés au statut de l’artiste. On traitait André Breton de "Pape du surréalisme". Duchamp peut à bon droit être qualifié d' "Empereur du ready-made". Refusant de signer des « chefs-d’œuvre » au bas desquels il serait fier d’apposer sa signature, Duchamp voulut en finir avec la « confiscation » de la créativité par les seuls individus « créatifs ». Idée a priori généreuse et démocratique.
Mais c'est du flan, une vaste blague, une farce grotesque et un désastre général, en vérité, car on sait ce qu’il en est advenu : non seulement le monopole n’a pas été mis à bas, mais il est à présent accaparé, non par des créateurs authentiques, mais par des individus qui se contentent de commercialiser une « idée » artistique, si possible spectaculaire (le bleu de Klein, l’outre-noir de Soulages, la Campbell Soup de Warhol), quand ce n’est pas par de vulgaires hommes d’affaires (Jeff Koons était courtier en matières premières à Wall Street, avant d'être embauché dans la domesticité au service du milliardaire François Pinault).
Il est bien loin, le temps où la société demandait à l’artiste d’administrer la preuve de son savoir-faire et de sa maîtrise technique dans l’art de peindre. Aujourd’hui, tout individu (je ne dis pas "artiste", car tout le monde est concerné par l’appel) un peu astucieux devient une start-up potentiellement dotée d’un bel avenir commercial : sois assez ingénieux pour créer toi-même ton propre « créneau ». Il ne s’agit certes pas du même savoir-faire.
Christopher Lasch se réfère à un essai du philosophe allemand Walter Benjamin, suicidé en 1940 à la frontière franco-espagnole, L’Œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique. Qui dit production en série dit forcément société industrielle, société de consommation, société de masse. Chaque tendance de l’art contemporain va s’inscrire dans un « créneau » précis, celui qui lui est dévolu sur le marché d’une consommation donnée. Que cela s’appelle « minimal art », « systemic painting », « optical art », « process art », « earth art » ou conceptualisme, tous participent de ce mouvement de déconstruction (de « démystification »). Et chacun, bien rangé dans sa case, occupe le « segment de marché » qu’il a réussi à s’ouvrir.
Christopher Lasch conclut logiquement à la « fusion du moi et du non-moi », sorte d’indifférenciation des moi, des êtres et des choses, un monde où les distinctions sont abolies, « un monde où tout est interchangeable ». C’en est au point que « la survie de l’art, comme de toute autre chose, est devenue problématique », au motif « que l’affaiblissement de la distinction entre le moi et son environnement – développement fidèlement consigné par l’art moderne jusque dans son refus de devenir figuratif – rend le concept même de réalité, ainsi que celui du moi, de plus en plus indéfendable » (p.155).
Ce qui arrive arrive, ce qui existe existe, ce qui est là est là, c’est tout : il n’y a plus rien sous la surface des choses, toute substance, tout contenu sont révocables, l’unité de la personne est pulvérisée (« Puisque l’individu semble être programmé par des agences extérieures – ou peut-être par sa propre imagination exaltée – il ne peut être tenu pour responsable de ses actes »), l’insignifiance triomphe. Il n'y a plus que de pures apparences : images fabriquées par des gens de métier, et déconnectées de tout contenu humain réel. L'homme en personne devient virtuel.
Les artistes de la fin du 20ème siècle commentent leurs propres œuvres et le « geste » qui les y a conduits comme s’ils inventaient un nouveau monde. Mais c’est une simple grimace. N’est pas Christophe Colomb qui veut.
Au total, Christopher Lasch, en regardant l’évolution de l’art contemporain, semble contempler un champ de ruines. Difficile, je crois, d’aller plus loin dans la dénonciation de l’impasse où se sont engouffrés les artistes depuis cinquante ans et plus.
Plus radical que Christopher Lasch, tu meurs.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : christopher lasch, le moi assiégé, narcissisme, éditions climats, art contemporain, william burroughs, jg ballard, robert rauschenberg, andy warhol, roy lichtenstein, claes oldenburg, jasper johns, robert morris, clement greenberg, marcel duchamp, ready-made, campbell soup, outre-noir soulages, bleu klein, jeff koons, françois pinault, walter benjamin, pop art, op art, art conceptuel, andré breton, surréalisme, sol lewitt, guy debord, la société du spectacle
dimanche, 07 décembre 2014
L’ART CON AU MUSÉE
2
J'ai décidé de ne plus parler d' « Arcon », mais d'appeler les choses par leur nom. Je parlais de Jeff Koons, homme d'affaires. Chef d'entreprise. Dans l'industrie, où l'on sous-traite beaucoup, il paraît qu'on appelle ça un « donneur d'ordre ». Je trouve que ça lui va bien.
Toujours est-il que c’est cet « artiste » qui, après avoir envahi Versailles de ses « Balloons » et autres homards, se voit célébré par le Centre Pompidou, qui consacre une grande « rétrospective » à toute l’œuvre du grand homme. D’après le directeur de l’institution, Jeff Koons et toutes ses équipes (si, si !) se sont comportés en grands « professionnels ». Je n'en doutais mie. Toutes mes félicitations néanmoins.

Il paraît que c’est l’ « artiste » le plus cher du monde. Grand bien lui fasse. Mais pourquoi vouloir à tout prix être considéré comme un artiste ? Andy Warhol nous avait en son temps fait le même coup, alors que toute l’industrie warholienne repose sur son envie dévorante de gagner beaucoup d’argent. Ce qui n’était pas totalement le cas de Marcel Duchamp, son grand-père artistiquement génétique. S'il n'était pas dénué d'esprit de lucre (dame, il faut bien vivre !), du moins ne l'affichait-il pas de façon aussi ostentatoire (« décomplexée » serait plus dans l'air du temps).

Wim Delvoye : "œuvre" sortie de sa machine à caca (Cloaca).
Jeff Koons est encore plus cynique qu’Andy Warhol. Au départ, cet étudiant doué pour les chiffres et les opérations boursières se présente sur le marché du travail comme un « trader ». Ce qui, en anglais, signifie « commerçant ». Son métier ? Courtier (« adviser » ?) en matières premières sur la place de Wall Street. Je ne sais pas si l'image ci-dessous est en mesure de confirmer cette assertion de l'encyclopédie en ligne. Si la dame, après tout ne fait que son métier d'actrice porno, qu'en est-il du métier du monsieur ? Il n'a visiblement pas toujours sous-traité les tâches de réalisation. Sa façon de mettre la main à la pâte, peut-être ?

C'est bourré de concepts ? Fallait le dire !
Au moment où il se dit que le marché de l’art offre des perspectives incomparables de spéculations financières fabuleuses, ce n’est pas que l’art l’intéresse, c’est qu’il a des idées à vendre. S’il se lance dans l’art, c’est juste parce qu’il y voit un « vecteur privilégié de merchandising ». C’est tout. C'est lui qui le dit.

Un monochrome avant la lettre d'un nommé Alphonse Allais.
Il se souvenait qu’Andy Warhol lui-même avait acheté l’idée de la « Campbell Soup » à une copine galeriste. Pour faire du pognon avec un truc qui ne dépasse pas le niveau "Arts Déco". Mais Warhol n’avait pas d’idées, et il fallait amorcer la pompe. C'est lui qui disait que c'est trop difficile, de peindre. Koons, lui, il en a, des idées. Le premier « coup » de Jeff Koons, c’est évidemment la Cicciolina, l’actrice porno, qu’il va même jusqu’à épouser. Et la rédemption, ça marche ! Tout le monde marche.

On me dira qu’il y a eu un marché de l’art dès qu’il y a eu civilisation. On me dira que les milieux de l’art, dès le premier moment de leur existence, ont connu les opportunistes les plus éhontés, les plus cyniques. On me dira que les plus grands artistes ont eu besoin des puissants, de leur « protection », de leur argent pour « laisser libre cours à leur art ».
Certes, je ne dis pas que c’est faux. Simplement, je trouve horriblement moche d'en être arrivé à une civilisation capable de donner honte à quelques-uns d'y appartenir. Et d'en être un produit. Peut-être un déchet.
Quelle est, en dernière analyse, dans le corpus hautement signifiant d'une contemporanéité progressiste soucieuse, de ce fait, d'exprimer, dans ses visions fulgurantes, l'âme future de l'humanité, la fonction sémiologique des prouesses amoureuses, supposées ou réelles, de Jeff Koons ?

Maurice Tillieux adorait l'art contemporain.
Faudra-t-il considérer ses éjaculats sur la face extasiée (?) de la Cicciolina comme l'insémination prémonitoire d'un avenir radieux dans le ventre d'une modernité qui attendrait d'enfanter on ne sait quel monstre ?

Certains "concepts" sont comme le camembert. Quand ils sont trop mûrs : ils coulent.
Les activités de ce petit monsieur, sûrement un excellent homme d'affaires, ne cherchent même pas à se donner le prétexte de « faire de l’art ». Seulement de l’argent. Le reste est une histoire de « Storytelling ». Et de « merchandising ». Mais il prétend mordicus au statut d'artiste.
Au royaume des « Bonnisseurs de la Bath » (= "bonimenteurs", c'était le patronyme donné à OSS 117 par son inventeur Jean Bruce), les Koons, McCarthy, Delvoye, Hirst et compagnie sont rois.
A voir ce dont sont grosses les prémonitions de l'avenir radieux, je ne suis pas près de quitter les rangs des diplodocus et des ptérodactyles : j'aime bien comprendre ce qu'on me dit quand on s'adresse à moi. Et j'en ai assez des bonimenteurs.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : à part Gaston Lagaffe (Franquin, Le Géant de la gaffe, p. 51) et Libellule (Maurice Tillieux, Popaïne et vieux tableaux), je précise que j'ai trouvé les illustrations en errant et tâtonnant sur la "toile".
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, art contemporain, jeff koons, mécène, françois pinault, palazzo grassi, château de versailles, koons à versailles, balloon dog, rétrospective koons centre pompidou, andy warhol, marcel duchamp, wim delvoye, pornographie, la cicciolina, alphonse allais, campbell soup, oss 117, paul mccarthy, jean bruce, damien hirst
samedi, 06 décembre 2014
L’ART CON AU MUSÉE
1
Forcément catalogués parmi les fossiles les plus archaïques des âges paléo-anthropiques, où les artistes et autres inventeurs de nos paysages se souciaient d’en fabriquer les éléments pour l’agrément, le bonheur et le plaisir des hommes qui vivaient là, mes pauvres yeux préhistoriques demeurent étrangement, quoique violemment, incrédules devant les extravagances qui surgissent en rangs toujours plus serrés des cerveaux d’individus royalement rémunérés par ce qui se fait de plus riche sur la planète.

L'ex-courtier en matières premières à Wall Street, Jeff Koons et son patron, le richissime François Pinault, autour du buste intitulé "Jeff et Ilona" (Ilona est le vrai prénom de l'actrice porno "Cicciolina"). Photo peut-être prise au Palazzo Grassi à Venise, propriété de monsieur Pinault.
Il paraît qu’il convient de les appeler - quand même - « artistes ». Cela me laisse sur le cul, mais admettons que ce soit « l’époque qui veut ça ». Une époque qui ne cesse de donner des raisons de la haïr. Dernièrement, la dite époque nous a offert « l’affaire Paul McCarthy », du nom de « l’artiste » qui avait planté une chose verte en pleine place Vendôme, et dont il avait emprunté le dessin aux fournisseurs d’ustensiles des amateurs de sodomie.

Une "Très Grosse Commission" de Paul McCarthy (que les gens viennent quand même photographier).
Un éditorialiste du Monde était allé jusqu’à traiter de « crétins » les diplodocus et ptérodactyles qui avaient osé apporter la preuve, en rendant au « monument » la platitude qu'il n'aurait jamais dû quitter, que bien des « œuvres » de « l’art contemporain » ne sont, comme la baudruche, que de la gonflette, tout juste dignes de ces salles où des corps d’hommes (et de femmes) se gavent de clenbutérol, stanozolol et autres joyeusetés moléculaires anabolisantes, dans le but de faire mieux que Schwarzenegger, dans leur miroir qui n’a pas mérité ça. Il faut choisir : c’est ça ou le compresseur d’air.

Mesdames, avouez : ça vous fait envie ?
Nous qui savons que tout époque produit les œuvres d'art qu'elle mérite, avons-nous besoin de ces « artistes » pour comprendre que l’époque présente est, dans ses grandes lignes et dans bien des détails, à vomir, à déféquer, à expulser comme les urates de n’importe quel docteur Faustroll qui s’ignore, même si, contrairement à l'original, la plupart des gens ne le font pas dans un « as » (chapitre "Du bateau du Docteur, qui est un crible", c'est dans la bible de la 'Pataphysique) ? Si c’est là le « message » de Paul McCarthy, je me permets de le trouver tout à fait niaiseux. Quoi ? Tout ça pour "ça" ?

Un "Balloon Dog", façon Jeff Koons, mais de Paul McCarthy, et bien arrimé au sol, de peur qu'il rejoigne la stratoshère.
Dommage, d'ailleurs.
De graves « critiques d’art », de dignes « intellectuels » auront beau me prouver par a + b que je n’ai rien compris et que c'est moi qui suis affligé du même QI que le pétoncle, je persisterai dans mon aveuglement : que peut bien procurer au spectateur sa représentation de Blanche-Neige (ou qui que ce soit) en train de faire caca devant les animaux de la forêt ?

C'est qui, déjà, qui avait détourné une couverture de livre pour enfants ?

C’est sans doute moi qui suis irrémédiablement bouché. Je me rassure en me disant que des « œuvres » qui ont besoin de tout un volume imprimé sur papier bible pour expliquer et justifier leur nécessité doivent être décidément bien minces d’intérêt pour être remplacées par de si savantes logorrhées, plus conceptuelles qu'argumentatives.
Au moins, Jeff Koons, anticipant sans doute les agressions inqualifiables qui ont anéanti la chose verte de McCarthy, a conçu des œuvres « en dur ». A ceux qui se méprendraient, je dirai de se méfier : ne faites pas comme Prunelle, quand il veut essayer le « fauteuil de cuir fin » imaginé par Gaston Lagaffe pour la Fédération de boxe et qui se fracasse le crâne sur le prototype en plâtre armé.

Une histoire qui fait pendant à celle (vraie) de cette femme de ménage consciencieuse employée dans un musée allemand qui, croyant faire son boulot, a détruit une « œuvre d'art » en nettoyant un canapé sali exprès par l'artiste. Vous avez sûrement entendu parler. Après vérification, c'est une femme de ménage qui a détruit une œuvre (fait disparaître la patine) de Martin Kippenberger en récurant le récipient en caoutchouc, baptisé "Quand des gouttes d'eau commencent à tomber du plafond", qu'il exposait à Dortmund. L'œuvre était assurée pour 800.000 euros.
Quoi qu'il en soit, je me dis qu'après tout, ça existe peut-être, la "justice immanente".
Car Jeff Koons, lui, a conçu ses « Balloons » en acier, que ce soient des fleurs, des lapins ou des chiens, et pour parfaire l’illusion, il a exigé un « poli miroir » qui suscite l’admiration. Ça nous change de l’exhibition pas si lointaine (1991-1992) de ses galipettes sexuelles avec Ilona Staller, alias « la Cicciolina », l’actrice porno qu’il avait épousée. Jeff Koons, ou la pornographie érigée en œuvre d'art. Mieux : la pornographie élevée à la dignité de concept (vous connaissez sûrement, "nommé", "promu", "élevé à la dignité de" : on appelle ça la "Légion d'Honneur").

Peut-être avait-il invité, en plus des amis, quelques caméras pour immortaliser leur nuit de noces, et quelques micros pour enregistrer les sons de leurs orgasmes. S’agissant de sexe, certains n’hésiteraient pas à parler de « perfomance », bien que le terme, s’agissant d’art, prête aujourd’hui à confusion (contamination de l’anglais « to perform »).

Ce qui s'appelle "faire argent de tout". Et surtout de n'importe quoi. Vérifiant l'adage qui dit que "l'argent n'a pas d'odeur". Ici, ça vaut mieux.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, peinture, sculpture, jeff koons, françois pinault, la cicciolina, paul mccarthy, journal le monde, schwarzenegger, culturisme, stéroïdes anabolisants, balloon dog, franquin, gaston lagaffe, pornographie
mercredi, 29 octobre 2014
UN « CRÉTIN » PARLE AUX « CRÉTINS »
On me dit que je caricature et généralise quand je parle des Puissants, des Décideurs, des « élites dévoyées ». Eh bien demandez donc à l'éditorialiste du Monde de ne plus me traiter de "crétin". Qu'il retire ses propos et qu'il fasse des excuses. On a sa dignité : il n'avait qu'à pas commencer. Et puis d'abord, c'est celui qui le dit qui l'est.

Mais voyons, monsieur, « élites dévoyées », il ne faudrait pas généraliser. Il ne faudrait surtout pas que les « élites dévoyées » se sentent stigmatisées. On en arriverait vite, rendez-vous compte, au « Tous pourris ! » qui « fait le jeu du Front National », n’est-ce pas. Le problème, c’est que je caricature, mais à peine. Eh bien ce n’est pas l’Editorial du Monde du 22 octobre (Place Vendôme, le créateur et les crétins) qui me convaincra du contraire. Au contraire.
Quand un homme ne sait plus quoi faire de son argent, comme je le disais, il le jette par les fenêtres. Il fait comme les pays pauvres ou en guerre (de préférence les deux), qui jettent dehors, et de préférence à la mer, toutes leurs populations superflues. Cela donne quelque chose qui s’appelle « N’importe quoi ». Et j’ajoute : « Pourvu que ça fasse de la mousse ». Surtout s’il trouve un Décideur complaisant, d’accord avec lui pour décréter : « Tout est permis », et à apposer sa signature au bas de l'autorisation. Plus qu'à poser le "plug anal" en pleine place Vendôme.
Les gens situés à proximité plus ou moins immédiate des bureaux sur lesquels on pose les papiers sur lesquels les « décideurs » sont invités à apposer le graffiti ou l’arabesque à l’encre de leur signature par des larbins distingués qui sortent des Grandes Ecoles, ces gens, dis-je, composent un potager et une faune qui, à force de grandir dans des serres séparées et d'être conservés dans des bocaux bien à l’abri du « plein champ » où prospère l'épaisse rusticité du « vulgum pecus », se font de celui-ci une idée aussi virtuelle que les images des jeux vidéo grâce auxquels ils prennent quelques moments de détente, entre deux stress insoutenables, là-haut, tout en haut de l’échelle.
Puissants (détenteurs de l’argent privé) et Décideurs (détenteurs de la signature publique) ont donc adopté ce qui se fait de mieux dans le domaine de l’Art et de la Culture en matière de contestataires, réfractaires, insoumis, dissidents, marginaux, déviationnistes, provocateurs, immoralistes, subversifs, anticonformistes, anarchistes et j'en oublie sûrement.
Il est convenu dans le cahier des charges qu'il faut être dérangeant, déstabilisant pour ces étranges bestioles appelées « les gens », dont on décrète qu'ils sont pris dans des routines morales, lieux communs intellectuels, idées toutes faites et autres stéréotypes qu'il s'agit de faire voler en éclat, pour les rendre à la pureté de ... de quoi, au fait ?
C'est fou, quand on y pense, le nombre de gens de Spectacle et d'Art qui ont pour but d'agir sur le spectateur, le plus souvent en le mettant mal à l'aise, en l'obligeant à se remettre en question, en le tourneboulant, désorientant, abasourdissant. Comme on est à Lyon, j'ajoute "badibulguant". Tous ces gens sont d'un altruisme terrifiant et dévastateur. Jamais les "bonnes intentions" n'ont commis pareils dégâts. C’est à qui dénichera son Poseur de Bombes personnel, qu’il comblera de ses bienfaits s’il consent à poser celles-ci dans son musée personnel.
Damien Hirst et Jeff Koons se tirent la bourre pour savoir qui sera le mieux coté. Les nouveaux académiques pontifiants Daniel Buren ou Bertrand Lavier jouent les fripons, sans doute pour faire plus jeunes. Anish Kapoor s’en donne à cœur joie au Grand Palais, sans doute pour ne pas empiéter sur les plates-bandes versaillaises de Takeshi Murakami. Dans le fond, Paul McCarthy, dans ce paysage, fait figure de « Petit Bras » (je suis en cela d’accord avec monsieur Dagen, du Monde, si j’ai bien lu).
On a compris que, quoi qu’il arrive, aucun artiste digne de la Modernité ne saurait advenir sur le Marché de l’Art s’il ne commet aucune profanation. Il arrive que Puissants et Décideurs tolèrent qu'il se contente de proposer du "Jamais Vu", mais même le "Jamais Vu" doit rester exceptionnel. Car le sacrilège et le blasphème sont des laissez-passer magiques. Du « Piss-Christ » d’Andres Serrano à la Crucifixion d’une femme par Bettina Rheims, par exemple.
Et l’ « artiste », le commanditaire et le mécène sont aux anges quand l’œuvre exposée a la joie ineffable et le bonheur sans mélange de se faire vandaliser. Quand l'artiste est arrivé à appuyer sur le bon bouton, celui de la fureur vindicative des "Crétins", qui n'attendaient que cette occasion pour passer à l'action. Quand l'étincelle de la provocation a remonté toute la longueur de la mèche, jusqu'au tonneau de poudre.
Si le scandale n’est pas au rendez-vous, c’est que la mèche de la bombe était mouillée. Hernani, Pelléas, Le Sacre, Ubu, Déserts, tous les directeurs de salles rêvent de ces échauffourées merveilleuses, de ces émeutes ébouriffantes, de ces soulèvements délicieux, de ces batailles épiques en smokings et robes de soie dont on parle encore cent ans après, et plus.
« Encore raté », s’écrie alors, rageur, ce colonel Olrik de l’Art Contemporain, « mais je reviendrai, je me vengerai, je l’aurai, mon scandale ». Le scandale est désormais un investissement ; faire scandale est un but de guerre : tout doit être pensé pour l’atteindre, et d’abord le thème. La religion, le sexe sont des « créneaux porteurs ». Il y a aussi le caca : successeur de Piero Manzoni et de sa « Merda d’artista » (1961), Wim Delvoye s’est illustré avec sa féconde série (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009) des « Cloaca » et autres « machines à caca ». Il a aussi tatoué des cochons, et même le dos d'un certain Tim Steiner, dont la peau, qui a été vendue 150.000 euros en 2008, sera définitivement acquise par son acheteur à la mort de son porteur et possesseur. Furieusement excitant, n'est-il pas vrai, très chère ?
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme les œuvres d’art et expositions, les pièces de théâtre et spectacles de danse dont les médias parlent le plus sont ceux qui portent l’étendard de la « Transgression ». C’est au metteur en scène qui « transgressera » le plus, le mieux et le plus radicalement : la concurrence est impitoyable. Cette vogue a gagné la mise en scène d’opéra. Au point d'en être devenue d'un terrible conformisme. Je donne même une idée : le fin du fin serait de dénuder sur scène des très vieilles et des très vieux, des très laids et des très obèses, que sais-je, des très fous sortant de l'asile et des très dangereux évadés de prison, bref la fine fleur de ce qui se fait en matière d'apparences repoussantes. Le pied, je vous dis pas !
La parole est au « transgresseur » : acteurs à poil sur la scène pour un oui ou pour un non, défécations et mictions, corps dénudés couverts d’on ne sait quelles déjections et autres contenus de poubelle. Aujourd’hui, c’est bien simple, un jeune n’arrive à rien s’il ne transgresse pas. Sinon, il sera considéré comme anormal. C’est un principe hors duquel il ne saurait trouver le salut.
Qu’on se le dise : la transgression est devenue la norme. Les gens normaux sont devenus inadmissibles. Il n'est plus normal d'être normal. Une bonne partie de la Culture actuelle crie : « A bas les gens normaux ». C'est bien simple, ils sont atteints d'un insupportable « conservatisme », quand ils ne sont pas carrément des « réactionnaires », des « crétins », des « fachos ». La Révolution des valeurs est en marche qui, tel Saint Jean-Baptiste annonçant la venue du Messie, nous prépare à la « post-humanité ». Amen.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, arts, art contemporain, front national, paul mccarthy place vendôme, france, société, damien hirst, jeff koons, daniel buren, bertrand lavier, anish kapoor, takeshi murakami versailles, piss christ andres serrano, bettina rheims, colonel olrik, piero manzoni, wim delvoye, merda d'artista, delvoye cloaca, machine à caca, tim steiner
dimanche, 26 octobre 2014
UN « CRÉTIN » PARLE AUX « CRÉTINS »
Ce billet fait suite au Manifeste du « Crétin », paru ici il y a quelques jours, titre motivé par celui d’un éditorial du journal Le Monde. J'aurais bien intitulé "Les Crétins parlent ...", mais comme je suis tout seul, ... Tant pis pour le rythme de la phrase, avec sa syllabe "-ent" et sa liaison en plus, à la musique desquelles notre oreille est habituée (vous savez, point-point-point-trait, "ici Londres", etc.).

Je chantais donc le cantique des rebutés de sa Majesté la Modernité, jugés inaptes à l'Art : « Je suis crétin, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien ».
Ce qui m’intrigue, dans l’ « affaire Paul McCarthy-plug anal-place Vendôme », c’est qu’il s’est produit une drôle d’inversion de processus, depuis le premier « ready-made » de pépé Marcel, en 1913. Papy Duchamp, lui, avec sa roue de bicyclette sur un tabouret, il voulait « faire œuvre » (ensuite avec sa « fontaine », son hérisson porte-bouteilles, ses trois « stoppages étalons », tout l’usinage de ses « moules mâliques », sa « broyeuse de chocolat », son « pendu femelle », ses « témoins oculistes », tout ça pour dire qu’on connaît un peu ses classiques …) tout en restant radicalement en dehors du domaine officiel et réservé de l’art, de l’académie, tout ce qu’on voudra.
Commençons par signaler que les gens d’alors, comme prévu, réagissaient comme les gens d’aujourd’hui. Il y avait, dans toute la démarche de Marcel Duchamp un puissant moteur anarchiste, asocial, voire nihiliste qui tirait avec violence tout son autobus (sa « boîte-en-valise ») hors du consensus qui fait la vie collective, hors du champ institutionnel, à commencer par l’Institution du Travail. Les gens avaient une bonne perception de ce nihilisme et de sa haine de l’ordre établi, et lui rendaient bien ses intentions. Tout allait bien, la logique était respectée : le marginal par choix d'un côté, les gens normaux de l'autre, cahin-caha, vaille que vaille.
La différence avec autrefois, elle vient des autorités. Eh oui, c'est elles qui ont pris un virage à 180°. Quand elles levaient les bras au ciel en criant « au fou l’artiste ! », elles hurlaient avec la foule. Aujourd’hui, on assiste à cet incroyable retournement de situation : ce sont les autorités (artistiques, culturelles, politiques, …) qui hurlent contre la foule (on me dira que c'est un groupuscule d'exaltés extrémistes) qui dégonfle le godemichet vert de la place Vendôme, « au fou la foule ! », en « condamnant fermement des actes inqualifiables » commis par des « fascistes », des « réactionnaires », des « mongoliens », bref des « crétins », comme dit souverainement Le Monde.
Aujourd’hui, qu’on se le dise, l’Anarchiste et Nihiliste anti-social, le vaguement escroc, farceur et mystificateur Marcel Duchamp (marchand du sel, comme disait lui-même cet amateur de contrepèteries et autres jeux de mots) a été bombardé Ministre de la Culture. Et son premier décret porte en toutes lettres cette affirmation définitive, au sujet de son « Grand Verre », alias La Mariée mise à nu par ses célibataires, même : « Désormais, la Culture, c’est ça !!! ». Je ne suis pas sûr qu'il ait ajouté « bande de nazes », mais le cœur y est. "Plug" anal compris : il avait bien exposé un urinoir, lui.
Aujourd’hui, pour son « apport décisif à l’histoire de l’art mondial et au rayonnement artistique de la France éternelle », François Hollande en personne a solennellement remis à Marcel Duchamp, le roi du « ready-made », vêtu pour la circonstance de son habit vert d’Académicien Français, la grand-croix de la Légion d’Honneur, dans la cour de l’Elysée, au cours d’une cérémonie grandiose bercée par les flonflons de la fanfare de la Garde Républicaine en grand uniforme, devant une armée de photographes et de cameramen venus du monde entier.
Blague à part, j’aimerais bien qu’on m’explique ce retournement de veste des Puissants. Mais aussi le retournement de veste des Anarchistes, Terroristes et Poseurs de Bombes de l’Art d'avant-garde, qui se sont convertis au métier servile de caniches de leurs Majestés les Puissants. Comment ont-ils fait pour troquer le rôle d'épouvantails et de croquemitaines contre celui de faire-valoir et de bouffons de Sa Majesté ? Comment les Autorités ont-elles pu accepter de faire entrer ces Loups dans la Bergerie Sociale ?
Je risque une première approximation de réponse : parce que nier le Système où règnent ces Puissants est devenu un « fromage ». Alors dis-moi pourquoi la Subversion du Système est devenue un « fromage » ? Parce qu'elle en est devenue un Aliment. Le Carburant de ce Système s'appelle en effet "Négation de soi", "Effacement des données identitaires", "Du Passé faisons Table Rase" (eh oui, aussi étonnant que ça paraisse, le refrain communiste est devenu un chant purement capitaliste).
Le Système a compris que l'Art est absolument inoffensif. La Subversion Politique c'est fini ! Vive la Subversion Idéologique ! La Subversion inoffensive de l'ordre établi par l'Art (et domaines connexes), qu'on se le dise, est devenue un moyen extrêmement prisé de gouvernement des masses. Le "plug anal" de Paul McCarthy place Vendôme a ça d'inscrit dans ses significations prioritaires.
Mais j'ajoute aussitôt qu'à la différence des "Bouffons de Sa Majesté", dont les saillies étaient censées corriger la trajectoire du monarque quand elle devenait erratique, les individus admis à jouer le rôle de "Grands Négateurs Institutionnels" récitent leur Manuel Officiel de la Subversion Permanente à l'intention exclusive du bon peuple, celui qui ne sait pas. Celui qui ne sait plus rien est ainsi appelé à consentir à la subversion permanente de ses propres valeurs, de ses repères, de son histoire, de son identité. A se soumettre à des institutions devenues elles-mêmes subversives. Il y a des exemples récents hors du domaine de l'Art, que les valets des Puissants s'empressent de classer parmi les Progrès décisifs de la Civilisation (je peux mettre les points sur les i si vous voulez).
Le "bon peuple" est celui que les nouvelles élites au service des Puissants ont pour charge de guider sur le chemin qui mène à la définition d'un Homme Nouveau et d'une Humanité Nouvelle. Il faut que cela se sache : le Puissant a désormais besoin du Négateur pour confirmer sa Puissance. Tout simplement parce que le Négateur, en produisant des objets qui manifestent aux yeux de tous la Négation de la Puissance, prouve que le Puissant est plus puissant que sa Négation même, puisqu'il lui ouvre ses portes et lui offre sa protection. C'est la raison pour laquelle Jeff Koons, Takeshi Murakami ou dernièrement Paul McCarthy sont des "Bouffons de Sa Majesté". J'espère que vous suivez.

Jeff Koons et François Pinault, posant lors d'une conférence de presse à Séoul, devant le buste en marbre représentant JK en compagnie d'Ilona. C'est sûrement pour d'excellentes raisons qu'ils se marrent.
Quand je dis « puissants », je renvoie à toutes sortes de gens, mais en premier lieu, évidemment, à ceux qui ont les plus gros moyens. M. François Pinault a dédié un des joyaux vénitiens à ce qui se fait de plus con et temporain dans l’arcon : le Palazzo Grassi. Pour faire pièce à ce grand rival dans la course au titre de « Français le plus riche », Bernard Arnaud (LVMH) a déposé (je suppose) un tas d’or suffisant au pied de Frank Gehry pour que celui-ci lui construise l’écrin rêvé pour ses collections de la plus grande classe. Le bon choix, le premier milliardaire venu vous le dira.

Gehry n’est-il pas l’immortel auteur de l’immeuble (ci-dessus) « Dancing House » de Prague ? Cela vous pose un homme. Ça a de la « patte », voire de la « cuisse ». C’est une « signature ». Walt Disney à Los Angeles, Guggenheim à Bilbao, maintenant la Fondation Vuitton à Paris : mieux qu’un grand chelem à l’ATP, plus fort que mettre tous les œufs dans le même panier, non seulement ça vous en bouche un coin, mais ça vous en colmate une fissure ! Ce brave philanthrope de Bernard Arnaud se voit décerner le label de « mécène respectable ». Pas comme ce pillandre (j’essaie de réhabiliter le patois lyonnais) ostentatoire de Pinault à Venise.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arts, art contemporain, paul mccarthy, plug anal place vendôme, marcel duchamp, ready-made, grand verre, la mariée mise à nu par ses célibataires même, journal le monde, jeff koons, takeshi murakami, bernard arnaud, françois pinault, palazzo grassi venise, fondation vuitton paris, frank gehry, guggenheim bilbao
mercredi, 19 juin 2013
ORWELL N'AIME PAS DALI

PÂTISSIER, PAR AUGUST SANDER
***
George Orwell donc. Et pas dans le maître-livre qui l’a propulsé au rang de superstar de la science-fiction. Je trouve personnellement que 1984, un chef d’œuvre, évidemment, est plus alambiqué, plus complexe et plus allégorique que La Ferme des animaux.
Nous sommes d'accord : 1984 va incomparablement plus loin et plus profond, et son propos ne se limite pas finalement au stalinisme qu'il dénonçait explicitement (l'expression « Big Brother » comme pastiche de  « Petit père des peuples »). Et puis de toute façon, j’ai envie de parler d’un autre aspect de l'activité de l'auteur, plus proche du journaliste qu’il fut. George Orwell a écrit des centaines de textes de natures très diverses. Ivréa et L’Encyclopédie des nuisances ont publié une partie non négligeable de ceux-ci, sous le titre Essais, articles, lettres. Une édition chronologique.
« Petit père des peuples »). Et puis de toute façon, j’ai envie de parler d’un autre aspect de l'activité de l'auteur, plus proche du journaliste qu’il fut. George Orwell a écrit des centaines de textes de natures très diverses. Ivréa et L’Encyclopédie des nuisances ont publié une partie non négligeable de ceux-ci, sous le titre Essais, articles, lettres. Une édition chronologique.
Quatre forts volumes. Environ 2000 pages. Je regarde ça, et je me reprends à espérer – oh non, pas dans l’humanité, rassurez-vous, simplement dans le courage et la ténacité d’éditeurs qu’on peut dire, pour le coup, indépendants. Je veux dire : libres. Et pour être en mesure de se dire libre, il faut avoir assez de coffre pour sacrifier quelque chose de soi. C’est Michel Noir, ancien maire de Lyon, qui déclarait : « Il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme ». Une phrase qui a de la gueule, ne serait-ce que parce qu’elle est rare. Editeur peut être un beau métier, si l’on fait ce qu’il faut pour que ça le soit et le reste.
Alors évidemment, il n’est pas question de résumer ici 2000 pages, à moins que le résumé ne tienne sur 2000 pages. Non, je voudrais juste donner une idée de ce qu’on peut y trouver, en évoquant tel ou tel sujet que George Orwell a abordé à l’occasion. Tiens, pourquoi pas L’immunité artistique : quelques notes sur Salvador Dali, qui date de 1944 ?
J’aime bien quand quelqu’un de l'envergure aquiline de George Orwell, planant dans les hautes couches de l'atmosphère, repère soudain au ras du sol un charogne à sa mesure et plonge de tout son bec et de toutes ses griffes sur ce vil escroc qui a réussi à faire croire qu’il révolutionnait la peinture. Je passe sur « Avida Dollars » (anagramme de S. D.) dont André Breton l’a habillé pour l’hiver. Reconnaissons-lui une vraie créativité si vous voulez, mais seulement jusqu’en 1935, dans le cadre du groupe surréaliste.
Après, il a juste fait du pognon, du pognon et encore du pognon. J’exagère sans doute, mais pas tant que ça. Le soin qu’il apportait à la mise en scène de soi-même (il se déclarait lui-même narcissique) me le rend tout à fait antipathique. C’est ce qui parvient peut-être à gâter la perception que je peux en avoir, même si, quoi qu’il en soit, il me semble qu’il a fait naufrage dans l’incongru et le tape-à-l’œil, dont il a fait commerce, en produisant à tire-larigot des images pieuses d'un nouveau genre, quasiment sulpiciennes à force d'être parfaitement léchées.
Orwell aborde Dali d’un point de vue un peu voisin, puisqu’il le regarde sous un angle moral, comme le laisse entendre le titre ci-dessus (qui n’est pas la traduction de l’original). Il relève son goût marqué pour « la perversité sexuelle et la nécrophilie », le « thème excrémentiel », note que Dali « se targue de ne pas être homosexuel », et conclut : « … mais à part cela, il semble détenir la plus belle panoplie de perversions dont on puisse rêver ». On ne saurait être plus net dans le reproche.
Enfin, quand je dis « reproche », tout cela est formulé (pour le moment) sans jugement : pour Orwell, qui se veut davantage objectif que moralisateur, les faits parlent d’eux-mêmes, et il n’a pas besoin d’en rajouter, même si la morale, ici, est le critère : « L’obscénité est un sujet dont il est très difficile de parler en toute sincérité. Les gens ont trop peur soit de paraître choqués, soit de paraître ne pas l’être, pour être en mesure de définir les rapports entre l’art et la morale ». Il écrit ça en 1944, et il meurt en 1949. Il n’a pas eu la chance d’admirer le gobelet d’urine de Ben (1962), la scène de pénétration de la Cicciolina par Jeff Koons (1992) ni la machine à merde de Wim Delvoye (2000).
En fait, le commentaire d’Orwell est suscité par la parution de l’ « autobiographie » (on ne sait pas trop) de Dali The Secret Life of Salvador Dali. L’artiste s’y vante de certaines dépravations, de certains actes sadiques et autres turpitudes. Je dirai qu’il « en remet ». Et le commentaire d’Orwell montre que, s’il avait été médecin, il aurait été célèbre pour la qualité de son diagnostic : il met le doigt là où ça fait mal. Il sait que les saloperies révélées par Dali dans le bouquin peuvent tout aussi bien être réelles que fictives. Ce qui porte un nom : complaisance dans le sordide.
Voici, in extenso, le paragraphe que je crois névralgique de l'étude d'Orwell : « Ce que revendiquent en fait les défenseurs de Dali, c’est une sorte d’immunité artistique. L’artiste doit être exempté des lois morales qui pèsent sur les gens ordinaires. Il suffit de prononcer le mot magique d’ « art », et tout est permis. Des cadavres en décomposition avec des escargots qui rampent dessus, c’est normal ; donner des coups de pied dans la tête des petites filles, c’est normal ; même un film comme L’Âge d’or [où l’on voit une femme en train de chier, selon Henry Miller] est normal. Il est également normal que Dali s’en mette plein les poches pendant des années en France, puis détale comme un rat aussitôt que la France est en danger. Dès lors que vous peignez assez bien pour être consacré artiste, tout vous sera pardonné ». Ce paragraphe, est-il utile de le préciser, me réjouit au plus haut point. Au passage, les lecteurs un peu assidus de ce blog auront goûté à sa juste valeur la répétition du mot « normal ».
Il dit encore quelques petites choses intéressantes : « Il est aussi antisocial qu'une puce. Il est clair que de tels individus sont indésirables, et qu'une société qui favorise leur existence a quelque chose de détraqué ». Et même des choses assez drôles : « Si vous dites que Dali, tout en étant un brillant dessinateur, est une sale petite fripouille, on vous regarde comme si vous étiez un sauvage. Si vous dites que vous n'aimez pas les cadavres en putréfaction, et que les gens qui aiment les cadavres en putréfaction sont des malades mentaux, on en déduit que vous manquez de sens esthétique ».
Sans se gargariser de formules brillantes, c'est avec sobriété qu'Orwell assène les coups de son bon sens sur la tête du reptile.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, littérature, george orwell, 1984, arts, peinture, salvador dali, la ferme des animaux, animal farm, ben, jeff koons, wim delvoye, cicciolina, andré breton, surréalisme, avida dollars, éditions ivréa, encyclodédie des nuisances
lundi, 10 septembre 2012
L'ART D'AGATHE DAVID (PREAMBULE)
Pensée du jour : « Achras : Ô mais, c'est qué - y a point d'idée du tout de s'installer comme ça chez les gens. C'est une imposture manifeste ...
M. Ubu : Une posture magnifique ! Parfaitement, monsieur : vous avez dit vrai une fois dans votre vie ».
ALFRED JARRY
Je signalais, il y a quelques jours en bas de page, l'exposition AGATHE DAVID qui a lieu depuis jeudi à la Galerie Gilbert Riou (1, place d'Ainay, mais l'entrée est située rue Vaubecour).

AGATHE DAVID est une artiste. Comme je les aime. Car, contrairement à tous les « artistes » figurant dans mon album « art con et temporain » (ci-contre, n’hésitez pas à découvrir 80 façons de tuer l'art, à m’engueuler, voire à mépriser le néandertalien que je suis éventuellement), AGATHE DAVID ne désespère pas de la création artistique. Cette rareté attire forcément l'attention et la curiosité.
C’est vrai, aujourd’hui, la plupart des « artistes » ont emboîté le pas à MARCEL DUCHAMP. S'il n'est pas en personne le meurtrier, il en est l’emblème et le héraut. Le porte-parole et le messager. Le ready made (ci-contre, la "roue de bicyclette")  a mis le point final au parcours millénaire de l’Art. Or le ready made, c'est l'appel de trompette après lequel il n’y a plus qu’à déclarer : « L’ART est mort ! Il est temps de vous repentir ! ». Pour la suite, voir l'Apocalypse de Jean.
a mis le point final au parcours millénaire de l’Art. Or le ready made, c'est l'appel de trompette après lequel il n’y a plus qu’à déclarer : « L’ART est mort ! Il est temps de vous repentir ! ». Pour la suite, voir l'Apocalypse de Jean.
Mais celui qui souffle dans la trompette (et la cohorte de ceux qui le suivent), en même temps qu'il sonne "Aux Morts", comme un 11 novembre ordinaire, ouvre un extraordinaire marché à toutes sortes d’hommes d’affaires. Certains protestent en vociférant : « TOUT EST ART ». Mais je rétorque : « Et alors ? Quelle différence ? ». Et toc ! C'est vrai, ça : si la réalité, la nature, nos objets sont de l'art, où il se trouve, l'art artistique ? Si vraiment tout est art, ça signifie juste que plus rien n'est art.
« Art con et temporain », donc : en plaçant JEFF KOONS à la porte d'entrée de l’album ainsi intitulé, en train de saillir (il n'y a pas d'autre mot, n'est-ce pas ?) sa femme, l’actrice porno CICCIOLINA, c'est une modalité de la mort de l'ART que je voulais illustrer.

On constate pourtant, éberlué, que le cadavre de l'ART a revêtu, depuis les « audaces » de DUCHAMP (1913 et après, avec l'invention du READY MADE, qu'il soit "aidé" ou non :  porte-bouteilles, "fontaine", stoppage-étalon, ... On en fête bientôt le centenaire, préparez-vous, il est temps de vous repentir), une infinité de cadavres bien vivants, dont l’énumération gonflerait inutilement cette modeste note.
porte-bouteilles, "fontaine", stoppage-étalon, ... On en fête bientôt le centenaire, préparez-vous, il est temps de vous repentir), une infinité de cadavres bien vivants, dont l’énumération gonflerait inutilement cette modeste note.
Il n’y a pas besoin d'un couple forniquant pour confirmer l’obscénité essentielle, pour ne pas dire la pornographie d’une bonne part de ce qu’il est convenu d’appeler « art » contemporain. Disons que cette copulation symbolise assez bien une des grandes tendances de l' « art » contemporain : j'ai nommé le FOUTAGE DE GUEULE. 
Il est peut-être bon de rappeler que JEFF KOONS a commencé comme « courtier en matières premières » à Wall Street, et que s’il a changé d’orientation « professionnelle », s’il s’est lancé dans l’art, c’est, je le cite : « en tant que vecteur privilégié de mechandising ». On n’est pas plus « honnête ». Il ne s’agit de rien d’autre que de « glorifier des produits de consommation ». Comme son prédécesseur et mentor ANDY WARHOL.
Disons le fond des choses : l’artiste con et temporain n'est en général qu'un pervers nécrophile, qu'une chair nécrosée congénitale. Il prospère sur le cadavre de l’Art, comme l’insecte nécrophage sur la dépouille animale gisant au bord du chemin :
« Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d’été si doux :
Au détour d’un sentier une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux,
Les jambes en l’air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,
Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d’exhalaisons ».
CHARLES B. (je vous laisse deviner)
Après la mort de l’ART, donc, voici l’ « art-mort ». Debout les morts, entendait-on dans les tranchées de 1914. Eh bien qu'on se rassure : c'est chose faite ! Et qu'on se le dise, le cadavre se porte comme un charme :
« On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague,
Vivait en se multipliant ».
Si GEORGES BRASSENS pouvait parler, il dirait : « On s’aperçut que le mort avait fait des petits ». Car après le second coup de grâce dans la nuque de l'ART, porté par ANDY WARHOL, le cadavre se met à vivre sa vie, pleinement, joyeusement et « artistement » : « J’ai commencé comme artiste commercial, je veux finir comme artiste d’affaires » (WARHOL).
DUCHAMP ayant rédigé l’acte de décès à coups de « ready mades », WARHOL pouvait introduire la dépouille mortelle de l’Art dans l’univers de la marchandise et de la publicité, et le marchand d’ « art-mort » commercialiser ses charognes « pleines d’exhalaisons ». Car je pense qu'on sera d'accord : il n'y a rien de plus mort qu'une marchandise. Pire : une marchandise érigée en être vivant.
Si vous n’avez jamais vu un cimetière en effervescence, prenez un billet pour Le Caire, où beaucoup de drôles de silhouettes, de jour comme de nuit, errent entre les tombes. Elles ont investi les caveaux et les pierres tombales. Les gens normaux s'interrogent. Les cimetières du Caire connaissent une belle animation, même si elle est encore honteusement minimisée par les tour opérateurs. Vous verrez qu’il n’y a pas plus vivant qu’un cimetière.
L’art contemporain, c’est pareil : un univers de ZOMBIES, de morts-vivants, qui s’activent, s’affairent, font des affaires, essaient de « percer ». Une seule solution : l'évacuation. Tirez la chasse. S'il n'est pas trop tard.
Une seule solution : l'évacuation. Tirez la chasse. S'il n'est pas trop tard.
A la rigueur, reportez-vous à Trou dans la couche d’os jaunes, dans  la série « Pierre Tombal », de HARDY & CAUVIN, éd. Dupuis.
la série « Pierre Tombal », de HARDY & CAUVIN, éd. Dupuis.
L'art con et temporain est plus mort-vivant que jamais.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre, AGATHE DAVID.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agathe david, art, dessin, exposition, galerie gilbert riou, lyon, art contemporain, marcel duchamp, andy warhol, jeff koons, cicciolina, pornographie, ready made, une charogne, baudelaire, georges brassens, campbell soup, zombie, mort-vivant, pierre tombal, hardy et cauvin, bande dessinée
jeudi, 07 juin 2012
LE MONDE, SUBVERSION DE SOI-MÊME
RÉSUMÉ : les critiques, dans toutes les disciplines de la création artistique (jusque dans le monde de la mode) crient au miracle et se rendent en longues processions dans les temples de la « Culture » pour se prosterner devant leurs grands prêtres, passés maîtres dans l’art de transgresser les règles admises, d’enfreindre les codes, de violer la morale, d’oser subvertir la société, de commettre des attentats contre l’ordre esthétique établi. Et pourtant, l’ancien monde n’a pas bougé, il est toujours debout. Comment se fait-ce ?
N’allons pas chercher la réponse trop loin. Tout ce petit peuple qui mange aux multiples râteliers des Arts et des Lettres, tous ces laborieux tâcherons, plus ou moins lumineux, tous ces « révolutionnaires » qui ne font la « révolution » qu’à condition qu’elle soit subventionnée par l’Etat, - l’impeccable parce qu’intellectuellement intègre PHILIPPE MURAY les assaisonne dûment, en leur accolant généreusement la formule, délicieuse et parfaitement exacte, de « MUTINS DE PANURGE » (tiens, revoilà Panurge, décidément, on ne se débarrasse pas de Panurge).
Et ce sont ces schtroumpfs qui déclarent que c’est eux qui changent le monde. Remarquez, BERNARD-HENRI LÉVY, dans son film Le Serment de Tobrouk, s’attribue bien la chute de KHADDAFI, pas à lui tout seul, mais pas loin ! Alors, au point où on en est.
Sur les scènes de théâtre, de danse, d’expositions, de « performances », venez braves gens, voyez défiler la longue cohorte des MUTINS grassement rémunérés, des INSOUMIS fonctionnaires, des DISSIDENTS en mission officielle, des REVOLTÉS conformes, des REBELLES uniformisés.
Leur profession de foi ? « En dehors » ! (A condition que ça reste confortable.) Remarquez, on a vu récemment se présenter à la présidentielle un candidat paraît-il « anti-système », copain du dit BERNARD-HENRI LÉVY, qui venait de passer cinq ans à l’Elysée. Comme il disait en 2007, SARKOZY : « Tout devient possible ».
Si, si, c’est possible, le mec du système qui devient anti-système du jour au lendemain. J’entends quelques-uns soupirer : « On a déjà tout vu ». Et moi, je rétorque finement : « Non, messieurs, s’agissant de propagande, vous n’avez pas encore tout vu ». Attendez la propagande « socialiste », avant de prononcer un jugement. J’espère qu’il ne vous faudra pas trop de « neutralité » pour avouer que vous avez méchamment déchanté.
Il suffit de savoir qu’on appelle aujourd’hui « subversion » ce qu’on appelait il n’y a pas si longtemps « conformisme ». C’est juste une question de vocabulaire, comme dans 1984 de GEORGE ORWELL. Il suffit d’appeler l’esclavage « liberté » pour que tout le peuple d’esclaves soit aussitôt déclaré « libre ». ORWELL appelait ça la « novlangue ». C’est un autre nom pour la « magie du verbe ». Certains appellent ça la « publicité ». Je trouve que c’est assez bien vu : l’inversion est une figure bien connu des publicitaires.
La VÉRITÉ vraie, vous voulez que je vous dise, c’est qu’aujourd’hui, plus rien et plus personne au monde n’est en mesure d’introduire la plus petite once de SUBVERSION dans l’ordre du monde. La vérité vraie, c’est que toutes les tentatives, tous les efforts de subversion de l’ordre établi effectués jusqu’à présent ont échoué, y compris et au premier chef la révolution « communiste », dont les piques ont fini par s’enfoncer dans l’édredon insondable de l’ordre du monde.
Et cela, pour une raison unique : si toute subversion de la société est devenue rigoureusement impossible, c’est que nous avons inventé la SOCIÉTÉ DE LA SUBVERSION. Notre société a accompli le tour de force d’adopter pour base et principe premier de fonctionnement la révolution constante, le bouleversement de tout à tout moment. Aujourd’hui, il est interdit de ne pas être « subversif ».
Le monde tel qu’il est organisé a fait de sa propre SUBVERSION le moteur même qui l’anime. Pour éliminer tout risque de destruction par des forces extérieures à elle, il s’est débrouillé pour intégrer dans ses fibres mêmes les forces de sa propre négation.
Pourquoi croyez-vous qu’un « puissant » comme Monsieur FRANÇOIS PINAULT dépense à plaisir beaucoup d’argent dans son immense Palazzo Grassi à Venise, pour abriter sa collection d’art « subversif » (qu’on appelle « art contemporain ») ? Pourquoi croyez-vous que Monsieur AILLAGON demande à des gens comme JEFF KOONS ou TAKASHI MURAKAMI de profaner le site historique de Versailles avec leurs déjections excrémentielles, ostensiblement encensées ?
C'est pour ça qu'il ne saurait plus y avoir de « menées subversives » dirigées contre l'ordre établi, puisque l'ordre établi est précisément établi sur la subversion en action, la subversion permanente. Il est là, le nouveau conformisme.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre dans quelques jours.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : conformisme, anti-conformisme, philippe muray, mutins de panurge, bernard-henri lévy, le serment de tobrouk, khadafi, nicolas sarkozy, george orwell, 1984, françois pinault, jean-jacques aillagon, versqailles, jeff koons, takashi murakami, palazzo grassi
mercredi, 06 juin 2012
DE LA SUBVERSION EN MILIEU CULTUREL

N'EST-CE PAS QUE C'EST DERANGEANT ?
Vous avez entendu, le critique de théâtre enthousiaste, qui chantait les louanges de tel spectacle en Avignon où des acteurs pissaient sur les premiers rangs de spectateurs : « Quel sens admirable de la transgression ! » ? Vous l’entendez, le critique de cinéma, encore terrassé par la violence des émotions ressenties lors de la projection de Crash : « Jamais on n’avait osé aller si loin dans l’ébranlement des conventions ! » ? Et de louer dans la foulée le pouvoir de subversion exercé par l’œuvre.
Dans quelque direction de la « création culturelle » que vous tourniez votre regard, c’est à qui s’extasiera de la façon la plus spectaculaire et bruyante face au « bouleversement de tous les codes », face aux « infractions radicales ». C’est à qui criera au génie (forcément dérangeant) d’un DAMIEN HIRST (l’homme au crâne humain orné de plus de 8000 diamants), d’un JEFF KOONS (l’homme qui copulait en photo avec la CICCIOLINA, mais aussi l’auteur de l’outrage d’aspect gonflable fait à Versailles, à l'invitation de Monsieur JEAN-JACQUES AILLAGON). Il paraît que ce sont eux qui font la révolution.

Enfin bref, le commentaire obligé, aujourd’hui, dès que l’on parle de peinture, d’art, de musique, de danse, de théâtre, de cinéma, de tout ce que vous voulez qui soit de la « création esthétique », c’est la couronne de laurier tressée autour de l’auguste tête de l’artiste qui saura se montrer le plus « subversif », le plus « révolutionnaire ». « Défilé de mode révolutionnaire, je vous reçois fort et clair. Parlez. » Je ne sais pas si vous avez remarqué : si un artiste n’a pas l’ambition d’être SUBVERSIF, il est catalogué comme intolérablement conformiste.
Les mots sacrés que tout ce monde a à la bouche sont SUBVERSION, TRANSGRESSION. Tout, dans ce monde, n’est que DESOBEISSANCE et INSOUMISSION. Pour un peu, c’en deviendrait presque drôle. Surtout quand on regarde la définition du mot « subversion » : « action de renverser l’ordre établi ». A entendre les LAURE ADLER, les FRANÇOIS ANGELIER, enfin tous ceux qui confisquent à leur seul profit le rôle de « prescripteurs culturels », l’ordre établi ne cesse d’être renversé, badibulgué, mis cul par-dessus tête.
Bref : guillotiné. Les multiples expressions artistiques contemporaines ne cessent, jour après jour, de séparer le corps du roi Louis XVI de sa tête et d’instaurer un « ordre nouveau », destiné à régénérer l’homme social : « Après le Piss Christ d’ANDRÈS SERRANO, vous serez des hommes neufs ». La règle observée par ces gens, en la matière, est importée tout simplement de l’intégrisme bolchevique le plus pur : « Du passé faisons table rase », chantent ces enfants de chœur d’un nouveau genre.
A les entendre, tout ne serait, dans tous les « événements culturels » qui se produisent, que 11 septembre 2001, tsunami de Sumatra de 2004, tsunami du Japon de 2011, tremblements de terre d’Italie de 2012. Les colonnes de nos temples de la Culture, à force de vaciller sur leurs bases à cause des sols successifs qui se dérobent sous elles, devraient être par terre depuis belle lurette. « Etonnant, non ? », comme disait PIERRE DESPROGES dans La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède.

Oui, on est étonné qu’il subsiste, de l’ordre établi (forcément honni), vaille que vaille, autre chose et davantage que deux ou trois pierres l’une sur l’autre. Normalement, avec toutes les destructions qu’il a subies, l’ordre établi (forcément détesté et détestable), jour après jour, sous les coups de boutoir de tous les héros (« sublimes, forcément sublimes », comme disait MARGUERITE DURAS, jadis, à propos d’un crime) de la subversion artistique du monde, nous devrions normalement nous retrouver comme les survivants de Dresde au soir du 15 février 1945 après le bombardement de la ville par les Forteresses volantes B 17 de l’USAF et les Avro Lancaster de la RAF (15.000 morts).

Nous devrions être devant un paysage intégralement détruit. Or il n’en est RIEN. Toute la société désespérément ancienne est restée désespérément DEBOUT (enfin, c’est l’impression qu’on a). Je pose la question :
« Comment se fait-ce ? »
Réponse demain.
Voilà ce que je dis, moi.
09:01 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théâtre, festival d'avignon, cinéma, danse création culturelle, critique de cinéma, damien hirst, jeff koons, art, peinture, sculpture, la cicciolina, laure adler, françois angelier, piss christ, andrès serrano, louis 16, 11 septembre 2001, tsunami, pierre desproges, marguerite duras, bombardement de dresde
lundi, 24 octobre 2011
PEINTURE : ELOGE DE GERARD TITUS-CARMEL
Parlez-moi, si vous voulez, de GERARD TITUS-CARMEL, bien qu’il soit beaucoup moins confidentiel. Sa peinture (parce que, figurez-vous, il fait de la peinture) est celle d’un INDIVIDU. J’ai découvert les dessins de GERARD TITUS-CARMEL dans le volume des Actes d’un colloque qui s’est tenu en 1970 à Cluny (p. 86 et suivantes). Quelques-unes des 25 Variations sur l’Idée de Rupture. Des dessins d’une netteté de scalpel. Des tiges (en métal ?) attaquées par des forces adverses, soit torturantes, soit entaillantes, soit bourgeonnantes, etc. Enfin, tous les genres de déformations qui peuvent s’attaquer au lisse de l’objet sorti de la perfection manufacturière.
J’ai connu un excellent poète (un peu hermétique, hélas) du nom de JACQUES DUPIN. Son gagne-pain, s’il est vrai que les poètes aussi doivent manger, consistait à administrer la galerie LELONG, 13, rue de Téhéran à Paris, dans le 8ème arrondissement. Une galerie abritant un certain nombre d’artistes considérables, comme PIERRE ALECHINSKY, le déjanté BARRY FLANAGAN, professeur agrégé de lapins en bronze qui, je crois, a quitté ce monde, ERNEST PIGNON-ERNEST, PAUL REBEYROLLE ou ANTONI TAPIES, pour citer mes préférés.
LELONG avait sous contrat (et peut-être encore) GERARD TITUS-CARMEL. Au fait j’avais oublié de préciser que l’un des vins préférés de JACQUES DUPIN était le Saint Joseph, si j’en crois un repas pris au restaurant, à présent disparu, « A Bon vin point d’enseigne ». J’ai toujours le bouquin absolument formidable de ses (pas DUPIN, mais TITUS-CARMEL) dessins 1971-1979 (Editions Maeght). Je vous jure, sa fascination pour les diverses manières dont la matière pure se dégrade est elle-même fascinante. Ce qui est merveilleux, ici, ce ne sont pas les textes, estimables (entre autres GILBERT LASCAULT, pas le premier venu), mais les dessins.
On y voit « 20 variations sur l’idée de détérioration », « 17 exemples d’altération d’une sphère », « 7 démontages » : je pense en les regardant au travail qu’on demande au peintre dans les livres de botanique et de zoologie. Vous savez qu’une photo de fleur ou d’animal, censée représenter fidèlement son objet, n’arrivera jamais à la cheville de ce travail du peintre. La faiblesse de la photo, c’est qu’elle ne saisit qu’un seul moment, une seule lumière, un seul contexte. Dans la réalité, impossible de retrouver quoi que ce soit sur la base d’une photo.
Le dessin et la peinture qui, faisant figurer TOUTES les informations nécessaires sur l’illustration, synthétisent tout ce qu’il faut savoir de la Centranthe rouge, de la Picride fausse Vipérine ou de la Lysimaque des bois, sont incomparablement, infiniment supérieurs pour vous apprendre à vous y retrouver. La photo, c’est l’instant isolé. Le dessin, la peinture de la chose, c’est la permanence, la quintessence de la chose, un peu de son éternité. Rien à voir.
Eh bien GERARD TITUS-CARMEL possède cet ordre d’exactitude et de précision scientifiques. Impossible de vous tromper : quand vous tomberez sur une sphère dégradée, ce qui ne peut manquer d’arriver, n’est-ce pas, ce sera forcément un dessin de G. T.-C. Un conseil, gardez-le précieusement. J’ai fait il y a longtemps la bêtise de ne pas m’endetter pour acheter quelques œuvres qui étaient montrées rue Auguste-Comte. Je m’en mords encore les doigts. Remarquez, j’ai fait la même bêtise dans la même rue, s’agissant de linogravures de JEAN-MARC SCANREIGH, mais aussi à la galerie « L’œil écoute », pour un fabuleux tableau de SERGE PLAGNOL, alors … Si ce n'est pas de la récidive, ça...
C’est la même précision et la même exactitude qui commandent aux « Démontages », aux « Déambulatoires », avec toujours le souci de marier en les distinguant à l’extrême les matières (bois, métal, ficelle, chiffon, fourrure), dans des dispositifs agencés selon une logique implacable mais mystérieuse. Les « Déambulatoires » comme des cadres de tableau où le tableau importe peu. Cela pourrait facilement virer à la préciosité. Même genre de travail avec les « Four seans sticks », la « Suite italienne », les « Noren », les « Constructions frêles ».
Il y a quelque chose de japonais dans le regard de GERARD TITUS-CARMEL sur les choses. Que ce soit dans la cuisine ou l’aménagement de la maison, les Japonais aiment confronter des matières dont les êtres sont opposés, par exemple le rugueux noirâtre et mat de la fonte confronté à un couvercle de porcelaine lisse et colorée, ou le cylindre vénérable d’un pilier de bois non travaillé sur le fond de laque brillante noire et rouge de cette loge ménagée dans le mur de la pièce principale.
Je m’enorgueillis de posséder le catalogue intitulé « The Pocket Size Tlingit Coffin » (ou « cercueil tlingit de poche », les Tlingit étant une peuplade d’Alaska), non pas pour l’indigeste et rébarbatif baratin de monsieur JACQUES DERRIDA en personne (mais on a l'habitude), dont les premiers mots sont : « 30 novembre 1977. – et ainsi du reste, sans précédent. ». Voilà, vous savez tout du baratin, pas besoin de lire tout le filandreux qui suit, que DERRIDA a chié en se tordant les boyaux de la tête (mais on va dire que je suis bêtement anti-intellectuel, ce qui est peut-être vrai).
Ce cercueil, d’abord, il faut savoir que c’en est un, tellement ça a l’air d’un jouet. Soit une petite boîte en acajou (environ 10 centimètres de long), fermée par une plaque d’altuglass, et comportant différentes petites pièces d’accastillage. Si vous avez aimé les séries de GERARD TITUS-CARMEL, là, vous serez servis : 127 fois exactement. C'est exactement comme ça qu'ANTOINE PARMENTIER a converti LOUIS XVI aux patates. Le même mets, accommodé de 127 manières différentes. Et pas deux pareilles : au crayon, à l’encre, à l’aquarelle, au trait, en à-plat, comme s’il voulait récapituler les trésors des techniques graphiques.
Cela me fait penser à un bouquin de GEORGES PEREC : Tentative d’épuisement d’un lieu parisien. Si c’est un petit « cercueil » (rien n’est moins sûr), GERARD TITUS-CARMEL s’efforce de l’épuiser, de le vider de toute la force qu’il possède. Malheureusement, en même temps qu’il le vide, par le fait même il le renforce. L’objet irréductible devient en soi un défi. En voulant en venir à bout, le peintre l’élève en majesté. « Damnation, encore raté. » D’où cette fuite dans toutes sortes de « séries ». J’ai le même respect pour les « Intérieurs », « Eclats & Caparaçons », « Suite Chancay ». Respect à cause du respect de l’artiste pour les choses.
Moralité : le réel est inépuisable, tout simplement parce qu’il ne nous paraît mangeable qu’au prix d’un désespoir et d’une illusion. Je me demande si ce n’est pas pour ça que nous nous vengeons de lui en consommant physiquement la planète.
Ce que je reproche finalement à tous les « fabricateurs » et autres « truqueurs » contemporains qui s’intitulent « artistes », c’est une incroyable arrogance face au monde, auquel ils croient pouvoir impunément substituer le leur. Comme s’ils avaient un monde ! Comme s’ils étaient un monde ! Ils posent leur unique idée sur les trottoirs de la culture comme on voit les merdes de chiens sur les trottoirs des villes, à la façon des mystificateurs JEFF KOONS ou TAKASHI MURAKAMI, des clowns qu’un snob désinvolte et dégénéré, avide de bruit médiatique (JEAN-JACQUES AILLAGON) a laissés récemment souiller le château de Versailles de leurs déjections.
Au temps de LOUIS XIV, la puanteur était une réalité quotidienne (due à l’absence totale de « toilettes »). Cette fois, c’est l’aristocratie en place qui fait tomber des trous du cul des « élites » cette bouse nauséabonde. Une telle ARROGANCE est d’origine biblique (« Tu seras possesseur et maître de la nature »), et a quelque chose à voir avec celle de l’Occident, qui a plié le monde à sa discipline. Il faudra que je revienne là-dessus. Rien de tel chez GERARD TITUS-CARMEL. Dieu merci.
Dire que je n'ai même pas parlé de l'oeuvre poétique de GERARD TITUS-CARMEL ! Car il en a publié, le diable d'homme. Très souvent chez Fata Morgana (La Tombée, Le Motif du fleuve, Instance de l'orée, Gris de Payne), mais pas seulement.
Fin de la série, pour le moment.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, peinture, art, gérard titus-carmel, jacques dupin, galerie lelong, jacques derrida, georges perec, jeff koons, takashi murakami
jeudi, 18 août 2011
LISEZ LA CARTE ET LE TERRITOIRE
Damien Hirst, pour ceux qui l’ignorent, a réalisé l’œuvre d’art la plus chère de tous les temps (à la fabrication, dirons-nous), avec un véritable crâne humain recouvert de (environ) 8000 diamants authentiques. A mon avis, ça défonce l’œuvre de Jeff Koons, visible autrefois dans Art press, où celui-ci se photographie avec sa verge en train de pénétrer dans la Cicciolina à cheval sur lui, tout ça dans des couleurs tendres, voire kitsch, et où la femme fait tout, par sa mimique, pour indiquer qu’elle est en train de jouir. Bon, c’est vrai, elle fait toujours la mimique de la jouissance féminine sur toutes les photos de la série, car il y a une série entière, bien entendu, on aurait tort de se priver.
Il a dû chercher longtemps le moyen de se replacer au sommet du podium, Jeff Koons, mais, apparemment, il n’a pas trouvé. Moralité : l’argent a eu la peau du sexe. Dit autrement : la marchandise a triomphé de la morale, puisque pour « heurter les sensibilités », exhiber une copulation « in vivo » est dépassé : il faut maintenant des diamants, et des diamants comme s’il en pleuvait. Et ça ne heurte même plus personne. C’est le stade, en quelque sorte, des icônes désicônisées.
C’est d’ailleurs ce dont Michel Houellebecq est convaincu, au moins apparemment, car ce tableau impossible à achever, que Jed Martin finira d’ailleurs par détruire, ça symbolise bien sûr (mais est-ce si sûr ?) l’escroquerie cynique et arrogante que constitue désormais l’étalage sans vergogne des montagnes de fric sous le nez même de ceux que l’ultralibéralisme racle jusqu’à l’os.
La Carte et le territoire, c’est curieux, on rencontre cette expression deux ou trois fois dans le volume des Essais de Philippe Muray. Un territoire, à proprement parler, c’est rigoureusement indéchiffrable : regardez une photo aérienne prise à la verticale, impossible de se repérer, de s’orienter, ni numéro de routes, ni nom de village ou de rivière. Et si on est au-dessus d’une forêt, je vous dis pas. En gros, face à une telle photo, vous êtes, comme on dit, paumé. Remarquez, c’est la même chose pour n’importe quelle photo : dans la presse, qu’est-ce qu’il en reste, comme information, si vous en supprimez la légende ?
Elle sert à ça, la carte : à donner toutes les légendes nécessaires pour qu’on sache bien ce qu’on est en train de regarder, à poser l’étiquette avec les noms sur les paysages. A donner des points de repère. A s'orienter. S'il n'y a pas de métaphore, là, c'est rudement bien imité : nous avons fabriqué une époque totalement dépourvue de valeurs, qui n'a plus aucun sens de la valeur des choses et des êtres, démunie de points de repère. En clair, TOUT est possible (et l'inverse aussi, naturellement).
Et Jed Martin a été photographe avant de virer peintre. Il a commencé par « trois cents photos de quincaillerie », avec « écrous, boulons et clefs à molette », tout ça en « lumière neutre », sur « fond de velours gris moyen ». Puis il a l’illumination, un jour où, sur une aire d’autoroute, son père lui demande d’acheter la carte Michelin du département. Ils sont dans la Creuse. Le passage vaut, comme on dit dans le Guide Michelin, le détour.
« Cette carte était sublime ; bouleversé, il se mit à trembler devant le présentoir. Jamais il n’avait contemplé d’objet aussi magnifique, aussi riche d’émotion que cette carte Michelin au 150.000ème de la Creuse, Haute-Vienne. L’essence de la modernité, de l’appréhension scientifique et technique du monde, s’y trouvait mêlée avec l’essence de la vie animale. » C’est le coup de foudre. On ne comprend pas bien, mais le roman, c’est aussi ça.
A suivre...
P. S. du 26 août : L'expression "la carte et le territoire" se trouve aussi (ou alors, en fait) dans le livre de Philippe Muray Festivus festivus, paru en 2005 chez Fayard, à la page 389 : « La fameuse distinction de la carte et du territoire était encore rassurante : c'était la distinction du réel et de l'imaginaire; mais il n'y a plus de territoire, et c'est le peuple de la carte qui s'exprime. Sans drôlerie, comme de juste. Sans imagination. Ou qui ne s'exprime pas du tout, d'ailleurs ». Cela ouvre comme un horizon, une sorte de profondeur de champ.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeff koons, peinture, art press, damien hirst, art contemporain, cicciolina, philippe muray, la carte et le territoire
mercredi, 17 août 2011
DIRE DU BIEN DE MICHEL HOUELLEBECQ
Je n’avais encore lu aucun livre de Michel Houellebecq. Vous allez me demander pourquoi, peut-être. La raison en est simple, je crois d’ailleurs l’avoir déjà exposée ici, quoique pour une autre raison : il y avait une controverse, que dis-je, une dispute, un débat national ! Le sujet, tout simplement, faisait exploser l’audience dans les médias.
Et l’ébullition virtuelle (récurrente, il faut bien l’avouer, le carburant des médias n’étant rien d’autre que l’ébullition, quel que soit le combustible), tout simplement, ça me donne dans la minute, en plus de la nausée, un urticaire géant, massif, à donner même au unau des gestes fébriles et saccadés, voire capricants et convulsifs, c’est vous dire.
Il suffit que la mayonnaise médiatique « prenne » autour d’un individu, d’un phénomène, d’un événement pour que je fasse comme l’escargot : je me rétracte, je retourne au fond de la coquille utérine de ma surdité natale. C’est simple, tout ce qui a pour vertu de « faire parler les gens », je m’en protège par instinct comme d’une peste. Bon, c’est vrai, j’ai abordé ici plusieurs fois, par exemple, l’ « affaire » Strauss-Kahn, mais c’est parce que j’écoute beaucoup la radio. Vous dites : paradoxal ? Je veux bien. Mais qui est sans contradiction ?
Une amie avait prêté à H. La Carte et le territoire, le petit dernier de l’auteur controversé. Le livre était là, sur sa table, inoccupé, désœuvré même, il s’ennuyait. Je l’ai ouvert – avec réticence, mais je l’ai ouvert. Autant l’avouer : je craignais le pire. Eh bien tenez-vous bien, je n’ai pas regretté. Franchement, c’est une heureuse surprise. J’ai donc lu récemment deux ouvrages contrastés d’auteurs français d’aujourd’hui : Claude Arnaud, avec Qu’as-tu Fait de tes frères ?, et, donc, Michel Houellebecq, avec La Carte et le territoire.
Autant je trouve le premier dénué de toute force et de tout intérêt, frappé d’émasculation littéraire, autant je trouve le Houellebecq réjouissant et « couillu ». Enfin un livre d’un auteur français d’aujourd’hui qu’il ne faut pas se forcer, la mort dans l’âme, à boire jusqu’à la lie de la dernière page. Tiens, du coup ça me donne envie de lire les précédents.
Le Claude Arnaud, c’est du mètre linéaire, comme on dit dans les supermarchés, mais du linéaire à tous les étages du bouquin, dans les faits, dans les personnages, dans la construction, et surtout dans le regard sur le monde que c’est censé refléter : tout simplement, de regard, il n’y en a pas. Mai 1968, avec ce qui précède et tout ce qui suit, pourtant, ça devrait motiver le romancier, bon dieu ! Là non, rien, pas de regard du tout : si l’on veut, c’est un tableau aveugle sur l’époque. Cette époque, il s’est contenté de la vivre. Ça ne fait pas une littérature. Le secrétaire de séance se contente d’exposer, comme je disais, son compte-rendu de conseil d’administration.
Avec Michel Houellebecq pas du tout. L’action se passe aujourd’hui, ou peu s’en faut : il ne faut pas compter sur une reconstitution historique. Et l’époque, on l’entend pester contre. On sent qu’il ne peut pas la sentir. Et pour moi, ça tombe bien, c’est une attitude que non seulement je comprends, mais que je partage. Je pense à Philippe Muray qui, d’ailleurs, dans sa détestation du bocal littéraire parisien, épargne plutôt l’auteur de La Carte et le territoire, si je me souviens bien (voir son volume d’Essais, aux Belles Lettres).
Ce qui est vraiment bien, c’est que Michel Houellebecq, non seulement ne dit jamais « je » comme dans ces pseudo-romans que sont les soi-disant « auto-fictions », mais encore met en scène un personnage qui s’appelle Michel Houellebecq, qui meurt atrocement, soit dit en passant, dans la troisième partie. Mais attention, ce n’est pas une projection, ce serait plutôt un double, et c’est assez marrant. Car le pire, dans l’autofiction, c’est l’espèce de vortex auto-érotique où l’auteur masturbe à longueur de page des obsessions qui l’obsèdent. C’est, bien entendu, insupportable. Rien de tel ici.
Le personnage principal, c’est l’artiste Jed Martin, fils de l’architecte Jean-Pierre Martin, à la riche et belle carrière d’architecte, mais il a pris sa retraite, un jour. Le roman commence sur l’impossibilité de finir le tableau dont le sujet consiste en Jeff Koons et Damien Hirst, les deux artistes les plus chers du marché de l’art contemporain. Déjà, cette impossibilité de finir un pareil tableau me rend le livre sympathique. Ça ne suffit pas, mais ça aide. D’autant que le futur tableau s’intitule « Jeff Koons et Damien Hirst se partageant le marché de l’art ».
A suivre...

