vendredi, 14 juin 2024
LA FRANCE QUI TOMBE
Pour introduire le présent billet, j'ai piqué dans le journal Le Figaro du 13 mai dernier le titre de l'éditorial de Vincent Trémolet de Villers.
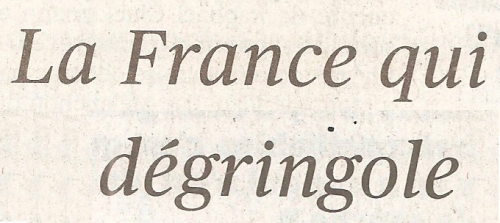
Inutile j'espère de préciser que l'objet de l'édito n'a rien à voir avec le propos que je m'apprête à tenir ici, puisqu'il parle de « situation économique et sociale proche de l'autodestruction ». Je reconnais cependant que mon idée a peut-être quelque chose à voir avec une autodestruction.
Car depuis dimanche 9 juin et les 32 % de la liste Jordan Bardella-Marine Le Pen aux élections européennes, je me sens très mal dans ma peau de Français. Comment ça ? Il se trouve un tiers des suffrages exprimés en faveur du clan Le Pen ?
Certes, c'est Jordan Bardella qui figure en tête de liste pour siéger à Strasbourg et Bruxelles. Mais pour moi, Bardella n'est qu'un comparse, un homme de paille, une marionnette, un faux nez, un paravent, un masque. Complaisant et opportuniste, sans conviction ni corps de doctrine, sans contenu ni consistance, voilà en tout cas un drôle de personnage.
Remarqué au Parlement européen pour son absentéisme, pour la rareté de ses interventions et pour son inscription à une seule commission : celle dite "des pétitions", généralement rebaptisée "commission des planqués" par les autres députés européens. Son rôle exclusif et sa fonction dans les rangs du R.N. ? Représentant de commerce. Camelot si vous préférez ("bonnisseur de la bath", comme disait Jean Bruce pour OSS 117). Je veux dire que sa tâche est de faire du porte-à-porte (et pourquoi pas "portail-à-portail" ?) sur les réseaux sociaux et de conquérir de nouvelles clientèles par son pouvoir de séduction.
Un tiers des électeurs, donc. Je me dis : « Ce n'est pas possible ! » Et pourtant si ! Et j'en ai entendu, de ces électeurs, avec leurs "Mais on ne les a jamais essayés, alors pourquoi pas ?" Et je me dis que c'est ce genre d'eau usée qui sert de conscience politique à la majorité relative de mes semblables. Faut-il que la France soit tombée bien bas pour aller jusqu'à fouiller au fond de ses poubelles pour ramener au jour de vieilles idées vaguement effrayantes.
Bien sûr, Marine a, dit-on, "dédiabolisé" le Front National, cet épouvantail et croquemitaine façonné par son père Jean-Marie, qui a longtemps joué le rôle du diable et rassemblé autour de sa personne tout ce que la droite radicale comptait de baroudeurs et autres aventuriers. Le premier tour de la présidentielle de 2002 montre que ce diable-là ne faisait déjà plus si peur que cela.
Le problème, avec le R.N., c'est sans doute moins Marine, qui après tout ne fait que dorer la pilule, comme les autres, c'est-à-dire mentir comme les autres, que les divers animaux carnassiers qui gravitent autour d'elle.

Et l'article de Charlotte Cieslinski (Canard enchaîné du 12 juin dernier) montre — si elle dit vrai — qu'avec le haut terreau administratif, Marine semble arriver en pays conquis. Et ne parlons pas des eaux troubles de la police, où frétillent quelques autres poissons inquiétants.

Alors, pourquoi ce triomphe annoncé ? Sans être spécialiste de quoi que ce soit, je voudrais mettre en avant trois facteurs.
1) L'immense médiocrité du personnel politique français. Je n'apprends rien à personne.
2) Les marges de manœuvre de plus en plus étroites laissées aux individus formant la classe politique par l'édification besogneuse et tatillonne de l'Europe communautaire.
3) L'impuissance de cette classe politique à imposer quelque régulation ou partage des richesses que ce soit à des puissances économiques et financières de plus en plus voraces.
Ce n'est pas "pour du beurre", mais bel et bien pour de vrai, le lent, constant, irrésistible grignotage de tous les bienfaits hérités des années fastes, des Trente glorieuses, des luttes syndicales, des conquêtes sociales, grignotage qu'on peut observer depuis trente ou quarante ans, et dont l'effet visible est d'augmenter sans cesse le nombre des pauvres. Il ne faut pas oublier que : « Qui sème la misère récolte la colère ». Tout le succès du parti de Marine découle de cette misère, de cette colère et de cette vérité primordiales.
Ceux qui déclarent qu'il faut tout faire pour empêcher le Rassemblement National d'accéder au pouvoir mentent, font semblant et mettent le doigt dans l'œil de leurs électeurs. Ceux qui proclament qu'il faut avant tout lutter contre la réémergence de la "bête immonde" savent qu'ils trompent leur monde. On ne lutte pas contre le Rassemblement National.
On ne lutte pas contre des idées : on fait ce qu'il faut pour que leurs conditions d'émergence ne soient jamais réunies. Je veux dire : quand on est un homme politique responsable, on agit pour procurer aux populations des conditions de vie correctes, une prospérité relative, un certain bonheur d'exister, de travailler, de prospérer dans un Etat de droit où règne la justice. Un homme d'Etat responsable se débrouille pour que les gens soient satisfaits de leur sort. Il travaille pour que soit effective une certaine redistribution des richesses.
Tout cela pour dire que la montée du Front National du père, puis du Rassemblement voulu par la fille dépend d'une logique implacable, et même d'une mécanique bien huilée. Marine, c'est l'enfant biologique de cette triple faillite.
P.S. : Du coup, j'irai peut-être voter cette fois.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le figaro, le canard enchaîné, vincent trémolet de villers, charlotte cieslinski, jordan bardella, marine le pen, rassemblement national, élections européennes, élections législatives, jean bruce, oss 117, jean marie le pen, hubert bonnisseur de la bath, france, société, politique
dimanche, 07 décembre 2014
L’ART CON AU MUSÉE
2
J'ai décidé de ne plus parler d' « Arcon », mais d'appeler les choses par leur nom. Je parlais de Jeff Koons, homme d'affaires. Chef d'entreprise. Dans l'industrie, où l'on sous-traite beaucoup, il paraît qu'on appelle ça un « donneur d'ordre ». Je trouve que ça lui va bien.
Toujours est-il que c’est cet « artiste » qui, après avoir envahi Versailles de ses « Balloons » et autres homards, se voit célébré par le Centre Pompidou, qui consacre une grande « rétrospective » à toute l’œuvre du grand homme. D’après le directeur de l’institution, Jeff Koons et toutes ses équipes (si, si !) se sont comportés en grands « professionnels ». Je n'en doutais mie. Toutes mes félicitations néanmoins.

Il paraît que c’est l’ « artiste » le plus cher du monde. Grand bien lui fasse. Mais pourquoi vouloir à tout prix être considéré comme un artiste ? Andy Warhol nous avait en son temps fait le même coup, alors que toute l’industrie warholienne repose sur son envie dévorante de gagner beaucoup d’argent. Ce qui n’était pas totalement le cas de Marcel Duchamp, son grand-père artistiquement génétique. S'il n'était pas dénué d'esprit de lucre (dame, il faut bien vivre !), du moins ne l'affichait-il pas de façon aussi ostentatoire (« décomplexée » serait plus dans l'air du temps).

Wim Delvoye : "œuvre" sortie de sa machine à caca (Cloaca).
Jeff Koons est encore plus cynique qu’Andy Warhol. Au départ, cet étudiant doué pour les chiffres et les opérations boursières se présente sur le marché du travail comme un « trader ». Ce qui, en anglais, signifie « commerçant ». Son métier ? Courtier (« adviser » ?) en matières premières sur la place de Wall Street. Je ne sais pas si l'image ci-dessous est en mesure de confirmer cette assertion de l'encyclopédie en ligne. Si la dame, après tout ne fait que son métier d'actrice porno, qu'en est-il du métier du monsieur ? Il n'a visiblement pas toujours sous-traité les tâches de réalisation. Sa façon de mettre la main à la pâte, peut-être ?

C'est bourré de concepts ? Fallait le dire !
Au moment où il se dit que le marché de l’art offre des perspectives incomparables de spéculations financières fabuleuses, ce n’est pas que l’art l’intéresse, c’est qu’il a des idées à vendre. S’il se lance dans l’art, c’est juste parce qu’il y voit un « vecteur privilégié de merchandising ». C’est tout. C'est lui qui le dit.

Un monochrome avant la lettre d'un nommé Alphonse Allais.
Il se souvenait qu’Andy Warhol lui-même avait acheté l’idée de la « Campbell Soup » à une copine galeriste. Pour faire du pognon avec un truc qui ne dépasse pas le niveau "Arts Déco". Mais Warhol n’avait pas d’idées, et il fallait amorcer la pompe. C'est lui qui disait que c'est trop difficile, de peindre. Koons, lui, il en a, des idées. Le premier « coup » de Jeff Koons, c’est évidemment la Cicciolina, l’actrice porno, qu’il va même jusqu’à épouser. Et la rédemption, ça marche ! Tout le monde marche.

On me dira qu’il y a eu un marché de l’art dès qu’il y a eu civilisation. On me dira que les milieux de l’art, dès le premier moment de leur existence, ont connu les opportunistes les plus éhontés, les plus cyniques. On me dira que les plus grands artistes ont eu besoin des puissants, de leur « protection », de leur argent pour « laisser libre cours à leur art ».
Certes, je ne dis pas que c’est faux. Simplement, je trouve horriblement moche d'en être arrivé à une civilisation capable de donner honte à quelques-uns d'y appartenir. Et d'en être un produit. Peut-être un déchet.
Quelle est, en dernière analyse, dans le corpus hautement signifiant d'une contemporanéité progressiste soucieuse, de ce fait, d'exprimer, dans ses visions fulgurantes, l'âme future de l'humanité, la fonction sémiologique des prouesses amoureuses, supposées ou réelles, de Jeff Koons ?

Maurice Tillieux adorait l'art contemporain.
Faudra-t-il considérer ses éjaculats sur la face extasiée (?) de la Cicciolina comme l'insémination prémonitoire d'un avenir radieux dans le ventre d'une modernité qui attendrait d'enfanter on ne sait quel monstre ?

Certains "concepts" sont comme le camembert. Quand ils sont trop mûrs : ils coulent.
Les activités de ce petit monsieur, sûrement un excellent homme d'affaires, ne cherchent même pas à se donner le prétexte de « faire de l’art ». Seulement de l’argent. Le reste est une histoire de « Storytelling ». Et de « merchandising ». Mais il prétend mordicus au statut d'artiste.
Au royaume des « Bonnisseurs de la Bath » (= "bonimenteurs", c'était le patronyme donné à OSS 117 par son inventeur Jean Bruce), les Koons, McCarthy, Delvoye, Hirst et compagnie sont rois.
A voir ce dont sont grosses les prémonitions de l'avenir radieux, je ne suis pas près de quitter les rangs des diplodocus et des ptérodactyles : j'aime bien comprendre ce qu'on me dit quand on s'adresse à moi. Et j'en ai assez des bonimenteurs.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : à part Gaston Lagaffe (Franquin, Le Géant de la gaffe, p. 51) et Libellule (Maurice Tillieux, Popaïne et vieux tableaux), je précise que j'ai trouvé les illustrations en errant et tâtonnant sur la "toile".
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, art contemporain, jeff koons, mécène, françois pinault, palazzo grassi, château de versailles, koons à versailles, balloon dog, rétrospective koons centre pompidou, andy warhol, marcel duchamp, wim delvoye, pornographie, la cicciolina, alphonse allais, campbell soup, oss 117, paul mccarthy, jean bruce, damien hirst
dimanche, 25 mai 2014
KUNDERA, VIEILLARD JUVENILE
MILAN KUNDERA : LA FÊTE DE L’INSIGNIFIANCE
(vient de paraître)
PREAMBULE
Il m’arrive de lire des romans au moment de leur parution, mais en général j’évite. Pour une raison qui, au moins dans mon esprit, doit paraître évidente : lire ce qui vient à l'instant où ça vient, c’est prendre un risque. Celui d’avoir perdu son temps et son argent. L’impression d’avoir lu des sottises ou des choses inutiles. L’impression de s’être fait avoir, en quelque sorte. Et je suis comme pas mal de gens : je n’aime pas.
C'est pourquoi, du moins en général, j'attends que le temps ait fait son œuvre, qu'il ait sassé l'impressionnante moisson romanesque annuelle et séparé le bon grain de l'ivraie. J'avoue, certes, que c'est aussi risquer de passer à côté de merveilleuses pépites littéraires, mais comme les journées n'ont que vingt-quatre heures, je me fais une raison.
Je dis tout ça parce qu'il m’est arrivé en quelques occasions de n'avoir qu'une envie, un fois le livre refermé : le mettre à la poubelle. J’ai dit ici, en son temps, tout le mal que je pensais de Qu’as-tu fait de tes frères ?, livre stupide de Claude Arnaud, espèce de rapport de secrétaire de conseil d'administration sur une époque à la mode (mai 68 et la suite), stupidement qualifié de « roman » (genre : « Voilà, mesdames et messieurs ce qui s'est passé, les grands hommes que j'ai rencontrés ... »). Accessoirement petit livre de propagande homosexuelle. Je garde aussi en travers de ma mémoire « littéraire » (si l’on peut dire) Passion simple d’une certaine Annie Ernaux.
Je prétends que Passion simple n’est pas un livre, mais une petite crotte déposée sur le trottoir par un animal souffreteux, égrotant, cacochyme et anémié, et d’où monte le délicat fumet d’imposture auquel certains nez contemporains croient être autorisés à reconnaître la fragrance majestueuse de la littérature.
Les nez contemporains sont, hélas, massivement induits en erreur par l’I.B.M. (Indice de Bruit Médiatique). Avec des complices bien placés pour répandre la bonne parole du haut de l’autorité que leur confère l’audimat, mais aussi le simple fait d’être payés pour « parler dans le poste », pour quelque raison nauséeuse que je répugne à connaître (vous savez : « il faut bien vivre, il n'y a pas de sot métier ... », slogans faciles auxquels je réplique : « Il n'y a peut-être pas de sot métier, mais il y a des boulots de merde »). Où est passée la critique littéraire ? On ne voit plus que des tournées de promo, de plateau en plateau, chez des animateurs complaisants, avec des chroniqueurs « littéraires » en valets de ferme.
Et je préviens madame Cantonade, qui qu’elle soit, qu’elle aura beau me recommander le Mémé de Philippe Torreton, qui, si l’on en croit Le Monde, « réveille une nostalgie des campagnes d’antan », je suis bien décidé, dans ma grande générosité, à laisser aux amateurs de soupe tous les exemplaires disponibles du livre. J’en fais ici le serment solennel.
Et ce ne sont pas les larmes des dames (« la soixantaine, même un peu plus ») bouleversées d’émotion en faisant signer le bouquin (et leur billet de train !) par l’acteur à la librairie L’Armitière, qui me convaincront de le rompre. L'article du Monde (18-19 mai) est consternant sur l'état culturel et littéraire de la population, même si je crois que ce phénomène est moins littéraire qu'identitaire et générationnel.
Il est d'ailleurs heureux que l'article figure parmi les rubriques des informations générales. La nostalgie n'est pas mon fort. Ceux qui critiquent l'époque ne sont pas forcément adeptes du « tout fout l'camp, mon bon monsieur » et du « c'était mieux avant ». Je demande simplement aux prosélytes du Progrès s'ils sont si sûrs que ça qu'on va vers le Mieux. Dire « c'était mieux avant », j'ai envie de traduire « arrêtons d'aller vers le pire ».

Je ne lis donc guère de livres au moment de leur publication. Voyez par exemple aujourd’hui même, quelqu’un que j’aime bien m’a vanté les mérites de Living, de l’Argentin Martin Caparros. Je m’y suis mis bravement ce matin, mais après soixante-dix pages, j’ai crié grâce et j’ai rendu le livre : peut-être un bon roman, je ne le saurai jamais, mais pour quelle raison le monsieur est-il aussi bavard ? BAVARD ! J'ai au moins fait la faveur à l'auteur d'avoir tourné soixante-dix pages de son bavardage complaisant. Il a une dette envers moi. Par ici la monnaie : il me doit soixante-dix pages.
Comment peut-on être bavard jusqu’à ce boursouflé-là ? Je manque de patience : la prolixité, la volubilité, le luxe des détails et l’abondance verbale, tout ça m’énerve et m’ennuie très vite. Au motif que la personne qui me cause prétend passer avant ce qu'elle veut me dire. M'assujettir, en quelque sorte. J’aime la sobriété, que je considère comme une forme de modestie et de courtoisie.
Le camelot parle beaucoup parce qu’il veut me vendre sa camelote en me noyant sous son flot mercantile. Je rappelle que c’est le sens premier du nom du héros de Jean Bruce, OSS 117 : Hubert Bonisseur de la Bath. Le connaisseur d’argot sait que « bonir » signifie "bonimenter". Quant à « bath », je le traduis par « esbroufe », malgré le regretté Bertaud du Chazaud. Je n'ai rien d'un Méditerranéen.
Ah, on me dit que Martin Caparros est invité aux Assises Internationales du Roman (AIR) 2014 dans notre bonne ville de Lyon, peut-être invité par le patron de la Villa Gillet, Guy Walter qui, sur une photo publiée dans Le Progrès, se donne l'air bobo d'un Lambert Wilson. Bon, et alors ? Si son histoire avait tenu en deux cents pages, je serais peut-être allé jusqu’au bout, mais plus de cinq cents, alors là non, il ne faut pas exagérer. Ouvrir un livre d’un auteur inconnu est d’abord un acte de confiance et d’espoir.
Mais un démarcheur, pensez !!! Si j’ai le malheur d’ouvrir ma porte sur un de ces spécimens indésirables, celle-ci se referme aussitôt. Je suis équipé en aspirateur et en encyclopédies. Le succès ne dispense aucun écrivain d'avoir du style. La prolixité n'est pas un style. Tant pis pour la marchandise, quelle que soit sa valeur. Je sais : je passe à côté de bien des choses intéressantes.
Tant pis pour moi.
Voilà ce que je dis, moi.
Promis, demain c'est Kundera.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, littérature étrangère, martin caparros, assises internationales du roman, lyon, villa gillet, guy walter, le progrès, bertaud du chazaud, jean bruce, oss 117, hubert bonisseur de la bath, martin caparros living, mémé, philippe torreton, annie ernaux, passion simple, claude arnaud, qu'as-tu fait de tes frères, milan kundera, la fête de l'insignifiance
mercredi, 18 avril 2012
N'AYEZ PAS PEUR !
Allez, aujourd'hui, je reviens à l'actualité.
J’en ai soupé depuis le début, de l’élection présidentielle, depuis qu’elle a commencé, non, depuis qu’elle a été annoncée, non, depuis que son profil impérieux s’est imprimé au loin sur l’horizon de la « République Française ». Le vainqueur sera-t-il Monsieur MENTEUR EN CHEF (NICOLAS SARKOZY) ? Sera-t-il Monsieur CHAMPION DES BLUFFEURS (FRANÇOIS HOLLANDE) ?
En tout cas, les professionnels du brassage de vent que sont les entrepreneurs de sondages nous le promettent : n’ayez pas peur, ce sera « bluffeur » ou « menteur ». Le premier tour est plié, on vous dit. Moi, je vous le dis, si je votais, ce que je n’ai pas l’intention de faire, j’apporterais ma voix à un des candidats que les sondeurs créditent actuellement d’environ 1 % des voix. C’est vous dire si ce serait un « vote utile ».
Vous aimeriez que je vous dise, hein, bande de curieux. N’ayez pas peur, je vais vous le dire : si je votais, ce serait pour le seul qui ne bluffe pas, même si l’on peut trouver qu’il rêve un peu : NICOLAS DUPONT-AIGNAN.
C’est le seul à ne pas baratiner (avec POUTOU ?). C’est le seul (avec MELENCHON ? Avec LE PEN ?) à mettre à son programme l’abrogation de la loi de 1973, qui oblige l’Etat français à emprunter au prix fort aux banques privées, aux dépens des contribuables, et qui lui interdit d’emprunter à 0 % à la Banque de France. C’est le seul à voir où il reste encore quelques traces de ce qu’on appela autrefois l’aujourd’hui défunte « souveraineté nationale ».
Ceux qui n’en parlent pas, de deux choses l’une : soit ils ignorent totalement ce point, soit ils ne veulent surtout pas toucher au système (rappelez-vous SARKOZY annonçant une grande offensive contre les paradis fiscaux, dont les paradis en question se gondolent encore). En tout cas, quand j’ouvre les écoutilles sur la présente « campagne », ça me les pollue vilainement, les écoutilles, car j’entends du blabla, et encore du blabla.
C’est à qui bonira les plus belles craques de camelot. Pour les gens surpris par « bonira », je rappelle qu’OSS 117, le vrai, celui de JEAN BRUCE, s’appelle, de son « vrai » nom, Hubert Bonisseur de la Bath. Or le « bonisseur » (même racine que boniment), c’est le gars, en général jovial et sympathique, qui est fait (parce qu’il dégoise à merveille) pour vous vendre, sur les marchés, le produit vaisselle miracle, le coupe-légumes miracle, la serpillière miracle. Je propose de traduire la vraie fonction du personnage par la vieille expression : « Vous me la baillez belle ».
Autrement dit : « Mon œil ! ». Et cette campagne, c’est la foire aux bonisseurs de la bath. Quoi, ça a toujours été ? Bien sûr ! Mais ce qui change, aujourd'hui, c'est le côté abyssal du décalage entre les mots et la réalité. Ils ont beau se dire "modernes", les candidats usent (médias à l'appui) de ficelles archaïques. De ficelles usées jusqu'à la la corde, si l'on me pardonne l'expression.
Dans ce flot de blablateries et de trouducuteries, il arrive cependant que les quatre pattes fatiguées de mon œil morne dressent un moment l’oreille, au détour d’une phrase. C’est ainsi que s’est dessiné, sur le champ de labour de ma pauvre face ravinée par les pluies de promesses démagogiques, épuisée du spectacle donné par les deux clowns « principaux » qui s’efforcent, à grands coups de cabinets de communication, de faire rire le public enfantin, infantile et puéril réuni autour d’eux, au choix, sur le parking de la Concorde ou sur le parking de Vincennes, le dernier des rares sourires crispés qu’est arrivée jusque-là à me tirer cette « campagne » (pour ceux qui ont du mal avec cette phrase, "sourires" est sujet du verbe "s'est dessiné").
Ce fut une phrase prononcée par NICOLAS SARKOZY, dimanche 15 avril. C’est d’ailleurs ce qui me fait dire que si le comble du culot et du mensonge cynique portait un nom, ce serait celui de l’actuel président, dont le patrimoine personnel a augmenté, durant son quinquennat, de 600.000 euros (et le pouce). Tudieu, c'était donc ça, le « Travailler plus pour gagner plus » ! C'était donc ça, bugne que j'étais !
Il y eut, rappelez-vous, JEAN JAURÈS, GUY MÔQUET, LEON BLUM et quelques autres. Et là, qu’est-ce qu’il ose sortir ? La première parole qu’ait prononcée JEAN-PAUL II après son élection, place Saint-Pierre : « Non abbiate paoura ! ». « N’ayez pas peur ». Et SARKOZY l’a dit, il a osé le dire, il n’a pas eu honte, puisqu’il n’a tellement honte de rien qu’on peut dire que c’est un « SANS VERGOGNE ». Il a dit : « N’AYEZ PAS PEUR ». Sauf que là, il le dit avant l’élection. Ça laisse un espoir ?

EH, LES MAMIES, IL NE VOUS FAIT PAS PEUR, CE TYPE ?
C’est une démarche assez désespérée, je trouve. Oui, je sais, le but, c’est de donner successivement à toutes les catégories de la population l’impression qu’on s’adresse à chacune en particulier. Mais à force de piocher, de prendre du fourrage sur toute l’étendue de la mangeoire électorale, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche en passant par la religion, vous ne croyez pas qu’à la longue, les électeurs de droite, de gauche, de devant et de derrière vont avoir du « shimmy » dans la vision (capitaine Haddock, Les Bijoux de la Castafiore, p. 50, je tiens à être précis dans le choix et la source de mes références) ?
Du trouble dans le bulletin de vote ? Du pêle-mêle dans la réception du message ? A force de vouloir représenter à lui tout seul l’intégralité de l’offre électorale, tout ce qu’il réussit à faire, NICOLAS SARKOZY, c’est de transformer la campagne en hypermarché. Pas sûr que la demande suive, parce qu’à la longue, ça finit par gaver. N’ayez pas peur. NICOLAS SARKOZY, quoi qu’il arrive, continuera à FAIRE SEMBLANT de s’occuper de tout.
Voilà ce que je dis, moi.
A finir demain.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas sarkozy, ump, françois hollande, parti socialiste, ps, politique, société, france, élection présidentielle, propagande, sondages, nicolas dupont-aignan, poutou, jean-luc mélenchon, marine le pen, oss 117, jean bruce, meeting, jean jaurès, guy môquet, léon blum, jean-paul ii, tintin, capitaine haddock, bijoux de la castafiore
vendredi, 14 octobre 2011
AIMER LIRE, AVEC ARSENE LUPIN
Il y avait, en haut de l’escalier de la « petite maison », tout un rayonnage de romans policiers. La « petite maison » comprenait au rez-de-chaussée plusieurs pièces « utiles », et à l’étage, une salle de bains et trois chambres. Le soir, je piochais régulièrement dans les polars, avec une petite prédilection pour les OSS 117.
C’était alors pour moi le fin du fin du héros au service de son pays, qui accomplit des missions impossibles dans des pays hostiles, et qui revient chez lui même pas dépeigné après avoir séduit, palpé et davantage deux ou trois superbes femmes pas trop farouches, à la poitrine forcément « généreuse » et aux cuisses forcément « fuselées ». Je serais bientôt en âge de repérer clichés et stéréotypes.
Je me rappelle (ce n’est peut-être pas JEAN BRUCE) une scène au Japon, dans laquelle une jeune femme absolument ravissante, mais qui avait eu le malheur de trahir la « cause », est maintenue en l’air d’une main par un épouvantable mastodonte qui, de l’autre main, la « pèle » littéralement de tous ses vêtements pour lui faire subir les pires tortures imaginables. Le héros retrouve son pauvre cadavre après avoir un peu gratté la terre, parce que ça sent vraiment mauvais.
Les auteurs de ces romans cherchent autant qu’ils peuvent ces moments de paroxysme, qui sont l’acmé de l’intensité en action. Affaire d’imagination, et d’exploration des fantasmes sexuels (sadiques ou autres). C’est un aspect, dans la littérature « populaire », qui manque de noblesse, je le reconnais.
Et puis il y eut Arsène Lupin. Parenthèse sur Arsène Lupin.
Il ne faut pas dire de mal de MAURICE LEBLANC. Certains chipotent son mérite, font la grimace, doutent que ce soit de la « littérature ». MAURICE LEBLANC n’est certes pas HONORÉ DE BALZAC : chez lui, pas de « vision de la société », pas de « comédie humaine », mais c’est un raconteur d’histoires d’une grande habileté, et à ce titre, très respectable. Ce n’est pas lui qui va modifier votre regard sur le monde et sur l’humanité. Il veut simplement que ses histoires aient du succès.
Adolescent, j’ai lu TOUTES les aventures d’Arsène Lupin. Le plus génial dans la trouvaille du personnage d’Arsène Lupin, c’est qu’il n’y a pas de héros plus pratique pour son auteur : comme il change d’aspect comme de chemise, comme il change de nom comme il respire, comme il change de maîtresse sans arrêt, nul besoin pour l’écrivain de s’ingénier à faire de lui un portrait physique fouillé, et encore moins un portrait psychologique. Dans la population des héros de roman policier, Arsène Lupin, c’est de la pâte à modeler, c’est un personnage à la plasticité inépuisable.
Héros militaire de la guerre de 14 dans L’Eclat d’obus ; légionnaire au Maroc sous les traits de Don Luis Perenna ; bandit diplomate de haut vol capable de convoquer dans sa cellule de prison l’empereur d’Allemagne en personne (dans 813) ; détective d’une subtilité sans égale, sous le nom de Jim Barnett ou de Victor de la brigade mondaine, capable de griller sur le fil les meilleurs limiers de la police et de damer le pion à Herlock Sholmes et Isidore Bautrelet (lui, c’est dans L’Aiguille creuse), les meilleurs parmi les meilleurs, et capable de deviner la présence de la « liste des vingt-sept » dans l’œil de verre de Daubrecq.
Arsène Lupin en bandit aristocrate qui, à cause du regard de la femme qu’il aime, et qui vient de le surprendre en pleine nuit, dans le château du Malaquis (si si), en plein « déménagement » des meubles, objets et œuvres d’art appartenant au baron Nathan de Cahorn, est capable, par pur panache, de tout faire remettre en place par ses complices (c'est là-dedans, je crois bien, l'énigme sur le nom de THIBERMESNIL) ; amoureux toujours heureux et toujours transi des plus belles femmes, mais le plus souvent des femmes au caractère moins ardent que mélancolique.
Arsène Lupin en « deux ex machina » qui, une fois coincé dans une grotte en compagnie d’une jeune femme, pendant qu’on leur tire dessus et que l’eau du lac monte inexorablement (La Demoiselle aux yeux verts), une autre fois coincé dans une grotte dans une falaise bretonne en compagnie d’une jeune femme, pendant que le sol même de la grotte se soulève inexorablement pour les faire basculer dans le vide (L’Île aux trente cercueils), redresse la situation et sauve d’un coup de baguette magique la vie de la belle jeune femme, qui lui en sera éperdument reconnaissante, n’en doutons pas.
Arsène Lupin en enfant redresseur de torts, connu, une fois adulte, sous le nom de « chevalier Floriani », qui dérobe le « collier de la reine » et en vend les diamants pour sauver sa mère malade, et qui, chevaleresque, en dépose vingt ans après le coffret contenant la monture intacte sur la table de la chambre de Madame de Dreux-Soubise (« Le Collier de la reine », dans Arsène Lupin gentleman cambrioleur).
Arsène Lupin en justicier grand seigneur, qui rend à l’Etat français l’énorme tas d’or qui attendait bêtement sur un quai qu’on lui assignât une destination, à peine dissimulé sous un énorme et innocent tas de sable (Le Triangle d’or) ; et puis Arsène Lupin amoureux, à genoux devant cette jeune femme évanouie, et la ramenant à la conscience en promenant tout en douceur ses lèvres sur ses joues (La Demeure mystérieuse ?).
Fin de la parenthèse sur Arsène Lupin.
A suivre bientôt.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, littérature, arsène lupin, oss 117, jean bruce, polar, maurice leblanc, 813, l'aiguille creuse

