mercredi, 27 février 2019
JE HAIS LES SCIENCES HUMAINES
Tiens, oui, au fait, je parlais de la haine. On verra ici qu'il n'y a pas que la tyrolienne (voir 25 février).
ÉPISODE 1
Oui, je hais les sciences humaines, mais pour quelques raisons précises que je vais m'efforcer de détailler ici. La première est leur omniprésence dans l’espace médiatique généraliste : pas un bulletin d’information où le journaliste n’invite pas un spécialiste, un chercheur, un expert d’un des sujets abordés pour tenter d’éclairer le pauvre monde qui écoute, à l’autre bout du poste, à l'affût de ses doctes analyses. A force, il y a saturation.
A croire que le journaliste ne se suffit plus à lui-même, puisqu’il ressent le besoin irrépressible de faire intervenir quelqu’un d’un peu plus qualifié que lui. A croire que la demande est forte et que l’Université (ou quelle que soit l’officine pourvoyeuse, tant les "think tanks" fleurissent en ribambelles) est devenue un indispensable auxiliaire de presse.
A croire aussi que le monde est devenu à ce point nébuleux, indéchiffrable et incompréhensible qu’il est nécessaire d’ajouter des lumières à l’information sur les faits : dans ce monde gouverné par la médiatisation, l’auditeur appartient à la catégorie méprisable des « non-comprenants » (Guy Bedos). Aujourd’hui c’est le sociologue qui s’y colle, demain ce sera l’historien, et puis le philosophe, et puis l’économiste, et puis le politiste, et puis, et puis …
Tous ces braves gens qui ont le nez au ras de l'histoire qui se fait (sont-ils payés pour intervenir ?) vous expliquent comment vous devez comprendre les faits dont le journaliste vient de rendre compte. On me dira que tous ces braves gens apportent leur contribution au nécessaire "débat démocratique". Alors là, je pouffe : en réalité, ils se précipitent sur l'actualité comme des vautours, et leurs commentaires "à chaud" se perdent dans les sables.
Pour quelqu’un qui s’intéresse à ce qui se passe dans le monde et suit l’actualité avec une certaine constance, l’effet produit par cette inflation de gens supposés savoir est aux antipodes des attentes. Car j’ai l’impression que plus on cherche à éclairer ma lanterne, plus mon esprit s’embrouille, assiégé qu’il est par la multiplicité des savoirs et des points de vue : sans parler du narcissisme de l’expert (flatté d'être invité par un micro ou une caméra) ou des contradictions éventuelles qui opposent les grilles de lecture et les interprétations, aucun de ces savants spécialistes ne semble s’interroger sur l’effet de brouillage global du sens produit par la concurrence féroce entre les spécialités (sans même parler de la rivalité entre "écoles" à l'intérieur d'une même discipline) : quel sens se dégage de l'ensemble de ces savoirs juxtaposés ? Qui nous dira ce que cette juxtaposition permet de dégager comme signification d'ensemble ? Personne, malgré tout ce qu'on peut me dire de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité ou ce qu'on veut.
La raison en est que chaque savant intervenant dans sa spécialité est comme le type en blouse blanche qui rend compte de ce qui s’est passé dans les éprouvettes de son laboratoire : il ignore ce qui s’est passé dans celles du labo voisin. C’est ainsi qu’il ne faut pas demander à la biologie cellulaire d’intervenir en biologie moléculaire, en biochimie ou en microbiologie. Plus le spécialiste se spécialise, plus son champ d’investigation devient « pointu » (cela veut dire plus il pénètre dans le précis, plus le champ se rétrécit), et moins il peut se prononcer sur le champ voisin à cause de ses œillères : chacun opère exclusivement dans le compartiment qu’il occupe, aucun ne détient une vérité commune.
L'espace des sciences humaines est aujourd'hui le résultat d'un découpage à la petite scie du savoir humain, qui fait penser à l'obsession de Percival Bartlebooth, le personnage principal de La Vie mode d'emploi de Georges Perec, qui ne vit que pour l'entreprise désespérée qui consiste à peindre 500 aquarelles dans le monde entier, à les faire fixer sur autant de supports de bois qu'il demande à Gaspard Winckler de découper artistement en 750 pièces, pour passer le reste de sa vie à reconstituer les images ainsi décomposées. Il finira terrassé par une crise cardiaque au moment où la dernière pièce du puzzle (en forme de W) refusera d'entrer dans la dernière loge disponible (en forme de X).
Au cours du temps, le monde de la connaissance s’est fragmenté en territoires de plus en plus nombreux, de plus en plus étroits et de plus en plus jalousement gardés (on appelle ça la "rigueur scientifique"). Il s’ensuit de cette évolution – mais ça, on le savait depuis quelques siècles (Pic de la Mirandole, 1463-1494, l’homme qui savait tout), ça n’a fait que s’aggraver au point de devenir ridicule – une pulvérisation à l’infini du paysage du savoir en options de toutes sortes. Impossible de reconstituer l'homogénéité, donc la signification de ce puzzle-là.
On ne s’aperçoit pas assez que l’unité du savoir est intimement liée à l’unité de la personne qui sait et de la société dans laquelle elle s’insère : si plus personne ne peut tout savoir, le monde de la connaissance devient un puzzle infernal, et la société se craquelle. L'exemple de Histoire mondiale de la France, sous la direction de Patrick Boucheron, illustre ce morcellement : le gâteau de l'histoire de France découpé en 122 parts (= chapitres) confiées à 122 "spécialistes". Belle image d'une France définitivement démembrée. Image aussi de l'individu qui a définitivement perdu le sentiment de sa propre unité.
L’univers actuel de la connaissance est devenu un gigantesque hypermarché dans les rayons duquel l’amateur n’a qu’à circuler et pousser son chariot pour le remplir des marchandises qu’il préfère : tel yaourt de sociologie, tel pot de moutarde d’histoire, tel paquet de sucre d'économie orthodoxe, telle friandise de politologie, etc. Le savoir est devenu une marchandise comme une autre, et les chercheurs, les intellos, les travailleurs du ciboulot sont devenus de vulgaires producteurs de matière grise, sur un marché obéissant comme tout le monde à la loi de l’offre et de la demande, sachant que le sommet de l’offre est lié à la « notoriété » du producteur (c’est lui qui est en tête de la page Google, grâce au nombre de « requêtes »).
La réalité de ce système, c’est que plus personne n’est en mesure de comprendre la logique du fonctionnement global du dit système. La réalité, c’est que tous les intellos de toutes les chapelles science-humanistes courent comme des fous après la réalité du monde tel que le fabriquent les véritables acteurs, qui se moquent des théories et des concepts, parce que leur seule préoccupation demeure le pouvoir, la puissance et la richesse, ainsi que l’accroissement indéfini de ceux-ci. La vérité du système, c'est que plus aucun des éminents innombrables spécialistes qui nous font la leçon tout au long de France Culture n'est en mesure de nous dire ce que signifie le monde actuel dans sa globalité. Les intellos ont rejoint les politique dans l'impuissance à agir sur le réel.
Les science-humanistes viennent sur les lieux du crime après qu’il a eu lieu, pour constater le décès et procéder à l’autopsie du cadavre pour tenter d’en déterminer les causes. Non contents d’être les virgules dans le texte de l’histoire qui s’écrit, les science-humanistes de tout poil font les avantageux dès que l’oreille d’un micro ou l’œil d’une caméra leur offre sa tribune. Pris individuellement, ils peuvent être risibles ou passionnants, mais pris collectivement, aussi sérieux, sagaces et pertinents soient-ils, ils ne sont, dans l’histoire qui se fait, que des jean-foutre.
Les sciences humaines, telles que le monde actuel en a l’usage, n’aident plus à comprendre celui-ci : elles produisent des lumières tellement aveuglantes et éclatées qu’elles contribuent à son inintelligibilité. Chacun des intellos qui envahissent en troupes serrées les plateaux de radio-télé et les pages "Débats" de Libération, du Figaro ou du Monde vient en réalité chercher son « quart d'heure de célébrité » (Andy Warhol). Ils n'ont pas conscience qu'ils travaillent activement (sans en avoir conscience) à rebâtir un monument que la Bible a rendu célébrissime : la Tour de Babel.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : ce n'est pas un sociologue, mais bien l'écrivain Michel Houellebecq qui parle du "plan social" d'une envergure jamais vue, à propos de l'agriculture paysanne et de sa disparition programmée sous le rouleau-compresseur ultralibéral qui généralise l'industrialisation des métiers agricoles et le productivisme à outrance (mariage totalitaire du machinisme et de la chimie). Ici le sociologue ne sert à rien. Peut-être bien que Houellebecq ne sert pas non plus à grand-chose, mais au moins, il est moins chiant.
Moralité : seule la littérature est en mesure de réaliser l'unité du savoir.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences humaines, intellos, intellectuels, journalistes, université, guy bedos, sociologie, historien, philosophe, économiste, littérature, michel houellebecq, andy warhol, journal libération, journal le monde, journal le figaro, quart d'heure de célébrité, pic de la mirandole, georges perec, la vie mode d'emploi, percival bartlebooth, gaspard winckler, patrick boucheron, histoire mondiale de la france, google, presse, france culture
samedi, 30 avril 2016
CHRISTOPHER LASCH ET L'ARCON
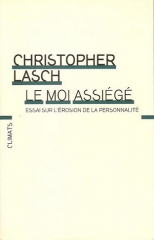 2
2
Alors maintenant, comment Christopher Lasch analyse-t-il l’évolution des pratiques picturales après 1950 ?
« Les équipements d’enregistrement modernes monopolisent la représentation de la réalité, mais ils brouillent également la distinction entre réalité et illusion, entre le monde subjectif et celui des objets, gênant par là même les artistes lorsqu’il s’agit de se réfugier dans le fait brut du moi, comme le disait Roth. Pas plus le moi que son environnement n’est plus un fait brut. » Christopher Lasch, Le Moi assiégé, p. 135. On a déjà croisé une telle idée. On sait qu'elle vient de Guy Debord et de sa Société du spectacle : tout au long de notre existence, toutes nos perceptions (enfin, la plupart) nous parviennent aujourd'hui médiatisées sur un écran où se projettent des images élaborées par d’autres instances que nous-mêmes. Nous n'avons plus d'expérience directe du monde.
« L’artiste romantique projetait des mots et des images dans le vide, en espérant imposer l’ordre au chaos. L’artiste postmoderne et postromantique les voit comme des instruments de surveillance et de contrôle. » C’est l’écrivain William Burroughs qui inspire ici Lasch.
Mais surveillance et contrôle ont été rendus possibles par la généralisation des sciences dites « humaines », au premier rang desquelles on trouve bien sûr la psychologie et la sociologie : « L’observation scientifique et sociologique abolit le sujet en faisant de lui le "sujet" d’expériences censées faire apparaître sa réaction à divers stimuli, ses préférences et ses fantasmes privés. Sur la foi de ses découvertes, la science construit un profil composite des besoins humains sur lesquels elle pourra baser un système (envahissant bien que pas ouvertement oppressif) de régulations comportementales » (p.141). "Régulations comportementales" ? On ne peut être plus clair, me semble-t-il, sur le processus d'asservissement des individus par un système devenu complètement anonyme, du fait que tout ce qui sert à connaître l'homme (les sciences humaines) fournira plus tard des outils perfectionnés pour le contrôler.
L’auteur puise la substance de ce raisonnement chez l’Anglais J.G. Ballard. La préoccupation que ce dernier exprime dans ses romans n’est autre que le processus d’onirisation de la vie, qui résulte de la « saturation de l’environnement par les images et l’effacement consécutif du sujet », tel qu’on peut en voir la manifestation dans le travail d’artistes comme Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Jasper Johns, Robert Morris.


Que ce soient une vignette de BD (Lichtenstein), une aiguille et son fil ou une pince à linge (Oldenburg), l’agrandissement démesuré (x 1000 ou 10000, pour le moins) de l’objet lui fait perdre sa matérialité utilitaire et le coupe de toute réalité concrète. Ce qui fait perdre toute possibilité pour l'œuvre d'art de signifier quoi que ce soit. Sans parler de l'infinie dérision dont de telles œuvres sont porteuses. Il se produit le même phénomène de déréalisation dans la multiplication de la boîte de Campbell Soup ou du portrait de Marylin (Warhol). Il est désormais admis que l’ « œuvre d’art » vole de ses propres ailes, loin de toute basse réalité, offrant au gré des caprices de l’artiste tel objet trivial à l’adoration des foules. On peut voir là une forme de prosternation devant le dérisoire : Clement Greenberg « croyait quant à lui que l’art ne devait jamais tenter de renvoyer à quoi que ce soit en dehors de lui-même ».
Un tel courant a pour conséquence (c’est peut-être le but poursuivi par ces artistes) de dépersonnaliser l’œuvre d’art et d’éliminer la subjectivité (Sol Lewitt), tendant à « brouiller la frontière entre illusion et réalité ». Cette conception de la création artistique procède évidemment des coups inauguraux que Marcel Duchamp, en son temps, a portés au statut de l’artiste. On traitait André Breton de "Pape du surréalisme". Duchamp peut à bon droit être qualifié d' "Empereur du ready-made". Refusant de signer des « chefs-d’œuvre » au bas desquels il serait fier d’apposer sa signature, Duchamp voulut en finir avec la « confiscation » de la créativité par les seuls individus « créatifs ». Idée a priori généreuse et démocratique.
Mais c'est du flan, une vaste blague, une farce grotesque et un désastre général, en vérité, car on sait ce qu’il en est advenu : non seulement le monopole n’a pas été mis à bas, mais il est à présent accaparé, non par des créateurs authentiques, mais par des individus qui se contentent de commercialiser une « idée » artistique, si possible spectaculaire (le bleu de Klein, l’outre-noir de Soulages, la Campbell Soup de Warhol), quand ce n’est pas par de vulgaires hommes d’affaires (Jeff Koons était courtier en matières premières à Wall Street, avant d'être embauché dans la domesticité au service du milliardaire François Pinault).
Il est bien loin, le temps où la société demandait à l’artiste d’administrer la preuve de son savoir-faire et de sa maîtrise technique dans l’art de peindre. Aujourd’hui, tout individu (je ne dis pas "artiste", car tout le monde est concerné par l’appel) un peu astucieux devient une start-up potentiellement dotée d’un bel avenir commercial : sois assez ingénieux pour créer toi-même ton propre « créneau ». Il ne s’agit certes pas du même savoir-faire.
Christopher Lasch se réfère à un essai du philosophe allemand Walter Benjamin, suicidé en 1940 à la frontière franco-espagnole, L’Œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique. Qui dit production en série dit forcément société industrielle, société de consommation, société de masse. Chaque tendance de l’art contemporain va s’inscrire dans un « créneau » précis, celui qui lui est dévolu sur le marché d’une consommation donnée. Que cela s’appelle « minimal art », « systemic painting », « optical art », « process art », « earth art » ou conceptualisme, tous participent de ce mouvement de déconstruction (de « démystification »). Et chacun, bien rangé dans sa case, occupe le « segment de marché » qu’il a réussi à s’ouvrir.
Christopher Lasch conclut logiquement à la « fusion du moi et du non-moi », sorte d’indifférenciation des moi, des êtres et des choses, un monde où les distinctions sont abolies, « un monde où tout est interchangeable ». C’en est au point que « la survie de l’art, comme de toute autre chose, est devenue problématique », au motif « que l’affaiblissement de la distinction entre le moi et son environnement – développement fidèlement consigné par l’art moderne jusque dans son refus de devenir figuratif – rend le concept même de réalité, ainsi que celui du moi, de plus en plus indéfendable » (p.155).
Ce qui arrive arrive, ce qui existe existe, ce qui est là est là, c’est tout : il n’y a plus rien sous la surface des choses, toute substance, tout contenu sont révocables, l’unité de la personne est pulvérisée (« Puisque l’individu semble être programmé par des agences extérieures – ou peut-être par sa propre imagination exaltée – il ne peut être tenu pour responsable de ses actes »), l’insignifiance triomphe. Il n'y a plus que de pures apparences : images fabriquées par des gens de métier, et déconnectées de tout contenu humain réel. L'homme en personne devient virtuel.
Les artistes de la fin du 20ème siècle commentent leurs propres œuvres et le « geste » qui les y a conduits comme s’ils inventaient un nouveau monde. Mais c’est une simple grimace. N’est pas Christophe Colomb qui veut.
Au total, Christopher Lasch, en regardant l’évolution de l’art contemporain, semble contempler un champ de ruines. Difficile, je crois, d’aller plus loin dans la dénonciation de l’impasse où se sont engouffrés les artistes depuis cinquante ans et plus.
Plus radical que Christopher Lasch, tu meurs.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : christopher lasch, le moi assiégé, narcissisme, éditions climats, art contemporain, william burroughs, jg ballard, robert rauschenberg, andy warhol, roy lichtenstein, claes oldenburg, jasper johns, robert morris, clement greenberg, marcel duchamp, ready-made, campbell soup, outre-noir soulages, bleu klein, jeff koons, françois pinault, walter benjamin, pop art, op art, art conceptuel, andré breton, surréalisme, sol lewitt, guy debord, la société du spectacle
samedi, 12 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS
ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
7/9
Du pré carré de la propriété intellectuelle (ou "Art et Image de Marque").
Nulle nostalgie dans tout ça, je vous assure. Simplement un regard effaré, abasourdi sur le monde réel et sur le monde de l’art tels qu’ils se fabriquent, jour après jour, avec une constance proprement effrayante. Au 20ème siècle, les artistes (musique, peinture, poésie, sculpture, architecture, …) se sont mis à « s’exprimer », à développer des « formes-sens » qui leur fussent propres, chacun avec son langage à lui, sa « grammaire » à lui, son « vocabulaire » à lui. Leur marque de fabrique, la raison pour laquelle certains noms brillent d’un éclat particulier au firmament esthétique, c’est leur capacité à synthétiser tout ce qui se faisait autour d’eux, jusqu’à faire de leur travail quelque chose qui a été considéré à la fois comme unique et comme supérieur, voire emblématique.
Les « écoles » en -isme sont devenues des tendances, des « groupes », voire des « courants » aux contours flous et aux étiquettes fluctuantes : Cobra, Factory, Support / Surface, Fluxus, Abstraction lyrique, Nuagisme, Figuration narrative, Pop art, Expressionnisme abstrait, Art performance, Installations, … Ce qui a fait de Picasso un cas si particulier, le grand homme du 20ème siècle, c’est d’abord sa longévité (mort à 91 ans, ça aide), et aussi une énergie créative démesurée et une voracité hors du commun, qui lui ont permis de ne faire qu’une bouchée de toutes les tendances successives, au fur et à mesure de leur apparition, et de donner à chacune un état d’accomplissement qu’elle n’aurait jamais pu espérer. Tout en ne s’interdisant pas d’en créer autant de personnelles. C’est sûr, Picasso est incontournable : cela fait-il de lui un des plus grands artistes de l’histoire de l’art ? Je me permets d’en douter fortement (au 19ème siècle, Victor Hugo aussi fut "incontournable". "Hélas", ajoutait André Gide).
Avec la mondialisation montante, chaque musicien, pour écouter tout ce qui passait à portée d’oreille, chaque peintre, pour saisir tout ce qui pouvait titiller sa rétine, a eu à sa disposition un réservoir absolument inépuisable (en apparence) : tout le réel, tout le passé de l'humanité, toute la géographie de l'art, dans l'infinie hétérogénéité de leur diversité, ont été embauchés. Chaque artiste a été prié de déposer au vestiaire de la « Modernité » le carcan de tous les codes d'expression qu'il avait appris à l'école (occidentaux, donc arbitraires, donc à bannir). Et de "s'ouvrir au monde". Et d'inventer pour son seul compte un nouvel alliage pour bâtir un édifice que nul autre que lui n'aurait pu concevoir : matériau, ciment, plan d'ensemble, méthode d'édification, aspect extérieur, et tout ça et tout ça.
 La documentation des artistes n’avait jamais été aussi volumineuse : chacun est devenu une véritable encyclopédie universelle. On peut dire ça autrement : le monde est devenu, pour les artistes, un gigantesque SUPERMARCHÉ. Le travail d’un grand nombre d’entre eux fut dès lors un travail de sélection, comme on remplit son caddie, puis de recombinaison des éléments retenus, si possible jamais opérée auparavant. La "LIBERTÉ" s'est racornie en liberté de choix. La liberté de choix, c'est celle du client : "Qu'y a-t-il en rayon ?". Le client est roi, dit-on : c'est parce qu'il paie. La liberté de choix est celle qui s'achète. Plus tu as les moyens, plus tu es libre. La LIBERTÉ, au contraire, ne saurait s'acheter, son prix est astronomique. Stratosphérique. Tout l'or du monde, et encore, on en est loin ! Même Bill Gates n'a pas les moyens.
La documentation des artistes n’avait jamais été aussi volumineuse : chacun est devenu une véritable encyclopédie universelle. On peut dire ça autrement : le monde est devenu, pour les artistes, un gigantesque SUPERMARCHÉ. Le travail d’un grand nombre d’entre eux fut dès lors un travail de sélection, comme on remplit son caddie, puis de recombinaison des éléments retenus, si possible jamais opérée auparavant. La "LIBERTÉ" s'est racornie en liberté de choix. La liberté de choix, c'est celle du client : "Qu'y a-t-il en rayon ?". Le client est roi, dit-on : c'est parce qu'il paie. La liberté de choix est celle qui s'achète. Plus tu as les moyens, plus tu es libre. La LIBERTÉ, au contraire, ne saurait s'acheter, son prix est astronomique. Stratosphérique. Tout l'or du monde, et encore, on en est loin ! Même Bill Gates n'a pas les moyens.
Chaque artiste ainsi miniaturisé en client, musicien ou autre, ayant ainsi fait ses emplettes dans le grand magasin planétaire, se retire alors dans son laboratoire, parmi ses cornues, ses athanors, ses alambics, ses aludels, ses matras, ses mortiers, pilons et autres pélicans (on peut vérifier les termes), pour se livrer à l’élaboration de son Grand Œuvre, sa Pierre Philosophale à lui. C'est devenu un bidouilleur de chimie. Un bricoleur d'éprouvettes.
Dans le supermarché planétaire et de l’histoire de l’art, il a sélectionné son propre « vocabulaire », collection de substances qui n’appartienne qu’à lui, sa propre « grammaire », façon personnelle de mettre en ordre, d’assembler les éléments de la collection globale. Il a rédigé ses protocoles expérimentaux. Il en a publié le résultat dans des "revues à comité de lecture". Lu et approuvé par la communauté des semblables. Toutes les apparences, en effet, de la scientificité.
 Tout cela ayant été mené à bien, l’artiste, musicien, poète ou plasticien, s’est fait le maître d’un « langage » qui rend ses œuvres reconnaissables entre toutes. C’est ainsi que Yves Klein a pu faire breveter son bleu « YKB », que Pierre Soulages a inventé l’ « outre-noir », que Mondrian s’est illustré comme le coloriste de la géométrie pure, que François
Tout cela ayant été mené à bien, l’artiste, musicien, poète ou plasticien, s’est fait le maître d’un « langage » qui rend ses œuvres reconnaissables entre toutes. C’est ainsi que Yves Klein a pu faire breveter son bleu « YKB », que Pierre Soulages a inventé l’ « outre-noir », que Mondrian s’est illustré comme le coloriste de la géométrie pure, que François Rouan a popularisé le tressage de toile peinte (que Jacques Lacan tenta - un peu en vain, si j'ai bien compris - d'enrôler dans sa théorie des fameux "nœuds borroméens", mais le grand homme était un peu "affaibli", et c'était peut-être Rouan qui était le plus déçu), que Roy Lichtenstein est devenu le recycleur en chef de vignettes de BD
Rouan a popularisé le tressage de toile peinte (que Jacques Lacan tenta - un peu en vain, si j'ai bien compris - d'enrôler dans sa théorie des fameux "nœuds borroméens", mais le grand homme était un peu "affaibli", et c'était peut-être Rouan qui était le plus déçu), que Roy Lichtenstein est devenu le recycleur en chef de vignettes de BD  érigées en œuvres à part entière, que Jackson Pollock, avec quelques autres, a fondé l’ « action painting », cette danse à trois temps qu’il pratiquait sur de très grandes toiles posées au sol, etc. Tous ces gens ont confisqué l'objet de leur choix en en faisant un monomanie exclusive (pas toujours brevetée, reconnaissons-le, ni dûment déposée à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle).
érigées en œuvres à part entière, que Jackson Pollock, avec quelques autres, a fondé l’ « action painting », cette danse à trois temps qu’il pratiquait sur de très grandes toiles posées au sol, etc. Tous ces gens ont confisqué l'objet de leur choix en en faisant un monomanie exclusive (pas toujours brevetée, reconnaissons-le, ni dûment déposée à l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle).
 Les artistes ont pu proclamer : « Ceci est à moi ! » (implorons la pitié des mânes de Jean-Jacques Rousseau : « Le premier homme qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : "Ceci est à moi"... », Discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes). A Arman les accumulations, à Christo l'emballage de monuments historiques, à Villeglé les affiches déchirées, à Viallat les séries d’empreintes d’éponge (jusqu'aux
Les artistes ont pu proclamer : « Ceci est à moi ! » (implorons la pitié des mânes de Jean-Jacques Rousseau : « Le premier homme qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : "Ceci est à moi"... », Discours sur l'origine et les fondements des inégalités parmi les hommes). A Arman les accumulations, à Christo l'emballage de monuments historiques, à Villeglé les affiches déchirées, à Viallat les séries d’empreintes d’éponge (jusqu'aux vitraux de l'église d'Aigues-Mortes, ci-contre : s'ils savaient ! Mais ils trouvent peut-être ça joli, s'il y a encore des fidèles pour assister à la messe à Aigues-Mortes), à Orlan les réfections chirurgicales de son corps en bloc opératoire, à Raynaud le carrelage de salle de bains (à joints noirs), à Tsykalov les pastèques sculptées façon tête de mort, à Buren les bandes parallèles, à Pagès les
vitraux de l'église d'Aigues-Mortes, ci-contre : s'ils savaient ! Mais ils trouvent peut-être ça joli, s'il y a encore des fidèles pour assister à la messe à Aigues-Mortes), à Orlan les réfections chirurgicales de son corps en bloc opératoire, à Raynaud le carrelage de salle de bains (à joints noirs), à Tsykalov les pastèques sculptées façon tête de mort, à Buren les bandes parallèles, à Pagès les  totems, à Warhol les "multiples" (Campbell soup, Marilyn), à César les compressions et expansions, on n’en finirait pas, il suffit de trouver l’IDÉE, puis de la presser jusqu’au trognon pour en tirer tout le jus. Plus personne n'enchérit ? Pas de regret ? Adjugé !
totems, à Warhol les "multiples" (Campbell soup, Marilyn), à César les compressions et expansions, on n’en finirait pas, il suffit de trouver l’IDÉE, puis de la presser jusqu’au trognon pour en tirer tout le jus. Plus personne n'enchérit ? Pas de regret ? Adjugé !
 Jean-Pierre Raynaud a fini par réduire en petits morceaux sa
Jean-Pierre Raynaud a fini par réduire en petits morceaux sa maison-salle-de-bains. Il a mis les morceaux dans des seaux.
maison-salle-de-bains. Il a mis les morceaux dans des seaux.
Ces seaux remplis de ces gravats, il les a solennellement  exposés, puis vendus, j’ignore à quel prix. Raynaud, récemment, a été choqué d'apprendre que la ville de Québec a détruit son monument (toujours en carrelage de salle de bains, en marbre, cette fois, toujours jointoyé de noir : trente tonnes de béton !) intitulé "Dialogue avec l'histoire". Rendons grâce à la ville de Québec pour son courage et la sûreté de son sens des valeurs.
exposés, puis vendus, j’ignore à quel prix. Raynaud, récemment, a été choqué d'apprendre que la ville de Québec a détruit son monument (toujours en carrelage de salle de bains, en marbre, cette fois, toujours jointoyé de noir : trente tonnes de béton !) intitulé "Dialogue avec l'histoire". Rendons grâce à la ville de Québec pour son courage et la sûreté de son sens des valeurs.
A tous ces "artistes" devenus des marques déposées à l'INPI, l'image de marque a bientôt tenu lieu de style. Le "métier" des artistes s'est vu détrôné par le blason que chacun de ces faiseurs, se prenant pour quelque antique chevalier, avait dessiné sur son écu pour s'en parer, et sur son étendard pour le brandir. A chacun son fief, son apanage, son pré carré. Touche pas à mon concept.
La question qui se pose est (pour pasticher le Jacques Chancel de « Radioscopie ») : et l’homme, dans tout ça ? C’est bien là que le bât blesse. Réponse : il est absent. Peut-être s'est-il effacé. Ou alors il est mort. En tout cas, en tant que destinataire par nature des  œuvres, il a disparu du radar de la plupart des artistes. Je
œuvres, il a disparu du radar de la plupart des artistes. Je ne reviens pas sur les désintégrations successives de la peinture dite « figurative », qui a très longtemps fait une place centrale à la « figure » (humaine) et au milieu dans lequel celle-ci se mouvait. Je pense ici à la saisissante série des "Otages" de Jean Fautrier (à gauche). Pierre Tal-Coat est allé jusqu'à barbouiller ses autoportraits (à droite). Fautrier, Tal-Coat : deux frères, deux démarches terriblement pleines de sens. De quoi frémir un bon coup.
ne reviens pas sur les désintégrations successives de la peinture dite « figurative », qui a très longtemps fait une place centrale à la « figure » (humaine) et au milieu dans lequel celle-ci se mouvait. Je pense ici à la saisissante série des "Otages" de Jean Fautrier (à gauche). Pierre Tal-Coat est allé jusqu'à barbouiller ses autoportraits (à droite). Fautrier, Tal-Coat : deux frères, deux démarches terriblement pleines de sens. De quoi frémir un bon coup.
Je ne reviens pas non plus sur l’insupportable agression dont les mélomanes, depuis Schönberg (et Varèse, et Schaeffer après lui), ont commencé à être victimes de la part de compositeurs dont beaucoup ne se considéraient plus comme les producteurs de plaisirs musicaux, mais comme des chercheurs lancés à la poursuite de codes sonores jusqu’alors inconnus, de langages musicaux d’un nouveau genre. Ils se sont mis à vociférer : « A bas la tonalité ! A bas la consonance ! A bas la mélodie ! A bas le chant ! A bas le plaisir ! A bas la dictature de l’oreille ! Vive la Dissonance absolue ! Que nous importe le destinataire ? C'est à l'oreille de s'adapter à nos théories ! Nous sommes la "Nouvelle Harmonie" ! ».
Comme en peinture, les désintégrations se sont succédé : le destinataire des sons musicaux a fini par être éliminé, comme un vulgaire gêneur, comme un parasite. Comme un consommateur, sommé par la publicité d'acheter les produits innovants. En musique, en peinture, l'argument d'autorité s'est substitué à la publicité. Ces chercheurs trop savants, ces scientifiques trop intelligents, réfugiés au fond de leurs laboratoires, ont concocté de nouvelles sonorités, de nouvelles combinaisons, en se disant : « Quel dommage que mon travail d’orfèvre finisse dans l’oreille d’auditeurs conformistes, passéistes, incapables d’en apprécier l’ingéniosité, l’originalité, la nouveauté ! ».
Voulez que je vous dise ? Pierre Boulez et son pote Karlheinz Stockhausen (ah, l'Helicopter-Streichquartett, quel pied !) : de la confiture aux cochons !
Je veux bien être considéré comme un cochon (car en lui tout est bon, à ce qu'on dit), mais qu'est-ce qu'on essaie de me faire croire ? De la confiture, cette tambouille immangeable ? Ne me faites pas vomir : c'est mauvais pour la qualité de la viande.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, musique, peinture, inpi, institut national de la propriété industrielle, image de marque, mouvement cobra, factory andy warhol, support surface, abstraction lyrique, pop art, expressionnisme abstrait, pablo picasso, yves klein, pierre soulages, piet mondrian, françois rouan, jacques lacan, roy lichtenstein, jackson pollock, action painting, jean-jacques rousseau, arman, jacques mahé de la villeglé, viallat église aigues mortes, orlan, jean-pierre raynaud, daniel buren, bernard pagès, andy warhol, campbell soup, jean fautrier, pierre tal coat, arnold schönberg, edgar varèse, pierre schaeffer, pierre boulez, karlheinz stockhausen, helicopter streichquartett, discours sur l'origine et les fondements des inégalités
dimanche, 07 décembre 2014
L’ART CON AU MUSÉE
2
J'ai décidé de ne plus parler d' « Arcon », mais d'appeler les choses par leur nom. Je parlais de Jeff Koons, homme d'affaires. Chef d'entreprise. Dans l'industrie, où l'on sous-traite beaucoup, il paraît qu'on appelle ça un « donneur d'ordre ». Je trouve que ça lui va bien.
Toujours est-il que c’est cet « artiste » qui, après avoir envahi Versailles de ses « Balloons » et autres homards, se voit célébré par le Centre Pompidou, qui consacre une grande « rétrospective » à toute l’œuvre du grand homme. D’après le directeur de l’institution, Jeff Koons et toutes ses équipes (si, si !) se sont comportés en grands « professionnels ». Je n'en doutais mie. Toutes mes félicitations néanmoins.

Il paraît que c’est l’ « artiste » le plus cher du monde. Grand bien lui fasse. Mais pourquoi vouloir à tout prix être considéré comme un artiste ? Andy Warhol nous avait en son temps fait le même coup, alors que toute l’industrie warholienne repose sur son envie dévorante de gagner beaucoup d’argent. Ce qui n’était pas totalement le cas de Marcel Duchamp, son grand-père artistiquement génétique. S'il n'était pas dénué d'esprit de lucre (dame, il faut bien vivre !), du moins ne l'affichait-il pas de façon aussi ostentatoire (« décomplexée » serait plus dans l'air du temps).

Wim Delvoye : "œuvre" sortie de sa machine à caca (Cloaca).
Jeff Koons est encore plus cynique qu’Andy Warhol. Au départ, cet étudiant doué pour les chiffres et les opérations boursières se présente sur le marché du travail comme un « trader ». Ce qui, en anglais, signifie « commerçant ». Son métier ? Courtier (« adviser » ?) en matières premières sur la place de Wall Street. Je ne sais pas si l'image ci-dessous est en mesure de confirmer cette assertion de l'encyclopédie en ligne. Si la dame, après tout ne fait que son métier d'actrice porno, qu'en est-il du métier du monsieur ? Il n'a visiblement pas toujours sous-traité les tâches de réalisation. Sa façon de mettre la main à la pâte, peut-être ?

C'est bourré de concepts ? Fallait le dire !
Au moment où il se dit que le marché de l’art offre des perspectives incomparables de spéculations financières fabuleuses, ce n’est pas que l’art l’intéresse, c’est qu’il a des idées à vendre. S’il se lance dans l’art, c’est juste parce qu’il y voit un « vecteur privilégié de merchandising ». C’est tout. C'est lui qui le dit.

Un monochrome avant la lettre d'un nommé Alphonse Allais.
Il se souvenait qu’Andy Warhol lui-même avait acheté l’idée de la « Campbell Soup » à une copine galeriste. Pour faire du pognon avec un truc qui ne dépasse pas le niveau "Arts Déco". Mais Warhol n’avait pas d’idées, et il fallait amorcer la pompe. C'est lui qui disait que c'est trop difficile, de peindre. Koons, lui, il en a, des idées. Le premier « coup » de Jeff Koons, c’est évidemment la Cicciolina, l’actrice porno, qu’il va même jusqu’à épouser. Et la rédemption, ça marche ! Tout le monde marche.

On me dira qu’il y a eu un marché de l’art dès qu’il y a eu civilisation. On me dira que les milieux de l’art, dès le premier moment de leur existence, ont connu les opportunistes les plus éhontés, les plus cyniques. On me dira que les plus grands artistes ont eu besoin des puissants, de leur « protection », de leur argent pour « laisser libre cours à leur art ».
Certes, je ne dis pas que c’est faux. Simplement, je trouve horriblement moche d'en être arrivé à une civilisation capable de donner honte à quelques-uns d'y appartenir. Et d'en être un produit. Peut-être un déchet.
Quelle est, en dernière analyse, dans le corpus hautement signifiant d'une contemporanéité progressiste soucieuse, de ce fait, d'exprimer, dans ses visions fulgurantes, l'âme future de l'humanité, la fonction sémiologique des prouesses amoureuses, supposées ou réelles, de Jeff Koons ?

Maurice Tillieux adorait l'art contemporain.
Faudra-t-il considérer ses éjaculats sur la face extasiée (?) de la Cicciolina comme l'insémination prémonitoire d'un avenir radieux dans le ventre d'une modernité qui attendrait d'enfanter on ne sait quel monstre ?

Certains "concepts" sont comme le camembert. Quand ils sont trop mûrs : ils coulent.
Les activités de ce petit monsieur, sûrement un excellent homme d'affaires, ne cherchent même pas à se donner le prétexte de « faire de l’art ». Seulement de l’argent. Le reste est une histoire de « Storytelling ». Et de « merchandising ». Mais il prétend mordicus au statut d'artiste.
Au royaume des « Bonnisseurs de la Bath » (= "bonimenteurs", c'était le patronyme donné à OSS 117 par son inventeur Jean Bruce), les Koons, McCarthy, Delvoye, Hirst et compagnie sont rois.
A voir ce dont sont grosses les prémonitions de l'avenir radieux, je ne suis pas près de quitter les rangs des diplodocus et des ptérodactyles : j'aime bien comprendre ce qu'on me dit quand on s'adresse à moi. Et j'en ai assez des bonimenteurs.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : à part Gaston Lagaffe (Franquin, Le Géant de la gaffe, p. 51) et Libellule (Maurice Tillieux, Popaïne et vieux tableaux), je précise que j'ai trouvé les illustrations en errant et tâtonnant sur la "toile".
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, art contemporain, jeff koons, mécène, françois pinault, palazzo grassi, château de versailles, koons à versailles, balloon dog, rétrospective koons centre pompidou, andy warhol, marcel duchamp, wim delvoye, pornographie, la cicciolina, alphonse allais, campbell soup, oss 117, paul mccarthy, jean bruce, damien hirst
jeudi, 20 juin 2013
ORWELL N'AIME VRAIMENT PAS DALI

ENFANTS DE PAYSANS, PAR AUGUST SANDER
(BAUERNKINDER)
***
« Dali est un bon dessinateur et un être humain répugnant ». C’est là que nous en étions restés.
Le verdict moral de George Orwell à propos de Salvador Dali est sans appel. Mais il ne se contente pas d’un jugement moral. Car sans être un spécialiste de l’art pictural, il sait raisonner en s’appuyant sur le bon sens, mais aussi sur les choses qu’il connaît, et là, on peut dire qu’il a le sens de l’histoire de la peinture. Il va donc parler de Dali peintre. Et ça devrait décoiffer tous les adeptes séduits par la « palette » du « maître » !
« Ah, Dali le déliquescent, on ne comprend pas tout, mais qu’est-ce que c’est bien fait ! » Eh bien on peut dire que les adeptes devraient s’améliorer en matière de culture picturale. Il y a comme un « chaînon manquant ». Et il faut l’inculte (!) Orwell (en matière de peinture) pour débusquer l’escroc sous l’avant-gardiste.
Il n’est pas question pour lui d’exiger l’interdiction de l’autobiographie (réelle et fictive tout à la fois) de Salvador Dali : « … c’est une politique contestable que d’interdire quoi que ce soit ». Une variante, somme toute, quoique bémolisée, de la célébrissime phrase de Voltaire : « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai etc. », parce qu’il ne faut pas exagérer, et qu’on ne peut lui demander l’impossible. Et puis finalement, ce n’est pas un problème d’accord ou de désaccord, mais un problème de choix de vie, voire une question de principe.
Car il prend soin de préciser, dans la suite de la phrase citée ci-dessus : « … les fantasmes de Dali éclairent sans doute utilement sur le déclin de la civilisation capitaliste. Mais ce dont il a assurément besoin, c’est d’un diagnostic ». Selon George Orwell, le résultat visible de la production « artistique » de Salvador Dali contient quelque chose de résolument avilissant pour l’homme : « Il ne devrait faire aucun doute que nous avons affaire ici à un esprit malade … ». Et encore ceci : « Il représente un symptôme de la maladie du monde ». Pour dire de quelle sorte est sa « grille de lecture ». Et combien je suis d’accord avec cette façon de voir.
Et puis en plus, George Orwell sait regarder. Il n’est pas historien de l’art, il n’est pas spécialement calé en critique de peinture, mais il dispose quand même d’un certain nombre de références. Et quand Dali ne fonce pas tête baissée sur la route surréaliste, l’attention de notre moraliste est attirée par « un indice qui constitue peut-être un début de réponse ». Cet indice est le style de dessin, qu’il juge en 1944 « démodé, surchargé d’ornements, édouardien ». C’est curieux d’ailleurs, car « édouardien », d'après ce que je crois en savoir, c’est plutôt la sobriété, opposée à l’exubérance victorienne du décor, mais je ne suis pas spécialiste. Peut-être un problème de traduction ?
Toujours est-il qu’il repère quelques influences dans le travail de Dali : Albrecht Dürer, Aubrey Beardsley, William Blake. Et puis, après avoir été troublé par une sorte de ressemblance générale qu'il a du mal à préciser, un détail attire son attention : un chandelier ornemental qui lui rappelle quelque chose. Bon sang mais c’est bien sûr : « la fausse bougie que l’on voit sur les lustres électriques, dans les hostelleries de campagne qui veulent se donner un style Tudor ». Et cela provoque immédiatement en lui « une vive impression de mièvrerie ». La mièvrerie de Salvador Dali ! C’était donc ça. Et les mouchetures d’encre semées pour dissimuler la chose n’y changent rien.
Il voit ici une image digne d’illustrer le conte de Peter Pan, là un crâne de sorcière de conte de fées. Et Orwell déduit : « Le pittoresque fait irruption à tout instant. Oubliez les têtes de mort, les fourmis, les homards, les téléphones et autres bric-à-brac, et vous vous retrouvez plongé dans l’univers de Barrie, de Rackham, de Dunsany et de Where the Rainbow Ends ». Le pittoresque ! Que des histoires pour enfants ! Ça la fout mal, pour celui qui se veut un grand pervers !
J. M. Barrie est le créateur de Peter Pan, Arthur Rackham un illustrateur de livres pour enfants, dont le dessin est empreint de préciosité, Lord Dunsany un auteur fantastique (La Fille du roi des Elfes), et le conte cité en dernier raconte l’histoire d’enfants qui voyagent sur un tapis volant. George Orwell voit Salvador Dali comme un enfant qui n’aurait grandi que physiquement. A tout prendre, il le juge indécrottablement infantile (scato, copro, nécro, sado, en un mot : pervers polymorphe). Etonnant, non ?
Pour enrichir son autobiographie, Dali n’a-t-il pas, au surplus, pioché dans les Ruthless Rhymes de Harry Graham, ces « comptines sans pitié pour foyers sans cœur » qui ne sont pas sans rappeler (c’est moi qui l’ajoute) Max und Moritz, les cruels enfants du grand Wilhelm Busch, finalement punis ? Par exemple, cette anecdote complaisante où il se vante d’avoir shooté dans la tête de sa petite sœur ressemble curieusement à la comptine féroce de Graham citée par Orwell.

LES IMPAYABLES, INÉNARRABLES ET INFERNAUX
MAX UND MORITZ,
DE WILHELM BUSCH
("Hélas, pourquoi faut-il souvent lire ou entendre parler de méchants enfants, comme par exemple les deux, ici présents, qui se nommaient Max et Moritz, qui, au lieu de se convertir au Bien au moyen d'un apprentissage ...", la suite un autre jour.)
Cet aspect de la pratique de Salvador Dali s’apparente à du pastiche. Sur ce, Orwell se lance dans une interprétation : « Mais il se peut que ces choses soient là également parce que Dali ne peut s’empêcher d’exécuter des dessins de ce genre, parce que c’est à cette période et à ce style de dessin qu’il appartient en réalité ». Ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve ça intéressant.
Orwell enfonce le même clou : « Et supposez que vous n’ayez rien d’autre en vous que votre égoïsme et un bon tour de main ; supposez que votre véritable don soit pour le style de dessin minutieux, académique, figuratif, et votre véritable métier celui d’illustrateur de manuels scientifiques. Comment faire, dans ce cas, pour être Napoléon ? Il reste toujours une solution : la perversité ». Nous y voilà.
Ce procédé, consistant à provoquer, heurter et choquer le spectateur, qui est devenu extrêmement banal aujourd’hui, et quasiment obligatoire, Dali a su en faire une mine d’or à son profit : « Lorsque vous lanciez des ânes morts à la tête des gens, ils vous lançaient de l’argent en retour ». Comme quoi derrière l'argent que des élites faisandées investissent sur des artistes orduriers, il y a toujours un calcul des retombées potentielles en termes de prestige social. Le prestige d'un âne mort. Ce qui nous change de Rabelais, qui dit (Gargantua, 16) : « et ne fut possible de tirer de luy une parolle non plus qu'un pet d'un âne mort ». Les temps changent. C'est le progrès.
Ce que je retiens de cette étude de George Orwell sur un des peintres les plus célèbres du 20ème siècle, c’est d’abord cette formule, à propos de l’individu : « Dali est un bon dessinateur et un être humain répugnant ». Cette autre : « Il ne devrait faire aucun doute que nous avons affaire ici à un esprit malade ».
C'est ensuite une remarque sur l'état moral du monde. Car il est loin d’être seul coupable : les amateurs, snobinards et richissimes qui font fête à des artistes comme Dali sont tout aussi dépravés. Je ne dis pas « dégénérés », parce que c’est ainsi que les nazis désignaient les peintres et les musiciens qui n’était pas dans leur ligne (Die entartete Kunst). Et la dépravation de Dali trouve son exact reflet dans la dépravation des amateurs : « Il représente un symptôme de la maladie du monde ».
La maladie du monde, le premier à la rendre visible, c'est un certain Marcel Duchamp : un destructeur, sans doute, pas un pervers. Un malin qui fait de l'art avec les objets existants, et qui va torpiller les critiques d'art en inventant l'art intellectuel (l'inépuisable Mariée mise à nu ..., l'indéchiffrable Etant donnés : 1° la chute d'eau ...). Salvador Dali est un malin d'un autre genre : l'ordure et le difforme sont élevés au rang d'oeuvre d'art. Avec Andy Warhol, vous avez enfin l'oeuvre d'art indéfiniment polycopiée, vous avez définitivement l'art commercial des sociétés de masse. Duchamp, Dali, Warhol : c'est le trépied sacré sur lequel est assis tout l'art du 20ème siècle.
Pour moi, Orwell prenant Dali comme preuve de la déliquescence morale de la civilisation occidentale, voilà un point de repère auquel les paumés que nous sommes peuvent à l'évidence se référer. Et chaque jour qui passe confirme le diagnostic de George Orwell. Autrefois, on parlait avec respect d'un homme dont la droiture était insoupçonnable. J'ai le bonheur de saluer à mon tour la personne droite et l'oeuvre intègre de GEORGE ORWELL. Même si c'est lui qui a perdu la guerre morale, et que la saloperie a gagné. Il faut être héroïque pour se tenir droit, quand c'est le monde qui est tordu.
Que dire de Salvador Dali ? Que dire des goûts de François Pinault ? De Bernard Arnault ? De tous ces milliardaires qui couvrent d’or des Jeff Koons et des Damien Hirst ? Que dire, sinon que tout ça est OBSCÈNE et LAID, VULGAIRE et SALE ?
Vous êtes très moches, messieurs.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, littérature, arts, peinture, salvador dali, george orwell, acrt pictural, peintre, morale, 1984, peter pan, jm barrie, arthur rackham, contes enfants, wilhelm busch, max und moritz, pastiche, marcel duchamp, andy warhol
lundi, 10 septembre 2012
L'ART D'AGATHE DAVID (PREAMBULE)
Pensée du jour : « Achras : Ô mais, c'est qué - y a point d'idée du tout de s'installer comme ça chez les gens. C'est une imposture manifeste ...
M. Ubu : Une posture magnifique ! Parfaitement, monsieur : vous avez dit vrai une fois dans votre vie ».
ALFRED JARRY
Je signalais, il y a quelques jours en bas de page, l'exposition AGATHE DAVID qui a lieu depuis jeudi à la Galerie Gilbert Riou (1, place d'Ainay, mais l'entrée est située rue Vaubecour).

AGATHE DAVID est une artiste. Comme je les aime. Car, contrairement à tous les « artistes » figurant dans mon album « art con et temporain » (ci-contre, n’hésitez pas à découvrir 80 façons de tuer l'art, à m’engueuler, voire à mépriser le néandertalien que je suis éventuellement), AGATHE DAVID ne désespère pas de la création artistique. Cette rareté attire forcément l'attention et la curiosité.
C’est vrai, aujourd’hui, la plupart des « artistes » ont emboîté le pas à MARCEL DUCHAMP. S'il n'est pas en personne le meurtrier, il en est l’emblème et le héraut. Le porte-parole et le messager. Le ready made (ci-contre, la "roue de bicyclette")  a mis le point final au parcours millénaire de l’Art. Or le ready made, c'est l'appel de trompette après lequel il n’y a plus qu’à déclarer : « L’ART est mort ! Il est temps de vous repentir ! ». Pour la suite, voir l'Apocalypse de Jean.
a mis le point final au parcours millénaire de l’Art. Or le ready made, c'est l'appel de trompette après lequel il n’y a plus qu’à déclarer : « L’ART est mort ! Il est temps de vous repentir ! ». Pour la suite, voir l'Apocalypse de Jean.
Mais celui qui souffle dans la trompette (et la cohorte de ceux qui le suivent), en même temps qu'il sonne "Aux Morts", comme un 11 novembre ordinaire, ouvre un extraordinaire marché à toutes sortes d’hommes d’affaires. Certains protestent en vociférant : « TOUT EST ART ». Mais je rétorque : « Et alors ? Quelle différence ? ». Et toc ! C'est vrai, ça : si la réalité, la nature, nos objets sont de l'art, où il se trouve, l'art artistique ? Si vraiment tout est art, ça signifie juste que plus rien n'est art.
« Art con et temporain », donc : en plaçant JEFF KOONS à la porte d'entrée de l’album ainsi intitulé, en train de saillir (il n'y a pas d'autre mot, n'est-ce pas ?) sa femme, l’actrice porno CICCIOLINA, c'est une modalité de la mort de l'ART que je voulais illustrer.

On constate pourtant, éberlué, que le cadavre de l'ART a revêtu, depuis les « audaces » de DUCHAMP (1913 et après, avec l'invention du READY MADE, qu'il soit "aidé" ou non :  porte-bouteilles, "fontaine", stoppage-étalon, ... On en fête bientôt le centenaire, préparez-vous, il est temps de vous repentir), une infinité de cadavres bien vivants, dont l’énumération gonflerait inutilement cette modeste note.
porte-bouteilles, "fontaine", stoppage-étalon, ... On en fête bientôt le centenaire, préparez-vous, il est temps de vous repentir), une infinité de cadavres bien vivants, dont l’énumération gonflerait inutilement cette modeste note.
Il n’y a pas besoin d'un couple forniquant pour confirmer l’obscénité essentielle, pour ne pas dire la pornographie d’une bonne part de ce qu’il est convenu d’appeler « art » contemporain. Disons que cette copulation symbolise assez bien une des grandes tendances de l' « art » contemporain : j'ai nommé le FOUTAGE DE GUEULE. 
Il est peut-être bon de rappeler que JEFF KOONS a commencé comme « courtier en matières premières » à Wall Street, et que s’il a changé d’orientation « professionnelle », s’il s’est lancé dans l’art, c’est, je le cite : « en tant que vecteur privilégié de mechandising ». On n’est pas plus « honnête ». Il ne s’agit de rien d’autre que de « glorifier des produits de consommation ». Comme son prédécesseur et mentor ANDY WARHOL.
Disons le fond des choses : l’artiste con et temporain n'est en général qu'un pervers nécrophile, qu'une chair nécrosée congénitale. Il prospère sur le cadavre de l’Art, comme l’insecte nécrophage sur la dépouille animale gisant au bord du chemin :
« Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d’été si doux :
Au détour d’un sentier une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux,
Les jambes en l’air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,
Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d’exhalaisons ».
CHARLES B. (je vous laisse deviner)
Après la mort de l’ART, donc, voici l’ « art-mort ». Debout les morts, entendait-on dans les tranchées de 1914. Eh bien qu'on se rassure : c'est chose faite ! Et qu'on se le dise, le cadavre se porte comme un charme :
« On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague,
Vivait en se multipliant ».
Si GEORGES BRASSENS pouvait parler, il dirait : « On s’aperçut que le mort avait fait des petits ». Car après le second coup de grâce dans la nuque de l'ART, porté par ANDY WARHOL, le cadavre se met à vivre sa vie, pleinement, joyeusement et « artistement » : « J’ai commencé comme artiste commercial, je veux finir comme artiste d’affaires » (WARHOL).
DUCHAMP ayant rédigé l’acte de décès à coups de « ready mades », WARHOL pouvait introduire la dépouille mortelle de l’Art dans l’univers de la marchandise et de la publicité, et le marchand d’ « art-mort » commercialiser ses charognes « pleines d’exhalaisons ». Car je pense qu'on sera d'accord : il n'y a rien de plus mort qu'une marchandise. Pire : une marchandise érigée en être vivant.
Si vous n’avez jamais vu un cimetière en effervescence, prenez un billet pour Le Caire, où beaucoup de drôles de silhouettes, de jour comme de nuit, errent entre les tombes. Elles ont investi les caveaux et les pierres tombales. Les gens normaux s'interrogent. Les cimetières du Caire connaissent une belle animation, même si elle est encore honteusement minimisée par les tour opérateurs. Vous verrez qu’il n’y a pas plus vivant qu’un cimetière.
L’art contemporain, c’est pareil : un univers de ZOMBIES, de morts-vivants, qui s’activent, s’affairent, font des affaires, essaient de « percer ». Une seule solution : l'évacuation. Tirez la chasse. S'il n'est pas trop tard.
Une seule solution : l'évacuation. Tirez la chasse. S'il n'est pas trop tard.
A la rigueur, reportez-vous à Trou dans la couche d’os jaunes, dans  la série « Pierre Tombal », de HARDY & CAUVIN, éd. Dupuis.
la série « Pierre Tombal », de HARDY & CAUVIN, éd. Dupuis.
L'art con et temporain est plus mort-vivant que jamais.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre, AGATHE DAVID.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : agathe david, art, dessin, exposition, galerie gilbert riou, lyon, art contemporain, marcel duchamp, andy warhol, jeff koons, cicciolina, pornographie, ready made, une charogne, baudelaire, georges brassens, campbell soup, zombie, mort-vivant, pierre tombal, hardy et cauvin, bande dessinée
samedi, 25 août 2012
LA METHODE VIALATTE 4/5
Pensée du jour : « Voilà un homme [à propos du Prince de Ligne]. Le reste est plèbe et fibre épaisse, imbécile, et nous vivons dans cet affreux malaise d'une affreuse civilisation qui sécrète elle-même les poisons dont elle mourra, par voie de suicide évidemment, sans trop tarder. Par auto-intoxication. Comme le scorpion qui se pique la nuque avec sa queue ».
Alexandre Vialatte
***
Résumé : je disais donc que la vie n’est qu’une digression. Mais j’en viens à mon sujet initial.
Oui, il s’agit bien d’en venir, enfin, à Alexandre Vialatte. Au sourire désolé qu’il pose sur l’époque dans laquelle il est obligé de vivre, à l’angle des rues Léon-Maurice Nordman et de la Santé (l’hôpital Cochin n’est pas loin à droite, la prison est en face). Quand il n'est pas dans son Auvergne. C’est à Paris. Il parle plus de la prison (qu’il a sous ses fenêtres) que de l’hôpital (un peu à l’écart de son champ de vision). On est dans le 13ème, au seuil du 14ème.
« Les pigeons de Paris, au vol lourd, tournent autour des toits de la Santé et se posent sur le rebord des fenêtres des cellules ; peint en blanc. Et numéroté : 128, 129, 130, ... Seraient-ce les colombes de la Paix ? Sur l'un des rebords il y a un petit pot bleu. En bas tournent les C.R.S., les sergents de ville, ou la garde mobile, la mitraillette braquée. En haut rêvent les détenus.
Ils rêvent, ils font des songes. »
Oh, l’époque où il vit, il la voit, il l’entend, il la renifle, il l'ausculte, il en a examiné les moindres coutures, et à son gré, le tissu se découd un peu trop vite. Il voudrait ralentir la chute. La culture, la civilisation (« La civilisation ne cesse de s'effondrer sous l'énergique poussée des hommes »). La langue (« Il ne faut pas de h à Nathalie »). La grammaire, ah, la grammaire (« Pas de subjonctif après après que ») ! La création littéraire. Son éloge incessant du labeur de moine pieux du bon écrivain. L'exaltation de l’artiste peintre maître de son art. La profondeur de son regard sur l’homme qui, par son travail, fait aux hommes le don d'une oeuvre.
Et l'acuité du regard qu'il porte sur la défaite humaine face à l’avènement du règne intraitable des recettes, des concepts et des coups de pub. Devant la victoire de l’idée sur l’œuvre, et du coup de pub sur le talent. L’idée, on la doit à Marcel Duchamp. L’art confondu à la publicité, à Andy Warhol. Les deux meurtriers en chef de tout ce qui, en d’autres temps, s’est appelé « art ». C'est grâce à tout ça qu'on lui doit cette célèbre phrase :
« ON N'ARRÊTE PAS LE PROGRES : IL S'ARRÊTE TOUT SEUL ».
La défaite devant le merchandising et le packaging. Le parking et le pressing. Le profiting et le n’importequ’ing. La cotation en bourse. La veuve écossaise. Les valeurs sonnantes. La Rolex à cinquante ans, le bling-bling. Accessoirement la tyrannie exercée par le succès des fausses gloires. L’inconsistance de la « surface médiatique », une surface sans profondeur, ça va de soi. La vanité des sunlights et le toc des plateaux de télévision. Ce qu'il appelle quelque part le « règne du faux ». A son époque, ce n’étaient déjà plus seulement des vues de l’esprit ou des anticipations, mais les stigmates incontestables d'une avancée irrésistible.
Vialatte a observé tout ça. Et nommé. Et envoyé à la poubelle. Avec la souveraine élégance de l’esprit dont il ne s’est jamais départi. C’est de là que lui vient le sourire désolé qui ne quitte jamais sa prose. Il sait que Rome assiégé ne pourra rien contre les barbares qui se pressent sous ses murs. Mais qu'on ne compte pas sur lui pour les laisser entrer : tout ce qu'il écrit a de la tenue.
Aucune brèche dans la muraille du style. Cette colonne vertébrale sert à se tenir bien droit. Mais en même temps une bonhomie dépourvue de prétention. Les fureurs injuriantes d’un CÉLINE ne sont pas de sa planète à lui, mais son pessimisme n'a rien à lui envier. Rien que lorsqu'il définit l'homme : « Animal à chapeau mou qui attend l'autobus 27, au coin de la rue de la Glacière ».
Je vais vous dire un truc définitif : Vialatte est un sourire désolé posé sur le monde sinistré qui l’entoure.
L’Amérique domine ? Il s’en attriste, certes, mais il refuse obstinément de le laisser paraître. Si, bien sûr, les bulles de colère éclatent à la surface, mais c'est difficile à repérer, car c’est toujours une colère courtoise, civilisée, exprimée dans les formes. Littéraires, évidemment. Et surtout qui n’a jamais l’air d’une colère.
Il se sait impuissant contre le « mouvement de l’histoire » et contre la régression tant redoutée vers la barbarie. De ce point de vue, il me fait penser à Claude Lévi-Strauss, celui de Regarder, écouter, lire (en 1993, il a 85 ans, et il meurt centenaire en 2009, il a eu le temps d'en voir).
Comme Vialatte, Lévi-Strauss voit. Sur la fin, il sait toute la saloperie qui est en train d’arriver et qui réduit à néant tout l’effort d’élévation qui fut celui de l’homme depuis ses origines. Il ne joue pas les prophètes. Il voit agoniser un monde qui fut beau. Pas que beau (excusez-moi, mais là, c’est justifié), mais non sans grandeurs diverses. Et voyant cela, il se tourne vers l’essentiel de ce qui constitue SA culture (la mienne aussi), à lui qui a tant œuvré pour les cultures des autres, des « primitifs », comme on disait.
Dans Regarder écouter lire, Lévi-Strauss se tourne vers Poussin, Rameau, Diderot. Il ne se désole pas de l’état du monde tel qu’il est ou sera. Simplement, lui, l’anthropologue et l’ethnologue de peuplades en voie de disparition (et souvent déjà disparues) choisit de s’incliner devant trois statues en or massif, dont chacune figure à elle seule la majesté, la puissance, le génie de l'art français classique, dans la peinture, la musique et la littérature : Poussin, Rameau, Diderot.
Oh, nulle contrition dans son propos. Il assume toujours (hélas !) Roman Jakobson, l'aridité, la sécheresse universitaires de la linguistique et de l’anthropologie structurales. Mais je veux être convaincu que, en écrivant ce livre, Lévi-Strauss s’est rendu compte du destin tragique de SA culture (la mienne aussi), et qu’il y a, dans Regarder écouter lire, au moins en négatif, la manifestation d’un regret.
Sa façon de célébrer, pour finir, trois génies français d'un lointain passé désigne, au moyen même de tout le reste qu'il ne dit pas, le délabrement qu'il ressent de la culture de son époque. La célébration de cet art français vaut condamnation de ce qui se répand au présent sous le nom de culture.
Le problème, c'est qu'il a participé à la démolition structuraliste. Rien que le fait de décider que, grâce aux structures des contes, de la parenté ou de je ne sais quoi, on va pouvoir mettre l'humanité entière dans un grand sac unique, ce n'est finalement qu'une idéologie. Et je veux me dire que Lévi-Strauss s'est rendu compte de ce à quoi à servi le structuralisme : le nivellement de tout. La destruction de tous les critères (parce qu'un critère permet un jugement). Il ne faut plus juger. Cela veut dire qu'il ne faut plus différencier. L'autre est devenu le même. Le Mal, c'est le critère de jugement. Il faudra bien que j'y revienne, à cette folie.
Alexandre Vialatte lui, n’a jamais été structuraliste : il a donc eu moins à se faire pardonner. Il n'a jamais été un homme de la théorie englobante. Disons que, s’il a souri désolément, c’est d’une autre manière, plus directe et franche peut-être. La "pensée du jour" qui ouvre cette note espère en être une vive illustration. Il lui arrive même, à Vialatte, d'être terrible de noirceur.
On ne peut pas lui donner tort, tant le vingtième siècle a détruit : la première guerre de destruction des hommes (14-18), la première guerre de destruction des femmes et des enfants (39-45), mais aussi, tout au long du siècle, et de plus en plus arrogante, la première guerre de destruction américaine, pacifique et commerciale des racines des peuples, et le rouleau compresseur n'a pas fini d'avancer.
Pas de théorie donc chez Vialatte, certes, mais une méthode. Et sa méthode, il en fait cadeau : « Je ne vends pas la recette, je la donne ». Ecrivain, il a prouvé aux éclairés qu’il sait écrire des romans (Battling le ténébreux, et surtout Les Fruits du Congo, si vous ne connaissez pas, jetez-vous). Peu connu, mais estimé de confrères qui comptent, il livre donc sa recette à tous ceux – et ils sont nombreux – qui se proposent d’écrire : « Commencez par n’importe quoi », dit-il martialement.
Et plus loin : « Pour la conclusion, même principe : concluez sur n’importe quoi ». Ainsi, vous avez votre première page et la dernière. Quant au reste : « Mais que doit-on mettre entre la préface et l’épilogue ? Qu’on ne me le demande jamais, car je ne l’ai jamais su ». Voilà qui a le mérite de la netteté, même si ça n’arrange pas le débutant. Et l’on peut être sûr qu’il est sincère.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, fantaisie, digression, prison de la santé, paris, auvergne, grammaire, style, écrivain, marcel duchamp, andy warhol, art, publicité, télévision, louis-ferdinand céline, claude lévi-strauss, regarder écouter lire, nicolas poussin, diderot, jean-philippe rameau
mardi, 22 novembre 2011
DITHYRAMBE AU CACA DE CHIEN
MERCI ET BRAVO A TOUS LES CHIENS !
Je voudrais me tourner aujourd’hui vers nos frères inférieurs, ces compagnons de nos veilles les plus studieuses comme de nos échappées les plus folâtres, de nos humeurs les plus dyspeptiques comme de nos instants de déréliction les plus pathétiques. Je voudrais m’adresser à eux pour les remercier.
Merci à vous, mes frères inférieurs. Je vous rends grâce. Vous avez accepté de quitter les champs fertiles et les verts pâturages au cours d’un exode rural que nulle autre espèce que la vôtre n’a jamais eue à subir, pour vous enfermer dans des appartements de vingt-cinq mètres carrés avec des individus drôlement moins drôles que les rats des champs, et avec des mollets qu’il vous est interdit de caresser avec les dents quand l’envie vous en prend.
Merci à vous, en particulier, d’avoir gardé de vos campagnes ancestrales la saine et sainte habitude de parsemer les champs de nos trottoirs de vos superbes fleurs d’anus, qui ouvrent leurs corolles généreuses aux semelles de nos chaussures, heureuses de transporter jusque sur nos moquettes épaisses et claires quelques pétales de vos bouquets aux mille senteurs.
Merci aussi à vous, les maîtres de si charmantes créatures, qui n’hésitez pas à partager avec tous les inconnus que vous croisez la si délicate attention qui sort du derrière de vos compagnons à quatre pattes. Je n’hésite pas, en chantant vos louanges, à vous comparer à ces sublimes donateurs de tableaux d’église, tels les glorieux chancelier Rolin, chanoine van der Paele et Chartreux, dont nous avons conservé les traits par la magie des pinceaux de Jan Van Eyck, dans ses célébrations de la Vierge.
Oui, merci à vous, ô donateurs : vos chiens sont les pinceaux vivants de votre art éternel. Pour être parfaitement exact, je devrais dire qu’ils sont les tubes que l’on presse pour en faire sortir la couleur. Quant aux trottoirs, ils sont les palettes de votre inépuisable inspiration esthétique, en même temps que la toile qui s’offre à vos élans créateurs. Fidèles, passant et repassant inlassablement chaque jour, renouvelant et mélangeant avec subtilité et audace les pâtes colorées, vous faites apparaître à nos yeux émerveillés des paysages aux tons enchanteurs sortis des culs canins que vous entretenez avec amour.
Ici, cette pincée d’un bistre si subtil, presque éthéré, offerte par la bouche arrière de quelque pékinois pincé et hautain, retrouve, on ne sait comment, la simplicité primitive de ses ancêtres frustes, dont l’esprit jamais ne fut effleuré par l’idée de s’arracher à sa glèbe originaire, à laquelle est intimement attachée la botte paysanne, et dans laquelle elle se ressource à tout moment.
Alors, et alors seulement, la botte citadine se ressouvient de ses racines et pousse, au moment d’écraser l’offrande qui lui est destinée, un profond soupir d’indicible contentement : « Rhââ lovely ! ».
Là, ce monticule de rouge profond, d’un caroténoïde triomphant, voire insolent, tout droit sorti de l’orifice arrogant et puissant d’un dogue allemand de superbe embonpoint, dessine l’ocre éclatant de la falaise des ailleurs qui nous appellent aux éternels voyages, en des incantations mystérieuses et ensorcelantes.
Son « parfum exotique », « qui circule dans l’air et m’enfle la narine » et qui n’est pas sans rappeler (de loin, si possible) celui « des verts tamariniers » (Baudelaire), insuffle sa force au passant trop timide, à la passante apeurée, à l’enfant impressionné, au vieillard effarouché.
Heureux celui qui là, venant aux heures tardives, va prendre des deux pieds assez de souvenirs pour toute une longue soirée d’analyse de l’oeuvre. On l’entendra longtemps, dans la nuit magnétique, manifester son enthousiasme et entonner son cantique d’action de grâce et de bonheur : « Rhââ lovely ! ».
Et quelle extase enfin, quand deux ministres canins, pour le moins plénipotentiaires, croisant à l’improviste leurs humeurs colorectales aux nuances irisées, extraites en grande pompe et en couches alternées de leurs trappes aux immondices, marient la sobriété d’un coloris chatoyant de chocolat au lait aux pressentiments sombres d’un chocolat noir digne d’Hamlet. Vous l'entendez jouir, le spectre d'Hamlet ? Oui ! On entend distinctement : « Rhââ lovely ! ».
Merci à tous les chiens ! Merci à tous leurs maîtres ! Sur cette école d’art appliqué à ciel ouvert, l’humble peintre contemporain prendra modèle, que dis-je, prend d’ores et déjà modèle, et depuis quelque temps, comme on le constate dans la plupart des galeries et musées d’art assez modernes pour flairer, c’est le cas de le dire, les tendances à la mode.
C’est fou ce que l’humble peintre contemporain s’inspire de ses professeurs à quatre pattes pour obturer le vide inspiratoire de la toile blanche tendue sur son cadre, comme un trou à plâtrer. Je propose cette idée à tous les ANDY WARHOL qui s’efforcent de percer, parmi la meute de loups affamés qui peuplent le milieu impitoyable qu’on appelle art contemporain. A condition qu’ils s’efforcent d’acquérir la technique du métier par une discipline appropriée. Reprenons.
On commence par un cours sur l’étalement des matières, selon les deux étapes didactiques désormais bien connues : ouverture commandée du sphincter troufignesque, pour la partie « production », puis étalement proprement dit, pour la partie « mise en forme ».
Cette dernière étape, assez convenue dans son déroulement méthodologique, revêt une infinité d’aspects qui dépendent d’un grand nombre de facteurs, dont j’indique ici les principaux : poids de la personne, longueur et largeur des semelles, parties de celles-ci qui « entre en contact » avec la matière, sexe de la chaussure.
A cet égard, on ne saurait sous-estimer les possibilités d’exploitation qu’offrent les différences entre, mettons, pour aller vite, le haut escarpin à la Marlène Dietrich ou le léger « trotteur » des dames, d’une part, et d’autre part, les brodequins, mocassins et autres pataugas arborés par les messieurs. Une mention spéciale (et une pensée apitoyée) pour les amateurs, en été, de marche en « tongs », bien que lui, de toute façon, soit obligé de se laver les pieds avant de se mettre au lit.
Pour les cours de couleurs, on n’épiloguera pas, et l’on renverra le lecteur au Vincent Van Gogh des Mangeurs de pommes de terre, au Jean Dubuffet de Paysage blond. L’explication en est simple : la palette du chien, en peinture, ce n’est pas l’arc-en-ciel, loin de là. Elle se limite malheureusement à l’insuffisante variété de son alimentation. Il est excessivement rare et difficile d’obtenir un beau bleu soutenu. Le vert manque de netteté. Quant au jaune, il va souvent de pair avec une liquidité extrême de la matière, très difficile à manier, par définition.
Quoi qu’il en soit, je tenais à rendre cet hommage à la gent canine, si souvent et si injustement décriée par tant de renfrognés, tant de vieux béotiens bougons et de malappris sans culture, sans aucun goût pour les œuvres esthétiques, non seulement assez égoïstes pour se passer de talents picturaux incomparables, mais encore assez outrecuidants pour dénigrer les travaux de recherche désintéressée d’artistes à quatre pattes, uniquement soucieux d’apporter gratuitement un peu de beauté dans l’univers désincarné de nos villes de pierre.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, crottes de chiens, chiens, animaux de compagnie, jan van eyck, rhââ lovely, baudelaire, art contemporain, andy warhol, marlène dietrich, van gogh, jean dubuffet
dimanche, 23 octobre 2011
MUSIQUE, PEINTURE ET SALMIGONDIS
Regardez en peinture, comment ça se passe : il y a longtemps, c’était du temps de la Galerie K (quai de Bondy, non loin de la salle Molière) et de Colette Kowalski, veuve du poète lyonnais Roger Kowalski, mort trop tôt, je m’étais permis de faire remarquer à Régis Bernard (qui avait repris l’atelier de Henri Vieilly, place Antonin-Poncet, il me semble) que sa peinture me faisait tout à fait penser à celle de Giorgio Morandi. Dans mon esprit, c’était plutôt flatteur, car Morandi est un tout grand artiste. Il n’avait pas donné l’impression d’être démesurément flatté de ma remarque. Et pourtant, Régis Bernard est un vrai bon peintre.
Cela montre peut-être combien est grande, sur l’artiste (poète, musicien, peintre), la pression d’une exigence : apporter du nouveau, en particulier un « style » qui devienne sa « patte » reconnaissable et irréfutable. Qui n’appartienne qu’à lui. Une condition sine qua non. Faire ce que personne avant lui n’a fait. D’une manière qui ne fut celle de nul autre avant lui. Mathématiquement impossible : vous imaginez sept milliards d’artistes, tous individués de manière nette et sans bavure ?
Drôle d’exigence quand même, et dans un drôle de monde. C’est vrai quoi, pendant des millénaires, le nouveau a fait peur, et pour une raison bien simple : ce qui est nouveau est inconnu, et ce qui est inconnu est dangereux, et c’est dangereux, parce que ça risque d’ébranler l’ordre établi, le mode de vie, les points de repère, que sais-je ? De tout foutre en l’air, si ça se trouve.
Nous, on est des drôles d’animaux, par exemple. Même pas peur ! Pas peur du nouveau. C’est même le contraire : on guette, on est à l’affût. On est malades d’innovation. Besoin d’inscrire son nom dans la déjà interminable liste des innovateurs. Tiens, c’était quoi, le nom de cet « artiste », et en quelle année c’était, qui avait rempli un camion-benne de balles de ping-pong, qui avait été amené en marche arrière au sommet de la Montée de la Grand’Côte ? Le chauffeur avait actionné la benne. L’ « artiste » avait ouvert le battant arrière, et contemplé en riant et battant des mains les milliers de petites baballes débaroulant jusqu’à la place des Terreaux, tout au moins jusqu'au local de la secte scientologique.
Mais au moins, ce geste dérisoire a la gentillesse amusante de l’enfantillage. Et ça n’a pas la prétention hargneuse et hautaine de certains qui se disent « hartistes » (avec « h » violemment aspiré). Je pense à ce niais prétentieux qui avait cru intéressant de suspendre au plafond, en un quadrilatère régulier de 10 sur 10, une centaine de traversins de couleur écrue au bas de chacun desquels il avait inscrit au feutre noir le prénom de la fille supposée y avoir une nuit posé sa tête.
C'est quoi, ce monsieur ? Ni la vigueur, ni le savoir-faire pour donner aux dames l'envie de s'attarder plus d'une nuit sur son oreiller ? Eh bien je le dis : je le plains. En plus, cette exposition de l'intimité a quelque chose de prétentieux dans l'indécence, ou d'indécent dans la prétention. Il y a certes plus prétentieux. Cela se passait hélas au Centre d’Arts Plastiques de Saint-Fons, dirigé par l’excellent Jean-Claude Guillaumon. Lequel m’avait fait l’amitié trop généreuse de m’inviter à y intervenir en 1988, moi qui n’y avais guère de titres. J'avais platement lu mon Manifeste de Babelthérapie. Je n'ai aucun sens de la mise en scène.
Je ne partirai pas en guerre contre les moulins à vent de l’art contemporain qui se prennent pour des géants attendant en vain leur Don Quichotte pour en acquérir un petit lustre. Cela ferait trop plaisir à Daniel Buren, fossilisé avant d’être mort dans les innombrables strates marneuses de ses milliers de bandes alternées de 8,7 centimètres de largeur. On en retrouvera les traces dans quelques milliers d’années, et les paléontologues interloqués se gratteront le crâne devant ces étranges manifestations de rituels religieux : à quoi de même pas intelligent, mais simplement sensé auraient bien pu se référer des éléments aussi secs, malhabiles et rudimentaires, qui avaient tout d’un académisme bégayant et guindé ?
Je ne partirai pas en guerre contre Bertrand Lavier, qui « interroge les rapports de l’art et du quotidien », et qui modifie et hybride, au sein même du musée, « des objets de la vie courante, de façon à ce que leur statut même s’en trouve mis en question » (wikipédia). Je lui laisse ses porte-manteaux et autres accessoires accrochés en biais, en diagonale ou de guingois.
Je me garderai de partir en guerre contre les carreaux blancs de Jean-Pierre Raynaud, qui transforme tout en décor de salle de bains, dont une « stèle pour les droits de l’homme », à Barcelone (ne pas oublier les joints noirs comme constitutifs de l’œuvre d’art). Je ne m’en prendrai pas davantage à la maison qu’il a mis plus de 20 ans à édifier pour des « études spatiales », et qu’il a décidé de détruire et de réduire en morceaux, pour vendre ceux-ci empilés dans de très gros pots de fleurs.
Ne me parlez pas non plus de Claude Viallat, immortel inventeur du quadrilatère flasque, forme qu’il a déclinée sur toutes sortes de supports textiles et dans toutes sortes de couleurs (des « toiles non tendues », s’il vous plaît), et dont il a défiguré l’église Notre-Dame des Sablons à Aigues-Mortes en en faisant le motif des vitraux.
Remarquez, tout le monde s’extasie devant le champion du monde du noir, Pierre Soulages, mais regardez l’effet visuel que donnent maintenant les vitraux de la fabuleuse église de Conques (avec son tympan du jugement dernier à se relever la nuit du dernier jour). Vu de l’extérieur, un effet d’acier mat, vu de l’intérieur, des diagonales relativement incompréhensibles.
Ce qui fait qu'on supporte qu'Erik Dietman fasse partie de la bande des truqueurs, c’est une sorte de jubilation noire et ricanante. Ma foi, pourquoi pas ? Mais le tableau de Christian Zeimert « Le monde riant » est juste fait pour s’esclaffer (hi hi, Piet Mondrian (1872-1944), la bonne blague). Orlan, la masochiste, a transféré très tôt son atelier dans un bloc opératoire, ce dont on voit les effets sur son propre corps. Elle est très fière des « cornes » qu’elle s’est fait greffer par un chirurgien, et ce n’est pas sa farce du « Baiser de l’artiste » qui peut sanctifier le naufrage (le slogan « Ceci est mon corps », était déjà pris).
Au fond, ce qui me donne la nausée, dans une bonne partie de l’art contemporain, c’est que ceux qu’on appelle par abus de langage des « artistes » se sont fait un nom sur une seule idée, qui devient leur marque de fabrique, qu’ils rentabilisent à tout va, et qu’ils déclinent ensuite de toutes les façons de formes, de couleurs, de lieux, de conditions temporelles possibles et imaginables : César et ses compressions, Andy Warhol et ses multiples, etc.
Cette unique idée, elle devient explication et synthèse du monde, « cymbalum mundi », système philosophique, grille de lecture pour les grands mystères de l'humanité. Elle est érigée en dogme. Les prêtres de leur Eglise le proclament. Les fidèles s'inclinent et s'agenouillent pour communier, et se mettent àat ventre pour leur baiser les orteils.
Vraiment, peut-on dire que Keith Haring ou Robert Combas ont développé un « style » ? Non : ils ont créé du « visuel ». C'est de la publicité. C’est de l’image de marque, et rien d’autre. Peut-on dire que Ben Vautier possède un style, avec ses formules à la noix qu’il a vendues contre monnaie sonnante à la marque Clairefontaine, et qui « habillent » à qui mieux-mieux les cartables et agendas des collégiens et lycéens ?
J’ai vu il y a fort longtemps une « installation » de Jean Clareboudt à la maison de la Condition des Soies : que voulez-vous, les bras m’en tombent. Même chose pour cette « performance », vue au Centre d’Arts Plastiques de Saint-Fons, je ne sais plus quand, où une femme parcourait un quadrilatère en versant du sable en quatre petits tas, pendant qu’un collègue équipé pour l’escalade parcourait un mur lui-même équipé pour ça, et qu’un troisième larron poussait à intervalles réguliers de petits cris, assis dans une baignoire suspendue au plafond dont il s’échappait par la bonde un liquide jaunasse comme de l’urine. Y a-t-il quelque chose à ajouter à ce petit descriptif neutre et objectif ?
Mon but n’est évidemment pas de faire l’inventaire de toutes les colifichets que des camelots d’art ont cru de leur devoir d’encombrer la réalité existante. Ce serait plutôt de glisser une remarque dans l’oreille des « artistes expérimentaux ». Monsieur Daniel Dezeuze, reconnaissez que vous vous êtes livré à un bon gros foutage de gueule, avec votre « Echelle en bois souple déroulée au sol ». Monsieur Robert Malaval, avouez le mensonge moral que constitue votre « Germination d’un fauteuil Louis XV » (d’ailleurs vieux comme L’Enigme d’Isidore Ducasse. Empaquetage, de Man Ray (1920), ou le Couvert en fourrure, de Meret Oppenheim (1936)).
Tout le monde a en mémoire les spectaculaires empaquetages de Christo. Mais quand il a empaqueté le Pont Neuf et le Reichstag, qui a dit qu’il a purement et simplement piqué l’idée, en l’amplifiant, à Man Ray qui, lui (en 1920, s’il vous plaît !), rendait hommage aux Chants de Maldoror, de Lautréamont (« beau comme la rencontre fortuite d’une machine à coudre et d’un parapluie sur une table à dissection »), ce qui avait tout de même un peu plus de gueule, quoi qu’il faille penser de son paquet ficelé ?
Trop de démarches « artistiques » modernes sentent la rentabilisation effrénée d’idées toujours déjà précédentes, la recherche de notoriété et de fric, dont Andy Warhol est la caricature paroxystique. Ou alors tout simplement, ça sent le manque d’inspiration. « Qu’est ce que je pourrais trouver, qui n’ait jamais été fait ? Une idée qui marche ? » Surtout « qui marche ». Et si tous les fabricateurs d'oeuvres et les imposteurs d'art ne souffraient pas, tout bien considéré, de radicale pauvreté, de totale absence d'inspiration ?
Mais heureusement, il reste de la vie dans le désert de l’art contemporain.
Parlez-moi du travail de Bernard Réquichot, alors là, moi, je marche à fond. C’est tout ce que vous voulez, ces traits qui s’enroulent sur le papier, qui s’entrelacent, se recouvrent, se développent comme des tentacules ou des pseudopodes, qui me font penser aux monstres qui naissent sous la plume de Franquin (oui, le même que celui de Gaston Lagaffe). Quelque chose de complètement allumé, certainement, et de vaguement inquiétant, j’en suis d’accord. Mais tout à fait fascinant. Quoi, c’est confidentiel ! Bien sûr que c'est confidentiel !
Mais c’est justement pour ça que c’est intéressant, Bernard Réquichot. Pourquoi ? Parce qu’on sait tout de suite qu’on a à faire à un individu, et non pas à un marchand ou à un clone. C’est un vrai problème : comment se distinguer de la masse, c’est-à-dire comment devenir ou rester un individu, quand il y en a six milliards d’autres aussi légitimes à y prétendre ? Et comment le faire sans user de « trucs » et procédés dont la seule vertu est de frapper à l’estomac ? Le seul moyen, c’est de rester dans son coin à cultiver son lopin, comme Bernard Réquichot.
Mais du coup, qui connaît Bernard Réquichot ?
A suivre, avec un vrai peintre, cette fois, promis.
09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roger kowalski, galerie k, régis bernard, giorgio morandi, daniel buren, bertrand lavier, jean-pierre raynaud, claude viallat, pierre soulages, erik dietman, orlan, keith haring, robert combas, ben, andy warhol, bernard réquichot, art contemporain, peinture, littérature
jeudi, 13 octobre 2011
SONNETTE POUR VIOLON SALE (2)
J’ai continué à m’intéresser. Je suis allé aux concerts, j’ai acheté les disques, en me disant que, de tout temps, les gens ont écouté la musique qui se faisait là où ils vivaient, au moment où ils vivaient, et qu’il n’y avait pas de raison pour que ça changeât. Ça tombe sous le sens. La musique a évolué, comme la peinture, comme l’architecture, comme la poésie. Ce n’est pas parce que la modernité a inventé la musique EN CONSERVE qu’il faut arrêter d’écouter ce qui se compose ici et maintenant.
Je précise que je parle ici de la « musique savante ». Une autre fois et à part, je parlerai du reste, c’est-à-dire de la saucisse sonore au kilomètre, qui sert à provoquer des gestes convulsifs légaux chez ses adeptes pendant des nuits entières et autorisées. J'évoquerai aussi les ghettos musicaux infinitésimaux farouchement campés sur leurs « identités ». L’évolution des formes, certains appellent ça « l’histoire », d’autres appellent ça « le progrès ». C’était ce que je me disais naguère, avant de me poser des questions « existentielles ».
La musique contemporaine, si on ne s'y est jamais aventuré, c'est compliqué.
La première tendance à citer est l'amorphisme. Il m’arrive d’écouter de temps en temps, à titre de curiosité, « les lundis de la contemporaine » sur France Musique. J’ai évoqué ici même, le 29 mars, un de ces concerts du lundi. Je parlais, à propos de la musique de BRICE PAUSET de « retour massif de l’organique », de « régression vers l’animalité », et de « retour puissant de l’adulte vers l’oral et l’anal ». Il y a, dans cette branche de la musique contemporaine, de l'inarticulé. Remarquez, Tintin a bien appris à parler l'éléphant (Les Cigares du pharaon).
On assiste là à la promotion du larvaire et de l’informe. C’est choisir la trace du pas en lieu et place de la personne qui l’a laissée. C’est réduire le repas gastronomique aux bruits intestinaux qu’il provoquera. C’est ramener la forme esthétique élaborée à l’informe de la matière dont elle est constituée. C'est faire du bredouillement primitif de l'enfant le modèle impérieux de l'éloquence humaine. C'est disséquer l'emploi du temps amoureux et le menu des repas d'un grand homme pour percer le secret de son génie. J'arrête.
Une deuxième grande tendance à fuir dans la musique contemporaine, c’est celle de l’ingénieur en mathématiques et du théoricien des sons, qui concocte « in vitro » des partitions d’une complexité musicale insurpassable (pour bien montrer à ses confrères qu’il sait faire), mais qui laisse l’auditeur (je veux dire le mélomane) raide sur le carreau et froid comme un poisson juste sorti du congélateur.
Il faut être arrivé premier en mathématiques à X-Mines-Ponts pour entrevoir de loin la beauté de la chose. Je partage volontiers le prix Nobel dans cette catégorie entre PIERRE BOULEZ et KARLHEINZ STOCKHAUSEN (mais celui-ci s’est illustré de bien d’autres façons croquignolettes, alors que l’autre, le gourou pénétré de son propre sérieux et de sa propre importance, n’a jamais utilisé d’hélicoptères pour accompagner ses quatuors à cordes).
La troisième tendance à évoquer, comme elle a offert à boire, mais aussi à manger, il faut se montrer prudent, nuancé et circonspect. Je veux parler de tous ceux qui ont suivi l'exemple de l'auteur du Traité des objets sonores : PIERRE SCHAEFFER, pionnier de la « musique concrète », et qui sont partis avec leurs magnétophones dans les gares, les ports, les usines et autres lieux où les hommes (ou bien la nature) produisent des sons, qui sont en l'occurrence des BRUITS.
Ensuite, ils revenaient dans leur laboratoire et, en coupant et collant savamment les bouts de leur collecte (ça s'appelle échantillonnage, et je ne vous dis pas les pas de géant que l'informatique a fait faire à cette façon de procéder), puis en combinant tout ça avec des sons électroacoustiques, mais aussi, ô merveille rare, avec des sons musicaux authentiques (= produits par des instruments de musique, c'est comme ça que ça s’appelle), bâtissaient des morceaux qu'ils appelaient oeuvres. Mais c'est vrai que des oeuvres, il y en a (je pense, par exemple, à City life, de STEVE REICH).
Une quatrième tendance de la musique contemporaine, c’est ce que j’appellerai le « FOUTAGE DE GUEULE». Je considère les « pianos préparés » de JOHN CAGE comme une aimable farce. Mais moins farcesque que son « morceau » pour piano intitulé 4’33’’, où le pianiste s’assied en croisant les bras ostensiblement devant son instrument pendant quatre minutes et trente-trois secondes, pour bien montrer au public que la musique ne s’arrête jamais, pourvu que l’on compte parmi les sons musicaux les catarrhes tubaires du dit public, les froissements de papiers, les fauteuils de la salle qui grincent, etc..
JOHN CAGE a aussi composé un morceau pour piano jouet (un vrai jouet faux piano) et diverses autres joyeusetés du même lard. Inutile de dire que toutes les explications tendant à démontrer que de telles « oeuvres » sont de savants commentaires sur la nature de la musique déclenchent chez moi de redoutables spasmes d'hilarité.
Remarquez, je ne sais pas si le larvaire n’a pas finalement quelque chose à voir avec le « foutage de gueule ». Quoi qu’il en soit, dans le même chapitre, je fais entrer pêle-mêle les coups sur le bois du piano (avec les doigts, le poing, le coude…), les fouettements du manche de violoncelle avec la mèche ou le bois de l’archet, la pichenette du violoniste lancée du bout de l’ongle au verre en cristal à moitié rempli, placé sur le pupitre, et tout un tas de trouvailles délicieuses et si originales, ma très chèèère !
C’est incroyable le nombre des gens de bonne foi qui prennent encore au pied de la lettre le dernier vers du dernier poème des Fleurs du Mal : « Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau ». Le « nouveau » à tout prix a vite fait de devenir une impasse. Ils oublient un peu vite ce qui précède : « Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! Levons l’ancre ! Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons ! ». Baudelaire a raison : appareillons. Je veux dire : fuyons !
Une autre tendance a encore pas mal de succès. Prenez un instrument tout seul, poussez-le dans ses retranchements, faites-le hurler ses suraigus et gronder ses infrasons avec quadruple forte, faites passer l'archet du violon de temps en temps sur les cordes, mais aussi sur le bois, sur le chevalet, en dessous du chevalet. De la flûte, faites entendre le simple souffle qui passe à travers, ou le bruit que font les clés sous le choc des doigts. Sur les touches du piano, le bruit du choc du bout du doigt. Bref, tout comme ça. LUCIANO BERIO est sans doute le maître de l'exercice, sous le nom de Sequenza, en faisant « chanter » à sa femme KATY BERBERIAN toutes sortes de bruits, y compris ceux qui sortent de la salle de torture, ou de la salle d'accouchement, ou du lit conjugal, on finit par ne plus savoir.
Ce qui est marrant, ici, c'est que le compositeur essaie de faire dire à l'instrument tout ce pour quoi IL N'A PAS ETE FAIT, c'est-à-dire de la musique musicale. Il ne faut surtout pas que le compositeur donne l'impression que les instruments de son orchestre ont quoi que ce soit à voir avec le CHANT. J'exagère, je sais, mais il y a de ça. Faire entendre le bois du violon, le vent dans la flûte, et tout et tout : ce que veut le musicien, ici, c'est échapper au carcan, à la prison, à la dictature de la PARTITION. On ne dira jamais assez, dans la musique, les méfaits de la partition. On a observé le même effort dans la peinture : je ne sais qui avait exposé des toiles avec le côté peint face contre le mur.
Je signale pour finir, à propos de « foutage de gueule », que JOHN CAGE était un excellent copain de MARCEL DUCHAMP, immortel inventeur de l’urinoir artistique (sous le nom de « fontaine ») et du non moins artistique sèche-bouteilles, objets qu’il dénommait « ready-mades », mot qui veut dire (je traduis en français) : « Ne me faites plus ch ... avec l'œuvre d’art ».
Je renvoie à la facétie du même, consistant à exposer un « objet-dard » face à une « feuille de vigne femelle » (pas besoin de décrypter), ou à cette autre (pertinemment intitulée Why not sneeze Rrose Sélavy ?), qui consiste à empiler dans une petite cage à oiseau un tas de petits cubes de marbre (pour faire les morceaux de sucre) augmentés d’un thermomètre et d’un os de seiche. A la vôtre ! Mais le plus marrant dans l'affaire, c'est l'innombrable postérité de ce que j'appellerai le GAG à prétention artistique et les mètres de rayons de bibliothèques savantes qui se sont écrits pour commenter l’ « œuvre » du maître.
Rien n’est plus drôle que cette armée de graves savantasses penchés, le front plissé dans un indicible effort de contention, sur les bobards, canulars et autres plaisanteries d’un brave monsieur très intelligent, excellent mystificateur, qui a très tôt compris que son talent était trop mince pour lui permettre de rivaliser avec des PICASSO, MATISSE ou BRAQUE, ses contemporains et qui, plutôt que de se résigner aux seconds rôles, a préféré « se faire un nom » en jouant les EROSTRATE, (excusez-moi : c'est l'incendiaire du temple d’Artémis à Ephèse, en – 356, dont le nom seul est resté, comme c’était son but).
Cette leçon n’est pas tombée dans l’œil d’un aveugle, puisque ANDY WARHOL a pris le même chemin, dans une variante et une époque « consommation de masse ». ANDY WARHOL, dont le but était avant tout de gagner beaucoup d'argent, fit tout de même un jour cet aveu ahurissant : « Il est trop difficile de peindre ». MARCEL DUCHAMP, ANDY WARHOL et une foule d’autres, après tout, ne sont que des flemmards, des cossards, de vulgaires GROSSES FEIGNASSES d’atelier, des tire-au-flanc de la palette et du chevalet. Bref des PARESSEUX. Dommage qu’ils aient été intelligents (et rusés), et surtout qu’ils aient fait passer (c’est ça, la ruse) leur intelligence pour le nec plus ultra de la démarche artistique.
Et que des millions de gourdiflots vaguement niquedouilles, d’ânes carrément bigorneaux et d’andouilles joyeusement moules (j'ai malheureusement fait partie de la cohorte, mais je me suis soigné), guidés par tous les Diafoirus frénétiques et agités du bocal de la « critique », n’y aient vu que du feu et aient accouru au bruit tonitruant de la renommée, au point d’en obscurcir l’horizon et d’en gaver le paysage. Jusqu’à ce qu’un jour peut-être, l’estomac du paysage ne restitue tout ça sous la forme des vomissures que ça n’aurait jamais dû cesser d’être.
A suivre bientôt, et promis, retour à la musique contemporaine.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brice pauset, pierre boulez, karlheinz stockhausen, pierre schaeffer, john cage, marcel duchamp, andy warhol

