mardi, 21 avril 2020
PAGES FESSE-BOUC
Je ne suis pas un praticien de Facebook, que le Sheîtan m'étouffe si je mens, mais j'ai un accès privilégié à quelques pages par-ci par-là. Et j'avoue que, si je me rase en général en voyant s'étaler les dégoulinades du moi de gens qui croient celui-ci intéressant, il m'arrive de goûter de temps en temps les facéties parfois mirobolantes dont certains esprits libres et inventifs nourrissent leur espace mental et visuel.
***
Deux exemples.
1

Construction assez convenue mais rigolote, élaborée par Alexandre Durand, qui appartient à un groupe d'intervention surréaliste (je ne savais pas que ça existait encore).
***
2

Là, j'ai éclaté de rire.
Essayez pour apprécier la performance ; je suppose que la photo a été précédée d'un sévère entraînement.
***
Ce n'est évidemment pas aux habitués et aux fervents de ce "réseau social" que ce billet est destiné.
09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, alexandre durand, surréalisme
jeudi, 07 février 2019
REFLET
Poème
*
Du vase en cristal de Bohème
Aux bulles qu'enfant tu soufflais,
C'est là c'est là tout le poème,
Aube éphémère de reflets.
*
Quatrain d'André Breton, mais c'était avant qu'il le passe dans sa moulinette dadaïste ou surréaliste pour en faire un infâme n'importe quoi : il fallait sans doute qu'il donne des gages de son adhésion (donc de son reniement) à ses nouveaux amis.
*

Au musée, à Dijon.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poème, andré breton, surréalisme, dada, poésie
samedi, 30 avril 2016
CHRISTOPHER LASCH ET L'ARCON
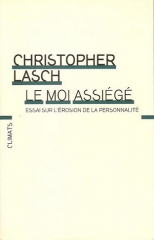 2
2
Alors maintenant, comment Christopher Lasch analyse-t-il l’évolution des pratiques picturales après 1950 ?
« Les équipements d’enregistrement modernes monopolisent la représentation de la réalité, mais ils brouillent également la distinction entre réalité et illusion, entre le monde subjectif et celui des objets, gênant par là même les artistes lorsqu’il s’agit de se réfugier dans le fait brut du moi, comme le disait Roth. Pas plus le moi que son environnement n’est plus un fait brut. » Christopher Lasch, Le Moi assiégé, p. 135. On a déjà croisé une telle idée. On sait qu'elle vient de Guy Debord et de sa Société du spectacle : tout au long de notre existence, toutes nos perceptions (enfin, la plupart) nous parviennent aujourd'hui médiatisées sur un écran où se projettent des images élaborées par d’autres instances que nous-mêmes. Nous n'avons plus d'expérience directe du monde.
« L’artiste romantique projetait des mots et des images dans le vide, en espérant imposer l’ordre au chaos. L’artiste postmoderne et postromantique les voit comme des instruments de surveillance et de contrôle. » C’est l’écrivain William Burroughs qui inspire ici Lasch.
Mais surveillance et contrôle ont été rendus possibles par la généralisation des sciences dites « humaines », au premier rang desquelles on trouve bien sûr la psychologie et la sociologie : « L’observation scientifique et sociologique abolit le sujet en faisant de lui le "sujet" d’expériences censées faire apparaître sa réaction à divers stimuli, ses préférences et ses fantasmes privés. Sur la foi de ses découvertes, la science construit un profil composite des besoins humains sur lesquels elle pourra baser un système (envahissant bien que pas ouvertement oppressif) de régulations comportementales » (p.141). "Régulations comportementales" ? On ne peut être plus clair, me semble-t-il, sur le processus d'asservissement des individus par un système devenu complètement anonyme, du fait que tout ce qui sert à connaître l'homme (les sciences humaines) fournira plus tard des outils perfectionnés pour le contrôler.
L’auteur puise la substance de ce raisonnement chez l’Anglais J.G. Ballard. La préoccupation que ce dernier exprime dans ses romans n’est autre que le processus d’onirisation de la vie, qui résulte de la « saturation de l’environnement par les images et l’effacement consécutif du sujet », tel qu’on peut en voir la manifestation dans le travail d’artistes comme Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Jasper Johns, Robert Morris.


Que ce soient une vignette de BD (Lichtenstein), une aiguille et son fil ou une pince à linge (Oldenburg), l’agrandissement démesuré (x 1000 ou 10000, pour le moins) de l’objet lui fait perdre sa matérialité utilitaire et le coupe de toute réalité concrète. Ce qui fait perdre toute possibilité pour l'œuvre d'art de signifier quoi que ce soit. Sans parler de l'infinie dérision dont de telles œuvres sont porteuses. Il se produit le même phénomène de déréalisation dans la multiplication de la boîte de Campbell Soup ou du portrait de Marylin (Warhol). Il est désormais admis que l’ « œuvre d’art » vole de ses propres ailes, loin de toute basse réalité, offrant au gré des caprices de l’artiste tel objet trivial à l’adoration des foules. On peut voir là une forme de prosternation devant le dérisoire : Clement Greenberg « croyait quant à lui que l’art ne devait jamais tenter de renvoyer à quoi que ce soit en dehors de lui-même ».
Un tel courant a pour conséquence (c’est peut-être le but poursuivi par ces artistes) de dépersonnaliser l’œuvre d’art et d’éliminer la subjectivité (Sol Lewitt), tendant à « brouiller la frontière entre illusion et réalité ». Cette conception de la création artistique procède évidemment des coups inauguraux que Marcel Duchamp, en son temps, a portés au statut de l’artiste. On traitait André Breton de "Pape du surréalisme". Duchamp peut à bon droit être qualifié d' "Empereur du ready-made". Refusant de signer des « chefs-d’œuvre » au bas desquels il serait fier d’apposer sa signature, Duchamp voulut en finir avec la « confiscation » de la créativité par les seuls individus « créatifs ». Idée a priori généreuse et démocratique.
Mais c'est du flan, une vaste blague, une farce grotesque et un désastre général, en vérité, car on sait ce qu’il en est advenu : non seulement le monopole n’a pas été mis à bas, mais il est à présent accaparé, non par des créateurs authentiques, mais par des individus qui se contentent de commercialiser une « idée » artistique, si possible spectaculaire (le bleu de Klein, l’outre-noir de Soulages, la Campbell Soup de Warhol), quand ce n’est pas par de vulgaires hommes d’affaires (Jeff Koons était courtier en matières premières à Wall Street, avant d'être embauché dans la domesticité au service du milliardaire François Pinault).
Il est bien loin, le temps où la société demandait à l’artiste d’administrer la preuve de son savoir-faire et de sa maîtrise technique dans l’art de peindre. Aujourd’hui, tout individu (je ne dis pas "artiste", car tout le monde est concerné par l’appel) un peu astucieux devient une start-up potentiellement dotée d’un bel avenir commercial : sois assez ingénieux pour créer toi-même ton propre « créneau ». Il ne s’agit certes pas du même savoir-faire.
Christopher Lasch se réfère à un essai du philosophe allemand Walter Benjamin, suicidé en 1940 à la frontière franco-espagnole, L’Œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique. Qui dit production en série dit forcément société industrielle, société de consommation, société de masse. Chaque tendance de l’art contemporain va s’inscrire dans un « créneau » précis, celui qui lui est dévolu sur le marché d’une consommation donnée. Que cela s’appelle « minimal art », « systemic painting », « optical art », « process art », « earth art » ou conceptualisme, tous participent de ce mouvement de déconstruction (de « démystification »). Et chacun, bien rangé dans sa case, occupe le « segment de marché » qu’il a réussi à s’ouvrir.
Christopher Lasch conclut logiquement à la « fusion du moi et du non-moi », sorte d’indifférenciation des moi, des êtres et des choses, un monde où les distinctions sont abolies, « un monde où tout est interchangeable ». C’en est au point que « la survie de l’art, comme de toute autre chose, est devenue problématique », au motif « que l’affaiblissement de la distinction entre le moi et son environnement – développement fidèlement consigné par l’art moderne jusque dans son refus de devenir figuratif – rend le concept même de réalité, ainsi que celui du moi, de plus en plus indéfendable » (p.155).
Ce qui arrive arrive, ce qui existe existe, ce qui est là est là, c’est tout : il n’y a plus rien sous la surface des choses, toute substance, tout contenu sont révocables, l’unité de la personne est pulvérisée (« Puisque l’individu semble être programmé par des agences extérieures – ou peut-être par sa propre imagination exaltée – il ne peut être tenu pour responsable de ses actes »), l’insignifiance triomphe. Il n'y a plus que de pures apparences : images fabriquées par des gens de métier, et déconnectées de tout contenu humain réel. L'homme en personne devient virtuel.
Les artistes de la fin du 20ème siècle commentent leurs propres œuvres et le « geste » qui les y a conduits comme s’ils inventaient un nouveau monde. Mais c’est une simple grimace. N’est pas Christophe Colomb qui veut.
Au total, Christopher Lasch, en regardant l’évolution de l’art contemporain, semble contempler un champ de ruines. Difficile, je crois, d’aller plus loin dans la dénonciation de l’impasse où se sont engouffrés les artistes depuis cinquante ans et plus.
Plus radical que Christopher Lasch, tu meurs.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : christopher lasch, le moi assiégé, narcissisme, éditions climats, art contemporain, william burroughs, jg ballard, robert rauschenberg, andy warhol, roy lichtenstein, claes oldenburg, jasper johns, robert morris, clement greenberg, marcel duchamp, ready-made, campbell soup, outre-noir soulages, bleu klein, jeff koons, françois pinault, walter benjamin, pop art, op art, art conceptuel, andré breton, surréalisme, sol lewitt, guy debord, la société du spectacle
vendredi, 11 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 6/9

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS
ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
6/9
Du triomphe de la Dissonance (ou "Le siècle du Divorce").
Car le 20ème siècle, encore plus que le 19ème, est celui où plus personne ne sait. Celui qui casse toutes les grandes machines à produire des points de repère intellectuels, moraux, sociaux, affectifs, religieux, politiques, idéologiques, psychiques. Celui qui disloque les machines à produire un SENS qui puisse servir d'assise à l'existence des gens. Celui qui m’a amené pour finir, dans un souci de préservation, à cesser de me vivre comme un contemporain de mon époque. Le siècle où je suis né a fini par me décider à me raccrocher à quelques rochers surnageant encore dans un océan de destructions, quelques îlots esthétiques où il semble encore possible de respirer malgré les conditions que fait le monde des hommes à l'humanité. Comme dit le grand Pierre Rabih : « On ne peut pas renoncer à la beauté ».
Le 20ème siècle est celui qui ne sait plus grand-chose de l’humanité. Bien des formes d’art qu’il a fait naître ignorent superbement l’humain. La beauté ? N'en parlez surtout pas en présence de Catherine Millet ou de Catherine Francblin, qui sont aux manettes de la revue Art press, cette manufacture de la "modernité" ultra-chic et à la pointe de toutes les avant-gardes. La beauté, c'est un critère ringard et archaïque. Et finalement, je crois qu’il est là et nulle part ailleurs, le grief radical que j’adresse à Marcel Duchamp et à toute son innombrable progéniture.
Encore pourrais-je moi-même, à bon droit, soutenir l’idée que cet inaugurateur de la destruction esthétique n’a fait que transposer dans le domaine de l’art ce qu’il voyait se produire sous ses yeux dans la réalité : Dada (auquel Duchamp a participé de très loin et "en esprit") est né en février 1916, c’est-à-dire en pleine guerre, plus précisément au moment du déclenchement de la grande boucherie de Verdun (où Falkenhayn avait promis de "saigner l'armée française"). Un symbole ? Le 20ème siècle comme assassin de l'idée de la beauté ?
Mais on rétorquerait à aussi bon droit que les premières œuvres plus ou moins ouvertement atonales (rompant avec les notions de tonalité, de mélodie et d'harmonie qui prévalaient jusque-là), datent d'avant ce premier carnage planétaire (le dernier Liszt, Scriabine). Je répliquerais au contradicteur que la guerre de 14-18 n’est pas sortie de nulle part, et que des prodromes de plus en plus nets (montée des nationalismes, rivalités impérialistes, entre autres) étaient perceptibles bien avant le 4 août 1914. Ce n'est pas pour rien que l'époque a produit dans le même temps le cubisme, la musique atonale, le dadaïsme et la guerre : ces choses-là sont vendues en "pack". Et c'est bien le problème : c'est à prendre ou à laisser. Mais était-il possible de "laisser" ?
En musique, l’indifférenciation radicale des douze sons de la gamme, puis plus tard l'extension de la notion de son musical à toutes les matières sonores possibles et imaginables, et l'élévation de tous les bruits à la dignité d'objets musicaux (Pierre Schaeffer a écrit Traité des objets musicaux, et puis ce fut la litanie : sons d’origine électronique, moyens portatifs d’enregistrement, et échantillonner, et couper-coller, et bidouiller, et métisser, et ...), tout ça pourrait être considéré comme autant d'oracles : en parallèle, plus le monde sonore (créé par l'homme) devenait dissonant, plus il annonçait à l’humanité que le 20ème siècle serait le grand siècle de la Dissonance généralisée et des conditions dissonantes de la vie.
Les conditions capables de rendre concevable et possible une éventuelle « Harmonie » ont disparu. La Dysharmonie règne en maîtresse. Et qu'on ne me raconte pas de fable à propos d'une improbable « Harmonie Nouvelle », à laquelle il faudrait que le bon peuple se fasse et s'habitue, bon gré mal gré. Trop de musiques du 20ème siècle sont, restent et demeureront inhabitables. Nous sommes les enfants de la Dissonance, de la Discorde, de la Distorsion, de la Dysharmonie, ... Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que la planète, la nature et les océans subissent les amères conséquences d'un siècle à ce point déprédateur.
La Dissonance est devenue la Norme dans la vie en même temps que dans les arts. La Dissonance, cette forme de Divorce qui demeurait l'exception auparavant (une dissonance finissait par une "résolution", c'est-à-dire un accord consonant), s'est ainsi banalisée et généralisée dans la peinture, dans la musique, dans la vie des gens mariés, dans la relation des hommes avec leurs semblables, dans leur relation avec la nature, etc. Le divorce est devenu le grand mode de vie, une modalité durable de l'être cassé en deux (en combien de morceaux ?). On a tenté de faire croire aux gens qu'on peut s'habituer à tout. Mais non : on ne s'habitue pas à tout. Nul ne peut habiter une maison qui le détruit. De quoi pleurer jusqu'à la fin des temps. Pour échapper à cette violence, une seule issue : divorcer de l'époque.
C'est ce genre de divorce qu'ont magistralement incarné quelques grandes figures de la pensée et de la littérature : Jacques Ellul, Günther Anders, Guy Debord, Philippe Muray, Michel Houellebecq, ... (le cas de Hannah Arendt, beaucoup moins en rupture, est différent). C'est l'unique raison que je vois à la détestation, que dis-je : à l'aversion, à l'exécration, à l'abomination dont ces dissidents font l'objet dans les milieux du consensus mou, de l'hypocrisie caritative, de la doxa, de la police de la pensée et du terrorisme intellectuel (quoique Debord ait récemment fait l'objet d'une récupération d'Etat : ses archives sont désormais un "Trésor national"). Cette pensée et cette littérature ont-elles infléchi la trajectoire d'une minute d'angle ? Je vous laisse répondre : c'est trop évident. Mais que peut la Culture ? Que peut la Littérature ? Que peut la Pensée ? Vous avez quatre heures pour rendre copie blanche.
Le monde pictural lui-même n’a pas attendu la guerre de 14-18 pour se détraquer : que faire, face à l'académisme, au conformisme pompier (Bouguereau, Couture, Meissonnier, Detaille, Laurens, Gervex, …) : obéir aux suggestions de Corot, de Rosa Bonheur, d’Eugène Boudin ? Une certitude émerge : il faut inventer pour exister. Claude Monet, qui se met à diviser les couleurs pures, à les juxtaposer, à rendre problématique la représentation du monde, pousse sur ce terreau, et tous les suivants, jusqu’à Seurat et Van Rysselberghe. Bientôt fauvisme, cubisme, suprématisme, surréalisme. Ces désintégrations successives disent un chose : à quoi bon l’art, quand le message porté par l’époque est la dissonance, la fragmentation, voire la négation de la réalité visible, bientôt suivies par la destruction des hommes à l’échelle industrielle ? Que reste-t-il à espérer du monde en train de se faire ?
Heureusement, les lois de l’inertie étant ce qu’elles sont, ce désespoir radical mettra un peu de temps à manifester sa radicalité (quoique ... Céline ...). La négativité côtoiera pendant quelque temps l’optimisme qui rend possible la création. Le cas du surréalisme est particulièrement riche d'enseignement. « Révolution » pour ses premiers promoteurs, puis mis « au service de la Révolution », on peut dire que, avant de rentrer dans le rang et de faire simplement de l'art "comme tout le monde", il a effectivement mis le bazar dans la culture, dans l'art et dans les esprits de son temps (en gros de 1924 à l'après-guerre, je compte pour rien les suiveurs, les suivistes, les petits curés, les "post-", les "épi-", les "para-", les prosélytes, les mouches à m...iel et les apôtres).
Avec le recul du temps, qu'en est-il ? Qu'ont-ils fait, en définitive, André Breton, ses séides et sa meute de courtisans (lire le méconnu Odile de Raymond Queneau à ce sujet, où le "pape du surréalisme" est dépeint sous les traits du pompeux Anglarès qui, entre parenthèses, passe beaucoup de temps, dans le livre, à boire des bières en compagnie de ses suiveurs), avec leur « automatisme psychique pur », leurs « rêves éveillés », leur « changer la vie, a dit Rimbaud, transformer le monde, a dit Marx, ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un » ?
D'un côté, ils ont permis à l'époque de croire qu'elle disposait encore de ressources jusque-là insoupçonnées, dans le sous-sol du psychisme. Une planche de salut inespérée. Si l'on veut bien comparer avec les gaz et pétroles de schistes, solution désespérée pour soi-disant remédier au « Peak Oil », le surréalisme apparaît comme l'ultime possibilité de croire que l'art disposait encore d'une réserve de nouveaux moyens d'expression. En amenant au jour tout un attirail d'images, d'objets et d'assemblages, les surréalistes ont pu donner l'illusion d'un gisement inépuisable de nouveaux papiers peints à apposer sur les murs de plus en plus craquelés de notre univers désolé.
De l'autre côté, ils ont fourni à la propagande, au bourrage de crâne, à l'endoctrinement, en un mot : à la publicité (alors en plein épanouissement : Edward Bernays et consort), un carburant aux effets puissants : une masse de thèmes nouveaux et surprenants, exploitables ad libitum. Ils ont permis à la bientôt sacro- sainte marchandise de prendre possession des esprits, et de se mettre à briller d'un éclat aveuglant à l'horizon de toutes les populations du monde. Magritte, en particulier, avec ses confusions en gros sabots (paradoxes visuels, premier plan / arrière-plan, calembours picturaux, jeux signifiant / signifié, etc...), reste une mine d'or pour bien des "créatifs" d'agences publicitaires.
sainte marchandise de prendre possession des esprits, et de se mettre à briller d'un éclat aveuglant à l'horizon de toutes les populations du monde. Magritte, en particulier, avec ses confusions en gros sabots (paradoxes visuels, premier plan / arrière-plan, calembours picturaux, jeux signifiant / signifié, etc...), reste une mine d'or pour bien des "créatifs" d'agences publicitaires.
En réalité, le surréalisme est la tentative désespérée d'une humanité poussée dans la nasse par un siècle fou, de trouver une issue de secours. Et l'on ne peut que constater les dégâts : plus la réalité s'est craquelée sous les coups totalitaires des camps de la mort, des procès de Moscou et de la "Bombe" (Allemands + Russes + Américains, ça fait du monde), puis sous les coups plus insidieux de la marchandisation progressive de tout, plus ce recours au monde intérieur, au monde de l'inconscient et de l'imaginaire apparaît comme un dernier refuge avant écrasement. Comme une impasse et un cul-de-sac. Un sac en plastique pour y mettre la tête jusqu'à ... On se félicite, rétrospectivement, de ce qu'André Breton ait été tout à fait insensible à la musique. Quels dégâts n'aurait-il pas commis ? Remarquez que d'autres s'en sont chargés, qui ne se réclamaient pas du surréalisme.
Le surréalisme a momentanément rassuré le monde de l'art en lui fournissant, pendant un temps, une sorte de trésor de substances nutritives de substitution (le surréalisme est au monde de l'art ce que la méthadone est à l'héroïne), en même temps que l'illusion de possibilités infinies de développement. En réalité, avec le surréalisme, le monde de l'art raclait ses fonds de tiroirs. Asséchait ses derniers marécages avant le désert. Achevait ce qu'avait commencé Alphonse Daudet avec son personnage principal, dans L'Homme à la cervelle d'or : se vider la tête.
Car ce qui est curieux ici, c’est de constater que plus le surréalisme met le paquet sur le renouvellement des images et ce ressourcement superficiel de l’imaginaire, plus la réalité concrète prend le chemin inverse, celui du sordide et de l’invivable. Au fond, les formes héritées du surréalisme constituent une sorte de dénégation générale de la réalité. Une dissociation d'ordre publicitaire (la dissonance métaphorique, qui prend des airs de coalescence : une femme nue pour vendre un yaourt, mettre du désir dans une marchandise, ...), qu’on observe pareillement dans l’évolution des discours politiques : plus la réalité fout le camp, plus le discours doit faire semblant de restaurer le désir en affirmant la maîtrise du politique sur le réel. En France, les politiciens incantatoires s'entendent à merveille pour nous en offrir des preuves éclatantes.
A partir de là, art et réalité ont pu diverger "à plein tube". "Artistes" et "responsables", de plus en plus déconnectés du réel, ont commencé à faire comme si. Comme si le monde ancien se perpétuait, pendant que la réalité foutait le camp, échappant à tout le monde. Comme si l’on pouvait continuer impunément à soutenir dans les mots un modèle déjà quasiment effondré dans la réalité. Tout le monde a fait semblant (faire semblant : un des sens du mot « Spectacle » dans le vocabulaire de Guy Debord). La Dissonance a gagné. Le Divorce est consommé.
Il y a donc beaucoup d’artistes (il faut bien vivre) qui se sont alors faits les simples greffiers du désastre, dont ils se sont contentés d’enregistrer, inlassablement, les signes. Ils ont tiré un trait définitif sur l’homme. Ils ont pris acte. Ils ont tourné la page, sans joie (quoique …), mais sans regret. Ils ont meublé ce désert enfin débarrassé de l’humain, nouveau territoire de l’art, des objets les plus divers surgis de leur fantaisie, de leurs caprices, de leurs humeurs, du hasard, des occasions. Ils ont inventé la gratuité, la futilité, la vanité du geste artistique, de même que je ne sais plus quel personnage de Gide médite je ne sais plus quel meurtre pour prouver que l’ « acte gratuit », ça existe. Ils ont introduit la destruction et le déchet dans l’acte créateur (toujours l’ultralibéral Schumpeter, avec sa "destruction créatrice"). D’où, entre beaucoup d’autres, la machine à caca ("Cloaca") de Wim Delvoye, façon de déclarer : « On est dans une belle merde ». Mais la merde peut-elle être belle ? Comme l’écrit quelque part Beckett : « Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste plus qu’à chanter ». C’est à cette vision du monde (« Weltanschauung ») que je ne peux me résoudre. 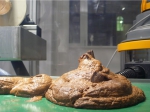
 Quand on a fait caca, on peut dire qu'on a "coulé un bronze", mais aucun être humain n'est en mesure de chier le "Persée" de Benvenuto Cellini. La Cloaca de Wim Delvoye en est une preuve répugnante.
Quand on a fait caca, on peut dire qu'on a "coulé un bronze", mais aucun être humain n'est en mesure de chier le "Persée" de Benvenuto Cellini. La Cloaca de Wim Delvoye en est une preuve répugnante.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, peinture, marcel duchamp, dada, dadaïsme, bataille de verdun, guerre 14-18, falkenhayn, franz liszt, scriabine, musique atonale, dodécaphonisme, musique sérielle, cubisme, pierre schaeffer traité des objets musicaux, dissonance, jacques ellul, günther anders, guy debord, philippe muray, michel houellebecq, pompiérisme, peintres pompiers, bouguereau, couture, meissonnier, detaille, gervex, corot, rosa bonheur, eugène boudin, claude monet, impressionnisme, divisionnisme, van rysselberghe, fauvisme, surréalisme, louis ferdinand céline, odile raymond queneau, edward bernays, publicité, magritte peintre, alphonse daudet l'homme à la cervelle d'or, wim delvoye cloaca, pierre rabih, revue art press, catherine millet, catherine francblin
vendredi, 15 mai 2015
IL Y A DU TOTALITAIRE ...
... DANS LA STATISTIQUE
1/2
A quoi servent les statistiques ? Est-ce seulement ce merveilleux outil de connaissance, qui permet de mettre en lumière des aspects de la réalité inaccessibles à la simple perception individuelle ? Faits sociaux, situations politiques, données économiques, recherches scientifiques, les statistiques font partie intégrante de notre monde, dans tous les domaines qui concernent (de très près ou de très loin) notre vie quotidienne.
Non, elles ne sont pas seulement un outil de connaissance : elles sont aussi un outil de gouvernement. Un outil qui peut se révéler terrible à l'usage. Il en est d'ailleurs ainsi pour les sciences humaines : inutile sans doute de s'appesantir sur l'utilisation des avancées dans la connaissance du psychisme humain par la publicité, par la propagande et par toutes les techniques de manipulation mentale. Vous vous rendez compte : sans Sigmund Freud, pas de Scientologie. Pas d'agressions Coca-Cola par panneaux 4 m. x 3. Pas de surréalisme. « Que la vie serait belle en toute circonstance Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards » (Tonton Georges a toujours raison).
Les statistiques sont donc entrées dans les mœurs. Il faudrait même dire : « Dans les têtes », tant chacun a désormais intériorisé la notion abstraite de « catégorie de la population », dans laquelle, à force de bourrage de crâne, il tend aujourd’hui à se ranger spontanément, sans qu’un seul flic lui en ait seulement intimé l’ordre.
Qu’il le veuille ou non, chacun a désormais une connaissance statistique de lui-même. Chacun est prié de s'éprouver non plus à partir de ses confrontations concrètes à des réalités contondantes ou suaves, mais par le médium infaillible des chiffres élaborés par des experts dont la science le dépasse de trop loin. Chacun est prié d'acquérir une connaissance objective de lui-même. Les statistiques portent le négationnisme de la subjectivité. C'est en cela qu'elles sont porteuses du germe totalitaire.
Chaque jour, journalistes, économistes, politiciens, « experts » et « spécialistes » produisent à qui mieux-mieux, à destination de tous les individus, l’inépuisable spectacle des statistiques dans le fatras desquelles tous ces "sachants" leur intiment l’ordre de trouver leur place. Les statistiques sont la nouvelle figure de la « collectivité », de la « société ». Si ça se trouve, vous appartenez à des catégories dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. On vous définit sans vous demander votre avis. On vous assigne une identité dont vous n'avez nulle idée.
La statistique est par nature l’action de compartimenter les comportements humains en les rangeant successivement dans toutes sortes de cases soigneusement étiquetées en un nombre incalculable de catégories abstraites. La statistique a quelque chose à voir avec la dissection : il s’agit de segmenter un corps pour en étudier de plus près chacun des segments.
Evidemment, comme dans toute dissection, on n’étudie valablement que quelque chose qui fut vivant, mais qui ne l’est plus. Sinon, ça s’appelle un supplice. Premier effet des statistiques : elles font de populations de chair, d’os et d’existences concrètes des abstractions pures et simples. Autrement dit, une population statistique est une humanité chiffrée, comme l’énonce clairement le titre d’Alain Supiot, sur le blog de Paul Jorion : La Gouvernance par les nombres. L’humanité accède enfin à l’existence numérique, seule collectivité sociale aux yeux du statisticien.
Définitions : « 1 – Etude méthodique des faits sociaux, par des procédés numériques (classements, dénombrements, inventaires chiffrés, recensements, tableaux …). 2 – Ensemble de techniques d’interprétation mathématique appliquées à des phénomènes pour lesquels une étude exhaustive de tous les facteurs est impossible, à cause de leur grand nombre ou de leur complexité ».
Historique : « Statistique : n. f. et adj. est un emprunt (1771 selon F. e. w.) au latin moderne statisticus "relatif à l’Etat" (1672), formé à partir de l’italien "statistica" (1663), dérivé de "statista" (homme d’Etat), lui-même de "stato", du latin classique "status" ».
La statistique établit donc des catégories. Ça a des aspects éventuellement rigolos : on peut être « contribuable » et « automobiliste », « électeur » et « pêcheur à la ligne » (on peut s'amuser longtemps à juxtaposer les carpes et les lapins) ; on est rangé par sexe, par appartenance professionnelle, par âge, par situation géographique, que sais-je. On n’en finirait pas. Ce sont les « critères ». Le résultat de tout ça, c’est qu’on a fini par réaliser ce que Voltaire dit de l’homme vu par Micromégas : un amas d’atomes. Voilà, la statistique atomise l’humanité : vous appartenez sans le savoir à mille huit cent quatre-vingt-douze catégories de la population suivant le critère qui est retenu contre vous.
Première fonction selon moi de la statistique : quantifier à l'infini en subdivisant à l'infini. Etablir des nombres. La statistique instaure le règne des comptables sur le corps social et réduit la vie sociale à une gestion bureaucratique. Elle établit une dichotomie rigoureuse entre sujet et objet, étant entendu que, pour le statisticien, personne n'est une personne, vu qu'il n'y a que des objets.
Elle vous apprend qu’au 1er janvier 2015, la France comptait 32.126.316 hommes et 34.191.678 femmes. Soit dit en passant, on voit que la statistique établit clairement que la génétique se moque éperdument de la parité entre les sexes et de l'égalité hommes-femmes.
On en pense ce qu'on veut.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : totalitaire, totalitarisme, statistique, sciences humaines, publicité, propagande, manipulation mentale, journalisme, presse, politique, société, paul jorion, alain supiot, la gouvernance par les nombres, voltaire, micromégas, recenssement, georges brassens, sigmund freud, psychanalyse, scientologie, coca-cola, surréalisme
samedi, 09 mai 2015
L'HOMME EST APPROXIMATIF
Est-ce ainsi que Pierre Reverdy envisageait ses "Flaques de verre" ?
A moins que ce ne soit qu'un grain de café presque transparent.
(Murakami Ryu a écrit l'allumé halluciné Bleu presque transparent.)
**********************************************************************************
Je n’ai jamais pu me dépêtrer de L’Homme approximatif. Cette œuvre de Tristan Tzara (qui a bien connu Pierre Reverdy), qui n'a pas arrêté de me courir après depuis des millénaires, m’a convaincu que, quand on est poète, on ne saurait se résumer au croupion d'un quelconque Mouvement Dada, ou au squelette d'une vulgaire Révolution Surréaliste. Et qu'il y a de la chair, et de la bonne, sur les os de cette volaille : c'est du corpulent.
Que l’homme ne sait jamais ce dont il est porteur quand il fait. Qu’il n’est jamais ce qu’il croit être. Qu'il est une flèche lancée par l'arc d'il ne saura jamais qui. Que la trajectoire humaine n'est jamais une ligne droite. Que ce qu’il est dépasse (je n’ose pas dire "transcende") de loin l’image qu'il s'est faite de ce qu'il doit être. Quand le poète est en état de produire cet effet, il dégage un puissant souffle de vérité. Ici, il me dépasse.

L’Homme approximatif me colle à la peau. Tenez ce petit fragment :
« frileux avenir – lent à venir
un écumant sursaut m’a mis sur ta trace de regard là-haut où tout n’est que pierre et nappe de temps voisin des crêtes argileuses où les jamais s’enflent sous robe d’allusion
je chante l’incalculable aumône d’amertume
qu’un ciel de pierre nous jette – nourriture de honte et de râle –
en nous rit l’abîme
que nulle mesure n’entame
que nulle voix ne s’aventure à éclairer
insaisissable se tend son réseau de risque et d’orgueil
là où l’on n’en peut plus
où se perd le règne du silence plat pulsation de la nuit ainsi se rangent les jours au nombre des désinvoltures et les sommeils qui vivent aux crochets du jour sous leur joug
jour après jour se rongent la queue et dansent autour et là-haut là-haut tout n’est que pierre et danse autour »
Rien que le titre du livre est un chef d’œuvre.
Voilà ce que je dis, moi.
**********************************************************************************
Babioles :
Elections législatives en Grande-Bretagne.
Une fois de plus, prosternons-nous devant l'infaillibilité Royale et Scientifique de leurs Majestés et de leurs Excellences les Sondages d'Opinion.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, littérature, tristan tzara, dada, surréalisme, dadaïsme, pierre reverdy, flaques de verre, la révolution surréaliste, andré breton, grande bretagne, david cameron, tory, labour, ed milliband, nick clegg, sondages d'opinion, élections législatives
mardi, 04 novembre 2014
L’ÉLÉPHANT CÉLÈBES
LE JOURNAL DES VOYAGES AUX SOURCES DE MAX ERNST ?
Les visiteurs de ce blog, s’ils se souviennent ou qu’ils font un détour par ce que j’y avais mis les 1, 2 et 3 août 2013, savent à quelle profondeur de sol est enraciné mon intérêt pour la « Bande Dessinée », nourrice au sein généreux et au lait aussi riche qu’Abondant et Crésus réunis.
Si je cite ces trois dates, c’est que j’y braquais alors ma lorgnette sur certaines sources qui avaient pu inspirer le grand Hergé pour certaines de ses vignettes. C’est ainsi que Les Malices de Plick et Plock (Georges Colomb, alias Christophe) ont été mises à contribution dans la scène du Temple du soleil où le capitaine Haddock se transforme en énorme boule de neige dévalant une pente vertigineuse (dans les deux images, notez le pied qui dépasse).
Que L’Idée fixe du savant Cosinus a fourni le remède miracle capable de le réveiller de son coma (Le Temple du soleil, p. 32, et On a Marché sur la lune, p. 61), quoique sur un thème plus en accord avec son penchant pour une boisson forte distillée en Ecosse, alors que le docteur Letuber avait réveillé Cosinus en introduisant, « pour se donner une contenance », une erreur dans la formule savante que ce dernier avait écrite sur son tableau noir, inventant « la fameuse mathématicothérapie ». Moralité : Hergé s'est souvenu de Christophe, par ailleurs inoubliable géniteur du sapeur Camember (né un 29 février) et de la famille Fenouillard.
Et puis j’étais tombé par hasard, en feuilletant une collection du Journal des Voyages, sur un incendie de prairie qui a bien pu inspirer celui de la page 38 de Tintin en Amérique. Et que Tintin au Congo, en sa page 20, avait fort bien pu aller y chercher la locomotive Decauville, que l’autorité de Tintin - dont l'automobile avait jeté bas celle-ci - commandant la manœuvre aux Africains réussit à remettre sur ses rails (se reporter aux billets mentionnés plus haut).
Mais c’est surtout l’éléphant formant la partie centrale de ces billets qui m’intéresse aujourd’hui. Car si je n’ai rien de nouveau sur le couple (ci-contre) Hergé-Journal des Voyages, un souvenir m’est revenu, en revoyant l’image de cet éléphant soulevant le « gamin de Paris » avec sa trompe, celui d’une œuvre peinte par Max Ernst en 1921 : L’Eléphant des Célèbes (parfois nommé "L'Eléphant Célèbes").
On pensera ce qu’on voudra de cette grosse masse couleur d’ardoise, la question n’est pas là. J'en ai pensé pendant un temps ce que j'ai pensé : je n’étais pas encore dessillé de la grosse fumisterie surréaliste.
L’encyclopédie en ligne signale que l’artiste s’est servi, pour la forme principale, d’un « silo à grains soudanais ». Je veux bien, c'est sûrement vrai, et je n’ai rien contre les silos à grains soudanais. Au contraire, je les adore. Pour dire le vrai, j’en raffole. Nul ne saurait se passer d’un silo à grains, surtout soudanais, surtout en temps de disette, surtout s'il est convenablement pourvu. Je me tapote cependant le menton.
Mon scepticisme paraîtra peut-être suspect (voire lèche-cul) à certains, mais qu'on juge plutôt la curieuse parenté de forme qui unit l’œuvre du peintre "surréaliste" (pas encore : le Manifeste est de 1924) à la gravure du Journal des Voyages. Bien mieux même, à la réflexion, qu’à la vignette d’Hergé. Il me semble que la confrontation des deux images met en évidence une source d'inspiration de Max Ernst, de façon très vraisembable. Tout n'y est pas, certes, mais ...
Je n’entrerai pas dans les détails, l’analyse ou l'argumentation : que celui qui a des yeux regarde. Je me contente de me gausser : Max Ernst a fourni à plaisir un arsenal de brimborions de ce qui fera plus tard l'attirail quincaillant et fossilisé des poncifs de la verroterie surréaliste (où l'on remarque encore, soit dit en passant, des souvenirs techniques de Giorgio de Chirico - alors l'idole d'André Breton - ou de Carlo Carra).
Alors je ne vais pas cacher une légère déception : l'éléphant, dans le récit du Journal des Voyages, n'a rien à voir avec les Célèbes (Kalimantan, Sulawesi, Moluques, ... enfin, c'est dans ce coin-là). Les aventures de Friquet, dans Le Tour du monde d'un gamin de Paris, (racontées par Louis Boussenard) se déroulent en effet quelque part en Afrique, sans doute du côté de l'actuel Gabon, où les aventuriers ont affaire aux cruels « Osyebas », des anthropophages sans pitié (qui, soit dit en passant, si ce sont bien les mêmes, fabriquent des représentations saisissantes du visage humain). Pour les amateurs de références précises, l'illustration figure à la p.37 du tome V, dans le n°107, paru le dimanche 27 juillet 1879.
Résultat des courses : si « l'éléphant est irréfutable » (cela doit dire quelque chose aux connaisseurs d'Alexandre Vialatte, que diable !), je ne sais pas de quel chapeau est sorti l'archipel des Célèbes. Voilà un beau thème de recherche pour les chercheurs. En revanche, je peux dire que Vialatte a fait venir cette expression sous sa plume en écrivant sa « Chronique d'Orson Welles, de Falstaff, et de plusieurs autres éléphants », publiée dans La Montagne le 9 août 1966. Toujours pour les amateurs de références précises.
Ma conclusion ? Oh, elle est simple : le Surréalisme prônait une « révolution de l’esprit » (vous savez, la sempiternelle rengaine andrébretonnouillante : « Changer la vie, a dit Rimbaud, transformer le monde, a dit Marx : ces deux mots d’ordre pour nous n’en font qu’un »), et il a, au bout du compte, accouché d'un avorton minable et dévastateur : Sa Majesté la Marchandise, en fournissant à la toute-puissante Régence de Son Eminence Publicité une mine inépuisable d’images (puisées dans les couches les plus superficielles de l'inconscient), capables de déréaliser la réalité et d’élever un écran infranchissable entre l’esprit des masses consommatrices et la destruction réelle du monde concret (la formule "destruction concrète du monde réel" est également admise).
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hergé, tintin, tintin et milou, casterman, max ernst, peinture, surréalisme, journal des voyages, christophe georges colomb, les malices de plick et plock, l'idée fixe du savant cosinus, le temple du soleil, on a marché sur la lune, tintin en amérique, tintin au congo, locomotive decauville, max ernst éléphant célèbes, manifeste du surréalisme, giorgio de chirico, carlo carra, andré breton, alexandre vialatte, l'éléphant est irréfutable, le sapeur camember, la famille fenouillard
mercredi, 13 août 2014
LE LIEVRE DE PATAGONIE 2/4
 J’ai eu un peu de mal à suivre le récit des premiers temps, quand Claude et Jacques Lanzmann (le bégayeur qui écrivait des livres pour dire qu'il traversait les déserts à pieds, en espadrilles, accessoirement parolier de Dutronc) sont baladés dans divers lieux au moment de l’invasion allemande et pendant la durée de la guerre : Brioude, Paris, Clermont-Ferrand, Saugues finissent par se mélanger. Cela n’a guère d’importance. Je retiens que le père et le fils s’affilient à peu près en même temps à des réseaux de résistance différents et qu’un jour, marchant sur une route, ils s’en font la révélation et la surprise mutuelles. L’instant, qui ne manque pas de cocasserie en même temps que de gravité, est rendu à merveille.
J’ai eu un peu de mal à suivre le récit des premiers temps, quand Claude et Jacques Lanzmann (le bégayeur qui écrivait des livres pour dire qu'il traversait les déserts à pieds, en espadrilles, accessoirement parolier de Dutronc) sont baladés dans divers lieux au moment de l’invasion allemande et pendant la durée de la guerre : Brioude, Paris, Clermont-Ferrand, Saugues finissent par se mélanger. Cela n’a guère d’importance. Je retiens que le père et le fils s’affilient à peu près en même temps à des réseaux de résistance différents et qu’un jour, marchant sur une route, ils s’en font la révélation et la surprise mutuelles. L’instant, qui ne manque pas de cocasserie en même temps que de gravité, est rendu à merveille.
Je passe sur les divers événements auxquels l’auteur est confronté. Ce qui est sûr, c’est que le père, juif, a remarquablement organisé la vie et la survie de sa famille pendant toute la période, puisqu’elle en est sortie entière et bien vivante. Cela passe par exemple par les exercices minutés auxquels le père oblige ses enfants pour échapper à une éventuelle rafle en se réfugiant, dans le plus grand silence et le plus vite possible, dans la cache qu’il a aménagée au fond du jardin, à n'importe quelle heure de la nuit. Le père sait. Curieusement, la suite et la fin du bouquin l'escamotent : qu'est-il devenu ?
On apprendra que la mère a pris le père en haine au moment même de la nuit de noce. En juive orthodoxe et sourcilleuse, elle n’a pas supporté que son époux la sodomise, précisément cette nuit-là. Les enfants reverront leur mère (flamboyante quoique bégayante, sauf quand elle est en colère), qui vit désormais avec un certain Monny, juif fils d’un banquier bulgare ou serbe, à l’esprit brillantissime, à l’entregent époustouflant.
Il savait convaincre un Eluard et quelques autres de la bande de manuscrire leurs poèmes à tire-larigot pour les vendre sans cesse aux amateurs d'autographes (mais les surréalistes, Tzara en tête, avaient déjà pillé les collections nègres du Musée de l'Homme). Quelques figures vraiment intéressantes parsèment ainsi le récit. Lanzmann sait à merveille raconter, tirer le portrait, ne retenir que l'essentiel. Pour tout dire : Lanzmann sait ce qu'écrire veut dire.
Passons très vite sur toutes les parties de ce gros ouvrage (546 pages !) où Lanzmann raconte ses relations avec Jean-Paul Sartre, personnage qui me rebute radicalement. Passons sur la puissante relation amoureuse qu’il entretint avec Simone de Beauvoir, ce soleil de la « condition féminine » (un soleil qui me glace), avec laquelle il vécut sept ans, aventure dont il raconte quelques épisodes, en particulier dans les montagnes suisses. Passons sur l’activité de l’auteur au sein de la célèbre revue Les Temps modernes, fondée par Sartre. Je passe finalement sur beaucoup de choses, qui m’ont moyennement intéressé.
Je m’arrête un instant sur la première cohorte de visiteurs occidentaux en Corée du Nord, dont il fait partie, et sur ce qui la sépare de la seconde vingt ans plus tard. Vingt ans qui permettent à Lanzmann, stupéfait, de voir à l’œuvre le processus de glaciation et de régression de la société nord-coréenne.
Autant la première fois cela grouillait de monde et il avait pu, malgré l’espionnite aiguë qui sévissait déjà, ébaucher une histoire d’amour avec la belle Kim Kum-Sun, qu’il n’oubliera plus par la suite, autant la seconde fois il atterrit dans un désert humain où il se sent carrément ligoté. L'étrange comédie des scènes de piqûres de vitamine par la belle infirmière sous le regard omniprésent de six ou sept « casquettes », est à ne louper sous aucun prétexte. Vingt ans après, c'est devenu absolument sinistre.
Tout au moins jusqu’au moment où il révèle à ses interlocuteurs qu’en fait ce n'est pas la première fois, et qu'il est venu vingt ans auparavant et qu'il a même partagé à trois reprises le repas de leur « Grand Leader », l’immense Kim Il-Sung, père fondateur de la patrie. Alors là, coup de théâtre et changement à vue : c'est comme si Dieu en personne apparaissait ! Tout d'un coup c'est courbette, sourire et tapis rouge. La gloire, quoi.
Je passe sur les activités de l’auteur pendant la guerre d’Algérie, sauf que je tiens à signaler l’excellente analyse qu’il fait de la situation. On exalte en effet la « guerre d’indépendance » des Algériens contre l’infâme puissance coloniale (c'est nous, la France), mais on oublie en général qu’il y eut une lutte féroce pour la conquête du pouvoir, lutte impitoyable et fratricide entre Algériens, suivant qu'ils étaient « de l’intérieur » ou « de l’extérieur », ceux-ci réfugiés en Tunisie. Qui s’achève sur la victoire totale de ces derniers, menés par un Ben Bella sans pitié.
Une authentique guerre civile meurtrière entre Algériens, qui explique pourquoi l’Algérie n’est pas encore une démocratie : la guerre civile rougeoie encore sous la cendre. Un semblable accaparement de l'Etat par un seul clan explique selon moi le chaos meurtrier qui s'est instauré après la mort de Tito en Yougoslavie, de Khadafi en Libye, de Saddam Hussein en Irak, en attendant le Bachar de Syrie et quelques autres : quand le chat despotique n'est pas là, les souris carnassières se déchaînent les unes contre les autres, et ça, ça fout vraiment la merde. Regardez les effets de l'obstination de Nouri Al Maliki à s'approprier l'exclusivité du pouvoir à Bagdad.
Je passerais aussi sur la complexité des relations entre Claude Lanzmann et l’Etat d’Israël, si elles n’étaient pas déterminantes pour toute la dernière partie du livre. L’auteur ne cache pas que l’Etat d’Israël repose sur un mensonge, comme il le constate au spectacle des milliers de tentes du camp de réfugiés où les Israéliens ont fourgué tous les juifs séfarades accourus en Israël parce qu’on leur y promettait un sort enviable. Les Falachas d'Ethiopie ne connaîtront pas un sort plus enviable à partir du milieu des années 1970.
Le mensonge encore : « Comme le dirait vingt ans plus tard dans mon film Pourquoi Israël Léon Rouach, conservateur du musée de Dimona : "Mentir, ce n'est pas bien, mais le pays, qui venait lui-même de naître, était gravement menacé. Pour le construire, il fallait le remplir et pour le remplir, il fallait mentir !"» (pp. 224-225). Déjà cette puissante et imperturbable volonté de conquête. Et déjà cette négation, totale et inentamable, de la légitimité historique de la présence arabe en Palestine : c'est comme si l'Arabe n'existait pas.
Et puis le meurtre : « Ben Gourion était impressionnant, comme Begin, mais le premier était le vainqueur de l'autre puisqu'il n'avait pas hésité à faire tirer sur l'Altalena, le navire qui, l'Indépendance à peine prononcée, amena sur les côtes d'Israël, outre des passagers, des armes pour l'Irgoun. Ben Gourion ne pouvait tolérer un double pouvoir et s'étaient résolu à ce que des Juifs en tuent d'autres, acte fondateur de la naissance d'un Etat véritable» (p. 237).
Il y a du Lénine (celui qui fusille les marins de Cronstadt en 1921) chez Ben Gourion (et le Ben Bella de l'indépendance algérienne n'a rien à lui envier). Et la fondation de l’Etat d’Israël est issue entre autres des actes terroristes et des assassinats commis par l’Irgoun dès avant la 2ème guerre mondiale. Terrorisme israélien contre terrorisme arabe : ça n'a pas changé depuis 1937 (bien avant la décision de l'ONU).
Quelques remarques qui permettent de comprendre que la situation au Proche-Orient et le conflit entre Arabes et Israéliens ont encore l'éternité devant eux pour que la paix - à laquelle tout le monde dit aspirer - n'arrive jamais.
Je note que l'état de guerre remonte à l'époque où des Juifs se sont persuadés que leur "Terre" était là, depuis des temps à les attendre, "Promise" par on ne sait qui. Ils s'appelaient les sionistes, qui obéissaient à la logique : « Pousse-toi d'là que j'm'y mette ! ». Le sionisme seul est à l'origine de la guerre en Palestine. Il se trouve que tous les sionistes se trouvaient être des Juifs. C'est encore le cas.
En décidant, avec le consentement de presque toutes les nations (ONU), de constituer un Etat en Palestine, les Juifs sionistes ont déclaré aux Arabes une guerre qui ne peut pas connaître de fin.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, claude lanzmann, le lièvre de patagonie, deuxième guerre mondiale, juifs, extermination des juifs, shoah, tristan tzara, surréalisme, paul éluard, jean-paul sartre, simone de beauvoir, revue les temps modernes, corée du nord, kim il sung, guerre d'algérie, ben bella, état d'israël, david ben gourion, palestine, guerre israélo-palestinienne, terrorisme, terre promise
jeudi, 27 mars 2014
RAOUL UBAC PHOTOGRAPHE






09:13 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, raoul ubac, surréalisme
jeudi, 29 août 2013
HERMANN BROCH ECRIVAIN
LA MORT DE VIRGILE 3
Qu’est-ce qui fait céder Virgile à la colère de son empereur ? Je crois que le poète se rend compte que, lui comme son illustre souverain, ils sont chacun engagés dans une impasse, et qu’Auguste, en se mettant en colère, laisse entrevoir un défaut dans sa cuirasse (puisque sa raison souveraine n’a pas su venir à bout de celle de Virgile), agit comme jadis Alexandre le Grand quand il fut mis, face au « nœud gordien », de dénouer celui-ci, qu’il trancha simplement de son épée.
Un aveu de faiblesse, mais en même temps, l'affirmation d'une certitude et d'un pouvoir. Si la volonté de détruire l'Enéide est inaccessible aux arguments de la raison, autant en finir au plus vite avec les arguments, et autant le décréter du haut de la souveraine autorité du Maître.
Toujours est-il que Virgile consent à abandonner son précieux manuscrit aux mains d’Auguste, et que ce consentement le plonge dans un bain de félicité qui illumine toute la dernière partie. Il n’est ni dieu ni animal, et comme il est homme, il est à mi-chemin, comme tout le monde. Or le mi-chemin est somme toute l’espace impur, l’espace des dissonances entre les aspirations, les désirs et la réalité.
L’absolu n’est pas de ce monde, il faut que l’homme se résolve à l’idée d’être dans la dissonance, d’être lui-même une dissonance : « Il n’y a de dissonance, ni dans l’acte du dieu, ni dans celui de l’animal », écrit Hermann Broch. A croire qu’il a lu Sur le Théâtre de marionnettes, de Kleist : « De même aussi retrouve-t-on la grâce, après que la connaissance ait semblablement passé par, et à travers un infini. C’est ainsi qu’elle apparaît le plus pure dans la forme de l’homme, ou bien qui n’a aucune conscience, ou bien qui possède une conscience infinie : c’est-à-dire, et tout aussi bien, chez la marionnette et chez le Dieu ».
Dès lors, Virgile peut être en paix avec le monde et avec lui-même, ayant atteint le point de l’existence depuis lequel il n’est plus possible de percevoir des contradictions, le point à partir duquel l’individu saisit l’Unité de tout. C’est, au fond, ce que recherche le narrateur de L’Aleph, de Jorge Luis Borges, et qu’il découvre, stupéfait, dans l’escalier d’une simple cave, « à la partie inférieure de la marche, vers la droite ».
C’est aussi ce que recherche André Breton, quand il proclame : « Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçu contradictoirement » (Second manifeste du Surréalisme). Pour Virgile, cet instant de l’Unité retrouvée, on comprend que c’est l’instant qui précède la restitution de son âme à l’univers.
Il faut aussi parler du message ultime que Virgile adresse à son empereur (p. 351) : « La profondeur de ton œuvre est souvent énigmatique Virgile, mais maintenant tu parles également par énigmes.
– Pour l’amour des hommes, pour l’amour de l’humanité, le Dispensateur du salut s’offrira lui-même en sacrifice ; par sa mort, il fera de sa personne un acte de connaissance, un acte qu’il lancera à l’univers, pour qu’à partir de cette suprême réalité symbolique du secours charitable, la création commence à se développer ».
Je crois qu’il n’y a pas besoin d’expliciter l’identité du « Dispensateur du salut ». C’est une prophétie, si l’on se souvient qu’on est, au moment de cet échange, jour de la mort du poète romain, 19 ans avant l’ère chrétienne. Virgile prophète, maintenant ! Remarquez, Dante Alighieri (« Nel mezzo del camin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita ») l’a bien désigné et choisi pour le guider à travers l’enfer, le purgatoire et le paradis, pour le conduire jusqu’à Béatrice. D’ailleurs, Broch, à la suite de Dante, embauche à son tour le personnage de Virgile : « Il n’y a jamais eu qu’un seul guide, c’était toi ; toujours tu seras destiné à nous guider » (p. 243). On n’est pas plus clair.
Hermann Broch aime sans doute, dans la symétrie, la force symbolique : de même que, dans Le Tentateur, les douze chapitres (tiens, le même nombre que dans Au-dessous du Volcan de Malcolm Lowry), comme des chiffres sur le cadran d’une horloge, accompagnent et signifient l’écoulement du temps et l’accomplissement de l’action, de même, dans La Mort de Virgile, il borne les deux lourds chapitres où se concentre le sens au moyen de deux autres beaucoup plus brefs, où la respiration est plus facile.
Dans le premier chapitre (« l’eau – l’arrivée »), on suit les vacillements, hésitations et difficultés du cortège de la litière où gît le poète, depuis le navire jusqu’au palais, avec un détour par les bas-fonds abjects de la ville. Le deuxième chapitre (« le feu – la descente ») développe dans un long monologue intérieur les ruminations qui l’amènent à sa décision de brûler l’œuvre.
Le troisième (« la terre – l’attente ») voit le poète se confronter à des amis, qui sont aussi des admirateurs, qui sont incapables de comprendre à la suite de quel cheminement intérieur, il en est arrivé à cette décision. Le dernier chapitre (« l’éther – le retour ») se situe entre le moment du consentement (la soumission à la volonté d’Auguste) et celui de l’adieu. C’est le plus léger, le plus aérien. C’est le chapitre de la réconciliation de Virgile avec le monde et avec les limites humaines.
Je l’ai dit, l’intrigue (un roman, c’est une intrigue) est plus que mince et tient à pas grand-chose : un poète décide de brûler son œuvre, puis y renonce. Pour entrer dans ce livre absolument sans équivalent, il faut accepter de suivre le même itinéraire, il faut se faire un peu Virgile soi-même, il faut accepter de se laisser guider par l’âme du poète dans les méandres de son itinéraire complexe et subtil. Il faut renoncer au récit linéaire, et se laisser porter par le souffle d’une écriture ample comme l’espace. Je dirai qu’il faut accepter de se laisser perdre dans cette forêt profonde, ténébreuse et inspirée.
C’est le manuscrit de La Mort de Virgile que Hermann Broch emportait, quand il a quitté l’Allemagne nazie. En 1938, je crois. Il a bien fait, nom de Zeus !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal des voyages, littérature, hermann broch, la mort de virgile, empereur auguste, alexandre le grand, énéide, kleist, sur le théâtre de marionnettes, jorge luis borges, l'aleph, andré breton, surréalisme, manifeste du surréalisme, dante alighieri, divine comédie, le tentateur, au-dessous du volcan, malcolm lowry, allemagne nazie
mercredi, 19 juin 2013
ORWELL N'AIME PAS DALI

PÂTISSIER, PAR AUGUST SANDER
***
George Orwell donc. Et pas dans le maître-livre qui l’a propulsé au rang de superstar de la science-fiction. Je trouve personnellement que 1984, un chef d’œuvre, évidemment, est plus alambiqué, plus complexe et plus allégorique que La Ferme des animaux.
Nous sommes d'accord : 1984 va incomparablement plus loin et plus profond, et son propos ne se limite pas finalement au stalinisme qu'il dénonçait explicitement (l'expression « Big Brother » comme pastiche de  « Petit père des peuples »). Et puis de toute façon, j’ai envie de parler d’un autre aspect de l'activité de l'auteur, plus proche du journaliste qu’il fut. George Orwell a écrit des centaines de textes de natures très diverses. Ivréa et L’Encyclopédie des nuisances ont publié une partie non négligeable de ceux-ci, sous le titre Essais, articles, lettres. Une édition chronologique.
« Petit père des peuples »). Et puis de toute façon, j’ai envie de parler d’un autre aspect de l'activité de l'auteur, plus proche du journaliste qu’il fut. George Orwell a écrit des centaines de textes de natures très diverses. Ivréa et L’Encyclopédie des nuisances ont publié une partie non négligeable de ceux-ci, sous le titre Essais, articles, lettres. Une édition chronologique.
Quatre forts volumes. Environ 2000 pages. Je regarde ça, et je me reprends à espérer – oh non, pas dans l’humanité, rassurez-vous, simplement dans le courage et la ténacité d’éditeurs qu’on peut dire, pour le coup, indépendants. Je veux dire : libres. Et pour être en mesure de se dire libre, il faut avoir assez de coffre pour sacrifier quelque chose de soi. C’est Michel Noir, ancien maire de Lyon, qui déclarait : « Il vaut mieux perdre une élection que perdre son âme ». Une phrase qui a de la gueule, ne serait-ce que parce qu’elle est rare. Editeur peut être un beau métier, si l’on fait ce qu’il faut pour que ça le soit et le reste.
Alors évidemment, il n’est pas question de résumer ici 2000 pages, à moins que le résumé ne tienne sur 2000 pages. Non, je voudrais juste donner une idée de ce qu’on peut y trouver, en évoquant tel ou tel sujet que George Orwell a abordé à l’occasion. Tiens, pourquoi pas L’immunité artistique : quelques notes sur Salvador Dali, qui date de 1944 ?
J’aime bien quand quelqu’un de l'envergure aquiline de George Orwell, planant dans les hautes couches de l'atmosphère, repère soudain au ras du sol un charogne à sa mesure et plonge de tout son bec et de toutes ses griffes sur ce vil escroc qui a réussi à faire croire qu’il révolutionnait la peinture. Je passe sur « Avida Dollars » (anagramme de S. D.) dont André Breton l’a habillé pour l’hiver. Reconnaissons-lui une vraie créativité si vous voulez, mais seulement jusqu’en 1935, dans le cadre du groupe surréaliste.
Après, il a juste fait du pognon, du pognon et encore du pognon. J’exagère sans doute, mais pas tant que ça. Le soin qu’il apportait à la mise en scène de soi-même (il se déclarait lui-même narcissique) me le rend tout à fait antipathique. C’est ce qui parvient peut-être à gâter la perception que je peux en avoir, même si, quoi qu’il en soit, il me semble qu’il a fait naufrage dans l’incongru et le tape-à-l’œil, dont il a fait commerce, en produisant à tire-larigot des images pieuses d'un nouveau genre, quasiment sulpiciennes à force d'être parfaitement léchées.
Orwell aborde Dali d’un point de vue un peu voisin, puisqu’il le regarde sous un angle moral, comme le laisse entendre le titre ci-dessus (qui n’est pas la traduction de l’original). Il relève son goût marqué pour « la perversité sexuelle et la nécrophilie », le « thème excrémentiel », note que Dali « se targue de ne pas être homosexuel », et conclut : « … mais à part cela, il semble détenir la plus belle panoplie de perversions dont on puisse rêver ». On ne saurait être plus net dans le reproche.
Enfin, quand je dis « reproche », tout cela est formulé (pour le moment) sans jugement : pour Orwell, qui se veut davantage objectif que moralisateur, les faits parlent d’eux-mêmes, et il n’a pas besoin d’en rajouter, même si la morale, ici, est le critère : « L’obscénité est un sujet dont il est très difficile de parler en toute sincérité. Les gens ont trop peur soit de paraître choqués, soit de paraître ne pas l’être, pour être en mesure de définir les rapports entre l’art et la morale ». Il écrit ça en 1944, et il meurt en 1949. Il n’a pas eu la chance d’admirer le gobelet d’urine de Ben (1962), la scène de pénétration de la Cicciolina par Jeff Koons (1992) ni la machine à merde de Wim Delvoye (2000).
En fait, le commentaire d’Orwell est suscité par la parution de l’ « autobiographie » (on ne sait pas trop) de Dali The Secret Life of Salvador Dali. L’artiste s’y vante de certaines dépravations, de certains actes sadiques et autres turpitudes. Je dirai qu’il « en remet ». Et le commentaire d’Orwell montre que, s’il avait été médecin, il aurait été célèbre pour la qualité de son diagnostic : il met le doigt là où ça fait mal. Il sait que les saloperies révélées par Dali dans le bouquin peuvent tout aussi bien être réelles que fictives. Ce qui porte un nom : complaisance dans le sordide.
Voici, in extenso, le paragraphe que je crois névralgique de l'étude d'Orwell : « Ce que revendiquent en fait les défenseurs de Dali, c’est une sorte d’immunité artistique. L’artiste doit être exempté des lois morales qui pèsent sur les gens ordinaires. Il suffit de prononcer le mot magique d’ « art », et tout est permis. Des cadavres en décomposition avec des escargots qui rampent dessus, c’est normal ; donner des coups de pied dans la tête des petites filles, c’est normal ; même un film comme L’Âge d’or [où l’on voit une femme en train de chier, selon Henry Miller] est normal. Il est également normal que Dali s’en mette plein les poches pendant des années en France, puis détale comme un rat aussitôt que la France est en danger. Dès lors que vous peignez assez bien pour être consacré artiste, tout vous sera pardonné ». Ce paragraphe, est-il utile de le préciser, me réjouit au plus haut point. Au passage, les lecteurs un peu assidus de ce blog auront goûté à sa juste valeur la répétition du mot « normal ».
Il dit encore quelques petites choses intéressantes : « Il est aussi antisocial qu'une puce. Il est clair que de tels individus sont indésirables, et qu'une société qui favorise leur existence a quelque chose de détraqué ». Et même des choses assez drôles : « Si vous dites que Dali, tout en étant un brillant dessinateur, est une sale petite fripouille, on vous regarde comme si vous étiez un sauvage. Si vous dites que vous n'aimez pas les cadavres en putréfaction, et que les gens qui aiment les cadavres en putréfaction sont des malades mentaux, on en déduit que vous manquez de sens esthétique ».
Sans se gargariser de formules brillantes, c'est avec sobriété qu'Orwell assène les coups de son bon sens sur la tête du reptile.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, august sander, littérature, george orwell, 1984, arts, peinture, salvador dali, la ferme des animaux, animal farm, ben, jeff koons, wim delvoye, cicciolina, andré breton, surréalisme, avida dollars, éditions ivréa, encyclodédie des nuisances
samedi, 06 avril 2013
L'ART ET LE VERBE ETRE
Bon, ce n’est pas pour radoter, c’est juste pour mettre un point final à cette longue série.
Chaque petit individu a donc, désormais, le droit d’être original, et ce faisant, de se faire un nom, voilà donc le Graal ultime du char d’assaut de la modernité. Pour faire exister coûte que coûte le sacro-saint individu, hérité des Lumières. A ce titre, il a le droit de désigner ce qu’il fait (et qu’il est, espère-t-il, seul à faire, à cause des droits d’auteur) comme activité artistique, parce que tel est son bon plaisir. Et que tel l'ordonne Madame Egalité.

CECI EST UNE OEUVRE D'ART
L'ARTISTE EST PHILIP NEWCOMBE
LE TITRE EST "WEENER"
Le paradoxe n’est pas laid, qui me rappelle ce dessin de Sempé où, dans une librairie vaste comme une cathédrale aux immenses murs couverts de dizaines de milliers de livres, le brave libraire félicite un auteur pour son premier bouquin : « Cela doit faire du bien, de se sentir émerger de la masse ». Attention les yeux, quand on sera sept milliards à avoir le droit d’émerger de la masse ! Je sens que ça va dépoter !
Chaque individu a le droit d’innover, c’est-à-dire de désigner comme de l’art l’objet de son « travail ». C'est-à-dire, à élargir jusqu'à lui-même la définition de ce qui est artistique. A s'inclure comme partie prenante dans le monde de l'art, comme s'il craignait que personne ne le fasse s'il n'en prenait pas l'initiative. On n'est jamais si bien servi que par soi-même.
C’est ainsi qu’en musique, sont entrés la « techno », qui n’est rien d’autre que de la percussion avec du semblant de sons musicaux pour faire croire, et le « rap », qui est la même chose, mais avec des mots - si possible hargneux, vindicatifs et violents.

CECI EST UNE OEUVRE D'ART
L'ARTISTE EST RAPHAËL HEFTI
LE TITRE EST "SUBSTRACTION AS ADDITION"
Le « slam », petit dernier avant la prochaine « innovation », n’est pas autre chose, mais cette fois sans les sons musicaux, et qui plus est, avec un usage de la rime étrangement conformiste, curieusement passéiste, bizarrement démodé. La fraîcheur d’âme de tous ces petits qui font une « standing ovation » à la défunte rime, et qui jouent les Louis XVIII pour sa Restauration, ça vous a quelque chose de profondément touchant. Souvenons-nous cependant que la Restauration a mal fini (1830).
Le pauvre verbe « être » – vous savez, ce prince tout-puissant qui établit des équivalences entre ce qui le précède et ce qui le suit – a été mis à mal, à contribution, à la torture et à toutes les sauces. Allez contredire, en argumentant subtilement, sur un plateau de télévision, l’énergumène qui lance, autoritaire : « Le rap est de la musique » !

CECI EST UNE OEUVRE D'ART
L'ARTISTE EST PHILIP NEWCOMBE
LE TITRE EST "GOBSHITE"
Allez lui faire admettre que la musique ne se réduit pas à de la scansion diversement (pas trop quand même) rythmée, et qu’il lui reste, s'il y consent, deux ou trois petites choses à apprendre ! Que "SA" culture, ce n'est pas "LA" culture.
Si vous faites ça, c'est le meilleur moyen de vous attirer des répliques du genre : « Mais de quel droit ? - Au nom de quel principe ? - Au nom de quelle autorité ? - Au nom de quelle valeur absolue ? ». Et là, vous, je vous vois comme si j'y étais, vous ramez contre le courant, à remonter à Platon, au monde des Idées, à la hiérarchie des valeurs, à l'élévation de l'âme par la contemplation du Beau. Disons-le tout net : vous êtes très mal embarqué. Le verbe « être » est péremptoire à lui seul. Il dissuade.
Le verbe « être » est donc le grand petit soldat de l’innovation, car il est une véritable baguette magique, grâce à laquelle la frontière imposée par la définition s’abolit d’elle-même, puisque la définition, c’est lui ! Regardez dans le premier dictionnaire venu : la première définition venue répond à la question : « Qu’est-ce que c’est ? ». Dites-moi que c'est faux, tiens, pour voir.

CECI EST UNE OEUVRE D'ART
L'ARTISTE EST HENRIQUE OLIVEIRA
LE TITRE EST "DESNATUREZA"
Les surréalistes ont abondamment donné dans ce panneau, avec leur « jeu » (tiens tiens) : « Qu’est-ce que … ? – C’est … ». Le surréaliste José Pierre (rien à voir avec Jean-Marc Thibaut) a même écrit un roman érotique de qualité pas détestable intitulé Qu’est-ce que Thérèse ? – C’est les marronniers en fleurs.
Pierre (rien à voir avec Jean-Marc Thibaut) a même écrit un roman érotique de qualité pas détestable intitulé Qu’est-ce que Thérèse ? – C’est les marronniers en fleurs.
Maintenant, allez prouver par a + b que non, Thérèse n’est pas les marronniers en fleurs ! La faute au verbe « être », qui a tout autorisé, à commencer par les innovations les plus innovantes. Tout a donc commencé par une faute de la grammaire (pas la même chose qu'une faute de grammaire). Bon sang, mais c'est bien sûr ! Ention et damnafer (citation du regretté Fred, qui vient de mourir, voir ici, les 3 et 4 mars) ! J'aurais dû m'en douter !

CECI EST UNE OEUVRE D'ART
L'ARTISTE EST PIERRE BURAGLIO
LE TITRE EST "PAYSAGE 2 CV"
Faites comme Francis Picabia qui, dans une galerie d’art, suspendit un jour (autour de 1920), avec une ficelle, un morceau de macadam dans un cadre doré magnifique, et dites : « Ceci est de l’art ». Passez muscade ! C’est bien le diable si les réfractaires à l’esbroufe, impressionnés par la clameur unanime des dévots, oseront marmonner dans leur barbe : « Foutage de gueule ! ». Ils seront écrasés par l’audace de l’innovation.
Le verbe « être » est le roi de l’ubiquité, qui fait franchir à ce que vous voulez des distances infranchissables, et instantanément, qui plus est ! Sans bouger de votre fauteuil. Voilà, vous avez compris d’un seul coup tout le surréalisme, toute la publicité et une bonne partie de l’univers médiatique actuel. L'équivalence absolue et triomphante. Enfin, une équivalence supposée. Entre l'univers des mots et l'univers des choses.

CECI EST UNE OEUVRE D'ART
L'ARTISTE EST BERTRAND LAVIER
LE TITRE EST "GIULIETTA"
Ce serait de la 'pataphysique si ce n'était de la promotion et de la dévotion. La 'Pataphysique, qu'on se le dise, ne promeut rien et ne célèbre rien. La 'Pataphysique se contente de manifester l'immarcescible permanence et l'eccéité immanente de Faustroll.
Ici, c'est l'équivalence dévastatrice. Vous atteignez en un instant les territoires les plus sauvages, véritables réserves à ciel ouvert, bourrées à craquer de trésors d’imagination utilisables. Et tout ça par la magie du verbe « être » qui, tel Satan, en déposant le monde à vos pieds, vous en a fait l'offrande sous la forme du « déchet ultime ». Le monde en son entier. Comme chante Léo Ferré : « Thank you, Satan ! ». Ou si vous préférez :
« Bâton des exilés, lampe des inventeurs,
Confesseur des pendus et des conspirateurs,
O Satan, prends pitié de ma longue misère ! ».
Thank you, Charles Baudelaire !
Voilà ce que je dis, moi.
NB : Le nom de SATAN me fait, à tort ou à raison, penser à un bel ouvrage de Cornélius Castoriadis paru en 1996. Voici à quoi il ressemble.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, arme à feu, kalachnikov, art contemporain, cornélius castoriadis, pataphysique, josé pierre, surréalisme, musique, rap, slam
dimanche, 26 août 2012
LA METHODE VIALATTE 5/5
Pensée du jour : « Il y a un style de l'almanach Vermot. Et sans doute, ça ressemble à la nouille ; mais en plus fort ; ça la transcende ; ça la défie ; ce n'est même plus la nouille sans sel, c'est réellement la nouille sans nouille au beurre sans beurre. Du vide de nouille dans l'absence de beurre. Bref, c'est du trou de macaroni. Essayez de parler de Landru sans dire qu'il a brûlé ses femmes, ou de Ruskin sans un mot de la religion du beau ! Ils y arrivent ! Et ils s'y ébrouent. Ils donnent le rien de toutes choses dans le détail. C'est peu de dire qu'ils le donnent, ils le modulent, ils le festonnent, ils l'ouvragent. C'est étonnant. Le lecteur bien doué arrive ainsi à ne rien savoir d'à peu près tout avec des précisions affreuses ».
Alexandre Vialatte
Résumé : Alexandre Vialatte porte sur le monde et sur l’époque un regard désolé, avec un sourire fraternel et amusé qui en corrige le fatalisme d’un semblant de tendresse. Pour écrire, conseille-t-il, « commencez par n’importe quoi » et « concluez sur n’importe quoi ».
Si je voulais faire le savant (je m'en garderai bien), je dirais que Vialatte est un écrivain du paradigmatique. Or, il faut le savoir, le paradigmatique est l’ennemi juré du syntagmatique. Je traduis : le détail plutôt que le global. Je l'ai dit il y a peu. Au paradigme l'unité de base. Au syntagme la vue d'ensemble, la phrase.
Pour faire simple, Vialatte, c'est la préférence donnée au substituable sur l'enchaînable. A la liberté improvisée de la trouvaille sur la discipline rectiligne de la logique rationnelle. Axe vertical contre axe horizontal. Bref, le mot et ses semblables, plutôt que la phrase et sa logique. La perception par les sens plutôt que les généralités abstraites. Ce qui ne l'empêche pas de garder l'uniforme de la syntaxe dans un état impeccable, et de prendre plaisir à tourner des phrases compliquées. Ne serait-ce que pour embêter les gens.
Je préfère moi aussi le paradigme du livreur de lait, avec ses bidons accrochés à son vélo (on a peine à imaginer, mais je jure que c'est vrai, parce que je l'ai vu, c'était la laiterie de la rue du Garet), aux syntagmes de la Critique de la raison pure. L'image plutôt que le concept. Le particulier plutôt que le général. Pourquoi ? C’est très simple : l’humain est l’hôte naturel du particulier. Et la victime du général. L'ami précis du spécifique et la cible globale du générique.
C'est exactement pour cette raison que la 'pataphysique, science du particulier qui se propose de mettre au jour les lois qui gouvernent les exceptions (essayez d'imaginer), est une véritable urgence humaine, et que Vialatte fut un lecteur attentif d'Alfred Jarry qui, à travers Ubu et Faustroll, en fut l'inventeur.
L’individu plutôt que la statistique. Dès que se pointe le général (mettons le sociologue), l’humain disparaît, réduit à sa quantité. A son nombre. Plus précisément : l'unique est éliminé. L'individu écrasé. Voyez la catastrophe des sondages. Les mensondages, qui me découpent en morceaux (avec des décimales) pour me faire dire leur vérité : 37,8 % (ou 17,2 %) de moi-même sont d'accord (ou pas d'accord).
Où voulez-vous que je les trouve, mes 37,8 % (ou 17,2 %) ? Dans le bras ? Dans la fesse ? Non, ce n'est pas possible. C'est comme la natalité en France : 2,1 enfant par femme, nous dit-on. Qu'est-ce que c'est, 0,1 enfant ? Il faut une mentalité de sous-chef comptable pour raisonner ainsi, pour être obsédé par la moyenne à calculer. Sans parler de la fiabilité des chiffres qu'on lui a donné à passer dans sa moulinette, au sous-chef comptable. Et dire que les populations du globe sont gérées de cette façon, par des chefs comptables qui se fient aveuglément aux chiffres qu'on leur fait mouliner.
Voilà pourquoi la chronique de Vialatte dont je parle commence par la citation tirée d’un San Antonio : « J’ai oublié mon écureuil chez le brocanteur », que j’ai donnée ici il y a quelque temps. Il fait de cette phrase anodine (pas tant que ça) l’emblème d’une méthode d’écriture : « Cet "écureuil" est universel, on peut lui faire symboliser toute chose, il aura toujours son "brocanteur", qu’on peut remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. Cette méthode peut fournir un volume de proverbes, une sagesse, une philosophie et même plusieurs poèmes lyriques. On voit par là [c'est une de ses formules préférées] que tout est dans tout ». Il a bien raison. Remplacer au hasard pour découvrir des vérités nouvelles. C'est tellement bien dit. Tout est dans tout, peut-être, mais pas n'importe comment.
Substituer au hasard un mot à un autre, c'est exactement ce qui se passe dans le cadavre exquis, cette invention des surréalistes (le jeu des "petits papiers", vous savez, qu'on se passe autour de la table, et qui produisit l'inaugural « Le cadavre exquis boira le vin nouveau » : sujet-adjectif-verbe-COD-adjectif). Vialatte excelle à tirer du procédé (substitution sur l'axe paradimatique, excusez-moi) des effets d'une grande drôlerie. L'exercice lui ouvre la porte à la surprise et à l'inattendu (« des vérités nouvelles »).
Jean-Sébastien Bach répète à l'envi (c'était un humble) que quelqu’un qui ferait l'effort de s’appliquer autant que lui arriverait au même résultat que lui. Sa méthode pour bien jouer du clavier ? Rien de plus simple : « Il faut poser le bon doigt sur la bonne touche au bon moment ». Le propre du génie, c’est de paraître évident à celui qui le possède. Ben oui, il a toujours vécu avec. C'est une excuse. Pas une explication.
« Il en résulte qu’on peut prendre la vérité, ou toute autre chose, par n’importe où, et tout suivra ; il n’y a qu’à tirer un peu sec, ou adroitement, sur le bout de la laine, tout l’écheveau, ou le nœud, y passera. (…) Si vous avez à parler d’un sujet, commencez donc par n’importe où. Voilà qui facilite les choses (…) : le soleil, la machine Singer, que sais-je, le président Fallières. Au besoin, vous pouvez même toujours vous servir du même commencement ; par exemple : "Le soleil date de la plus haute antiquité". »
Et c’est là qu’on arrive au cœur de la méthode Vialatte : « Parti de prémisses si fermes et si catégoriques, pour arriver au sujet même (disons le tigre du Bengale, la femme fatale ou la pomme de Newton), vous serez obligé de l’extérieur à faire de tels rétablissements de l’esprit et de l’imagination que vous trouverez en route mille idées à la fois plaisantes et instructives qui ne vous seraient jamais venues sans cela ».
La clé de voûte de la méthode Vialatte est là, dans l'effort constant et puissant de « rétablissement » de l'esprit. Un vigoureux rétablissement de gymnaste qui soit à même de le surprendre lui-même. Il faut le savoir, c'est un vrai sportif. Qui improvise pour s'enrichir. Le « rétablissement » sert à retomber sur ses pieds, et à éviter le n'importe quoi, maladie typiquement surréaliste (vous savez, le truc piqué par André Breton au poète Reverdy : la poésie naît du rapprochement incongru de deux réalités éloignées). La preuve que c'est une maladie, c'est que la publicité en a fait son carburant principal.
Voilà, vous savez tout : si Alexandre Vialatte est un grand écrivain, c’est qu’il attend d’être surpris par ce qu'il va poser sur le papier. Parce que la réalité présente ne le satisfait pas. Parce qu’il attend de découvrir au fil de la plume ce dont lui-même est capable, et qu'il ignorait posséder. En commençant par n'importe quoi, il se met à l'épreuve.
Imaginez un auteur de polars qui met son héros dans une situation inextricable, et qui se demande comment il va faire pour l'en sortir dans le prochain épisode du feuilleton (il faut qu'il reste vivant). Lui aussi procède par un rétablissement de l'esprit. Vialatte, c'est pareil, il lui faut de l'inédit. Parce que la route sur laquelle il marche, il la trace et la goudronne au fur et à mesure. En se demandant où elle le fera aboutir. Le monde qui est le sien sort de sa plume au moment où il écrit. Il ne sait pas, en avançant le premier pied, quel sera son point d’arrivée. Et c’est ça qui compte, évidemment.
Et ça explique qu’il n’ait jamais été un ethnologue à la façon de Lévi-Strauss, mais le meilleur anthropologue autodidacte qui soit. Et même un amoureux de la littérature. Qui décoche, de sa patte aux griffes rentrées, un mot feutré sur les fausses gloires médiatiques du moment (qui se souvient de Minou Drouet (qu'il faisait semblant, quelque part, de confondre avec Françoise Sagan, en inversant les prénoms) ce feu de paille littéraire à sensation de 1955 ?), mais qui consacre de longues pages à célébrer Chardonne, Gadenne, Hellens, Frédérique (que des discrets !), et une palanquée d'autres qu’il estime dignes d’hommage.
Le n’importe quoi de la conclusion « aura été fixé d’avance », naturellement. Les orateurs du grand siècle finissaient tous leurs sermons sur un « Ave Maria » : l’admiration allait à ceux dont l’art et la technique amenaient la prière à Marie avec le plus de souplesse et d’évidence. Et Vialatte ajoute : « Le naturel naît de la contrainte. Le naturel n’est pas naturel. C’est la grande leçon de La Fontaine. L’aisance s’ajoute. On n’arrache pas "naturellement" deux cents kilos sans faire une tête de crapaud qui fume ; c’est par l’artifice qu’on parvient à le faire en souplesse. Le naturel est artificiel ». CQFD. Qui arriverait aussi "naturellement" à cet oxymore ?
Je regrette de n’avoir jamais vu Alexandre Vialatte faire le saut de l’ange, qu’il exécutait, selon les témoins, à la perfection, à la piscine Deligny, oui, celle qui a bizarrement coulé au fond de la Seine en 1993, et que j’ai fréquentée avec mon ami Hans-Joachim Bühler dans l’ancien temps, un 15 août, dans un Paris totalement silencieux et désert.
Nous étions venus en stop depuis Neustadt-an-der-Weinstrasse, dans le Rheinland Pfalz. En fait, la maison était à Mussbach, juste à côté. Neustadt, c’était le chef Queyrel. Les parents de HA-JO habitaient Richard-Wagner Strasse 11 (ne cherchez pas, la rue a été débaptisée, je suis tombé sur un bec). Un jardin. Un barbecue.
Et puis : « Ich bin kein mädchen dass man einmal kusst », m'avait-elle lancé, l’idiote invitée, révoltée par mes manières. L'uppercut m’est resté. Abattu, je n’avais pas tardé à me rabattre. La loi de l'offre et de la demande, il faut la mettre en oeuvre. Cela aussi exige un « rétablissement de l'esprit ». Pas seulement. C’était en quelle année, bon dieu ?
Voilà ce que je me demande encore, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, poésie, almanach vermot, pataphysique, alfred jarry, ubu, faustroll, jean-sébastien bach, surréalisme, andré breton, reverdy, imagination, publicité, statistiques, san antonio, claude lévi-strauss, jacques chardonne, paul gadenne, piscine deligny
mercredi, 04 janvier 2012
QUI VEUT SAUVER RENE MAGRITTE ?
Résumé : je continue et persiste à dire du mal de MAGRITTE.
La lourdeur de MAGRITTE vient de ce qu’il veut péter plus haut que son cul, en prétendant insuffler du SENS. Il veut faire croire que ses facéties picturales sont la quintessence de l’art. Ce faisant, il procède comme tous ceux qui, en s’appuyant sur les techniques les plus modernes, prétendent imiter dans des objets fabriqués les structures biologiques du cerveau vivant, de l’A. D. N. ou de je ne sais trop quoi : à l’arrivée, ça donne quelque chose de pauvre, que dis-je, d’infirme, voire de peu humain. En plus, c’est tellement simple que c’en est aride comme le Kalahari.
Somme toute, la peinture de RENÉ MAGRITTE est la peinture THEORIQUE d’un peintre INTELLECTUEL. Comme le dit le même « docte » déjà cité auparavant : « L’œuvre de Magritte est certainement l’un des rares exemples de peinture intellectuelle de notre époque ». Tu l’as dit, bouffi ! Autrement dit, qu’on se le dise, nous voici devant de la « peinture à message ». C’est didactique, et chiant comme tout ce qui est didactique.
Le bouffi en question met sur le même plan RENÉ MAGRITTE et MAX ERNST. Il faut l'être jusqu'à la moelle, bouffi, pour confondre un fabricant de gags picturaux et un artiste véritable qui offre à voir un monde dont, la plupart du temps, il ne donne pas la clé (je pense à ses séries de collages La Femme 100 têtes et Une Semaine de bonté, mais aussi aux Jardins gobe-avions, et à tant d’autres). C’est bête, mais avec MAGRITTE, on arrive tout de suite au but. Regardez plutôt ce Jardin gobe-avions :
Et dans le genre « gag » visuel, un type comme ROLAND TOPOR pète infiniment plus haut, plus loin et plus profond que cet intello de salon. Chez TOPOR, un seul truc reste insupportable : son rire. Moins horripilant depuis qu’il est mort (mais il y a Youtube). Tout le reste est rigoureusement impeccable, même quand il se met à quatre pattes pour faire le tour du plateau de télé en gruïkant comme un cochon qu’on assassine. Je recommande en particulier la série de dessins dont il a illustré l’édition des Œuvres Complètes de MARCEL AYMÉ.
Un dernier truc qui ne me revient pas, chez RENÉ MAGRITTE, mais alors pas du tout. Il fait partie de la cohorte surréaliste, et ça c’est impardonnable, et pour une raison très précise. ANDRÉ BRETON, le pape de cette secte devenue une religion, considérait ARTHUR RIMBAUD comme « coupable devant nous d’avoir permis, de ne pas avoir rendu tout à fait impossibles certaines interprétations déshonorantes de sa pensée, genre Claudel » (Second Manifeste du Surréalisme).
Eh bien, franchement, on serait en droit d’accuser BRETON du même chef. Car à force de fouiller dans le subconscient, à force de déterrer de la « beauté convulsive » dans les tréfonds de l'âme humaine, à force d'en appeler aux ressources freudiennes de l'inconscient, le surréalisme a ouvert à la PUBLICITÉ une autoroute. Le minerai précieux de l'imagination enfouie a été amené à la lumière, et la PUBLICITÉ s'est ruée sur le magot, et s'en est servie comme d'un cheval de Troie pour envahir en retour les tréfonds de l'âme humaine avec de la MARCHANDISE sublimée par la métaphore plus ou moins poétique.
Sans même parler de ce qu’il y a d’absolument ahurissant dans le reproche adressé à RIMBAUD par ANDRE BRETON, sans même parler de SALVADOR DALI, alias Avida Dollars (comme disait A. B. en personne), le surréalisme des peintres est devenu le principal PROXENETE PUBLICITAIRE.
MAGRITTE est l'archétype du fournisseur de la filière prostitutionnelle qui exploite les pauvres PUTAINS de l'imagination, sous le couvert même de la liberté. Il a apporté à la PUBLICITE l'aliment idéal de la putasserie, qui peut se formuler ainsi : « Tout est dans tout, et réciproquement ».
RENÉ MAGRITTE, que ce soit comme surréaliste ou comme fabricant de gags visuels, est de ceux qui ont fourni en chair fraîche les « créatifs » de toutes les agences de publicité, à commencer par l'idée d' « images à idées ». Je me souviens d’une publicité pour les appareils Hi-Fi pour automobile Pioneer, réalisée de main de maître, montrant une très belle voiture en forme de violon, pour bien convaincre que la voiture, grâce à Pioneer, était devenue musique. C'était du MAGRITTE tout craché.

ANDRÉ BRETON ne tresse-t-il pas des couronnes de laurier à MAGRITTE ? « Il a abordé la peinture dans l’esprit des "leçons de choses" et sous cet angle a instruit le procès de l’image visuelle dont il s’est plu à souligner les défaillances et à marquer le caractère dépendant des figures de langage et de pensée. Entreprise unique, de toute rigueur, aux confins du physique et du mental, mettant en jeu toutes les ressources d’un esprit assez exigeant pour concevoir chaque tableau comme le lieu de résolution d’un problème. » Si je m’appelais ANDRÉ BRETON, je m’enlèverais les mots de la bouche.
Dire que j’ai trouvé fréquentable un type comme ça ! Enfin, à chacun ses erreurs de jeunesse ! Je ne lui concède qu’une seule vertu : ANDRE BRETON écrit dans un français d’un classicisme irréprochable. Pour le reste, il y a du LENINE dans les oukases de cet homme. Dire toutes ces belles paroles pour finir sur des affiches 4 x 3, le long des routes, quel avilissement !
Et je passe sur les élucubrations philosophico-machines de MICHEL FOUCAULT : « Magritte noue les signes verbaux et les éléments plastiques, mais sans se donner le préalable d’une isotopie ; et tralala… ». C’est sûr, il devait être bien défoncé, le MIMI. N'empêche que "isotopie", fallait y penser. Voyez, on n'en sort pas, du gag.
Et je passe sur les divagations délirantes de RENÉ MAGRITTE lui-même, où il attribue aux choses un autre nom, appelant une « feuille » (d’arbre) un « canon ». Ou pas de nom du tout, comme cette barque qui vogue sur la mer. Le fait que ça se passait en 1929 (La Révolution surréaliste n° 12) peut-il constituer une excuse ? Une circonstance exténuante ? Un délit de non-assistance à personne engrangée ? Un cas non répertorié de grippe aviaire ?
Pour conclure, une petite charge sabre au clair contre l’ « art conceptuel ». Vous voyez déjà le lien, non ? Je sais bien que MARCEL DUCHAMP est considéré comme le grand ancêtre, avec ses ready-mades et quasi-ready-mades (hérisson porte-bouteille, urinoir transformé en « fontaine », trois « stoppages-étalons », etc.), mais MAGRITTE arrive pas loin derrière.
D'ailleurs, des artistes encore vivants ont réglé son compte à DUCHAMP. Ils s'appellent GILLES AILLAUD, EDUARDO ARROYO et ANTONIO RECALCATI. Et leur oeuvre (anecdotique, disons-le) s'intitule Vivre et laisser mourir ou La Fin tragique de Marcel Duchamp. Cela date de 1965. Certains ont appelé cela « réhabilitation du figuratif » ou postmodernité. Quand il n'y a plus de concept, il en vient encore.
Mentionnons tout de même ce magnifique cadre doré digne des salons de la grande bourgeoisie, où FRANCIS PICABIA avait, je crois que c’était en 1919, à l’occasion d’une exposition, suspendu par une ficelle un vrai morceau de macadam noirâtre comme seule et unique « œuvre ». C’était aux beaux jours de Dada.
Il me semble que MAGRITTE est, plus que DUCHAMP, le précurseur de cette cinglerie qui s’appelle « art conceptuel », auquel il prépare le chemin. Pour prendre une comparaison, je dirais que RENÉ MAGRITTE est à l’art conceptuel ce que SAINT JEAN-BAPTISTE fut à JESUS CHRIST. « L’objectif de l’art conceptuel est d’affirmer de façon radicale la prééminence de l’idée, de la conception sur la réalisation. » Ce n’est pas moi qui le dis.
Attendez, c’est pas fini : « De plus, l’œuvre pouvant se réduire à un énoncé, sa matérialisation n’est plus intrinsèque à l’acte artistique ». Si, si, je vous jure, à midi, une tranche de ça entre deux tranches de pain, et je vous garantis que vous n’avez plus faim de toute la journée. Même que JOSEPH KOSUTH l’a dit : « Art as idea as idea ». L'étape suivante, on s'en souvient très bien, c’est l’équation de la relativité générale à résoudre en milieu subaquatique par deux pingouins à lunettes demandant la nationalité daghestanaise en plein blocus continental.
Je continue : « La démarche se veut essentiellement intellectuelle [et toc !], analytique et critique ». Le grand mot est lâché (il faudrait dire le « gros mot » : intellectuel). L’auteur que je cite concède quand même : « Une part de la critique s’est plu à voir dans ce mode d’expression extrémiste, austère, parfois immatériel et paradoxal, souvent ennuyeux, la mort de l’art (…) ». Eh bien écoutez, franchement, parfois, ça fait du bien à entendre. « La mort de l'art ». Et ce n'est même pas moi qui le dis.
Voilà ce que je dis, moi.
Ça suffira pour cette fois.
09:00 Publié dans L'ARCON, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : publicité, publicitaire, propagande, rené magritte, art, peinture, art contemporain, art conceptuel, intellectuel, max ernst, andré breton, surréalisme, arthur rimbaud, salvador dali, lénine, michel foucault, marcel duchamp, gilles aillaud, eduardo arroyo, antonio recalcati, francis picabia, joseph kosuth
mardi, 03 janvier 2012
MAGRITTE, UNE GRITTE CARABINEE
Résumé : j'ai commencé à me payer la tête de RENÉ MAGRITTE.
Prenez La Lampe du philosophe, par exemple. Un homme en costume-cravate fume la pipe, à droite, en vous jetant un œil torve, pendant qu’une bougie brûle sur une sellette d’artiste. Sauf que, d’une part, la bougie semble grimper le long du pied pour venir s’épanouir comme un serpent dressé, et d’autre part, le nez de l’homme opère un plongeon dans le fourneau de la pipe. Bon, vous me direz que « lampe » rappelle la bougie, et « philosophe » l’homme. Je veux bien. Mvoui … Vous y croyez, vous ?

En fait, il ne fait pas de la peinture, il fait de la linguistique. Et saussurienne, en plus (de FERDINAND DE SAUSSURE, le fondateur de la discipline, celui de la trilogie en pataugas « signifiant / signifié / référent », celui de « le signifié "chien" ne mord pas », celui de « l’arbitraire du signe », et tant de belles choses dont on s’est servi pour détruire l’enseignement de la grammaire à l’école, sous prétexte qu’il fallait procéder intelligemment). Tout ça, si ce n’est pas du pataugas, c’est du gros sabot. Je m’explique.
Au commencement était Ceci n’est pas une pipe. Le gros malin, sur sa toile, représente une pipe. Le travail est grossier, mais on reconnaît l’objet. Et pour faire chier le spectateur, qu’est-ce qu’il fait, le gros malin ? Il peint en toutes lettres « Ceci n’est pas une pipe ». Tout ça pour dire au premier con venu à qui il prendrait l’idée de bourrer son tableau de tabac pour l’allumer et le fumer, qu’il n’a rien compris, ce gros plouc.

On ne sait jamais, doit-il se dire. Comme le dit un « docte » : « Il suffit d’un instant de réflexion pour se rendre à l’évidence : l’image d’un objet n’est pas l’objet lui-même ». « Tu l’as dit, bouffi ! », aurait ricané Arsène Lupin au nez de l’inspecteur Ganimard.
Mais pour peindre ça, c’est vraiment ce que RENÉ MAGRITTE s’est dit : « Qu’est-ce que j’en ai marre, que les gens confondent la chose et sa représentation, je vais leur administrer une injection de linguistique. Répétez après moi : la matière picturale qui fait la pipe, c’est le ? Le ? Signifiant, bande de balourds ! L’objet représenté ? Le signifié, bande de baudets ! ».
« Et la bouffarde que je viens d’allumer sous vos yeux ? Le référent, bande de nuls ! – Oui m’sieur, bien m’sieur, je l’f’rai plus, m’sieur. – Allez, circulez, et ne m’emmerdez plus ! ». Voilà comment il vous parle, RENÉ MAGRITTE. Et vous, vous supportez qu’on vous adresse la parole en levant le menton comme ça ?
Alors une fois que tu as compris ça, tu sais ce qu’elle fait, la peinture de RENÉ MAGRITTE, si tu es normalement constitué ? Elle te tombe des yeux. Tiens, prends un grand problème philosophique, je sais pas moi, dis voir quelque chose. – La Condition humaine ? – Allez, prenons la « condition humaine ». Il se trouve que c’est un autre titre du peintre.
Tu devines pas ce que ça représente ? Une chambre dont la large fenêtre voûtée donne sur un paysage campagnard, avec un ruisseau, de l’herbe, des buissons, et un ciel où passent quelques nuages. Un rideau rouge à droite et à gauche. Tout est soigné, léché même, y compris le chevalet installé devant la fenêtre, sur lequel est posée une toile peinte.

Allez, tu devines pas ce qu’il y a de peint sur la toile ? Mais si, gros ballot : le paysage lui-même ! Le gros malin qui tient le pinceau s’est juste débrouillé pour qu’on confonde pas : à gauche, le tableau déborde un chouïa sur le rideau, à droite on voit les clous qui fixent la toile sur le cadre, avec en haut le sommet du chevalet. Sans ces détails, tu ferais pas la différence entre le paysage et le tableau, con ! Là, pas moyen de se tromper. Sous le même titre et avec le même « truc » (on ne change pas une équipe qui gagne), on trouve aussi un paysage marin.

Voilà, le seul « truc » de cette « œuvre », c’est de nous enfoncer dans le crâne que ce qu’on voit sur la toile n’est pas ce qu’on voit de la nature. La surface peinte donne l’illusion de la nature. « Mais attention, les petits enfants, je suis là, moi, le peintre savant, pour vous dire qu’il ne faut pas confondre. » Finalement, le père MAGRITTE prend le spectateur pour une buse, et prend la pose dans l’attitude du professeur donneur de leçons.
Toute la peinture de RENÉ MAGRITTE est contenue dans la seule surface, se résume à la surface. C’est une peinture de truqueur habile, qui se contente de jouer sur les apparences. Tiens, encore un exemple. Je ne me rappelle plus le titre de celui-ci : dans une pièce fermée, sur une table, trône une superbe cage à oiseaux. Dans la cage, pas d’oiseau, mais un œuf. Et pas n’importe quel œuf : un énorme, un œuf de dinosaure. Pour vous dire, il occupe tout le volume de la cage.
Et alors, me direz-vous ? Ben rien. C’est tout. A votre avis, quelle taille aurait dû avoir la cage pour abriter l’oiseau capable de pondre un œuf pareil ? Bon sang mais c’est bien sûr, ah le diable d’homme, fallait y penser. Ben oui, il est là le gag. Mais quand on a résolu l’énigme, c’est comme le polar, on peut le jeter, le donner ou se torcher avec. Il n’y a plus rien à en tirer. Là c’est pareil : le fruit est sec.
MAURITS CORNELIS ESCHER a le même genre de succès que MAGRITTE, avec ses paradoxes visuels : cascade qui se jette plus haut que son point d’origine, personnages qui montent et descendent des escaliers dans tous les sens verticaux et horizontaux, deux mains qui se dessinent mutuellement, l’anneau de Möbius et autres facéties graphiques. Son truc à lui, c’est le trompe-l’œil : il télescope les deux dimensions de la feuille de papier et les trois dimensions de la perspective (illusion du volume). Du coup, ça détraque tout et ça fait du paradoxe.

Je qualifierais volontiers ce genre de succès de « succès de poster » : ça fait très bien, punaisé sur le mur de la chambre du jeune qui s’initie. Mais il me semble que ESCHER a un statut beaucoup plus modeste, je veux dire moins prétentieux. Regardez donc Le Thérapeute, de MAGRITTE : un corps de berger normal, sauf la cage thoracique, dont l’espace est occupé par une cage à oiseaux ouverte, avec deux blanches colombes sur la piste de décollage.

Oui, monsieur, on a compris le MESSAGE. Un rien de niaiserie en plus, et voilà-t-il pas qu’il tomberait dans la boutasse JACQUES PREVERT (« Pour faire le portrait d’un oiseau ») ou dans le fumier PIERRE PERRET (« Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux »).
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:04 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : magritte, peinture, art contemporain, surréalisme, linguistique, ferdinand de saussure, ceci n'est pas une pipe, arsène lupin, littérature, la condition humaine, le thérapeute, jacques prévert, pierre perret, mc escher
lundi, 02 janvier 2012
MAGRITTE : DU CONCEPTUEL DANS L'ART
Il est convenu que RENÉ MAGRITTE est passé dans les mœurs. On passe devant un MAGRITTE comme on passe devant une publicité, des latrines, un banc public ou un Roumain qui mendie à un feu rouge. On ne s’arrête pas. Il fait partie du paysage. C’est une preuve. De quoi ? Au premier rabord, c’est une preuve de succès. Qu’est-ce que c’est, le succès, demandé-je finement ? Le succès, réponds-je superbement, c’est quand l’offre, à sa grande surprise, est submergée par la demande.
Dans n’importe quelle entreprise, ça poserait problème. Pas dans l’entreprise MAGRITTE ltd. La ligne de production, surdimensionnée, a été conçue en prévision d’un tel problème. Car on a du flair, chez MAGRITTE. Quand les chalands se jettent sur le rayon familial où l’on vend quelques tableaux, ces marchands forains ont tôt fait d’effacer les ardoises et d’y multiplier à la craie les prix par deux, dix ou cinquante.
Dans la banque, on appelle ça « faire marcher la planche à billets ». C’est qu’on n’est pas con, dans la famille, on comprend vite comment faire rentrer les pépettes. Et ça marche.
Comment s’explique un tel succès ? Je vais vous le dire. En fait, rien de plus simple : RENÉ MAGRITTE est le premier peintre qui ait abandonné l’art pictural pour la peinture intelligente. Enfin, la peinture qui se veut intelligente. Même pas : qui se croit intelligente. Avec un arrière-fond métaphysique dans la prétention. Mais tout ça ne serait rien sans un rien d’astuce.
Car ce rusé renard est
· un habile finaud et futé,
· un madré subtil et matois,
· un Normand (de Belgique) habile et adroit
(rayer les mentions inutiles). En camelot accompli, MAGRITTE arrive à faire croire que c’est le badaud lui-même qui est intelligent, et que c’est pour ça qu’il aime sa peinture. Quel talent ! On aura beau dire, mais des trouvailles comme ça, ça vaut de l’or. Le plus fort, c’est que le gogo s’exclame : « Gogo est content ! », en rentrant chez lui son tableau sous le bras. Le perroquet de L’Oreille cassée ne disait pas ça, mais : « Rodrigo Tortilla, tu m’as tué ! ».
On va dire que je calomnie, que je diffame. Que je veux faire mon intéressant. Cela n’aura même pas le mérite d’être vrai. Car je vais vous dire une bonne chose : toute la peinture de RENÉ MAGRITTE est fondée sur des « trucs », des gags, si vous préférez.
Pour le premier degré, prenez une toile blanche, mettez-y de la peinture « en un certain ordre arrangée » (en clair : faites-y apparaître un paysage, un portrait, une nature morte ou ce que vous voulez). Cela donne, par exemple, cette palissade de planches de sapin, bien dessinée avec les nœuds, les veines et les rainures de séparation. Au pied de la palissade, un sol rougeâtre, où l’on distingue des graviers, un bout de journal, un mégot, une allumette.
Et sur le sol ? « Je vois une paire de pieds. – Mais non, tu vois bien que c’est une paire de chaussures. – T’es fou, c’est des pieds. – Non, c’est des chaussures. – Paf ! – Pif ! » Et bien moi, je vais vous réconcilier : c’est une paire de brodequins, des bottines si vous voulez, avec les lacets qui pendouillent, et que plus vous allez vers la pointe, plus ce sont des pieds. Même que sur le pied gauche, on voit une grosse veine bien gonflée.
Voilà, c’est ça, un tableau de MAGRITTE. Ah on ne peut pas dire qu’il ne sait pas faire. Pour ça, c’est sûr que c’est du travail bien fait. Le seul problème, c’est que c’est un gag. Si je voulais faire mon intello, je dirais qu’il s’agit d’un paradoxe. Le spectateur qui découvre la scène s’arrête, interloqué : « Tiens, c’est bizarre ». Puis il réfléchit. Après une cuisson de quelques secondes, le voilà qui se dit : « Putain, c’est bien trouvé ! Fallait y penser ! ».
Devant un tableau de RENÉ MAGRITTE, voilà comment on réagit. Et pas autrement. Parce qu’il n’y a rien d’autre à voir, on n’a rien d’autre à faire. MAGRITTE fait de l’image comme RICHARD VIRENQUE fait du vélo. Alors bon, d’un tableau à l’autre, c’est plus ou moins énigmatique, ou rigolo, ou soigné, ou ce qu’on veut, mais dans l’ensemble, on a fait le tour quand on a compris le gag. C’est comme les blagues de l’Almanach Vermot qu’on trouve dans les papillotes Voisin.
Mais ce n’est pas fini, car après le premier degré, il y a le second. Sinon le moteur tomberait vite en panne d’essence. Prenez le tableau décrit ci-dessus et collez-lui un TITRE, pour voir, allez-y. « Isba détrempée » ? Vous n’y êtes pas. « La Marche au supplice » ? Ce ne serait pas si bête, mais c’est déjà pris. Allez, vous donnez votre langue au chat ? Ce mirifique tableau porte le mirifique titre de Le Modèle rouge.
Ça vous en colmate une fissure, non ? Et là encore, la seule réaction à avoir : « Fallait y penser ». Un génie pareil, on comprend qu’il ait commencé dans une fabrique de papier peint. C’est d’autant plus drôle que c’est authentique. Parce que je me dis aussi que c’est peut-être là qu’il a eu la révélation de son inspiration. Alors pour les titres, les officines du Savoir vous diront qu’ils furent proposés à MAGRITTE par ses copains de la « société du Mystère ». Je veux bien, mais je ne vois pas ce que ça change : moins le titre a de rapport avec le tableau, plus la blague est réussie.
Pour bien montrer que RENÉ MAGRITTE n'est finalement qu'un dessinateur humoristique, dont la place est en réalité dans la presse quotidienne, et pas dans les musées, voici, côte à côte, Le Balcon, d'EDOUARD MANET, et le gag imaginé par MAGRITTE pour se foutre de la gueule de MANET (qui, soit dit en passant, rendait hommage aux Majas au balcon, de GOYA).
Et voilà le public qui se met à rire grassement et à faire ouaf ouaf !
Voilà ce que je dis, moi.
A continuer demain.
09:01 Publié dans L'ARCON, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené magritte, peinture, art contemporain, surréalisme, l'oreille cassée, le modèle rouge, richard virenque, almanach vermot, art conceptuel


