vendredi, 11 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 6/9

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS
ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
6/9
Du triomphe de la Dissonance (ou "Le siècle du Divorce").
Car le 20ème siècle, encore plus que le 19ème, est celui où plus personne ne sait. Celui qui casse toutes les grandes machines à produire des points de repère intellectuels, moraux, sociaux, affectifs, religieux, politiques, idéologiques, psychiques. Celui qui disloque les machines à produire un SENS qui puisse servir d'assise à l'existence des gens. Celui qui m’a amené pour finir, dans un souci de préservation, à cesser de me vivre comme un contemporain de mon époque. Le siècle où je suis né a fini par me décider à me raccrocher à quelques rochers surnageant encore dans un océan de destructions, quelques îlots esthétiques où il semble encore possible de respirer malgré les conditions que fait le monde des hommes à l'humanité. Comme dit le grand Pierre Rabih : « On ne peut pas renoncer à la beauté ».
Le 20ème siècle est celui qui ne sait plus grand-chose de l’humanité. Bien des formes d’art qu’il a fait naître ignorent superbement l’humain. La beauté ? N'en parlez surtout pas en présence de Catherine Millet ou de Catherine Francblin, qui sont aux manettes de la revue Art press, cette manufacture de la "modernité" ultra-chic et à la pointe de toutes les avant-gardes. La beauté, c'est un critère ringard et archaïque. Et finalement, je crois qu’il est là et nulle part ailleurs, le grief radical que j’adresse à Marcel Duchamp et à toute son innombrable progéniture.
Encore pourrais-je moi-même, à bon droit, soutenir l’idée que cet inaugurateur de la destruction esthétique n’a fait que transposer dans le domaine de l’art ce qu’il voyait se produire sous ses yeux dans la réalité : Dada (auquel Duchamp a participé de très loin et "en esprit") est né en février 1916, c’est-à-dire en pleine guerre, plus précisément au moment du déclenchement de la grande boucherie de Verdun (où Falkenhayn avait promis de "saigner l'armée française"). Un symbole ? Le 20ème siècle comme assassin de l'idée de la beauté ?
Mais on rétorquerait à aussi bon droit que les premières œuvres plus ou moins ouvertement atonales (rompant avec les notions de tonalité, de mélodie et d'harmonie qui prévalaient jusque-là), datent d'avant ce premier carnage planétaire (le dernier Liszt, Scriabine). Je répliquerais au contradicteur que la guerre de 14-18 n’est pas sortie de nulle part, et que des prodromes de plus en plus nets (montée des nationalismes, rivalités impérialistes, entre autres) étaient perceptibles bien avant le 4 août 1914. Ce n'est pas pour rien que l'époque a produit dans le même temps le cubisme, la musique atonale, le dadaïsme et la guerre : ces choses-là sont vendues en "pack". Et c'est bien le problème : c'est à prendre ou à laisser. Mais était-il possible de "laisser" ?
En musique, l’indifférenciation radicale des douze sons de la gamme, puis plus tard l'extension de la notion de son musical à toutes les matières sonores possibles et imaginables, et l'élévation de tous les bruits à la dignité d'objets musicaux (Pierre Schaeffer a écrit Traité des objets musicaux, et puis ce fut la litanie : sons d’origine électronique, moyens portatifs d’enregistrement, et échantillonner, et couper-coller, et bidouiller, et métisser, et ...), tout ça pourrait être considéré comme autant d'oracles : en parallèle, plus le monde sonore (créé par l'homme) devenait dissonant, plus il annonçait à l’humanité que le 20ème siècle serait le grand siècle de la Dissonance généralisée et des conditions dissonantes de la vie.
Les conditions capables de rendre concevable et possible une éventuelle « Harmonie » ont disparu. La Dysharmonie règne en maîtresse. Et qu'on ne me raconte pas de fable à propos d'une improbable « Harmonie Nouvelle », à laquelle il faudrait que le bon peuple se fasse et s'habitue, bon gré mal gré. Trop de musiques du 20ème siècle sont, restent et demeureront inhabitables. Nous sommes les enfants de la Dissonance, de la Discorde, de la Distorsion, de la Dysharmonie, ... Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que la planète, la nature et les océans subissent les amères conséquences d'un siècle à ce point déprédateur.
La Dissonance est devenue la Norme dans la vie en même temps que dans les arts. La Dissonance, cette forme de Divorce qui demeurait l'exception auparavant (une dissonance finissait par une "résolution", c'est-à-dire un accord consonant), s'est ainsi banalisée et généralisée dans la peinture, dans la musique, dans la vie des gens mariés, dans la relation des hommes avec leurs semblables, dans leur relation avec la nature, etc. Le divorce est devenu le grand mode de vie, une modalité durable de l'être cassé en deux (en combien de morceaux ?). On a tenté de faire croire aux gens qu'on peut s'habituer à tout. Mais non : on ne s'habitue pas à tout. Nul ne peut habiter une maison qui le détruit. De quoi pleurer jusqu'à la fin des temps. Pour échapper à cette violence, une seule issue : divorcer de l'époque.
C'est ce genre de divorce qu'ont magistralement incarné quelques grandes figures de la pensée et de la littérature : Jacques Ellul, Günther Anders, Guy Debord, Philippe Muray, Michel Houellebecq, ... (le cas de Hannah Arendt, beaucoup moins en rupture, est différent). C'est l'unique raison que je vois à la détestation, que dis-je : à l'aversion, à l'exécration, à l'abomination dont ces dissidents font l'objet dans les milieux du consensus mou, de l'hypocrisie caritative, de la doxa, de la police de la pensée et du terrorisme intellectuel (quoique Debord ait récemment fait l'objet d'une récupération d'Etat : ses archives sont désormais un "Trésor national"). Cette pensée et cette littérature ont-elles infléchi la trajectoire d'une minute d'angle ? Je vous laisse répondre : c'est trop évident. Mais que peut la Culture ? Que peut la Littérature ? Que peut la Pensée ? Vous avez quatre heures pour rendre copie blanche.
Le monde pictural lui-même n’a pas attendu la guerre de 14-18 pour se détraquer : que faire, face à l'académisme, au conformisme pompier (Bouguereau, Couture, Meissonnier, Detaille, Laurens, Gervex, …) : obéir aux suggestions de Corot, de Rosa Bonheur, d’Eugène Boudin ? Une certitude émerge : il faut inventer pour exister. Claude Monet, qui se met à diviser les couleurs pures, à les juxtaposer, à rendre problématique la représentation du monde, pousse sur ce terreau, et tous les suivants, jusqu’à Seurat et Van Rysselberghe. Bientôt fauvisme, cubisme, suprématisme, surréalisme. Ces désintégrations successives disent un chose : à quoi bon l’art, quand le message porté par l’époque est la dissonance, la fragmentation, voire la négation de la réalité visible, bientôt suivies par la destruction des hommes à l’échelle industrielle ? Que reste-t-il à espérer du monde en train de se faire ?
Heureusement, les lois de l’inertie étant ce qu’elles sont, ce désespoir radical mettra un peu de temps à manifester sa radicalité (quoique ... Céline ...). La négativité côtoiera pendant quelque temps l’optimisme qui rend possible la création. Le cas du surréalisme est particulièrement riche d'enseignement. « Révolution » pour ses premiers promoteurs, puis mis « au service de la Révolution », on peut dire que, avant de rentrer dans le rang et de faire simplement de l'art "comme tout le monde", il a effectivement mis le bazar dans la culture, dans l'art et dans les esprits de son temps (en gros de 1924 à l'après-guerre, je compte pour rien les suiveurs, les suivistes, les petits curés, les "post-", les "épi-", les "para-", les prosélytes, les mouches à m...iel et les apôtres).
Avec le recul du temps, qu'en est-il ? Qu'ont-ils fait, en définitive, André Breton, ses séides et sa meute de courtisans (lire le méconnu Odile de Raymond Queneau à ce sujet, où le "pape du surréalisme" est dépeint sous les traits du pompeux Anglarès qui, entre parenthèses, passe beaucoup de temps, dans le livre, à boire des bières en compagnie de ses suiveurs), avec leur « automatisme psychique pur », leurs « rêves éveillés », leur « changer la vie, a dit Rimbaud, transformer le monde, a dit Marx, ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un » ?
D'un côté, ils ont permis à l'époque de croire qu'elle disposait encore de ressources jusque-là insoupçonnées, dans le sous-sol du psychisme. Une planche de salut inespérée. Si l'on veut bien comparer avec les gaz et pétroles de schistes, solution désespérée pour soi-disant remédier au « Peak Oil », le surréalisme apparaît comme l'ultime possibilité de croire que l'art disposait encore d'une réserve de nouveaux moyens d'expression. En amenant au jour tout un attirail d'images, d'objets et d'assemblages, les surréalistes ont pu donner l'illusion d'un gisement inépuisable de nouveaux papiers peints à apposer sur les murs de plus en plus craquelés de notre univers désolé.
De l'autre côté, ils ont fourni à la propagande, au bourrage de crâne, à l'endoctrinement, en un mot : à la publicité (alors en plein épanouissement : Edward Bernays et consort), un carburant aux effets puissants : une masse de thèmes nouveaux et surprenants, exploitables ad libitum. Ils ont permis à la bientôt sacro- sainte marchandise de prendre possession des esprits, et de se mettre à briller d'un éclat aveuglant à l'horizon de toutes les populations du monde. Magritte, en particulier, avec ses confusions en gros sabots (paradoxes visuels, premier plan / arrière-plan, calembours picturaux, jeux signifiant / signifié, etc...), reste une mine d'or pour bien des "créatifs" d'agences publicitaires.
sainte marchandise de prendre possession des esprits, et de se mettre à briller d'un éclat aveuglant à l'horizon de toutes les populations du monde. Magritte, en particulier, avec ses confusions en gros sabots (paradoxes visuels, premier plan / arrière-plan, calembours picturaux, jeux signifiant / signifié, etc...), reste une mine d'or pour bien des "créatifs" d'agences publicitaires.
En réalité, le surréalisme est la tentative désespérée d'une humanité poussée dans la nasse par un siècle fou, de trouver une issue de secours. Et l'on ne peut que constater les dégâts : plus la réalité s'est craquelée sous les coups totalitaires des camps de la mort, des procès de Moscou et de la "Bombe" (Allemands + Russes + Américains, ça fait du monde), puis sous les coups plus insidieux de la marchandisation progressive de tout, plus ce recours au monde intérieur, au monde de l'inconscient et de l'imaginaire apparaît comme un dernier refuge avant écrasement. Comme une impasse et un cul-de-sac. Un sac en plastique pour y mettre la tête jusqu'à ... On se félicite, rétrospectivement, de ce qu'André Breton ait été tout à fait insensible à la musique. Quels dégâts n'aurait-il pas commis ? Remarquez que d'autres s'en sont chargés, qui ne se réclamaient pas du surréalisme.
Le surréalisme a momentanément rassuré le monde de l'art en lui fournissant, pendant un temps, une sorte de trésor de substances nutritives de substitution (le surréalisme est au monde de l'art ce que la méthadone est à l'héroïne), en même temps que l'illusion de possibilités infinies de développement. En réalité, avec le surréalisme, le monde de l'art raclait ses fonds de tiroirs. Asséchait ses derniers marécages avant le désert. Achevait ce qu'avait commencé Alphonse Daudet avec son personnage principal, dans L'Homme à la cervelle d'or : se vider la tête.
Car ce qui est curieux ici, c’est de constater que plus le surréalisme met le paquet sur le renouvellement des images et ce ressourcement superficiel de l’imaginaire, plus la réalité concrète prend le chemin inverse, celui du sordide et de l’invivable. Au fond, les formes héritées du surréalisme constituent une sorte de dénégation générale de la réalité. Une dissociation d'ordre publicitaire (la dissonance métaphorique, qui prend des airs de coalescence : une femme nue pour vendre un yaourt, mettre du désir dans une marchandise, ...), qu’on observe pareillement dans l’évolution des discours politiques : plus la réalité fout le camp, plus le discours doit faire semblant de restaurer le désir en affirmant la maîtrise du politique sur le réel. En France, les politiciens incantatoires s'entendent à merveille pour nous en offrir des preuves éclatantes.
A partir de là, art et réalité ont pu diverger "à plein tube". "Artistes" et "responsables", de plus en plus déconnectés du réel, ont commencé à faire comme si. Comme si le monde ancien se perpétuait, pendant que la réalité foutait le camp, échappant à tout le monde. Comme si l’on pouvait continuer impunément à soutenir dans les mots un modèle déjà quasiment effondré dans la réalité. Tout le monde a fait semblant (faire semblant : un des sens du mot « Spectacle » dans le vocabulaire de Guy Debord). La Dissonance a gagné. Le Divorce est consommé.
Il y a donc beaucoup d’artistes (il faut bien vivre) qui se sont alors faits les simples greffiers du désastre, dont ils se sont contentés d’enregistrer, inlassablement, les signes. Ils ont tiré un trait définitif sur l’homme. Ils ont pris acte. Ils ont tourné la page, sans joie (quoique …), mais sans regret. Ils ont meublé ce désert enfin débarrassé de l’humain, nouveau territoire de l’art, des objets les plus divers surgis de leur fantaisie, de leurs caprices, de leurs humeurs, du hasard, des occasions. Ils ont inventé la gratuité, la futilité, la vanité du geste artistique, de même que je ne sais plus quel personnage de Gide médite je ne sais plus quel meurtre pour prouver que l’ « acte gratuit », ça existe. Ils ont introduit la destruction et le déchet dans l’acte créateur (toujours l’ultralibéral Schumpeter, avec sa "destruction créatrice"). D’où, entre beaucoup d’autres, la machine à caca ("Cloaca") de Wim Delvoye, façon de déclarer : « On est dans une belle merde ». Mais la merde peut-elle être belle ? Comme l’écrit quelque part Beckett : « Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste plus qu’à chanter ». C’est à cette vision du monde (« Weltanschauung ») que je ne peux me résoudre. 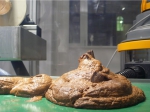
 Quand on a fait caca, on peut dire qu'on a "coulé un bronze", mais aucun être humain n'est en mesure de chier le "Persée" de Benvenuto Cellini. La Cloaca de Wim Delvoye en est une preuve répugnante.
Quand on a fait caca, on peut dire qu'on a "coulé un bronze", mais aucun être humain n'est en mesure de chier le "Persée" de Benvenuto Cellini. La Cloaca de Wim Delvoye en est une preuve répugnante.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, peinture, marcel duchamp, dada, dadaïsme, bataille de verdun, guerre 14-18, falkenhayn, franz liszt, scriabine, musique atonale, dodécaphonisme, musique sérielle, cubisme, pierre schaeffer traité des objets musicaux, dissonance, jacques ellul, günther anders, guy debord, philippe muray, michel houellebecq, pompiérisme, peintres pompiers, bouguereau, couture, meissonnier, detaille, gervex, corot, rosa bonheur, eugène boudin, claude monet, impressionnisme, divisionnisme, van rysselberghe, fauvisme, surréalisme, louis ferdinand céline, odile raymond queneau, edward bernays, publicité, magritte peintre, alphonse daudet l'homme à la cervelle d'or, wim delvoye cloaca, pierre rabih, revue art press, catherine millet, catherine francblin
samedi, 23 juin 2012
LISEZ TOUS LES NOMS, MONSIEUR LE MAIRE !
Merci à Philippe Meyer, centriste multicarte par ailleurs, mais aussi amateur et militant (et chanteur lui-même, et grand connaisseur) de la chanson française, l’autre matin, sur France Culture. A l’occasion de la mort de l’un d’eux, il a égrené les noms des « Compagnons de la Libération » qui sont encore en vie à ce jour. Les très rares (1038 au total, avouez que ça ne fait pas lourd) qui ont rejoint, parfois de façon assez « acrobatique », le Général De Gaulle à Londres, juste après avoir entendu son appel, lancé le 18 juin 1940, sur « Radio Londres ».
Voici les noms de ces Compagnons de la Libération survivants : HENRI BAUGE-BERUBE, GUY CHARMOT, DANIEL CORDIER, LOUIS CORTOT, YVES DE DARUVAR, VICTOR DESMET, CONSTANT ENGELS, ALAIN GAYET, HUBERT GERMAIN, CHARLES GONARD, JACQUES HEBERT, PAUL IBOS, FRANÇOIS JACOB, PIERRE LANGLOIS, CLAUDE LEPEU, LOUIS MAGNAT, JEAN-PIERRE MALLET, FRED MOORE, ROLAND DE LA POYPE, CLAUDE RAOUL-DUVAL, ANDRÉ SALVAT, ETIENNE SCHLUMBERGER, PIERRE SIMONET, JEAN TRANAPE, EDGAR TUPÊT-THOMÉ, ANDRÉ VERRIER.
Bon, c’est vrai, c’est sans doute héroïque, mais le hasard n’est pas pour rien dans cette affaire, car on se demande combien de Français l’ont entendu, l’Appel du 18 Juin 1940. Ils auraient été combien, si tout le monde en France avait été devant sa radio, allumée sur la bonne longueur d’onde, à la bonne heure ?
Et à l'époque, il n’y avait pas de réécoute, de podcast, de téléchargement possibles. Ils ont été 1038 à sauter le pas : je dis bravo, même si je trouve qu’il ne faudrait pas trop en faire autour de ce fait somme toute, au moins concrètement, anecdotique. Mais DE GAULLE avait besoin de faire mousser son mythe. Et pour la propagande, il se posait un peu là, CHARLOT. Reste qu’il fallait avoir le culot de le faire, quoi qu’on dise. Sans lui, on ne serait pas « en Germanie », comme le chantait MICHEL SARDOU (« Si les Ricains n’étaient pas là »), mais en Américanie. Remarquez, l’Américanie, on y est venu ensuite.
Quoi qu’il en soit, on ne dira jamais assez combien est important le nom de l’homme qui porte son nom. Les anthropologues ou les zoologues n’ont peut-être pas assez souligné, à ce jour, que ce qui sépare le règne animal du règne humain, c’est la capacité, entre les individus, non seulement de se reconnaître entre eux, mais encore de se nommer les uns les autres. Pourquoi croyez-vous que, dans ce blog, je me donne la peine de mettre des majuscules aux noms des personnes, chaque fois que je parle des personnes, y compris celles que je n'aime pas ? Parce que finalement, c'est du boulot, de mettre les majuscules. Mais je me dis que, non seulement ça vaut le coup, mais c'est essentiel.
Les Juifs, au mémorial Yad Vashem, ont compris l’importance qu’il y a à lire les noms. Ils savent que c’est le seul moyen, après leur mort, de continuer à affirmer que des individus ont été vivants. Et il y en a 6.000.000. C’est comme ça, et pas autrement, que nous, Français, devrions procéder, à chaque 11 novembre, devant chacun des 36.000 monuments élevés, dans nos 36.000 communes, à chacun des 1.712.000 individus morts durant les quatre ans de la 1ère guerre mondiale.
Des individus, voilà ce que nous sommes. Et la barbarie, pour commencer le 20ème siècle, a été la tentative effectuée par une prétendue civilisation d’effacer la notion d’individu, en inventant le massacre industriel, le massacre de masse d’individus qu’on aurait voulu transformer en machines ou en matière. Un Hiroshima étendu sur quatre ans, quoi. Hiroshima, en somme, a eu le mérite de l'instantanéité. De la rentabilité, si l'on veut. Car quatre ans, ça coûte un prix fou. L'endettement de la France, en 1919, était de 120 % du PIB. A comparer aux 85 % actuels, vendus dans les médias comme déjà catastrophiques.
« Il faut saigner l’armée française », disait FALKENHAYN, juste avant l’énorme bataille de Verdun, en 1916, qui fit en 10 mois 715.000 victimes (tout compris : tués, blessés, disparus) allemandes et françaises, avec le léger avantage de 41.000 aux Français. Cela n’a pas empêché FALKENHAYN de croire jusque sur son lit de mort qu’il avait « saigné l’armée française », et pas l’armée allemande par la même occasion. Si ça se trouve, il le croit encore.
Ce qui me semble désolant, à chaque 11 novembre, devant le monument aux morts, ou devant la « tombe du Soldat Inconnu », ou à Douaumont ou ailleurs, c’est le côté militaire et anonyme de la commémoration. Il y a le maire du village, certes, mais il y a aussi des drapeaux, et même des Anciens Combattants, souvent coiffés de leur béret rouge, vert ou noir, et arborant leurs décorations. Je suis désolé : l'ancien combattant d'Algérie ou d'Indochine, le 11 novembre, c'est pire qu'une erreur, c'est carrément un contresens.
Car ce faisant, ce qu’on oublie, ce sont tout simplement les NOMS des hommes de 14-18 creusés dans la pierre du monument aux morts. Alors même que ce sont eux l’essentiel. C’est parce qu’ils sont gravés là qu’il y a ce rassemblement municipal. Les noms des gars du coin, pour la plupart des paysans, sans doute (en 1896, la France agricole comptait, pour une population globale d’environ 40.000.000, plus de 8.000.000 de personnes actives, dont pas loin de 6.000.000 d’hommes, à comparer aux actuels 400.000 (environ) agriculteurs).
Comment leur rendre hommage ? Comment se souvenir d’eux ? C’est très simple : en prononçant leurs noms, tous leurs noms, à haute et intelligible voix. Et s’il vous plaît, ne vous défaussez pas, ne vous débarrassez pas du poids du fardeau, en déléguant la tâche, en les faisant prononcer par les « enfants des écoles » : montrez-leur, aux enfants, que c’est important pour vous. Les enfants des écoles, c'est juste bon pour amuser la galerie, attendrir la populace. Les gamins, ils ne comprennent pas, ils font ce qu'on leur dit. Cela n'a aucun sens. En plus, à la lecture, ils hésitent, ils estropient, ils bafouillent.
Monsieur le Maire, prononcez-les vous-même, joignez-y le Conseil Municipal, les pompiers, les gendarmes, je ne sais pas, mais que ce soient les autorités officielles qui disent les noms. RIEN N'EST PLUS IMPORTANT QUE LE NOM.
Prouvez-leur, aux enfants, que c’est vous qui vous souvenez, et que ça compte pour vous. Ça, oui, ça aura plus l’air d’une vraie transmission que de l'accomplissement d'une corvée. Alors c’est sûr, ce sera différent dans le tout petit patelin (4 noms) et dans les grandes villes (plusieurs centaines, qui sait, plusieurs milliers). Moi je dis : et alors ? Est-ce qu'on ne leur doit pas quelque chose ?
Et ne noyez pas le poisson dans le bouillon de « toutes les guerres », cette espèce de brouillard du sens où tout est dans tout et réciproquement, le « toutes les guerres » des bonnes intentions, des bons sentiments et du n’importe quoi. Le 11 novembre appartient, qu’on se le dise, à la GUERRE DE 1914-1918, et uniquement à celle-ci. Il ne faut pas apporter là la confusion des généralités vagues.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans HISTOIRE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : philippe meyer, france culture, général de gaulle, compagnons de la libération, radio londres, guerre mondiale, 1914-1918, première guerre mondiale, deuxième guerre modiale, appel du 18 juin, michel sardou, si les ricains n'étaient pas là, mémorial yad vashem, barbarie, monuments aux morts, hiroshima, falkenhayn, bataille de verdun, douaumont, soldat inconnu, 11 novembre
mercredi, 07 décembre 2011
CARTHAGE, WATERLOO ET VERDUN
« Les taureaux s’ennuient le dimanche », chantait JACQUES BREL. La chanson finissait (et finit toujours, que je sache) par une question sur ce que les taureaux ont dans la tête : « Ne nous pardonneraient-ils pas, en songeant à Carthage, Waterloo et Verdun ? ». BREL répète « Verdun ». Il n’a pas tort. L’homme a fait fort à Verdun, côté rendement, en matière de meurtre collectif, même si c’est un peu moins bien qu’à Hiroshima.
A Hiroshima, on dénombra 60.000 morts en un instant. A Verdun, c’est 300.000 morts, mais en huit mois. C’est malgré tout un résultat honorable, dont on peut être fier : rappelons que presque trente ans séparent les deux champs de bataille.
Par ailleurs, l’avancement dans les techniques de destruction de la vie humaine n’avaient pas encore connu les spectaculaires progrès qui virent le jour au cours de la deuxième guerre mondiale. Certains esprits chagrins objecteront que Hiroshima ne fut pas un champ de bataille. Je réponds que je ne m’intéresse ici qu’au seul aspect technique des opérations.
Je pense à Verdun et aux 100.000 obus par jour, en moyenne, qui sont tombés. Au total, on compte, selon une source, 53.000.000 d’obus sur 10 kilomètres carrés. Techniquement, on peut se consoler en se disant que ce fut la preuve éclatante que l’industrie française pouvait rivaliser avec l’allemande.
Mais économiquement, on est bien obligé de reconnaître que ce fut un gouffre financier. Rendez-vous compte : une moyenne de 176 obus pour une seule tête de pipe cassée dans le camp d’en face. Le rendement devient ridicule. Rien ne vaut finalement d’entrer dans les détails pour se faire une vue plus juste des choses.
Pour parler sérieusement, ce qui est sûr, c’est que la première guerre mondiale est le premier massacre de l’histoire qui ait été pensé, conçu et exécuté comme massacre à grande échelle, et dans l’unique but d’être un massacre. Ce que les Allemands n’avaient pas prévu à Verdun, c’est qu’à peu près autant des leurs que de Français tombèrent (à 20.000 près, mais, n’est-ce pas, « quand on aime, on ne compte pas », paraît-il).
Je ne vais pas vous reparler ici des 15.000 monuments aux morts que j’ai collectionnés sur internet, dont j’ai publié un certain nombre dans mon blog « kontrepwazon » de 2007, avec la dignité que cela requiert, comme je le pense et l’espère. A part ça, je suis assez convaincu que les monuments aux morts ont été conçus à l'époque comme une gigantesque opération de propagande.
Je pense à Verdun, et à la « marche pacifiste Metz-Verdun » qui eut lieu en 1976. Je suis heureux d’avoir participé. Je suis heureux d’avoir marché au côté de THEODORE MONOD. Je suis heureux d’avoir marché sur la route légèrement montante qui mène au cimetière.
Je suis presque heureux que nous n’ayons pas pu parvenir à celui-ci. Je ne parle pas de l’obscène monument pâteux et presque excrémentiel, je parle juste du cimetière. J’y ai pensé des années plus tard, quand j’ai visité le cimetière américain de Colleville-sur-mer. Une croix par bonhomme. Sur des centaines de mètres carrés.
Combien ils étaient, pour empêcher cette procession silencieuse et digne d’arriver sur les lieux ? Dix piliers de bar à tête de beauf, armés du calot rouge des parachutistes, qui estimaient que nous profanions ce « champ d’honneur ». Entre eux et nous (qui étions facilement plusieurs centaines), la gendarmerie mobile, pour empêcher toute « atteinte à l’ordre public ».
Je pense à Verdun, et à ce que les soldats ont commencé à recevoir sur la calebasse à partir du 21 février 1916. C’est que le grand penseur stratégique responsable de l’offensive s’appelle ERICH VON FALKENHAYN. Il a décidé de « saigner à blanc l’armée française ». Résultat : plus de 140.000 Allemands étendus aussi pour le compte.
Pour obtenir ce brillant résultat, il fait venir un nombre impressionnant de « bouches à feu », comme on disait au 18ème siècle. FALKENHAYN a fait disposer 1.300 canons, dont plusieurs centaines de gros calibre. Il a imaginé une technique de bombardement, dite « Trommelfeuer » (qu’on peut traduire « feu en roulement de tambour »).
C’est d’ailleurs cet usage jamais vu auparavant de l’artillerie qui fera qu’à Verdun, deux morts sur trois sont devenus des disparus. Cette seule idée me flanque la chair de poule. Il me semble que cet acharnement illustre assez bien ce que peut vouloir dire une expression comme « réduire en miettes ».
FALKENHAYN devait être la caricature même de la vieille baderne fanatique, parce que, jusque sur son lit de mort, il a soutenu que la bataille de Verdun avait tué deux fois plus de Français que d’Allemands.
Je pense à Verdun, et à mon grand-père, alors simple étudiant en médecine, qui a servi dans un hôpital de campagne à proximité du champ de bataille. Je n’en ai jamais su davantage.
Je pense à Verdun.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : verdun, bataille de verdun 1916, jacque brel, douaumont, vaux, première guerre mondiale, pacifisme, théodore monod, falkenhayn

