dimanche, 01 avril 2018
PAPA, C'EST QUAND L'EFFONDREMENT ? 2/2
14 décembre 2017
Des nouvelles de l'état du monde (11).
2/2
L’effondrement dont on parle ici n’est certainement pas un événement. Car si tel était le cas, croyez-moi, il y a longtemps que les caméras et les bonimenteurs de BFMTV seraient sur place pour le remplissage habituel. Pas un événement, donc, mais un processus. Cela n’intéresse pas les chaînes d’info en continu : il ne se passe rien, vous comprenez. Analogie : pour donner une idée du temps au temps des dinosaures, un compositeur italien avait écrit (ça remonte à loin : fin des années 1970 ?) une œuvre pour piano sur un thème paléontologique. Un cluster chaque fois que l'iguanodon faisait un pas. Pas très rapide, l'animal : un gros « cluster » par minute, grand maximum, peut-être moins. L'auteur devait se dire qu'il rendait ainsi l'impression de la durée à l'époque de l'élasmosaure, du platéosaure et du ptéranodon. Sans m'attarder sur le côté proprement musical de la chose, je n’imagine pas les BFMTV proposer un de ces directs dont ils ont le secret, pour faire le poireau jusqu'à l'extinction des dinosaures.
Cet effondrement-là passe quasiment inaperçu. Il s'est inscrit comme tel dans le paysage. C'est juste un créneau qu'on laisse à quelques journalistes spécialisés, à placer le dimanche soir, entre les bouchons du weekend, les nouvelles imperturbables venues de Syrie ou d'Israël et les dernières mauvaises blagues inventées par Macron pour embêter ce qui reste des vieux partis ou pour mettre au pas de charge l'économie française au diapason de l'ultralibéralisme triomphant. C'est un effondrement inodore, incolore et sans saveur particulière. C'est un effondrement qui est entré dans les habitudes. Et surtout, c'est un effondrement d'une lenteur telle qu'il se maintient hors de portée de nos moyens physiologiques de la perception. Bref, c'est un effondrement normal : pas de quoi s'affoler dans l'immédiat. (paragraphe ajouté le 1 avril, au fait : joyeuses Pâques !).
Processus donc. Comme il y a des chances que son accomplissement laissera aux vivants actuels le temps d’achever leur existence sans trop de casse (et même à leurs successeurs, on espère), la notion de changement irrémédiable est donc bien partie pour échapper encore longtemps à l’attention du plus grand nombre. Laissons les masses vivre en paix, doit-on se dire en haut lieu, il sera alors bien temps de les prévenir quand le monde aura le nez dessus. Quand ce sera urgent, c’est-à-dire quand il sera trop tard (dans ce qu’on appelle l’ « urgence humanitaire », la catastrophe a toujours déjà commencé).
Notre aveuglement se nourrit d’un ingrédient dont personne n’ose imaginer l’absence dans le déroulement de son quotidien : le temps présent. Je veux dire l’instantané, immédiat ou imminent, forcément décisif pour garder l’impression de ne pas être largué par l’époque, qui ne cesse d’améliorer ses performances et d’aller plus vite. Il faut rester dans le flux, à l'affût, s'adapter, accélérer.
Nous comprenons d’autant moins ce qui se passe dans notre temps long qui s’appelle l’avenir, que notre nez renifle au ras du sol des « réseaux sociaux » la moindre fragrance de l’éphémère qui passe, en s’imaginant tenir là la clé de ce « temps présent » qui nous échappe. Les réseaux sociaux sont, à cet égard, la énième tentative désespérée de l’homme d’arrêter l’écoulement du temps (et d'abolir l'espace), en ce qu'ils illustrent la capacité des individus à s'accrocher à la moindre ramille d'immédiat émergée de leur écran, comme à une bouée de sauvetage.
A l’affût de la moindre vaguelette en surface, nous nous jetons sur la plus petite proie qui passe, nous l’avalons vite, la digérons vite et l’excrétons de même : notre esprit fonctionne comme un vulgaire intestin. Comme une machine à transformer l'oral en fécal : prescience de l'artiste Wim Delvoye avec sa "Cloaca", alias machine à fabriquer de la merde ? En tout cas, une extrapolation très répugnante mais d'une absolue justesse pour désigner notre monde, à partir des principes qui servent de base à la civilisation de la production-consommation.

Pourtant (et paradoxalement), ça a beau être un tuyau, ce temps présent-là est fermé aux deux bouts, isolé, hermétique : en aval l’aveuglement sur ce qui nous attend la semaine prochaine, en amont l’oubli de ce que nous avons avalé hier. La fascination pour le présent est une prison de l’esprit. Comment, dans ces conditions, être en mesure de percevoir les signes d'un quelconque effondrement ? L’homme est pourtant le seul animal qui sait qu’il doit mourir un jour. Mais notre monde éminemment technologique nous serine : « J'ai tous les moyens efficaces de te faire oublier le tragique de ton destin » (traduction : de boucher les deux bouts de ton tuyau). Un certain Blaise P. avait déjà bien analysé la chose il y a quelques siècles (la phrase finit par : « ... un homme plein de misères »).
L’humanité tombe donc de plus en plus bas, mais avec une telle lenteur que la plupart des gens pensent qu’ils ont la vie devant eux pour se mettre à penser à des choses pas drôles. C’est vrai, quoi, il faut rester optimiste ! Tant qu'ya d'la vie ya d'l'espoir ! Ya d'la joie ! L'espoir fait vivre ! Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la vie quotidienne continue, les ennuis gastriques ou conjugaux sont les mêmes, les prix continuent à augmenter, les enfants continuent à ne pas ranger leur chambre, il faut continuer à se chauffer quand il fait froid, le bruit des voisins continue à nous agacer, les magasins continuent à nous fournir les denrées nécessaires à la restauration de nos forces, les camions-poubelles continuent à passer le matin sous nos fenêtres. Tant que les structures de notre quotidien ne connaissent pas de panne, il n’y a pas de quoi s’affoler : la vie continue.
Si ça s’arrête (les trains, l’électricité, les camionneurs, … jusqu’au beurre des supermarchés, récemment), nous pestons jusqu’à ce que la circulation ou le courant soient rétablis. Car nous sommes tous concrètement pénétrés de l’idée de continuité de la « vie normale » et des indispensables répétitions quotidiennes : nous sommes façonnés de routine et nous disons, comme Letizia Bonaparte : « Pourvu que ça dure ». La durée est notre chair. Son défaut est qu'elle coule d'un robinet de couleur terne.
Pourtant, curieusement, nous ne saurions nous passer de tous les « événementiels » ("c'est là qu'ça s'passe, mec") qui ne nous sont absolument de rien, et qui semblent couler d'un robinet en or massif (mais c'est du toc, tout juste du plaqué-or) pour nous abreuver de cette liqueur spécialement produite pour ravir le gosier de notre imaginaire. Impression de participer, impression de vivre, je veux bien, mais en réalité ? Notre moteur est hybride : d'un côté la carburation par la nécessité si prosaïque, de l'autre par la séduction marchande. De quel côté, la "vraie vie" ?
C’est même un paradoxe : autant nos esprits sont en éveil quand il s’agit d’un fait, d’une parole, d’une séquence qui ne nous concernent en aucune manière, et qui sont indifférents à la banalité de toutes les banalités qui meublent notre quotidien, autant nos corps sont résignés à l’accomplissement journalier, discipliné, machinal des mêmes gestes et des mêmes actes, jusqu'aux plus triviaux, routine indifférente à cette écume des jours qui ne nous parvient que par le canal de voix et de visages que nous ne connaissons pas et qui n’ont aucune envie de nous connaître, parce qu'à leurs yeux, nous ne valons pas tripette.
Qui osera réhabiliter la dignité de l'ordinaire et du banal ? Qui dira enfin du bien de la masse des gens qui « font comme tout le monde » ? Qui inspirera aux gens ordinaires de l'amour pour la "nullité" de leur existence ? Quel auteur en vue aura le courage de ne pas écrire un best-seller, voire un chef d'œuvre, sur ceux que les journalistes nomment, très sympathiquement, « les anonymes » ?
D’un côté les bulles de savon qui nous fascinent mais nous feront crever, de l’autre l’épaisse et lourde glèbe routinière de ce qui fait la substance la plus permanente de notre vie concrète : il y a en nous, séparés par une cloison, deux mondes qui ne sont pas faits pour se rencontrer, indifférents l’un à l’autre. Si j'étais "psy" (ce qu'à Dieu ne plaise !), je proposerais de nommer ce symptôme "schizophrénie institutionnelle", ou quelque chose comme ça, au motif que cette double perception nous est inculquée par le mode de vie partagé par toute une civilisation. Qu'est-ce qui nous est le plus cher ? La sollicitation extérieure de nos multiples écrans, instantanée mais inconsistante, à laquelle nous nous prêtons de moment en moment ? Ou bien notre propre permanence, bien corporelle celle-là, à laquelle il nous est physiquement impossible d'échapper ? Les deux, mon général. Pour notre malheur.
On aurait intérêt à se demander qui a intérêt à figer notre attention dans les paillettes scintillantes de l’instantané. Qui cherche à nous imprégner de dégoût et de lassitude pour ce qui fabrique la banalité de notre continuité réelle ? A inspirer nos engouements pour des vies prodigieuses autres que la nôtre, convaincus que nous sommes de sa nullité ?
Tout ça pour dire que, si nous préférons les « trépidations de la machine » à la lenteur du déroulement de nos jours, cela ne nous prédispose pas à anticiper des menaces qui, elles, sont apportées par le temps long. Notre expérience intime du temps, hors de toute sollicitation extérieure, est certes la durée, pourtant nous préférons l'éclair de l'orage au long coucher de soleil sur l'horizon. La force des habitudes, la force d’inertie nous sont des poids sur les épaules. Durée, répétition, routine, transmission nous sont des épouvantails. Nous voulons que « ça bouge ». Nous n'avons même aucun regard pour ce qui nous semble ne pas bouger. Alors un effondrement, et au ralenti qui plus est, pensez ... Je vais vous dire : l'effondrement, nous l'attendons finalement avec indifférence. Nous n'en pensons rien, tout simplement parce qu'il n'a pas d'existence (tant qu'il ne s'est pas produit). Qui vivra verra (rien de plus rassurant que des proverbes).
Alors je repose ma question : « Papa, c’est quand, l’effondrement ? ». Personne ne sait au juste. Guy McPherson nous donne dix ans. Rien ni personne n’est en mesure de nous persuader de cette échéance. Ce qu’on sait, en revanche, c’est que tous les facteurs de notre développement planétaire conduisent le vivant au précipice. Que le mécanisme fatal est à l'œuvre. Ce que des hallucinés persistent à nommer le « Progrès » est devenu une entreprise de destruction massive. Tout nous l'indique. Les signaux se sont déjà allumés sur les écrans de contrôle : ouragans d’une force inconnue jusque-là, migrations massives dues aux guerres ou à la misère, fonte des glaces polaires, le blog de Paul Jorion, etc., etc., etc.
Tout le monde a, plus ou moins confusément, conscience que nos façons de faire sont mortifères. Alors quand ? « Tais-toi, fiston, et nage. En attendant, souris : nous sommes filmés ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, paul jorion, à quoi bon penser à l'heure du grand collapse, bfmtv, info en continu, urgence humanitaire, dinosaures, élasmosaure, ptéranodon, réseaux sociaux, txitter, facebook, arcon, art contemporain, wim delvoye cloaca, blaise pascal divertissement, letizia bonaparte pourvu que ça dure, psychanalyse, guy mcpherson, gilles boeuf, claude bourguignon, emmanuel macron, one planet summit
vendredi, 11 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 6/9

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS
ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
6/9
Du triomphe de la Dissonance (ou "Le siècle du Divorce").
Car le 20ème siècle, encore plus que le 19ème, est celui où plus personne ne sait. Celui qui casse toutes les grandes machines à produire des points de repère intellectuels, moraux, sociaux, affectifs, religieux, politiques, idéologiques, psychiques. Celui qui disloque les machines à produire un SENS qui puisse servir d'assise à l'existence des gens. Celui qui m’a amené pour finir, dans un souci de préservation, à cesser de me vivre comme un contemporain de mon époque. Le siècle où je suis né a fini par me décider à me raccrocher à quelques rochers surnageant encore dans un océan de destructions, quelques îlots esthétiques où il semble encore possible de respirer malgré les conditions que fait le monde des hommes à l'humanité. Comme dit le grand Pierre Rabih : « On ne peut pas renoncer à la beauté ».
Le 20ème siècle est celui qui ne sait plus grand-chose de l’humanité. Bien des formes d’art qu’il a fait naître ignorent superbement l’humain. La beauté ? N'en parlez surtout pas en présence de Catherine Millet ou de Catherine Francblin, qui sont aux manettes de la revue Art press, cette manufacture de la "modernité" ultra-chic et à la pointe de toutes les avant-gardes. La beauté, c'est un critère ringard et archaïque. Et finalement, je crois qu’il est là et nulle part ailleurs, le grief radical que j’adresse à Marcel Duchamp et à toute son innombrable progéniture.
Encore pourrais-je moi-même, à bon droit, soutenir l’idée que cet inaugurateur de la destruction esthétique n’a fait que transposer dans le domaine de l’art ce qu’il voyait se produire sous ses yeux dans la réalité : Dada (auquel Duchamp a participé de très loin et "en esprit") est né en février 1916, c’est-à-dire en pleine guerre, plus précisément au moment du déclenchement de la grande boucherie de Verdun (où Falkenhayn avait promis de "saigner l'armée française"). Un symbole ? Le 20ème siècle comme assassin de l'idée de la beauté ?
Mais on rétorquerait à aussi bon droit que les premières œuvres plus ou moins ouvertement atonales (rompant avec les notions de tonalité, de mélodie et d'harmonie qui prévalaient jusque-là), datent d'avant ce premier carnage planétaire (le dernier Liszt, Scriabine). Je répliquerais au contradicteur que la guerre de 14-18 n’est pas sortie de nulle part, et que des prodromes de plus en plus nets (montée des nationalismes, rivalités impérialistes, entre autres) étaient perceptibles bien avant le 4 août 1914. Ce n'est pas pour rien que l'époque a produit dans le même temps le cubisme, la musique atonale, le dadaïsme et la guerre : ces choses-là sont vendues en "pack". Et c'est bien le problème : c'est à prendre ou à laisser. Mais était-il possible de "laisser" ?
En musique, l’indifférenciation radicale des douze sons de la gamme, puis plus tard l'extension de la notion de son musical à toutes les matières sonores possibles et imaginables, et l'élévation de tous les bruits à la dignité d'objets musicaux (Pierre Schaeffer a écrit Traité des objets musicaux, et puis ce fut la litanie : sons d’origine électronique, moyens portatifs d’enregistrement, et échantillonner, et couper-coller, et bidouiller, et métisser, et ...), tout ça pourrait être considéré comme autant d'oracles : en parallèle, plus le monde sonore (créé par l'homme) devenait dissonant, plus il annonçait à l’humanité que le 20ème siècle serait le grand siècle de la Dissonance généralisée et des conditions dissonantes de la vie.
Les conditions capables de rendre concevable et possible une éventuelle « Harmonie » ont disparu. La Dysharmonie règne en maîtresse. Et qu'on ne me raconte pas de fable à propos d'une improbable « Harmonie Nouvelle », à laquelle il faudrait que le bon peuple se fasse et s'habitue, bon gré mal gré. Trop de musiques du 20ème siècle sont, restent et demeureront inhabitables. Nous sommes les enfants de la Dissonance, de la Discorde, de la Distorsion, de la Dysharmonie, ... Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que la planète, la nature et les océans subissent les amères conséquences d'un siècle à ce point déprédateur.
La Dissonance est devenue la Norme dans la vie en même temps que dans les arts. La Dissonance, cette forme de Divorce qui demeurait l'exception auparavant (une dissonance finissait par une "résolution", c'est-à-dire un accord consonant), s'est ainsi banalisée et généralisée dans la peinture, dans la musique, dans la vie des gens mariés, dans la relation des hommes avec leurs semblables, dans leur relation avec la nature, etc. Le divorce est devenu le grand mode de vie, une modalité durable de l'être cassé en deux (en combien de morceaux ?). On a tenté de faire croire aux gens qu'on peut s'habituer à tout. Mais non : on ne s'habitue pas à tout. Nul ne peut habiter une maison qui le détruit. De quoi pleurer jusqu'à la fin des temps. Pour échapper à cette violence, une seule issue : divorcer de l'époque.
C'est ce genre de divorce qu'ont magistralement incarné quelques grandes figures de la pensée et de la littérature : Jacques Ellul, Günther Anders, Guy Debord, Philippe Muray, Michel Houellebecq, ... (le cas de Hannah Arendt, beaucoup moins en rupture, est différent). C'est l'unique raison que je vois à la détestation, que dis-je : à l'aversion, à l'exécration, à l'abomination dont ces dissidents font l'objet dans les milieux du consensus mou, de l'hypocrisie caritative, de la doxa, de la police de la pensée et du terrorisme intellectuel (quoique Debord ait récemment fait l'objet d'une récupération d'Etat : ses archives sont désormais un "Trésor national"). Cette pensée et cette littérature ont-elles infléchi la trajectoire d'une minute d'angle ? Je vous laisse répondre : c'est trop évident. Mais que peut la Culture ? Que peut la Littérature ? Que peut la Pensée ? Vous avez quatre heures pour rendre copie blanche.
Le monde pictural lui-même n’a pas attendu la guerre de 14-18 pour se détraquer : que faire, face à l'académisme, au conformisme pompier (Bouguereau, Couture, Meissonnier, Detaille, Laurens, Gervex, …) : obéir aux suggestions de Corot, de Rosa Bonheur, d’Eugène Boudin ? Une certitude émerge : il faut inventer pour exister. Claude Monet, qui se met à diviser les couleurs pures, à les juxtaposer, à rendre problématique la représentation du monde, pousse sur ce terreau, et tous les suivants, jusqu’à Seurat et Van Rysselberghe. Bientôt fauvisme, cubisme, suprématisme, surréalisme. Ces désintégrations successives disent un chose : à quoi bon l’art, quand le message porté par l’époque est la dissonance, la fragmentation, voire la négation de la réalité visible, bientôt suivies par la destruction des hommes à l’échelle industrielle ? Que reste-t-il à espérer du monde en train de se faire ?
Heureusement, les lois de l’inertie étant ce qu’elles sont, ce désespoir radical mettra un peu de temps à manifester sa radicalité (quoique ... Céline ...). La négativité côtoiera pendant quelque temps l’optimisme qui rend possible la création. Le cas du surréalisme est particulièrement riche d'enseignement. « Révolution » pour ses premiers promoteurs, puis mis « au service de la Révolution », on peut dire que, avant de rentrer dans le rang et de faire simplement de l'art "comme tout le monde", il a effectivement mis le bazar dans la culture, dans l'art et dans les esprits de son temps (en gros de 1924 à l'après-guerre, je compte pour rien les suiveurs, les suivistes, les petits curés, les "post-", les "épi-", les "para-", les prosélytes, les mouches à m...iel et les apôtres).
Avec le recul du temps, qu'en est-il ? Qu'ont-ils fait, en définitive, André Breton, ses séides et sa meute de courtisans (lire le méconnu Odile de Raymond Queneau à ce sujet, où le "pape du surréalisme" est dépeint sous les traits du pompeux Anglarès qui, entre parenthèses, passe beaucoup de temps, dans le livre, à boire des bières en compagnie de ses suiveurs), avec leur « automatisme psychique pur », leurs « rêves éveillés », leur « changer la vie, a dit Rimbaud, transformer le monde, a dit Marx, ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un » ?
D'un côté, ils ont permis à l'époque de croire qu'elle disposait encore de ressources jusque-là insoupçonnées, dans le sous-sol du psychisme. Une planche de salut inespérée. Si l'on veut bien comparer avec les gaz et pétroles de schistes, solution désespérée pour soi-disant remédier au « Peak Oil », le surréalisme apparaît comme l'ultime possibilité de croire que l'art disposait encore d'une réserve de nouveaux moyens d'expression. En amenant au jour tout un attirail d'images, d'objets et d'assemblages, les surréalistes ont pu donner l'illusion d'un gisement inépuisable de nouveaux papiers peints à apposer sur les murs de plus en plus craquelés de notre univers désolé.
De l'autre côté, ils ont fourni à la propagande, au bourrage de crâne, à l'endoctrinement, en un mot : à la publicité (alors en plein épanouissement : Edward Bernays et consort), un carburant aux effets puissants : une masse de thèmes nouveaux et surprenants, exploitables ad libitum. Ils ont permis à la bientôt sacro- sainte marchandise de prendre possession des esprits, et de se mettre à briller d'un éclat aveuglant à l'horizon de toutes les populations du monde. Magritte, en particulier, avec ses confusions en gros sabots (paradoxes visuels, premier plan / arrière-plan, calembours picturaux, jeux signifiant / signifié, etc...), reste une mine d'or pour bien des "créatifs" d'agences publicitaires.
sainte marchandise de prendre possession des esprits, et de se mettre à briller d'un éclat aveuglant à l'horizon de toutes les populations du monde. Magritte, en particulier, avec ses confusions en gros sabots (paradoxes visuels, premier plan / arrière-plan, calembours picturaux, jeux signifiant / signifié, etc...), reste une mine d'or pour bien des "créatifs" d'agences publicitaires.
En réalité, le surréalisme est la tentative désespérée d'une humanité poussée dans la nasse par un siècle fou, de trouver une issue de secours. Et l'on ne peut que constater les dégâts : plus la réalité s'est craquelée sous les coups totalitaires des camps de la mort, des procès de Moscou et de la "Bombe" (Allemands + Russes + Américains, ça fait du monde), puis sous les coups plus insidieux de la marchandisation progressive de tout, plus ce recours au monde intérieur, au monde de l'inconscient et de l'imaginaire apparaît comme un dernier refuge avant écrasement. Comme une impasse et un cul-de-sac. Un sac en plastique pour y mettre la tête jusqu'à ... On se félicite, rétrospectivement, de ce qu'André Breton ait été tout à fait insensible à la musique. Quels dégâts n'aurait-il pas commis ? Remarquez que d'autres s'en sont chargés, qui ne se réclamaient pas du surréalisme.
Le surréalisme a momentanément rassuré le monde de l'art en lui fournissant, pendant un temps, une sorte de trésor de substances nutritives de substitution (le surréalisme est au monde de l'art ce que la méthadone est à l'héroïne), en même temps que l'illusion de possibilités infinies de développement. En réalité, avec le surréalisme, le monde de l'art raclait ses fonds de tiroirs. Asséchait ses derniers marécages avant le désert. Achevait ce qu'avait commencé Alphonse Daudet avec son personnage principal, dans L'Homme à la cervelle d'or : se vider la tête.
Car ce qui est curieux ici, c’est de constater que plus le surréalisme met le paquet sur le renouvellement des images et ce ressourcement superficiel de l’imaginaire, plus la réalité concrète prend le chemin inverse, celui du sordide et de l’invivable. Au fond, les formes héritées du surréalisme constituent une sorte de dénégation générale de la réalité. Une dissociation d'ordre publicitaire (la dissonance métaphorique, qui prend des airs de coalescence : une femme nue pour vendre un yaourt, mettre du désir dans une marchandise, ...), qu’on observe pareillement dans l’évolution des discours politiques : plus la réalité fout le camp, plus le discours doit faire semblant de restaurer le désir en affirmant la maîtrise du politique sur le réel. En France, les politiciens incantatoires s'entendent à merveille pour nous en offrir des preuves éclatantes.
A partir de là, art et réalité ont pu diverger "à plein tube". "Artistes" et "responsables", de plus en plus déconnectés du réel, ont commencé à faire comme si. Comme si le monde ancien se perpétuait, pendant que la réalité foutait le camp, échappant à tout le monde. Comme si l’on pouvait continuer impunément à soutenir dans les mots un modèle déjà quasiment effondré dans la réalité. Tout le monde a fait semblant (faire semblant : un des sens du mot « Spectacle » dans le vocabulaire de Guy Debord). La Dissonance a gagné. Le Divorce est consommé.
Il y a donc beaucoup d’artistes (il faut bien vivre) qui se sont alors faits les simples greffiers du désastre, dont ils se sont contentés d’enregistrer, inlassablement, les signes. Ils ont tiré un trait définitif sur l’homme. Ils ont pris acte. Ils ont tourné la page, sans joie (quoique …), mais sans regret. Ils ont meublé ce désert enfin débarrassé de l’humain, nouveau territoire de l’art, des objets les plus divers surgis de leur fantaisie, de leurs caprices, de leurs humeurs, du hasard, des occasions. Ils ont inventé la gratuité, la futilité, la vanité du geste artistique, de même que je ne sais plus quel personnage de Gide médite je ne sais plus quel meurtre pour prouver que l’ « acte gratuit », ça existe. Ils ont introduit la destruction et le déchet dans l’acte créateur (toujours l’ultralibéral Schumpeter, avec sa "destruction créatrice"). D’où, entre beaucoup d’autres, la machine à caca ("Cloaca") de Wim Delvoye, façon de déclarer : « On est dans une belle merde ». Mais la merde peut-elle être belle ? Comme l’écrit quelque part Beckett : « Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste plus qu’à chanter ». C’est à cette vision du monde (« Weltanschauung ») que je ne peux me résoudre. 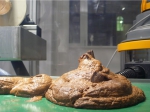
 Quand on a fait caca, on peut dire qu'on a "coulé un bronze", mais aucun être humain n'est en mesure de chier le "Persée" de Benvenuto Cellini. La Cloaca de Wim Delvoye en est une preuve répugnante.
Quand on a fait caca, on peut dire qu'on a "coulé un bronze", mais aucun être humain n'est en mesure de chier le "Persée" de Benvenuto Cellini. La Cloaca de Wim Delvoye en est une preuve répugnante.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, peinture, marcel duchamp, dada, dadaïsme, bataille de verdun, guerre 14-18, falkenhayn, franz liszt, scriabine, musique atonale, dodécaphonisme, musique sérielle, cubisme, pierre schaeffer traité des objets musicaux, dissonance, jacques ellul, günther anders, guy debord, philippe muray, michel houellebecq, pompiérisme, peintres pompiers, bouguereau, couture, meissonnier, detaille, gervex, corot, rosa bonheur, eugène boudin, claude monet, impressionnisme, divisionnisme, van rysselberghe, fauvisme, surréalisme, louis ferdinand céline, odile raymond queneau, edward bernays, publicité, magritte peintre, alphonse daudet l'homme à la cervelle d'or, wim delvoye cloaca, pierre rabih, revue art press, catherine millet, catherine francblin

