vendredi, 12 juin 2020
TÂTONNEMENT PHOTOGRAPHIQUE
Vue générale.
Gros plan.
********************
Et maintenant rions un peu.
À l’Urbild de cette formation, quoique aliénante par sa fonction extranéisante, répond une satisfaction propre, qui tient à l’intégration d’un désarroi organique originel, satisfaction qu’il faut concevoir dans la dimension d’une déhiscence vitale constitutive de l’homme et qui rend impensable l’idée d’un milieu qui lui soit préformé, libido « négative » qui fait luire à nouveau la notion héraclitéenne de la Discorde, tenue par l’Éphésien pour antérieure à l’harmonie.
Jacques Lacan, Ecrits, Seuil, 1966, p. 116.
Dans « L’agressivité en psychanalyse », ibid. pp. 101-124.
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, jacques lacan, psychanalyse
vendredi, 10 janvier 2020
2020 : DOLTO PÉDOPHILE ?
Aujourd'hui, c'est la fête à Françoise Dolto.
Oui, oui, l'icône en personne : sainte Françoise.
La mamie absolue.

Le Canard enchaîné, mercredi 8 janvier 2020. Dessin signé Aurel.
Décidément, c'est l'époque qui veut ça ! L'époque ? En état d'hébétude et d'ahurissement et dans une ambiance de scandale insoutenable, elle découvre les années 1970 et l'incroyable permissivité morale qui a vu s'ébattre et s'épanouir les grandes causes sociétales de la "libération sexuelle", de l'homosexualité, du féminisme et de la pédérastie (mot pris dans son sens étymologique d' "amour avec les enfants").
Sauf que la dernière de ces "grandes causes" est devenue, au fil des ans, des redressements moraux et des révisionnismes idéologiques, la grande pestiférée, alors que les deux autres prospéraient à qui mieux-mieux, au point d'édifier autour des homosexuels et des femmes un rempart pénal infranchissable. L'époque, qui a d'un côté sacralisé la cause des homosexuels et des femmes au point d'inscrire au Code Pénal les délits d'homophobie et de sexisme, désigne l'amour (physique) des enfants comme l'ennemi à abattre.
Un problème se pose néanmoins : que faire de la mémoire de personnes auxquelles, entre-temps, l'époque elle-même a élevé des statues en acier inoxydable et plaquées or, alors qu'elles ont publiquement avoué leur tolérance ou leur solidarité avec ceux que nous appelons rétrospectivement des "pédophiles" ? Sans parler de celles qui ont milité en leur temps pour la libéralisation de ces mœurs qui paraissent abominables à tant de gens aujourd'hui.
Prenez la liste des signataires de la "Lettre du 23 mai 1977" publiée par le journal Le Monde : que du beau linge ! Cette lettre, peut-être rédigée par un certain Gabriel Matzneff (qui en revendique la paternité), demande au législateur la révision, dans un sens plus "laxiste", des lois réprimant les abus dans les relations entre adultes et mineurs.
Des noms ? Allez, quelques-uns : Louis Althusser, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Jean-Louis Bory, Patrice Chéreau, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Françoise Dolto, André Glucksman, Félix Guattari, Roland Jaccard, Pierre Klossowski, Jean-François Lyotard, Michel Leiris, Christiane Rochefort, Alain Robbe-Grillet, Jean-Paul Sartre, Philippe Sollers (parmi les noms figurant sur la liste aimablement fournie par l'encyclopédie en ligne).
Parmi ces noms de gens ou très célèbres ou assez connus, on note celui de Françoise Dolto. Eh bien figurez-vous que ça tombe bien, parce que Le Canard enchaîné du mercredi 8 janvier 2020 consacre quasiment une demi-page à la célébrissime psychanalyste des enfants, auteur de nombre d'ouvrages savants et animatrice de mémorables émissions de radio.
Il se trouve qu'en novembre 1979, la revue "Choisir la cause des femmes" (Gisèle Halimi) a publié un entretien que Françoise Dolto a eu avec un juge des enfants, texte ensuite repris dans un ouvrage. Et l'on peut dire que ça décoiffe. Je cite Le Canard enchaîné.
« Dolto : Dans l'inceste père-fille, la fille adore son père et est très contente de pouvoir narguer sa mère !
Q. : Et la responsabilité du père ?
R. : C'est sa fille, elle est à lui. Il ne fait aucune différence entre sa femme et sa fille, ou même entre être l'enfant de sa femme ou bien le père de sa femme. La plupart des hommes sont de petits enfants. Il y a tellement d'hommes qui recherchent dans femme une "nounou". Et des femmes qui les confortent dans cette idée-là ! Alors la responsabilité du père, à ce niveau (...).
Q. : Donc, la petite fille est toujours consentante ?
R. : Tout à fait.
Q. : Mais enfin, il y a bien des cas de viol ?
R. : Il n'y a pas de viol du tout. Elles sont consentantes.
Q. : Quand une fille vient vous voir et qu'elle vous raconte que dans son enfance, son père a coïté avec elle, et qu'elle l'a ressenti comme un viol, que lui répondez-vous ?
R. : Elle ne l'a pas ressenti comme un viol. Elle a simplement compris que son père l'aimait et qu'il se consolait avec elle, parce que sa femme ne voulait pas faire l'amour avec lui. »
J'arrête ici la citation, car la suite est également assez gratinée, mais j'invite tout le monde à se procurer ce morceau d'anthologie, qui montre que les années 1970 étaient imprégnées jusqu'au trognon d'idées qu'une majorité s'accorde aujourd'hui à juger puantes, repoussantes, et même pornographiques. Le Canard enchaîné signale tout de même en fin d'article que Françoise Dolto, deux ans auparavant, jugeait que « l'initiation sexuelle des adolescents et des enfants par un adulte (...) est toujours un traumatisme psychologique profond ».
L'icône François Dolto prise en flagrant délit de pédalage dans la semoule de choucroute au yaourt ! Elle pourrait faire un tour chez le psy, non ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis althusser, roland barthes, simone de beauvoir, jean-louis bory, patrice chéreau, gilles deleuze, jacques derrida, françoise dolto, andré glucksman, félix guattari, roland jaccard, pierre klossowski, jean-françois lyotard, michel leiris, christiane rochefort, alain robbe-grillet, jean-paul sartre, philippe sollers, journal le monde, gabriel matzneff, le canard enchaîné, gisèle halimi, psychanalyse
lundi, 09 avril 2018
DOCTEUR, COMMENT VONT LES GENS ?
16 mars 2018
(notablement augmenté le 9 avril)
Des nouvelles de l'état du monde (20).
« Pour répondre à votre question de savoir comment vont les gens ? A vrai dire, cher monsieur, je crois que les gens ne vont pas très bien. – Et qu'est-ce qu'y a qui va pas, à votre avis, mon bon docteur ? – Eh ben, c'est surtout comme si plus personne n'avait de boussole, et que tout le monde avançait à l'aveuglette. On entend de plus en plus de gens appeler : « Aidez-moi » Les gens ne peuvent plus vivre sans aide.
Personnellement, j'ai tendance à ne jamais me plaindre, et je n'aime pas en général entendre des gens qui s'apitoient sur leur sort. Je me suis réconcilié avec Christine Angot quand j'ai appris qu'elle avait fait chialer une femme, sur un plateau de télévision, en répondant : « Eh bien, on se débrouille ! », en répondant à la question du viol. Pensez : victime, quel beau statut ! Angot a eu le cran de refuser le statut gémissant ! Et tout le monde lui est tombé dessus. C'est Christine Angot qui a raison : face aux épreuves de la vie, si dures soient-elles, l'individu adulte et responsable de son existence un seul rôle à jouer : assumer. Faire face. Mais il semblerait aujourd'hui que ça fasse débat.
Des portions de plus en plus impressionnantes de la population demandent chaque jour (contre rétribution) à des gens "supposés savoir" (coaches, psys de toutes obédiences, "consultants" divers plus ou moins improvisés et autoproclamés, nouveaux prêtres et gourous des âmes errantes, etc.) des conseils pour continuer à conduire leur vie. Cela fait sans doute partie de ce qu'il est convenu d'appeler "aide à la personne", comme quoi, il n'y a pas, et loin de là, que les très vieux qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. « Qu'est-ce que j'peux faire ? Chais pas quoi faire » (Anna Karina, dans Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, 1965).
A l'heure où l'autonomie est devenue un impératif individuel absolu, de moins en moins de gens sont assez autonomes pour marcher sans béquille. On a l'impression que plus personne ne peut affronter les petites et grandes épreuves de son existence sans s'en remettre à une « cellule de prise en charge psychologique ». Et je ne parle pas des attentats terroristes comme au Bataclan en 2015, où une femme qui n'a pas été tuée ou blessée gravement (les journalistes appellent les "survivants") s'est trouvée confrontée à l'insupportable sentiment de culpabilité d'être encore en vie.
Je l'ai su bien malgré moi : j'avais fait ici même l'éloge de cet homme, qui était son fiancé (je n'ai pas oublié son nom, mais appelons-le V. R.), qui s'est jeté sur elle pour la protéger et qui a peut-être à sa place pris la balle mortelle. C'est ici un cas extrême : j'avais été ému par le geste héroïque du jeune homme, et j'avais été sommé de retirer de mon blog l'éloge nominal que j'avais fait de sa personne et de son nom. J'avais été stupéfait que la fiancée de l'assassiné ait été incapable de partager avec moi le sentiment d'admiration suscité par le geste magnifique qu'avait fait l'homme de sa vie pour la lui sauver. Comme si la vulnérabilité psychologique nouvelle de la population fournissait un argument décisif pour ce que je suis obligé d'appeler de la censure.
Au-delà de ce cas extrême, on ne peut nier cependant, d'une façon très générale, que la « cellule de prise en charge psychologique » est devenue un incontournable de tous les événements - accidents ou autres - qui viennent heurter le mouvement linéaire normal du déroulement normal des individus normaux dans leur vie normale. Je présente ici quelques plaques professionnelles et affiches de vitrines aperçues lors de mes déambulations dans mon quartier : indubitablement, le marché de la béquille psychologique est florissant. Ce qui en dit long sur l'état moral et sur l'équilibre psychologique de la population : on appelle ça un symptôme, mon cher monsieur. – Eh bien, cher docteur, je ne sais pas si j'ai très envie de vous remercier de ce diagnostic impitoyable ».
La fragilisation des personnes semble se répandre au rythme de la précarisation croissante des conditions d'existence. J'aimerais qu'on m'explique ce paradoxe : comment se fait-il que, plus les individus se décrètent indépendants, libres et autonomes, plus ils tombent dans un déplorable état de dépendance ? Ce qui fait peur ici, c'est que, sur le papier, nous avons toujours officiellement des "citoyens" (avec tout ce que cela suppose), mais que dans la réalité, tout ce que cela suppose (responsabilité personnelle, capacité de faire face, maturité adulte, ....) a tendance à s'effacer derrière d'impalpables mais puissantes relations de dépendance. Et que cette population vote, consomme du réseau social jusqu'à plus soif, gobe de la propagande comme jamais auparavant. Pas de quoi inspirer confiance dans l'avenir.
Le "coaching" est partout ! Quant à "consultation philosophique", le doute m'habite.
Drôle d'époque, vraiment ! Jamais les individus ne se sont voulus ou prétendus aussi libres, et jamais ils n'ont eu autant besoin d'aide pour se guider dans la vie, pour se rassurer sur eux-mêmes, sur le monde, sur le sens de la vie et sur le sexe des anges. Les parents font appel à un "coach" pour qu'il leur explique qui sont leurs enfants et comment il faut faire avec eux.
Un symptôme parmi tant d'autres de ce mal de vivre se trouve par exemple dans les deux heures et demie de programmes quotidiens de la chaîne France Inter où de consternants humoristes sont payés pour dérider un public venu là pour se faire dérider coûte que coûte : ce sont les "travaux forcés du rire".
Car il faut se "déstresser", tant la vie quotidienne est devenue "stressante".
L'enthousiasme de commande est devenu le principal du cahier des charges imposé aux "animateurs" d'émissions radio et télé.
Les parents font appel à un "coach" pour qu'il leur explique qui sont leurs enfants et comment il faut faire avec eux.
On pourrait ajouter que les innombrables libertés ainsi octroyées sont allées de pair avec leur exact contraire : jamais les gens n'ont autant "fait comme tout le monde", dans un conformisme frénétique dont ils ne se rendent même pas compte, agglutinés comme des mouches sur les incontournables du moment : plages, supermarchés, touiteur, fesse-bouc, smartphones, réseaux sociaux, hashtags, "libération de la parole", comme si ce conformisme méticuleux était le corollaire obligé de l'abolition des limites. On peut se demander ce que veut dire le mot "liberté" pour une grande masse de gens. Qu'on ne vienne pas les emmerder ? Chacun dans son bocal avec ceux qu'il estime être seuls ses semblables ?
Appréciez "sororité".
Mais il y a encore un autre paradoxe : dans nos pays économiquement et politiquement favorisés, jamais la revendication d'autonomie et la fierté d'être soi (avec au premier rang la "marche des fiertés") n'ont été aussi hautement proclamées, et jamais on n'a vu un tel déferlement de plaintes de toutes sortes jaillies d'innombrables poitrines.

Des plaintes de deux sortes, émanées soit de suppliants, soit de vengeurs. Dit autrement : d'un côté les plaintifs, de l'autre les plaignants. D'un côté ceux qui réclament des indemnités pour les préjudices qu'ils ont subis.
De l'autre, ceux qui réclament la condamnation des coupables pour les sévices qu'ils ont subis. Les uns gémissent, les autres rugissent. Les uns pleurent, les autres mordent. Le point commun, on le voit, c'est que tous ont subi. Tous revendiquent le statut de victimes. Ceux qui ne se plaignent de rien (appelons-les les gens normaux) sont les dindons de la farce. Et ils n'ont pas intérêt à dire publiquement que cet amoncellement de "victimes" finit par rendre impossible la vie de tous avec tous.

Cercles de femmes, cercles d'hommes : on ne se sent bien qu'entre soi. Il faut se tenir chaud. Comme projet de société, ça se pose là.
omme si la vulnérabilité morale, l'angoisse, la rancœur ou la détresse étaient la rançon à payer pour cette liberté si fièrement revendiquée. L'homme occidental est à cet égard un authentique paradoxe : plus il veut être "libre", "autonome" et ne dépendre que de sa propre initiative pour la conduite de son existence, plus il a besoin de s'en remettre à des "sujets supposés savoirs" (comme on dit en psychanalyse) ou à l'autorité de la loi pour ce qui est de la direction à prendre.
C'est même devenu un marché florissant : plus les gens sont "libres", plus ils abdiquent leur soi-disant libre-arbitre entre les mains de gens qui les persuadent, contre rémunération, qu'ils détiennent la solution à leurs problèmes : c'est ainsi qu'on voit fleurir aux portes des immeubles toutes sortes de plaques de spécialistes autoproclamés de la guérison des âmes en souffrance.
Notez tous les petits ®.
Après la disparition des curés, des confesseurs et de l'Eglise, après la disparition du paradis communiste, après la floraison des "psychanalystes", des "psychologues" et des "psychothérapeutes" de toutes obédiences, on voit proliférer les professions innovantes, à commencer par les "consultants", les "conseillers de vie" en tout genre, dont l'activité principale consiste à "conseiller" la foule des gens qui ne savent plus qui ils sont, où ils vont, ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Le mot "coaching" a contaminé le vocabulaire courant.

Cela signifie une chose : plus une société fait des individus des entités autonomes, plus ces entités sont perdues, du fait qu'elles sont livrées à elles-mêmes pour décider de leur propre sort. Corollaire : moins ces individus éprouvent un sentiment d'appartenance à la collectivité.
Traduction toute personnelle (quoique ...) : la solitude morale est directement proportionnelle au degré d'autonomie revendiquée. Certains appelleront ce phénomène "mobilité du moi". D'autres seraient cependant fondés à le nommer "déréliction" (Michel Houellebecq, notre scalpel littéraire, dit quelque part (Interventions ?) que l'individu occidental contemporain est un être vide et sans consistance : je ne suis pas sûr qu'on puisse lui donner tort). Et c'est cela qui est le plus effrayant, car c'est bien le signe que notre société rend la vie ordinaire de plus en plus difficile à supporter.
Même les chamans ont compris le profit très concret qu'ils peuvent tirer de la décrépitude spirituelle, intellectuelle et morale dans laquelle errent les occidentaux (je connais quelqu'un qui à fait le voyage - organisé, cela va de soi).
Moralité : eh bien vous savez, docteur, cette population, qui d'un côté réclame à grands cris (souvent vindicatifs, voire agressifs) toutes sortes de "droits" nouveaux à exercer et qui, d'un autre côté, et selon une tendance lourde et durable, appelle au secours au moindre accident de la vie en brandissant l'étendard de « Victime », eh bien je vais vous dire : cette population me fait peur. Vous savez pourquoi ? Parce que je me dis qu'une telle contradiction est un obstacle infranchissable s'il s'agit d'édifier ce que je persisterai à appeler une SOCIÉTÉ. Une collection d'entités individuelles indéfiniment autonomes ne sera jamais faite pour constituer un CORPS SOCIAL. Et j'ai comme l'impression que ce désastre n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité.
Note : les illustrations de ce billet ont été sélectionnées dans un périmètre restreint. Leur point commun, pour la plupart, est d'être apparues sur nos murs dans des temps très récents.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'état du monde, coaching philosophique, coaching, psychothérapie, méditation, sexe des anges, access bars, constellations familiales énergétiques, cercle d'hommes, psychanalyse, michel houellebecq, photographie, qu'est-ce que je peux faire je sais pas quoi faire, anna karina, jean-luc godard, pierrot le fou, cinéma, jean-paul belmondo
dimanche, 01 avril 2018
PAPA, C'EST QUAND L'EFFONDREMENT ? 2/2
14 décembre 2017
Des nouvelles de l'état du monde (11).
2/2
L’effondrement dont on parle ici n’est certainement pas un événement. Car si tel était le cas, croyez-moi, il y a longtemps que les caméras et les bonimenteurs de BFMTV seraient sur place pour le remplissage habituel. Pas un événement, donc, mais un processus. Cela n’intéresse pas les chaînes d’info en continu : il ne se passe rien, vous comprenez. Analogie : pour donner une idée du temps au temps des dinosaures, un compositeur italien avait écrit (ça remonte à loin : fin des années 1970 ?) une œuvre pour piano sur un thème paléontologique. Un cluster chaque fois que l'iguanodon faisait un pas. Pas très rapide, l'animal : un gros « cluster » par minute, grand maximum, peut-être moins. L'auteur devait se dire qu'il rendait ainsi l'impression de la durée à l'époque de l'élasmosaure, du platéosaure et du ptéranodon. Sans m'attarder sur le côté proprement musical de la chose, je n’imagine pas les BFMTV proposer un de ces directs dont ils ont le secret, pour faire le poireau jusqu'à l'extinction des dinosaures.
Cet effondrement-là passe quasiment inaperçu. Il s'est inscrit comme tel dans le paysage. C'est juste un créneau qu'on laisse à quelques journalistes spécialisés, à placer le dimanche soir, entre les bouchons du weekend, les nouvelles imperturbables venues de Syrie ou d'Israël et les dernières mauvaises blagues inventées par Macron pour embêter ce qui reste des vieux partis ou pour mettre au pas de charge l'économie française au diapason de l'ultralibéralisme triomphant. C'est un effondrement inodore, incolore et sans saveur particulière. C'est un effondrement qui est entré dans les habitudes. Et surtout, c'est un effondrement d'une lenteur telle qu'il se maintient hors de portée de nos moyens physiologiques de la perception. Bref, c'est un effondrement normal : pas de quoi s'affoler dans l'immédiat. (paragraphe ajouté le 1 avril, au fait : joyeuses Pâques !).
Processus donc. Comme il y a des chances que son accomplissement laissera aux vivants actuels le temps d’achever leur existence sans trop de casse (et même à leurs successeurs, on espère), la notion de changement irrémédiable est donc bien partie pour échapper encore longtemps à l’attention du plus grand nombre. Laissons les masses vivre en paix, doit-on se dire en haut lieu, il sera alors bien temps de les prévenir quand le monde aura le nez dessus. Quand ce sera urgent, c’est-à-dire quand il sera trop tard (dans ce qu’on appelle l’ « urgence humanitaire », la catastrophe a toujours déjà commencé).
Notre aveuglement se nourrit d’un ingrédient dont personne n’ose imaginer l’absence dans le déroulement de son quotidien : le temps présent. Je veux dire l’instantané, immédiat ou imminent, forcément décisif pour garder l’impression de ne pas être largué par l’époque, qui ne cesse d’améliorer ses performances et d’aller plus vite. Il faut rester dans le flux, à l'affût, s'adapter, accélérer.
Nous comprenons d’autant moins ce qui se passe dans notre temps long qui s’appelle l’avenir, que notre nez renifle au ras du sol des « réseaux sociaux » la moindre fragrance de l’éphémère qui passe, en s’imaginant tenir là la clé de ce « temps présent » qui nous échappe. Les réseaux sociaux sont, à cet égard, la énième tentative désespérée de l’homme d’arrêter l’écoulement du temps (et d'abolir l'espace), en ce qu'ils illustrent la capacité des individus à s'accrocher à la moindre ramille d'immédiat émergée de leur écran, comme à une bouée de sauvetage.
A l’affût de la moindre vaguelette en surface, nous nous jetons sur la plus petite proie qui passe, nous l’avalons vite, la digérons vite et l’excrétons de même : notre esprit fonctionne comme un vulgaire intestin. Comme une machine à transformer l'oral en fécal : prescience de l'artiste Wim Delvoye avec sa "Cloaca", alias machine à fabriquer de la merde ? En tout cas, une extrapolation très répugnante mais d'une absolue justesse pour désigner notre monde, à partir des principes qui servent de base à la civilisation de la production-consommation.

Pourtant (et paradoxalement), ça a beau être un tuyau, ce temps présent-là est fermé aux deux bouts, isolé, hermétique : en aval l’aveuglement sur ce qui nous attend la semaine prochaine, en amont l’oubli de ce que nous avons avalé hier. La fascination pour le présent est une prison de l’esprit. Comment, dans ces conditions, être en mesure de percevoir les signes d'un quelconque effondrement ? L’homme est pourtant le seul animal qui sait qu’il doit mourir un jour. Mais notre monde éminemment technologique nous serine : « J'ai tous les moyens efficaces de te faire oublier le tragique de ton destin » (traduction : de boucher les deux bouts de ton tuyau). Un certain Blaise P. avait déjà bien analysé la chose il y a quelques siècles (la phrase finit par : « ... un homme plein de misères »).
L’humanité tombe donc de plus en plus bas, mais avec une telle lenteur que la plupart des gens pensent qu’ils ont la vie devant eux pour se mettre à penser à des choses pas drôles. C’est vrai, quoi, il faut rester optimiste ! Tant qu'ya d'la vie ya d'l'espoir ! Ya d'la joie ! L'espoir fait vivre ! Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la vie quotidienne continue, les ennuis gastriques ou conjugaux sont les mêmes, les prix continuent à augmenter, les enfants continuent à ne pas ranger leur chambre, il faut continuer à se chauffer quand il fait froid, le bruit des voisins continue à nous agacer, les magasins continuent à nous fournir les denrées nécessaires à la restauration de nos forces, les camions-poubelles continuent à passer le matin sous nos fenêtres. Tant que les structures de notre quotidien ne connaissent pas de panne, il n’y a pas de quoi s’affoler : la vie continue.
Si ça s’arrête (les trains, l’électricité, les camionneurs, … jusqu’au beurre des supermarchés, récemment), nous pestons jusqu’à ce que la circulation ou le courant soient rétablis. Car nous sommes tous concrètement pénétrés de l’idée de continuité de la « vie normale » et des indispensables répétitions quotidiennes : nous sommes façonnés de routine et nous disons, comme Letizia Bonaparte : « Pourvu que ça dure ». La durée est notre chair. Son défaut est qu'elle coule d'un robinet de couleur terne.
Pourtant, curieusement, nous ne saurions nous passer de tous les « événementiels » ("c'est là qu'ça s'passe, mec") qui ne nous sont absolument de rien, et qui semblent couler d'un robinet en or massif (mais c'est du toc, tout juste du plaqué-or) pour nous abreuver de cette liqueur spécialement produite pour ravir le gosier de notre imaginaire. Impression de participer, impression de vivre, je veux bien, mais en réalité ? Notre moteur est hybride : d'un côté la carburation par la nécessité si prosaïque, de l'autre par la séduction marchande. De quel côté, la "vraie vie" ?
C’est même un paradoxe : autant nos esprits sont en éveil quand il s’agit d’un fait, d’une parole, d’une séquence qui ne nous concernent en aucune manière, et qui sont indifférents à la banalité de toutes les banalités qui meublent notre quotidien, autant nos corps sont résignés à l’accomplissement journalier, discipliné, machinal des mêmes gestes et des mêmes actes, jusqu'aux plus triviaux, routine indifférente à cette écume des jours qui ne nous parvient que par le canal de voix et de visages que nous ne connaissons pas et qui n’ont aucune envie de nous connaître, parce qu'à leurs yeux, nous ne valons pas tripette.
Qui osera réhabiliter la dignité de l'ordinaire et du banal ? Qui dira enfin du bien de la masse des gens qui « font comme tout le monde » ? Qui inspirera aux gens ordinaires de l'amour pour la "nullité" de leur existence ? Quel auteur en vue aura le courage de ne pas écrire un best-seller, voire un chef d'œuvre, sur ceux que les journalistes nomment, très sympathiquement, « les anonymes » ?
D’un côté les bulles de savon qui nous fascinent mais nous feront crever, de l’autre l’épaisse et lourde glèbe routinière de ce qui fait la substance la plus permanente de notre vie concrète : il y a en nous, séparés par une cloison, deux mondes qui ne sont pas faits pour se rencontrer, indifférents l’un à l’autre. Si j'étais "psy" (ce qu'à Dieu ne plaise !), je proposerais de nommer ce symptôme "schizophrénie institutionnelle", ou quelque chose comme ça, au motif que cette double perception nous est inculquée par le mode de vie partagé par toute une civilisation. Qu'est-ce qui nous est le plus cher ? La sollicitation extérieure de nos multiples écrans, instantanée mais inconsistante, à laquelle nous nous prêtons de moment en moment ? Ou bien notre propre permanence, bien corporelle celle-là, à laquelle il nous est physiquement impossible d'échapper ? Les deux, mon général. Pour notre malheur.
On aurait intérêt à se demander qui a intérêt à figer notre attention dans les paillettes scintillantes de l’instantané. Qui cherche à nous imprégner de dégoût et de lassitude pour ce qui fabrique la banalité de notre continuité réelle ? A inspirer nos engouements pour des vies prodigieuses autres que la nôtre, convaincus que nous sommes de sa nullité ?
Tout ça pour dire que, si nous préférons les « trépidations de la machine » à la lenteur du déroulement de nos jours, cela ne nous prédispose pas à anticiper des menaces qui, elles, sont apportées par le temps long. Notre expérience intime du temps, hors de toute sollicitation extérieure, est certes la durée, pourtant nous préférons l'éclair de l'orage au long coucher de soleil sur l'horizon. La force des habitudes, la force d’inertie nous sont des poids sur les épaules. Durée, répétition, routine, transmission nous sont des épouvantails. Nous voulons que « ça bouge ». Nous n'avons même aucun regard pour ce qui nous semble ne pas bouger. Alors un effondrement, et au ralenti qui plus est, pensez ... Je vais vous dire : l'effondrement, nous l'attendons finalement avec indifférence. Nous n'en pensons rien, tout simplement parce qu'il n'a pas d'existence (tant qu'il ne s'est pas produit). Qui vivra verra (rien de plus rassurant que des proverbes).
Alors je repose ma question : « Papa, c’est quand, l’effondrement ? ». Personne ne sait au juste. Guy McPherson nous donne dix ans. Rien ni personne n’est en mesure de nous persuader de cette échéance. Ce qu’on sait, en revanche, c’est que tous les facteurs de notre développement planétaire conduisent le vivant au précipice. Que le mécanisme fatal est à l'œuvre. Ce que des hallucinés persistent à nommer le « Progrès » est devenu une entreprise de destruction massive. Tout nous l'indique. Les signaux se sont déjà allumés sur les écrans de contrôle : ouragans d’une force inconnue jusque-là, migrations massives dues aux guerres ou à la misère, fonte des glaces polaires, le blog de Paul Jorion, etc., etc., etc.
Tout le monde a, plus ou moins confusément, conscience que nos façons de faire sont mortifères. Alors quand ? « Tais-toi, fiston, et nage. En attendant, souris : nous sommes filmés ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, paul jorion, à quoi bon penser à l'heure du grand collapse, bfmtv, info en continu, urgence humanitaire, dinosaures, élasmosaure, ptéranodon, réseaux sociaux, txitter, facebook, arcon, art contemporain, wim delvoye cloaca, blaise pascal divertissement, letizia bonaparte pourvu que ça dure, psychanalyse, guy mcpherson, gilles boeuf, claude bourguignon, emmanuel macron, one planet summit
samedi, 31 mars 2018
PAPA, C'EST QUAND L'EFFONDREMENT ? 1/2
Je crois aujourd'hui que toutes les questions qu'on peut se poser sur la politique, l'économie, les relations entre les gens (la vie "sociétale") sont du pipi de chat par rapport à la question globale de la survie des êtres vivants sur la planète. Après la démonstration faite par les Allemands que 80% des insectes ont disparu du territoire en trente ans, on apprend que 30% des oiseaux "ordinaires" de nos campagnes ont également disparu en 15 ans. Les spécialistes de la biodiversité font des diagnostics à peu près identiques sur tous les continents. Qui s'en soucie ? J'ai du mal à prendre au sérieux tout ce qui ne tourne pas autour des questions de la survie de l'espèce humaine et de toutes les espèces vivantes. Ce ne sont pas, par exemple, quelques malades mentaux (je veux parler des "vegans") qui insultent un mort du Super U de Trèbes au motif qu'il était boucher qui me convaincront du contraire (écrit le 31 mars).
Je remets donc en ligne, plutôt deux fois qu'une, ce billet écrit le 13 décembre 2017.
Des nouvelles de l'état du monde (10).
1/2
Paul Jorion (encore lui) vient de publier A quoi bon penser à l’heure du grand collapse ? (Fayard). Pardonnons-lui l’anglicisme : l’anglais lui est si familier qu’il lui est devenu  naturel. Un « collapse », c’est un effondrement. Il en est convaincu : la catastrophe est inéluctable. J’avais suivi le conseil de lecture qu’il donnait dans le billet audiovisuel qu’il poste chaque semaine sur son blog ("Le temps qu'il fait") : j’avais lu Comment tout peut s'effondrer (sans point d’interrogation) de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Seuil, 2015).
naturel. Un « collapse », c’est un effondrement. Il en est convaincu : la catastrophe est inéluctable. J’avais suivi le conseil de lecture qu’il donnait dans le billet audiovisuel qu’il poste chaque semaine sur son blog ("Le temps qu'il fait") : j’avais lu Comment tout peut s'effondrer (sans point d’interrogation) de Pablo Servigne et Raphaël Stevens (Seuil, 2015).
Les auteurs constataient l’état déplorable de la planète dans une foule de domaines, et pronostiquaient le pire si rien n’était fait. La première partie du livre (jusqu’à la page 133, c’est l’état des lieux), donnait froid dans le dos, avec plein de petits graphiques montrant très bien l’emballement planétaire des productions et des destructions à partir de 1950.

Dioxyde de carbone, azote, méthane, poissons, forêts, températures, acidification, ...
J’avais hélas été horriblement déçu ensuite par ce qu’ils entrevoyaient et proposaient pour éviter que l’histoire humaine s’achève en eau de boudin. J'avais dit ici même cette déception dans mon billet du 24 juin 2015 (voir lien plus haut, et note en fin de billet). Au lieu de dire franchement et directement que le monde va à la catastrophe si les nantis du Progrès, du bien-être et de la technique (en gros : l'occident) ne renoncent pas à leur mode de vie de gaspillage et de dévoration des ressources, ils misaient tous leurs espoirs sur la nécessité de « changer les mentalités » (ben voyons, ma parole, ils n'ont pas compris ?), plaçant les solutions dans la sphère quasi-exclusive de la psycho-sociologie contemporaine, c’est-à-dire, pour aller vite, sur la capacité des moyens techniques et médiatiques de façonner les comportements de masse par une propagande judicieusement conçue. Comme si le problème et sa solution étaient là.
Comme si les atteintes à l’environnement se réduisaient aux habitudes de consommation inculquées aux populations. Comme si la question du mode de production des nuisances n’était pas concerné en premier lieu. Comme si - soit dit en passant - le rôle des sciences humaines était d'agir sur les orientations des sociétés (aveu de militantisme "scientifique" ?). La question qui me vient, à chaque invention de telles solutions, c’est évidemment toujours la même : « Comment tu fais, coco ? ». Car malheureusement pour les auteurs, on a lu Beauvois et Joule (Petit traité de manipulation ...), Edward Bernays (Propaganda) et quelques autres : on sait ce qu'il en est de la manipulation mentale et du formatage des esprits par l'intermédiaire d'une psychanalyse habilement instrumentalisée et correctement mise en œuvre.
La question, en l’occurrence : si la publicité peut influencer ponctuellement (dans une certaine mesure) les attitudes des populations ordinaires, comment va-t-on procéder au changement de « mentalité » de tous les gens qui trouvent un puissant intérêt matériel et financier dans l’actuelle marche du monde et dans une « mondialisation » qui se réduit à une compétition féroce entre acteurs transnationaux ? Comment va-t-on faire changer d'avis les gens qui détiennent le pouvoir et l’argent qui va avec ? Ils croient vraiment, Servigne et Stevens, que les gros lards de l'économie mondiale vont battre leur coulpe et se laisser tondre ? Le diagnostic des deux compères est sans appel, mais leur remède est plus foireux qu’une colique frénétique.
Paul Jorion est plus lucide, plus réaliste et plus rationnel : La Crise du capitalisme américain, écrit en 2004-2005, où il annonçait, entre autres, la crise des « subprimes », est sorti en janvier 2007, trop tard pour servir à qui que ce soit pour parer la menace. Aurait-il permis d’empêcher la crise si un éditeur courageux et conscient avait osé le publier aussitôt écrit ?
La conclusion que l'auteur tire aujourd’hui ("Le temps qu'il fait", 1 décembre 2017) de sa débauche d’activités pendant tant d’années pour expliquer l’urgence, avertir les responsables et mobiliser les foules laisse à penser que lui-même n'y croit guère, avec raison selon moi (« J'ai fait ce que j'ai pu », dit-il, comme quoi même les gens spécialement doués ne peuvent que ce qu'ils peuvent). C'est sans doute pourquoi, lassé de rompre des lances contre les moulins à vent, il a décidé de passer le relais de l’action à des bonnes volontés neuves et encore fraîches. Paul Jorion, fatigué, raccroche les gants, pour consacrer sa belle intelligence à des tâches plus personnelles et plus gratifiantes. C’est regrettable, mais on le comprend : militant, ce n'est vraiment pas un métier. Heureusement.
Alors l’effondrement, maintenant ? Comme Servigne et Stevens, Jorion le voit inéluctable. Il n’est pas le seul : Guy McPherson, Claude Bourguignon, Gilles Bœuf et tant d’autres dont, tout dernièrement, 15.000 scientifiques du monde entier, ne cessent d’alerter sur ce qui attend la planète et l’humanité si sept, et bientôt dix milliards d’hommes se mettent à vouloir vivre comme des nababs sur un gâteau en train de fondre.
J’ai déjà dit ici ("L'humanité en prière") pourquoi je crois que l’inéluctable est inéluctable : pour la raison que plus un système est global et interdépendant, moins les individus, même regroupés en vastes ensembles d'influence (partis, lobbies ou autres), peuvent y changer la moindre virgule ou le plus petit guillemet. Je n’y reviens pas. La question que je me pose aujourd’hui porte sur la raison de l’apathie, de la passivité massive qui accueille obstinément les cris poussés par des savants d’ordinaire froids comme des constats. Pourquoi une telle surdité ?
Un effondrement, tous ceux qui ont assisté à l’implosion des grandes barres de La Duchère à Lyon (on pourrait dire la même chose dans bien des endroits) savent comment ça se passe : ça fait du bruit, de la poussière et un gros tas de gravats à déblayer (pour les mettre quelque part, pourvu que ce soit ailleurs). Ça dure quoi ? En un clin d’œil tout est terminé, il n’y a plus rien à voir. Voilà justement le problème : un effondrement, c’est instantané.
Or, l’effondrement dont parlent Servigne et Stevens, Paul Jorion, Gilles Bœuf et consort n’est pas visible à l’œil nu. Il se produit sous nos yeux, mais si lentement ! Un effondrement qui se produit à la vitesse imperceptible, si l’on veut, de l’aiguille des minutes sur le cadran de la montre ou de l’ombre du soleil à midi en plein été, est-ce crédible ? Pas assez en tout cas pour que le détecteur de mouvement déclenche le signal. Ce n’est pas une durée d’ordre géologique, mais ça donne une idée. Apprendre que 80% des insectes ont disparu en trente ans sur le territoire européen est déjà plus parlant. Mais pour ça, il faut des statistiques scientifiquement établies.
Pour notre malheur, l’effondrement qui nous entraîne aujourd’hui se produit donc avec beaucoup trop de lenteur pour que nos moyens de perception soient mis en alerte. C’est un effondrement indolore, inodore et sans saveur. Un effondrement qui s'écoule tranquillement, grisâtre, et si lentement que nous sommes déjà fatigués d'en entendre parler : arrête de rabâcher, vieux schnock, il est où l'effondrement ? Rien en effet ne semble avoir changé depuis la veille, tout le paysage est semblable ou presque, si l’on excepte quelques changements imperceptibles ou hors de notre portée visuelle. Tout le monde regarde le même film, mais c’est un immense plan-séquence tourné en immense ralenti. Ce n’est pas l’immobilité complète, mais comme ça semble ne pas avancer, on se dit qu’à ce rythme-là, on a le temps de voir venir. Qui remarque le vieillissement, jour après jour, sur le visage aimé de la personne qui partage sa vie ?
Gilles Bœuf, dans un cours au Collège de France où il parlait de l’effondrement des effectifs dans les espèces animales, voyait très juste : aux écologistes qui clament que « l’humanité va dans le mur » (ils n’ont pas tort sur le fond, mais), il répondait qu’il n’y a pas de mur et qu’il n’y aura pas de grand choc. Simplement, plus la situation va aller en se dégradant, plus le cadre et les conditions de vie des vivants vont devenir difficiles. On en voit déjà des manifestations, mais si parcellaires et circonscrites dans leurs dégâts (l'île de Saint-Martin n'est pas New York) que très peu de gens font le lien entre elles pour se dire que la situation d'ensemble est grave. Pour les journalistes, ce sont des "événements". A la rigueur des "catastrophes", mais soigneusement localisées, et prises en charge par la "communauté internationale". (« Mais que fait la communauté internationale ? », pleurent en chœur les journalistes des plus gros journaux du monde et les présidents des plus grosses ONG).
L'espace de la conscience individuelle a bien du mal à se hisser jusqu'à la hauteur de l'enjeu global. Et, s'il y parvient, à en tirer toutes les conséquences pour son propre compte.
Voilà ce que je dis, moi.
15 décembre 2017 : Pablo Servigne est interviewé sur France culture. Il n'y a décidément pas grand-chose à espérer du monsieur. Pour contrer les représentations catastrophistes de l'avenir du monde, il vient avec des collègues de publier un ouvrage qui tend à démontrer que l'on ne trouve pas dans la nature seulement des rapports "prédateur-proie", mais qu'il y a aussi, partout, de l'entraide. Comme exemple d'entraide, il cite la pollinisation. Ah bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. La pollinisation, c'est de l'entraide, maintenant. Ça m'a bien fait rire. Les pommiers de font pas des poires. Pablo Servigne est atteint jusqu'au verre de ses lunettes d'une maladie qui continue à faire des ravages : l'optimistose aiguë. Symptôme principal : une bonne grosse pomme bien rouge et bien gonflette. Mais la pomme gonflette est dans l'air du temps : Peter Wohlleben est l'auteur à succès de La Vie secrète des arbres, où il développe l'idée qu'il n'y a pas que les humains à pratiquer l'entraide (surtout quand ça les arrange) : il y a aussi les arbres. La nature sera désormais un modèle idéal de ce que doit être, et sera peut-être, la société altruiste. Message : il suffirait que les humains s'inspirent de ... pour ... « Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain ». Ouais ! Farpaitement !
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul jorion, à quoi bon penser à l'heure du grand collapse, blog de paul jorion, pablo servigne comment tout peut s'effondrer, éditions du seuil, psycho-sociologie, changer les mentalités, environnement, écologie, écologistes, biodiversité, beauvois et joule petit traité de manipulation, edward bernays, bernays propaganda, manipulation mentale, mondialisation, globalisation, psychanalyse, jorion la crise du capitalisme américain, crise des subprimes, guy mcpherson, claude bourguignon, gilles boeuf, collège de france, lyon la duchère, nicolas hulot, eelv, les verts, sciences humaines
vendredi, 28 avril 2017
MICHÉA : NOTRE ENNEMI, LE CAPITAL
 Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.
Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.
Qu’on en juge : l’axe principal de son propos tel qu’il s’expose en quatre courts chapitres tient dans les quatre-vingts premières pages, les deux cent vingt-neuf suivantes étant consacrées à développer des « scolies » (alias "commentaires", numérotés de A à P), qui sont autant de greffes entées sur le tronc du raisonnement, et qu’il préfère, pour cette fois, regrouper à part. Et non content de cette "curiosité", chacune des scolies digresse en notes, souvent très copieuses et qui volent parfois en escadrille, annoncées en lettres minuscules cette fois.
Par-dessus le marché, son style d’exposition n’est pas fait pour faciliter la tâche au lecteur. Je ne nie pas la nécessité de la précision et de l’exactitude de l’expression. Mais, pour prendre un exemple dans la psychanalyse, entre la manière quasi-maniaque d’un Jacques Lacan et le langage accessible d’un Didier Anzieu, je choisis ce dernier, dont on suit en général le propos sans peine : le non-spécialiste lui en sait gré, quelle que soit la validité de ses thèses.
La langue de Michéa est faite de phrases à rallonge (celle qui commence page 65 s’achève vingt-cinq lignes plus bas, et quatre ou cinq pages plus loin, à cause des notes !), et qui plus est, de phrases souvent bourrées d'interruptions diverses, sous forme d’incises, de tirets, de parenthèses, qui finissent par noyer le fil conducteur sous les strates multiples. C’est sûr, l’auteur ne veut rien oublier, mais cette façon d’écrire, jointe au choix de la scolie, a quelque chose d’horripilant.
C'est ce que je reprochais, par exemple, à Bourdieu (du temps où je lisais ça), dont on se demande après combien d'incises et de propositions subordonnées la phrase qu'il vient de commencer va s'achever. C'était permis à Proust qui, lui, écrivait de la littérature. A quoi tient le besoin de certains intellectuels d'obscurcir à loisir leurs thèses, auxquelles je suppose pourtant qu'ils tiennent ?
C’est d’autant plus dommage, dans le livre de Michéa, que bien des remarques, dans le texte ou dans les notes, ont tout pour remplir d'aise le lecteur déjà un brin critique. Pour rester page 65, par exemple, Michéa s’en prend, en bas de page, à tous les intellectuels qui ont décidé de rénover le discours du capital en affublant leur entreprise du masque de la « déconstruction » ("neutralité axiologique" oblige : la belle blague). Il place ceci entre parenthèses : « comme en témoigne, entre autres, le fait que la carrière d’un universitaire français – du moins dans le domaine des « sciences sociales » – dépend avant tout, de nos jours, du nombre de génuflexions qu’il acceptera d’accomplir devant l’œuvre de Foucault et de Derrida ». Je goûte fort les guillemets à "sciences sociales".
Oui, la police universitaire est bien faite, et l'ordre économique et idéologique y règne. Cette mise en cause fait un bien fou, car la gauche soft, vous savez, la gauche sociétale qui s'est désintéressée des rapports de classes et des rapports de production pour se convertir à l'économie de marché et à la dérégulation morale, fait en effet régner dans les « sciences » humaines un terrorisme intellectuel qui paralyse et stérilise la pensée dans l’université française, où la cooptation, si elle n'est pas la règle absolue, pèse quand même de tout son poids.
Toujours sur un de ces papes de la « déconstruction » : « Certains se souviendront alors peut-être du jugement prophétique de Sartre. La pensée de Foucault – écrivait-il dès 1966 – est "le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx". L’université française contemporaine est là pour le confirmer » (p.61). Bien que je n'approuve pas trop la référence à Sartre, je trouve que s'en prendre à Foucault et Derrida, c'est ne pas manquer de courage, et l'on comprend que tous leurs émules s'entendent à merveille pour rejeter avec haine et hauteur Michéa parmi les plus fieffés "réactionnaires".
De même quand il s’en prend à une figure quasi-christique de la gauche moderne, sociétale et cosmétique, celle qui a promu le "mariage" des homosexuels : « Si, du reste, ces notions d’identité nationale et de continuité historique ne renvoyaient qu’à un simple "mythe populiste", une Christiane Taubira pourrait encore exiger – sous les applaudissements de cette même extrême-gauche libérale – la "repentance" collective des Français d’aujourd’hui pour des crimes commis aux XVI° et XVII° siècles par un petit nombre de leurs ancêtres » (p.33). Soit dit en passant, Taubira a, entre autres, été un temps l'égérie de Bernard Tapie ! Tiens, au fait, n’est-ce pas le baratineur Emmanuel Macron qui, en Algérie, a décrété que la colonisation avait été un "crime contre l’humanité" ? Repentons-nous, mes frères !!! En chemise et la corde au cou ! Comme les bourgeois de Calais (ça avait une autre gueule que la "jungle", sous la patte de Rodin).
La mise en cause du système capitaliste qui met la planète en coupe réglée et qui bourre les crânes à coups d’idéologie libertaro-marchande est donc tout à fait impeccable. Quel dommage que Jean-Claude Michéa n’arrive pas à débroussailler sévèrement la forêt emberlificotée de ses raisonnements !
Ses ennemis, nombreux, soyons-en sûr, s'en félicitent.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, littérature, sociologie, philosophie, jean-claude michéa, notre ennemi le capital, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, pierre bourdieu, michel foucault, jacques derrida, jean-paul sartre, christiane taubira, repentance, élection présidentielle, emmanuel macron, crime contre l'humanité, bernard tapie, les bourgeois de calais, auguste rodin
samedi, 16 avril 2016
CHRISTOPHER LASCH ET GUY DEBORD
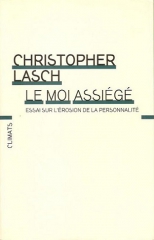 Quelques réflexions après lecture de Le Moi assiégé, "essai sur l'érosion de la personnalité", de Christopher Lasch.
Quelques réflexions après lecture de Le Moi assiégé, "essai sur l'érosion de la personnalité", de Christopher Lasch.
Pour mettre du baume au cœur.
Il est bon d’avoir lu, au moins une fois dans sa vie, un livre de Christopher Lasch, observateur intransigeant de la civilisation occidentale en général, mais principalement de la façon dont elle évolue aux Etats-Unis. A cet égard, La Culture du narcissisme (Climats, 2000, écrit en 1979), que je suis en train de relire, fait un excellent point de repère et de départ, même si c'est un peu « consistant ».
La méthode de Christopher Lasch est impeccable : il fait le tour complet d’une documentation impressionnante et passe au crible tout ce qui a été dit par d’autres du sujet qui le préoccupe. Il énumère les points de vue qu’il estime erronés et s’efforce de corriger les idées fausses que des gens sûrement sérieux véhiculent et colportent.
Dans Le Moi assiégé (« essai sur l’érosion de la personnalité », Climats, 2008, écrit en 1984), que je viens de relire avec intérêt, il revient, pour l’approfondir, sur la notion de narcissisme. Le sous-titre dit assez sur quelle hypothèse il s’efforce de fonder son ouvrage. C’est une idée qu’on croise dans les bouquins de Michel Houellebecq, de façon explicite dans un de ses volumes d'Interventions. Une idée qui se veut un constat. Une idée qui, si elle s'avère, a des implications qui peuvent effrayer.
Dans une société vouée à la catastrophe humaine que constituent la marchandise, son spectacle et sa consommation, assailli constamment par des armées d’images, l’individu ne parvient plus à se constituer un « moi » par ses propres moyens, un « moi » qui lui appartienne en propre, après avoir fait sa propre expérience directe du monde et de la réalité. Le système de la communication publicitaire - à tendance tant soit peu totalitaire -, qui a gagné un terrain considérable pour organiser les relations sociales à tous les niveaux, occupe désormais une place prépondérante, en lieu et place de ce que Freud appelle le Moi.
Ne pas oublier qu'Edward Bernays, l'un des grands inventeurs de la publicité moderne, était le double neveu de l'inventeur de la psychanalyse, discipline dans laquelle il a abondamment puisé pour mettre au point la machine publicitaire : on va puiser dans le bric-à-brac du secret des motivations les figures, motifs et arguments qui, brandis ensuite comme un miroir devant le nez du citoyen devenu consommateur, vont orienter son désir vers la marchandise à vendre.
Pour resituer la chose, il ne faut pas oublier que le livre de Lasch est publié en 1984. Je veux dire par là qu'il n'est pas impossible qu'une question d'ordre générationnel se pose, car l'idée dit peut-être davantage à des gens de mon âge qu'à des générations plus neuves, vu que les conditions concrètes de l'existence n'avaient pas encore été aussi radicalement transformées qu'elles ne l'ont été depuis une trentaine d'années.
Quoi qu'il en soit, l'idée du spectacle marchand comme programme général d'existence avait été largement diffusée en leur temps par les situationnistes en général, et Guy Debord en particulier. Une idée le plus souvent incomprise, du fait d’une interprétation tout à fait étriquée, donc fausse, de la notion de « spectacle », que je reformulerais ici de la façon suivante : « création, entre l’homme et le monde, d’une réalité entièrement artificielle autour de la marchandise érigée en objet de désir par les moyens de la propagande ».
Il s’ensuit que la personne a été en quelque sorte vidée d’elle-même, comme si un écran s’était interposé entre sa conscience et son moi. Dépossédée de ce qu’elle serait devenue si elle avait été soumise aux seules influences héritées de la tradition, elle ne s’appartient plus, fabriquée des pièces et des morceaux d’images conçues par d’autres et introduites en elle de l’extérieur. Autrement dit, comme elle a du mal à distinguer ce qui vient d’elle et ce qu’elle ingurgite de l’extérieur, la personne ne sait plus à qui elle a à faire quand elle dit « je ». « L’anxiété actuelle au sujet de l’ "identité" reflète une partie de cette difficulté à définir les frontières de l’individualité » (p.15).
J’ajoute, pour enfoncer le clou, que la personne, quand elle dit « je », croit sincèrement qu’elle parle en son propre nom, alors qu’elle exprime un « moi » qui lui a été pour une grande part inculqué à son insu : la société du capitalisme spectaculaire-marchand (Debord) a façonné des semblants de personnes, des fantômes persuadés qu’ils existent de façon pleine et entière : des artefacts, des zombies. L’idée est pour le moins radicale.
Ce qui change, par rapport à la situation précédente, c'est que nous sommes ici dans l'exécution d'un projet parfaitement concerté, généralisé, et prévu pour produire les effets qu'il produit. Ce que fait, dans un autre domaine, le génie génétique par rapport, par exemple, à la méthode de nature purement empirique de sélection et d'appariement de deux races de chiens par les éleveurs, en fonction des qualités attendues de la nouvelle race envisagée (flair, endurance, dressabilité, puissance, potentiel agressif, etc.). Si la grille de lecture de Christopher Lasch est la bonne, cela veut dire en effet que les populations embarquées dans ce système ne sont plus désormais en mesure de porter ce qui s’appelle une « civilisation ». Et, accessoirement, que le système qui est le nôtre a quelque chose à voir avec le totalitarisme.
Cela veut dire que le système spectaculaire-marchand débarrasse l’individu du fardeau de la civilisation, puisqu’il il le débarrasse du fardeau de lui-même, en le transformant en simple spectateur et client, consommateur de biens et de services. En poussant un peu, on pourrait considérer que le système spectaculaire-marchand fait disparaître jusqu’à la possibilité de la civilisation, en transformant tout ce qui appartient au passé en simple objet muséal, ou en simple marchandise destinée à des touristes venus errer dans l'hypermarché global pour consommer les traces d’un passé mort, et dénué pour eux de signification présente.
Charmante perspective.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, christopher lasch, le moi assiégé, éditions climats, psychologie, psychanalyse, narcissisme, michel houellebecq, guy debord, la société du spectacle, spectaculaire-marchand, houellebecq interventions, edward bernays
mardi, 29 mars 2016
LE DERNIER PAUL JORION
 2
2
Résumé : je disais que je n’avais rien contre la formule « fascisme de l’économie », que je crois bien avoir entendu Paul Jorion prononcer dans un de ses billets « Le temps qu’il fait » du vendredi.
Je n’ai rien contre cette vision des choses : depuis quelques années maintenant, la religion (terrorisme, islam, djihad, attentats, Daech) et l’économie (chômage, entreprise, partenaires sociaux, MEDEF, Code du travail, etc.), en envahissant les journaux écrits ou télévisés, nous empestent, nous empoisonnent, nous asphyxient, nous assiègent et nous font subir un harcèlement moral et idéologique de tous les instants. Qu'est-ce que c'est, aujourd'hui, que notre vie ? Les médias nous bombardent de ce qu'elle n'est pas, comme s'ils voulaient nous en déposséder.
Comme si le diamètre de l'image du monde qui nous parvient par le canal des médias s'était rétrécie, étriquée, rabougrie. Comme si l'on était conduit par nos moyens d'information à "zoomer" sur une minuscule partie du monde, en occultant d'énormes et multiformes pans de la réalité (disons, presque tout le reste). Qu’est-ce qui s’est passé pour que ces thèmes soient devenus à ce point obsessionnels (au sens étymologique : "assiégeants") ? D'accord avec Jorion, donc.
Mais là où je n’arrive plus à suivre l’auteur dans ses pérégrinations intellectuelles ou philosophiques, c’est quand il consacre tout un chapitre à la démonstration du caractère totalement illusoire de ces piliers de civilisation que sont pour nous l’intention et la volonté dans la préparation de l’action (politique ou autre), puis tout un autre chapitre à la démonstration que nous avons eu tort de donner une telle place à la raison, qui ne mérite aucunement une telle confiance.
Bien sûr, Freud et la psychanalyse nous ont appris que nos intentions, notre volonté, nos décisions sont largement tributaires des forces chaotiques qui font semblant de dormir dans notre inconscient et en réalité orientent indéniablement nos trajectoires ; bien sûr, nous sommes à même aujourd’hui de mesurer l’ampleur des dégâts que peut entraîner la raison quand on lui laisse la bride sur le cou et qu’on lui fait une confiance aveugle. Comme le dit Hermann Broch, il nous restera toujours sur les bras un « résidu irrationnel » : autant s’en accommoder.
Ces deux chapitres, quoi qu’il en soit, me semblent soit enfoncer des portes ouvertes, soit tomber à côté de la plaque. Le problème, avec l'idée que l'intention, la volonté, la raison sont de pures illusions, c'est qu'elles font partie intégrante du socle sur lequel toute la civilisation est bâtie. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire, de cette civilisation fondée sur du vent ? Le dernier chapitre tente de répondre : laissons les choses aller à leur terme. Là, Paul Jorion laisse libre cours à l’anticipation et, disons-le, à l'imagination. On sait que Michel Houellebecq, dans La Possibilité d’une île, place tout son espoir dans le clonage humain pour voir enfin l’espèce humaine accéder à une forme d’immortalité.
C’est d’une façon différente, quoique cousine, que Jorion envisage sans trop se formaliser la perspective d’une telle immortalité, mais lui, il l'imagine à partir du « grand remplacement » du genre humain par des robots si intelligents que ce sont eux, et non plus les hommes, qui se reproduiront et qui liront et apprécieront Shakespeare et porteront la culture. Dans la foulée, et sans regrets exagérés (au moins en apparence), il se prépare à faire, pour son compte, le « deuil du genre humain ». Vous l'imaginez, la Terre débarrassée de toute présence humaine, et mais dont la surface grouillerait de machines perpétuant à jamais, en la mimant, l'espèce humaine ? J'ai un peu de mal à le concevoir.
Je n’ai rien contre le noir pessimisme que suppose une telle perspective : peu ou prou, comme disent les Dupondt : « C’est mon opinion et je la partage ». Je ne vois pas quelle force pourrait s'opposer au ratiboisage programmé de la surface de la planète.

Quant aux machines et aux robots, faudra-t-il se résoudre à les "aimer", comme le soutient un auteur cité par Paul Jorion ? Mais alors, c’est toute la démarche du bouquin qui pose question : à quoi bon s’emberlificoter les boyaux de la tête avec des rafales de Nietzsche, de Hegel et de quelques autres (j'ai d'ailleurs du mal à faire le lien entre toutes les références, qui vont de l'encyclique "Laudato si'" du pape François au Sophocle d’Œdipe à Colone, en passant par Alain Supiot et plusieurs œuvres précédentes de l'auteur lui-même), si c’est pour retomber sur cette évidence : ce sont les passions qui conduisent les hommes ? Ça, on le savait déjà, monsieur Jorion.
Je ne suis pas sûr que votre livre, en faisant ainsi table rase, éclaircisse quoi que ce soit. Je ne veux pas dire qu'on y attendrait des propositions ouvrant sur un horizon : l'affaire est entendue.
Toutefois, si le procès est clos, la sentence n'est pas encore rendue. Paul Jorion pense que si : dans ces conditions, je lui demanderais volontiers comment il fait pour tenir.
Voilà ce que je dis, moi.
Notes :
1 – Paul Jorion cite, à la toute fin de son livre, celui de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer (commenté ici du 22 au 24 juin 2015) : « les auteurs ont rassemblé, comme ils le soulignent – et à la différence de leurs prédécesseurs – les preuves de l'effondrement, non pas dans un domaine spécifique, correspondant dans la plupart des cas à la sphère d'investigation d'une discipline ou d'une sous-discipline, mais dans l'ensemble des domaines où des effets se conjuguent pour sceller l'extinction de notre espèce » (p.266).
J'avais en effet été frappé par l'accumulation des signes indubitables d'un affolement planétaire : tout ce qui était de l’ordre du constat apparaissait irréfutable et effrayant. Mais j'étais resté médusé devant la niaiserie de la "solution" que les auteurs proposaient, que je résumerais par le slogan : "Il faut changer les mentalités", – solution inopérante, puisque purement incantatoire, inspirée des travaux des psychosociologues, vous savez, tous les « spécialistes » qui travaillent d’arrache-pied à l’amélioration constante des techniques de conditionnement des esprits et de manipulation des foules. Jorion relève la même faiblesse en citant la phrase : « Il est temps de passer à l'âge adulte » (p.267), qui atteint, disons-le moins gentiment que lui, le comble de la courgerie radieuse.
2 – Quelques remarques : a) Paul Jorion, p.61, parle des générations futures, et du peu de considérations dont elles sont l’objet de la part des plus anciennes. Je répondrai deux choses. La première est une citation que je crois empruntée à Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas la Terre de nos parents : nous l’empruntons à nos enfants ». Autrement dit, ce souci ne date pas d’hier. La seconde est la suivante : j’espère que le souci de la préservation de la planète n’a pas besoin de penser aux générations futures pour s’exercer, et que soi-même dans le présent (dans l’urgence de sa propre préservation) est en soi une raison pour refuser certaines conditions inacceptables qui sont faites à l’être humain. L'appel à l'argument "générations futures" est purement rhétorique.
b) On trouve p.42 cette phrase : « Nous avons été incapables, en des dizaines de milliers d’années, de nous débarrasser de la guerre». Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que les paléontologues font remonter les premières guerres à l’époque où l’homme a inventé, pour succéder à l’existence précaire de chasseur-cueilleur, la sédentarité, le regroupement en unités humaines plus vastes, l’élevage et l’agriculture, c’est-à-dire à l’âge du néolithique, peu ou prou dix mille ans avant nous. Pas tellement plus : dix ou douze mille ans de guerres, ce n’est déjà pas mal.
c) Carrément anecdotique : « La raison est en fait, toujours selon Nietzsche, l’ultime "deus ex machina", l’artifice dérisoire d’un dieu sorti de nulle part, si ce n’est de la plate-forme actionnée par des poulies qui le fait descendre de l’architrave sur la scène ». Sauf erreur ou ignorance de ma part, on ne trouve pas d’architrave dans un théâtre : à la rigueur ce qu’on appelle les « cintres » ?
dimanche, 13 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS

LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS
ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
8/9
De la science et de la dérision dans les arts.
En musique, il ne s’est plus agi d’offrir à l’auditeur une nourriture capable de combler son appétit d’élévation ou de plaisir esthétique, mais de lui assener le résultat aride de cogitations savantes. Il s’est agi de le ramener sur le banc de l’école pour qu’il subisse les coups de la férule magistrale d’un maître supérieurement intelligent, qui le considère en priorité comme un être inachevé, qui reste à former, à éduquer, à dresser selon les nouvelles normes, elles-mêmes constamment changeantes (nécessité pour tout maître qui tient à rester le maître).
L'artiste s'est voulu penseur. Il s'est fait intellectuel. Il se servait de son intelligence pour procurer un plaisir : il faut désormais qu'il montre, d'abord et avant tout, son QI. Le plaisir suivra, mais comme une simple éventualité. L'artiste, aujourd'hui, a déserté le sensoriel : c'est un cérébral, doué pour l'abstraction. Dans l'œuvre musicale ou plastique, s'il reste quelque chose pour les sens de la perception, c'est accessoire, ou alors c'est involontaire, ou alors c'est accidentel. Eventuellement une provocation.
Musique et arts plastiques ont abandonné la perspective de la réception sensorielle des œuvres et sont devenus des produits 100% jus de crâne. De même qu'on a pu  parler d' "art abstrait" à propos de peinture, on devrait pouvoir
parler d' "art abstrait" à propos de peinture, on devrait pouvoir désigner le monde sonore ainsi créé par l'expression "musique abstraite" (quelle que soit la validité du terme "abstrait"). J'aimais beaucoup entendre André Boucourechliev parler de Beethoven, qu'il mettait résolument "über alles", mais sa musique (Les Archipels, Quatuor à cordes, même joué par les Ysaÿe) refuse toujours obstinément de franchir les paupières de mes oreilles.
désigner le monde sonore ainsi créé par l'expression "musique abstraite" (quelle que soit la validité du terme "abstrait"). J'aimais beaucoup entendre André Boucourechliev parler de Beethoven, qu'il mettait résolument "über alles", mais sa musique (Les Archipels, Quatuor à cordes, même joué par les Ysaÿe) refuse toujours obstinément de franchir les paupières de mes oreilles.
La meilleure preuve, c’est que, en musique tout comme dans les arts plastiques, la production des œuvres a dû s’accompagner de commentaires filandreux, d’éclaircissements opaques, de conférences à bourrer le crâne, parfois copieux comme des livres, pour expliquer aux ignorants les intentions de l’artiste. L'artiste est devenu, en même temps qu'il élaborait des formes esthétiques, le théoricien de sa propre démarche. Il s'est mis en devoir de construire toute la théorie préalable à son œuvre. Et il ne s'est pas privé d'en assener les coups sur la tête de son futur public, l'obscurité du propos étant sans doute un gage de sa hauteur de vue. Je laisse bien volontiers, quant à moi, comme Libellule dans Popaïne et vieux tableaux (Maurice Tillieux), sans honte, sans regret et sans me laisser intimider, toutes les "hauteurs de vue" me passer loin au-dessus de la comprenette. Je n'ai pas vérifié l'exactitude de la citation.
De l’aveu même de l'artiste, donc, son œuvre ne se suffit plus à elle-même, puisqu’il s’agit, en même temps qu’elle est fabriquée, d’en élaborer l’exégèse complexe et complète. L'artiste devient son propre herméneute : on n'est jamais trop prudent. Il faut que le public, en même temps qu'il accueille l'œuvre, ait en main la seule interprétation / justification juste qu'il convient d'en faire. Alfred Jarry était à la fois infiniment plus modeste et, à juste titre, infiniment plus fier : « Suggérer au lieu de dire, faire dans la route des phrases un carrefour de tous les mots » ; et plus loin : « ... il n'y a qu'à regarder, et c'est écrit dessus ». Conception certes un peu théologique de l'écrivain et de l'acte d'écrire, mais somme toute préférable. Cela n'en fait pas pour autant un écrivain populaire, un écrivain "à succès", capable de pondre les "best sellers" à la chaîne.
Voilà : les arts, au 20ème siècle, sont des arts sans sujet et sans destinataire. Un art de grands savants hautains fait pour de pauvres ignares. Une nouvelle – et étrange – mouture, en quelque sorte, de « L’Art-pour-l’art », liée exclusivement au "bon plaisir" de l'auteur (le "choix du roi"). Peinture et musique sont devenues intransitives. Peinture et musique ont pris acte du fait que ce ne sont plus les hommes qu’il convient de servir, mais les choses. Voilà : peut-être le cœur du réacteur de la question se situe-t-il dans cette direction : il faut servir les choses, non les hommes. Tant pis pour ces derniers : laissons la bride sur le cou aux lois de la nature, elles se chargeront de la besogne d'élimination. C’est l’univers des choses qui commande. Les hommes n'ont plus voix au chapitre.
Les artistes sont devenus de modernes "abstracteurs de quintessence", des expérimentateurs de matière seulement matérielle sans plus aucune perspective humaine, de quelque densité de sens virtuels "a posteriori" qu'ils voudraient la charger. Ils se sont livrés à des expériences cérébrales, après avoir échafaudé des hypothèses, dont les œuvres ainsi produites avaient pour mission de confirmer la validité. Rien de plus efficace pour évincer la notion de goût esthétique, cet archaïsme auquel il faut être au moins réactionnaire pour se référer. Non mais, vous avez dit « subjectivité », « goût esthétique », « émotion musicale » ? A-t-on idée d’ainsi aller fouiller les « Poubelles de l’Histoire », fussent-elles celles de l'art ? Soyons sérieux, c'est-à-dire définitivement « Modernes » ! Du passé faisons table rase.
Comme la nature pour les sciences exactes, peinture et musique (je veux dire les couleurs et les sons) sont devenues des proies pour la connaissance objective : de même que l’astrophysicien cherche de quoi sont faits l’univers, les astres, les comètes, peintre et compositeur partent en explorateurs dans les univers des arts visuels et sonores, explorations dont ils espèrent rapporter quelque pépite, de même que les spationautes d’Apollo XI avec leurs échantillons de la matière lunaire.
Pour qu’il y ait « science exacte », il faut supprimer l’intervention de l’homme. Pour avoir une vision claire du déroulement des mécanismes, il faut exclure l'homme, sous peine d’artefacts qui fausseraient l’expérience. Semblable révocation de l’humanité vivante, au 20ème siècle, dans le laboratoire des « artistes plasticiens » et des compositeurs : on fait des assemblages improbables, des précipités jamais tentés, on fait voisiner des substances incompatibles, juste pour voir ce que ça va donner. Ah, faire de la musique une science exacte, une pure mathématique abstraite, entièrement intelligente, entièrement artificielle, et surtout coupée de ce maudit monde des sens de la perception : le rêve de Pierre Boulez.
des compositeurs : on fait des assemblages improbables, des précipités jamais tentés, on fait voisiner des substances incompatibles, juste pour voir ce que ça va donner. Ah, faire de la musique une science exacte, une pure mathématique abstraite, entièrement intelligente, entièrement artificielle, et surtout coupée de ce maudit monde des sens de la perception : le rêve de Pierre Boulez.
Le lecteur se dira que j'exagère d'exagérer, que j’abuse d'abuser, que je généralise de généraliser, que je mets tout le monde dans le même sac. Je l’admets bien volontiers. Je sais bien qu’il ne faut pas les mettre tous dans le même panier, qu’il y a des « Justes », heureusement, comme il y a eu des « Justes » en Europe pendant la terreur nazie. Les Justes dont je parle ici ont eu le mérite, sans pour autant se retirer hors de leur temps, de résister à l’entreprise généralisée de déshumanisation des œuvres humaines. Je ne vais pas faire la liste : pour l'heure, je me la garde. J'imagine que chacun a la sienne.
Qu’est-ce qu’ils ont fait, ces héros, pour figurer dans cette sorte de panthéon que je me suis constitué ? Ou plutôt, de quoi se sont-ils abstenus ? A quoi ont-ils résisté ? Dit autrement : qu’est-ce que je leur reproche, à la fin, à tous les foutriquets de l’art contemporain, de la musique contemporaine ? J’ai tourné et retourné la question dans tous les sens. J’ai fini par arriver à synthétiser tous mes reproches dans un seul vocable : la DÉRISION. La même dérision, quoique dans le symbolique, que ces "marmites" tout à fait concrètes et sanglantes faisaient pleuvoir sur l’humanité blottie dans les piètres abris des tranchées à partir de 1914.
Je n’aime pas les grands mots, pleins de vent, pleins de vide et d’inconsistance. Je n’aime pas les grands mots, parce que, trop souvent, ils servent de nez rouges et de masques à des mensonges peinturlurés en vérités. Je crois cependant, en profondeur, que ce qui a tué l’humanité de l’homme au 20ème siècle s’appelle la dérision. La dérision concrète, la dérision symbolique, la dérision métaphorique, la dérision que vous voulez, mais … la dérision, quoi. Après tout, ce n'est même pas un "grand mot".
Mais c'est peut-être la raison, tout bien considéré, de la distance que j'ai prise avec toute la mayonnaise qui s'est accumulée autour de cette "Pataphysique" qui m'avait si longtemps attiré : il y a en effet une grande dérision à soutenir le principe de « l'identité des contraires ». Je considère que l'identité des contraires est, tout bien considéré, l'idéologie dominante qui chapeaute tout le 20ème siècle. Il faut être singulièrement dans le déni de l'humanisme pour penser que "tout se vaut". J'ai fini par choisir. Or, choisir, c'est éliminer. Moi, je choisis l'humanisme et les Lumières. Il n'y a pas de mythe de rechange pour sauver l'humanité.
Je pense ici à Denis Vasse, un jésuite qui peut se vanter d'avoir marqué, fût-ce très temporairement, mon parcours (lire L'Ombilic et la voix, ce « roman » (c'est faux, bien sûr, mais) extraordinaire, qui raconte la "naissance" d' "Hector", enfant autiste), qui avait intitulé son séminaire de 1978 au Centre Thomas More, au couvent de La Tourette (oui, celui du Corbusier), « VIOLENCE ET DERISION ». Il y parlait de psychanalyse, mais de façon vaste et percutante. Et à voir l'ensemble du siècle, il me semble qu'on peut généraliser. Le 20ème siècle, qu'on se tourne vers l'économie, vers la politique ou vers les arts, est le grand siècle de la DÉRISION à l'encontre de l'homme (je vois finalement beaucoup de dérision dans cette oeuvre de James Joyce devenue intouchable à force de sacralité moderniste : Ulysse).
très temporairement, mon parcours (lire L'Ombilic et la voix, ce « roman » (c'est faux, bien sûr, mais) extraordinaire, qui raconte la "naissance" d' "Hector", enfant autiste), qui avait intitulé son séminaire de 1978 au Centre Thomas More, au couvent de La Tourette (oui, celui du Corbusier), « VIOLENCE ET DERISION ». Il y parlait de psychanalyse, mais de façon vaste et percutante. Et à voir l'ensemble du siècle, il me semble qu'on peut généraliser. Le 20ème siècle, qu'on se tourne vers l'économie, vers la politique ou vers les arts, est le grand siècle de la DÉRISION à l'encontre de l'homme (je vois finalement beaucoup de dérision dans cette oeuvre de James Joyce devenue intouchable à force de sacralité moderniste : Ulysse).
Pas étonnant que le 20ème siècle soit en même temps, le grand siècle de la VIOLENCE. Et en ce début de nouveau siècle, ça ne semble pas près de s'arranger.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, peinture, musique, art abstrait, bande dessinée, maurice tillieux, gil jourdan, popaïne et vieux tableaux, alfred jarry, linteau minutes de sable mémorial, l'art pour l'art, pierre boulez, karlheinz stockhausen, denis vasse, violence et dérision, psychanalyse, l'ombilic et la voix, james joyce, ulysse joyce, andré boucourechliev, quatuor ysaÿe, pataphysique, docteur faustroll, identité des contraires
jeudi, 05 novembre 2015
NE PAS DERANGER

******************************************************
Hommage à René Girard, qui vient de rendre son tablier, qui a fini par se résoudre à plier ses cannes. Je n'oublierai pas le choc tectonique que fut pour moi la lecture de La Violence et le sacré, d'une érudition ébouriffante. C'était dans les années 1970. Même si on peut être agacé par la prétention de l'auteur à donner à sa théorie du désir mimétique, et sur un ton de certitude péremptoire, une dimension tellement englobante que Freud, avec toute sa psychanalyse, pouvait aller se rhabiller.
09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaston lagaffe, andré franquin, bande dessinée, humour, spirou, littérature, anthropologie, rené girard, la violence et le sacré, mensonge romantique et vérité romanesque, des choses cachées depuis la fondation du monde, sigmund freud, psychanalyse
vendredi, 16 octobre 2015
BEETHOVEN ÜBER ALLES
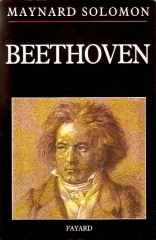 1/2
1/2
C’est très curieux, le hasard : je me remets à ce modeste compte rendu de bouquin, juste après avoir visionné sur le youtube quelques scènes du film Léon, de Luc Besson (bof !). J’avais complètement oublié que certaines étaient accompagnées de fragments du quatrième mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven (« Freunde, nicht diese Töne, sondern lasst uns … »). Je n’en tire aucune conclusion.
Après avoir lu le formidable « portrait » de Bach (Jean-Sébastien) par John Eliot Gardiner, je me suis dit qu’il était temps de combler une lacune, et j’ai attaqué la biographie de Beethoven (Ludwig van) qui dormait debout dans mes rayons depuis lurette, en me préparant à éprouver un plaisir égal.
Le livre de Maynard Solomon (Beethoven, Fayard, 2003) souffre malheureusement de l’aridité intrinsèque à tout travail universitaire, conçu et mis en œuvre avec le plus grand sérieux et une rigueur impeccable, mais dépourvu de cette vibration intérieure où transparaît l’amour de l’auteur pour son sujet. Une vibration qui sourd à chaque page de Musique au château du ciel, de Gardiner, qui ne se proposait pas, il est vrai, d’écrire une biographie canonique du cantor de Leipzig.
Ce que je reprocherai, en outre, au livre de Maynard Solomon, c’est de se perdre dans des considérations oiseuses : qu’il s’agisse du « Testament de Heiligenstadt », du fantasme d’une ascendance aristocratique voire royale, de l’identité de « L’immortelle bien-aimée » ou des mésaventures du compositeur dues à son neveu Karl, dont il avait assumé la tutelle à la mort de son frère pour l’arracher à l’emprise de sa maudite belle-sœur Johanna, il me semble très vain de se lancer à la recherche de l’ultime vérité. Peu me chaut (pour être poli) dans le fond d’apprendre que la dite bien-aimée s’appelle Antonie Brentano, à laquelle l’auteur consacre tout de même un chapitre entier (quarante pages).
Je suis d’accord, le projet biographique s’assigne le but de reconstituer le parcours d’une existence particulière dans l’ensemble de son déroulement. Faut-il pour autant vouloir en résoudre à tout prix des énigmes qui sont, à tout prendre, de la même espèce que le « Masque de fer » ou « Louis XVII », tout juste bonnes à jouer le rôle de « marronniers » dans des magazines en mal de copie ? Le biographe est-il un médecin-légiste ? Il est vrai qu’il est plus difficile de restituer vivante la vie du grand homme, que d'en disséquer le cadavre.
De même, je ne suis pas sûr qu’il faille faire une psychanalyse posthume de Beethoven, même sans trop appuyer. C’était déjà le cas dans le petit Le Dernier Beethoven (Gallimard, 2001), de Rémy Stricker. Oui, le fils et son père alcoolique, oui, le célibataire endurci toujours à la recherche tantôt de la compagne idéale, tantôt d’un fils (le neveu), tantôt d’une famille stable et aimante, réalités qui, dans le cas de Beethoven, avancent comme l’horizon qu’on essaie d’atteindre. Et alors ?
Enfin, très studieusement, le dernier chapitre de chacune des quatre parties est intitulé « La musique ». J’imagine qu’il est bien difficile de faire autrement, mais ce choix méthodologique interpose un écran entre l’homme et l’œuvre. Ce qui m’aurait intéressé, c’est d’être mis sur la piste du génie : qu’est-ce qui fait que les plus grandes œuvres de Beethoven font figure, encore aujourd’hui, de sommets indépassables ? Est-ce simplement dû aux prouesses et inventions techniques du compositeur dans l’architecture, les formes et l’écriture musicale ? Est-il utopique de chercher à percer le mystère de la voix que Beethoven entendait, et qui lui dictait ce qu’il écrivait ? Voilà un objectif qui vaut la peine de se donner la peine.
Oui, si Beethoven est un génie de la musique, il doit être possible à un biographe de permettre au lecteur de toucher du doigt cette vérité. Pour Maynard Solomon, cela va tellement de soi qu'il ne juge pas utile de détailler. Dommage.
Reste que, si j'ai l'air de ne pas apprécier le livre, je dois reconnaître qu'il fait le tour de la question : la bibliographie montre que l'auteur connaît tout de la question beethovénienne. Qu'a-t-on le droit de reprocher à quelqu'un qui a fait son boulot avec pour souci premier la précision et l'exactitude ?
J'exprime aujourd'hui une frustration. Promis, demain je me rattrape.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, littérature, ludwig van beethoven, luc besson léon, beethoven neuvième symphonie, john eliot gardiner, jean-sébastien bach, musique au château du ciel, maynard solomon beethoven, maynard solomon, testament de heiligenstadt, immortelle bien-aimée, rémy stricker, stricker le dernier beethoven, psychanalyse
mardi, 13 octobre 2015
LES ÂNERIES DE TISSERON

Nous sommes en compagnie de M. Serge Tisseron, psychanalyste qui, dans les colonnes du Monde, étrille les « intellectuels » en leur reprochant de n'être plus d'aucun poids pour influer sur l'époque.
2/2
Comment le monsieur voit-il les choses ? A sa façon. Et ça vaut le coup de le citer en longueur : « Or le monde a changé. Il n’est justement plus binaire, il est devenu multiple, et fondamentalement instable. Ce ne sont plus seulement les idéologies qui se succèdent à un rythme accéléré, ce sont les situations économiques, politiques et militaires. Les idéologies suivent, s’adaptent, se métissent. Ce ne sont plus elles, et les intellectuels qui prétendent en être les garants, qui impulsent les actions. Aujourd’hui, l’extrême fragmentation des rapports de force entre entité politique ou idéologique rend impossible la délimitation d’affrontements entre des forces clairement identifiées et circonscrites ».
Si vous pouvez tirer une vision claire de ce joyeux mélange de clichés, faites-moi signe. J’apprécie particulièrement ces idéologies qui "se succèdent", "s’adaptent" et, surtout, "se métissent". Je pose la question : qu'est-ce qu'une idéologie métissée ? Et je passe sur la faute de français (« rapports de force entre entité » : quand quelque chose est "entre", ce qui suit est au moins deux, comme le montre l’occurrence suivante dans la citation), qui révèle au moins, disons ... un flou notionnel.
Il évoque ensuite les « progrès technologiques qui évoluent à une vitesse exponentielle » (Tisseron aime tant le mot "exponentiel" qu'il le répète deux paragraphes plus loin). Est-ce la numérisation de tout, l’informatisation et la robotisation galopantes qu’il a en tête ? Il faudrait alors commencer par démontrer que ce sont des progrès, ce qui n'est pas sûr du tout.
De plus, affirmer que les progrès technologiques avancent à une vitesse exponentielle est une bêtise et un abus de langage : l'apparente évolution actuelle découle de l'exploitation tous azimuts et de l'application aux domaines les plus divers d'une innovation décisive (numérisation, puis robotisation). Quant à la « vitesse exponentielle », s’agissant du monde tel qu’il va, j’ai un peu de mal à l’envisager. Je vois surtout un bolide lancé à toute allure sur l’autoroute, de nuit et dans le brouillard. Mais ça ne l’inquiète pas : il est au spectacle. Dans le brouillard ! Trop fort, Serge Tisseron !
La preuve, c’est qu’il ajoute ensuite : « L’atomisation des rapports de force et le métissage des idéologies [encore lui !] sont d’abord à considérer comme un effet des bouleversements technologiques, de leur intrication croissante, et des nouveaux paysages économiques et politiques qui en découlent ». J’ai l’impression que Tisseron est installé dans son laboratoire et que, de là, il regarde le monde comme une gigantesque éprouvette dans laquelle est en train de se faire une expérience inédite, mais passionnante. Il est impatient d’en observer le résultat, tout en avouant dans le même temps qu'il ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. A se demander s'il en pense quelque chose.
Puis il reproche à Régis Debray d’oublier dans le débat actuel une phrase qu’il a écrite, une des rares qui aient retenu sa considération : « … nous finissons toujours par avoir l’idéologie de nos technologies », et de : « … ne voir aucune idéologie de remplacement à celles que les naufrages du XX° siècle ont englouties, aucune nouvelle "religion" ne pointant son nez à l’aube du XXI° siècle ». D’abord, pour ce qui est de la religion, je ne sais pas ce qu’il lui faut : d’accord, l’islam n’est pas vraiment nouveau, mais l'élan conquérant qui l’anime actuellement est pour le coup une vraie nouveauté.
Ensuite, je dirai juste qu'en matière d'idéologie de remplacement, l'humanité actuelle est servie : que faut-il à Serge Tisseron pour qu'il ne voie pas que la course en avant effrénée de la technique est en soi un idéologie ? Je rappelle que le propre d'une idéologie se reconnaît d'abord à ce qu'elle refuse de se reconnaître comme telle, ce qui est bien le cas du discours des fanatiques de l'innovation technologique. Et les « transhumanistes » (adeptes de la fusion homme-machine) vont jusqu'à ériger cette idéologie en utopie.
Quant aux idéologies du 20ème siècle (grosso modo communisme et nazisme, ajoutées aux grandes religions monothéistes), héritières des utopies du 19ème, il omet de préciser qu’elles contenaient et proposaient de grands projets pour l’humanité. Or l’humanité actuelle semble bel et bien avoir abandonné tout effort pour élaborer un quelconque projet lui dessinant un avenir. Pas forcément un mal, vu les catastrophes qui en ont découlé dans le passé. Mais pour laisser place à quoi ? Au libre affrontement des forces en présence.
Où prendrait place un tel projet, sur une planète qui est un champ de bataille autour des ressources ; un champ de bataille qui voit s'affronter des nations prises dans une compétition généralisée, sorte de « guerre de tous contre tous » ? Quand l'heure est à la lutte pour la conquête ou pour la survie, rien d'autre ne compte que le temps présent. Le temps de l'appétit ou de l'angoisse (manger pour ne pas être mangé). Et vous n'avez pas le choix. Comme dit Jorge Luis Borges, je ne sais plus dans laquelle de ses nouvelles : « Il faut subir ce qu'on ne peut empêcher ».
La seule idéologie, la seule religion si l’on veut, qui continue à faire luire à l’horizon une lueur d’espoir dans la nuit de l’humanité, c’est précisément la foi dans les technologies : « … la génomique, la robotique, la recherche en intelligence artificielle et les nanotechnologies ». Je crois quant à moi que les adeptes de cette religion sont des fous furieux, qui ne font qu'accélérer la course à l'abîme.
Mais Tisseron se garde bien de dire ce qu’il en pense. Que pense-t-il des théoriciens du « transhumanisme » et de leurs partisans, qui s’agitent fiévreusement quelque part dans la Silicon valley, en vue de l'avènement de l'homme programmable ? On ne le saura pas : l’auteur réserve pour une autre occasion l’expression de son jugement.
« Car le monde est en train d’échapper aux intellectuels de l’ancien monde », affirme fièrement l’auteur de l’article. L’objection que je ferai à Serge Tisseron sera globale : à quel haut responsable politique, à quel grand scientifique, à quelle grande conscience morale le monde actuel n’est-il pas en train d’échapper ? Tout le monde, à commencer par les décideurs, a « perdu toute prise sur notre époque » (cf. titre). Le temps est fini des grands arrangements entre puissances. Plus personne ne sait quelle créature va sortir du chaudron magique, en fin de cuisson.
Pas besoin d’être un « intellectuel », qu’il soit de l’ancien ou du nouveau monde. Car ce qui apparaît de façon de plus en plus flagrante, c’est que plus personne n’est en mesure de comprendre le monde tel qu’il est. Le monde est en train d’échapper à tout contrôle. D’échapper à l’humanité. Ce que Serge Tisseron n’a peut-être pas très envie de regarder en face. La planète semble aujourd’hui, plus que jamais auparavant, un bateau ivre.

Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, vu par le grand Aristidès (Othon Frédéric Wilfried), dit Fred.
Serge Tisseron se trompe de cible. Cet intellectuel a donc perdu une bonne occasion de la boucler.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal le monde, serge tisseron, les intellectuels, rabelais, gargantua, jean-paul sartre, pierre bourdieu, michel foucault, alain finkielkraut, michel onfray crépuscule d'une idole, régis debray, éric zemmour, laurent ruquier, onpc, on n'est pas couché, sigmund freud, secrets de famille, tintin et milou, hergé, psychanalyse, jorge luis borges, transhumanistes, bande dessinée, fred philémon, arthur rimbaud
jeudi, 24 septembre 2015
L'HOMME OBSOLÈTE
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 4
Sur la bombe et les causes de notre aveuglement face à l’Apocalypse
La remarque la plus étonnante – la plus amusante si l’on veut – qu’on trouve dans ce dernier essai composant L’Obsolescence de l’homme, se trouve p. 283. C’est le titre du §8 : « L’assassin n’est pas seul coupable ; celui qui est appelé à mourir l’est aussi ». Il se trouve que j’étais en train de lire Maigret et le clochard. Les hasards de l’existence … On lit en effet au chapitre IV ce petit dialogue entre M. et Mme Maigret : « – Les criminologistes, en particulier les criminologistes américains, ont une théorie à ce sujet, et elle n’est peut-être pas aussi excessive qu’elle en a l’air … – Quelle théorie ? – Que, sur dix crime, il y en a au moins huit où la victime partage dans une large mesure la responsabilité de l’assassin ». Le rapprochement s’arrête évidemment à cette coïncidence.
Günther Anders analyse ici les implications et significations de la bombe atomique. Il reprend une idée exprimée dans Sur la Honte prométhéenne : « Nous lançons le bouchon plus loin que nous ne pouvons voir avec notre courte vue » (p.315). Autrement dit, nous agissons sans nous préoccuper des conséquences de nos actes, et nous inventons des choses qui finissent par nous dépasser, voire se retourner contre nous.
Je me contenterai de picorer ici des réflexions qui m’ont semblé intéressantes. D’abord cette idée que, aujourd’hui, « c’est nous qui sommes l’infini », qui dit assez bien ce que la bombe, fruit de l’ingéniosité humaine, a d’incommensurable avec l’existence humaine : nous éprouvons désormais « la nostalgie d’un monde où nous nous sentions bien dans notre finitude ».
Faust est mort, dit l’auteur, précisément parce qu’il est le dernier à se plaindre de sa « finitude ». Je ne sais plus où, dans le Second Faust, le personnage s’adresse à Méphisto : « Voilà ce que j’ai conçu. Aide-moi à le réaliser ». Notons au passage qu’aux yeux de Goethe, c’est la technique en soi qui a quelque chose de diabolique, puisque c’est Méphisto qui l’incarne.
Une autre idée importante, je l’ai rencontrée récemment dans la lecture de La Gouvernance par les nombres d’Alain Supiot (cf. ici, 9 et 10/09) : ce dernier appelle « principe d’hétéronomie » l’instance d’autorité qui, surplombant et ordonnant les activités des hommes, s’impose à tous. Or ce principe, dans une civilisation dominée par la technique, tend à devenir invisible, conférant alors au processus lui-même une autorité d’autant plus inflexible qu’elle n’émane pas d’une personne. Ce qui fait que la finalité de la tâche échappe totalement à celui qui l’accomplit, avec pour corollaire : « Personne ne peut plus être personnellement tenu pour responsable de ce qu’il fait » (p.321).
C’est aussi dans le présent essai qu’on trouve le chapitre intitulé « L’homme est plus petit que lui-même ». Je ne reviens pas en détail sur cette idée formidable, qui développe d’une certaine manière les grands mythes modernes suscités par la créature du Dr Frankenstein (Mary Shelley) ou par le Golem (Gustav Meyrink) : l’homme, en déléguant sa puissance à la technique, a donné naissance à une créature qui lui échappe de plus en plus. Avec pour conséquence de multiplier les risques pour l’humanité : « Ce qui signifie que, dans ce domaine, personne n’est compétent et que l’apocalypse est donc, par essence, entre les mains d’incompétents » (p.301). Autrement dit, l’humanité a construit un avion pour lequel il n’existe pas de pilote.
Je signale une expression qui m’a aussitôt fait penser à Hannah Arendt : « cette horrible insignifiance de l’horreur » (p.304).
Pour terminer, ce passage (l'auteur vient d'évoquer Les Frères Karamazov) : « Accepter que le monde qui, la veille encore, avait un sens exclusivement religieux devienne l’affaire de la "physique" ; reconnaître, en lieu et place de Dieu, du Christ et des saints, "une loi sans législateur", une loi non sanctionnée, sans autre caution que sa seule existence, une loi absurde, une loi ne planant plus, « implacablement », au-dessus de la nature, bref la « loi naturelle » – ces nouvelles exigences imposées à l’homme de l’époque, il lui était tout simplement impossible de s’y plier » (p.333). Le « Système technicien » (Jacques Ellul) s’est autonomisé. L’homme se contente de suivre la logique de ce système, de se mettre à son service pour qu’il se développe encore et toujours et, pour finir, de lui obéir aveuglément.
Au total, un livre qui secoue pas mal de cocotiers.
Voilà ce que je dis, moi.
FIN
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer, maigret, georges simenon, maigret et le clochard, la banalité du mal, goethe, méphisto faust, alain supiot
mercredi, 23 septembre 2015
L'HOMME OBSOLÈTE
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 3
Le Monde comme fantôme et comme matrice
Le monde qu’analyse cet essai est celui de la médiatisation triomphante de tout. Günther Anders parle seulement de la radio et de la télévision, mais je suis sûr qu’il ne verrait aucun obstacle à étendre ses analyses aux médias qu’une frénésie d’innovation technique a inventés depuis son essai (1956). Aujourd’hui, tout le monde est « connecté », au point qu’être privé de « réseau » peut occasionner de graves perturbations psychologiques.
Il commence par nier la valeur de l’argument habituel des défenseurs de la technique face à ceux qui s’indignent de certains « dommages collatéraux » : ce n’est pas la technique qui est mauvaise, ce sont les usages qu’on en fait (air connu). Cet argument rebattu fait semblant d’ignorer que « les inventions relèvent du domaine des faits, des faits marquants. En parler comme s’il s’agissait de "moyens" – quelles que soient les fins auxquelles nous les faisons servir – ne change rien à l’affaire » (p.118).
Notre existence, dit-il, ne se découpe pas en deux moitiés séparées qui seraient les « fins » d’une part, les « moyens » d’autre part. L’ « individu », par définition, ne peut être coupé en deux (cf. le jugement de Salomon). L’argument n’a l’air de rien, mais il est puissant. Conclusion, il est vain de se demander si c’est la technique qui est mauvaise en soi, ou les usages qui en sont faits ensuite : une poêle sert à griller des patates, elle peut servir à assommer le voisin qui fait du bruit à deux heures du matin.
Pour qui est familiarisé avec les critiques lancées contre la télévision dans la dernière partie du 20ème siècle, le propos de Günther Anders compose un paysage connu. Les Situationnistes en particulier, à commencer par Guy Debord, ont constamment passé dans leur moulinette virulente la « société spectaculaire-marchande ». Il n’est d’ailleurs pas impossible que Debord (La Société du spectacle date de 1967) ait picoré dans l’essai d’Anders (paru en 1956).
Si les films, marchandises standardisées, amènent encore les masses à se réunir dans des salles pour assister collectivement à la projection, la télévision semble livrer le monde à domicile. Pour décrire l’effet produit par ce changement, Anders a cette expression géniale : « Le type de l’ "ermite de masse" était né ». « Ermite de masse » est une trouvaille, chacun étant chez soi, en quelque sorte, « ensemble seul ».
On peut ne pas être d’accord avec l’auteur quand il met exactement sur le même plan radio et télévision, car la réception d’images visuelles change pas mal de choses. Le point commun réside dans l’action de médiatisation : l’écran de télévision, et dans une moindre mesure le poste de radio, littéralement, « font écran » entre le spectateur et la réalité concrète du monde, qui du coup n’est plus l’occasion d’une expérience individuelle par laquelle chacun teste sa capacité d’action sur celle-ci.
L’auteur le dit : le monde, qui est servi « à domicile », n’est plus que le « fantôme » de lui-même : « Maintenant, ils sont assis à des millions d’exemplaires, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas pour fuit le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde "en effigie" ». L’exagération ne peut toutefois s’empêcher de ressurgir : « Chaque consommateur est un travailleur à domicile non rémunéré [il faudrait même dire "payant"] qui contribue à la production de l’homme de masse ». Mais on a bien compris l’idée.
Autrement intéressante est l’idée que radio et télévision induisent l’établissement, entre la source et le récepteur (entre les animateurs du spectacle et les auditeurs et téléspectateurs) une « familiarité » pour le moins étrange, qui semble tisser entre eux des liens de proximité immédiate, du seul fait que ces voix semblent s’édresser à eux personnellement. On pense ici à tout ce que peuvent déclarer de charge affective et d’identification les consommateurs quand ils s’adressent aux animateurs par oral ou par écrit. De plus, ces liens apparents entraînent une relative déréalisation des proximités concrètes (exemple p. 148-149). Ces liens sont en réalité une grande imposture qui fait que l’ « individu devient un "dividu" » (p.157). C’est bien trouvé.
Anders évoque aussi l’espèce d’ubiquité que produit le média et la schizophrénie artificiellement produite qui en découle. S’il voyait aujourd’hui avec quelle attention fascinée passants, clients de terrasses de bistrots et passagers du métro fixent l’écran de leur téléphone, même marchant ou en compagnie, il serait encore plus catastrophé par le monde que les hommes ont continué à fabriquer.
Faisant semblant d’être ici (puisqu’ils « communiquent » et sont « connectés ») et faisant semblant d’être ailleurs (pour les mêmes raisons !), ils constituent une sorte d’humanité « Canada dry », cette boisson qui « ressemble à de l’alcool, mais ce n’est pas de l’alcool ». Voilà : ça ressemble à de l’humanité, mais ce n’est pas de l’humanité. L’incessante innovation technique au service de la marchandise tient l’humanité en laisse.
Je n’insiste pas sur le conditionnement du désir, en amont de la manifestation d’une volonté et d’une liberté, pour orienter celui-ci sur des marchandises. Je n’insiste pas sur le caractère impérieux, voire vaguement totalitaire, de cette façon d’imposer une représentation du monde (une idéologie) : « Que ma représentation soit votre monde » (p. 195), façon plus sophistiquée que celle qu’Hitler utilisait pour formater les esprits. Günther Anders suggère que le règne de la radio et de la télévision produit un autre totalitarisme.
L’essai Le monde comme fantôme et comme matrice (titre pastichant Schopenauer), par sa radicalité dans l’analyse de la radio et de la télévision, indique assez que son auteur n’attend rien de bon de l’évolution future de l’humanité et du sort que l’avenir, sous l’emprise de la technique, lui réserve.
Il serait désespéré que ça ne m’étonnerait pas. Sa réflexion, qui remonte à plus d’un demi-siècle, n’a en tout cas rien perdu de sa force.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre, guy debord, la société du spectacle, situationnistes, hitler, schopenauer
mardi, 22 septembre 2015
L’HOMME OBSOLÈTE
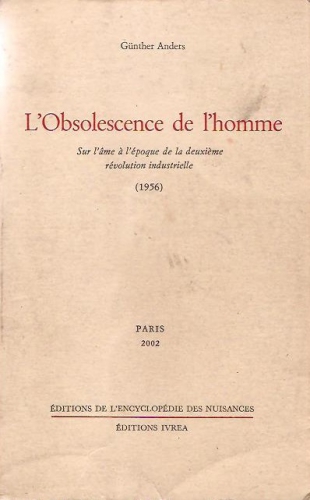 GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 2
Je disais que, selon Günther Anders, l'homme n'est plus à la hauteur du monde qu'il a fabriqué.
Sur la honte prométhéenne
Le premier essai de l’ouvrage, développe cette idée. L’auteur parle de la réaction de son ami T. lors de leur visite à une exposition technique : « Dès que l’une des machines les plus complexes de l’exposition a commencé à fonctionner, il a baissé les yeux et s’est tu ». Il va jusqu’à cacher ses mains derrière son dos. L'auteur en déduit que T. est saisi de honte devant tant de perfection, honte motivée par la cruauté de la comparaison entre l’organisme humain, fait d’ « instruments balourds, grossiers et obsolètes » et des « appareils fonctionnant avec une telle précision et un tel raffinement ».
J’imagine que certains trouveront gratuite l’interprétation de l’attitude de T., mais je pense à une page de Zola (L’Assommoir ?), où Coupeau et Gervaise visitent une usine, page où Zola décrit les machines comme douées de vie propre, alors que les visiteurs semblent rejetés hors de l’existence. Et Coupeau, abattu et découragé après une bouffée de colère contre les machines, de conclure : « Ça vous dégomme joliment, n’est-ce pas ? ». C’est bien une réaction du même genre.
Moralité : l’homme est « inférieur à ses produits ». J’avoue que je me tapote le menton quand il énonce : « Avec cette attitude, à savoir la honte de ne pas être une chose, l’homme franchit une nouvelle étape, un deuxième degré dans l’histoire de sa réification ». Mais après tout, quand on sait ce que suppose l’apprentissage des gestes sportifs et la discipline requise dans les sports de haut niveau aujourd’hui, on est obligé de se dire que le corps des plus grands champions que les foules vénèrent s'est peu ou prou mécanisé.
Il est de notoriété publique que l’industrie européenne a été amplement délocalisée dans les pays à bas coût de main d’œuvre. Et que quand on parle aujourd’hui de « relocalisation industrielle », c’est pour installer des usines entièrement robotisées, où une quinzaine d’humains suffisent pour surveiller et maintenir en état, quand l’installation précédente, avant délocalisation, avait besoin de plusieurs centaines d’ouvriers. Et Günther Anders a publié L’Obsolescence … en 1956 ! L’homme devient l’accessoire de la machine.
De même, l’auteur attige quand il affirme : « … les choses sont libres, c’est l’homme qui ne l’est pas ». De même : « Il espère, avec leur aide, obtenir son diplôme d’instrument et pouvoir ainsi se débarrasser de la honte que lui inspirent ses merveilleuses machines ». C’est la qu’on voit à l’œuvre la méthode de « l’exagération ». Il y a visiblement, dans cette façon de prendre les perceptions ordinaire à rebrousse-poil, un goût du paradoxe et un désir de provoquer.
Il n’empêche que, quand on prend conscience de l’emprise de plus en plus grande des machines sur le cadre et les conditions de notre vie, on se dit que les caricatures et hyperboles formulées par Günther Anders recèlent leur part de vérité. Il est assez juste de soutenir comme il le fait que l’homme « n’est plus proportionné à ses propres productions », même si ce qu’il dit un peu plus loin de « l’hybris » (démesure, orgueil) le conduit à tenir un raisonnement alambiqué.
Ce qui reste très étonnant malgré tout dans la lecture de « Sur la honte prométhéenne », c’est que l’auteur pressent quelques conséquences de la frénésie d’innovation technologique. Je pense au clonage, évoqué indirectement dans un très beau passage : « Mais si on la considère en tant que marchandise de série, la nouvelle ampoule électrique ne prolonge-t-elle pas la vie de l’ancienne qui avait grillé ? Ne devient-elle pas l’ancienne ampoule ? Chaque objet perdu ou cassé ne continue-t-il pas à exister à travers l’Idée qui lui sert de modèle ? L’espoir d’exister dès que son jumeau aura pris sa place, n’est-ce pas une consolation pour chaque produit ? N’est-il pas devenu "éternel" en devenant interchangeable grâce à la reproduction technique ? Mort, où est ta faux ? » (p.69). Devenir éternel en devenant interchangeable, c’est à peu de chose près le programme du héros de La Possibilité d’une île, de Michel Houellebecq. Il suffit de remplacer par l’être humain l’objet fabriqué. Pour Anders, l’homme est inférieur puisqu’une telle immortalité lui est refusée : à son époque, le clonage était inconcevable.
Pour être franc, je ne suis guère convaincu, à l’arrivée, par le concept de « honte », qui me semble inopérant. L’expression oxymorique « honte prométhéenne » est à prendre (selon moi) pour un tour de force intellectuel, pour un jeu conceptuel virtuose si l’on veut.
Dernier point : tout le §14 est étonnamment consacré à la musique de jazz. Je ne sais pas bien à quel genre de jazz pense Günther Anders en écrivant. En 1956, la vague « be-bop » est encore bien vivante. Miles Davis (Ascenseur pour l’échafaud, 1957) et Ornette Coleman (Change of the century, 1959) vont bientôt donner quelques coups de fouet à cette musique. Inutile de dire que le développement est fait pour choquer l’amateur de jazz, à commencer par celui (dont je suis) qui préfère les petites formations fondées sur le trio rythmique, éventuellement augmenté d’un ou plusieurs « souffleurs », où les uns et les autres ne cessent de se relancer, de se répondre et de se stimuler.
Le §14 est intitulé « L’orgie d’identification comme modèle du trouble de l’identification. Le jazz comme culte industriel de Dionysos » (p.103). Je me demande ce qui prend à l’auteur d’affirmer : « La "fureur de la répétition", qui neutralise en elles tout sentiment du temps et piétine toute temporalité, est la fureur du fonctionnement de la machine » (p.104). Je me dis pour l’excuser que la techno n’existait pas : il faut avoir assisté (je précise : par écran interposé !) à une « rave party » pour avoir une idée modernisée de ce qu’est le « culte industriel de Dionysos ».
Désolé, M. Anders, rien de moins machinal que le jazz auquel je pense.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les origines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique, sur la honte prométhéenne, zola l'assommoir, coupeau gervaise, michel houellebecq, la possibilité d'une île, jazz, miles davis, ascenseur pour l'échafaud, ornette coleman, change of the century, geaorges brassens, un 22 septembre
lundi, 21 septembre 2015
L’HOMME OBSOLÈTE
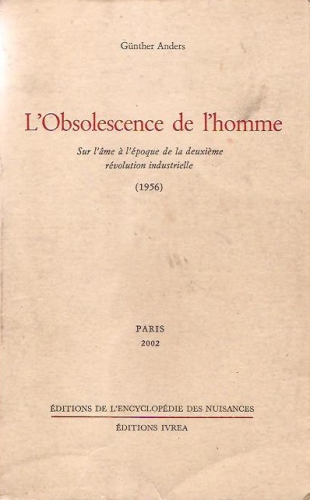 GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 1
GÜNTHER ANDERS : L’OBSOLESCENCE DE L’HOMME 1
L’Obsolescence de l’homme, (éditions de l’Encyclopédie des Nuisances + éditions Ivréa, Paris, 2002) du philosophe Günther Anders, voilà un livre qui m’a donné du fil à retordre (comme le montre ci-contre l'état de la couverture). Mais un livre important.
L’idée surgit au 20ème siècle : l’homme est désormais « de trop ». La preuve, l'homme (pas le même) est capable de l’éliminer en masse de 1914 à 1918, puis de 1939 à 1945. La preuve, Staline a supprimé sans doute cinquante millions de « mauvais soviétiques ». La preuve, les nazis furent les premiers industriels de la mort de populations civiles. La preuve, les Américains ont effacé de la surface de la Terre deux villes « ennemies », avec leurs habitants. D’autres preuves ne manquent pas, inutile d’énumérer.
Cette idée que l’homme a été rendu « superflu », je l’avais découverte en lisant Les Origines du totalitarisme, le grand ouvrage de Hannah Arendt. Pierre Bouretz la souligne dès son introduction (Gallimard-Quarto, 2002) : « Son horizon est un système dans lequel "les hommes sont superflus" » (p.151). Arendt enfonce le clou dans sa deuxième partie (« L’impérialisme »), attribuant à la « monstrueuse accumulation du capital » la production d’une richesse superflue et d’une main d’œuvre superflue (p.405). A deux doigts d'expliquer ainsi la concurrence colonialiste entre puissances européennes.
Je viens de trouver la même idée (pas tout à fait : "superflu" n’est pas "obsolète", mais le résultat est le même, répondant à la même question : « A quoi sers-je ? ») exprimée dans le dernier livre paru de Paul Jorion (Penser tout haut l’économie avec Keynes, Odile Jacob, septembre 2015), qui cite le célèbre économiste britannique : « Mais l’effet des machines des générations les plus récentes est toujours davantage, non pas de rendre les muscles de l’homme plus efficaces, mais de les rendre "obsolètes" » (p.94). Il écrivait cela en 1928. Que dirait-il aujourd’hui, où la numérisation bat son plein et où la robotisation avance par vent arrière et a sorti le spinnaker ?
Le livre de Günther Anders, sous-titré « Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle », publié en 1956, s’il n’invente pas la notion, la place en tant que telle au centre de la réflexion du philosophe. C’est du brutal. A noter que la notion d’ « obsolescence programmée » est inventée à la fin des années 1920, quand les fabricants d’ampoules lumineuses se rendent compte que si celles-ci sont éternelles ou presque (comme ils sont parfaitement capables de le faire), leurs entreprises ne survivront pas longtemps.
Je l’avoue : il m’arrive de lire des philosophes. J’exècre, je l’ai dit, les économistes qui jargonnent pour bien faire comprendre leur supériorité sur les gens ordinaires en usant de concepts sophistiqués et d’un vocabulaire amphigourique. C’est la même chose pour la psychanalyse : Lacan me fait rire, contrairement à quelqu’un comme Didier Anzieu, qui n’abrite pas son « autorité » derrière un sabir ou un volapük motivé selon lui par l’extrême précision technique que requiert sa discipline.
C’est encore la même chose avec les philosophes. Je ne suis pas familier de la discipline, mais il m’arrive d’en fréquenter, tout au moins parmi ceux qui me paraissent fréquentables, dans la mesure où ils écrivent pour être compris du commun des mortels, et non du seul petit cercle de leurs confrères spécialistes de la spécialité. Pour rendre intelligible leur pensée, en rédigeant en « langue vulgaire », c’est-à-dire – au sens latin – la langue « commune à tous ».
Ce qui est curieux (et qui rend la lecture tant soit peu ardue), avec le livre de Günther Anders, c’est qu’il cumule. Je m’explique. Il s’exprime dans une langue très accessible, sans toutefois s’interdire de recourir à l’occasion au dialecte propre à quelques philosophes (Hegel, Heidegger, …). Mais il accroît la difficulté : le contenu même des idées est fait pour rebuter le lecteur, dans la mesure où celui-ci se retrouve démuni et perdu, faute d’apercevoir quelques points de repère grâce auxquels il ait l’impression d’être en terrain connu. Indéniablement, on a à faire à un original authentique. L’éditeur le déclare d’entrée de jeu : si la traduction française paraît près d’un demi-siècle après l’édition allemande, « La difficulté du texte y est certainement pour quelque chose … ».
Anders (pseudo signifiant « autre », son vrai nom étant Stern) est un philosophe de toute évidence marginal, à cause de sa radicalité, et surtout à cause d’une « méthode » pour le moins idiosyncrasique. Il revendique en effet le droit à l’exagération comme méthode. Il justifie ce choix en comparant sa recherche à celles que mène un virologue, dont l’outil principal est le microscope : que serait une « virologie à l’œil nu » (encyclopédie en ligne) ?
L’argument semble d’autant plus valable qu’il soutient que ce n’est pas lui mais le monde dont il parle qui exagère : ce qu’il écrit « … n’est que l’exposé outrancier de ce qui a déjà été réalisé dans l’exagération » (p.35). Il le dit ailleurs : l’humanité a commencé à fabriquer « un monde au pas duquel nous serions incapables de marcher ». La grande idée qui traverse tout l’ouvrage est que certes, par son génie, l’homme a élaboré un monde qui tend à se rapprocher des œuvres divines, mais que, par sa nature, il en reste à jamais « pas à la hauteur ».
« L’homme est plus petit que lui-même » est d’ailleurs le titre d’un des chapitres. Le pataphysicien pense bien sûr au chapitre IX du livre II de Faustroll : « Faustroll plus petit que Faustroll ». « Tout est dans Faustroll », s’écriait d’ailleurs le docteur Irénée-Louis Sandomir (fondateur du Collège de 'Pataphysique), pour bien signifier qu’Alfred Jarry reste un grand précurseur.
L’homme n’est pas à la hauteur du monde qu’il a fabriqué à partir du 20ème siècle. Il y faudrait, comme dit Jarry, un SURMÂLE, du type d'André Marcueil.

Dessin de Pierre Bonnard pour Le Surmâle, d'Alfred Jarry.
Mais il n'y a pas de surmâle, comme le montre la baudruche appelée indûment Superman. Comme par hasard américaine.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, philosophie, günther anders, l'obsolescence de l'homme, éditions encyclopédie des nuisances, éditions ivréa, staline, hannah arendt, les rigines du totalitarisme, pierre bouretz, éditions gallimard quarto, paul jorion, penser tout haut l'écononmie avec keynes, john maynard keynes, éditions odile jacob, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, volapük, docteur faustroll, alfred jarry, gestes et opinion du docteur faustroll pataphysicien, le surmâle, andré marcueil, collège de pataphysique
mardi, 07 juillet 2015
CATHOLIQUE ET FRANÇAIS
J’ai tenté voilà quelque temps (4 mai dernier) d’expliquer comment on peut être à la fois de très-gauche et de très-droite. Très-gauche pour tout ce qui est répartition des richesses et réduction des inégalités, très-droite pour tout ce qui concerne la vie des gens dans la société. Je me demandais (en réalité, je faisais semblant, parce que) comment c’était possible. Et j'avais l'impression d'être un peu seul, très bizarre et carrément anormal. Rafael Correa vient de m’apporter un soutien de choix et la caution de son prestige.
Rafael Correa est président de l’Equateur. Je ne connais de lui ni maille ni mie. Je sais juste qu’il a reçu le pape François le 5 juillet. Un dimanche. Une messe monstre doit être célébrée aujourd'hui. Et voici ce que Correa déclare à cette occasion : « Je suis très progressiste en matière économique et sociale, très conservateur sur les sujets de société ». Bon sang mais c’est bien sûr ! On peut donc être, à la fois, "conservateur" et "progressiste". Je n'utiliserais pas ces mots, mais l'idée est là.
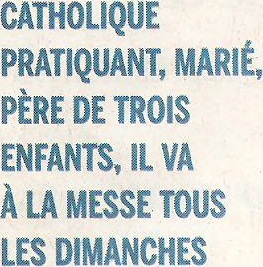
C'est ainsi qu'est présenté Rafael Correa, président de l'Equateur.
Eh oui, c’est sûrement ça : je suis catholique, et je ne le savais pas ! Je ne dis pas ça parce que j’ai la foi – si je l'avais, je le saurais, j'aurais été informé –, mais à cause de l'article publié par Le Monde (daté 7 juillet) au sujet du président de l’Equateur. J’appartiens sûrement à ces « catholiques zombies » qui ont, selon Emmanuel Todd, parcouru les artères des villes de France le 11 janvier (encore un dimanche, tiens !).
Et pourtant non : je n’ai pas marché dans les rues de Lyon le 11 janvier, monsieur Todd. J’ai été impressionné, ça oui, par la masse de ceux qui ont marché, par le silence, aussi, qui a marqué le défilé lyonnais, pas de banderoles, pas de revendications ! Mais je n’ai pas marché. Ne me demandez pas pourquoi : j’étais en deuil de Cabu et de quelques autres. Ça ne peut pas se partager.
Et pourtant, si je pense aux dernières trouvailles « sociétales » qui passent pour des « progrès », des « avancées démocratiques » décisives, dans la direction d’un parfaite « égalité » entre les individus (mariage homo, ventres féminins à louer, …), obtenus de longue lutte par les abrogateurs frénétiques des « discriminations », des « racismes », des « stigmatisations », je suis obligé de l’avouer : je suis catholique. Même si ce n’est pas vrai.
Voilà, je suis d’accord avec le président Correa, même si je ne confesse pas sa foi. Je respecte une certaine rigidité en matière de mœurs, j’éprouve de la révolte devant la montée des inégalités économiques et sociales. C’est tout, mais ça me fait plaisir de me sentir moins seul.
Et au sujet des inégalités, je dirai ceci : d'abord qu'il y en a de deux sortes. Les plus cruciales, qui conditionnent tout le reste, sont les inégalités économiques et sociales. Toutes les autres (inégalités multiples), par rapport à ça, c'est de la roupie de sansonnet.
Je me rappelle ce petit bouquin par lequel Pierre Rey achevait sa psychanalyse, Une Saison chez Lacan. Sa dette chez le maître était montée à haute altitude. Son insolvabilité devenue trop inconfortable, il décida d'écrire un best-seller. L'argent qu'il se mit à gagner lui permit de solder toutes ses dettes, et même au-delà. Il en avait tiré cet enseignement : les gens riches sont plus libres que les gens pauvres. Plus un monde sera inégalitaire, plus il favorisera la violence. C'est mon opinion, et je la partage.

Je suis moins préoccupé par l’établissement d’une égalité parfaite entre les citoyens jusque dans les moindres recoins de l'existence sociétale, que par la résurgence incroyable des inégalités économiques et sociales, parfois abyssales. J’ai moins la passion de l’égalité en toutes matières que je n’éprouve la rage devant les inégalités triomphantes qui s’affichent de plus en plus « décomplexées » et arrogantes, au gré des démissions de plus en plus empressées et serviles des pouvoirs politiques devant les pouvoirs économiques et financiers.
Voilà le secret de la chose. Si je peux me revendiquer catholique par un attachement à la tradition dans laquelle j’ai grandi, ce n’est pas par amour de l’égalité, mais par haine des inégalités indues, injustes, injustifiées, intolérables. Et je suis révolté par le fait que les luttes sociales aient disparu, au profit des seules « luttes sociétales ». Pour le plus grand plaisir des puissants, qui se disent : plus il y aura de ces luttes sociétales, plus on oubliera que nous existons. C’est excellent pour nos affaires.
Les homosexuels, les féministes, les musulmans devraient réfléchir à ça, plutôt que de s’exalter pour le triomphe idéologique du minoritorat (excusez ce néologisme inélégant, qui voudrait traduire le pouvoir de nuisance acquis par toute minorité « opprimée »). Quelle merveilleuse manœuvre de diversion ! Quel beau rideau de fumée ! Quel magnifique bouclier humain se sont constitué là les puissants ! Ils se frottent les mains : plus on verra « les associations » lutter pour davantage d’ « égalités », plus ils pourront dormir sur leurs deux oreilles.
Militants homosexuels, militantes féministes, militants islamiques ou noirs, tous ces combattants-pour-les-droits, ulcérés des « discriminations » et « stigmatisations » qu’ils disent qu’ils subissent, me font l’effet d’enfants gâtés, de gosses de riches, gavés de jouets dont ils ne savent plus que faire, à qui des gens très malins et très calculateurs sont ravis de refiler des hochets qui détournent l’attention du public de l’essentiel (business, Davos, paradis fiscaux : les affaires sérieuses, quoi).
Car pendant ce temps, les vraies inégalités prospèrent, s’accroissent, se multiplient et s’aggravent. Elles caracolent là-bas, très loin hors de notre vue. Et il y a fort à parier que, plus elles caracoleront, plus les puissants verront d’un œil favorable les appels à combattre l’homophobie, le sexisme, le racisme ou l’islamophobie.
Une façon d'aller vers la guerre. Et peut-être de la souhaiter.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catholique et français, progressiste, conservateur, réactionnaire, extrême-droite, extrême-gauche, rafael correa, pape françois, président équateur, journal le monde, catholiques zombies, emmanuel todd, attentat charlie hebdo 7 janvier, 11 janvier, cabu, charlie hebdo, wolinski, bernard maris, discrimination, stigmatisation, racisme, grèce, alexis tsipras, pierre rey, jacques lacan, psychanalyse, angela merkel, hergé, tintin, dupont dupond
vendredi, 15 mai 2015
IL Y A DU TOTALITAIRE ...
... DANS LA STATISTIQUE
1/2
A quoi servent les statistiques ? Est-ce seulement ce merveilleux outil de connaissance, qui permet de mettre en lumière des aspects de la réalité inaccessibles à la simple perception individuelle ? Faits sociaux, situations politiques, données économiques, recherches scientifiques, les statistiques font partie intégrante de notre monde, dans tous les domaines qui concernent (de très près ou de très loin) notre vie quotidienne.
Non, elles ne sont pas seulement un outil de connaissance : elles sont aussi un outil de gouvernement. Un outil qui peut se révéler terrible à l'usage. Il en est d'ailleurs ainsi pour les sciences humaines : inutile sans doute de s'appesantir sur l'utilisation des avancées dans la connaissance du psychisme humain par la publicité, par la propagande et par toutes les techniques de manipulation mentale. Vous vous rendez compte : sans Sigmund Freud, pas de Scientologie. Pas d'agressions Coca-Cola par panneaux 4 m. x 3. Pas de surréalisme. « Que la vie serait belle en toute circonstance Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards » (Tonton Georges a toujours raison).
Les statistiques sont donc entrées dans les mœurs. Il faudrait même dire : « Dans les têtes », tant chacun a désormais intériorisé la notion abstraite de « catégorie de la population », dans laquelle, à force de bourrage de crâne, il tend aujourd’hui à se ranger spontanément, sans qu’un seul flic lui en ait seulement intimé l’ordre.
Qu’il le veuille ou non, chacun a désormais une connaissance statistique de lui-même. Chacun est prié de s'éprouver non plus à partir de ses confrontations concrètes à des réalités contondantes ou suaves, mais par le médium infaillible des chiffres élaborés par des experts dont la science le dépasse de trop loin. Chacun est prié d'acquérir une connaissance objective de lui-même. Les statistiques portent le négationnisme de la subjectivité. C'est en cela qu'elles sont porteuses du germe totalitaire.
Chaque jour, journalistes, économistes, politiciens, « experts » et « spécialistes » produisent à qui mieux-mieux, à destination de tous les individus, l’inépuisable spectacle des statistiques dans le fatras desquelles tous ces "sachants" leur intiment l’ordre de trouver leur place. Les statistiques sont la nouvelle figure de la « collectivité », de la « société ». Si ça se trouve, vous appartenez à des catégories dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. On vous définit sans vous demander votre avis. On vous assigne une identité dont vous n'avez nulle idée.
La statistique est par nature l’action de compartimenter les comportements humains en les rangeant successivement dans toutes sortes de cases soigneusement étiquetées en un nombre incalculable de catégories abstraites. La statistique a quelque chose à voir avec la dissection : il s’agit de segmenter un corps pour en étudier de plus près chacun des segments.
Evidemment, comme dans toute dissection, on n’étudie valablement que quelque chose qui fut vivant, mais qui ne l’est plus. Sinon, ça s’appelle un supplice. Premier effet des statistiques : elles font de populations de chair, d’os et d’existences concrètes des abstractions pures et simples. Autrement dit, une population statistique est une humanité chiffrée, comme l’énonce clairement le titre d’Alain Supiot, sur le blog de Paul Jorion : La Gouvernance par les nombres. L’humanité accède enfin à l’existence numérique, seule collectivité sociale aux yeux du statisticien.
Définitions : « 1 – Etude méthodique des faits sociaux, par des procédés numériques (classements, dénombrements, inventaires chiffrés, recensements, tableaux …). 2 – Ensemble de techniques d’interprétation mathématique appliquées à des phénomènes pour lesquels une étude exhaustive de tous les facteurs est impossible, à cause de leur grand nombre ou de leur complexité ».
Historique : « Statistique : n. f. et adj. est un emprunt (1771 selon F. e. w.) au latin moderne statisticus "relatif à l’Etat" (1672), formé à partir de l’italien "statistica" (1663), dérivé de "statista" (homme d’Etat), lui-même de "stato", du latin classique "status" ».
La statistique établit donc des catégories. Ça a des aspects éventuellement rigolos : on peut être « contribuable » et « automobiliste », « électeur » et « pêcheur à la ligne » (on peut s'amuser longtemps à juxtaposer les carpes et les lapins) ; on est rangé par sexe, par appartenance professionnelle, par âge, par situation géographique, que sais-je. On n’en finirait pas. Ce sont les « critères ». Le résultat de tout ça, c’est qu’on a fini par réaliser ce que Voltaire dit de l’homme vu par Micromégas : un amas d’atomes. Voilà, la statistique atomise l’humanité : vous appartenez sans le savoir à mille huit cent quatre-vingt-douze catégories de la population suivant le critère qui est retenu contre vous.
Première fonction selon moi de la statistique : quantifier à l'infini en subdivisant à l'infini. Etablir des nombres. La statistique instaure le règne des comptables sur le corps social et réduit la vie sociale à une gestion bureaucratique. Elle établit une dichotomie rigoureuse entre sujet et objet, étant entendu que, pour le statisticien, personne n'est une personne, vu qu'il n'y a que des objets.
Elle vous apprend qu’au 1er janvier 2015, la France comptait 32.126.316 hommes et 34.191.678 femmes. Soit dit en passant, on voit que la statistique établit clairement que la génétique se moque éperdument de la parité entre les sexes et de l'égalité hommes-femmes.
On en pense ce qu'on veut.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : totalitaire, totalitarisme, statistique, sciences humaines, publicité, propagande, manipulation mentale, journalisme, presse, politique, société, paul jorion, alain supiot, la gouvernance par les nombres, voltaire, micromégas, recenssement, georges brassens, sigmund freud, psychanalyse, scientologie, coca-cola, surréalisme
dimanche, 23 février 2014
AUX CHIOTTES LES NORMES !
Résumé : après avoir remarqué que la théorie du « genre », qui a envahi le champ social, les médias et qui est partie à l’assaut de l’école pour promouvoir dans le monde entier le point de vue (la « grille de lecture », les « lunettes », pour parler comme Bourdieu à propos des journalistes) de la communauté homosexuelle, je m’interrogeais sur les raisons de son succès actuel, du moins si l’on en croit ceux qui sont habilités (payés) à « causer dans le poste ». Je pointais la résistance légitime aux persécutions.
Mais parmi les raisons que j’entrevois, il en est une autre, qui me semble venir des eaux les plus profondes sur lesquelles avance l’esquif nommé « civilisation ». Et cette raison tient à l’évolution des rapports que nos sociétés entretiennent avec la question des interdits, des normes et des critères.
Grosso modo et pour simplifier, à mesure que les sociétés ont évolué vers la consommation de marchandises, la jouissance immédiate et l’individualisme, les populations se sont mises à rejeter ce qu’elles considéraient de plus en plus comme des contraintes.
Les normes n'ont plus été vues comme un bien commun, comme ce qui unit les citoyens d'un même pays, ce qu'on persiste à tort à appeler un « corps social », mais comme un ensemble insupportable de diktats, à faire disparaître d'urgence. Il faut choisir : s'il n'y a plus que des individus, il n'y a plus de société. De même et à l'inverse, s'il n'y a plus que de la société, l'individu s'abolit, dissout dans l'entité collective : c'est le totalitarisme nazi, stalinien, khmer rouge, le Petit Livre Rouge de la Révolution Culturelle chinoise .... Ah c'est sûr que l'équilibre est difficile à trouver !
Tout le monde admet, moi le premier, que toutes les coutumes et les cultures de toutes les peuplades de la Terre ont des particularités : les anthropologues et ethnologues ont noirci des milliers de kilomètres de parchemins savantissimes pour les décrire jusque dans leurs moindres détails, parfois abracadabrantesques à nos yeux.
Tout le monde admet par conséquent que toutes les coutumes et les cultures de la Terre, du fait de ce particularisme, comportent à leur base une part incompressible d’arbitraire. Nos coutumes et cultures d’Occidentaux endurcis comme celles de tous les autres peuples.
Et dans le maelström de la globalisation à outrance découlée de la généralisation de la société marchande, ces particularismes, en même temps que leur caractère arbitraire, sont devenus totalement insupportables. La liberté dans le choix des marques et des produits a détrôné la noble « Liberté guidant le Peuple ». Il est exigé de chacun des sept milliards d’individus qui grouillent sur la planète de participer au gigantesque effort qui consiste à la détruire pour entretenir la machine de la consommation.
L’accès de tous à tout est devenu le « credo », le « gloria » et le « confiteor » de la nouvelle Eglise vers laquelle se pressent (ou rêvent de se presser) les masses de la planète entière, j’ai nommé sa majesté l’Hypermarché, augmenté de sa dernière extension en date, dans les travées de laquelle se rend à chaque instant un culte au dieu nommé Illimité : l’empereur Internet.
Dans ce contexte, où les corps individuels se dilatent à l’infini aux dépens du corps social, comment voulez-vous que survive la vile et vieille notion de norme ? Quand les bornes du corps individuel sont franchies, il n’y a plus de limite au désir, il n’y a surtout plus de limite aux « droits ». Car le désir de l'individu est devenu générateur automatique de droit.
Qu’il s’agisse de l’enfant (à tout prix), de se marier avec quelqu’un du même sexe ou de suicider l’oncle à héritage au motif qu’il est en soins palliatifs, les désirs créent désormais des droits. Chaque individu est appelé à concevoir la norme particulière qui correspond à l'essence de son être.
A charge pour lui de la trouver et de la définir, bien sûr. Ce n'est pas le plus aisé, on le sait. Mais toutes sortes de coaches de vie, de consultants et de marchands de services à la personne et de biens matériels sont là pour l'aider à s'y retrouver dans le fouillis de ses contradictions et de ses changements d'humeur.
L’individu étant sa propre norme (« je fais ce que je veux parce que je suis libre », ou plutôt « je suis libre, donc je fais ce que je veux »), il n’y a plus de norme. Moyennant quoi on se rend bientôt compte que le social a disparu. Le social, je veux dire le bien commun. Je veux dire, comme disent les ânes bâtés (qui se prennent pour l'aristocratie moderne) qui nous gouvernent, le « vivre-ensemble ». Dit par eux, c’est devenu une abjection et une ordure.
Je ne vais pas jouer au gourou psychanalyste qui dirait à ces masses aveuglées que tout ça manque d’un père castrateur, parce que je n’ai pas les diplômes qui m’y autorisent, mais je me doute qu’il y a là-dedans quelque chose de cet ordre. Car finalement, accepter la norme, qu'est-ce d'autre qu'admettre une limite de soi ? On ne m’ôtera pas de l’idée que l’individu aux désirs tout-puissants est en réalité resté un enfant déguisé en adulte. Idée bien résumée dans le slogan publicitaire :
« Parce que je le vaux bien ! ».
Il est aujourd’hui de plus en plus difficile de supporter la frustration d’un désir, étant donné que les marchands de marchandises se donnent un mal fou (= consacrent des sommes folles) pour connaître les motivations des gogos qui s’imaginent qu’ils combleront leur vide existentiel en achetant les merdes élaborées par des margoulins à partir de mille enquêtes de motivations fabriquées pour leur soutirer la formulation de quelque manque qu’ils attendent de combler, bouclant ainsi la boucle.
Faire croire aux gens que leurs désirs sont tout-puissants, ça confine à l’artistique. Sauf que c’est tout, sauf de l’art.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : normes, moeurs, société, civilisation, petit livre rouge, révolution culturelle, khmers rouges, france, liberté guidant le peuple, psychanalyse
mardi, 23 avril 2013
QUE FAIRE AVEC LE MAL ? (4)

UN QUI L'A OUVERTE, SA GUEULE
(DESSIN DU REGRETTÉ PIERRE FOURNIER)
***
Je disais donc du bien de La Violence et le sacré, grand livre de René Girard, et je laissais entendre qu’ensuite, ça se gâtait. Mais on peut déjà faire un reproche à l’auteur, à propos de son maître-livre, c’est de ne pas se prendre pour un flacon d'urine éventée. Franco de port, il ne vous l’envoie pas dire : sa théorie du désir mimétique et de la victime émissaire est tout simplement "révolutionnaire". Elle envoie à la poubelle, en même temps qu’aux oubliettes, toute la psychanalyse de Papa Freud.
Mieux : elle l’englobe ! Pour vous dire la supériorité de son « pouvoir heuristique », comme on dit à l’université, pour dire qu’une théorie parvient à expliquer d'un seul jet homogène un ensemble de phénomènes éparpillés, que l’état précédent des connaissances ne permettait d’aborder qu’en ordre dispersé.
Remarquez que j’avais demandé (c’était entre deux portes, il est vrai) au père Denis Vasse, psychanalyste renommé, ce qu’il pensait des travaux de René Girard. Il m’avait regardé, puis m’avait répondu (je cite de vieille mémoire et en substance) : « Mais c’est qu’il ne s’occupe de rien de ce que nous faisons ». Circulez, y a rien à voir ! Un partout la balle au centre.
J’aurais quant à moi tendance à me méfier davantage de Girard que de la psychanalyse, et pour une raison précise : avec, et surtout après la publication de Des Choses cachées depuis la fondation du monde, il a viré au militant chrétien. Je précise que Denis Vasse était prêtre jésuite, mais n'a jamais confondu sa foi avec les choses de la science. Je n'en dirai pas autant de Girard. Chacun fait ce qu’il veut, mais quand on est militant, cela jette un drôle de jour sur l’objectivité des savoirs établis à l’université, qui sont davantage faits pour enrôler les adeptes d’une croyance que pour former des esprits à la méthode scientifique.
Je ne prendrai comme exemple que Judith Butler, militante avouée de la cause lesbienne, avec sa théorie du « genre ». Soit dit par parenthèse, on peut s’étonner que les affirmations qui forment le socle du « genrisme », et qui enfoncent les vieilles portes ouvertes du vieux débat « nature / culture », aient contaminé aussi facilement autant de soi-disant bons esprits, dotés d'un soi-disant bon sens, lui-même soi-disant rassis.
On s’étonne moins quand on voit que la théorie du genre sert de drapeau à tous les militants de la « cause » homosexuelle : nulle objectivité là-dedans, mais une arme, et une arme aux effets dévastateurs, car son champ d’action est le langage lui-même, le sens des mots et la façon dont ils désignent les choses. Les adeptes, ici, obéissent au raisonnement : « Puisqu'on ne peut pas tordre les choses, commençons par tordre les mots ». Et on peut dire qu'ils ont réussi, au-delà de toutes leurs espérances, à les tordre, les mots. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui, au nom de l' « ÉGALITÉ » !
Revenons à René Girard et à Des Choses cachées …. En dehors des salades que l’auteur commence à débiter sur la supériorité du christianisme, je garde de la lecture de ce gros bouquin le souvenir d’une idée qui me semble encore étonnante de pertinence : à observer les bases du christianisme à travers une grille de lecture « sacrificielle » (le rite religieux conçu et mis en œuvre pour expulser d’une communauté humaine la violence accumulée, dangereuse pour sa survie, en la déviant sur un seul individu), Jésus Christ apporte une innovation radicale.
Si j’ai bien tout compris, la mort du Christ sur la croix est le premier sacrifice raté, le premier sacrifice qui échoue à rétablir la paix dans la communauté dont il devait raffermir la cohésion. En tant que sacrifice humain comparé à tout ce qui s’est pratiqué et se pratique dans les sociétés, primitives ou non, la mort du Christ est un ratage complet. Le dernier des sacrifices humains, si l’on veut, du fait qu’il est le premier sacrifice inefficace. Et en même temps, il s’avère comme façon radicalement nouvelle d’envisager le Mal.
Un ratage, pour la raison très simple que la victime est reconnue et déclarée innocente, alors que la « bonne » victime est celle sur la tête de laquelle s’est concentré tout le Mal accumulé, et dont toute la communauté doit pouvoir dire qu’il était juste de la tuer, au motif qu’elle était coupable.
Le message du Christ, de ce point de vue, est clair : s’en prendre à un individu innocent, et croire ainsi expulser hors de soi le Mal, c’est commettre une injustice, voire un crime. Ce n’est pas parce que vous tuez un homme (choisi ou non au hasard) que vous chassez le Mal de la communauté. A cet égard, je suis bien obligé de reconnaître que la base du christianisme constitue une avancée décisive sur ce qu’on appelle la « mentalité primitive ». Le Christ est le premier à dire que le Mal est au-dedans de chacun, et que pour le rejeter au-dehors, il faut s’y prendre autrement.
On dira ce qu’on veut, mais c’est un vrai Progrès.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la gueule ouverte, pierre fournier, écologie, rené girard, la violence et le sacré, des choses cachées depuis la fondation du monde, psychanalyse, denis vasse, sigmund freud, judith butler, lesbienne, théorie du genre, jésus christ, christianisme, bouc émissaire
vendredi, 07 décembre 2012
LIBEREZ-VOUS, MESDAMES : FUMEZ !
Pensée du jour :

AUTRE IDEE DE LA BEAUTE SELON LUCIEN CLERGUE
« Je vous cèderais volontiers ma place, malheureusement, elle est occupée ! ».
GROUCHO MARX
 Résumé de l’épisode précédent : les femmes doivent leur « libération », non pas aux « luttes » féministes, comme la rumeur s’en colporte encore aujourd’hui avec une veule complaisance, mais à EDWARD BERNAYS, dont elles ont obtenu – et de façon spectaculaire – l’autorisation de brandir en public un petit cylindre d’une substance végétale délicatement et finement découpée, et soigneusement enveloppée d’une feuille extrêmement fine de papier de riz, dont l’extrémité peut à volonté être portée à incandescence, une fois que l’autre extrémité a été sensuellement glissée entre les lèvres féminines.
Résumé de l’épisode précédent : les femmes doivent leur « libération », non pas aux « luttes » féministes, comme la rumeur s’en colporte encore aujourd’hui avec une veule complaisance, mais à EDWARD BERNAYS, dont elles ont obtenu – et de façon spectaculaire – l’autorisation de brandir en public un petit cylindre d’une substance végétale délicatement et finement découpée, et soigneusement enveloppée d’une feuille extrêmement fine de papier de riz, dont l’extrémité peut à volonté être portée à incandescence, une fois que l’autre extrémité a été sensuellement glissée entre les lèvres féminines.

EDWARD BERNAYS, donc, et personne d’autre. EDWARD BERNAYS, que le magazine Life, en son temps, a désigné comme l’une des personnes les plus influentes du 20ème siècle. EDWARD BERNAYS, injustement maintenu dans un obscur cagibi du purgatoire des célébrités.

JOSEPH GOEBBELS, INITIATEUR DE LA "PROPAGANDASTAFFEL"
A LA DEMANDE DE SON MENTOR
Il s’agit bien de lui, et les notes que ce blog lui consacre ne visent qu’à réparer une sorte d’injustice : oui, il est temps de rendre justice à un homme dont les travaux ont brillamment inspiré des communicants aussi renommés et efficaces que JOSEPH GOEBBELS, ADOLF HITLER et JOSEPH STALINE, qui avaient sur leur table de chevet le maître-ouvrage du maître : Propaganda ou comment manipuler l’opinion en démocratie (éditions Zones-La Découverte, 2007, 141 p., 12 euros, c’est quasiment donné, et ça fait tomber quelques peau de "soss" devant les yeux qui en avaient).
Si je reformule le sous-titre, ça donne quelque chose comme : « Comment faire adhérer sans contrainte les masses aux discours d'un homme au pouvoir, et jusqu'aux folies d'un dictateur ». En regardant bien, on constate que c'est le principe qui régit tous les gouvernements actuels.

UN AMI DE L'HUMANITE QU'ON NE PRESENTE PLUS
Je vous explique : comme sa mère s’appelle ANNA FREUD, sœur de SIGMUND, et que son père est le frère de MARTHA BERNAYS, qui se trouve être l’épouse du dit SIGMUND, il devient à sa naissance neveu au carré d’un certain SIGMUND FREUD, l’écrasant papa d’une grosse bête appelée « Inconscient » et de tout ce qui se trouve dedans quand on la dissèque. Il est d’ailleurs sympa avec son neveu, le grand FREUD : il lui dédicace un exemplaire de son Introduction à la psychanalyse. Et le neveu, il va y mettre le nez, et pas qu’un peu.

En 1929, le président du consortium des producteurs de tabac, futur gros client de son officine, lui dit : « Comme les femmes ne peuvent pas fumer en public, nous perdons la moitié d’un énorme marché. Pouvez-vous faire quelque chose ? ». EDWARD BERNAYS répond : « Laissez-moi y réfléchir ». Puis il demande : « M’autorisez-vous à chercher du côté de la psychanalyse ? – Mais œuf corse ! Ne vous gênez pas ». Rappelons qu'à l'époque, la femme qui fume sur un trottoir est traitée de pute, ni plus ni moins.
Ni une ni deux, il se précipite chez ABRAHAM A. BRILL, un des premiers grands psychanalystes des Etats-Unis, non pas pour s’étendre sur un quelconque divan, mais pour poser une question au savant : « Que représente la cigarette pour la femme ? ». La réponse fuse : « Le pénis ! ». C’est clair, net et précis. Autrement dit la berdouillette, le scoubidou, la merguez (ou chipolata, au point où on en est), le cigare à moustaches, la bistouquette. En trois mots comme en cent : la BITE, la PINE, le CHIBRE.
EDWARD BERNAYS ne se démonte pas pour autant, c’est un esprit pratique. Il a un gros client, et le client, surtout le gros, est roi. Alors il a l’idée du siècle : le symbole de l’Amérique, c’est le cadeau fait par la France à l’occasion de son centenaire (celui des Etats-Unis !). J’ai nommé le chef d’œuvre d’AUGUSTE BARTHOLDI. J’ai nommé la statue de La Liberté éclairant le monde (inaugurée en 1886).

Deuxième étape dans l’élaboration du message : la torche que tient la Liberté est incandescente, le bout de la cigarette allumée est incandescent. Il faudrait être stupide pour ne pas faire le rapprochement, avouez ! Qui plus est, la Liberté, qu’elle guide le peuple ou qu’elle éclaire le monde, c’est une Femme, regardez DELACROIX. Concluez vous-même : EDWARD BERNAYS a sa campagne de « public relations » en poche, c’est comme si c’était fait.

LÀ, ELLE GUIDE LE PEUPLE.
C'EST BIEN UNE FEMME, SELON TOUTE APPARENCE.
Voilà ce que je dis, moi.
P.S. DERNIERE MINUTE : nous apprenons une triste nouvelle :

Adressons donc nos très sincères condoléances à l'U.M.P., et surtout à son "président autoproclamé".
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : femme, féminisme, mlf, photographie, lucien clergue, beauté féminine, humour, groucho marx, edward bernays, communication, propagande, publicité, tabac, magazine life, goebbels, adolf hitler, joseph staline, propaganda, manipulation, sigmund freud, psychanalyse, sexe, cigarette, bartholdi, statue de la liberté, la liberté éclairant le monde, eugène delacroix, inconscient, anna freud, françois fillon, ump, jean-françois copé
samedi, 10 novembre 2012
VOUS AVEZ DIT LACAN ? (fin)
Pensée du jour :
« Cette chronique ne cesse de se préoccuper de l'homme, de le poursuivre, de le piéger, de le traquer à travers l'apparence, de chercher à tracer son portrait éternel. Tout au moins son ombre chinoise ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé : le style écrit de JACQUES LACAN, c’est bien connu, est une sorte d’Everest pour un lecteur ordinaire. C’était tout à fait concerté et volontaire de sa part. C’en était au point que même ses collègues psychanalystes le trouvaient illisible, et qu’il a dû, dans certaines circonstances que ROUDINESCO expose, faire un (petit) effort de lisibilité.
L’autre aspect négatif de LACAN que je retiens du livre de ROUDINESCO, c’est le caractère très moyennement sympathique du personnage. L’une des principales raisons est l’obsession de l’argent. L’auteur écrit : « A sa mort, à la différence de Balthazar Claës [drôle de renvoi au personnage de La Recherche de l’absolu (BALZAC), mais la 8ème partie du livre porte précisément ce titre], Lacan était donc richissime : en or, en patrimoine, en argent liquide, en collections de livres, d’objets d’art et de tableaux » (p.514). Richissime !
Je me rappelle avoir lu dans le temps (dans la revue Actuel, 2ème mouture) un article insolent sur maître LACAN, illustré entre autres d’un dessin le représentant brassant plein de billets de banque dans un grand tiroir ouvert. Il y avait donc du vrai.
Une de ses filles est d’ailleurs, si je me souviens bien, devenue conseil en immobilier, pendant qu’un fils opérait dans la finance. Sa fille préférée, JUDITH, à la suite de je ne sais plus quel micmac, n’a porté son nom que deux ans, intervalle entre la démarche administrative pour avaliser la filiation et son mariage avec le redoutable JACQUES-ALAIN MILLER, dont elle a adopté le patronyme.
Cette richesse énorme, il la devait à son incomparable maîtrise dans la discipline psychanalytique et à l’incontestable (voire incroyable) succès rencontré par son enseignement auprès de différentes générations d’analystes. Les gens (y compris des célébrités parisiennes) se bousculaient à son séminaire.
Mais cette richesse, il la devait aussi à l’une des raisons qui l’ont coupé des autorités de la profession : la durée de la séance. L’IPA (l’association internationale) tenait à des séances uniformément étendues sur trois quarts d’heure. LACAN inventa la « durée variable », autrement dit les séances réduites à quelques minutes à la fin, voire interrompues au bout de quelques instants.
On se pose forcément la question de l'escroquerie (ce n'est pas la même chose de recevoir 15 patients et d'en recevoir 60 ou 80 dans la journée ; on pense aux "gagneuses" de Barbès qui épongeaient autrefois le micheton à la chaîne et à 100 balles).
Une autre raison est à chercher du côté de la certitude absolue qu’il a de son propre génie, et de la confiance infinie qu’il a en lui-même. Plongé dans sa recherche, plus rien d’autre n’existe que celle-ci. On peut se dire que BALZAC ou CÉLINE non plus ne doutaient de rien.
Mais cela peut rendre les relations délicates : LACAN n’hésite pas à réveiller ANDRÉ WEISS en pleine nuit pour le supplier de lui donner la solution de l’énigme que celui-ci lui a posée pendant la soirée (les « trois prisonniers », intéressant, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, parce qu’il faudrait encore développer). C’est sûr que cela comporte un aspect fascinant.
Qu’est-ce que je retiens d’autre, de la lecture d’un ouvrage consacré à un homme qui a, en son temps, défrayé la chronique ? J’ai connu un homme (que je suis très heureux d’avoir perdu de vue) qui a croisé LACAN. C’était à l’hôtel Pigonnet (catégorie *****, oui, 5 étoiles), à Aix-en-Provence.
Je n’ai pas retenu toutes les circonstances, mais au moment où il était assis dans le salon de réception, il a vu un monsieur descendre l’escalier, se diriger vers l’Accueil pour je ne sais plus quoi. C’était JACQUES LACAN, et d'une, et il était à poil, et de deux. Ma foi, pourquoi pas ? Quand on est riche et célèbre, on peut se permettre l’excentricité, au motif que le riche est plus libre que le pauvre.
Je retiens encore le fait que, si une foule de gens reconnaissent que LACAN a renouvelé en profondeur la lecture de l’œuvre de SIGMUND FREUD, c’est en bonne partie parce qu’il a énormément travaillé les philosophes (et avec eux) de son temps : HUSSERL, JASPERS, KOYRÉ, KOJÈVE, HEIDEGGER, et d’autres plus anciens, dont HEGEL.
Ce sont ses lectures et échanges philosophiques qui ont nourri ce renouvellement. ROUDINESCO pointe d’ailleurs les trois sources de l’inspiration lacanienne : médicale (c’est un médecin), intellectuelle et artistique (copain de DALI et d’ANDRÉ MASSON, passés par le surréalisme). A cet égard, la biographie de LACAN par ROUDINESCO (je dis ça, moi qui n’ai guère de points communs avec la psychanalyse) est un excellent travail de reconstitution d’une démarche et d’une trajectoire, tant pour la vie que pour l’œuvre du personnage.
J’ajouterai pour finir que ce n’est pas un livre sans faiblesses. Celle que je considère comme principale est dans la composition elle-même. Plus on descend le cours du temps, plus l’exposé perd en esprit de synthèse, et tombe un peu, disons-le, dans l’anecdotique, pour ne pas dire le « people ». Et plus on se perd dans des détails qui s’étalent indûment.
Si je peux avancer une explication : l’auteur est entré dans le circuit parisien organisé autour de LACAN à une certaine époque. Et ce dont elle-même a été témoin direct (ou presque) prend une ampleur que n’ont pas des sources plus anciennes (écrits et entretiens divers). Le synthétique résulte d’un travail de reconstruction a posteriori, comme « en laboratoire », le dilué venant d’un relatif manque de recul, dû à la présence "in vivo".
Et le moment où la biographie donne l’impression de s’effilocher et de tirer en longueur, je le situe quand l’auteur devient elle-même partie prenante. Qu’elle soit entrée dans le jeu n’a rien d’étonnant : elle est la fille de JENNY AUBRY (née WEISS, puis épouse ROUDINESCO, puis ...). Le monde est petit, comme on l’a vu avec DIDIER ANZIEU, le fils de MARGUERITE PANTAINE, qui a, sous le nom d’ « Aimée », servi de marchepied (de paillasson ?) à JACQUES LACAN.
Dernière remarque, inspirée par le dernier chapitre, intitulé « France freudienne : état des lieux ». Impressionnant, franchement. Il y avait la SPP et l’APF (je ne détaille pas, le P est pour "psychanalyse", le F pour Freud), augmentées de l’OPLF et du Collège de psychanalystes. Ce sont des associations professionnelles. Ajoutons l’EFP fondée par LACAN. Je me contente d’énumérer la suite : ECF, AF, CFRP, Cercle freudien, CCAF, EF, FAP, CP, Coût freudien (sic !), GRP, Errata, ELP, Psychanalyse actuelle.
Et moi qui croyais que le pompon de la scission et autres formes de scissiparité était détenu haut la main par les sectes trotskistes ! Quel désappointement ! Je vais être obligé désormais de changer de cible, et sans même avoir à caricaturer : la cible se caricature elle-même !!! Parce que la liste ci-dessus s’allonge dès la page suivante : entre 1985 et 1993, pas moins de « quatorze associations supplémentaires ont vu le jour. Six d’entre elles sont des créations nouvelles, deux sont le résultat de scissions, et six sont des lieux fédératifs » (p. 552).
Vous voulez une image du sac de nœuds ? Une représentation du nœud de vipères ? Du merdier ? De la confusion générale ? De l’imbroglio ? De l’enchevêtrement ? Alors, mieux que les sectes trotskistes, ouvrez la caisse aux psychanalystes, regardez-les grouiller, ... et vous serez servis.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, alexandre vialatte, littérature, jacques lacan, psychanalyse, psychanalyste, élisabeth roudinesco, la recherche de l'absolu, honoré de balzac, revue actuel, judith miller, jacques-alain miller, école freudienne de paris, louis-ferdinand céline, sigmund freud, heidegger, husserl, jaspers, kojève, salavador dali, andré masson, jenny aubry, didier anzieu
vendredi, 09 novembre 2012
VOUS AVEZ DIT LACAN ? (2)
Pensée du jour :

"SILHOUETTE" N°7
« L'homme est un étrange animal. Ses activités sont charmantes. Les spécialistes voient en lui une espèce d'insecte sautillant. Il fonde des villes, il dans se jerk, il sonde les mers, il chante en choeur et il boit à la ronde, il se coiffe au caranaval de chapeaux en papier. De temps en temps, il détruit la Bastille pour construire des prisons moins belles mais plus nombreuses, il tue ses rois pour avoir un empereur et le remplacer par un monarque, il adore la Raison, il se repaît de chimères, il massacre ses prisonniers. En un mot, il est libre, égal et fraternel ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé : on a compris, j’espère, qu’il y a une recette pour me faire monter la moutarde et pour que je prenne en grippe le coupable, c’est, comme on dit, de « ramener sa science ». Certains disent plus simplement : « Celui-là, il la ramène ». Ipso facto, on a compris que la prose de JACQUES LACAN n’est pas ma tasse de thé. C’est qu’avec le « vulgum pecus » auquel j’appartiens, le « maître »(que ROUDINESCO appelle parfois « Sa Majesté », du moins il me semble) sait faire preuve d’un dédain souverain.
Mais je crois, après lecture de la biographie d’ELISABETH ROUDINESCO, que LACAN a vite compris que ce dédain était un moyen de se poser en seigneur. En un mot, comme le dit l’auteur, LACAN est avant tout un SEDUCTEUR (de femmes, de disciples, …). Or le séducteur est celui qui a par-dessus tout besoin de s’ériger en objet de désir.
Il semble avoir adopté la maxime prêtée à CESAR : « Plutôt le premier dans mon village que le second à Rome », et la démarche induite par la logique du « tout seul », pourvu que ce soit « à la tête ». Ce qui l’a conduit à se couper de toutes les organisations et autorités professionnelles, pour fonder sa propre institution. Il est ainsi sûr de rester sans rival. Dans cet ordre d’idées, ajoutons sa hantise du plagiat : se considérant (sans doute à juste titre, bien qu’il ait « emprunté » quelques-unes de ses idées de départ) comme un inventeur, il redoutait d’être dépossédé de ce titre, au cas où des petits malins auraient eu l'idée d'un pillage en règle.
Toute sa virtuosité passe dans la tactique adoptée pour se faire désirer. Se faire désirer par qui ? LACAN, pour sa part, a réussi à mettre nombre de femmes dans son lit. Il n’est ni le premier, ni le dernier : un homme qui sait s’y prendre en fait autant, ou mieux. Et puis somme toute, ça le regarde, ainsi que les femmes qui ont bien voulu. Mais là où il a été très fort, et peut-être un génie, c’est qu’il a réussi à mettre nombre de disciples dans son séminaire. Et ça, c’est beaucoup plus impressionnant que les conquêtes féminines. Comment devient-on chef d'école ?
C’est aussi assez drôle, dans le livre, de suivre (de pas trop près) les trajectoires de frôlement, d’entrecroisement et d’interaction de tous les poissons plus ou moins gros qui évoluent dans le bocal parisien de l’intelligentsia intellectuelle et artistique des années 1930. Sur la paranoïa, par exemple, il est probable que LACAN a reçu une part de ses idées de SALVADOR DALI.
Ce qui est sûr, c’est qu’il a fréquenté les surréalistes, et qu’il s’est lié d’amitié avec le peintre ANDRÉ MASSON, l’auteur (entre autres) de l’emblème de la revue Acéphale, de GEORGES BATAILLE, un antirationaliste passionné de pulsions et de passions primitives, dont la compagne (SYLVIA BATAILLE) devint celle de JACQUES LACAN.
Passons rapidement sur une coquille marrante qui figure à la page 271 de mon exemplaire : « … la toute-puissance de l’analyste, placé en position d’interprètre dans la relation transférentielle ». De là à la position dite « du missionnaire », il n’y a qu’un pas, que je me garderai de franchir, pour garder intacte la réputation de sérieux qui est celle de ce blog. Est-ce une facétie ? Un lapsus ?
Alors finalement, quel portrait de JACQUES LACAN trace l’ouvrage d’ELISABETH ROUDINESCO ? Elle ne fait à coup sûr pas partie des dévots de l’Eglise lacanienne (certains disent la secte), où certains sont tombés dans le culte de l'idole. Mais elle reconnaît tous les apports dont il a enrichi la doctrine freudienne, en n’hésitant pas à s’opposer frontalement à des institutions (on n’imagine pas le continent que ça représente) qui, à ses yeux, avaient tendance à figer, voire à momifier la pensée du fondateur de la psychanalyse.
Elle essaie de faire le départ entre les lumières et les ombres. Et le résultat est bon. Du côté de ces dernières, je compte évidemment le style, même si des gens très compétents en la matière m’ont affirmé que la pensée de LACAN repose avant tout sur un effort de précision et d’exactitude. Je veux bien.
Un style au vocabulaire, disons, courant (à part les concepts élaborés par lui), mais à la syntaxe inspirée du MALLARMÉ le plus alambiqué, voire le plus obscur. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça donne des phrases qu’il faut relire plusieurs fois pour en discerner la construction grammaticale, les relations entre les parties, en un mot ce que ça peut bien vouloir dire. C’est un choix, évidemment.
L’obstacle de l’obscurité, devait-il se dire, est une condition de la naissance du désir de comprendre : à l’amateur de faire l’effort d’entrer dans son système de pensée (puisque système il y a, selon ROUDINESCO), pour comprendre le raffinement et la profondeur de l’agencement des concepts mis en place par le « maître ». On se dit qu’il y a du gourou chez cet homme. Eh bien, son obscurité pour initiés, qu'il la garde !
Voilà ce que je dis, moi.
Tant pis, je comptais finir ici, mais ce sera pour demain.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, france, liberté égalité fraternité, jacques lacan, élisabeth roudinesco, biographie, psychanalyse, séduction, séducteur, césar, séminaire de lacan, génie, salvador dali, paranoïa critique, andré masson, georges bataille, acéphale, mallarmé, poésie
jeudi, 08 novembre 2012
VOUS AVEZ DIT LACAN ?
Pensée du jour :

"RUPESTRE" N°1
« L'indignation ne saurait en aucun cas être une attitude politique ».
TALLEYRAND
(à transmettre à STEPHANE HESSEL)
Résumé : j’ai beaucoup d’estime pour l’anthropologue, l’historien, le sociologue, bref, pour le spécialiste de « sciences humaines » quand, sans rien céder sur ce qu’il y a de « pointu » dans la doctrine, il parvient à créer une œuvre qui ait des qualités littéraires.
Je n’en ai guère pour ceux, tels DENIS GUEDJ ou JOSTEIN GAARDER, qui passent par le roman pour faire une sorte de propagande simplificatrice à la "petite semelle" (excusez-moi). Ils ne sont que des intermédiaires entre la discipline et le grand public, des « vulgarisateurs », qui peuvent bien sûr briller sur les plateaux de télévision. Ils vous disent : « Moi je sais. Je vais tout vous expliquer, voyez comme je suis bon ». Mais ils se révèlent à la fois des romanciers infirmes et de piètres professeurs. De plus, cette attitude a quelque chose de toute à fait déplaisant.
Le vrai savant qui consent à faire entrer son lecteur dans la Science par le biais de la littérature est donc un esprit supérieur. EINSTEIN disait : « Il faut s'efforcer de rendre les choses simples, mais pas plus simples ». Réciproquement, la Science contenue dans la littérature est infiniment supérieure à ces balbutiements de pédagogues empêtrés et de vulgarisateurs à succès, mais aussi supérieure aux plus arides traités austères de science pure.
S’il en est ainsi, c’est que la dite Science, dans les ouvrages que je privilégie, ceux dont je parle, n’apparaît que comme un élément parmi d’autres dans ce qu’on appelle communément LA VIE. C’est cette science-là que BALZAC a élaborée et transmise dans La Comédie humaine.
C’est pour ça que je tire mon chapeau à quelques psychanalystes. Tiens, je me rappelle une histoire de cas racontée par un monsieur MASUD KHAN (quelque suspecte que soit sa réputation par ailleurs) dans un numéro de la Nouvelle revue de psychanalyse (n° 24, « L’emprise »), repris dans Passion, solitude et folie (Gallimard, 1985), histoire intitulée La Main mauvaise.
Sans me rappeler le détail, je me souviens du drame épouvantable vécu par un artiste habité par un fantasme qu’il tâche de transformer en œuvre d’art (y a-t-il un vélo en bois ?), jusqu’au jour où le hasard d’une rencontre féminine le met face à des circonstances et un déroulement d’événements qui ressemblent trait pour trait (et de façon épouvantable) aux forces de son fantasme. J’ai oublié s’il devient fou à la fin, ou quoi.
Dans mon souvenir, ce récit ne présente guère (en dehors des références proprement psychanalytiques) de différence avec les ambiances qu’on trouve dans les nouvelles, par exemple, de MAURICE PONS (Douce-amère, Denoël, 1985). MAURICE PONS, parmi les romanciers, est sûrement ce qu’on peut appeler un « petit maître ». Mais parmi les petits maîtres, c’est un bon.
références proprement psychanalytiques) de différence avec les ambiances qu’on trouve dans les nouvelles, par exemple, de MAURICE PONS (Douce-amère, Denoël, 1985). MAURICE PONS, parmi les romanciers, est sûrement ce qu’on peut appeler un « petit maître ». Mais parmi les petits maîtres, c’est un bon.
Pour moi il reste le bel auteur de quelques livres qui ont tracé leur sillage indélébile (il faut le faire, non ?) dans mon imaginaire, au premier rang desquels le lent, lugubre et remarquable Les Saisons. Il y a aussi Rosa et le complètement foutraque La Passion de Sébastien N. (bêtement rebaptisé Le Festin de Sébastien pour sa réédition au Dilettante, une histoire de droits, j'imagine).
Le héros finit par dévorer une automobile, des sièges à la carrosserie, avant de s’élancer à toute allure sur les routes, carburateur refait à neuf. Mais ça finit mal. Pris en chasse par deux motards : « … il alla s’écraser, la tête en avant, contre un pylône de béton édifié au milieu de la chaussée en prévision de l’éventuel projet du futur tronçon de l’autoroute Moyenvic-Vézelise ». Alors, « une bouillie d’organes et d’ossements se répandit sur la chaussée, mêlée à des fragments d’acier et des débris de tôle ». « A l’aube, les fossoyeurs et les ferrailleurs de Verveine, accourus en hâte, se disputaient ses restes ». Comme foutraque (et comme fantasme), on ne fait pas mieux.
Je reviens à DIDIER ANZIEU, dont je vantais les mérites hier, pour la lisibilité de L’Auto-analyse de Freud. Il se trouve qu’ELISABETH ROUDINESCO parle de lui dans sa biographie de JACQUES LACAN. Et pour cause : le premier coup d’éclat de celui-ci est la thèse qu’il soutient et publie en 1932 : De la Psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité (Seuil, 1975, rééd.).
Je me fiche éperdument de ce qu’y raconte le père du « lacanisme ». Ce qui m’a interpellé, c’est que ce livre traite du cas de MARGUERITE PANTAINE. Car c’est un « cas », au sens psychiatrique. Il se trouve que cette femme, à 38 ans, est allée attendre l’actrice HUGUETTE DUFLOS à son arrivée au théâtre Saint-Georges, qu’elle a sorti de son sac un couteau de cuisine et qu’elle a tenté de l’assassiner. Après quoi elle fut solidement hospitalisée pour paranoïa.
Dans le livre de LACAN, elle est devenue « Aimée », ou « le cas Aimée ». Le peu que je retiens du livre, c’est que LACAN refuse de faire résulter la folie d’ « Aimée » d’un désordre organique. Pour lui, la folie est une composante « comme les autres » de l’existence, une donnée possible de la vie humaine (je simplifie). Et, dit-il, si tout le monde est potentiellement fou, tout le monde n’a pas la liberté de le devenir. Je trouve l’idée passionnante.
D’autant plus passionnante qu’il se trouve que MARGUERITE PANTAINE est la mère de DIDIER ANZIEU. C’est ce que la biographie de LACAN m’a appris. DIDIER ANZIEU qui est devenu ensuite un des plus importants psychanalystes français. Ces circonstances ont quelque chose d’éminemment romanesque, ne trouvez-vous pas ?
D’autant que, d’après ROUDINESCO, LACAN s’est assez mal conduit avec « Aimée », et qu’il s’est servi d’elle plus qu’il n’a eu le souci de sa santé mentale. Il s’en est servi, plus qu’il ne l’a servie, comme d’un tremplin professionnel inespéré. Aux yeux d’ « Aimée » : « … il lui avait volé son histoire pour construire une thèse. Quand il devint célèbre, elle en fut dépitée et sentit resurgir en elle un fort sentiment de persécution. Jamais elle ne lui pardonna de ne pas lui avoir restitué ses manuscrits » (p.257).
Et, après la mort du maître, ROUDINESCO eut beau intervenir auprès du tout-puissant exécuteur testamentaire de LACAN, son gendre JACQUES-ALAIN MILLER, pour faire rendre à DIDIER ANZIEU, le fils de MARGUERITE, les cahiers rédigés par celle-ci pendant son enfermement à l’asile, le gendre ne daigna même pas répondre. Ce dédain constitue une signature morale. Avec quelque chose d'une odeur infamante. Une odeur de faux-cul. Et de cynisme racinaire.

VOUS AVEZ DIT JACQUES-ALAIN ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, vulgarisation, denis guedj, jostein gaarder, le théorème du perroquet, le monde de sophie, science, sciences humaines, littérature, balzac, la comédie humaine, psychanalyse, masud khan, passion solitude et folie, la main mauvaise, nouvelle revue de psychanalyse, nouvelles, maurice pons, douce-amère, les saisons, didier anzieu, jacques lacan, élisabeth roudinesco, l'auto-analyse de freud, sigmund freud, le cas aimée, paranoïa, psychose paranoïaque, jacques-alain miller, albert einstein
mercredi, 07 novembre 2012
VOUS AVEZ DIT BIOGRAPHIE ? (3)
Pensée du jour :

"SOUPIRAIL" N°8
« Nous vivons une époque tragique. Et même sérieuse ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé : je supporte de lire ce qu’écrivent des spécialistes en sciences humaines à condition qu’ils se donnent la peine de traduire leur haut savoir dans une langue lisible, et même de bonne ambition littéraire, voire qu’on puisse considérer comme de la littérature. Et c’est possible. FREUD (c’est traduit, mais …), pour la psychanalyse, le montre bien, et après lui des gens comme DIDIER ANZIEU, MAUD MANNONI, … Dans d’autres domaines, CLAUDE LEVI-STRAUSS est un véritable écrivain, JEAN-PIERRE VERNANT aussi, d’autres …
Un autre ouvrage m’a marqué de son empreinte : L’Auto-analyse de Freud, sous-titré et la découverte de la psychanalyse (Presses Universitaires de France, éditions de 1975, 752 pages à lire, mais la lecture est très facile, si l’on excepte la doctrine psychanalytique). L’auteur est DIDIER ANZIEU, cité ci-dessus.
Le livre constitue sa thèse de doctorat ès lettres soutenue à la Sorbonne. Je soutiens l’idée que ce livre constitue une base culturelle de l’Occident, parce qu’en racontant comment l’inconscient est devenu « incontournable », il établit au moins un tiers des points de repère de la « modernité ».
Et vous allez voir qu’avec ANZIEU, on se rapproche de JACQUES LACAN, quoi de façon étonnante, comme je l’ai appris dans la biographie qu’ELISABETH ROUDINESCO consacre à ce dernier. Vous voyez que je ne perds pas mon fil. Car je parlerai de JACQUES LACAN. Qu’on se le dise. « Un de plus », diront les connaisseurs. Mais c’est juste pour ajouter mon grain de sel de spectateur profane.
Ce bouquin d’ANZIEU, comme je l’ai lu il y a longtemps, je ne m’y attarderai guère. L’auteur y montre, de façon terriblement savante et détaillée, comment les concepts freudiens se mettent peu à peu en place, comment ils s’agencent, s’échafaudent et s’enchaînent jusqu’en 1900-1902, époque de publication de L’Interprétation des rêves, jusqu’à former un corps de doctrine à peu près cohérent, même s’il ne cessera d’évoluer au cours du temps, du vivant même de FREUD, donnant par là du grain à moudre à tous les disciples, à tous les renégats (qui furent souvent les mêmes), à tous les captateurs d’héritages et autres fondateurs de sectes.
Je me rappelle qu’ANZIEU insiste beaucoup sur l’analyse que FREUD élabore à partir d’un de ses propres rêves : « L’injection faite à Irma ». Le récit tient sur une page entière, et son analyse remplit un plein chapitre, alors je ne vais pas entrer dans les détails. Ce que je peux dire, c’est qu’ANZIEU parvient à rendre compte de ce qu’il appelle la « découverte » de la psychanalyse en mettant celle-ci à la portée, sans doute pas du grand public, disons au moins de la personne qui décide de s’y plonger, sans rien céder sur l’exactitude des notions et concepts.
J’avoue que j’ai été « bluffé » (comme on dit volontiers aujourd’hui) par la performance de monsieur DIDIER ANZIEU.
C’est cette même capacité du savant de s’adresser à un public, tout en restant rigoureux dans sa discipline, qui m’a fait plonger dans les Cinq psychanalyses de SIGMUND FREUD en personne. Comme ailleurs, ce que j’apprécie ici, c’est la capacité d’un maître à asseoir des bases théoriques sur un socle narratif. Le livre est trop connu pour que je me risque à ajouter ici un commentaire par avance nul et non avenu.
Je veux dire que, quand le psychanalyste condescend à se faire romancier, même si c’est pour du beurre et que tout ce qu’il raconte est scientifique et prouvé, le statut de ce qu’il écrit s’apparente au statut de la littérature et de la fiction romanesque.
Je signale en passant que MAUD MANNONI, citée ci-dessus, a écrit un livre dont le titre seul me ravit : La Théorie comme fiction. Bien qu’elle soit une lacanienne pur jus, je l’interprète pour mon compte comme un conseil à tous les théoriciens, d’avoir à montrer de la modestie quand ils élaborent leurs systèmes, et à considérer ceux-ci comme de simples détours narratifs n’excluant pas de faire appel à l’imaginaire.
Car on aura beau faire, il y a plus de vraie science de l’homme dans la littérature que dans tous les traités scientifiques de la Terre, du Ciel et des Planètes. Car la littérature, c’est de la Science destinée à l’Homme, et à personne d’autre, et ce n’est surtout pas une espèce de Statue en or massif que le public est prié d’admirer et d’adorer de loin, de derrière les barrières du langage que les spécialistes ont élevées. Il y a du Prométhée voleur de feu et bienfaiteur de l’humanité, chez le spécialiste qui accepte le détour littéraire de la fiction romanesque pour expliquer ce qu’il sait.
Je ne parle pas des petits clowns comme DENIS GUEDJ (Le Théorème du perroquet) ou JOSTEIN GAARDER (Le Monde de Sophie), tâcherons sans imaginaire ni imagination qui tissent à la diable un semblant de roman pour vulgariser, l’un l’histoire des mathématiques (GUEDJ), l’autre la philosophie (GAARDER), quel que soit à l’arrivée le succès de leur livre.
Dans les deux cas, l’intrigue, sorte de squelette laissé par l’être vivant après sa mort, est simplement posée sur le contenu, sorte de viande synthétique censée faire office de substance nourricière. Mais ce genre de livre ne tient pas debout.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, humour, psychanalyse, philosophie, sigmund freud, didier anzieu, maud mannoni, claude lévi-strauss, jean-pierre vernant, l'auto-analyse de freud, rêve, l'injection faire à irma, élisabeth roudinesco, jacques lacan, l'interprétation des rêves, cinq psychanalyses, la théorie comme fiction, imaginaire, imagination, denis guedj, le théorème du perroquet, jostein gaarder, le monde de sophie















