lundi, 15 avril 2019
LES NUISANCES DE L'INTELLIGENCE
Un exemple frappant de l'effet délétère induit par l'usage intempestif des "sciences" humaines se trouve dans l'évolution de l'enseignement de l'histoire de France à l'école, au collège et au lycée. Les inventeurs de l'enseignement de l'Histoire de France, au XIX° siècle, avaient pour ambition de susciter dans la jeunesse l'émergence d'un véritable sentiment national : leur projet n'était pas "scientifique" mais clairement politique, inséparable d'une volonté patriotique.
Pour eux, l'enseignement, sans repousser la vérité historique établie scientifiquement, réservait l'étude de celle-ci aux âges de la maturité, où le citoyen devient capable d'un discernement autonome. Ils se disaient avec raison que le savoir établi sur des bases "scientifiques" n'est authentiquement accessible qu'à des esprits déjà formés : le gamin de 10 ans, de 15 ans aime bien qu'on lui raconte des histoires. La science viendra plus tard, se disait-on. Le savoir, dans les premiers temps, n'a besoin que de bons raconteurs d'histoires. Cette façon raisonnable de faire ajournait l'exercice des convictions (politiques, morales ou autres) à un temps où l'homme était jugé en état de juger en toute indépendance. En attendant, il fallait, pensait-on, fixer de la façon la plus solide des points de repère dans le temps (histoire chronologique) et dans l'espace (géographie).
L'école et le lycée étaient là pour faire de tous les enfants de futurs citoyens disposant d'un solide socle de références communes. Voilà le formidable moyen que les concepteurs de cette école républicaine avaient trouvé pour aboutir à l'unification des esprits dans la nation française. Leur projet était exactement le "Grand Récit National" dont toutes sortes de commentateurs médiatiques déplorent aujourd'hui la perte irrémédiable. Il s'agissait d'abord pour eux de fabriquer du commun.
Malheureusement, plus aucun historien un peu "lancé" ne veut entendre parler de "Roman National" : vous n'allez pas revenir à "nos ancêtres les Gaulois", quand même ! Aujourd'hui, tous les responsables politiques rêvent de fabriquer du commun. Le problème, c'est que chacun de ces responsables voudrait que la seule fabrique du commun qui soit unanimement reconnue soit celle dont il a donné la définition et les contours précis ("ralliez-vous à mon panache").
A cet égard, l'enseignement "à la carte" (l'uniformité des programme est une fantaisie, tant est grande la diversité des mises en œuvre), est le meilleur moyen de renvoyer chaque individu à du particulier. Or fabriquer du commun, ce n'est sûrement pas des scientifiques que cela peut venir : c'est une tâche essentielle du Politique. Or le Politique a externalisé depuis longtemps cette tâche nationale essentielle à l'Université (théoriquement plus incontestable, parce que plus "scientifique", tu parles), à ses débats, à ses bisbilles et à ses luttes d'influence intellectuelle sur l'air du temps (en même temps que sur les budgets de recherche : qui paie ?). Faire de la France une nation "scientifique", quelle effroyable blague !
Il a délégué inconsidérément ce qui dépendait exclusivement de l'autorité de l'Etat à des mouvements incontrôlables. Il faut le dire : le commun, il faut commencer par le vouloir intensément. Le commun, ça se fabrique, ça se désire, ça se construit, ça se cultive, ça s'entretient amoureusement comme la plante verte, ça se nourrit d'ingrédients précis (mettez Jeanne d'Arc, Vercingétorix, Napoléon, etc.). Introduire le débat, la contestation, le dissensus universitaire dans la fabrique du commun, c'est torpiller l'entreprise au départ. Tout finit par tirer à hue et à dia, comme on le constate tous les jours, et dernièrement avec la crise des gilets jaunes et le "Grand Débat National". Le politique a démissionné. Il ne faut pas chercher ailleurs les causes de l'état de délabrement actuel de la conscience nationale. Et ce ne sont pas les larmes de crocodiles versées par les politiciens (et autres) en la matière qui me convaincront du contraire.
La déliquescence actuelle du sentiment national dans la jeunesse française (au sens large) résulte clairement de l'intrusion des "scientifiques" dans les programmes scolaires. Des dégâts analogues ont été commis dans l'enseignement des mathématiques à une époque (les "mathématiques modernes") ou du français, au moment du "boum" des recherches universitaires en linguistique, inspirées par les travaux de Ferdinand de Saussure (Ruwet, Jakobson, Troubetzkoï, Hjelmslev, Martinet, Ullmann, et j'en ai encore plein en réserve, ayant un peu fréquenté la chose).
En imposant, d'une part, aux enseignants d'inclure dans leur enseignement les dernières avancées des recherches universitaires, et d'autre part en focalisant l'attention de tous ses acteurs sur les méthodes pédagogiques plutôt que sur les contenus, le système scolaire français s'est débarrassé de ses missions primordiales : apprendre aux enfants à lire, écrire et compter, leur inculquer des rudiments d'éléments concernant leurs origines et ce qui ressemble à un sentiment d'appartenance à une communauté nationale, etc. La Commission Nationale des Programmes est devenue un champ de bataille.
Avant de parler de restaurer le "socle commun", il aurait fallu commencer par ne pas le détruire, en ne cessant d'ébranler la structure de l'édifice éducatif par la folie de réformes successives, innombrables et contradictoires. Aujourd'hui, plus aucune voix et plus aucune autorité ne détient la Vérité sur l'Education Nationale, qui est devenue un espace d'affrontement pour tous les conflits qui secouent la société dans son ensemble. Plus personne, en dehors d'exceptions héroïques, ne sait ce que veut dire "former l'esprit des enfants".
Il ne faut pas s'étonner de la pulvérisation de la population en une multitude de tribus qui fonctionnent en circuit fermé et ne communiquent plus avec les autres. Il ne faut pas s'étonner que la seule survivance de ce qui fut une société est aujourd'hui une entité purement administrative et de plus en plus désincarnée.
Bon, on me dira que je suis injuste et caricatural et que je véhicule des stéréotypes qui font se hérisser l'épiderme des spécialistes. Ce n'est peut-être pas complètement faux. Mais j'aimerais bien qu'on arrête d'exonérer, sous prétexte qu'il s'agit de "recherche scientifique", les sciences humaines de tout effet social. Pour preuve, n'est-ce pas une grande sociologue (Irène Théry) qui a présidé la commission mise en place par François Hollande pour l'instauration du mariage homosexuel ?
On ne peut pas contester le fait que, en l'occurrence, la sociologue en question ne s'est pas contentée de mener des recherches "scientifiques", mais s'est comportée en véritable acteur social, et même en militante fervente, et que la sociologie a été utilisée par les promoteurs de ce "mariage" comme une arme de destruction d'un état des choses, ouvrant une forme larvée de guerre civile. Alors, neutres, les "sciences" humaines ? Mon œil.
Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Irène Théry (et ils sont loin d'être les seuls) : autant de preuves que les spécialistes des "sciences" humaines sont aussi et surtout des militants de causes, et que leur projet ne se contente plus de décrire la réalité, mais bel et bien de transformer la société conformément à des convictions particulières, et en faveur de groupes particuliers. Autant de gens qui tendent tous leurs efforts à fonder leur foi particulière dans une vérité particulière sur un socle de "rationalisation" (défroques méthodologiques exigées par l'Université, seule théoriquement habilitée à valider un "savoir") qui transforme cette croyance en savoir irréfutable, capable de s'imposer ensuite comme une Vérité universelle. Du moins dans les pays occidentaux.
La vérité de la situation, en réalité, est pire que ce que dénoncent les pessimistes. L'époque actuelle se caractérise par la disparition du politique comme mode de guidage des sociétés modernes, au profit des autres autorités en la matière, qui sont l'économie et les idéologies, ces dernières déguisées en "sciences humaines". La vérité de l'époque, c'est que les gens ne peuvent plus ce qu'ils veulent et que, de toutes les manières possibles, ils sont dépossédés de leur propre vie.
Et les sciences humaines, mises à toutes les sauces et instrumentalisées par les puissants du jour, ont leur part de responsabilité dans le désastre. Il y a aujourd'hui, dans le champ des "sciences" humaines, une lutte féroce pour la conquête du pouvoir culturel. Et je crains fort que tout ce qui relève du particulier n'ait d'ores et déjà le dessus, que l'intérêt général ait été tué dans le combat, et que la victime principale de ce combat ne s'appelle le BIEN COMMUN.
Les sectes protestantes ont gagné.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, histoire de france, nos ancêtres les gaulois, grand récit national, roman national, sciences humaines, patriotisme, linguistique, ferdinand de saussure, éducation nationale, socle commun de connaissances, irène théry, mariage homosexuel, mariage pour tous, françois hollande, pierre bourdieu, michel foucault
vendredi, 08 février 2019
CAPITALISME ET FÉMINISME ...
... OU : LE FÉMINISME AU SERVICE DU CAPITALISME.
En inventant la "domination masculine", Pierre Bourdieu a bien mérité du capitalisme pour l'immense service qu'il lui a rendu : il a détourné le regard de l'opinion publique et des chercheurs de l'Université (sociologues, historiens, psychologues, ...) des rapports sociaux (entre classes) vers les rapports sociétaux (entre catégories identitaires de population : les "communautés").
Le principe de la chose, ovationné par les riches et les puissants, n'est autre que le très ancien et efficace "DIVISER POUR RÉGNER" : quand il y a des bisbilles dans le ménage, le propriétaire peut dormir tranquille, augmenter les loyers, reporter à plus tard les travaux dans l'immeuble. Certes, le mouvement féministe était tombé dans le panneau bien avant que Bourdieu voie le jour et ne l'avaient pas attendu pour déclarer : « L'homme, voilà l'ennemi ! », mais Bourdieu, avec ses attaques contre la "citadelle masculine", est bien un excellent valet du capitalisme et une des malédictions du corps social.
Les féministes les plus intransigeantes, les plus militantes, les plus acharnées – je veux dire : les plus aveugles et les plus bornées –, vous brossent complaisamment le tableau de la marche irrésistible des femmes vers l'égalité avec les hommes. Elles se félicitent bruyamment de ce que les femmes se soient ouvert, à la force du poignet, les portes du monde du travail et puissent "faire carrière", sur l'air de "on va leur montrer de quoi on est capables !". Comme le dit excellemment Alexandre Vialatte dans Le Spectacle du monde : « De conquête en conquête, elle en est arrivée à avoir le droit de travailler Quatre-vingt-dix heures par semaine ».
Au point qu'on entend dans les médias les mieux intentionnés et quelle que soit la rubrique (cinéma, bande dessinée, postes à responsabilité, etc.) ce refrain sempiternel et comminatoire : « Où sont les femmes ? ». Ce qui me troue le fondement de la comprenette, c'est que ces fanatiques considèrent la maternité comme une injustice, voire une malédiction (sans doute ce que Camille Froidevaux-Metterie appelle "les diktats de la nature").
Elles étaient "la moitié du ciel" de Mao Tsé Toung ? Elles veulent la moitié des places. Simple question d'arithmétique : on veut des quotas partout ! Des "panels" ! Des "échantillons représentatifs" ! La méthode des sondages appliquée à toute la vie sociale ! Quelle niaiserie !
Obsédées par la "visibilité" médiatique et le rang social, elles ont fait triompher l'évidence de ce que tout le monde considère depuis longtemps comme un droit : travailler. Drôle de "droit", mais enfin. Quelle avancée, en effet ! Bon, il est vrai qu'elles dénoncent vaillamment, année après année, la scandaleuse disparité qu'on observe entre les salaires masculins et les salaires féminins. Encore un bastion à prendre ! Le combat féministe ne doit s'arrêter sous aucun prétexte.
Elles n'ont pas pensé à une chose. Certes, "à travail égal salaire égal". Cette revendication parfaitement légitime devrait d'ailleurs être devenue la règle depuis lurette. J'observe seulement la mine réjouie de monsieur Capitalisme, vous savez, le bonhomme bien nourri à cigare et haut-de-forme. Quelle aubaine, se dit-il, cet afflux de main d'œuvre sur le marché du travail. Quelle aubaine, je vais pouvoir serrer la vis aux salaires. Et si je vous annonce les salaires que je paierai aux Bangladais, vous allez prendre peur à cause du remboursement de votre pavillon de banlieue. La pression salariale ? D'abord sur les hommes, puis sur les femmes, aujourd'hui sur les Bangladais : l'alignement sur le plus bas, on appelle ça "enchères inversées". Réjouissons-nous : la femme européenne vaut plus qu'un Bangladais. Nous avons la cote.
Ben oui quoi, la loi de l'offre et de la demande. Plus un bien est commun et en grand nombre, plus son prix est bas, c'est mécanique. Pour les personnes, c'est la même chose : plus il y a foule, plus le prix de chacun tend vers zéro. Plus il y a de demandeurs d'emploi, plus les personnes ne valent rien, et plus je suis à mon aise pour "modérer" leurs exigences (en français : pour casser les salaires). C'est mécanique.
L'arrivée en masse des femmes sur le "marché" du travail (aujourd'hui des Bangladais et autres pauvres du monde), à cet égard, est ce que les patrons pouvaient rêver de mieux : la compétition des mains d'œuvre entre elles. Et avec la mondialisation, la guerre fait rage, et touche tout le monde, y compris les hommes. Mécaniquement, le prix du travail baisse drastiquement, mais pas parce que ce sont des femmes : c'est le nombre qui compte. C'est la guerre de tous contre tous. Et ce n'est pas un hasard si les professions socialement moins valorisées (enseignement, médecine, couture, etc.) sont celles où l'on observe une féminisation galopante : ça permet à l'employeur de dépenser moins.
Dans un tout autre domaine, c'est le même mécanisme (conquérir des travailleurs – à payer moins –, ou des consommateurs – à rançonner davantage) qui a permis au cigarettier Lucky Strike, à la fin des années 1920, de doubler en peu de temps sa clientèle potentielle, en envoyant des femmes fumer ostensiblement des cigarettes sous l’œil des caméras pendant une parade nationale. L'idée était d'Edward Bernays (lire son Propaganda). Le capitalisme est aussi enchanté de ce que les femmes "travaillent" (en entreprise) que de ce qu'elles achètent (en magasin). L'arrivée des femmes qui consomment sur le marché est aussi profitable à monsieur Capitalisme que l'arrivée des travailleuses dans les entreprises.
J'ai connu en d'autres temps (années 1960) la situation d'une famille nombreuse (7 enfants) qui ne roulait pas sur l'or par la profession du père, mais qui a pu occuper un magnifique appartement de 300 m² à Lyon, simplement parce que les allocations familiales étaient suffisantes pour joindre les deux bouts et inciter la femme à "rester à la maison". Mais pour les "alloc", c'étaient les années de vaches grasses. Et c'est sûr, les loyers n'étaient pas encore devenus, pour les propriétaires, la superbe rente de situation qu'ils sont devenus aujourd'hui. Tiens vous, classe moyenne d'aujourd'hui, essayez donc de faire vivre votre famille avec un seul salaire, pour voir.
L'autre outil de monsieur Capitalisme (cigare et haut-de-forme) pour contrer la revendication sociale (la seule révolutionnaire) fut l'innovation technique, présentée comme dotée d'un potentiel infini de développement. Quand il fallait manœuvrer un aiguillage d'ancienne génération, une musculature "appropriée" était exigée. Aujourd'hui, la technique a fait du basculement du lourd levier métallique un simple bouton à presser. Même chose dans le domaine des poids lourds, où il fallait autrefois des biscotos d'athlète pour tourner le volant du 10 tonnes Berliet : la direction assistée a fait ce miracle.
L'accès des femmes au monde du travail salarié est donc le résultat d'une double volonté capitaliste : faire baisser le salaire individuel et rendre les tâches physiquement accessibles à des personnes théoriquement plus faibles, donc jugées moins "productives" et moins "exigeantes". Ce qu'on n'appelle plus aujourd'hui les "Arts ménagers" est emblématique du slogan qui appelait à "libérer la femme" de son « immémoriale assignation domestique » (splendide ineptie de Camille Froidevaux-Metterie) : plus le monde domestique est gouverné par des boutons (c'est tellement simple, mais il faut quand même charger, et décharger la machine, et on n'a pas forcément fini), plus la femme est "libérée". Alors, Madame, qu'est-ce qu'on dit à Monsieur Capitalisme ?
Une conséquence sûrement vénielle de cette participation massive des femmes aux tâches productives du pays est qu'il est tombé deux salaires au lieu d'un dans la famille à la fin du mois. En apparence, c'est tout bénéfice. Et en effet, dans les classes moyennes, on a pu améliorer nettement le confort de la maison et la qualité du mode de vie. Mais qu'est-ce qu'on observe, au bout de quelques décennies de ce régime ? C'est que, tendanciellement, le pouvoir d'achat du couple a régressé ou, au mieux, stagné, comme le montrent de multiples témoignages de gilets jaunes. Je l'ai dit : combien de familles peuvent vivre aujourd'hui avec une seul salaire ? Soit dit en passant, c'est à l'aspect hétéroclite du phénomène des gilets jaunes que l'on mesure l'état de délabrement et d'obsolescence des "structures intermédiaires" (syndicats, ex-partis traditionnels et autres).
Monsieur Capitalisme s'est dit que, puisque monsieur, madame et les enfants vivaient bien, il était inutile de pousser la locomotive des salaires. Oh, soyons-en sûr, ça s'est fait très progressivement, de façon imperceptible. Mais un beau jour il suffit d'une "modeste" taxe supplémentaire sur un carburant pour que la situation réelle d'une masse de gens éclate au grand jour, fasse sauter le couvercle de la cocotte, et lance la couleur jaune en masse sur la voie publique, là où personne n'attendait un tel refus, puissant et massif, même si le corps social qui le porte est hétéroclite. Aux échelons inférieurs de la société, il y a bien une homogénéité des conditions de vie, en direction d'une précarité de plus en plus partagée.
Comme quoi les conquêtes obtenues par les luttes pour "l'émancipation féminine" ne sont pas sans quelques effets pervers, quand on observe la situation sous un certain angle. Comme quoi les militantes féministes, surtout les plus exaltées (voir mon billet du 3 février), servent, sûrement sans l'avoir voulu, les projets de monsieur Capitalisme, en occupant le devant de la scène, en faisant, en quelque sorte, diversion. Car elles éloignent ainsi de lui le danger combien plus menaçant que fait peser lui le combat d'une masse de gens pour une société plus juste, une société qui redistribue les richesses de façon plus équitable, et qui empêche les vampires de confisquer à leur seul profit le surplus des richesses produites.
Ce qui me réjouit le plus dans le phénomène "gilets jaunes", c'est précisément que la justice sociale et la répartition des richesses jouent de nouveau les premiers rôles. Je ne suis pas hostile à un certain féminisme, à condition de ne pas mettre la charrue devant les bœufs et de ne pas inverser l'ordre des priorités : la meilleure méthode est celle qui va du général au particulier, ce que la visibilité tout à fait excessive et disproportionnée de quelques "minorités" (suivez mon regard) a tendance à faire oublier.
Les minorités ne se battent que pour elles-mêmes. Les minorités se plaignent du sort qui leur est fait à elles. Les minorités s'étalent en victimes aux yeux de tous. Les minorités sont par nature égoïstes, fermées sur elles-mêmes. Les minorités n'ont aucune idée de ce qu'est l'intérêt général. Les minorités se foutent éperdument de la République. Les minorités ainsi conçues (à l'américaine) sont de simples nuisances.
Quand la justice pour tous aura été instaurée, il sera temps alors de s'occuper des finitions.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : mon analyse n'a certes pas la rigueur d'un travail universitaire évalué par les pairs, mais à mon avis, l'intuition qui lui sert de fil rouge n'est pas si éloignée que ça de la réalité qu'elle est censée décrire.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : féminisme, capitalisme, pierre bourdieu, la domination masculine, diviser pour régner, machisme, camille froidevaux-metterie, diktats de la nature, société
dimanche, 03 février 2019
D'UN CRÉTINISME FÉMINISTE
OH LA BELLE BOUSE !
Nous parlons donc de la "Nuit des idées", la grande brasserie où toutes les élucubrations sont admises, et même suscitées, à partir d'un certain degré d'imbibition. La plus manifestement imbibée des interventions dans le dossier paru dans Le Monde du 31 janvier est celle de Camille Froidevaux-Metterie, philosophe, paraît-il. Madame est une féministe, et ce n'est rien de le dire : il faut lire cette prose pour comprendre à quel degré de décomposition sont arrivées certaines élites intellectuelles dans les pays riches. Décomposition découlant peut-être de la circulation consanguine des idées dans le cercle fermé des élites parisiennes, et l'on sait ce que le "Crétin des Alpes" doit à la consanguinité (voir Le Médecin de village, de Balzac).
Si elle se contentait d'être professeur (non, je ne mets pas de "e") de science politique, je me contenterais de m'assoupir et de somnoler au son de sa musique. Mais elle est également « chargée de mission égalité-diversité à l'université de Reims ». Alors là pardon, mais ça sent très fort, ce machin-là, et vous savez quoi ? Ça fleure bon l'air du temps, le poncif exigé de tout ce qui se prétend "moderne", bref : le nouveau stéréotype (inavoué comme tel, bien sûr) installé en lieu et place des vieux "stéréotypes", violemment dénoncés. La même odeur faisandée (et policière par ailleurs) que tout ce qui proclame avancer sur le chemin triomphal du Progrès indéfini.
Elle commence par un historique de la « condition féminine », où se succèdent les triomphes du féminisme, un historique qui prouve l'inéluctabilité de la marche des femmes vers la disparition de l'injustice que l'humanité masculine leur fait subir depuis 30.000 ans (au fait, c'est quand, "l'aube de l'humanité" ?), du fait de la "domination masculine" (le titre fameux de Bourdieu sonne comme une forfaiture). Dogme selon lequel l'homme, dès les temps préhistoriques, se serait approprié le corps des femmes, les maintenant dans une odieuse sujétion. Et l'on entend le chapelet des refrains habituels : « immémoriale assignation domestique », « bastions masculins de l'économie et de la politique », « mécanismes par lesquels la domination masculine se perpétue ». Rien que du classique, en Bourdieu dans le texte.
Elle formule alors une phrase qui constitue selon moi un point culminant de la sottise qui sort à jet continu d'un certain féminisme. Après avoir noté que « les facteurs d'oppression sont pour beaucoup multiples » [?], elle se lance : « Reste qu'il faut pouvoir le repérer [quoi ? ce n'est pas clair], la condition féminine au présent est inédite au point d'annoncer une mutation anthropologique : nous sommes entraînés dans un mouvement de désexualisation des rôles privés et des fonctions sociales qui fait signe vers l'avènement d'un individu générique affranchi des diktats de la nature comme des injonctions de la culture ».
Oh la belle déjection bovinoïde ! Oh l'incroyable théorie de la liberté humaine qui transparaît en filigrane ! Oh la belle conception de la nature ("diktats") et de la "culture" ("injonctions") ! Oh la belle vision de l'individu libéré de tout lien, flottant dans le liquide amniotique de son propre moi et de ses perspectives d'accomplissement personnel ! Je remarque juste que la "mutation anthropologique" a encore quelques siècles devant elle pour gagner la Terre entière. Et l'on peut remplacer sans problème "individu générique" par "individu interchangeable". Sûrement un indéniable "progrès", dans l'esprit de la dame.
Allez, encore quelques fleurs poussées sur ce "compost" (pour être gentil) : « la parentalité n'est plus l'exclusive des couples hétérosexuels » ; « tout individu, quels que soient son sexe, son genre ou sa sexualité, doit se voire reconnaître la légitimité de son désir d'enfant » ; « il s'agit de la [la sexualité] désinsérer de son cadre hétéronormé et d'en finir avec les normes viriles qui la caractérisent pour repenser la rencontre des corps au prisme de la liberté et de l'égalité ». Si j'ai bien compris, le fait pour l'individu de désirer avoir un enfant lui ouvre ipso facto un droit. Et par ailleurs, la dame semble être atteinte d'hétérophobie obsessionnelle. Mais qu'attend le législateur pour mettre fin à cette intolérance et rendre justice aux gens normaux ? Et j'ai la curieuse impression que la dame fait du rapport à la sexualité un critère central.
Maintenant le bouquet final : « Elle [la bataille de l'intime] montre en tout cas, et c'est sans doute le plus difficile à saisir, que la désexualisation n'est pas synonyme de désincarnation : elle ne fera pas de nous des anthropes asexués. La mutation à l'œuvre replace tout au contraire le corps au cœur de nos vies. Simplement, ce n'est plus au prisme binaire des sexes et des genres qu'il faut penser, mais dans les termes inédits de la singularité sexuée et de la fluidité genrée. Il nous reste donc à réfléchir aux conditions nouvelles dans lesquelles s'expriment, au présent, nos existences incarnées ».
Désexualisation, désincarnation, "fluidité genrée", mais où va-t-elle chercher tout ça ? Certains esprits mal tournés pourraient se demander s'il n'y a pas là une tendance à l'onanisme ou à la sodomisation des diptères. Voilà de la confiture de crâne ! Je souhaite bien du courage à celui qui se lancera dans une explication du texte. Et je note l'exaltation incantatoire qui anime son auteur, qui me fait penser – toute proportion gardée – aux envolées lyriques de tous les "philanthropes" qui ont projeté de fabriquer des "hommes nouveaux" et qui ont fait du 20ème siècle un bain de sang.
La remarque qui me vient, après ce festival conceptuel, est que la dame est résolument hermétique à ce qui se passe tout en bas de chez elle, très loin, dans les couches modestes de la société : il faut être singulièrement nanti pour se lancer dans ces acrobaties intellectuelles. Le plus étonnant est d'ailleurs qu'elle l'avoue : « Il va de soi que ces évolutions concernent avant tout les classes les plus favorisées ». "Il va de soi", bien entendu et de toute évidence. Je voudrais voir la dame développer ses théories au comptoir du Café de la Crèche, pour assister au spectacle. Je l'imagine enivrée de ses discours, et je comprends tout de suite qu'elle et ses semblables vivent bien à l'abri du vulgum pecus, dans leur bocal intellectuel.
Et je me dis que si toutes les élites politiques, économiques et intellectuelles du pays sont dans cet état de décomposition, le phénomène des "gilets jaunes" devient immédiatement logique, évident, aveuglant : protégées par les remparts de la citadelle sociale où elles se reproduisent, ces élites échafaudent des représentations autonomes, libérées de la contrainte d'une quelconque réalité concrète. A ceci près que ces représentations finissent par façonner les nouvelles réalités qui s'imposeront « pour leur bien » aux masses ignorantes, de gré ou de force. Emmanuel Macron (le pouvoir), Carlos Ghosn (l'argent), Camille Froidevaux-Metterie (le savoir) : un trio qui illustre à merveille la méconnaissance, l'indifférence et le mépris d'une caste de nantis pour les gens ordinaires.
Pour Macron, Ghosn et Froidevaux-Metterie, ce sont les élites qui guident le peuple. Cette écœurante saloperie aujourd'hui saute aux yeux. Ce "Progrès"-là, franchement, non merci.
Voilà, c'est la "Nuit des idées" : des mots, des discours, du langage, des "énoncés performatifs" pour sauver le monde ? Même question à propos du "Grand Débat National". Croyez-vous sincèrement que ces parlotes vont changer quelque chose à la situation concrète qui a provoqué la crise des gilets jaunes ?
Voilà ce que je dis, moi.
Note : la première fois que j'ai entendu l'extravagance selon laquelle la domination masculine remonte à la préhistoire, c'est dans la bouche de Michelle Perrot, bouche ô combien oraculaire de la cause des femmes. Il n'est venu à l'esprit de personne de répliquer que s'il en est ainsi, c'est qu'il y a peut-être une raison objective. Mais non : l'idéologie est la plus forte, on n'en démord pas, on tient à ses lunettes hallucinatoires et à sa grille de lecture définitive. Un fois pour toutes, l'homme est dominateur, un point c'est tout.
lundi, 30 juillet 2018
UN GÉOGRAPHE HORS-NORME
YVES LACOSTE
AVENTURES D’UN GÉOGRAPHE
Equateurs, 2018
Yves Lacoste est un géographe à la renommée solidement établie. Chaque fois que je l’ai entendu à la radio, j’ai été saisi par l’originalité de son propos. Je veux dire que je n’aurais jamais pensé à mettre en relation des faits appartenant à des domaines différents. Je me souviens par exemple qu’il avait opposé, en comparant l'Asie du sud-est et l'Afrique, deux sortes de tracés de frontières, suivant qu’ils étaient conçus par des officiers de marine ou par des officiers d’infanterie (on parle de l’époque coloniale), avec une prime à l’intelligence et à la pertinence accordée à la marine, alors que les « biffins » avaient tendance à tirer des lignes droites. Je n’ai pas cherché à savoir si l’idée était toujours opérationnelle : je m’étais contenté d’apprécier l’inattendu de la conception.
Je viens de lire Aventures d’un géographe, paru très récemment. Le livre se présente curieusement comme des « Mémoires ». Curieux, en soi, à cause du nombre de pages (330), mais aussi à cause du contenu, d’aspect beaucoup trop schématique (mais ça va avec) à mon goût. J’aurais aimé en particulier que l’auteur entre beaucoup plus dans les détails, s’agissant des problématiques envisagées.
Il concentre son récit autour de deux points qui constituent, pense-t-il avec raison, son principal apport à la discipline. D’abord, avoir arraché la « géopolitique » à l’acception qu’elle avait sous le régime nazi : « Je lui [Julien Gracq] répondis que les géographes allemands avaient proclamé de prétendues lois instituant la propriété des peuples germaniques sur certains territoires » (p.254). Ce que les nazis appelaient, je crois, le "Lebensraum" (espace vital). Ensuite, d’avoir fondé la revue Hérodote, devenue un outil indispensable dans l’exercice de la profession de géographe.
Je n’ai jamais fréquenté la revue, mais j’aurais lu avec beaucoup d’intérêt la narration circonstanciée de l’installation du mot « géopolitique » dans le langage des géographes, avec les aléas, les oppositions rencontrées, bref : les heurs et malheurs d’un concept qui, de mal famé qu’il était, est devenu d’un usage tellement courant que les journalistes l'invoquent souvent à tout bout de champ. Un volume de 600 pages ou davantage ne m’aurait pas fait peur. C’est dire que je reste (un peu, n'exagérons pas) sur ma faim.
Même remarque à propos de l'ouvrage – à léger parfum de scandale – par lequel il s’est fait un nom : La Géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre (Maspero, puis La Découverte) : « Et le petit livre bleu hérissa en effet la confrérie » (p.7). J'ai du mal à comprendre les raisons de cette réaction : ne parlait-on pas depuis longtemps de "cartes d'état-major" ? Or, si la carte est forcément géographique, qu'est-ce qu'un état-major, sinon le haut commandement militaire dirigeant des opérations, c'est-à-dire un acteur de l'histoire ? J’aurais aimé en savoir plus sur les raisons de l’hostilité déclarée des confrères géographes. Yves Lacoste préfère s’étendre sur le peu de considération dont jouissait la géographie dans la hiérarchie intellectuelle et son souci de participer à sa revalorisation : il voulait qu’on puisse le prendre au sérieux, et pour des motifs solides. Il avait bien raison, même si j’aurais été intéressé, par exemple, par un chapitre évoquant plus précisément la réception de l’ouvrage "scandaleux".
Si j’ai bien compris, la géopolitique, c’est précisément la mise en rapport des données de la géographie d’un territoire précis (question d'échelle : cela peut aller de quelques centaines de mètres à plusieurs centaines, voire milliers, de kilomètres) avec les événements qui se produisent sur ce territoire, conditionnés par ces données. La géopolitique traite des rapports de forces qui s'exercent sur un territoire. Dans le fond, la géopolitique, c’est vouloir expliquer la géographie par l’histoire, et envisager d’expliquer un certain nombre de faits de l’histoire par les données de la géographie. Il me semble qu’un certain Bismarck (1815-1898) avait déjà eu de telles idées, mais je ne suis pas spécialiste (est-il l'auteur de cette formule dont je crois me souvenir : « La seule chose qui ne change pas dans l'histoire, c'est la géographie » ?).
Et le duc de Saint-Simon, quand il commente certaines batailles perdues ou occasions manquées par l’un des bâtards de Louis XIV (le duc de Vendôme, je crois bien), ne manque pas de souligner, en plus de la paresse native de ce dernier, le peu d’à-propos avec lequel il choisissait et organisait le terrain de ses « exploits ». Et quand il relate les entreprises militaires (du début du printemps à la fin de l’automne, chaque année ou à peu près), il ne manque jamais de commenter l’intelligence ou la bêtise du général en chef dans la disposition des troupes en fonction du terrain, qu'il s'agisse de franchissement de fleuve, d'occupation d’une position dominante, de passage d’un défilé ou de défense d'une cité fortifiée, à l'exemple de celle, splendide, que le marquis de Boufflers conduit lors du siège de Lille, mené par le prince Eugène). Oui, la géographie est bien une constante des événements historiques.
Ce qui intéresse le spécialiste de géopolitique, ce sont les interactions entre la conformation d’un site et la façon dont se produisent les rapports entre les forces en présence ou l’affrontement des volontés et des intérêts. Cette préoccupation constante de l’auteur l’amène à conduire ses étudiants sur le terrain, dans la vallée de Chevreuse ou sur la Montagne de Reims : « En effet, il est interdit de planter de la vigne sur la totalité des versants de la Montagne de Reims. Il s’agit d’une décision du Comité interprofessionnel du vin de Champagne qui engendre d’énormes écarts de prix entre deux parcelles voisines, l’une plantée de vigne, l’autre où c’est interdit » (p.224). Voilà un exemple de passage où, n’étant pas géographe, j’ai du mal à comprendre les tenants et aboutissants du problème. Cette histoire de pente, de sable, de lignite et de prix du champagne me semble nébuleuse, faute de précision.
Dans un autre chapitre, en revanche, Yves Lacoste raconte comment il a été amené à intervenir au Vietnam, pendant la guerre et les bombardements américains : chapitre absolument passionnant. Je passe sur les aspects anecdotiques (croustillants : comment voyager en avion sans visa avec un billet offert en douce). Les Américains avaient imaginé de bombarder les digues qui contenaient les eaux du fleuve Rouge : « … j’écrivis un petit article très pédagogique expliquant que le fleuve coule au-dessus de la plaine du delta surpeuplée, et je l’avais envoyé au journal "Le Monde" » (p.180). Le journal publie l’article.
La suite est étonnante : les Nord-Vietnamiens ont immédiatement compris le parti qu’ils pouvaient tirer des compétences et du regard particulier du géographe, et le lui font savoir. Sautant allègrement par-dessus les formalités avec l'aide obligeante des soviétiques, il atterrit à Hanoï, il réclame et finit par obtenir les cartes, malgré le secret militaire, où figurent « les points qui ont été atteints » (p.182). On apprend que « la rupture d’une digue est plus probable si elle a été attaquée dans la partie concave du méandre, parce que c’est là que s’exerce surtout la pression du courant » (p.183). « Le réseau des digues du fleuve Rouge est l’un des plus complexe au monde et il faisait l’admiration de Pierre Gourou. Ces digues ont été construites en terre compactée par la mobilisation du peuple vietnamien au cours des siècles, de l’amont vers l’aval » (p.185). Pierre Gourou est l’auteur d’une thèse sur le fleuve Rouge.
Le plus fort de l’affaire montre que la géopolitique peut à l’occasion devenir un acteur dans un conflit, car la conclusion fut la suivante : « De retour à Paris, je me suis rendu au siège du "Monde" qui publia l’après-midi même la carte du delta du fleuve Rouge représentant les digues et les points bombardés, ainsi que mon commentaire. Des journaux du monde entier l’ont repris, même au Japon et aux Etats-Unis. Quelques jours plus tard, les bombardements américains sur les digues cessèrent » (p.186). On imagine sans peine la catastrophe humaine que le géographe a permis d’éviter. Yves Lacoste peut être fier : il a arrêté l’aviation américaine ! D'un autre côté, on pourrait souligner qu'il a mis clairement la géopolitique au service de l'un des belligérants, faisant fi de la sacro-sainte neutralité scientifique, mais bon.
Un autre chapitre tout à fait intéressant raconte la rencontre de l’auteur avec Julien Gracq, lui-même professeur d’histoire et géographie. L’idée lui en est venue à la lecture du Rivage des Syrtes, ce roman somptueux qui a obtenu le prix Goncourt (refusé par Gracq), et dont la trame illustre bien la phrase de Voltaire : « L’homme est fait pour vivre dans les convulsions de l’inquiétude ou dans la léthargie de l’ennui ». Un jeune aristocrate, rouage du destin, provoque la fin catastrophique de son pays, la principauté vieillissante d’Orsenna, parce qu’il finit par ne plus supporter la vie étale, immobile et sans relief qu’il mène dans le poste où il a été affecté à sa demande.
Yves Lacoste écrit à Gracq pour lui dire qu’il lui semble qu’il a écrit un « roman géopolitique ». La rencontre a lieu chez le romancier. Il lui explique que le terme sert à « désigner toute rivalité de pouvoirs sur un territoire et confronter les arguments des uns et des autres » (p.254). « Dans ce roman, lui dis-je, vous vous attachez aux signes avant-coureurs du nouvel affrontement à venir entre le Farghestan mystérieux, voire mystique, et les grandes familles vieillissantes d’Orsenna » (ibid.).
Il va jusqu’à faire dessiner par un spécialiste la carte « en perspective cavalière » de la façon dont il se représente la disposition des lieux tels que Julien Gracq les a imaginés. « Désorienté » par une précision demandée par Lacoste, le romancier lui répond, « presque en s’excusant » : « Vous savez, j’ai seulement voulu faire un "tremblé géographique" » (p.255). Pour un lecteur assidu de Julien Gracq, voilà un chapitre qui ne manque pas d’intérêt, en ce qu’il lui procure une grille de lecture inédite.
Il faudrait encore faire un sort aux multiples centres d’intérêt sur lesquels Yves Lacoste a été amené à travailler : Ibn Khaldoun, la Haute-Volta, Cuba, voire mentionner les recherches de son épouse sur les Kabyles. Ce dernier point donne à l’auteur quelques occasions délectables de s’en prendre aux thèses de Pierre Bourdieu : mon dieu, une tache sur la statue ! Au total, un livre foisonnant d’aperçus d’une grande variété. Si j’avais une réserve à faire, ce serait donc à propos du nombre de pages, à mon avis insuffisant pour combler la curiosité du lecteur, frustré par l’évocation trop rapide de certains aspects du travail de ce géographe hors-norme.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yves lacoste, géographe, géographie, aventures d'un géographe, éditions des équateurs, géopolitique, revue hérodote, la géographie ça sert d'abord à faire la guerre, éditions maspéro, éditions la découverte, duc de saint-simon, mémoires de saint-simon, guerre du vietnam, fleuve rouge, pierre gourou, julien gracq, littérature, prix goncourt, le rivage des syrtes, ibn khaldoun, kabyles, pierre bourdieu
jeudi, 05 avril 2018
2-LA PLANÈTE DES RICHES
27 décembre 2017
Des nouvelles de l'état du monde (14).
2/5
Egalité : la première ... et puis toutes les secondes.
La gauche cosmétique, sous son nez rouge et avec son couteau en carton entre les dents, a pris sa carte au parti capitaliste, adhère pleinement à l’économie de marché et a cessé de lutter contre les vraies inégalités. Même qu'il y a de vrais économistes (ceux qui gardent dans leur discipline sa facette éminemment politique) qui émergent pour donner un peu de publicité à une vérité qui aurait été jugée scandaleuse il n'y a pas si longtemps. Certains appellent ça une conversion, d’autres un reniement ou une trahison. Cela s’appelle aussi, en termes politiques, la droite.
Mais attention : « progressiste », cela va de soi. L’ultralibéralisme "gauchiste" (guillemets à cause du flou de cette "gauche") rejoint ainsi l’ultralibéralisme économique. Un seul principe les réunit : la dérégulation absolue, c'est-à-dire la destruction de toutes les normes – dans le commerce ou dans les mœurs – et de tous les critères de jugement. Tout doit être possible. Leur mot d’ordre : « Il est interdit de m’interdire quelque chose ». C’est mai 68 réactualisé : « Jouir sans entraves ! ». Aux uns le commerce et la finance, aux autres les mœurs et la police quotidienne au ras du bitume.
C’est fini, l’égalité à la grand-papa. Il faut lui donner un coup de jeune en la conjuguant au pluriel. Car l’égalité a fait des petits. Foin des inégalités sociales, dénonçons les inégalités sociétales ! Il convient de promouvoir désormais des égalités partielles, des égalités particulières, des croupions d'égalités, tout plein d’égalités spécifiques, un ramassis touffu d’égalités éparses qui se bousculent, se tirent la bourre, se courent après pour arriver sur le devant de la scène et briller enfin pour faire reconnaître dans la loi la légitimité de leurs justes revendications et le châtiment pour ceux qui les bafouent (handicapés, musulmans, noirs, femmes, homosexuels, arabes, etc. ad libitum). Dernière trouvaille en date : l’inénarrable (et illisible) « écriture inclusive ».
C'est la très vieille technique du chiffon rouge ("rideau de fumée" n'est pas mal non plus, même si la réalité marine et militaire de la chose ne dit plus rien, concrètement, à personne), qui permet à des gens mal intentionnés, en suscitant des "débats de société" en phase avec l'air du temps, de faire oublier l'essentiel, la question qui englobe et conditionne les autres : la question des conditions globales qui sont faites à l'humain, à commencer par les conditions matérielles.
Il y en a que ça arrange, de voir la piétaille se chamailler sur des thèmes qui leur garantissent une tranquillité à toute épreuve. Ils sont même prêts à mettre l'huile qu'il faut à l'endroit où le feu ne demande qu'à prendre : les gens pris dans le gras de la masse ne deviennent dangereux pour leurs intérêts que s'ils se liguent une bonne fois. Ce n'est pas demain la veille : selon toute vraisemblance, leurs intérêts n'ont pas de mouron à se faire. Parler de l'égalité homme-femme, du sexisme, de l'islamophobie, de l'antisémitisme, du racisme ou de la tolérance, ça permet aux gens sérieux de parler affaires sans être dérangés. Les foules qui s'intéressent à la guerre des sexes, à la guerre des religions, à la guerre de la normalité, à la guerre des cultures (les médias et les réseaux sociaux raffolent de ces affrontements) laissent une paix royale aux gens riches, et qui entendent bien le rester en se dotant de tous les moyens pour accroître les écarts de richesse.
C’est quoi, les vraies inégalités ? Pour faire simple, je réponds : celles qui touchent les conditions concrètes, objectives, matérielles de la vie. Ce n’est pas la même chose, j’espère, que celles qui concernent les modes de vie et les relations entre les individus ou les groupes, forcément empreintes de subjectivité et de toutes sortes d’affects (émotions, sentiments, désirs, frustrations, agressivités, tendresses, culpabilités, etc.).
Si on laisse la bride sur le cou aux subjectivités, si on laisse libre cours aux affects, on a toutes les chances d’instaurer pour longtemps la loi de la rancœur, de l’hostilité, de la haine et du règlement de compte entre les gens. Tout le monde a quelque chose à reprocher à quelqu’un, tout le monde a quelque chose à réclamer. Personne n'est « l'ami du genre humain » (le grand reproche d'Alceste à Philinthe au début du Misanthrope). Un critère objectif est nécessaire. Tenir compte des vraies inégalités tangibles est garant d’une certaine pacification des relations. Il est moins nécessaire de lutter pour l'égalité que contre l'inégalité des conditions : pas le communisme, mais des mécanismes d'une redistribution raisonnable des richesses produites. Ce qui est sûr, c'est que plus une société est inégalitaire, plus elle est régie par la violence.
Or le déplacement de la gauche vers la « gôche », c'est-à-dire les yeux fermés sur la montée des inégalités, fait que le règlement de compte se répand. C’est ce qui est en train de se passer et que nous constatons jour après jour : la pression de plus en plus audible et visible des revendications spécifiques de groupes particuliers, a fait entrer la France dans l’ère de « la société de la plainte », où ceux qu’on entend le plus sont, de deux choses l'une, soit des plaintifs, soit des plaignants. Les uns implorent la pitié, les autres portent plainte. Dans un cas on réclame une indemnisation, dans l’autre des dommages et intérêts. Dans les deux, on est intouchable. C’est à qui sera, plus que les autres, victime d’un préjudice. Malheur aux malheureux qui ne sont victimes de rien : ils n’existent pas.
Dans la société de la plainte, les vraies inégalités passent à la trappe. Dans la société de la plainte, pendant que les bisbilles sociétales font diversion et qu'on s'invective entre hommes et femmes, entre musulmans et chrétiens, entre handicapés et normaux, entre homos et normaux, entre blancs et noirs, entre Arabes et Européens, du moment qu'on a du débat de société à se mettre sous la dent, les plus riches s'enrichissent, achètent des tableaux hors de prix, jouent à la bourse, et mènent, somme toute, une existence pépère.
Dormez en paix, maîtres du monde. Dans la société de la plainte, le sommeil satisfait des puissants n'a jamais été aussi satisfait et puissant.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la planète des riches, lutte contre les inégalités, laurent joffrin, journal libération, journal le monde, warren buffett, gérard filoche, parti socialiste, benoît hamon, crif, érinnyes, twitter, journalistes, ultralibéralisme, boris vian, une bonn'paire de claque, écologie, pierre bourdieu, enseignement supérieur, université française, parcoursup, séletion des étudiants
mercredi, 04 avril 2018
1-LA PLANÈTE DES RICHES
26 décembre 2017
Des nouvelles de l'état du monde (13).
1/5
Contre les inégalités, mais lesquelles ?
Le monde va de mieux en mieux. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Laurent Joffrin dans un éditorial du « journal » Libération, vous savez, cet organe des rats de la gauche sociétale qui ont quitté le navire de la critique du capitalisme pour la barque de la critique des mœurs et de la promotion des « libertés individuelles ». Plus personne hormis la gauche gesticulatoire et postillonneuse (Mélenchon, Hamon, etc.) ne s'oppose sérieusement au système marchand tel qu'il est. Tout le monde a baissé pavillon et admis la conclusion du milliardaire américain Warren Buffett (si ce n'est pas George Soros) après la chute de l'empire soviétique : « Les riches ont gagné la guerre ». Il n'y a plus aucun frein pour modérer la furie de la locomotive de l'argent.
Pour ne pas défunter, pour continuer à croire qu'elle peut se prétendre « degôche », pour s'accrocher à ses rêves vermoulus de lendemains meilleurs, « la gauche » a mis une chemise propre et un accent circonflexe sur son "o", et elle a changé de boussole, de cheval et son fusil d'épaule. Elle est passée de la lutte des classes à la lutte des « identités » et des « minorités », important servilement des Etats-Unis toutes sortes de problématiques spécifiquement américaines (un exemple parmi d'autres : combien de noirs en France sont abattus de huit balles dans le dos dans leur jardin par la police ?).
Elle a enfourché la monture des relations entre les gens, entre les sexes, entre les religions, sur la base de critères nouveaux, comme le "respect", l' "antiracisme", la lutte contre les "discriminations" ou l' "intolérance", répandant de ce fait même un nouveau type de féroce intolérance, de type policier. Cette nouvelle « gôche » a continué à traquer la domination, mais une domination mieux circonscrite, plus "ciblée", plus "foucaldienne", du nom célèbre d'une sommité du "combat" des "minorités" contre les normes, la hiérarchie des valeurs (forcément arbitraire, n'est-ce pas).
Elle a cessé de s'attaquer à ceux qui détiennent le vrai pouvoir, je veux parler de l'argent, pour s'attaquer à ceux, y compris au plus bas de l'échelle sociale, détiennent injustement un "pouvoir", tout symbolique celui-là. C'est une cible tellement plus commode : militantes féministes, militants homosexuels (le film 120 Battements par minute – une propagande homosexuelle de plus – est entré dans la chair de la société comme dans du beurre mou), militants islamophiles, militants noirs (victimes du "racisme d'Etat", selon Rokhaya Diallo), militants de, militants pour, etc.
Cette « gôche », aidée en cela par la créativité conceptuelle de sociologues influents (des « scientifiques », on est prié de ne pas en douter), a laissé tranquilles les vrais détenteurs du pouvoir, pour s'en prendre à un seul de leurs traits communs : le masculin. L'équation est aveuglante d'évidence et de simplicité : pouvoir = masculin. Un esprit rassis pourrait trouver superflu, voire nuisible d'accoler quelque adjectif qualificatif que ce soit ("masculin" ou autre) au mot "domination", mais on nous dit qu'il s'agit de circonscrire le problème. Grâce à Pierre Bourdieu, voilà qui est fait : on parle donc de "domination masculine". Désormais, fini les grandes remises en question de la puissance en soi des ploutocrates : à n'en pas douter, ce sont des hommes. Dès lors, rien n'est plus important, d'une part, que de déboulonner les statues viriles et, d'autre part, que de « recréer du lien social » et de promouvoir le « vivre ensemble » : c'est plus facile. C'est là qu'il est, le « progressisme », et nulle part ailleurs.
La « gôche » s'est faite sociétale, c'est-à-dire cosmétique, inodore et incolore, quoiqu'assez discrètement (en fait, pas tant que ça) autoritaire (aidée en cela par maints ajouts au Code Pénal). Et bien sûr totalement inoffensive en ce qui concerne les vraies causes : la gauche de gauche a avoué sa défaite. Plus personne pour défendre les laborieux. Les syndicats (je devrais dire : les hautes autorités syndicales, parce que la base, elle, ...) ? Ils se sont tellement compromis avec les puissants de l'Etat et de l'Entreprise pour cogérer le système dans une bonne entente au temps des vaches grasses, qu'ils se sont finalement disqualifiés aux yeux de ceux qui triment. Les laborieux sont en réalité laissés à eux-mêmes et au bon plaisir des majestés modernes. Etonnez-vous ensuite qu’ils se laissent enivrer par les senteurs Marine.
La « gôche » a mis en place une vigilance sourcilleuse pour observer comment les individus se comportent avec les autres, et attaquer les récalcitrants qui regimberaient devant la "solidarité", le "respect", la "tolérance", l'humanitarisme et le multiculturalisme. Les gens de cette "gôche" dévoyée forment les rangs serrés de la police des mœurs, du langage et de l'expression libre des idées. La valeur cardinale et sacrée qui sert de boussole à cette « gôche » est la défense inconditionnelle des « droits des individus » et ce, quelles que puissent être les conditions générales faites par ailleurs aux humains par le dit capitalisme, qui continue comme avant à ratiboiser ce qui survivait, dans les pays industrialisés, des modestes conquêtes des travailleurs (qui ont plus ou moins embourgeoisé la classe ouvrière), et à mettre la planète en coupe réglée.
A cet égard, le rapport sur les inégalités publié par une centaine d’économistes, dont Le Monde rend copieusement compte sur trois jours (15/17 décembre 2017), est sans ambiguïté : les choses s’aggravent diablement. Mais l’économie furieuse d’un marché furieusement dérégulé peut réduire l'individu à ses valeurs marchandes de performance, de productivité et de rentabilité, le « journal » Libération, Laurent Joffrin en tête, estimera que le monde va de mieux en mieux, aussi longtemps que les « droits des individus » ne cesseront de progresser, grâce à la dénonciation méticuleuse de la moindre atteinte à ceux-ci (lutte contre les « discriminations » et les « stigmatisations »), et au zèle de militants associatifs plus vigilants que Cerbère et souvent plus hargneux que Mégère en personne, cette sœur haineuse d’Alecto et Tisiphone.
Un seul mot d'ordre, peut-être inspiré des méthodes éprouvées mises en œuvre par le CRIF : « On ne laisse rien passer ». Sous-entendu : « Il ne faut pas laisser passer la plus petite occasion de faire parler de nous : c'est pour défendre la cause ». Pour cela, veille internet permanente, surveillance des "réseaux sociaux" (touiteur, fesse-bouc, etc ..., comme Gérard Filoche vient d'en faire les frais, sous prétexte d'antisémitisme), chaîne d'alerte, entretien de relais médiatiques : un boulot à plein temps. Quand on fait dans le sociétal, on n'est pas des feignants.
Le « Progrès » se mesure exclusivement, selon eux, au caractère indéfiniment extensible des « libertés individuelles ». Cette extension se mesure à la force, à la virulence et à l'intensité, c'est-à-dire "à l'audience médiatique" des oppositions ("homos" contre "manif pour tous", Charlie Hebdo contre Médiapart, etc.) qui s'efforcent de lui mettre des bâtons dans les roues. Les journalistes courent derrière ce genre de face-à-face comme des ânes derrière la carotte : l'actualité en prend soudain des saveurs moussantes tout à fait roboratives. Pour neutraliser et disqualifier toute velléité d'opposition, la recette est désarmante de simplicité : rebaptisez-la illico du doux nom de « phobie ». Vous êtes femme, juif, handicapé, musulman, homosexuel, noir (rayer les mentions inutiles, ajouter celles qui ne figurent pas), utilisez le mot « phobie » et observez : ça fait taire. C'est le but : faire taire.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : texte longuement révisé.
09:02 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la planète des riches, lutte contre les inégalités, laurent joffrin, journal libération, journal le monde, warren buffett, gérard filoche, parti socialiste, benoît hamon, crif, érinnyes, twitter, journalistes, ultralibéralisme, boris vian, une bonn'paire de claque, écologie, pierre bourdieu
vendredi, 28 avril 2017
MICHÉA : NOTRE ENNEMI, LE CAPITAL
 Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.
Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.
Qu’on en juge : l’axe principal de son propos tel qu’il s’expose en quatre courts chapitres tient dans les quatre-vingts premières pages, les deux cent vingt-neuf suivantes étant consacrées à développer des « scolies » (alias "commentaires", numérotés de A à P), qui sont autant de greffes entées sur le tronc du raisonnement, et qu’il préfère, pour cette fois, regrouper à part. Et non content de cette "curiosité", chacune des scolies digresse en notes, souvent très copieuses et qui volent parfois en escadrille, annoncées en lettres minuscules cette fois.
Par-dessus le marché, son style d’exposition n’est pas fait pour faciliter la tâche au lecteur. Je ne nie pas la nécessité de la précision et de l’exactitude de l’expression. Mais, pour prendre un exemple dans la psychanalyse, entre la manière quasi-maniaque d’un Jacques Lacan et le langage accessible d’un Didier Anzieu, je choisis ce dernier, dont on suit en général le propos sans peine : le non-spécialiste lui en sait gré, quelle que soit la validité de ses thèses.
La langue de Michéa est faite de phrases à rallonge (celle qui commence page 65 s’achève vingt-cinq lignes plus bas, et quatre ou cinq pages plus loin, à cause des notes !), et qui plus est, de phrases souvent bourrées d'interruptions diverses, sous forme d’incises, de tirets, de parenthèses, qui finissent par noyer le fil conducteur sous les strates multiples. C’est sûr, l’auteur ne veut rien oublier, mais cette façon d’écrire, jointe au choix de la scolie, a quelque chose d’horripilant.
C'est ce que je reprochais, par exemple, à Bourdieu (du temps où je lisais ça), dont on se demande après combien d'incises et de propositions subordonnées la phrase qu'il vient de commencer va s'achever. C'était permis à Proust qui, lui, écrivait de la littérature. A quoi tient le besoin de certains intellectuels d'obscurcir à loisir leurs thèses, auxquelles je suppose pourtant qu'ils tiennent ?
C’est d’autant plus dommage, dans le livre de Michéa, que bien des remarques, dans le texte ou dans les notes, ont tout pour remplir d'aise le lecteur déjà un brin critique. Pour rester page 65, par exemple, Michéa s’en prend, en bas de page, à tous les intellectuels qui ont décidé de rénover le discours du capital en affublant leur entreprise du masque de la « déconstruction » ("neutralité axiologique" oblige : la belle blague). Il place ceci entre parenthèses : « comme en témoigne, entre autres, le fait que la carrière d’un universitaire français – du moins dans le domaine des « sciences sociales » – dépend avant tout, de nos jours, du nombre de génuflexions qu’il acceptera d’accomplir devant l’œuvre de Foucault et de Derrida ». Je goûte fort les guillemets à "sciences sociales".
Oui, la police universitaire est bien faite, et l'ordre économique et idéologique y règne. Cette mise en cause fait un bien fou, car la gauche soft, vous savez, la gauche sociétale qui s'est désintéressée des rapports de classes et des rapports de production pour se convertir à l'économie de marché et à la dérégulation morale, fait en effet régner dans les « sciences » humaines un terrorisme intellectuel qui paralyse et stérilise la pensée dans l’université française, où la cooptation, si elle n'est pas la règle absolue, pèse quand même de tout son poids.
Toujours sur un de ces papes de la « déconstruction » : « Certains se souviendront alors peut-être du jugement prophétique de Sartre. La pensée de Foucault – écrivait-il dès 1966 – est "le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx". L’université française contemporaine est là pour le confirmer » (p.61). Bien que je n'approuve pas trop la référence à Sartre, je trouve que s'en prendre à Foucault et Derrida, c'est ne pas manquer de courage, et l'on comprend que tous leurs émules s'entendent à merveille pour rejeter avec haine et hauteur Michéa parmi les plus fieffés "réactionnaires".
De même quand il s’en prend à une figure quasi-christique de la gauche moderne, sociétale et cosmétique, celle qui a promu le "mariage" des homosexuels : « Si, du reste, ces notions d’identité nationale et de continuité historique ne renvoyaient qu’à un simple "mythe populiste", une Christiane Taubira pourrait encore exiger – sous les applaudissements de cette même extrême-gauche libérale – la "repentance" collective des Français d’aujourd’hui pour des crimes commis aux XVI° et XVII° siècles par un petit nombre de leurs ancêtres » (p.33). Soit dit en passant, Taubira a, entre autres, été un temps l'égérie de Bernard Tapie ! Tiens, au fait, n’est-ce pas le baratineur Emmanuel Macron qui, en Algérie, a décrété que la colonisation avait été un "crime contre l’humanité" ? Repentons-nous, mes frères !!! En chemise et la corde au cou ! Comme les bourgeois de Calais (ça avait une autre gueule que la "jungle", sous la patte de Rodin).
La mise en cause du système capitaliste qui met la planète en coupe réglée et qui bourre les crânes à coups d’idéologie libertaro-marchande est donc tout à fait impeccable. Quel dommage que Jean-Claude Michéa n’arrive pas à débroussailler sévèrement la forêt emberlificotée de ses raisonnements !
Ses ennemis, nombreux, soyons-en sûr, s'en félicitent.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, littérature, sociologie, philosophie, jean-claude michéa, notre ennemi le capital, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, pierre bourdieu, michel foucault, jacques derrida, jean-paul sartre, christiane taubira, repentance, élection présidentielle, emmanuel macron, crime contre l'humanité, bernard tapie, les bourgeois de calais, auguste rodin
mardi, 25 avril 2017
CHRONIQUES DE PAUL JORION
 2/2
2/2
Mais si Paul Jorion ne tient pas le discours aveugle que je dénonçais hier, il n'en reste pas moins, à sa façon, un optimiste indécrottable, car il ne se résigne pas à subir, et demeure, envers et contre tout, comme on dit, une "force de proposition". Il pense en effet qu’on peut encore inverser un cours des choses qui, selon moi, a bien des aspects irrémédiables.
C'est cet optimiste qui ne cesse pourtant de répéter, dans ses interventions, que les gens qui font le système économique actuel n'accepteront de faire quelque chose pour sauver la planète qu'à la seule condition que ça leur rapportera quelque chose. Contre cet aveuglement, Jorion croit aux vertus de l'action individuelle et de l'action de groupe. Bien lui en fasse : pourquoi pas, après tout ? Je crois que c'est se faire bien des illusions sur le pouvoir de l'individu "acteur", dont se gargarisent bien des sociologues de l'école "moderne".
Il suffit pour s'en rendre compte d'examiner les propositions de Paul Jorion, dans le dernier chapitre (Que faire ?), qui sont les suivantes : 1 – Faire du respect de l’environnement une donnée économique. 2 – Restaurer la régulation. 3 – Rétablir une authentique science économique. 4 – Faire de l’Etat providence une fin en soi. 5 – Casser la machine à concentrer la richesse. 5 – Envisager autrement la question du travail et de l’emploi. 6 – Donner tout son rôle à l’opinion publique. 7 – Faire du socialisme (non stalinien) un objectif à atteindre.
Autant dire un programme révolutionnaire, qui prend carrément de front les tenants du système qui, de leur côté, ont tous les moyens en main pour s'y opposer. L’environnement ? En plus du réchauffement climatique, comptons sur la déforestation, l’acidification des océans, l’empoisonnement des hommes par toutes sortes de substances chimiques mutagènes, etc. La régulation ? Pour vaincre toutes les résistances, on verra dans 50 ou 100 ans. La science économique ? Il faudrait commencer par déboulonner les doctrines libérales qui font autorité dans l’Université et dans tous les « think tanks » possibles et imaginables (appelons ça la "pensée dominante", voire la "pensée unique"). L’Etat providence ? Qui aujourd’hui, à part Jorion et quelques autres "économistes atterrés", ne tire pas dessus à boulets rouges ? Interdire la concentration de la richesse ? Je crois que les « versements d’intérêts », les « dividendes » et les « bonus extravagants » (p. 223) ont encore de très beaux jours devant eux.
Bref, on dira que je ne vois que les obstacles, que je suis défaitiste, et tout ça. Soit, mais qu’on me montre, par exemple, les progrès accomplis en Europe pour lutter contre la concurrence salariale ou fiscale entre les pays qui la composent, ou contre la généralisation de l'emploi du glyphosate ou des néonicotinoïdes dans l'agriculture. L’Irlande avec son impôt dérisoire sur les sociétés, le Luxembourg avec ses « rescrits fiscaux », la Bulgarie avec ses travailleurs détachés « low cost », on n’en finirait pas d’énumérer les maux de l'ultralibéralisme économique qui déferlent sur le continent, et qui font de chacun des pays un rival, voire un adversaire de tous les autres. Quel beau modèle d'"Union", en vérité !
La raison du pessimisme qui me fait trouver chimérique le dernier chapitre du livre de Paul Jorion tient peut-être à un tempérament, mais elle tient aussi à quelques lectures (Jacques Ellul, Günther Anders - qui assume les yeux ouverts le renoncement à tout espoir, entre autres). J'avais eu la même impression en lisant La Richesse cachée des nations, de Gabriel Zucman : diagnostic impeccable sur le mal et sur ses causes, propositions et solutions totalement irréalistes. C'est le cas de tous ceux qui, dans le troisième temps de leur raisonnement (vous savez : constat / causes / solutions), commencent à balancer par paquets entiers les "il faut", "on doit" et autres formules comminatoires et vaines. Il y a là du Don Quichotte. Car la raison de mon pessimisme tient encore au regard que je porte sur le rapport des forces en présence et à la conception que je me suis faite, à tort ou à raison, de la notion de système.
En particulier, je me dis qu’un système (défini comme réseau serré d'interactions, de relations étroites et d’interdépendances multiples) a le plus grand mal à se critiquer lui-même, et encore plus à se corriger lui-même. Il suffit de voir la façon dont le système capitaliste a proprement digéré toutes les critiques qui lui ont été faites depuis ses origines, et annihilé tous les efforts faits, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour l'inciter ou le contraindre à changer. La plasticité de ce système semble sans limite : il s'adapte à tout, il avale tous ses contradicteurs, tous ses opposants, et même tous ses ennemis. Il s'est sans cesse renforcé des attaques de ses adversaires, et a jusqu'ici fait son miel de tous les pollens destructeurs envoyés contre lui comme des missiles.
Pour prendre un exemple minuscule qui illustre la chose à merveille, je pense à la micro-controverse qui eut lieu (en 1996) entre Pierre Bourdieu et le journaliste Daniel Schneidermann, qui l’avait invité à son émission télé Arrêt sur image. On peut dire que la télévision est une sorte de quintessence de la "société spectaculaire-marchande". A ce titre, l’émission ayant bien frustré le sociologue, il écrivit pour Le Monde diplomatique un article intitulé "Peut-on critiquer la télévision à la télévision ?", dans lequel il développait une argumentation serrée et pertinente. La réplique du journaliste, dans le numéro suivant, avait été assez basse pour s’en prendre à la personne même de Bourdieu, allant même jusqu'à insinuer, si je me souviens bien, que le sociologue est habité par le fantasme suggéré par la deuxième syllabe de son nom.
Conclusion : la télévision est un système, lui-même puissant instrument entre les mains du capitalisme, et en tant que tel, elle n’a rien à craindre de qui que ce soit pour continuer à exister. Elle digère tout, puisqu'elle transforme tout ce qui passe par elle en pur spectacle. Accepter d'aller sur un un plateau de télé, c'est devenir par le fait même un rouage du système. C'est apporter sa caution à son organisation (jusqu'à Poutou gardant le sourire pendant que Ruquier et son équipe se foutent de sa gueule ; on peut préférer Dupont-Aignan, n'acceptant l'invitation de telle chaîne que pour pouvoir, tel Maurice Clavel en son temps ("Messieurs les censeurs, bonsoir !"), faire son éclat en quittant le plateau brutalement, mais pour quel bénéfice réel ?).
Tiens, à propos de spectacle, je pense aussi à Guy Debord qui, après avoir voulu détruire en la mettant à nu la dite « société spectaculaire-marchande » dans ses œuvres, à commencer par La Société du spectacle, son maître livre, a laissé des archives que l’Etat français à intégrées sans aucun mal à ses collections institutionnelles au titre de « trésor national ». Ces paradoxes ne sont qu’apparents : tout ce qui fait système est invulnérable aux initiatives individuelles les plus « antisystèmes », et celui-ci se montre en mesure d'augmenter ses propres forces en faisant siennes jusqu'à la substance et à la dynamique de ses plus féroces opposants.
Cela ne m’empêche pas de saluer bien bas la combativité de Paul Jorion. Je ne sais plus qui (Albert Jacquard ?) a dit : « On ne peut pas changer le monde, mais le peu qu’on peut faire, le tout petit peu qu’on peut faire, il faut le faire ». C’est avoir la foi chevillée au corps. Et j’avoue que je n’aimerais pas voir le jour où Paul Jorion baissera les bras.
Cet homme éclaire le chemin.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, capitalisme, paul jorion, se débarrasser du capitalisme est une question de survie, éditions fayard, jacques ellul, günther anders, pierre bourdieu, daniel schneidermann, arrêt sur image, dupont-aignan, philippe oputou, laurent ruquier, guy debord, debord la société du spectacle
lundi, 13 juin 2016
LA PRESSE DANS UN SALE ÉTAT ...
... OU : LA GRANDE MISÈRE DU JOURNALISME AUJOURD’HUI
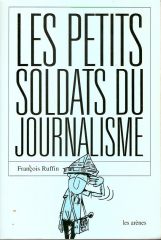 1/2
1/2
Je me rappelle avoir choqué un professeur d’université lors d’une conférence, quand je lui avais posé cette question : « Qu’est-ce que vous pensez du pouvoir journalistique ? ». Il m’avait répondu, péremptoire, avec une prestesse et un ton catégoriques : « Il n’y a pas de "pouvoir journalistique". Question suivante ? ». Ce n’est qu’ensuite que j’ai appris qu’il avait une relation, disons, privilégiée avec une journaliste qui travaillait dans la ville (initiales B.B.). Cela pouvait expliquer.
Pourtant, il est incontestable que, pour un journaliste, voir publier un article signé de son nom constitue, en même temps que la reconnaissance d’une maîtrise professionnelle, l’affirmation d’une sorte de « droit à dire le monde » qui, par « l’effet de présence » que produit la publication d’un document, manifeste l’exercice d’un pouvoir sur la représentation du monde qui en découlera pour le lecteur. Mais je ne vais pas faire mon Bourdieu.
On me dira que le lecteur ne mange que l'avoine qu’il a envie de trouver dans sa mangeoire, et que le picotin du Figaro n'a rien à voir avec le brouet que le lecteur trouve dans sa gamelle avec Libération, et réciproquement. Cela, certes, n’est pas faux. Mais nul ne peut nier qu’un article de journal, quelle que soit sa teneur, est en soi un cadrage d’une portion de réalité sur laquelle l’attention du lecteur est forcément attirée. Même si le signataire de l’article est forcé d’obéir aux consignes de son supérieur hiérarchique et de couler ce qu’il écrit dans le moule qu’il lui impose, l’effet au dehors ne change pas d’un iota, puisque produit par le simple fait d’être officiellement consacré au travers de la publication.
Mais je n’ai pas l’intention de supplicier davantage les petites mains qui noircissent les pages de nos quotidiens et magazines (en évitant de franchir les lignes du cadre qu’on leur a fixé), tant l’exercice de cette profession devenue misérable doit davantage attirer la commisération que le sarcasme. Et ce ne sont pas les grandes gueules d’éditorialistes qui me feront changer d'avis, eux dont les affirmations péremptoires toujours pleines de certitude et de suffisance truffent jour après jour des « revues de presse » qui rivalisent de complaisance envers les « confrères » haut placés dans la hiérarchie et qui, pour cette raison, ont le droit d'asséner leurs analyses comme autant de Vérités révélées.
Depuis l'Orphée aux enfers d'Offenbach, on a une idée de ce qu'est « l’Opinion Publique » (cf. ci-dessous). Offenbach a tout compris du dieu Sociologie et de ses prophètes Pierre Bourdieu et Patrick Champagne (cf. Faire l'opinion, de ce dernier).
Les insupportables « Grand Editorialistes » (Laurent Joffrin, Yves Thréard, Franz-Olivier Giesbert, Claude Imbert, Jacques Julliard, Nicolas Beytout et quelques autres), qui prétendent détenir les secrets de cette « Opinion Publique », sont en réalité les porte-voix en personne, les ministres plénipotentiaires de Sa Majesté le Système, qui a abattu ses griffes sur le monde.
S'il existe un vrai pouvoir journalistique, ce sont les "grands éditorialistes" nommés ci-dessus qui l'exercent. C'est par eux que passe le discours dominant, répercuté en longs échos dans tous les médias, en intime copinage avec les puissants des mondes politique et économique qu'ils côtoient très régulièrement, voire qu'ils tutoient (cf. le célèbre couple Anne Sinclair-Dominique Strauss-Kahn). Ignacio Ramonet, du Monde diplomatique, avait inventé une expression géniale pour désigner la chose : « La Pensée Unique » (titre l'article qui avait lancé la formule) qui, mise à toutes les sauces et réutilisée à satiété, à tort et à travers, fut malheureusement très vite vidée de son sens pour devenir un poncif éculé.
Ce sont des "grands éditorialistes" qui avaient appelé unanimement, en 2005, a voter « oui » au référendum, Serge July et Philippe Val compris. On a vu deux ans plus tard ce que Sarkozy faisait de la véritable opinion publique, celle qui s’exprime dans les urnes : il a posé son derrière sur le "Non" majoritaire pour l’étouffer sous le poids de son mépris. Pour se convaincre de la déliquescence de la corporation, il suffit de lire un petit livre paru en 2003 : Les Petits soldats du journalisme (Les Arènes, avec des dessins explicitement complices de Faujour) de François Ruffin.
François Ruffin, si l’on veut, est davantage militant que journaliste, mais ne chipotons pas : son livre vaut le coup d’être lu, ne serait-ce que pour les innombrables citations qu’on y trouve, et qui sont autant de proclamations de la nouvelle fonction que les grands organes de presse assurent, une fonction que je résumerais volontiers dans une formule du genre « dithyrambe en l’honneur de l'ordre établi, de la marchandise et de la société qu’elle engendre ». L'opération « Nuit Debout » et les actuelles grèves de la CGT et de FO ont été pour eux l'occasion de produire un nouveau festival de considérations haineuses sur des initiatives prises par d'impudents audacieux qui osaient agir en dehors des cadres définis par les gens en place.
Attention, je ne suis pas « Nuit Debout ». Il m’est arrivé d’entendre très récemment François Ruffin : c’était dans une émission de radio, lors d’un reportage place de la République, au cours d’une « Nuit Debout » parisienne. Pour être franc, la partie de son discours choisie pour diffusion par France Culture m’a bien fait rire. Me tapotant la tempe de l'index, je me suis dit que ce garçon prenait ses désirs pour des réalités et profitait de la « Nuit Debout » pour rêver tout éveillé et tenir des propos à tenir debout.
Il y a longtemps que les discours militants me laissent froid, quand ils ne me glacent pas. Les slogans du genre « Le monde doit changer de base, Nous ne sommes rien, soyons tout » ont amplement prouvé que, non seulement ils sont porteurs d’illusions, mais que ces illusions acquièrent à l’occasion une nocivité massacrante. Je n’ai pas vu Merci patron !, le film de François Ruffin qui est en train de faire un carton au box office. Ce canular aux dépens du milliardaire Bernard Arnault ne peut que me réjouir, mais de là à tirer de ce succès et de la "popularité" de « Nuit Debout » des conclusions anticipant quelque Grand Soir, non merci : je ne connais pas le magasin de chaussures où l'on vend les bottes de sept lieues capables de franchir le pas.
Ce qui m’a donné l’idée de relire le livre de François Ruffin, c’est une phrase que j’ai trouvée dans un vieux livre de Philippe Meyer, Pointes sèches (Seuil, 1992) : « Ne le répétez pas, mais il m’arrive de me demander si Panurge ne devrait pas être le saint patron des journalistes », qui regroupe des chroniques où l’auteur dresse le portrait de politiciens, en s’efforçant de faire sourire le lecteur sans trop écorcher les gens visés. Plusieurs furent lues à la télé ou à la radio, en présence de leur cible. La phrase me semble un résumé concentré de la situation actuelle de la profession. C'était bien vu, et même bien tapé.
"Mouton de Panurge", tout le monde sait à peu près ce que c'est. Vous connaissez l’histoire de ce navire bourré de touristes : à un moment, l’un d’eux, situé à tribord, s’écrie : « Oh, regardez ! ». Evidemment, tous ceux qui étaient accoudés au bastingage de bâbord se précipitent. On connaît la suite : le navire chavire. Le journalisme, en particulier politique, est spécialement atteint par ce cancer qui le ronge. On se souvient du char à foin camarguais où s’entassaient des dizaines de clampins, tous armés de micros ou d’appareils photo braqués en direction de Nicolas Sarkozy en train de parader tout fiérot sur son cheval blanc, lors de la campagne de 2007.

Bande de pauvres types ! Quel naufrage ! Quel troupeau ! Quelle lâcheté ! Quel avilissement ! Quelle misère, en vérité !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journaux, presse quotidienne nationale, pqn, presse quotidienne régionale, pqr, françois ruffin, les petits soldats du journalisme, éditions les arènes, journal le monde, journal libération, journal le figaro, offenbach orphée aux enfers, laurent joffrin, yves thréard, franz-olivier giesbert, claude imbert, jacques julliard, nicolas beytout, ignacio ramonet, le monde diplomatique, serge july, philippe val, france culture, film merci patron, philippe meyer pointes sèches, moutons de panurge, nicolas sarkozy, journalisme, journalistes, référendum 2005, pierre bourdieu, patrick champagne, faire l'opinion
jeudi, 21 janvier 2016
NÉO-RÉAC ET FIER DE L’ÊTRE
Double page « Débats » dans Le Monde daté 19 janvier : « Les néoréacs ont-ils gagné ? ». Ah, que l’intention est belle et noble ! Nicolas Truong, journaliste, fait précéder son article de présentation du « chapeau » suivant : « Le succès d’audience politique et l’hégémonie médiatique des antimodernes ou des néoconservateurs est-il le signe d’une dérive droitière en France ou provient-il de leur capacité à nommer le mal qui ronge nos sociétés ? ». L’alternative proposée a un air d’honnêteté à première vue. A ceci près que je m’étonne de l’expression "audience politique" : je ne savais pas que Finkielkraut, Onfray ou Zemmour (portraiturés en la compagnie bizarre de Patrick Buisson) avaient été nommés conseillers de nos plus hauts responsables politiques, dont ils ne pensent en général pas beaucoup de bien.
Quant à "hégémonie médiatique", je suis très mal placé pour en juger, dépourvu que je suis de cet appareil qu’on appelle « télévision », pour un motif que je persiste à estimer crucial, déterminant, vital, prépondérant, bref : capital. Comme Günther Anders et Guy Debord, je pense en effet qu’avec le poste de télévision installé en bonne place au salon, est juridiquement constitué le délit d’atteinte à la liberté individuelle. Je ne suis donc pas en mesure d’évaluer la force de l’emprise des « néoréacs » sur les plateaux. Contrairement à Philippe Sollers, qui osait dénier à Louis Althusser la qualité de "penseur" du seul fait qu'il n'avait pas la télévision, je crois qu'il est plus facile de continuer à penser quand on n'est pas encombré de cet objet intrusif. Je préfère m'en remettre au concept de "spectacle", élaboré par Guy Debord (voir mon billet du 18 janvier).
A voir l'armée des boucliers qui se lèvent dès qu’un de ces individus suspects ouvre la bouche, j'ai plutôt l'impression que le mot d’ordre est très généralement de faire taire les "néoréacs" sous le déluge des réactions scandalisées. On peut faire confiance au chœur des flics de la pensée pour veiller comme des vestales vigilantes sur le consensus moral, moralisant et moralisateur, dans lequel ils s’efforcent de bétonner toute l’époque, à coups de glapissements. Voir par exemple la façon dont Michel Onfray, qui a été récemment vomi par les cent bouches de la déesse dont parle Georges Brassens dans "Trompettes de la renommée" (« Pour faire parler un peu la déesse aux cent bouches, Faut-il qu'une femme célèbre, une étoile, une star, Vienne prendre entre mes bras la place de ma guitare »), s'est senti obligé de fermer sa page fesse-bouc et son « fil twitter ».
La haine de ces sentinelles de la "Nouvelle Vertu" pour ceux qui commettent des infractions à l’ordre qu’ils veulent faire régner a quelque chose de stupéfiant, et pour tout dire d’incompréhensible. Dans ses pages « Débats », Le Monde se garde bien entendu de trancher, et Nicolas Truong veille soigneusement à ne pas déroger à la sacro-sainte règle de neutralité, qui maintient la ligne du journal dans un juste-milieu de bon aloi, équidistant des extrêmes. Inattaquable.
Enfin, quand je dis "soigneusement", j’exagère. Certes, Nicolas Truong donne la parole à Alain Finkielkraut, et son interview peut donner une impression d’impartialité. Mais il ouvre dans le même temps les colonnes du journal à deux guerriers de la "Nouvelle Vertu" : l’historien Daniel Lindenberg et la sociologue Gisèle Sapiro, qui font jaillir, du haut des chaires universitaires où ils vaticinent, le venin capable de renvoyer l’ennemi déclaré dans le néant dont il n’aurait jamais dû sortir. Comptez : un neutre, un pour, deux contre. Le combat était inégal avant même la publication.
Le point commun, dans l’argumentation de ces deux mercenaires, c’est de ranger les intellectuels « néoréacs » parmi les responsables de la montée de l’extrême-droite : Sapiro fait référence au mouvement allemand « Pegida », Lindenberg à l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson. Lindenberg accuse même les « néoréacs » de véhiculer « une authentique rhétorique d’extrême-droite », quand Sapiro fait mine de s'alarmer de leur succès médiatique « alors que le FN est en pleine ascension ». L’intention, au moins, est claire : disqualifier l’adversaire en le faisant complice de supposés fascistes. Finkielkraut faisant le jeu de Marine Le Pen, l'hypothèse est tellement courge que je ne la discute même pas.
Ce qui apparaît de façon lumineuse, en tout cas, c’est la dissymétrie entre les argumentaires des uns et de l’autre. Alain Finkielkraut porte un regard sur l'ensemble de l'époque : « Je cherche seulement à penser le présent selon ses propres termes. Je le dépouille ainsi des oripeaux dont le revêt la prétendue vigilance et je suis traité de néoréac parce que je dis : "Le roi est nu" ». Finkielkraut mène une analyse du monde tel qu’il va. Il se contente de dire, à la suite de Guy Debord et de Philippe Muray, que le monde et l'humanité vont très mal. Il a quitté les rangs des choristes de l’Empire du Bien, c’est ce que ceux-ci ne lui pardonnent pas.
Car la dissymétrie est là : autant Finkielkraut parle du monde, autant Sapiro et Lindenberg parlent de Finkielkraut. Je veux dire que, si l'un parle du monde, les autres parlent de la personne qui a parlé. Quand celle-ci développe une argumentation « ad rem », ceux-là se déchaînent « ad personam ». Le coup classique : quand un argument t'embarrasse, il suffit d'attaquer la personne qui l'a proféré. Dans la plupart des cas, ça marche, devant les badauds.
Daniel Schneidermann avait utilisé la même ficelle, en son temps, dans Le Monde diplomatique (mai 1996) contre Pierre Bourdieu (que je n'aime pourtant guère), en réponse à l’article où celui-ci tirait les conclusions de son passage dans son émission Arrêt sur images, article intitulé « Peut-on critiquer la télévision à la télévision ? ». Schneidermann, dont j’estime le travail par ailleurs, n’avait pas aimé du tout, et s’en était pris à son invité en l’accusant, entre autres, en jouant sur son nom, de se prendre pour Dieu, si je me souviens bien. J'avais trouvé ça assez bas.
En gros, les « néoréacs » posent un diagnostic sévère sur l’état actuel du monde, alors que leurs accusateurs insultent les personnes qui osent un tel diagnostic. Coup classique, certes, mais infâme. Nicolas Truong pose d’ailleurs la question : « … et si ces néoconservateurs avaient raison ? ». Passons sur les qualifications d' "antimodernes" et de "néoconservateurs", bien qu'il y eût eu à dire. Eh oui, pendant que le sale gosse Alain Finkielkraut est le seul à dire que le roi est nu, alors que la foule des courtisans fait semblant de s’extasier sur la somptuosité de ses vêtements transparents, Daniel Lindenberg et Gisèle Sapiro intiment l’ordre au sale gosse de se taire : il ne faudrait pas, en disant la vérité, désespérer le peuple, on ne sait pas ce dont il serait capable. Cela pourrait créer du désordre.
Cela n’empêche pas Gisèle Sapiro d’avouer sa niaiserie profonde. Devinez comment elle conclut sa diatribe imbécile. Tout simplement en posant la question qu’elle n’aurait jamais dû oser poser. Car après avoir déversé son venin, voici ce qu’elle écrit : « Ils "passent" bien à la télévision ou à la radio. Cela contribue-t-il à expliquer ce qui n’en demeure pas moins un mystère, à savoir, pourquoi ils suscitent un tel intérêt auprès du public ? ». C'est un aveu de défaite, en même temps que d'incompétence fielleuse. Traduction : si le gars a du succès, la teneur de ses propos n'y est pour rien, c'est juste parce qu'il est télégénique.
Traduction bis : pourquoi les gens en redemandent, de ces salauds de « néoréacs », au lieu de nous écouter religieusement, nous qui savons ("de toilette", réplique Boby Lapointe) dire les mots qu'il faut pour rassurer ? Daniel Lindenberg et Gisèle Sapiro ne sont pas des menteurs professionnels. Ils haïssent seulement les porteurs de vérités désagréables. Et le "public" représente à leurs yeux un insondable mystère. J’imagine que leur gagne-pain est lié à la conviction qu’ils affichent dans l’entreprise systémique de dénégation du réel. Sapiro n'est pas près de se faire écouter du peuple. Non, je ne crois pas, contrairement à ce que nous serinent les sondages, que les gens "ont peur", "sont angoissés", et tout ça. J'ai plutôt l'impression que les gens se disent, jour après jour : quel sale monde que le monde qui s'annonce ! Et tous ces guignols qui font semblant de le trouver radieux !
Car Sapiro avoue ici, ingénument, son ignorance de l’essentiel, à savoir ce qu’attendent les gens. Ce qu’ils attendent ? Que ceux qui causent dans le poste leur disent enfin la vérité sur le monde réel. Oui, monsieur Truong, ils attendent des responsables un peu de courage, celui qu’il faut pour « nommer le mal qui ronge nos sociétés », comme vous écrivez. "Nommer le mal" ! Et je peux vous dire que ce mal s’appelle le Mensonge. Et les gens n’en peuvent plus : si on ne leur donne pas la vérité, c’est normal qu’ils préfèrent mettre la tête sous l’aile et s’abstenir aux élections. Leur taux d’abstention est proportionnel au mensonge que les pouvoirs leur servent jusqu'à la nausée. Qui ose aujourd'hui "nommer le mal" ? Je ne vois que les « néoréacs ».
Car la vérité du monde aujourd’hui n’est pas belle à voir. Economie ? Le travail manuel remplacé par des robots, le travail intellectuel remplacé par des logiciels et des algorithmes : c'est promettre la fin du travail et le chômage de masse à perpétuité. Finances ? Soixante-deux bonshommes possèdent autant à eux seuls que la moitié de l’humanité. Politique ? Extinction des idées et des projets, omniprésence de la soif quasi-mafieuse de pouvoir. Ecologie ? Sale temps pour la planète. Et je laisse de côté les migrants, l’islam, Daech, la violence, les guerres en cours, les guerres à venir, …. Franchement, il est dans quel état, le monde ? Ceux qui causent dans le poste ne sont visiblement pas de ce monde-là. Ils doivent péter de trouille en envisageant le jour où les yeux des foules s'ouvriront.
Car il faut rester optimiste, se cramponner au "tout va bien, nous avons les choses bien en main". Alors exterminons les oiseaux de mauvais augure. Mettons à mort le messager porteur de mauvaise nouvelle. A la lanterne, les lanceurs d’alerte. On peut compter sur Daniel Lindenberg et Gisèle Sapiro pour leur passer le nœud coulant.
Je ne remercie pas Le Monde d'avoir donné la parole à deux faussaires, tout en faisant mine d'apporter sa contribution à un grand "débat de société". Qui peut encore croire que c'est le discours des « néoréacs » qui domine toute la scène intellectuelle ? Le Monde apporte ici la preuve du contraire.
La réponse à la question du début, c'est : les « néoréacs » ont perdu. Et ce n'est pas une bonne nouvelle.
Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, débats de société, alain finkielkraut, éric zemmour, michel onfray, günther anders, guy debord, nicolas truong, daniel lindenberg, gisèle sapiro, nicolas sarkozy, patrick buisson, philippe muray, l'empire du bien, daniel schneidermann, le monde diplomatique, pierre bourdieu, sociologie, arrêt sur images, boby lapointe, lanceurs d'alerte, georges brassens
lundi, 21 décembre 2015
FRANCE : UN FOSSILE POLITIQUE

Préambule d'actualité
Le Grand retour de Nanard (ou : Nanard fait son cinéma)
Symptôme du grand délabrement de la vie politique française : Bernard Tapie fait annoncer son retour en politique. Les éditorialistes sont effondrés ce matin, et s'apitoient sur la panouille médiatique dans laquelle Tapie fait mine de revenir patauger. Entonnons avec Orgon le refrain qui scande la scène 4 de l'acte I de Tartuffe : « Le pauvre homme ! ». Enfin, "pauvre", ... ce n'est pas encore fait. Certains préféreront crier, avec les Tunisiens de 2011 contre Ben Ali : « Dégage ! ».
******************************************************
2
En France, pour autant qu’on soit bien informés, on n’en est pas là : juste un petit Cahuzac de temps en temps. La pourriture (sens premier de "corruption") semble périphérique. Croisons les doigts. On pourrait s’en féliciter. Malheureusement, la France souffre d’un Mal tout aussi térébrant. « Mon mal vient de plus loin », dit Phèdre dans la pièce de Racine (I,3). J’appelle ce Mal, quant à moi, la « Grande Fossilisation ». Certains commentateurs parlent d'une « vie politique congelée ». Une preuve en est fournie par le fait qu’à droite, un rival crédible de Nicolas Sarkozy dans la course à la présidentielle de 2017 a soufflé le 15 août dernier les soixante-dix bougies de son gâteau d’anniversaire. Soixante-douze ans en 2017 ! Soixante-dix-sept en 2022 (fin de mandat, s'il est élu). Comment est-ce possible ?
Tout le monde a l’air de trouver ça normal. En réalité, c’est une énormité, une incongruité, une anomalie, un scandale. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter les propos tenus à ce sujet à l’étranger, où l’on est stupéfait, par exemple, de voir qu’un Alain Juppé (c’était bien lui !) était déjà dans la politique plus de trente ans plus tôt.

MONTAGE PARU DANS AUJOURD'HUI LE PARISIEN DU 21 DÉCEMBRE 2015
Remarquez, il ne fait pas encore aussi bien que Jacques Chirac, dont la carrière politique aura duré quarante ans (1965-2005). Juppé peut encore battre un record. La France politique crève littéralement de ces records de durée. Le renouvellement du personnel politique en France s’opère sur un rythme géologique : dans un million d’années, c’est sûr, les os de Juppé auront subi la pétrification produisant un joli fossile en ordre de marche. Comme diraient Vigneault-Charlebois-Leclerc (4'45") : « Mais nous, nous serons morts, mon frère ». Et Aguigui Mouna (Dupont) ferait inlassablement reprendre en chœur le refrain : « Les-guer-riers-trou-ba-dours/-Les-guer-riers-trou-ba-dours/-Les … » (ça, c'est juste pour ceux qui l'ont connu).
Voilà : plus grave que la corruption, il s’agit là d’une confiscation pure et simple. Disons-le, depuis lurette, contrairement à ce que s'efforcent de nous faire accroire la meute des « journalistes politiques » et autres éditorialistes, il n’y a plus de vie politique en France : elle a été confisquée par une caste, on pourrait dire une mafia, moins la corruption qui va avec (tout au moins à ce qu’on sait, mais certains parleront d'une corruption structurelle, c'est-à-dire fabriquée par le système dans son ensemble). Le débat politique rampe dans le caniveau, et se réduit à des luttes pour le pouvoir. C'est le moment de faire retentir à nouveau le cri de Sade : « Français, encore un effort si vous voulez être républicains ! » (c'est dans La Philosophie dans le boudoir).
La preuve, c’est que lorsqu’un gouvernement fait mine de s'ouvrir à la « Société Civile », les pauvres sur qui ça tombe sont rapidement éjectés (Francis Mer, Léon Schwartzenberg, …) : ils ne sont pas du sérail. Je passe sur les connivences, pour ne pas dire les complicités qui se sont établies entre les élites politiques, les élites des affaires et les élites médiatiques : contentons-nous de ces mœurs proprement confiscatoires qui ont cours dans les centres de la décision politique, accaparés par une petite caste.
Y a-t-il même encore des « hommes politiques » en France ? Tous ou presque ont aujourd’hui, et depuis lurette, des têtes de premiers de la classe (regardez la gueule bien lisse de Macron). Et ces mentions "très bien" se sont tracé un « plan de carrière » : à tel âge, je suis "cadre dirigeant", et j'ai ma Rolex avant cinquante ans. Parmi eux, nul n’a plus l’accent d’un terroir quelconque (je ne parle pas de l’accent du midi). Beaucoup sortent, non pas de la société normale, mais de l’ENA ou d’une « Grande Ecole », parfois plusieurs (François Hollande).
Ces structures sont des bocaux, ils sont ignifugés, et les légumes qu'on y cultive sont mis en conserve après stérilisation. Ils ont appris à « administrer », mais ont-ils appris à « diriger » (au sens marin du verbe « barrer » : donner la direction) ? Même si on n'apprécie guère Pierre Bourdieu, ce serait le moment de faire une large publicité à La Noblesse d'Etat (Minuit, 1989), où il met en évidence l'étroite relation qui s'est établie entre vingt et une Grandes Ecoles et les cercles du pouvoir (politique, entre autres).
Dans leur immense majorité, ce ne sont pas des hommes politiques, mais des administrateurs de biens, des bureaucrates, des cadres, des gestionnaires, des comptables. Et ce sont ces régisseurs, ces fondés de pouvoir, ces managers, ces chefs de bureau et autres "maires du palais" que les Français ont l'inconscience de porter au pouvoir, élection après élection. Qui croit un mot de ce qu’ils disent, quand ils affirment « porter des convictions fortes » ?
Démunis de stratégie à moyen ou long terme, ça ne les empêche pas de marteler à longueur d'antenne : « Le Projet ! Le Projet ! Le Projet ! », en prenant bien soin de ne jamais préciser ce qu'ils mettent dedans concrètement. Diplômés de Science-Po, hommes du verbe, experts de je ne sais quoi, je veux bien l'admettre, mais en aucun cas des "hommes politiques". Ils savent un tas de choses subtiles et savantes, mais ils ignorent le principal : ce qu'il faut faire. Ceux qui ont le pouvoir n’ont pas de convictions. Et les seuls qui sont sincères n’ont aucun pouvoir.
Leurs seules convictions ? Faire preuve, avec un inentamable « sens du travail bien fait », de leur capacité à « traiter un dossier », quand il faudrait des Volontés. Ah ça, on ne peut pas leur refuser ce savoir-faire : constituer un dossier, ils savent. Pour les tactiques et les manœuvres, on peut leur faire confiance. Leur seule méthode ? La « navigation à vue ». Je devrais même dire : le cabotage, vu leur répugnance à s’éloigner des côtes : voir ce qui est « possible ». Ensuite, si ça fait de trop grosses vagues, en rabattre et se réfugier au plus vite dans la crique la plus proche. Ils n’ont pas de radar, pas de destination, pas de port d’attache.
Et puis, pas le temps d’aller mettre les mains dans le cambouis de la « Société Civile » : on ne va pas se salir les mains dans la réalité de tout le monde, ce n’est pas pour rien qu’on a été premier de la classe. Ça met à l'abri. Voilà : ils font partie de la secte "Tous aux abris". Leur parcours les a fait passer directement des tables de salles d’examen aux bureaux Second Empire. Leur expérience est d’avoir côtoyé un univers de papier, de mots et de concepts. Jeunes poissons, ils n’ont aucune envie de sortir du bocal pour partir dans des ailleurs exotiques pour respirer le grand miasme putride du monde réel. Le grand remugle fermenté dans le ventre de la complexité du monde. Le politicien ordinaire de niveau moyen, en France, aura eu l'avantage de ne jamais avoir été mis directement en présence des pestilences olfactives libérées par le sphincter anal de la réalité, elle aussi ordinaire, pourtant.
Jeunes chevaliers à peine sortis de l’Ecole, ils n’ont d’autre hâte que d’aller mettre leur épée au service d’un suzerain qui accepte de les adouber, et de leur accorder un fief en apanage, avec le titre d' « attaché parlementaire ». En échange d'une loyauté de vassal impeccable, cela va sans dire. De l’Ecole à la Chambre, sans passer par la réalité ordinaire : la porte peut alors s’ouvrir sur le bel horizon d’une « carrière politique ». Roule Raoul ! La machine à produire les fossiles politiques a de beaux jours devant elle. L'abstention est la manifestation aveuglante du dégoût sans cesse accru de la population envers ces mœurs ahurissantes. Mais qui fera parvenir ce message à leurs oreilles ? A leur cerveau ? A leur conscience ? Mais ont-ils une conscience ?
La machine à produire du Front National se dirige vers un avenir radieux.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : suiteetfin demain.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aguigui mouna, mouna dupont, le mouna frères, france, politique, société, parti socialiste, ump, les républicains, nicolas sarkozy, alain juppé, corruption, jacques chirac, gilles vigneault, félix leclerc, robert charlebois, quand les hommes vivront d'amour, la philosophie dans le boudoir, marquis de sade, emmanuel macron, pierre bourdieu, la noblesse d'etat, front national, jean-marie le pen, marine le pen, marion maréchal le pen, bernard tapie, jérôme cahuzac, sidi bouzid mohamed bouazizi, journal le parisien
mardi, 13 octobre 2015
LES ÂNERIES DE TISSERON

Nous sommes en compagnie de M. Serge Tisseron, psychanalyste qui, dans les colonnes du Monde, étrille les « intellectuels » en leur reprochant de n'être plus d'aucun poids pour influer sur l'époque.
2/2
Comment le monsieur voit-il les choses ? A sa façon. Et ça vaut le coup de le citer en longueur : « Or le monde a changé. Il n’est justement plus binaire, il est devenu multiple, et fondamentalement instable. Ce ne sont plus seulement les idéologies qui se succèdent à un rythme accéléré, ce sont les situations économiques, politiques et militaires. Les idéologies suivent, s’adaptent, se métissent. Ce ne sont plus elles, et les intellectuels qui prétendent en être les garants, qui impulsent les actions. Aujourd’hui, l’extrême fragmentation des rapports de force entre entité politique ou idéologique rend impossible la délimitation d’affrontements entre des forces clairement identifiées et circonscrites ».
Si vous pouvez tirer une vision claire de ce joyeux mélange de clichés, faites-moi signe. J’apprécie particulièrement ces idéologies qui "se succèdent", "s’adaptent" et, surtout, "se métissent". Je pose la question : qu'est-ce qu'une idéologie métissée ? Et je passe sur la faute de français (« rapports de force entre entité » : quand quelque chose est "entre", ce qui suit est au moins deux, comme le montre l’occurrence suivante dans la citation), qui révèle au moins, disons ... un flou notionnel.
Il évoque ensuite les « progrès technologiques qui évoluent à une vitesse exponentielle » (Tisseron aime tant le mot "exponentiel" qu'il le répète deux paragraphes plus loin). Est-ce la numérisation de tout, l’informatisation et la robotisation galopantes qu’il a en tête ? Il faudrait alors commencer par démontrer que ce sont des progrès, ce qui n'est pas sûr du tout.
De plus, affirmer que les progrès technologiques avancent à une vitesse exponentielle est une bêtise et un abus de langage : l'apparente évolution actuelle découle de l'exploitation tous azimuts et de l'application aux domaines les plus divers d'une innovation décisive (numérisation, puis robotisation). Quant à la « vitesse exponentielle », s’agissant du monde tel qu’il va, j’ai un peu de mal à l’envisager. Je vois surtout un bolide lancé à toute allure sur l’autoroute, de nuit et dans le brouillard. Mais ça ne l’inquiète pas : il est au spectacle. Dans le brouillard ! Trop fort, Serge Tisseron !
La preuve, c’est qu’il ajoute ensuite : « L’atomisation des rapports de force et le métissage des idéologies [encore lui !] sont d’abord à considérer comme un effet des bouleversements technologiques, de leur intrication croissante, et des nouveaux paysages économiques et politiques qui en découlent ». J’ai l’impression que Tisseron est installé dans son laboratoire et que, de là, il regarde le monde comme une gigantesque éprouvette dans laquelle est en train de se faire une expérience inédite, mais passionnante. Il est impatient d’en observer le résultat, tout en avouant dans le même temps qu'il ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. A se demander s'il en pense quelque chose.
Puis il reproche à Régis Debray d’oublier dans le débat actuel une phrase qu’il a écrite, une des rares qui aient retenu sa considération : « … nous finissons toujours par avoir l’idéologie de nos technologies », et de : « … ne voir aucune idéologie de remplacement à celles que les naufrages du XX° siècle ont englouties, aucune nouvelle "religion" ne pointant son nez à l’aube du XXI° siècle ». D’abord, pour ce qui est de la religion, je ne sais pas ce qu’il lui faut : d’accord, l’islam n’est pas vraiment nouveau, mais l'élan conquérant qui l’anime actuellement est pour le coup une vraie nouveauté.
Ensuite, je dirai juste qu'en matière d'idéologie de remplacement, l'humanité actuelle est servie : que faut-il à Serge Tisseron pour qu'il ne voie pas que la course en avant effrénée de la technique est en soi un idéologie ? Je rappelle que le propre d'une idéologie se reconnaît d'abord à ce qu'elle refuse de se reconnaître comme telle, ce qui est bien le cas du discours des fanatiques de l'innovation technologique. Et les « transhumanistes » (adeptes de la fusion homme-machine) vont jusqu'à ériger cette idéologie en utopie.
Quant aux idéologies du 20ème siècle (grosso modo communisme et nazisme, ajoutées aux grandes religions monothéistes), héritières des utopies du 19ème, il omet de préciser qu’elles contenaient et proposaient de grands projets pour l’humanité. Or l’humanité actuelle semble bel et bien avoir abandonné tout effort pour élaborer un quelconque projet lui dessinant un avenir. Pas forcément un mal, vu les catastrophes qui en ont découlé dans le passé. Mais pour laisser place à quoi ? Au libre affrontement des forces en présence.
Où prendrait place un tel projet, sur une planète qui est un champ de bataille autour des ressources ; un champ de bataille qui voit s'affronter des nations prises dans une compétition généralisée, sorte de « guerre de tous contre tous » ? Quand l'heure est à la lutte pour la conquête ou pour la survie, rien d'autre ne compte que le temps présent. Le temps de l'appétit ou de l'angoisse (manger pour ne pas être mangé). Et vous n'avez pas le choix. Comme dit Jorge Luis Borges, je ne sais plus dans laquelle de ses nouvelles : « Il faut subir ce qu'on ne peut empêcher ».
La seule idéologie, la seule religion si l’on veut, qui continue à faire luire à l’horizon une lueur d’espoir dans la nuit de l’humanité, c’est précisément la foi dans les technologies : « … la génomique, la robotique, la recherche en intelligence artificielle et les nanotechnologies ». Je crois quant à moi que les adeptes de cette religion sont des fous furieux, qui ne font qu'accélérer la course à l'abîme.
Mais Tisseron se garde bien de dire ce qu’il en pense. Que pense-t-il des théoriciens du « transhumanisme » et de leurs partisans, qui s’agitent fiévreusement quelque part dans la Silicon valley, en vue de l'avènement de l'homme programmable ? On ne le saura pas : l’auteur réserve pour une autre occasion l’expression de son jugement.
« Car le monde est en train d’échapper aux intellectuels de l’ancien monde », affirme fièrement l’auteur de l’article. L’objection que je ferai à Serge Tisseron sera globale : à quel haut responsable politique, à quel grand scientifique, à quelle grande conscience morale le monde actuel n’est-il pas en train d’échapper ? Tout le monde, à commencer par les décideurs, a « perdu toute prise sur notre époque » (cf. titre). Le temps est fini des grands arrangements entre puissances. Plus personne ne sait quelle créature va sortir du chaudron magique, en fin de cuisson.
Pas besoin d’être un « intellectuel », qu’il soit de l’ancien ou du nouveau monde. Car ce qui apparaît de façon de plus en plus flagrante, c’est que plus personne n’est en mesure de comprendre le monde tel qu’il est. Le monde est en train d’échapper à tout contrôle. D’échapper à l’humanité. Ce que Serge Tisseron n’a peut-être pas très envie de regarder en face. La planète semble aujourd’hui, plus que jamais auparavant, un bateau ivre.

Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, vu par le grand Aristidès (Othon Frédéric Wilfried), dit Fred.
Serge Tisseron se trompe de cible. Cet intellectuel a donc perdu une bonne occasion de la boucler.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal le monde, serge tisseron, les intellectuels, rabelais, gargantua, jean-paul sartre, pierre bourdieu, michel foucault, alain finkielkraut, michel onfray crépuscule d'une idole, régis debray, éric zemmour, laurent ruquier, onpc, on n'est pas couché, sigmund freud, secrets de famille, tintin et milou, hergé, psychanalyse, jorge luis borges, transhumanistes, bande dessinée, fred philémon, arthur rimbaud
lundi, 12 octobre 2015
LES ÂNERIES DE TISSERON

1/2
Ah qu’elle est belle, la tribune signée jeudi 8 octobre dans Le Monde par Serge Tisseron. Il intervient dans le débat actuel sur « Les Intellectuels », un débat ô combien franco-français, plein de bruit et de fureur, mais qu’on pourrait à aussi bon droit regarder comme une machine à fabriquer du brouillard, ou encore qualifier de bonne séance collective de branlette cérébrale. Ces prises de becs essentiellement médiatiques (tout le monde veut se faire une place sur le devant de la scène) moulinent en général du vent, et encore : à peine un petit zéphyr. Autant le dire d’un mot : une flatulence.
Le fondement de M. Tisseron ne pouvait pas rester silencieux et, par chance, Le Monde lui a déroulé sa toile cirée pour lui permettre de participer à ce grand concours de pets, qui nous ramène aux joyeux temps des internats masculins et de cours de physique animés et odoriférants, et de joindre le bruit de ses entrailles au concert. Il se dit peut-être que le bruit de ses entrailles est béni ? Pour illustrer une fois de plus le proverbe cité par Rabelais (« A cul de foyrard toujours abunde merde », Gargantua, IX), précisons qu’à la fragrance intestinale, ce genre de débat ajoute le plus souvent une substance intellectuellement breneuse.
Il est donc question des « intellectuels ». M. Tisseron nous dit (c’est son titre) que « les intellectuels d’aujourd’hui ont perdu toute prise sur notre époque ». On se dit "Encore un qui nous joue la rengaine du bon vieux temps". N’est pas Sartre, Foucault ou Bourdieu qui veut. Pour rétorquer, on se demandera quelle prise sur l’époque eut en son temps un Sartre juché sur son fût, haranguant les ouvriers de Billancourt. Pareil pour les deux autres. Mais Tisseron pense peut-être davantage à l’envergure intellectuelle de leur œuvre qu’aux actions d’éclat qu’ils ont menées.
Les intellectuels, donc. Mais quels intellectuels ? En réalité, si « les intellectuels » se réduisent à Michel Onfray et Régis Debray, les seuls dont il cite le nom, Tisseron commet un abus de langage. D’abord il aurait pu ajouter Alain Finkielkraut (L’Identité malheureuse) et, à l’extrême rigueur, Eric Zemmour (Le Suicide français).
Ensuite, il aurait pu ajouter son propre nom : ne fait-il pas partie de la confrérie des intellectuels ? Il entre bien dans le débat, non ? A quel titre si ce n’est parce qu’il est de la même espèce ? Peut-être, en fin de compte, n’est-il qu’un vilain jaloux qui leur en veut d’être plus souvent que lui invités par Ruquier et compagnie ? Moins brillant des gencives, il fait peut-être un « client » plus fade.
Que reproche Serge Tisseron aux « intellectuels », tout au moins à ceux que quelques animateurs-vedettes invitent régulièrement à venir jouer les bateleurs sur leurs tréteaux ? La binarité de leur pensée. Il les accuse d’être de piteux pétochards : « Mon hypothèse est que l’évolution du monde leur fait craindre que leurs outils théoriques ne leur soient plus d’aucune utilité pour comprendre celui qui s’annonce ». Quelle clairvoyance ! Quelle perspicacité !
Si Michel Onfray ne comprend rien au monde actuel, Tisseron, lui, a tout compris d’Onfray. Je ne vais pas défendre le monsieur, dont le ton péremptoire et tranchant a le don de m’exaspérer. Le Niagara de ses ouvrages, à raison de trois ou quatre par an, submerge les rayons des librairies. On se demande combien de mains il possède pour écrire comme Lucky Luke tire au revolver : plus vite que son ombre. Et il se permet d’évacuer en trois coups de cuiller à pot toute l’œuvre de Sigmund Freud (Le Crépuscule d'une idole, Grasset, 2010). Je veux bien mais.
Tout ça pour dire que je ne me fie pas à Michel Onfray pour me guider dans les méandres de la pensée. Libre à Serge Tisseron de lui planter quelques banderilles dans le derrière : Onfray s’en remettra. Mais l'auteur de l'article reproche aux « intellectuels », par-dessus le marché, de voir tout en noir : « Leur point commun ? Penser que rien ne va plus. Leur programme ? Rien de bien clair encore. Leur force ? Transformer ce qui devrait être un débat d’idées en un plébiscite sur leur personne : pour ou contre, d’autres diraient : "j’aime" ou "je n’aime pas" ». Pour ma part, je demanderais volontiers à Tisseron de m’indiquer ce qui, aujourd’hui, va bien.
Si, quelque chose continue à aller bien : la choucroute exquise de la semaine passée. Ou alors le quatuor op. 132 en ut mineur, du grand Ludwig van B. par le Quartetto italiano. Quoi d’autre ? What else ?
Voilà ce que je dis, moi.
Note : j’ai omis de préciser que Serge Tisseron est psychanalyste, et que le haut fait de guerre qui l’a fait connaître est d’avoir mis au jour un secret enfoui dans la famille d’Hergé, rien qu’en lisant les aventures de Tintin et Milou.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal le monde, serge tisseron, les intellectuels, rabelais, gargantua, jean-paul sartre, pierre bourdieu, michel foucault, alain finkielkraut, michel onfray crépuscule d'une idole, régis debray, éric zemmour, laurent ruquier, onpc, on n'est pas couché, sigmund freud, secrets de famille, tintin et milou, hergé
mardi, 10 mars 2015
A BAS LES STEREOTYPES !
Il est urgent d’en finir avec les stéréotypes.
Les journaux dénoncent à longueur de pages cette ignoble verrue qui transforme le nez si typique de la République en ignoble appendice tuberculeux, avec laquelle on proclame en très haut lieu (François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem et consort) que l'on va s'empresser d'en finir par les moyens les plus expéditifs. Il était temps.
On apprend, à la veille de Noël dernier (Le Monde daté 19 décembre 2014), que « la délégation aux droits des femmes du Sénat dénonce les jouets stéréotypés ». Et tout le monde (enfin presque) est d’accord pour appeler à la libération de l’infernal carcan qui enserre l’existence des femmes, des hommes et des animaux (« Les animaux sont des êtres humains comme les autres », disait la déjà défunte Brigitte Bardot) dans les hideux « stéréotypes sexués ». Plus personne (enfin presque) ne veut s’entendre rebattre les oreilles avec des petits garçons qui seraient faits pour les petites voitures et des petites filles pour les petites poupées.

Le Monde, 19 décembre 2014.
Elles ont raison : il faut dénoncer.
On ne dénonce jamais assez : c'est un principe.
Il faut en finir une fois pour toutes – pour en finir une fois pour toutes avec la « domination masculine » (Pierre Bourdieu) – avec les stéréotypes de « genre », si possible dès la Maternelle, en inculquant dans les jeunes cerveaux le principe sacro-saint de l’égalité entre les garçons et les filles, par exemple au moyen d’un ABCD qui les prédisposera à admettre que les premiers ne sont pas supérieurs aux secondes (ce dont personne ne doute), et convaincra les secondes de ne pas se laisser faire (ce qui s'observe depuis quelques siècles). Grâce à Dieu, à la statistique et à la sociologie progressiste, la société remédie heureusement à cette maladie.
À la limite, ils pourront choisir leur sexe tout à fait librement, une fois arrivés à maturité (c'est bien connu : un destin cruel pesait jusqu'à présent sur les individus en les assignant à un rôle sexuel fondé sur la seule présence arbitraire entre leurs cuisses, à leur naissance, d'un petit cylindre de chair flasque ou d'une fente ouverte sur on ne sait quelles profondeurs obscures).

Don Quichotte, au secours !
Il y a encore des moulins à vent à combattre !
Ah bon ? On vous fait bouffer de la musique contemporaine au-delà du raisonnable pour vous faire entrer dans le crâne que l’extrême dissonance et les intervalles les plus inouïs constituent le fin du fin de la cuisine musicale qui se concocte dans les laboratoires de la modernité (ils appellent ça, sans doute, la « mélodie » d’avant-garde, voir ici même du 24 février au 4 mars) ?
Eh bien de la même façon, on vous gavera, à longueur de médias, à profondeur de journée, à hauteur d'homme et à épaisseur d'esprit, de l’idée que la France se doit d’instaurer la parité intégrale des hommes et des femmes, dût-on pour y parvenir triturer en tout sens la carte électorale et révolutionner le mode de scrutin : si la société tarde ou résiste, le coup de force légal (juste un nouveau règlement administratif) y pourvoira. L'abolition des stéréotypes, tout comme celle des privilèges, un certain 4 août 1789, « sera le genre humain » : elle est d'ores et déjà sur la bonne voie. Même si, y compris parmi les abolitionnistes, semblent se manifester quelques résistances.
Rien de mieux en effet, pour se convaincre qu'il subsiste des obstacles à la disparition des stéréotypes sexués, que d’assister, le 8 mars (avant-hier), à la manifestation qui a eu lieu place Bellecour à Lyon, pour célébrer la journée internationale du droit des femmes, et qui prétendait illustrer brillamment, spectaculairement et fastueusement la fin des stéréotypes, comme on le constate ci-dessous.

(Le Progrès, 9 mars 2015)
C'est-y pas mignon ! Elles adhèrent toutes au PS ? Ou bien à la Manif pour tous ? Faudrait savoir.

D'un côté, les femmes en rose !

De l'autre, les hommes en bleu !
 Les fabricants de dragées de baptême ont encore de
Les fabricants de dragées de baptême ont encore de beaux jours devant eux ! C'est à la Manif pour tous qu'on doit bien rigoler !
beaux jours devant eux ! C'est à la Manif pour tous qu'on doit bien rigoler !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, féminisme, intégrisme, sexisme, machisme, bravo les hommes en bleu, dragées de baptême, stéréotypes sexués, stéréotypes de genre, journal le monde, fronçois hollande, najat vallaud-belkacem, pierre bourdieu, abcd de l'égalité, don quichotte, france, société, l'internationale sera le genre humain, 8 mars, journée internationale droits des femmes, lyon, place bellecour, flash mob, manif pour tous, parti socialiste, journal le progrès
mardi, 10 février 2015
REISER ET LES FEMINISTES
Ne pas confondre « femme » et « féministe ». D’un côté un être humain sexué normal, de l’autre une doctrinaire pétrie d’une idéologie. D’un côté « cinquante-cinq kilos de chair rose » dans « cinquante-cinq grammes de nylon » (Claude Nougaro). De l’autre, des volumes farcis d'histoire, de théorie et de statistiques montés sur deux jambes. D'un côté, une personne qui tente de vivre sa vie le moins mal possible. De l'autre, une militante qui brandit un étendard pour défendre une cause.

D’un côté, des individus vivants, concrets et particuliers, de l’autre des êtres génériques, un peu virtuels, qui se vivent et se pensent comme pourcentage d’une masse, et habités par la rage de modifier l'ordre des choses à leur convenance. Et à qui Bourdieu a appris à se considérer comme victimes a priori (cf. La Domination masculine). Conclusion : on ne dira jamais assez les méfaits impunis des sciences humaines en général et de la sociologie en particulier. Sans parler des sociologues.
Je sens que je suis de nouveau parti pour me faire bien voir ... Bon, je reconnais que tout ça est un peu binaire. Que ça manque de nuances. Certes. Mais le contraste, quand il est accusé, aide à penser. Et puis ça gagne du temps. Et puis, pour être sincère, ça fait du bien. C'est toute la vertu de la caricature. Il se trouve que Reiser, en matière de caricature, il s'y connaît.

Pour dire en passant ce qu'il pensait de Mitterrand.
Reiser ne confondait pas. Autant il dessinait les femmes avec un appétit et un amour jamais démentis, autant il regardait les « combats féministes », disons, avec au moins de la circonspection, peut-être pire. Comme le montrent les quelques dessins glanés dans la « Collection Les années Reiser » (éditions Albin Michel), ce bel hommage rendu par le fidèle Delfeil de Ton à son ami trop tôt disparu (en 1983, je crois).
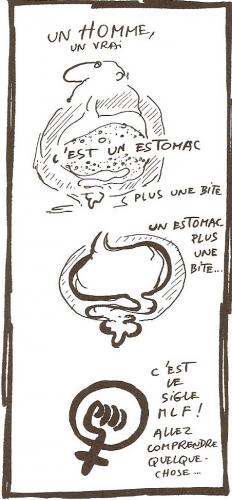
Il n’y allait pas avec le dos de la cuillère.
Voilà ce qu’on a perdu. Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, reiser, charlie hebdo, pierre bourdieu, féminisme, sociologie, caricature, claude nougaro, collection les années reiser, albin michel, delfeil de ton, mlf, mouvement de libération des femmes, société
lundi, 03 juin 2013
QUI EST NORMAL ?

HENRI MATISSE, PHOTOGRAPHIÉ PAR HENRI CARTIER-BRESSON
***
J’ai donc décidé de réhabiliter le mot « normal », ainsi que son frère ennemi « anormal », et de les rétablir dans l’honneur dont une modernité aussi légère qu’inconséquente les avait injustement privés. Dans le couple « normal / anormal », la barre oblique fait office de frontière. Les philosophes et les linguistes appellent ça un discriminant. Qu'est-ce qu'un discriminant ? « Qui établit une séparation entre deux termes » (Nouveau Larousse illustré, 1903). Le même dictionnaire définissait "discrimination" : « Faculté de discerner, de distinguer ».
Inutile de préciser que c'est cette barre oblique qui donnait de l'urticaire à tous les abolisseurs de frontières qui, sous prétexte de lutte pour les droits et pour l'égalité, n'ont rien trouvé de mieux que d'envoyer dans l'enfer de la bien-pensance la notion même d'anormal, en l'assortissant du poids infâme de la culpabilité, et en faisant de la « faculté de discerner, de distinguer » (la barre oblique) une sorcière à envoyer au bûcher séance tenante.
Le mot « anormal » est désormais un pestiféré. C'est même le couple « normal / anormal ». Peut-être une preuve que l'idée même de norme a définitivement filé à l'anglaise, déménagé à la cloche de bois, disparu à l'horizon. Puisque "normal" égale "anormal", plus besoin des termes. C'est logique.
Je ne me défais pas pour autant d’une certaine méfiance envers le mot, et je dirai pourquoi. Cette méfiance date au demeurant de bien avant les caricatures qui en ont été faites, me semble-t-il, au sortir de la 2ème guerre mondiale. Peut-être même dans les années qui ont suivi les « événements » de mai 1968. Ces « heureux temps » (paraît-il) où il était « interdit d’interdire ».
On pense ce qu’on veut de mai 68. De toute façon, tout ça n’a plus guère d’importance. Ce qu’a véhiculé mai 68 dépassait de très loin les petits lanceurs de pavés et autres goguenards se foutant des CRS sur les photos de Gilles Caron (DCB pour ne pas le nommer).  Mai 68, dans ses soubassements, c’était une civilisation qui voulait en déloger une autre. Où l’Amérique avait décidé de virer la vieille Europe d’un coup de pied occulte.
Mai 68, dans ses soubassements, c’était une civilisation qui voulait en déloger une autre. Où l’Amérique avait décidé de virer la vieille Europe d’un coup de pied occulte.
« Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi ! », lisait-on alors sur les murs. Sous-entendu : le vieux monde avec le carcan insupportable de ses normes admises. Si Eugène Pottier et Pierre Degeyter avaient pu imaginer que leur chansonnette triompherait dans la réalité vers la fin des années 1960, peut-être auraient-ils brûlé leur manuscrit de L’Internationale, avec son célèbre : « Du passé faisons table rase … Le monde va changer de base ». Et c’est l’Amérique protestante qui est à l’origine de ce triomphe. Mais ne nous égarons pas.
Car le monde a vraiment changé de base. A la poubelle de l’Histoire, les valeurs universelles. Quant aux Droits de l’Homme, en dehors de donner lieu aux glapissements de justiciers autoproclamés (ONG, « associations » genre Licra, Mrap, Cran, Lgbt, etc.) érigés en gendarmes moraux de l’humanité, et pointant leur « Gros Doigt Grondeur » sur tous les Milosevic et Pol Pot coupables d’abominations, que sont-ils devenus, dans la réalité concrète ?

Je précise : « Gros Doigt Grondeur » se réfère à la très belle BD Sarajevo Tango (1995), où Hermann rend hommage aux défenseurs de la capitale bosniaque et ridiculise la « communauté internationale », au temps de la guerre de Yougoslavie, époque où l’ONU impuissante et réduite aux rodomontades et remontrances était « dirigée » par un certain Boutros Boutros Ghali. Il y a aussi un président « Franz Mac Yavel Druhat-Delohm » (je suis d’accord, ça fait un peu épais). Mais ne nous égarons pas.

Disons donc qu’être « normal » est considéré comme une tare depuis le mouvement de transformation idéologique qui a achevé d’installer la société de consommation vers la fin des années 1960. C’est à partir de là qu’il est devenu de plus en plus risqué de parler des « anormaux » et d’affirmer la valeur des « normes », devenues de plus en plus intolérables à mesure qu’était mis au jour leur caractère « arbitraire », arbitraire voulant dire « lié aux circonstances spatio-temporelles » qui ont présidé à leur établissement. C’est le règne de la contingence : l’essence est très mal vue, « essentialiste » étant devenu une injure, valant disqualification automatique.
Nos institutions, c'est entendu, sont le résultat contingent de circonstances historiques données dans une région donnée du monde. A ce titre, elles ne sont porteuses d'aucune vérité absolue, c'est entendu. C'est entendu, il y a de l'arbitraire dans nos institutions, parce qu'elles résultent de conventions établies entre les membres de la société française.
Qu’importe que toute institution humaine entre dans cette définition, puisqu’il s’agit précisément de « déconstruire » les dites institutions, regroupées sous l’appellation générique « ordre établi » (Foucault, Derrida, auxquels on peut ajouter Bourdieu, bien que pour des raisons différentes).
Toutes les institutions humaines dépendent des conditions qui furent celles de leur élaboration, en un temps et en un lieu donné, nous sommes d’accord là-dessus. Est-ce à dire pour autant qu’elles sont toutes à chier comme des coliques ?
S’il en était ainsi, les « déconstructeurs » ne s’en prendraient pas seulement aux structures mises au monde par la société française, et soumettraient au même régime draconien que celui qu'ils lui font subir toutes les institutions élaborées depuis l’aube des temps dans toutes les régions du monde. On verrait alors ce qu'il en reste, des institutions, mais aussi des élucubrations déconstructionnistes.
Franchement, j’attends qu’on me dise ce qui fait que, dans l’intégralité des sociétés humaines telles que nous en avons connaissance aujourd’hui, seules nos institutions à nous (je pense évidemment au mariage) méritent pareille flagellation.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, henri matisse, henri cartier-bresson, normal, anormal, larousse, définition, dictionnaire, il est interdit d'interdire, gilles caron, daniel cohn-bendit, crs, mai 68, l'internationale, eugène pottier, pierre degeyter, europe, amérique, droits de l'homme, licra, mrap, cran, lgbt, ong, milosevic, pol pot, hermann, bande dessinée, onu, guerre yougoslavie, michel foucault, pierre bourdieu, mariage pour tous, mariage homosexuel
vendredi, 31 mai 2013
TOUT EST NORMAL

LE 1er FEVRIER 1968, EDDIE ADAMS (PRIX PULITZER ET WORLD PRESS POUR CETTE IMAGE) PHOTOGRAPHIE NGUYEN NGOC LOAN, CHEF DE LA POLICE DU SUD VIETNAM, TIRANT UNE BALLE DANS LA TÊTE DE NGUYEN VAN LEM, MEMBRE DU VIETCONG. IL SE REPROCHERA CETTE PHOTO EN APPRENANT PLUS TARD QUE LA "VICTIME" DU POLICIER AVAIT ASSASSINÉ LE MEILLEUR AMI DE CELUI-CI, ET MASSACRÉ SA FAMILLE.
DE QUEL CÔTÉ, LE BIEN ? DE QUEL CÔTÉ, LE MAL ?
***
Suite du billet d'hier.
Reste que je n’ai toujours pas compris ce qu’il y avait « de gauche » dans la revendication du mariage homosexuel. On me dira que je suis bouché, ou qu’il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, ou que je suis "de droite". Certes, c’est une possibilité. Mais je vais sans doute aggraver mon cas, car je ne comprends pas davantage l’argument de l’ « égalité ».
Je croyais bêtement que le 2ème terme de la devise nationale s’appliquait aux individus, point barre. Je croyais qu’il y avait une institution qui s’appelait « mariage », point barre. Et puis voilà-t-il pas qu’il faut maintenant des qualificatifs, des compléments du nom, des propositions subordonnées : individu « quelle que soit son orientation sexuelle » ; mariage « pour tous ». Et les phrases, du coup, prennent un aspect proliférant, puisqu’on est obligé de préciser.
Je ne comprends pas non plus ce qui peut, dans l’instauration du mariage homosexuel, ressembler à un quelconque « progrès ». Sauf, évidemment, à considérer que la progression de l’homosexualité dans la société (et dans le monde) est en elle-même un « progrès ». Cela commence à en faire beaucoup, des choses que je ne comprends pas. Eh bien tant pis.
Je n’ai pas manifesté dans les rues contre le mariage homosexuel. Pour une raison précise : je n’avais aucune envie de me retrouver en compagnie de gens adossés à des doctrines ou des croyances qui ne sont pas les miennes : Eglise catholique, mouvement Civitas, UMP ou autre parti politique, encore moins groupes « identitaires ». Les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis.
Il n’empêche que je me retrouve du même côté que tous ces gens, qui sont opposés pour des raisons variées au mariage de deux hommes ou de deux femmes. Combien de citoyens ont réagi comme moi ? Mystère. Les médias se sont précipités sur Monseigneur Vingt-Trois, sur Frigide Barjot et sur Jean-François Copé. Oui, combien sommes-nous à ne nous reconnaître ni dans les cathos, ni dans les ultras, ni dans l'UMP, et à rester heurtés, dans leur conscience, par la loi votée et par la façon dont elle l'a été ?
Ce qui me turlupine dans cette affaire, c’est qu’il me semble, à tort ou à raison, apercevoir derrière cette « conquête » de nouveaux « droits », une des nombreuses forces qui, dans le monde actuel, ne supportant pas qu’il subsiste des « valeurs » - « universelles » qui plus est -, s’en prennent délibérément aux « points de repère » et à tout ce qui sert de cadre stable aux représentations collectives. Au premier plan de ces points de repère, bien sûr, la différence des sexes.
Pour dire les choses plus directement et plus crûment, je pense que ce qu’il y a, derrière cette « conquête » de « droits », c'est la dernière tentative en date de briser une fois pour toutes l’idée même de « norme ». Voilà, le gros mot est lâché. Je ne sais pas ce qui s’est passé au cours du 20ème siècle, pour que, progressivement, le mot « norme » soit devenu imprononçable, un mot grossier, quasiment une injure.
Et cela au moment même où la France n'a jamais croulé sous un tel poids de normes. Certains parlent de 400.000 normes en vigueur sur le territoire national. Etonnant, non ? Et ça va de la taille des préservatifs à la courbure des concombres, les premiers n'étant pas, selon toute vraisemblance, prévus pour les seconds. Mais en matière de vie collective, le mot a été purement et simplement rayé du vocabulaire admis. Au nom de l'appel à la tolérance et du droit à la différence, il est devenu normal de ne plus supporter les normes. Allez comprendre.
Le problème du mot « norme », c’est qu’on a formé, à partir de lui, l’adjectif « normal ». Et le problème du mot « normal », c’est que c’est lui qui est devenu un gros mot. Dans les dîners en ville, quand un convive audacieux veut le prononcer, il commence par baisser la voix, comme s’il avait honte de ce qu’il allait oser, puis il dresse l’index et le majeur des deux mains, dont il plie les extrémités d’un geste rapide, et articule dans un souffle : « Les gens, entre guillemets, normaux ». Il est gêné d’avoir osé proférer une obscénité. J’attends qu’on me dise, preuves à l’appui, que ce geste ne s’est pas généralisé.
La loi non écrite, que tout un chacun a intériorisée au point d’en faire un réflexe, un automatisme, peut se formuler ainsi : « Article 1er : tout le monde est normal. Article 2ème : toute infraction à l’article 1er s’appelle une stigmatisation, et est en conséquence punissable ». Ainsi en a décidé Michel Foucault (avec d’autres) dans les années 1970, quand il menait les « recherches » qui l’ont conduit au Collège de France.
Puisque les homosexuels ne veulent plus être « stigmatisés » comme « anormaux », c'est le diktat du « normal » qu'il va falloir jeter à bas. Ben oui, au nom de quoi, de quelles valeurs, de quelle autorité surplombante se permet-on de faire le départ entre le Bien et le Mal ? Dans la nouvelle Bible, tout ce qui se déclare normal est d'office suspect d'intolérance. Le verset principal est contenu dans la formule : « De quel droit ? ». Si possible accompagnée d'une mine courroucée. C'est peut-être l'autopsie et l'enterrement de la notion tout entière de norme qui doit être considérée comme un progrès ?

QUAND ON ABANDONNE LE POUVOIR A L'IDEOLOGIE, VOILÀ CE QUE ÇA DONNE
Cette façon de réécrire l’histoire consiste à « déconstruire » l'existant, en se débrouillant pour le faire apparaître comme arbitraire, donc abusif. Tout le monde, et en particulier les « victimes » de « discrimination » et de « stigmatisation », est pleinement fondé à le remettre en question, et même à inverser la charge des responsabilités (de responsable à coupable, il n'y a qu'un pas à franchir). Le tout est d'arriver à faire apparaître l'ordre (établi, traditionnel, etc.) comme injuste par principe. Pour, accessoirement, faire jouer les rapports de forces sous l'action de groupes de pression bien organisés et très militants pour changer tout ça.
C'est ainsi qu'un énorme et long travail idéologique a été fourni dans toutes les instances où s'élabore le savoir (université française, universités américaines, ce qui n'est pas la même chose, comme le montrent ici le singulier de l'une et le pluriel des autres) pour refaçonner les représentations collectives, et cette fois au bénéfice de tous ceux qui, précédemment, étaient catalogués (« stigmatisés ») comme anormaux.
C'est ainsi que cette nouvelle histoire à la sauce Michel Foucault (Histoire de la folie à l'âge classique, Surveiller et punir, ..., mais vous pouvez ajouter quelques pincées de Pierre Bourdieu en fin de cuisson, avec La Reproduction, Les Héritiers, La Domination masculine, ...) s’est désormais établie comme une vérité d’évangile, inculquée dès l’âge le plus tendre, et interdite de toute remise en question, sous peine pour le profanateur d’être catalogué « intolérant », « facho » et, comme tel, d’être désigné à l'universel opprobre (« du ruisseau », ajoute Boby Lapointe dans Le Papa du papa), et englouti dans le silence médiatique qui attend tous ceux qui portent atteinte aux nouvelles tables de la loi. Mis hors d'état de nuire, en tant qu'ennemi public n°1.
Il n’y a plus, qu’on se le dise, d’ « anormaux », qu’ils soient physiques, mentaux, sociaux ou sexuels. Ah si, pourtant, sur ce dernier point, ceux qui désirent copuler avec des enfants. Sans doute au motif que « les enfants, c’est sacré » (les bonnes âmes vertueuses, défenseuses des enfants, devraient aller voir dans les livres de Tony Duvert, Quand mourut Jonathan, L'Île atlantique, etc., aux éditions de Minuit). Quelqu’un a posé ici une limite infranchissable, au-delà de laquelle se situe ce que tout le monde s'accorde à désigner comme une « perversion».

AU BÛCHER, LES OUVRAGES NON CONFORMES !
En dehors de ce cas très précis touchant les enfants, le mot perversion a été rayé du vocabulaire. Pour le reste, TOUT EST NORMAL, on vous dit. Sous-entendu : tout est permis. C’est ainsi que la séquence de lettres LGBT est entrée dans le langage courant, comme n’importe quel mot ordinaire. Encore que quatre pauvres lettres pour résumer toutes les "particularités" humaines en matière de sexualité (on en a fait des dictionnaires pour les recenser toutes), cela ressemble à un abus injustement réducteur.
Ah non, pas tout à fait ordinaire cependant : le mot LGBT est devenu une NORME. Etonnant, non ? Non, ce n'est pas étonnant : c'est le progrès, qu'on vous dit. Bon Dieu, mais c'est bien sûr : c'était donc ça ! Un progrès dont le refrain est : pas touche à mon particularisme, sinon gare à toi !
Sale temps pour les gens normaux. Et sans guillemets.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, eddie adams, guerre du vietnam, saïgon, homosexualité, mariage gay, mariage, françois hollande, sexualité, église catholique, ump, jean-françois copé, monseigneur vingt-trois, frigide barjot, catholiques, michel foucault, collège de france, les anormaux, histoire de la folie à l'âge classique, surveiller et punir, pierre bourdieu, tony duvert, l'île atlantique, quand mourut jonathan, éditions de minuit, perversions, lgbt
jeudi, 01 novembre 2012
LA MALEDICTION DE LA CURIOSITE
Pensée du jour :
« L'intellectuel est si souvent un imbécile que nous devrions toujours le tenir pour tel, jusqu'à ce qu'il nous ait prouvé le contraire ».
GEORGES BERNANOS
Résumé : le champ des sciences humaines, fruits abondants de la curiosité de l'homme pour l'homme, est aussi vaste que l'humanité elle-même, mais encore plus morcelé, tronçonné, parcellisé et cloisonné (si c'est possible). Personne n'y comprend plus rien. Personne n'y voit plus goutte. Il fait plus noir que dans l'anus d'un nègre.
On se demande un peu ce qui explique cette prolifération de disciplines et de "sciences". Je me dis quant à moi qu'il ne faut pas chercher des poires sous un pommier et la main de ma soeur dans la culotte du zouave. Nous vivons dans un système industriel et technique voué au changement permanent. Quand ça bouge sans arrêt, impossible de fixer une quelconque définition.
Ce changement incessant fait que le système est totalement incapable de se connaître lui-même, et qu'il est constamment obligé de réajuster sa connaissance de soi, s'il veut garder une chance de se gouverner. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les sciences humaines découlent de cet effort ? Et que leur prolifération cancéreuse va avec l'accroissement et le creusement de l'ignorance à laquelle notre système est condamné ?
Le résultat, rétrospectivement prévisible, c’est que les disciplines intellectuelles qui consistent à décortiquer le fonctionnement et l’évolution des sociétés humaines et de l’esprit des individus n’ont jamais autant foisonné, et que quand il s’agit de faire appel à un spécialiste, quelle que soit la question soulevée, le journaliste ne sait plus où donner de la tête, tellement son carnet d’adresses ressemble à un bottin pour le nombre de pages.
Jamais autant qu’aujourd’hui, les sociétés n’ont rémunéré autant d’experts en toutes sortes de spécialités pour qu’ils auscultent les groupes humains d’une multitude de points de vue. Impossible d'allumer la radio ou la télé sans tomber sur de l'expert ou du spécialiste. Parce qu’en fait, chaque discipline, dès le moment qu’elle dispose d’un enseignement à l’université, n’a de cesse que de faire comme n’importe quel groupuscule trotskiste : se subdiviser en deux. Quel disciple n’aspire pas à devenir un maître ? Avec son école et ses adeptes bien à lui ?
Tenez, tapez « liste branches "sociologie" » sur Gogol, pour voir, allez sur wiki, et vous serez content du voyage. Rien que pour les méthodologies, vous avez l’embarras du choix : vous pouvez opter pour la « sociologie clinique, économique, historique, juridique, mathématique, politique, rurale, urbaine », et j’en oublie. Quant aux domaines d’étude, c’est la rafale de kalachnikov : « sociologie de l’art, des catastrophes, de la communication, de la connaissance, de l’éducation, de la famille, de l’imaginaire », et j’arrête, parce que trop c’est trop et qu’on a compris.
Et je n’ai pas parlé des « écoles », dont chaque maître à penser (DURKHEIM, WEBER, GURVITCH, BOURDIEU, ...) élève entre ses adeptes et le reste de la profession des cloisons étanches, et gare à eux s’ils vont voir ailleurs, comme on l’a beaucoup vu dans la psychanalyse : c’est l’excommunication. On ne dit plus "bondieuserie", on dit "bourdieusien" ("champ", "habitus", ...) : génuflexion conseillée, sous peine de ...
Prenez ce que vous voulez, histoire, « sciences [sic !!!] de l’éducation » (excusez-moi, je pouffe, c'est nerveux), économie, psychologie, prenez n’importe quelle « science humaine », vous tombez sur un champ d’étude si vaste et si « éparpillé par petits bouts façon puzzle » (BERNARD BLIER dans Les Tontons flingueurs), qu’il faudrait un cartographe de l’IGN pour que la poule retrouve chacun de ses poussins bien à sa place. Soit dit en passant, quelle prétention ne faut-il pas à des gens qui se prétendent sérieux pour s’intituler « chercheurs en sciences de l’éducation » ?
Conclusion ? Je m’en tiendrai à l’essentiel : déjà que dans les « sciences dures », un spécialiste en biologie moléculaire est incompétent en microbiologie ou en biochimie (malgré le "bio" commun aux trois), imaginez ce que ça donne, la parcellisation des tâches (cf. GEORGES FRIEDMANN) dans les « sciences molles » ! Sans parler de l’incroyable prétention à toutes ces dernières à se voir conférer le statut de « sciences » !
Je veux dire que, sans même parler de la « scientificité » (disons le mot) de ces disciplines, quel imposteur oserait prétendre qu’il est capable de faire la SYNTHÈSE de ce magma ? De proposer une explication globale ? Certainement aucun des « experts » ou « spécialistes » issus de l’une quelconque des spécialités.
L’explication de notre monde, qu’on se le dise, ne saurait en aucun cas venir d’un tenant de quelque discipline précise que ce soit. Il faudrait, pour avoir le sens de la chose, un PHILIPPE MURAY, un JACQUES ELLUL, une HANNAH ARENDT. Autrement dit un philosophe moraliste. Cela signifie à mes yeux que plus personne, parmi les médiocres et les bandits qui nous gouvernent, n’a de cap pour diriger le navire. Que plus personne n’est en mesure de dire où nous allons, ni même où il faudrait aller. A commencer par les "experts" et les "spécialistes". Plus ça va, moins nous y voyons clair.
La dernière preuve m'en a été fournie hier ou avant-hier chez MARC VOINCHET, sur France Culture, qui avait invité deux économistes (experts en « science économique », excusez-moi, je pouffe, c'est nerveux) pour parler de la crise. Ils n'étaient pas de la même "école". Chacun a pu parler en paix environ trois minutes vingt-deux secondes. Après, comme c'était sans doute trop, il a fallu que l'animateur s'interpose entre les ennemis pour éviter qu'il y ait du sang sur la moquette du studio. J'en conclus qu'on n'est pas sortis de la crise.
Voilà ce que je dis, moi.
Allez, promis cette fois, à demain la dernière louche. Je vous assure que je n'y peux rien. Et surtout, je ne veux pas faire trop long. Enfin, j'essaie. Là, ce sera vraiment le dernier feu.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges bernanos, littérature, la france contre les robots, politique, société, sciences humaines, contrôle social, humanisme, psychologie, sociologie, psychologues, sociologues, georges friedmann, max weber, durkheim, pierre bourdieu, georges gurvitch, philippe muray, jacques ellul, hannah arendt, marc voinchet, france culture, françois hollande, france, statistiques, jivaros
samedi, 08 septembre 2012
ULTRALIBERAL DE GAUCHE ?
Pensée du jour : « L'âme est un tic ».
ALFRED JARRY
Je disais donc qu’aux Etats-Unis, les libertariens travaillent à la disparition de l’Etat. Leur slogan : « L’Etat n’est pas la solution, c’est le problème ». Dès qu’on leur parle de redistribution des richesses, ils crient à la dictature communiste. Mais s’ils sont ultralibéraux en politique et en économie, ils restent cohérents quand il s’agit des rapports sociaux et des mœurs : ils sont, entre autres et par exemple, favorables au mariage homosexuel et à l’adoption d’enfants par des couples homosexuels. Ils vont au bout de leur logique.
En France, on n’en est pas là. A droite comme à gauche, on reste timoré, pusillanime, pour ne pas dire effarouchable, dès qu’il s’agit d’être logique. Tous deux cultivent leurs contradictions amoureusement, comme un bout de jardin où poussent quelques légumes qui leur servent de fonds de commerce. Chez l’un, la tomate du dirigisme social voisine impunément avec l’aubergine du libéralisme économique. Chez l’autre, le poivron du dirigisme économique côtoie fièrement la courgette du libéralisme social. Et tout ça fait une excellente ratatouille, à condition d'oignons et aulx à suffisance.
Mais on va voir qu’ils poussent le fétichisme de la contradiction encore plus loin, jusque dans le domaine des mœurs. C’est ainsi que monsieur DEDROITE a dressé un piédestal sur lequel il a juché, entre autres valeurs sûres, la famille, le mariage, les bonnes manières. Au nom de la tradition, d’une part, mais d’autre part parce qu’il faut bien fonder la vie commune sur quelques vérités bien senties.
La famille découle de l’union, si possible consacrée en présence de Notre-Seigneur, entre un homme et une femme. L’union est évidemment définitive, et monsieur DEDROITE sentirait ses cheveux se hérisser sur son crâne, rien que d’imaginer qu’il pût en être autrement. La respectabilité avant tout. Cela fait partie des valeurs sûres et éprouvées. Et le respect des enfants pour leurs parents est une simple base de départ, évidente. Quasiment une condition.
Monsieur DEGAUCHE, de ce côté, il faut bien l’avouer, fait beaucoup plus débraillé. La famille ? Il faut être tolérant. Elle est à géométrie variable ? Il faut être compréhensif. Avec des rejetons ouverts aux possibles ? Il faut être tolérant. A peine sortis du berceau, les enfants sont considérés comme des personnes. A ce titre, ils sont dignes de respect : c’est à eux de choisir. La conception de l’enseignement est à l’avenant : c’est à l’enfant lui-même de « construire son savoir ».
Dans La Grande bouffe, MICHEL PICCOLI, avant d’entrer dans la villa de Neuilly pour y mourir d’occlusion intestinale, laisse sa fille lui présenter un grand noir dont le principal talent est de danser comme un dieu. PICCOLI est sûrement DEGAUCHE. Tout ça, apparemment, ne porte guère à conséquence.
Le mariage ? Qu’est-ce que c’est, cette institution désuète ? Il fait partie des structures d’une société honnie. Car monsieur DEGAUCHE déteste en général tout ce qui vient de la société capitaliste, et en particulier, tout ce qui en fait l’armature morale, dont il a bien l’intention de se débarrasser quand il aura changé la société dans son ensemble.
La manière de s’habiller ? JACK LANG, ministre de la Culture, la première fois qu’il voulut aller s’asseoir sur les bancs des ministres à la Chambre, se vit refuser l’accès par les appariteurs. Sûrement soudoyés par la droite réactionnaire : il voulait entrer, rendez-vous compte, en costume impeccable et impeccable pull blanc à col roulé ! Un attentat contre les institutions ! Disons-le : monsieur DEGAUCHE a inventé le « non-conformisme ». Le pull blanc à col roulé, au risque de renverser la république.
Car monsieur DEGAUCHE a accédé au pouvoir. Il y a planté les dents avec curiosité, l'a mâché avec intérêt, avalé avec délices. Ce faisant, il s’est dit : « Pourquoi pas moi ? ». C’est pourquoi en 1983, monsieur DEGAUCHE se convertit à l’économie de marché. C’est la seule concession qu’il consent à l’ordre établi. Pour le reste, il est intraitable : il faut être tolérant avec la canaille car, si l’on y regarde de près, c’est la société qui est responsable et en a fait des victimes. C’est en tout cas ce que proclame saint PIERRE BOURDIEU, de derrière ses lunettes teintées en vert-de-rose.
Il faut aussi se montrer tolérant avec tout ce qu’une société réactionnaire nomme « déviance » (à la rigueur « perversion »). Qu'on se le dise, rien que le fait de nommer déviance ou perversion des pratiques sexuelles statistiquement marginales, c'est porter un JUGEMENT. Et c'est intolérable à monsieur DEGAUCHE.
La « norme » est une convention établie de façon arbitraire par un ordre injuste, qui introduisait un clivage sans pitié entre les « normaux » et les « anormaux ». Ça, c’est saint MICHEL FOUCAULT qui l’a "déconstruit" de façon indubitable et définitive. C’en est fini des normes, du normal et de l’anormal. C'en est fini de juger. Monsieur DEGAUCHE a inventé l'interdiction des critères, des différences et des classements. Il a décidé que poser une limite est une atteinte aux droits fondamentaux. Tout est dans tout, voilà le credo.
C’est lui qui le dit.
A suivre.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alfred jarry, culture, société, politique, moeurs, droite, gauche, mariage homosexuel, france, libertarien, mariage, famille, civilité, la grande bouffe, marco ferreri, michel piccoli, jack lang, pierre bourdieu, tolérance, michel foucault

