samedi, 02 mars 2019
J'AI LU SÉROTONINE 2
2 – Le livre.
Ce que je retiens de la lecture de Sérotonine.
Drôle de lecture, quand même. Pensez, après avoir refermé le livre de Michel Houellebecq, un jour où je furetais dans les rayons de la librairie Vivement dimanche, je suis tombé sur un petit ouvrage de David Le Breton que j’ai acheté aussitôt.
Et cela au seul motif qu’il s’intitule Disparaître de soi (Métailié, 2015). Rendez-vous compte : exactement les mots que j’avais écrits au crayon à la lecture de Sérotonine en face de cette phrase : « Je parvenais à me brosser les dents, ça c’était encore possible, mais j’envisageais avec une franche répugnance la perspective de prendre une douche ou un bain, j’aurais aimé en réalité ne plus avoir de corps, la perspective d’avoir un corps, de devoir y consacrer attentions et soins, m’était de plus en plus insupportable … » (p.92). En fait j’avais souligné "j’aurais aimé ne plus avoir de corps" avant d’inscrire la formule dans la marge.
Pour terminer sur la circonstance, j’ai lu le livre de Le Breton, et j’ai compris pourquoi les sciences humaines en général et la sociologie en particulier souffrent d’une infirmité génétique irrémédiable par rapport à la littérature : l’universitaire produit un livre de tâcheron qui commence par une compilation laborieuse de cas pris généralement dans la littérature (ici le Bartleby d'Herman Melville, Robert Walser, Fernando Pessoa, etc.) et se rapportant au thème que l’auteur s’est choisi, cas dont il fait consciencieusement l’autopsie de façon finalement médico-légale, et où il arrive à lâcher une énormité en faisant de la disparition de soi « une expression radicale de liberté » (p.49 et sans explication). Est-ce que l'impossibilité de se plier à l'observance d'un code est pour autant une expression radicale de liberté ? J'en doute fort, au moins ça se discute.
Heureusement, la suite évite de me faire trop regretter mon achat : l'auteur associe de façon plus convaincante des "faits sociaux" typiques de notre époque, qui montrent le vampirisme effréné d'un système qui vise à vider l'individu de sa substance personnelle (et je ne pense pas seulement à la commercialisation des données personnelles par les "GAFA"). Reste que la littérature est seule à être en mesure de réaliser l'unité du savoir humain. Et que la "disparition de soi" dont la société actuelle nous parle n'est pas l'expression d'un choix, mais l'effet d'un puissant processus de civilisation. Elle nous l'impose.
Sérotonine s’oppose au Disparaître de soi de Le Breton un peu comme les physiciens opposent matière et antimatière. Oui, le bonhomme que met en scène Houellebecq est vide et nul (« …enfin je m’égare revenons à mon sujet qui est moi, ce n’est pas qu’il soit spécialement intéressant mais c’est mon sujet », p.181), il est dans une profonde dépression, dans un état de déréliction pitoyable, il se laisse aller, il ne croit plus en rien, il n’a même plus de désir.
Mais l’étonnant, c’est que dans ce récit d'une déconfiture morale, psychologique et humaine, le romancier parvient à donner à son personnage de Florent-Claude Labrouste, en en faisant une sorte d’anti-Vautrin (le personnage de Balzac est tout en force redoutable, même quand il se fait coffrer par un flic, alors que Sérotonine raconte un naufrage de la première à la dernière page), une existence littéraire spectaculaire et puissante. L'effet de présence est étonnant. Pas à la portée de la première Christine Angot venue.
C’est peut-être ce qui défrise les ennemis de Houellebecq : il élève un superbe monument à la Négation. Il s'en prend aux raisons de vivre (aux "valeurs") communément admises par la communauté des croyants, je veux dire les idolâtres du "Progrès". Les œuvres de Houellebecq, en commettant cette infraction, illustrent assez bien ce que Philippe Muray désigne comme l’enfer des bonnes intentions porté par la modernité, qui est l’évacuation pathologique du tragique inhérent à l’existence humaine : la négativité, autrement dit le Mal. Ce qui se prétend moderne et progressiste aujourd’hui a juste balayé sous le tapis rutilant du "Progrès" (= l’empire du Bien selon Muray) la poussière de sa propre négativité. Et réprime sans pitié tout ce qui met le doigt dessus pour le désigner comme telle.
Et le paysage de ce désastre d’une civilisation (« Plus personne ne sera heureux en Occident, pensa-t-elle », p.102 ; « …une civilisation meurt juste par lassitude … », p.159 ; « La France, et peut-être l’Occident tout entier, était sans doute en train de régresser au "stade oral" », p.323) défile devant le lecteur avec la clarté de l’évidence, dans une narration qui coule sans heurt, avec une régularité, une fluidité qui rendent le récit incontestable et sa « vérité » d’autant plus tangible. J’avais eu la même impression à la lecture de Soumission : une coulée irrésistible. Il y a là un savoir-faire d’autant plus redoutable que les caractéristiques du personnage du narrateur rendent bien compliqué le processus d’identification, ce ressort habituel du romanesque qui donne au lecteur l’impression de se trouver dans l’action.
Houellebecq a trouvé là un moyen « non-brechtien » de pratiquer la « distanciation » : il faut le faire ! Brecht, pour cela, n'hésitait devant aucune grossièreté intellectuelle : il montrait les rouages de la machine théâtrale au sein même de l’action théâtrale : cela suffisait, pensait-il, pour que le spectateur se sente moins « dans l’histoire » que dans une salle bien concrète, où il ne devait jamais perdre de vue qu’un acteur est un acteur, et non le personnage qu’il joue. Tout ça parce que le public ne devait jamais perdre de vue la problématique sociale de l’œuvre et son lien avec la réalité économique et politique : c'était du théâtre militant. Houellebecq n'est pas un militant : il regarde le monde. Il a cessé d'avoir envie de le changer. C'est du réalisme.
Le lecteur accompagne donc Florent-Claude Labrouste dans son naufrage, décrit comme une sorte de mécanique fatale, et auquel le personnage et le lecteur assistent impuissants. Sérotonine est peut-être (entre antres) le roman de l’impuissance : « … je compris que le monde ne faisait pas partie des choses que je pouvais changer … », p.182 ; « … décidément on ne peut rien à la vie des gens, me disais-je, ni l’amitié ni la compassion ni la psychologie ni l’intelligence des situations ne sont d’une utilité quelconque … », p.222-3 ; « Qu’est-ce que nous pouvons, tous autant que nous sommes, à quoi que ce soit ? », p.326. On conçoit que cette litanie des aveux heurte de plein fouet la morale de la volonté inculquée par la tradition chrétienne, selon laquelle « quand on veut on peut », socle d’une conviction du pouvoir de la volonté (= de la liberté) individuelle partagée par toute une civilisation.
L’impuissance masculine du héros, dans l’Armance de Stendhal (le « babilanisme »), est une exception, un cas particulier, elle a quelque chose d’accidentel et d’infâme. Florent-Claude Labrouste subit certes cette impuissance sexuelle (quoique de nature médicamenteuse, induite par le Captorix, cet antidépresseur qui réduit à néant la libido), mais c’est aussi celle, beaucoup plus générale, de « l’homme occidental » (p.87) : les femmes quant à elles (attention : seulement quand elles sont jeunes et fraîches) maintiennent éveillé l’instinct de reproduction et continuent à faire « plus qu’honnêtement leur travail d’érotisation de la vie » (p.323). Et au-delà même de la défaite des hommes, l’impuissance dont parle Houellebecq est aussi celle de la civilisation occidentale.
La civilisation de l'Occident règne sur le monde, et le roman de Houellebecq met précisément le doigt là où ça fait le plus mal : si cette civilisation finit, c'est le monde qui finit.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre, prochainement.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, houellebecq sérotonine, houellebecq soumission, sciences humaines, sociologie, david le breton, le breton disparaître de soi, éditions métailié, bartleby, robert walser, fernando pessoa, florent-claude labrouste, philippe muray, l'empire du bien, impuissance masculine, stendhal armance, captorix, christine angot
jeudi, 17 janvier 2019
HOUELLEBECQ
Je recycle aujourd'hui, en une seule fois, deux billets écrits en 2011 sur deux livres de Michel Houellebecq, au moment où je venais enfin de comprendre, grâce à La Carte et le territoire, l'importance de ses romans. Pourquoi "importance" ? Après tout ce temps, je crois y voir une figuration assez exacte de ce qui achemine la civilisation occidentale vers sa déchéance actuelle et sa destruction prochaine. Le système communiste a implosé, comme on sait, c'est-à-dire qu'il s'est effondré de l'intérieur, sous le poids de sa propre sénilité. Et je me demande si le même destin ne guette pas le système capitaliste, aujourd'hui encore tout fringant et triomphant, mais travaillé de l'intérieur par des forces que nul n'est capable de comprendre dans leur globalité et leurs interactions. J'ai beaucoup élagué tout ce qui m'est apparu superflu à la relecture (digressions, etc). J'ai laissé tout le reste. Je dois reconnaître que je n'ai guère développé le commentaire sur Plateforme. Un signe ? Mais de quoi ?


J’ai mis beaucoup de temps avant d’ouvrir un livre de Michel Houellebecq. Ce qui me repoussait, je crois l’avoir dit ici, c’est la controverse : il y a quelque chose de si futilement médiatique dans la présence éphémère du parfum de quelques noms dans l’air du temps, que je tenais celui-ci pour tout à fait artificiel, voire carrément illusoire, comme c’est le cas de la plupart des effervescences télévisuelles. Je suis devenu excessivement méfiant. En l’occurrence, j’avais tort.
J’ai donc commencé la lecture de Michel Houellebecq quand son dernier roman, La Carte et le territoire, fut placé, un peu par hasard, à proximité immédiate de ma main. J’ai dit grand bien du livre dans ce blog. J’en ai maintenant accroché deux autres à mon tableau de chasse : Les Particules élémentaires et Plateforme. Conclusion, vous allez me demander ? Voilà : je ne sais pas si on a à faire à un « grand » écrivain, je ne sais pas si ce sont des « chefs d’œuvre », comme les critiques patentés en décèlent à foison au fil des semaines. Je veux juste dire que ce sont des livres qui se situent au centre du paysage, pour qui espère comprendre quelque chose à la marche du monde actuel.
Donc, je ne sais pas si Michel Houellebecq est le digne successeur de Balzac et Proust. Ce que je sais, c’est qu’il travaille sur le monde qu’il a sous les yeux, qu’il dit quelque chose du monde tel qu’il est, et qu’il développe sur celui-ci un point de vue, une analyse, une proposition d’éclairage précise, une grille de lecture, si l’on veut.
C’est un romancier qui a pris position par rapport à la « civilisation occidentale », et qui a ceci de bien, s’il parle de lui, de le faire à distance respectable, hors de portée de tir de son propre nombril (malgré les apparences) et des ravages courants que celui-ci commet dans les rangs des « écrivains » français.
On peut trouver le point de vue développé par Michel Houellebecq d’une noirceur exécrable : pour résumer, grâce à la civilisation actuelle, exportée par l’Europe, moulinée avec la sauce techniquante, massifiante et consommante de l’Amérique triomphante, le monde actuel court à sa perte et, d’une certaine façon, est déjà perdu.
L’auteur met-il pour autant ses pas dans ceux de Philippe Muray, comme je l’ai suggéré ? Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que Philippe Muray a développé dès les années 1980 un regard analogue sur la réalité, d’une acuité de plus en plus grande, et un regard de plus en plus pessimiste.
Avant lui, plusieurs auteurs se sont inquiétés de l’évolution de notre monde : Günther Anders (L’Obsolescence de l’homme), Lewis Mumford (Les Transformations de l’homme), Hannah Arendt (La Crise de la culture), Christopher Lasch (La Culture du narcissisme), Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique), Guy Debord (La Société du spectacle), et quelques autres.
Pardon pour l’étalage, mais c’est parce qu’il y a un peu de tous ces regards dans les romans de Michel Houellebecq, tout au moins les trois que j’ai lus (publiés en 1998, 2001 et 2010, ce qui révèle quand même une certaine constance). La « patte » de Philippe Muray, c’est l’attention portée à un aspect particulier de la crise moderne : l’humanité est devenue peu à peu superflue, submergée par des objets techniques, des gadgets qui sont devenus pour elle si « naturels », mais en même temps si dominateurs, qu’elle est progressivement devenue une vulgaire prothèse de ses propres inventions. Philippe Muray le synthétise dans la notion de fête, dans l’abolition de tout ce qui permettait la différenciation (en particulier entre les sexes), dans le nivellement de toutes les « valeurs », et dans l'instauration unilatérale du règne de la positivité en tout, autrement dit de l'Empire du Bien (un des titres des Essais, éd. Les Belles lettres, 1991).
Les Particules élémentaires est un roman qui raconte quelle histoire, en fin de compte ? Janine Ceccaldi, une fille aux capacités intellectuelles hors du commun, épouse Serge Clément, qui entrevoit déjà (on est dans les années 1950) les immenses possibilités de la chirurgie esthétique. Puis elle rencontre Marc Djerzinski, homme talentueux qui œuvre dans le cinéma. Elle divorce pour l’épouser. De ces deux unions naîtront deux demi-frères : Bruno Clément et Michel Djerzinski.
Il y a donc l’histoire de Janine en pointillé. L’histoire d’Annabelle, qui a failli vivre une « belle histoire d’amour » avec Michel. L’histoire des ratages de Bruno qui, en compagnie de Christiane ou sans elle, hantera divers lieux où il espère connaître quelque aventure sexuelle.
A travers le personnage un peu pathétique de Janine, la mère, qui se fait appeler Jane, se formule une description somme toute caustique de l’ère baba-cool : délaissant les deux pères de ses enfants (et ses deux enfants par la même occasion), elle suit un genre de gourou, Francesco Di Meola, qui, s’étant fait pas mal d’argent, abandonne la Californie et Big Sur, où il a rencontré les dieux et les diables de la contre-culture, y compris l’imposteur Carlos Castaneda, celui qui était entiché de son sorcier yaqui, Don Juan Matus, dont il vendit les bobards à des millions d’exemplaires (mais ça, ce n’est pas dans le livre de Michel Houellebecq). Di Meola achète une propriété en Provence.
Janine-Jane (la mère) a baigné dans le jus contre-culturel, mais ce jus a tourné, ou alors il a aigri. Le bilan de son existence est « nettement plus catastrophique ». Et la mère des deux frangins aura une triste fin, dans une maison du village de Saorge, où vivent encore quelques illuminés post-soixante-huitards, dont « Hippie-le-Gris » et « Hippie-le-Noir », que Bruno appelle Ducon.
La scène est curieuse. Bruno est sous traitement de lithium pour raisons psychiatriques.
« Michel observa la créature brunâtre, tassée au fond de son lit, qui les suivit du regard alors qu’ils pénétraient dans la pièce. » Quant à Bruno, tout ce qu’il arrive à dire : « Tu n’es qu’une vieille pute… émit-il d’un ton didactique. Tu mérites de crever. ». « T’as voulu être incinérée ? Poursuivit Bruno avec verve. A la bonne heure, tu seras incinérée. Je mettrai ce qui restera de toi dans un pot, et tous les matins, au réveil, je pisserai sur tes cendres. »
Il y a souvent des problèmes, chez Michel Houellebecq, avec la transmission et avec la filiation. Un moment vaguement hallucinant, où Bruno se met à entonner à pleine voix "Elle va mourir la mamma", tout en insultant à qui mieux-mieux les hippies qui, d'après le testament maternel, vont hériter de la maison.
Face à Bruno, qui débloque sévèrement, le littéraire raté et hors du coup, Michel Houellebecq fait de Michel, en dehors d’un errant affectif quasiment indifférent à tout ce qui est humain, un biologiste à la pointe du « progrès », disons-le, une sorte de génie : son « testament » de chercheur s’intitule Prolégomènes à la réplication parfaite. Michel ne veut pas être emmerdé par les tribulations humaines ordinaires. Peut-être est-ce ce qui guide ses recherches.
Car ce testament s'avère porteur de tout l'avenir scientifique de l'humanité. Chacune de ses propositions révolutionnaires en sera plus tard dûment et scientifiquement prouvée. Autrement dit, le point culminant de son travail ouvre la voie à l’admission du clonage humain comme fondement institutionnel de l’humanité, ce qui débarrasse l'ancienne humanité (la nôtre) de tout le poids sentimental qui l'écrase.
Le livre évoque, depuis un moment du futur, l’extinction de la vieille race humaine. « On est même surpris de voir avec quelle douceur, quelle résignation, et peut-être quel secret soulagement les humains ont consenti à leur propre disparition. » [16 janvier : cela me fait penser à Soumission et à l'évidence tranquille avec laquelle l'islam s'impose en France en 2022.] On perçoit en positif cette post-humanité, qui adresse in fine sa gratitude à l’humanité archaïque : « Cette espèce aussi qui, pour la première fois de l’histoire du monde, sut envisager la possibilité de son propre dépassement ; et qui, quelques années plus tard, sut mettre ce dépassement en pratique ».
On est alors quelque part, dans ce regard rétrospectif, à la fin du 21ème siècle. Et la post-humanité rend alors hommage à l’humanité (la nôtre), qui fut si défectueuse, mais si touchante aussi. Glaçant, et très fort. Quand on ferme le livre, on se prend à espérer que c’est de la science-fiction. Mais ce n’est pas sûr.
La Carte et le territoire offrait une perspective analogue sur la disparition programmée de l’humanité, à travers l’œuvre en mouvement de Jed Martin, présenté comme un grand artiste de son temps. Plateforme nous plonge dans la décadence sexuelle de l'Occident en général et de l’Europe vieillissante en particulier. Le personnage principal, qui se nomme là encore Michel, est un obscur fonctionnaire aux Affaires Culturelles, un statut social négligeable. Au début du livre, Michel, qui vient de perdre son père, participe à un voyage organisé en Thaïlande. Il passe bien sûr par des « salons de massage ». Valérie fait partie du groupe, un groupe triste, hétérogène, et bête, avec ça !
Revenu à Paris, il démarre une relation vraiment amoureuse avec Valérie, qui travaille dans une entreprise de tourisme, sous la direction de Jean-Yves. Lui et Valérie, professionnellement, sont complémentaires. Ils gagnent confortablement leur vie. Une opportunité les propulse à la tête des villages Eldorador.
C’est dans un village de Cuba que Michel suggère à Jean-Yves, pour rétablir la situation de la société, de faire de ses villages des destinations pour un tourisme, disons … « de charme ». Tout se goupille à merveille, et l’entreprise est florissante, mais ces salauds d’islamistes feront tout capoter, avec à la clé l’insurrection de tout le féminisme français contre l’esclavage dégradant et le tourisme sexuel.
C’est sûr, l’humanité de Michel Houellebecq n’est pas belle à voir. Au fond, autant vaut qu’elle disparaisse, n’est-ce pas ? J'ai l'impression que les romans de Michel Houellebecq sont des applications romanesques pratiques de la pensée de Günther Anders (L'obsolescence de l'homme), de Hannah Arendt et de Guy Debord. Et le pire, c'est que ces romans paraissent être à peine de la science-fiction. Ce sont, et c'est Philippe Muray qui le dit à propos des Particules élémentaires, des romans de la fin. Très juste.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, les particules élémentaires, plateforme, la carte et le territoire, günther anders, l'obsolescence de l'homme, hannah arendt, la crise de la culture, christopher lasch, la culture du narcissisme, jacques ellul, guy debord, la société du spectacle, philippe muray, festivus festivus, l'empire du bien
jeudi, 21 janvier 2016
NÉO-RÉAC ET FIER DE L’ÊTRE
Double page « Débats » dans Le Monde daté 19 janvier : « Les néoréacs ont-ils gagné ? ». Ah, que l’intention est belle et noble ! Nicolas Truong, journaliste, fait précéder son article de présentation du « chapeau » suivant : « Le succès d’audience politique et l’hégémonie médiatique des antimodernes ou des néoconservateurs est-il le signe d’une dérive droitière en France ou provient-il de leur capacité à nommer le mal qui ronge nos sociétés ? ». L’alternative proposée a un air d’honnêteté à première vue. A ceci près que je m’étonne de l’expression "audience politique" : je ne savais pas que Finkielkraut, Onfray ou Zemmour (portraiturés en la compagnie bizarre de Patrick Buisson) avaient été nommés conseillers de nos plus hauts responsables politiques, dont ils ne pensent en général pas beaucoup de bien.
Quant à "hégémonie médiatique", je suis très mal placé pour en juger, dépourvu que je suis de cet appareil qu’on appelle « télévision », pour un motif que je persiste à estimer crucial, déterminant, vital, prépondérant, bref : capital. Comme Günther Anders et Guy Debord, je pense en effet qu’avec le poste de télévision installé en bonne place au salon, est juridiquement constitué le délit d’atteinte à la liberté individuelle. Je ne suis donc pas en mesure d’évaluer la force de l’emprise des « néoréacs » sur les plateaux. Contrairement à Philippe Sollers, qui osait dénier à Louis Althusser la qualité de "penseur" du seul fait qu'il n'avait pas la télévision, je crois qu'il est plus facile de continuer à penser quand on n'est pas encombré de cet objet intrusif. Je préfère m'en remettre au concept de "spectacle", élaboré par Guy Debord (voir mon billet du 18 janvier).
A voir l'armée des boucliers qui se lèvent dès qu’un de ces individus suspects ouvre la bouche, j'ai plutôt l'impression que le mot d’ordre est très généralement de faire taire les "néoréacs" sous le déluge des réactions scandalisées. On peut faire confiance au chœur des flics de la pensée pour veiller comme des vestales vigilantes sur le consensus moral, moralisant et moralisateur, dans lequel ils s’efforcent de bétonner toute l’époque, à coups de glapissements. Voir par exemple la façon dont Michel Onfray, qui a été récemment vomi par les cent bouches de la déesse dont parle Georges Brassens dans "Trompettes de la renommée" (« Pour faire parler un peu la déesse aux cent bouches, Faut-il qu'une femme célèbre, une étoile, une star, Vienne prendre entre mes bras la place de ma guitare »), s'est senti obligé de fermer sa page fesse-bouc et son « fil twitter ».
La haine de ces sentinelles de la "Nouvelle Vertu" pour ceux qui commettent des infractions à l’ordre qu’ils veulent faire régner a quelque chose de stupéfiant, et pour tout dire d’incompréhensible. Dans ses pages « Débats », Le Monde se garde bien entendu de trancher, et Nicolas Truong veille soigneusement à ne pas déroger à la sacro-sainte règle de neutralité, qui maintient la ligne du journal dans un juste-milieu de bon aloi, équidistant des extrêmes. Inattaquable.
Enfin, quand je dis "soigneusement", j’exagère. Certes, Nicolas Truong donne la parole à Alain Finkielkraut, et son interview peut donner une impression d’impartialité. Mais il ouvre dans le même temps les colonnes du journal à deux guerriers de la "Nouvelle Vertu" : l’historien Daniel Lindenberg et la sociologue Gisèle Sapiro, qui font jaillir, du haut des chaires universitaires où ils vaticinent, le venin capable de renvoyer l’ennemi déclaré dans le néant dont il n’aurait jamais dû sortir. Comptez : un neutre, un pour, deux contre. Le combat était inégal avant même la publication.
Le point commun, dans l’argumentation de ces deux mercenaires, c’est de ranger les intellectuels « néoréacs » parmi les responsables de la montée de l’extrême-droite : Sapiro fait référence au mouvement allemand « Pegida », Lindenberg à l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson. Lindenberg accuse même les « néoréacs » de véhiculer « une authentique rhétorique d’extrême-droite », quand Sapiro fait mine de s'alarmer de leur succès médiatique « alors que le FN est en pleine ascension ». L’intention, au moins, est claire : disqualifier l’adversaire en le faisant complice de supposés fascistes. Finkielkraut faisant le jeu de Marine Le Pen, l'hypothèse est tellement courge que je ne la discute même pas.
Ce qui apparaît de façon lumineuse, en tout cas, c’est la dissymétrie entre les argumentaires des uns et de l’autre. Alain Finkielkraut porte un regard sur l'ensemble de l'époque : « Je cherche seulement à penser le présent selon ses propres termes. Je le dépouille ainsi des oripeaux dont le revêt la prétendue vigilance et je suis traité de néoréac parce que je dis : "Le roi est nu" ». Finkielkraut mène une analyse du monde tel qu’il va. Il se contente de dire, à la suite de Guy Debord et de Philippe Muray, que le monde et l'humanité vont très mal. Il a quitté les rangs des choristes de l’Empire du Bien, c’est ce que ceux-ci ne lui pardonnent pas.
Car la dissymétrie est là : autant Finkielkraut parle du monde, autant Sapiro et Lindenberg parlent de Finkielkraut. Je veux dire que, si l'un parle du monde, les autres parlent de la personne qui a parlé. Quand celle-ci développe une argumentation « ad rem », ceux-là se déchaînent « ad personam ». Le coup classique : quand un argument t'embarrasse, il suffit d'attaquer la personne qui l'a proféré. Dans la plupart des cas, ça marche, devant les badauds.
Daniel Schneidermann avait utilisé la même ficelle, en son temps, dans Le Monde diplomatique (mai 1996) contre Pierre Bourdieu (que je n'aime pourtant guère), en réponse à l’article où celui-ci tirait les conclusions de son passage dans son émission Arrêt sur images, article intitulé « Peut-on critiquer la télévision à la télévision ? ». Schneidermann, dont j’estime le travail par ailleurs, n’avait pas aimé du tout, et s’en était pris à son invité en l’accusant, entre autres, en jouant sur son nom, de se prendre pour Dieu, si je me souviens bien. J'avais trouvé ça assez bas.
En gros, les « néoréacs » posent un diagnostic sévère sur l’état actuel du monde, alors que leurs accusateurs insultent les personnes qui osent un tel diagnostic. Coup classique, certes, mais infâme. Nicolas Truong pose d’ailleurs la question : « … et si ces néoconservateurs avaient raison ? ». Passons sur les qualifications d' "antimodernes" et de "néoconservateurs", bien qu'il y eût eu à dire. Eh oui, pendant que le sale gosse Alain Finkielkraut est le seul à dire que le roi est nu, alors que la foule des courtisans fait semblant de s’extasier sur la somptuosité de ses vêtements transparents, Daniel Lindenberg et Gisèle Sapiro intiment l’ordre au sale gosse de se taire : il ne faudrait pas, en disant la vérité, désespérer le peuple, on ne sait pas ce dont il serait capable. Cela pourrait créer du désordre.
Cela n’empêche pas Gisèle Sapiro d’avouer sa niaiserie profonde. Devinez comment elle conclut sa diatribe imbécile. Tout simplement en posant la question qu’elle n’aurait jamais dû oser poser. Car après avoir déversé son venin, voici ce qu’elle écrit : « Ils "passent" bien à la télévision ou à la radio. Cela contribue-t-il à expliquer ce qui n’en demeure pas moins un mystère, à savoir, pourquoi ils suscitent un tel intérêt auprès du public ? ». C'est un aveu de défaite, en même temps que d'incompétence fielleuse. Traduction : si le gars a du succès, la teneur de ses propos n'y est pour rien, c'est juste parce qu'il est télégénique.
Traduction bis : pourquoi les gens en redemandent, de ces salauds de « néoréacs », au lieu de nous écouter religieusement, nous qui savons ("de toilette", réplique Boby Lapointe) dire les mots qu'il faut pour rassurer ? Daniel Lindenberg et Gisèle Sapiro ne sont pas des menteurs professionnels. Ils haïssent seulement les porteurs de vérités désagréables. Et le "public" représente à leurs yeux un insondable mystère. J’imagine que leur gagne-pain est lié à la conviction qu’ils affichent dans l’entreprise systémique de dénégation du réel. Sapiro n'est pas près de se faire écouter du peuple. Non, je ne crois pas, contrairement à ce que nous serinent les sondages, que les gens "ont peur", "sont angoissés", et tout ça. J'ai plutôt l'impression que les gens se disent, jour après jour : quel sale monde que le monde qui s'annonce ! Et tous ces guignols qui font semblant de le trouver radieux !
Car Sapiro avoue ici, ingénument, son ignorance de l’essentiel, à savoir ce qu’attendent les gens. Ce qu’ils attendent ? Que ceux qui causent dans le poste leur disent enfin la vérité sur le monde réel. Oui, monsieur Truong, ils attendent des responsables un peu de courage, celui qu’il faut pour « nommer le mal qui ronge nos sociétés », comme vous écrivez. "Nommer le mal" ! Et je peux vous dire que ce mal s’appelle le Mensonge. Et les gens n’en peuvent plus : si on ne leur donne pas la vérité, c’est normal qu’ils préfèrent mettre la tête sous l’aile et s’abstenir aux élections. Leur taux d’abstention est proportionnel au mensonge que les pouvoirs leur servent jusqu'à la nausée. Qui ose aujourd'hui "nommer le mal" ? Je ne vois que les « néoréacs ».
Car la vérité du monde aujourd’hui n’est pas belle à voir. Economie ? Le travail manuel remplacé par des robots, le travail intellectuel remplacé par des logiciels et des algorithmes : c'est promettre la fin du travail et le chômage de masse à perpétuité. Finances ? Soixante-deux bonshommes possèdent autant à eux seuls que la moitié de l’humanité. Politique ? Extinction des idées et des projets, omniprésence de la soif quasi-mafieuse de pouvoir. Ecologie ? Sale temps pour la planète. Et je laisse de côté les migrants, l’islam, Daech, la violence, les guerres en cours, les guerres à venir, …. Franchement, il est dans quel état, le monde ? Ceux qui causent dans le poste ne sont visiblement pas de ce monde-là. Ils doivent péter de trouille en envisageant le jour où les yeux des foules s'ouvriront.
Car il faut rester optimiste, se cramponner au "tout va bien, nous avons les choses bien en main". Alors exterminons les oiseaux de mauvais augure. Mettons à mort le messager porteur de mauvaise nouvelle. A la lanterne, les lanceurs d’alerte. On peut compter sur Daniel Lindenberg et Gisèle Sapiro pour leur passer le nœud coulant.
Je ne remercie pas Le Monde d'avoir donné la parole à deux faussaires, tout en faisant mine d'apporter sa contribution à un grand "débat de société". Qui peut encore croire que c'est le discours des « néoréacs » qui domine toute la scène intellectuelle ? Le Monde apporte ici la preuve du contraire.
La réponse à la question du début, c'est : les « néoréacs » ont perdu. Et ce n'est pas une bonne nouvelle.
Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, débats de société, alain finkielkraut, éric zemmour, michel onfray, günther anders, guy debord, nicolas truong, daniel lindenberg, gisèle sapiro, nicolas sarkozy, patrick buisson, philippe muray, l'empire du bien, daniel schneidermann, le monde diplomatique, pierre bourdieu, sociologie, arrêt sur images, boby lapointe, lanceurs d'alerte, georges brassens
mardi, 08 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 3/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
3/9
De l'importance de la lecture.
Ce qui est sûr, c’est que l’art contemporain, la musique contemporaine, la poésie contemporaine (en ai-je bouffé, des manuscrits indigestes, futiles, vaporeux ou dérisoires, au comité de lecture où je siégeais !), tout cela est tombé de moi comme autant de peaux mortes. De ce naufrage, ont surnagé les œuvres de quelques peintres, de rares compositeurs, d’une poignée de poètes élus. Comme un rat qui veut sauver sa peau, j’ai quitté le navire ultramoderne. J'ai déserté les avant-gardes. C’est d’un autre rivage que je me suis mis à regarder ce Titanic culturel qui s’enfonçait toujours plus loin dans des eaux de plus en plus imbuvables.
Comment expliquer ce revirement brutal ? Bien malin qui le dira. Pour mon compte, j’ai encore du mal. Je cherche. Le vrai de la chose, je crois, est qu’un beau jour, j'ai dû me poser la grande question : je me suis demandé pourquoi, tout bien considéré, je me sentais obligé de m’intéresser à tout ce qui se faisait de nouveau.
Mais surtout, le vrai du vrai de la chose, c’est que j’ai fait (bien tardivement) quelques lectures qui ont arraché les peaux de saucisson qui me couvraient les yeux quand je regardais les acquis du 20ème siècle comme autant de conquêtes victorieuses et de promesses d'avenir radieux. J’ai fini par mettre bout à bout un riche ensemble homogène d’événements, de situations, de manifestations, d’analyses allant tous dans le même sens : un désastre généralisé. C’est alors que le tableau de ce même siècle m’est apparu dans toute la cohérence compacte de son horreur, depuis la guerre de 14-18 jusqu’à l’exploitation et à la consommation effrénées des hommes et de la planète, jusqu'à l’humanité transformée en marchandises, en passant par quelques bombes, quelques génocides, quelques empoisonnements industriels.
 Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
A tort ou à raison, j’ai conclu de cette lecture décisive qu’Hitler et Staline, loin d’être les épouvantails, les effigies monstrueuses et retranchées de l’humanité normale qui en ont été dessinées, n’ont fait que pousser à bout la logique à la fois rationnelle et délirante du monde dans lequel ils vivaient pour la plier au fantasme dément de leur toute-puissance. Hitler et Staline, loin d’être des monstres à jamais hors de l’humanité, furent des hommes ordinaires (la « Banalité du Mal » dont parle Hannah Arendt à propos du procès Eichmann). Il n'y a pas de pommes s'il n'y a pas de pommier. Ils se contentèrent de pousser jusqu’à l’absurde et jusqu’à la terreur la logique d’un système sur lequel repose, encore et toujours, le monde dans lequel nous vivons.
Hitler et Staline (Pol Pot, …) ne sont pas des exceptions ou des aberrations : ils sont des points d’aboutissement. Et le monde actuel, muni de toutes ses machines d’influence et de propagande, loin de se démarquer radicalement de ces systèmes honnis qu’il lui est arrivé de qualifier d’ « Empire du Mal », en est une continuation qui n’a eu pour talent que de rendre l’horreur indolore, invisible et, pour certains, souhaitable.
Un exemple ? L’élimination à la naissance des nouveau-nés mal formés : Hitler, qui voulait refabriquer une race pure, appelait ça l’eugénisme. Les « civilisés » que nous sommes sont convenus que c’était une horreur absolue. Et pourtant, pour eux (pour nous), c’est devenu évident et « naturel ». C’est juste devenu un « bienfait » de la technique : permettre de les éliminer en les empêchant de naître, ce qui revient strictement au même. C’est ainsi que, dans quelques pays où la naissance d’une fille est une calamité, l’échographie prénatale a impunément semé ses ravages.
 D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système
D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
Je citerai une troisième facette de ladite évolution : une réflexion tirée d’ouvrages d’économistes, parmi lesquels ceux du regretté Bernard Maris (à  commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
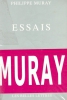 J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
Mais je dois reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
 Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude
Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
L'Histoire (le Pouvoir, la Politique), la Technique, l'Economie, donc : la trinité qui fait peur.
Restent les Lumières originelles : étonnamment et bien que je ne sache pas si le résultat est très cohérent, au profond de moi, elles résistent encore et toujours à l'envahisseur. Sans doute parce qu'en elles je vois encore de l'espoir et du possible.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, avant-garde, titanic, hannah arendt, les origines du totalitarisme, nazisme, staline, hitler, totalitarisme, stalinisme, banalité du mal, jacques ellul, le système technicien, le bluff technologique, günther anders, l'obsolescence de l'homme, bernard maris, charlie hebdo, antimanuel d'économie, jean-marc sylvestre, ultralibéralisme, philippe muray, l'empire du bien, exorcismes spirituels, éditions les belles lettres, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, une paire de bottes vaut shakespeare, éditions gallimard, george orwell essais articles lettres, jean-claude michéa, l'enseignement de l'ignorance, le moi assiégé, christopher lasch, la culture du narcissisme, michel houellebecq, la carte et le territoire, éditions l'encyclopédie des nuisances
jeudi, 30 avril 2015
L'ETAT FOUT LE CAMP ...
... MAIS LE POLICIER PROSPÈRE.
3/3
Je ne veux voir qu’une tête. Je ne veux entendre qu’une parole. Jusqu’à récemment, prononcer l’expression « génocide des Arméniens » conduisait un Turc direct au tribunal et en prison. Il paraît que ce n’est plus le cas, grâce à l’écrivain Ohran Pamuk. C'est encore mal vu, mais ce n'est plus un crime. La justice turque n’a rien compris apparemment au mouvement actuel de l’histoire : elle fait tout à l’envers. Elle n’a pas compris qu’il faut réprimer la parole en amont, à coups de lois transformant opinions et mots en délits ou crimes, et promettant prison et amendes à tous les nouveaux déviants. En espérant que ça empêchera les gens de penser "mal".
Eliminer les nuisibles, fabriquer l'homme nouveau : je crois vaguement me souvenir que c’était le rêve de quelques délicieux « Führer » qui ont ébloui le 20ème siècle des splendeurs de leurs exploits. Façonner ceux qui restent de façon qu’ils soient exempts de tout apport exogène, de toute excentricité allogène, en somme une race certifiée « 100 % pur porc ». Et puis surtout placer les militants du Bien aux postes névralgiques : les postes de commande.
Mais qu’il s’agisse des négateurs de « l'Empire du Bien » (Philippe Muray) ou de Michel Houellebecq, le problème ne cesse pas de se porter sur le « rapport à l’autre que moi ». Celui qui pense déviant, c'est toujours l'autre que moi, à condition que "moi" soit au pouvoir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est Michel Foucault qui est au pouvoir. Enfin, pas lui : ses adeptes confits en dévotion anti-étatique et anti-normative. Ce sont eux qui tiennent les rênes de la loi : la tolérance aux déviances sera totale. De même que l'intolérance aux subversifs qui osent encore poser le mot « déviance » sur certains comportements.
Les « philosophes de la déconstruction » (Foucault, Derrida, Deleuze, pour faire vite) sont les penseurs de la déconstruction de la société en tant tant qu'ensemble structuré. Poussés par l'idéologie, ils n'ont rien compris à l'essence de la socialité : accepter des limites aux droits de l'individu.
A force de soutenir qu'on n'est déviant (Foucault et les fous, Foucault et les prisonniers, Foucault et les anormaux, ...) qu'à cause de l'arbitraire de l'ordre établi, on constate qu'il suffit d'arriver au pouvoir pour inverser la nature de la déviance. Si Michel Foucault, grand militant de la réhabilitation de la déviance dans sa dignité pleine et entière, n'était pas mort du sida trop tôt, nul doute qu'il aurait été ministre pour instaurer la dénonciation de la nouvelle déviance comme moyen de gouvernement.
Mais ce n'était que partie remise : ses descendants ont accompli la chose. Et ce sont ceux qui soutiennent qu'il existe des déviances dans les comportements qui sont alors eux-mêmes considérés comme déviants. Dans le fond, tout dépend si on est au pouvoir ou pas.
Les nouveaux déviants, les indésirables d'aujourd'hui, les nuisibles qui persistent à voir du Mal dans le nouvel « Empire du Bien », ne sont plus dans le même camp : il est tacitement convenu qu'il faut être « progressiste ». Il faut être, comme Laurent Joffrin, du côté de ceux à qui les « conservateurs » et autres « Nouveaux réactionnaires » donnent envie de vomir. Le seul moyen d'y voir clair, c'est de se demander qui, à un moment donné, est détenteur du pouvoir. Je veux dire : qui est en mesure de décréter urbi et orbi ce qui est le seul Bien, le seul « Vrai Bien » admissible. Rétrospectivement, c'est instructif.
L’homme social a besoin de normes, c’est incontestable, je le dis à l'encontre de l’air du temps. Le problème, c'est que, dès qu'il y a "norme", il y a "écart" par rapport à la norme. C'est forcé. La déviance n'est jamais loin. D'où l'exécration générale de la notion de norme (ah, ces quatre doigts qui font les "guillemets" quand on ose, à l'oral, prononcer le mot !). Pourtant, je dirai que la socialité consiste essentiellement dans l'établissement d'une norme.
Les normes, après tout, ne sont rien d’autre que des limites chargées de contenir le moi des individus, dont les propensions totalitaires ne sont jamais à exclure. L'enfant tout-puissant n'est jamais complètement enfoui sous l'adulte d'apparence modeste. La norme est un régulateur social. Un frein à la folie. Il est invraisemblable que la notion de norme soit aujourd'hui à ce point la pestiférée de l'esprit.
Quand la norme se dissout (quand elle prolifère comme un cancer), la société suit aussitôt le mouvement de dissolution. Jean-Pierre Le Goff le dit : « déliaison ». L’appel à la « tolérance », l’interdiction de « l’intolérance » ne sont que des jambes de bois qui n’empêcheront jamais l’humanité de boiter (si possible « des deux pieds », comme dit Tonton Georges). Quel que soit le régime politique. L'humanité boite dans son essence. Tristan Tzara le résume magnifiquement dans son titre L'Homme approximatif.
Le Mal est inarrachable. J'ai fini par m'en convaincre : Jean-Jacques Rousseau a dangereusement tort. L'homme n'est pas "né bon". Il n'est pas non plus "né mauvais". L'homme devient ce qu'en fait la civilisation. Quand il naît, il n'est pas encore. Il deviendra, complexe assemblage de Bien et de Mal.
Jésus le dit dans la « Parabole du bon grain et de l'ivraie » : « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson ». Je ne suis pas théologien, mais je vois dans cette parabole un éloge de la fonction civilisatrice de la société. Aucun homme n'est mauvais d'avance, tout simplement parce que le Mal en lui est indétectable jusqu'à ce qu'il ait mûri. Voilà pourquoi Sarkozy est un imbécile, à vouloir détecter dès trois ans la dangerosité potentielle du futur adulte : « Il n'y a rien à faire, le mal naît en même temps que nous » (Roberto Saviano, Extra pure, 2013).
Les guignols politiques, assis sur le couvercle de la marmite où le Mal bouillonne et prospère, interdisent le Mal par décret, pour complaire à leurs clients électoraux. Ou plutôt, ce n'est pas le Mal qu'ils visent en soi (sur lequel ils sont impuissants), c'est la parole de ceux qui le voient, l'analysent, en parlent. La police et les tribunaux contre les paroles, plutôt que l'action sur les choses.
Ce qui se passe ? Comme l’Etat s’est coupé les mains pour surtout ne pas agir sur la réalité économique, comme il est de plus en plus incapable de parer à la débâcle concrète qui détruit le travail productif et la production de richesses, il a orienté son action sur ceux qui ne peuvent pas contester sa légitimité. Il a rabattu ses crocs, avec férocité, sur la sphère sociétale, les symboles, les « représentations » et les révolutions morales et idéologiques à tout va.
Puisque le politique est désormais impuissant à changer le monde concret, il a entrepris de changer les esprits, en leur injectant de force, dès le berceau, les « éléments de langage » qui leur feront voir la réalité de façon conforme à la grille de lecture officielle, à la ligne du parti unique, le parti bien-pensant.
Puisque la réalité économique lui échappe et part en quenouille, l’Etat se rabat sur les mœurs et les opinions. Le formatage des êtres à la nouvelle doxa, au moyen d'un propagande massive. Il ne faut pas lutter contre le désastre concret et de plus en plus certain auquel les transnationales, industriels, traders, financiers vouent la planète : il faut lutter contre le racisme et l’intolérance, il faut lutter contre le Front National. Cherchez l’erreur. Le mensonge s'est installé à demeure au pouvoir.
Car ceux qui font semblant de parler de cette réalité concrète, et qui noient le poisson et l’asphyxient en le plongeant dans toutes sortes de fumées qui font diversion et détournent l’attention de l’essentiel, sont seulement des MENTEURS.
Je serais à la place du législateur ou du punisseur, qu’il s’appelle Caroline Fourest, Laurent Joffrin ou Edwy Plenel, je commencerais par me demander de quel côté elle est, la HAINE. Et de quel côté les PHOBIES. Proclamer sa haine de la haine, en même temps que ça évite de s’occuper concrètement des problèmes (désindustrialisation, travail, logement, …), n’est pas sans effets.
La haine de certaines haines désignées comme telles (prenez un mot désignant une minorité, et faites-en une "phobie", vous aurez un motif passible de la correctionnelle), travaille sans le savoir à instaurer, sous une surveillance policière de plus en plus méticuleuse, la haine comme norme suprême de la relation sociale (inséparable de l’appel au « vivre-ensemble » et à la « tolérance », pendant obligé de sa double injonction paradoxale).
Quand le législateur se confond avec le justicier érigé en chevalier blanc, le pauvre monde a du mouron à se faire. A plus forte raison quand l’Etat, avec la complicité active de ses « serviteurs », se défile et s’écrase, pour mieux s'effacer et donner le pouvoir aux groupes de pression (filières professionnelles, entreprises, lobbies, compartiments étanches multiples appelés « minorités », …).
Disons-le, quand il devient le jouet, le pantin, la marionnette de toutes sortes de groupes influents qui grenouillent autour de tous ceux qui décident et ont la signature, qui obtiennent le vote de lois destinées à satisfaire leurs « justes revendications ».
La privatisation de tout ce qui était encore il y a peu le « Bien Commun » et le « Service Public », ajoutée au devenir policier du « Vivre ensemble », voilà un modèle de société auquel n’avaient pensé ni les humanistes de la Renaissance, ni les philosophes des Lumières.
C’est curieux, les paradoxes de l’histoire : je ne sais plus si c’est Marx ou Lénine qui assignait pour but ultime au communisme l’extinction de l’Etat. L’Etat ? Il est en train de s’éteindre, ou plutôt de crever, mais sous les coups de l’ennemi juré du communisme, depuis les débuts de celui-ci. J’ai nommé le Capitalisme.
Et ce n'est pas drôle.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : tout cela est long, lourd, touffu, j'en conviens. Indigeste. La faute aux relectures successives, aux ajouts et retouches opérés, et à la flemme d'y mettre de l'ordre.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : turquie, génocide arménien, ohran pamuk, l'empire du bien, michel houellebecq, philippe muray, michel foucault, la folie à l'âge classique, les anormaux, jacques derrida, deleuze, philosophes de la déconstruction, laurent joffrin, jean-pierre le goff, georges brassens, tristan tzara, l'homme approximatif, jean-jacques rousseau, jésus, parabole du bon grain et de l'ivraie, roberto saviano extra pure, nicolas sarkozy, caroline fourest, edwy plenel, service public à la française
mercredi, 29 avril 2015
L'ETAT FOUT LE CAMP ...
... MAIS LE POLICIER PROSPÈRE.
2/3
Parlant des outils que certains (comme Alain Bauer, « criminologue », grand copain en maçonnerie de Manuel Valls (avec Stéphane Fouks), "ami" de Nicolas Sarkozy, accessoirement franc-maçon haut placé et propriétaire d’une société privée (tiens donc !) de conseil en sécurité) tentent de mettre en place, l'au-dessus de tout soupçon juriste Mireille Delmas-Marty écrit en effet : « Baptisées "sciences criminologiques", ces analyses de risque, soutenues par une industrie de la surveillance en pleine expansion où des cadres issus des écoles de commerce côtoient des retraités des armées et des services de police et de renseignement, permettraient de prédire le risque de récidive » (p. 47). Je retiens surtout que l’ "industrie de la surveillance" est "en pleine expansion" et que les commerciaux copinent sans problème avec policiers et militaires.
Cette expansion est un signe des temps et éclaire d’un jour curieux le débat autour de la « loi renseignement », je trouve. Légaliser l’intrusion policière dans les vies privées par des instances étatiques, ça revient finalement à calquer « ce qui reste de l’Etat » sur la façon dont n’importe quelle entreprise commerciale (mettons Google ou Facebook) est organisée en vue d’une efficacité parfaite dans le ciblage du client potentiel.
Je vais même vous dire : ce n'est rien d'autre qu'un énorme sondage d'opinions généralisé, permanent et en temps réel. Un sondage d'opinion un peu spécial : on ne vous demande pas si vous voulez répondre à des questions. On a votre réponse avant que quiconque vous ait posé la question. C'est même vous qui l'avez fait spontanément.
Je sais, vous allez dire : « Tant que je n'ai rien à me reprocher ». Eh oui, je sais, vous avez déjà intériorisé l'Etat policier. Vous anticipez : vous concevez vos idées en fonction de ce qui risque de vous être reproché. Et tout ça démocratiquement. Bravo, nous construisons l'avenir radieux.
Je vais vous dire : les nouvelles méthodes commerciales et policières d'intrusion, de pistage et de traçage des trajectoires individuelles constituent l'absolu du marketing publicitaire appliqué à la gestion sécuritaire de la société. L’Etat-puissance-publique aligne son fonctionnement sur le management « à l’américaine » des entreprises privées : se retrouver « aux affaires », c’est être amené à se conformer à la « politique managériale » la plus efficace possible.
Et les gestionnaires actuels de l’Etat français sont tout bonnement en train d’appliquer à la puissance publique ce qui se pratique dans les entreprises privées : les principes du « lean management », dont le but est de débarrasser l’entreprise de toute la graisse qui entrave et ralentit le processus productif, y compris les stations devant la machine à café (« lean » veut dire « maigre », cf. la RGPP, non-remplacement de fonctionnaires partant à la retraite, si chère à Sarkozy). T'échanges trois mots avec ton collègue du service voisin : tu fais perdre du fric à ton entreprise ! Simple comme bonjour. Soumettre l'Etat au plus sévère régime d'amaigrissement possible, tout en accroissant son efficacité policière. Fallait y penser.
Car le renseignement n’est qu’un aspect de la question. J’ai en effet tendance à mettre bout à bout plusieurs annonces récentes du même tonneau où l’anodin le dispute au correctionnel. Sur le modèle de la Belgique et du Luxembourg, on parle d’instaurer en France le vote obligatoire, en prenant soin de préciser qu’au grand-duché, l’infraction coûte 1.000 €. Vous serez citoyens, ou vous ne serez pas. On vous forcera à être des électeurs libres et responsables. C’est pas fini.
Sur le modèle de la Suède, cette fois, on parle de faire une loi anti-fessée. On vous forcera à être des parents « immer korrect » (c’est-à-dire, comme ça se passe en Suède, sans cesse en train de négocier avec le gamin pour le persuader de se laisser éduquer parce que c'est pour son bien), sous peine de vous voir déchus de vos droits.
Pour la loi prochainement destinée à criminaliser les paroles (déjà que) de ceux qu’on traite d’antisémites, d'islamophobes ou d'homophobes, on ne fera pas une loi « sur le modèle de », parce que le lobby est assez puissant en France pour agir en amont de toute déclaration d’allégeance à un modèle quelconque.
En France, le lobby anti-antisémite, antisexiste, anti-islamophobe, anti-homophobe est devenu une composante du pouvoir. Par exemple, studieux et obéissant, le président de la République Française défère à l'injonction, comminatoire et annuelle, d'avoir à se présenter, en tant qu'ultime élu de la dite République, au congrès du CRIJF ou dans une synagogue, si possible en couvrant son crâne d'une kippa (après les attentats de janvier) ! Je renonce à comprendre.
Notez que le vocabulaire se prête volontiers à tous les trafics : le mot « racisme » a une portée beaucoup plus générale qu’« antisémitisme ». C'est sans doute pour ça qu'il a été ajouté a posteriori pour donner l'acronyme LICRA, ligue qui, si je ne me trompe, a été fondée par un juif, et qui, au départ, ciblait exclusivement l’antisémitisme. Le R de "racisme" a permis d’embellir le présentoir dans la vitrine et d'élargir la clientèle, pour mieux vendre une idée déjà instrumentalisée.
C’est sûr, Philippe Muray était dans le vrai, quand il dénonçait l’ « envie de pénal ». Tous les prétextes sont bons aux yeux des modéliseurs et spécialistes du formatage de l’humain, habités par l’obsession de fabriquer par décret une humanité exempte de tout Mal originel. De toute impureté biologique. De toute idéologie déviante.
Il faut empêcher une fois pour toutes le Mal de nuire. Il suffit de décréter que le Mal est définitivement banni de notre « Empire du Bien » (Philippe Muray, bien sûr) pour éliminer les infâmes nuisibles qui osent voir dans ce « Bien » même le germe d’un nouveau Mal : tous ceux qui ne sont pas d’accord avec cette vision irénique et policière des choses, tous les méchants qu’on a rassemblés dans ce centre de rétention d’un nouveau genre qu’est l’étiquette « Nouveaux Réactionnaires ». Notez bien "irénique et policière".
Le "Nouveau Réactionnaire", voilà l'ennemi, voilà le nuisible à éliminer du champ de vision. Je suis toujours étonné du nombre de gens qui se portent volontaires pour faire la police sur la voie publique de la pensée et des opinions. Toujours prêts à porter l'affaire devant la justice pour "incitation à la haine". Il faut faire taire les "Nouveaux Réactionnaires".
En commençant par les empêcher de s’exprimer. C’est la vision néo-conservatrice fanatique et fondamentaliste à la George W. Bush qu’on importe ainsi en France. A une grande différence près : privée de la complète liberté d’expression en vigueur aux USA. Appelons ça la double peine. Fait pas bon passer pour un réactionnaire, de nos jours. Alors que l' "incitation à la haine", elle ne vient pas de là où l'on pense.
Je signale que le mot "réactionnaire" désignait au départ tous ceux qui, après la Révolution, militaient pour rétablir la monarchie absolue, à l'exemple de Joseph de Maistre. Aujourd'hui, il désigne sous forme d'insulte tous ceux qui ne sont pas béats d'admiration devant le processus en cours, dont la seule ambition est d'instaurer un nouvel ordre moral.
« Ce qui reste de l'Etat » sera policier ou ne sera pas.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, france, état policier, criminologie, alain bauer, francs-maçons, manuel valls, nicolas sarkozy, stéphane fouks, mireille delmas-marty, loi renseignement, état français, rgpp, vote obligatoire, antisémitisme, islamophobie, homophobie, sexisme, féminisme, crijf, république française, kippa, licra, philippe muray, nouveaux réactionnaires, l'empire du bien, george w bush, joseph de maistre
samedi, 28 mars 2015
UNE GUEULE BIENVEILLANTE
QUELQUES FIGURES (PRESQUE) HUMAINES 2
Barong est un bon dieu : il combat éternellement la déesse du Mal. Elle s'appelle Rangda. Mais ça date de bien avant l'arrivée de George W. Bush, vous savez, ce cinglé qui s'est mis à la tête de la « Croisade » contre « L'Axe du Mal ».
Et puis par ailleurs, je pose la question : qu'attendent les féministes (vous savez, ces combattantes de L'Empire du Bien selon Philippe Muray) pour monter à l'assaut de ces traditions balinaises, odieuses, archaïques, dépassées, patriarcales, et pour tout dire sexistes et machistes (pour faire bonne mesure), qui osent faire d'une femme le principe du Mal ? Il faut en finir avec les hommes primitifs. Qu'attend la Civilisation pour y mettre bon ordre ?
La femme tant aimée, à laquelle Baudelaire adressait ce compliment :
« Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces,
Après les derniers sacrements,
Quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements ».
Il est vrai que c'est le même qui écrivait ailleurs : « La femme est bien dans son droit, et même elle accomplit une sorte de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle ; il faut qu'elle étonne, qu'elle charme ; idole, elle doit se dorer pour être adorée. Elle doit donc emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits ».
09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, barong, bali, tradition, féminisme, l'empire du bien, philippe muray, baudelaire une charogne, baudelaire le peintre de la vie moderne, george w. bush
lundi, 23 mars 2015
UN TRISTE SIRE ...
… ET UN ODIEUX PERSONNAGE
Je ne connais pas Laurent Obertone. Il vient de publier La France Big Brother, que je ne lirai pas : cela fait belle lurette que je suis au courant. Je n’oublie pas ma lecture de 1984, il y a longtemps, où apparaît le « Grand Frère », cette simple anticipation que George Orwell appliquait alors au régime stalinien, mais qui, le progrès technique aidant, est devenu le modèle de développement de grands groupes industriels (Apple, Google, etc. …), jusqu’à modeler de A à Z ce qu’il est convenu d’appeler encore une « civilisation occidentale ». 1984 apparaîtrait presque comme l'ébauche grossière et prémonitoire de ce modèle, qui s'est, depuis, merveilleusement perfectionné.
Sans même parler des « Grandes Oreilles » mises en place par la CIA, la NSA et les officines d’espionnage de tous les pays (Edward Snowden, ...), ces firmes ont substitué aux polices secrètes du « Petit Père des Peuples » (PPP, à ne pas confondre avec les Partenariats Public-Privé, ruineux pour les finances publiques, instaurés par Nicolas Sarkozy) l’ordre numérique et marchand qui surveille nos comportements grâce à des logiciels et algorithmes de plus en plus sophistiqués et intrusifs.
Je n'apprends rien à personne : le moindre pas de la fourmi dans sa fourmilière est cartographié, mis en mémoire, retraçable, inoubliable, ineffaçable. La police n'a plus besoin de poser des questions à des personnes, plus d'interrogatoire à mener : les réponses n'attendent qu'une requête de sa part pour parvenir.
Avouez que le profilage commercial de l’internaute consommateur et le stockage ad libitum de ses « données personnelles » dans une « ferme de serveurs » aux fins de constituer un réservoir infini de « Big Data », c’est tout de même moins terroriste que le KGB ou le NKVD de Staline.
Est-ce moins totalitaire ? Je pose la question. Je réponds que, tout bien considéré, une autre forme de totalitarisme pointe ici le bout de l'oreille. Au moins le bout : le nec plus ultra en matière de totalitarisme, celui auquel les masses adhèrent avec enthousiasme.
Est-ce moins totalitaire ? Laurent Joffrin, lui, le cogérant et directeur de la publication et de la rédaction (tout ça !) du journal Libération, répond par une affirmative épanouie, décomplexée, et pour tout dire d’un optimisme enfin libéré de toute entrave : nos chères démocraties n'ont strictement rien à voir avec ça. Exactement ce que Philippe Muray nommait « L'Empire du Bien ». L'insupportable et invivable Empire du Bien. Précisément le fonds de commerce du « journaliste » Laurent Joffrin (il a la carte, mais ...).
Laurent Joffrin ignore de toute la hauteur de sa superbe (et de sa suffisance satisfaite, voir le portrait, ci-contre, qu'il aime afficher dans son journal), le fichage généralisé des individus qui usent des technologies numériques en général et de l'informatique en particulier. Il n'y voit aucune atteinte aux libertés. Il doit se dire : « Ça ne me pose aucun problème, je n'ai rien à me reprocher ». S'il raisonne ainsi, il a de drôles de lunettes.
suffisance satisfaite, voir le portrait, ci-contre, qu'il aime afficher dans son journal), le fichage généralisé des individus qui usent des technologies numériques en général et de l'informatique en particulier. Il n'y voit aucune atteinte aux libertés. Il doit se dire : « Ça ne me pose aucun problème, je n'ai rien à me reprocher ». S'il raisonne ainsi, il a de drôles de lunettes.
Dire que Laurent Joffrin, Mouchard de son vrai nom (on se demande bien pourquoi il en a honte, c'est un joli nom, Mouchard, pour un journaliste), n’aime pas Laurent Obertone, c’est un euphémisme. Il y a peut-être des raisons de ne pas aimer Laurent Obertone, si on se réfère à ce que j’ai trouvé sur le monsieur en pianotant devant l’ordinateur. Je n’ai ni le temps ni l’envie de creuser la question. Il faut juste retenir que Laurent Joffrin se paie une page de publicité gratuite en plantant ses ergots de coq dévasté par le multiculturalisme dans le cadavre bientôt froid de son ennemi. C'est dans son journal qu'on la trouve, sous la forme d'une "chronique des livres parus".
Donc, Laurent Joffrin n’aime pas Laurent Obertone (c’est aussi un pseudo, paraît-il). Raison ou pas, mon propos est ailleurs. Il se trouve qu’il mentionne en passant, dans son papier, « l’excellente émission d’Alain Finkielkraut » (« Répliques », le samedi matin à 9 heures sur France Culture). Inutile de dire qu'il la trouve excellente parce qu'il y est invité. Il se trouve que j’ai écouté le début de cette émission. Juste le début.
Or il écrit, dans la « recension » (le mot « assassinat » serait plus exact, puisqu'il l'intitule d'une façon qui se veut originale et humoristique, et qui est juste infamante et grotesque, voir ci-dessous) qu’il en propose dans Libération de samedi 21 mars : « Il a, ainsi, pu expliquer, une heure durant, sur une radio nationale, que le système médiatique aux mains de la pensée unique l’empêchait de parler ». Je m’inscris en faux, monsieur Joffrin. Je vous prends ici en flagrant délit de mensonge.

Je ne connais pas Laurent Obertone. Je doute fort, cependant, qu'il ressemble en quoi que ce soit à l'illustre chef de guerre des barbares.
Si Laurent Obertone a été empêché de parler, ce n’est pas à cause du « système médiatique », c’est parce qu’un certain Laurent Joffrin n'a cessé de lui couper la parole dès qu’il ouvrait la bouche pour exposer ses idées. Si celles-ci sont aussi nauséeuses que le pense Joffrin, la moindre des courtoisies à l'égard de l’auditeur que je suis, pour qu'il s'en rende compte par lui-même, c'est de laisser le monsieur étaler en détail ce qui fait son ignominie supposée : sinon, je n’ai aucun moyen de savoir à quoi m’en tenir, à part acheter le livre.
Laurent Obertone n’a strictement rien pu développer. J’ai dit que j’ai écouté le début de « Répliques ». En effet, quand j’ai jugé, au bout d'un quart d'heure, que, vraiment, monsieur Joffrin s’était rendu assez odieux, j’ai coupé. Comment puis-je encore acheter le torchon publié sous l'autorité de Laurent Joffrin ? Peut-être parce que j'y trouve, de loin en loin, de véritables et importantes informations. Que j'estime trop cher payées.
Non seulement l’odieux monsieur Joffrin n’a cessé de couper la parole de l’interlocuteur, mais dans l’article cité ci-dessus, il ment effrontément en affirmant qu’Obertone « a pu expliquer, une heure duant … ». Vous êtes un odieux menteur, monsieur Joffrin, je suis là pour en témoigner. Et ce faisant, vous êtes à vous tout seul une illustration exemplaire de la validité du reproche que Laurent Obertone, selon vous, fait au « système médiatique ».
La peste soit de ces voix que leur notoriété autorise à s’exprimer sur les ondes ou dans les journaux, et à empêcher de le faire tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Je pense à Edwy Plenel, à Caroline Fourest, à quelques autres, qui viennent jouer les professeurs de morale sur France Culture. Laurent Joffrin appartient à cette même espèce nuisible qui se cramponne aux lambeaux des valeurs qui ont fait la démocratie, la République française, et dont il ne restera bientôt plus que le souvenir.
De derrière ce rempart en mie de pain, ces petits flics de la pensée (assez minables dans leur démarche, il faut le dire) lancent incantations, imprécations et foudres sur ceux qui osent rouler un peu à côté des rails des certitudes orthodoxes, émettre le moindre doute sur la validité du modèle qui les nourrit, remettre tant soit peu en question le bien-fondé des certitudes et du modèle.
Laurent Joffrin, avec ses semblables, tente de disqualifier, de ridiculiser l’adversaire en caricaturant son message (ici, Laurent Obertone est dénoncé pour l'amalgame qu'il fait entre nos régimes démocratiques et le totalitarisme policier élaboré par Staline). Exemple : « Dans cette société totalitaire, en effet, on a le front de penser, en général, que les hommes sont égaux en droit, que le racisme est condamnable et que les femmes peuvent prétendre aux mêmes droits que les hommes ». Un peu lourd, vous ne trouvez pas ?
Ça lui permet, et d'une, de faire ronfler une fois de plus les grands mots de la doxa, et de deux, de ne pas faire l'effort d'entrer dans les détails, le CQFD servant de point de départ à son raisonnement. En logique, cela s’appelle une « pétition de principe », le raisonnement typique du fraudeur et du démagogue, qui consiste à dénaturer les arguments de l'adversaire pour mieux les anéantir et le faire huer par le public qu'on a ainsi mis de son côté, conquis par la force de l'évidence.
Comme ses semblables, non content de faire semblant, outrageusement semblant, Laurent Joffrin pratique allègrement la dénégation du réel, au nom, dit-il, des grands principes. L’odieux, ici, est qu’il fait semblant d’oublier que le propre d’une idéologie, c’est de se présenter comme une évidence incontestable, de ne pas se reconnaître comme idéologie, mais de s'affirmer comme vérité. Laurent Joffrin est finalement le parfait exemple de l’idéologue qui, parce qu’il en tire les moyens de sa subsistance, se tient dans le système comme un rat dans son fromage.
Encore quelqu'un qui ne doit pas aimer les livres de Michel Houellebecq.
On a compris que je n'irai pas à l'enterrement de Laurent Joffrin : je ne veux pas entendre l'éloge que prononcera François Hollande à la mémoire de ce grand « Patron de Presse ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal libération, laurent joffrin, laurent obertone, la france big brother, totalitarisme, philippe muray, l'empire du bien, george orwell 1984, staline, stalinisme, kgb, nkvd, cia, nsa, edward snowden, big data, alain finkielkraut répliques, france culture, edwy plenel, caroline fourest, michel houellebecq
lundi, 26 janvier 2015
CHRISTINE ANGOT A LA HAINE 2/?
2
Oui, je n’aurais rien dit, mais voilà, celle qui n’a aucune parenté avec la seule Madame Angot qui vaille à mes yeux (ou plutôt à mes oreilles : c'est la fille de la dame, selon Charles Lecoq), n’est pas seulement « écrivain » : elle est aussi, avec une apparente satisfaction, un personnage médiatique important. Elle consent à se laisser présenter à l’occasion micros et caméras quand des journalistes en mal de papier font appel à elle pour remplir leurs obligations, croient-ils, professionnelles.

Sous la direction de Jésus Etcheverry.
Et puis là, elle se laisse offrir, avec répugnance (qu'elle prétend, mais elle ne répugne pas longtemps), une page entière du Monde (daté 16 janvier). Quatre colonnes larges et bien tassées. Si la dame n’est pas une autorité, au moins est-on sûr qu’elle « a de la surface ». Et des relations bien placées.
Au moins est-on sûr qu'elle est du bon côté de l'establishment, tous gens garnis de bonne conscience, sûrs de leur bon droit, édictant au nom de l'Empire du Bien (cf. Philippe Muray) ce qu'il est loisible, voire licite de faire, et ce qui doit être conduit devant les tribunaux populaires.
Toute un grande page du Monde, donc. Et pour parler de quoi ? De qui ? De Houellebecq ! Farpaitement. Angot qui se mêle de critique littéraire ! On aura tout vu ! Il est vrai que certains enfants croient mordicus que c'est à eux d'apprendre à leur mère à faire des enfants ! Au point où on en est !...
Notez que si je l’ai traitée de « pauvre pomme tombée d’un poirier », c’est qu’elle l’a bien cherché. Pensez, sous le gros pavé du titre (« C’est pas le moment de chroniquer Houellebecq », mais dans le texte, elle met la négation, c’est bien un coup du Monde, ça), elle n’y va pas par quatre chemins : Houellebecq, elle n’aime pas. C'est son droit. Ensuite, ça dépend de la façon dont on s'y prend pour le dire.
Moi, Houellebecq, je ne le connais pas. Ce que je connais, ce sont ses romans. Et ce que je sais, c'est que ces romans sont les meilleurs que j'aie lus, tous auteurs français confondus, depuis fort longtemps, quoi qu'en disent des gens que j'ai appréciés par ailleurs. Par exemple Eric Naulleau, qui traite Houellebecq de « romancier de gare » en 2005 (Au Secours, Houellebecq revient !, Chiflet et Cie). Je ne sais pas s'il est revenu entre-temps sur cette erreur manifeste de jugement.
Naulleau s'est racheté en 2008 en assaisonnant Christine Angot, façon pimentée, qu'il habillait pour les hivers les plus rigoureux, dans un livre très drôle et très juste : Le Jourde et Naulleau, Mango. Ma doué, quelle avoinée il lui mettait ! Comme quoi les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis, mais j'ai de l'affection pour certains. D'autant plus que je note que Houellebecq ne figure pas dans le jeu de massacre auquel se livrent les deux compères dans leur bouquin. S'il n'y a pas amende honorable, on n'est pas loin. Et ça rassure.
Exemple de prose sur laquelle Naulleau dirigeait ses boulets rouges, pour montrer de quoi la dame est capable : « Vous avez beaucoup approuvé la construction de L'Inceste, qu'elle était remarquable. C'était complètement un hasard, c'était un moteur en marche, ça suffit vos appréciations, stylistiques, narrotologiques [sic], techniques. Construit, construit veut dire enfermé, enfermé veut dire emprisonné, emprisonné veut dire puni, puni veut dire bêtise, bêtise veut dire faute, faute, erreur, erreur, faute de goût ou morale très grave, moi je n'ai rien fait de mal donc il n'y a aucune raison que je me construise une raison et une construction. Compris cette fois, Quitter la ville, pas de construction » (Quitter la ville, p.79, cité p. 29 du livre de Jourde et Naulleau). Angot, c'est bête, à chaque nouveau bouquin, j'entrouvre, je feuillette, ça confirme, je repose. Vous comprenez maintenant pourquoi.
Je passe sur l'état larvaire de la langue et sur l'infantilisme qui conclut le tout à fait étrange enchaînement associatif (« Mais j'ai rien fait, m'sieur ! »). Je note juste que l'auteur propose le magma et le chaos de la pensée (si on peut appeler ça pensée) comme principe de création littéraire. C'est pourquoi le relatif succès de ses livres comporte quelque chose d'inquiétant quant à l'état intellectuel de la partie de la population qui les achète.
Aux yeux des autres (ceux qui ne lisent pas ça), j'espère que ce bref aperçu sur la panade que constitue la prose de la dame rend superflu une analyse en détail. Chacun peut percevoir l'état pathétique de ce que des esprits aveuglés, stipendiés ou pervers n'hésitent pas à appeler une entreprise littéraire innovante. Tout juste bonne, l'entreprise littéraire innovante, à finir dans une poubelle du musée de l'Art Brut (vous savez, cette PME spécialisée dans le recyclage des déchets de l'Art).
Houellebecq, Angot ne l'aime pas. On commence à comprendre pourquoi. Elle le dit, et ça m'a tout l'air d'être viscéral. Alors là, je dis non : « Touche pas à mon Houellebecq ! ». Remarque, je dis ça pour pasticher, parce qu'il se défend très bien tout seul, celui qui vient de perdre son ami Bernard Maris. Bel élan d’humanité, belle élégance du geste, soit dit en passant, de la dénommée Christine Angot en direction de l’équipe de Charlie Hebdo, que de s'en prendre à un livre que le dit Bernard Maris venait d'encenser dans l'hebdomadaire, dans son tout dernier article.
Quoi, toute une belle page du « journal de référence » ! Et pour dégoiser quel genre de gandoises, s’il vous plaît ? Remarquez qu’on pouvait s’y attendre : la démonstration lumineuse que Christine Angot n’a rien compris. Houellebecq, elle n’y entrave que pouic. Rien de rien. J’ajoute que par-dessus le marché, elle n’a sans doute aucune idée de ce qu'est la chose littéraire. Bon, elle n’est pas la seule à sortir des sottises au sujet de « l’écrivain controversé ». Dans le genre gognandises savantes, j’ai entendu de belles pommes tomber aussi de la bouche poirière d’un certain Eric Fassin. J’en ai parlé.
Et puis Houellebecq n’est pas le seul à subir les foudres féminines. Il n’y a pas si longtemps (2012), l’excellent Richard Millet s’est fait dégommer par la très oubliable Annie Ernaux qui, dans une tribune parue dans Le Monde (tiens tiens !), traitait l’auteur de « fasciste ». Rien de moins. Il faut dire que le cousin n’y allait pas de main morte : faire l’éloge "littéraire" d’Anders Breivik, auteur d’une tuerie en Norvège, était pour le moins une prise de risque.
Certaines femmes n’aiment vraiment pas les mots de certains hommes ! Elles sont les modernes Fouquier-Tinville. C'est sûrement un hasard : Millet, Houellebecq, Philippe Muray en son temps, vous ne trouvez pas que ça commence à dessiner un profil ? Comme si des rôles étaient en train de se distribuer. D'un côté, tous ceux (en l'occurrence toutes celles) qui lancent des fatwas. De l'autre, ... c'est facile à deviner. Gare la suite !
C’est dans un jardin public de Tarbes que Jean Paulhan trouva l’idée d’un de ses titres (Les Fleurs de Tarbes), parce qu’il avait lu cette inscription à l’entrée : « Il est interdit d’entrer dans le jardin avec des fleurs à la main » (si je me souviens bien). Le sous-titre était plus explicite : « La Terreur dans les Lettres ». La Terreur, il n'y a pas seulement celle de fanatiques qui répandent le sang pour la gloire d’Allah (ou d'Akbar, je n’ai pas bien compris de qui il s’agit, peut-être deux frangins ?), il y a aussi celle de fanatiques socio-culturels, bien décidés à imposer dans les esprits leur propre conception de l'art, de la littérature et de la vie en société. A faire régner leur ordre.
Après la Terreur de la vérité maoïste imposée en son temps par Tel Quel et Philippe Sollers (dont Simon Leys a fait amplement et durablement les frais), la Terreur des impératifs moraux selon les Papesses Jeanne des Lettres françaises actuelles, Annie Ernaux et Christine Angot. Les temps changent, la Terreur reste.
Nous sommes pris entre celle que font régner les modernes Fouquier-Tinville et celle que lancent des imams (quand ce ne sont pas des ayatollahs). Sale temps pour la culture et la vie de l'esprit. Il y aura toujours des braves gens pour tirer la chevillette pour faire choir la bobinette de la guillotine morale sur le cou des créateurs de littérature. Virtuel, le cou, heureusement. Tant que ce ne sont pas des balles islamistes qui le coupent ...
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, christine angot, michel houellebecq, soumission, la fille de madame angot, charles lecoq, journal le monde, l'empire du bien, philippe muray, éric naulleau, au secours houellebecq revient, pierre jourde, le jourde et naulleau, musée de l'art brut, charlie hebdo, bernard maris, oncle bernard, éric fassin, richard millet, anders behring breivik, annie ernaux, fouquier-tinville, jean paulhan, les fleurs de tarbes, la terreur, tel quel, philippe sollers
mardi, 04 juin 2013
QUI EST NORMAL ?

WILLIAM CLAXTON PHOTOGRAPHIA, ENTRE AUTRES, LES GRANDS DU JAZZ.
ICI, SA MAJESTÉ CHET BAKER. AH ! "MY FUNNY VALENTINE" ! MÊME MILES DAVIS, QUI A LONGTEMPS FAIT SA CHOCHOTTE, A FINI PAR Y VENIR, A "MY FUNNY VALENTINE".
***
Episode précédent : les institutions sont donc faites, selon les thuriféraires stipendiés ou non de la modernité urgente, pour s'adapter aux désirs successifs et changeants des populations. Il n'y a plus de vérité absolue. L'humanité est devenue un énorme, permanent et profond sable mouvant conceptuel.
Quand on parle de norme, de normal et d’anormal, il s’agit de bien identifier la personne à laquelle on a à faire. On appellera « progressistes » tous ceux qui s’efforcent de faire « bouger » les choses, à force de « transgressions » de la norme, qui veulent « briser » les « tabous », et qui s'en prennent à tout ce qui emprisonne l’individu dans le « carcan d'intolérances » dues au crétinisme des « gens normaux ».
En face de ces enthousiastes de « l’empire du Bien », on appellera « nouveaux réactionnaires » (Philippe Muray en est une des figures principales) tous ceux qui se cramponnent à des valeurs plus anciennes, immobiles, a priori suspectes au plus grand nombre, du seul fait qu’elles avaient cours avant, ce qui les dévalue irrémédiablement, forcément et par principe. Il s’agit d’envoyer aux oubliettes les tenants de ce qui existe, puisque ce qui existe a le défaut rédhibitoire d’avoir existé. « Du passé faisons table rase ! », leur crie la « modernité » en colère.
De là (aux environs de mai 1968), datent ces slogans fulgurants d’audace : « Changez ! », « Bougez ! ». Sous-entendu : ce que vous êtes, ce que vous pensez, la façon dont vous vivez, c’est de la merde. Ce que vous êtes aujour'hui n'est que de l'étron infâme et informe, laissez-vous façonner, sculpter par les temps nouveaux qui viennent vous libérer de toutes les pesanteurs. Léger, léger, léger. Ce qui était ne doit plus être. Ce que vous étiez doit se soumettre à la nouvelle loi : la transformation perpétuelle de l'un dans l'autre.
Sous-entendu aussi : ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas est figé, froid, cadavérique. La voilà, la norme énorme d’aujourd’hui : menace de mort. Et l’anormal, d’avance condamné, c’est celui qui, s’en tenant à de l’existant, refuse obstinément d’ « avancer » du même pas que les autres sur la voie lumineuse du merveilleux et impérieux « Progrès ». Pour rester vivant, paraît-il.
Pourquoi faut-il changer, au fait ? Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut, parce que le monde aujourd'hui est comme ça, parce que ..., parce que ... Finalement, quand tu réfléchis, tous ces adeptes du respect de l'identité qui se ruent sur le changement d'identité pour rester quelque chose, ça finit par faire bizarre. Moi qui croyais qu'une vérité, quelle qu'elle fût, se remarquait au fait qu'elle était durable. Quelle désillusion !
Eh bien si c’est comme ça, je me sens furieusement « anormal ». Mais alors là attention : du genre anormal assumé, endurci, récidiviste et irrécupérable. Pour un peu, j'en deviendrais presque arrogant. Et pour montrer que les anormaux comme moi ne pèchent pas par ignorance de ce qui se passe sous leurs yeux, je propose d'organiser prochainement (ben oui, c'est l'époque, la Fête de la Musique est dans pas longtemps, ça ferait de l'animation), un de ces quatre, une splendide « Anormal Pride » ?
Puisqu'il s'agit de nos jours de s'affirmer à travers des « marches des fiertés », il n'y a aucune raison pour que les anormaux de mon espèce, redressant leur front suppliant vers des cieux qui braquent leurs yeux intransigeants sur leurs errances coupables, n'aient pas enfin, à leur tour, leur moment de fierté, eux qui sont invités en permanence à revêtir des imperméables gris pour raser les murs en espérant passer inaperçus, courbés sous le poids de la honte.
Le plus curieux dans l'affaire, c'est qu'une telle « marche des fiertés » des nouveaux anormaux serait potentiellement en mesure de réunir une majorité de citoyens. Mais qui est désormais fier d'être normal ? Il n'y a pas à être fier d'être normal, puisque c'est normal d'être normal. C'est là le drame.
 Je note que ce mouvement accompagne la naissance du nouvel homme, que Philippe Muray nomme « homo festivus », voire « homo festivus festivus » (voir ses entretiens avec Elisabeth Lévy, ci-contre, chez Fayard). C’est vrai qu’il est un peu hallucinant d’entendre les gens se plaindre que, dans leur hameau, leur village ou leur ville, « il ne se passe jamais rien », quand aucun « événement » ne s’y produit. Il faut savoir que l' « événementiel » est devenu une branche florissante de l'entreprise et du commerce, et que des entrepreneurs audacieux s'y sont accrochés avec succès.
Je note que ce mouvement accompagne la naissance du nouvel homme, que Philippe Muray nomme « homo festivus », voire « homo festivus festivus » (voir ses entretiens avec Elisabeth Lévy, ci-contre, chez Fayard). C’est vrai qu’il est un peu hallucinant d’entendre les gens se plaindre que, dans leur hameau, leur village ou leur ville, « il ne se passe jamais rien », quand aucun « événement » ne s’y produit. Il faut savoir que l' « événementiel » est devenu une branche florissante de l'entreprise et du commerce, et que des entrepreneurs audacieux s'y sont accrochés avec succès.
C’est vrai qu’aujourd’hui vous ne commencez à vous sentir mériter d'exister que si une caméra de la télé, branchée sur le direct, est présente pour vous le confirmer. Quand on a ainsi « mérité l'événement », l'existence en prend une densité et une saveur nouvelles. Quand je pense que le pauvre Sartre croyait avoir compris et être capable d’expliquer toute l’époque dans Huis-clos, avec son : « L’enfer c’est les autres » ! Juste de quoi rire un peu, somme toute, avec le recul.
Quand les gens trouvent qu’il ne se passe rien chez eux, d’abord, comprenez qu’ils ne connaissent pas leur bonheur, ensuite entendez qu’il ne s’y donne aucun spectacle, qu’aucune « animation » ne vient l’ « animer », que le Tour de France ne s’y est jamais arrêté, que Gérard Collomb, merdelyon, n’a jamais eu l’idée d’y organiser les « Nuits Sonores » que le monde entier nous envie, et toute cette sorte de choses.
Que dirait Montaigne aujourd’hui, lui qui affirmait : « Je suis desgousté de la nouvelleté » (Essais, I, 23), et qui répondait à un ami qui se plaignait de n’avoir « rien fait » de sa journée : « Eh ! Avez-vous pas vécu ? » ? Aujourd’hui ? Montaigne aurait tout faux. Il n’aurait rien compris à la loi de la modernité : « Changez ! », « Bougez ! ».
Comme si les gens, dans ces occasions, oubliaient que leur existence ne s’est pas interrompue malgré l’absence de tout événement extérieur ou de toute caméra de télé. La population se sentirait-elle à ce point vide ?
Bon sang mais c'est bien sûr : c'est donc pour ça que marchands de smartphones dernier cri avides de deniers et politiciens avides de bouts de papier imprimés à leur nom s’entendent à merveille pour faire croire au vulgum pecus que, sans leurs initiatives, prises en vue du bien de tous (la FÊTE conjuguée à tous les temps et à tous les modes), l’existence de tous serait un désert, un espace inutile occupé par le vide intersidéral.
« Mais elle est passée où, la vie intérieure ? », se demande l’anormal attardé, perdu au milieu de ce nulle part en carton pâte, en attendant que passe l'improbable « Anormal Pride ». L’anormal attardé ne se rend même pas compte qu’il vient encore de proférer un gros mot. Si, il s'en rend compte, hélas.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, william claxton, chet baker, jazz, miles davis, my funny valentine, normal, anormal, progrès, civilisation, transgression, l'empire du bien, philippe muray, mai 68, homo festivus, festivus festivus, élisabeth lévy, jean-paul sartre, huis clos, l'enfer c'est les autres, fête, montaigne, essais de montaigne
lundi, 13 mai 2013
AH, "FAIRE SOCIETE" !

***
Les « zompolitics » (pour faire Coluche, il faudrait avoir le son) en ont plein la bouche. Députés, ministres, chefs de parti ne parlent « à regonfle » (comme on disait chez moi quand le patois lyonnais voulait encore dire quelque chose) que du « vivrensemble », de « faire société », de « refaire du lien social ». Les journalistes s'y sont mis.
Il paraît que ce genre d'affirmation, ça pose son homme, et ça donne une idée de son sens des responsabilités et de sa volonté de se dévouer pour ses semblables, en espérant toucher les dividendes de son investissement. Je n’exagère pas, tous ceux qui lisent cette note peuvent s’en convaincre en allumant le poste à l’heure de la propagande (je parle évidemment du 20 heures de TF1 ou de France 2) ou en donnant l'obole à leur quotidien de dilection morose. Ah, le « vivrensemble» !

ALLEZ ! TOUT LE MONDE REPREND EN CHOEUR AU REFRAIN !
C’est à qui en fera le plus pour apparaître, au milieu du cheptel politique (vaste troupeau de bovins carnivores, je veux dire de "vaches folles", mais ce sont ces mêmes vaches qui traient les bouseux que nous sommes, le monde à l'envers) comme le plus sérieusement convaincu que le « collectif » est le bien suprême, mais surtout que c’est lui qui s’en occupe le plus sérieusement.
Le problème, c’est que « faire société », ce n’est pas un individu, si haut qu’il soit placé, qui peut le décider. Regardez par exemple ce que c’est très vite devenu, la « fête des voisins » : une table, quelques chaises, des verres et des bouteilles. Des conneries. Quoi, c’est tout ? Oui, un point c’est tout.
Ce n’est pas la « fête des voisins » qui peut changer un iota au rythme et à la vitesse de croisière auxquels chaque individu se déplace dans sa propre vie quotidienne. Et ce n’est pas de crier « tous ensemble tous ensemble ouais ! » en arpentant les rues principales des grandes villes pour protester contre le gouvernement (10.000 selon la police) qui y changera une virgule.
Regardez l'énorme n’importe quoi qu’est immédiatement devenue la « fête de la musique » décidée par l’inénarrable pantin Jack Lang : une innommable bouillie sonore à coups de décibels électriques avec, dans certains quartiers urbains, un « orchestre » de jeunes « rockeurs » malhabiles appuyés sur la puissance d’amplificateurs qui leur donnent l’impression de faire de la « musique », alors qu’il ne font que du bruit, à peine compensé par le bruit que fait le groupe suivant, à cinquante mètres de là.
Soit dit en passant, en traitant Jack Lang d’inénarrable pantin, je suis d’une affabilité excessive, quand je lis ce qu’en écrivait Philippe Muray en 1998 dans la préface à la réédition son Empire du Bien : « A ce propos, je dois avouer mon étonnement de n’avoir nulle part songé, en 1991, à outrager comme il se devait le plus galonné des festivocrates, je veux parler de Jack Lang ; lequel ne se contente plus d’avoir autrefois imposé ce viol protégé et moralisé qu’on appelle Fête de la Musique, … ». Et ce n'est pas fini, mais j’arrête la fusillade.
« Faire société », il faudrait bien s’en convaincre, ça ne se décide pas. Pour une raison assez simple : c’est quand ça « ne fait plus société » qu’on se rend compte qu’il y en avait une, de société. C’est quand chacun des atomes que nous sommes est réduit à sa simple fonction de numéro dans une liste de numéros qu’on se rend compte qu’une société, ce n’est pas une liste d’individus. Il ne faut pas confondre « faire société » et administrer la société.
En effet, tant qu’on peut parler de « corps social », on a de quoi se faire une petite idée de ce que c’est, une société. Est-ce qu’il suffit pour cela d’avoir des institutions en état de marche avec des gens pour les faire fonctionner ? Je me permets d’en douter. Car qu’est-ce que c’est, un corps social ? C’est forcément une métaphore. Mais qui veut bien dire ce qu’elle dit. Comme dit Paul Ricœur, en titre merveilleux d’une de ses belles œuvres, c’est une « métaphore vive ». Et ça, y a pas à tortiller, ça ne s'administre pas.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, martin veyron, revue à suivre, humour, hommes politiques, fête des voisins, fête de la musique, jack lang, philippe muray, l'empire du bien
samedi, 11 mai 2013
LE PORTATIF DE PHILIPPE MURAY

***
Philippe Muray est donc indispensable à tout ce qui prétend garder l’œil grand ouvert sur le monde que nous façonnent les marchands de tout poil (vendeurs de salades, de boniments ou de brosses à dents), aidés par l’industrie de la propagande, passée maîtresse dans l’art de tordre les mots pour les obliger à servir leurs intérêts. Leurs intérêts ? Ça tient en une phrase : soumission à la consommation et acceptation du mode de vie que son règne impose.
Avec un effort particulier pour amener les individus qui constituent ce qu’on appelle une population à ne plus penser par eux-mêmes, et à accepter comme paroles d’évangile deux sortes de messages : « Venez vous amuser (ce qui signifie : oublier les conditions qui vous sont faites) dans les fêtes que nous organisons pour vous ! ». Et : « Si vous n’êtes pas tolérants et respectueux des « droits » que d’infimes « minorités » font valoir, vous êtes bons pour la correctionnelle ». Je me contente de ces deux illustrations de la résistance de Philippe Muray à la mensée « mainstream ». Il y en a d'autres.
D’un côté, donc, la « fête » à tous les étages, dans tous les lieux et à tous les moments possibles. De l’autre, ce que Muray appelle « l’envie du pénal » (parodiant l’ « envie du pénis » prêtée par Sigmund Freud aux petites filles). D’un côté le « festivisme » exacerbé (voir les pages qu’il consacre à l’ouverture du parc Eurodisney à Marne-la-Vallée). De l’autre, la punition pour tous ceux qui porteraient atteinte à la « dignité » de tous ceux qui se présentent comme des « victimes » de l’ « intolérance ».
D’un côté, l’imposture d’une « fête » qui s’impose à tous. De l’autre l’imposture d’une « tolérance » qui n’est que l’expression d’un flicage de plus en plus pointilleux de la population. En tout état de cause, ce que ne digère pas Philippe Muray, c’est l’imposture de l’époque. Il s’efforce de démolir le discours qu’elle tient sur elle-même pour élever sa propre statue, et que colportent tous ses thuriféraires stipendiés ou ses adeptes aux yeux illuminés. Finalement, ce qu’il traque, c’est l’idéologie inquiétante qui se dissimule sous le masque de la positivité absolue et du consensus obligatoire et joyeux (genre sourire contractuel, "rien que du bonheur").

GASTON CHAISSAC ETAIT-IL VRAIMENT L'ARTISTE IDOINE POUR CETTE COUVERTURE ?
Je viens de revenir à Philippe Muray en ouvrant un tout petit (80 pages environ) bouquin publié par Les Belles Lettres et 1001 nuits en 2006 : Le Portatif (d’où le titre de ce couple de billets). Ce titre est à mon avis excessif : « Le titre que je donne à cet ensemble est un hommage au Dictionnaire philosophique de Voltaire, surnommé Le Portatif par ses lecteurs ». « Hommage », pourquoi pas ? La taille de l’ouvrage, et surtout ce qu’on y trouve, tout ça fait que la référence ne tient pas. Bon, c'est vrai que l'auteur l'a laissé en plan avant achèvement.
Ce qu’on y trouve, c’est pour tout dire un peu sec. C’est sûr que pour se faire une idée du lexique favori de Philippe Muray, l’ouvrage le permet. Sommaire, mais une idée. Première approche, quoi. A l’article « absent », inaugural, il pointe l’injonction qui est faite aux gens de participer (même à l’insu de son plein gré) à la « société du spectacle », et l’interdiction qui leur est faite de disparaître sans son aval (Kafka, je ne sais plus où, faisait de la possibilité de disparaître le dernier refuge de la liberté individuelle).
Il traite de l’infantilisation générale, de « l’Empire du Cœur » (qu’il appelle « cordicolisme », bon, moi, je veux bien …), de l’exigence de transparence, de Disneyland, de l’Europe, le l’ « homo festivus » et de l’ « hyperfestif », de la « post-histoire », de la modernité, de la musique (dans laquelle il voit, peut-être pas à tort, un moyen de domestication des foules, j’en ai parlé ici même en septembre 2012), de l’occultisme, des réactionnaires, de l’unification de la collectivité en un gros tas de chouettes copains, du retour en force de l’hygiénisme (rebaptisé « problème de santé publique »), et de quelques autres notions. Ce que regrettera le lecteur un peu aguerri de Philippe Muray, dans Le Portatif, c’est sa sécheresse de squelette de poisson.

LE BANDEAU SURDIMENSIONNÉ SEMBLE INDIQUER QUE MURAY A TROUVÉ UN PUBLIC.
JE DIS : EH BIEN TANT MIEUX !!!
Et pour qui voudrait y aller voir de plus près, je conseille malgré tout les 1800 pages des Essais (L’Empire du Bien, Après l’histoire I et II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV). Ça vaut largement les 33 € que ça coûte. Et pour être franc, ça se lit tout seul. C'est dans L'Empire du Bien que Philippe Muray développe les considérations qui lui permettent d'affirmer en conclusion que : « Notre société médiatique n'est pas du tout, comme on le prétend, la "forme moderne et achevée du divertissement"; c'est la figure ultime de la censure préventivement imposée ». Empêcher l'expression de savoir qu'elle pourrait devenir expression : le fin du fin en matière de totalitarisme.
En plus, quand on referme le livre, on se dit que la langue française et le style ont pris un bain de Jouvence.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe muray, littérature, essais, le portatif, l'empire du bien, après l'histoire, exorcismes spirituels
vendredi, 10 mai 2013
LE PORTATIF DE PHILIPPE MURAY

OUI, JE SAIS, CE N'ETAIT PAS ENCORE L'EURO
***
Ça fait une paie que je n’ai pas évoqué la haute figure de Philippe Muray. C’est regrettable : lire un peu de Philippe Muray chaque jour, c’est une excellente hygiène de l’esprit, en même temps que ça permet d’affûter la lame du regard jeté sur notre époque.
C’en est au point qu’au sujet de la pensée de Philippe Muray, je pourrais dire la même chose que Tonton Georges (mais lui, c’est d’une femme qu’il parle) : « Tout est bon chez elle, Y a rien à jeter ». Quoique je ne sois pas sûr qu’on puisse vraiment parler de la « pensée » de Philippe Muray. Il ne se prétendit jamais philosophe, Dieu merci. Après tout, je ne trouve rien de plus pertinent que « regard ». Un regard acéré, pour sûr.
Je n’ai pas lu tout Philippe Muray, juste les essais, et ses entretiens avec Elisabeth Lévy dans Festivus festivus (Fayard, 2005). Même pas tous les essais : j’ai calé, je l’avoue humblement, au bout de deux centaines de pages (sur 670) de Le 19ème siècle à travers les âges. Qu’est-ce qu’il a aussi besoin de faire bourgeonner à l’infini son cumulo-nimbus conceptuel ? La prolixité, moi, j’ai du mal. Et dans ce bouquin, s'il y a des idées proprement géniales, je n'y peux rien, la surabondance de l'expression m'intimide au point de me paralyser. Mais promis, je vais tâcher de m'y remettre.
En dehors de ça, je m’étais carrément régalé à la lecture du gros (1800 pages) volume publié par Les Belles Lettres, regroupant sous le titre Essais (2010) tout ce que Philippe Muray a publié dans des revues diverses et variées, articles plus ou moins développés, plus ou moins regroupés par thèmes, par dates ou par supports. Successivement, ça donne L'Empire du Bien, Après l'histoire, Exorcismes spirituels. Comme le conclut le rapport déposé par Superdupont sur la nouille française dans la Rubrique-à-brac (Marcel Gotlib, bien sûr) : « Rien que du bon : 98 %, Sel, 2 %».

Franchement, pour qui veut confirmer et conforter l’exécrable opinion qu’il a du « monde tel qu’il est », c’est une lecture de nécessité vitale, apte à rendre au suicidaire l’envie de retarder le geste fatal (dans le 813 de Maurice Leblanc, c’est ce qu’aura seulement réussi à faire Arsène Lupin, avec son obscur Leduc (le trop bien nommé), dont il aurait voulu poser le cul sur le prestigieux trône du grand-duché de Deux-Ponts-Veldenz).
Quel est le propos de Philippe Muray, pour ce que je peux en connaître ? Pour résumer et simplifier, il n’a pas un « système » à proprement parler, simplement il regarde, il écoute, il existe et il juge. Ce qu’il reproche à l’époque, c’est tout d’abord qu’il n’aime pas qu’on se paie sa tête en se payant de mots. Car on est à l’époque du bobard généralisé, du travestissement et du détournement des mots, de l’instauration du règne du langage perverti.
Ce qui me plaît aussi, dans la démarche de Muray, c’est qu’il refuse cette espèce de lâcheté tiédasse qui doit, paraît-il, habiller la pensée de tout universitaire qui se respecte : Muray n’est pas de ces « intellos » qui développent à n’en plus finir des argumentaires spécieux et interminables pour montrer qu’ils ont examiné la question sous toutes les coutures, et décider de ne rien décider tout en s’efforçant d’entortiller un peu de fantôme de réalité dans l’inextricable réseau de lianes de leurs raisonnements ou dans le serpentin labyrinthique de l’alambic de leurs systèmes abstrus.
Philippe Muray ne consent pas : il existe.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : philippe muray, élisabeth lévy, littérature, bande dessinée, martin veyron, revue à suivre, gotlib, rubrique-à-brac, georges brassens, festivus festivus, le xixè à travers les âges, l'empire du bien, après l'histoire, exorcismes spirituels, superdupont, maurice leblanc, arsène lupin


