lundi, 04 juillet 2016
AU FOND DES OUBLIETTES
Je peste assez régulièrement contre les politiciens qui persistent à plonger depuis des décennies la France dans des réalités qui ne sont que bourbiers marécageux. Et je supporte d'autant moins leur hypocrisie quintessentielle qu'ils passent leur temps à brandir bien haut l’étendard purement fictionnel des principes et des « valeurs » de la « République ».
Or je viens de tomber sur quelques citations qui m’ont donné l’impression de me retrouver en terrain connu, dans une atmosphère soudain fraternelle. Jugez plutôt : « Républicains, oui, nous le sommes. Et c’est pour cela justement que, dans certaines figures barbouillées de mensonge et d’effroi, nous refusons de reconnaître l’austère visage jacobin. La République, ça ? Allons donc ! la République, cette puante macédoine de faisans, de mendiants, de prévaricateurs ? … L’héritage des "grands ancêtres", ce refuge de la combine, de l’injustice, de l’impunité ? Ah, messieurs, vous voulez rire ! ». Rudement bien tapé, et en plein milieu de la cible ! Et avec le style, s’il vous plaît ! Cette plume porte des griffes au bout de son génie.
Ceci est écrit en 1934, figure dans Pavés rouges, ouvrage d’un auteur qui ne figure même pas dans Le Nouveau dictionnaire des auteurs – pour dire si les pouvoirs en place ont tenu grandes ouvertes les oubliettes de l’histoire pour un homme jugé si indésirable que, au moment de la Libération, il a été condamné à mort, avant que sa peine soit commuée, sans doute à la demande de François Mauriac, en travaux forcés à perpétuité.
Quel est ce danger public ? Ce « traître à la patrie » ? Il s’appelle Henri Béraud. Disons-le : un grand écrivain. Un des grands scandales, une forfaiture, une injustice commise par l’histoire officielle de la littérature telle qu'elle s'est écrite au second vingtième siècle. Qu’avait-il fait, Henri Béraud, pendant la guerre, pour mériter une telle vindicte de la part des vainqueurs ? On se dit que ça devait être très grave : collaboré avec les nazis, pour le moins. Il a bien failli finir comme Paul Chack, cet authentique nazi français, dont je garde pourtant bon souvenir de quelques livres dans la veine héroïque (Ceux du blocus, Hoang Tham, pirate, La Bataille de Lépante), et qui a fini fusillé au fort de Montrouge.
Henri Béraud ? Vraiment rien à voir. Tiens, la preuve, il allait jusqu’à écrire, après la défaite de 1940 : « Une douleur qui n’a point de nom frappe notre peuple. A cette heure, les restes de tous les chevaliers et de tous les paysans de France ont tressailli sous la terre. Ceux qui pendant vingt siècles ont fait ce pays entendent sur leurs ossements frapper le pas lourd de l’étranger … Je pense à tous ceux qui, saoulés de paroles vaines, ont osé souhaiter la victoire de nos ennemis, sans songer, les malheureux, que cette victoire les chargera des chaînes les plus pesantes et les mieux rivées ». Si ce n'est pas d'un patriote, cette envolée, alors moi je suis chèvre. C'est que lui, Béraud, il a connu la boue, les rats et les poux des tranchées. La mort, il l'a vue de près. Et la guerre lui a volé sept ans de sa vie (« sept ans de caserne », dira-t-il).
Et en plein 1942, même pas peur, il récidive : « Si devant l’Allemagne en armes et sûre de sa force, vous trahissez vos morts en penchant des fronts d’esclaves, l’Allemagne haussera les épaules et n’aura pour vous que mépris. Tiens-toi droit ! disions-nous à nos fils. Un Français de 1942 doit être Français et rien que Français … Nous voulons des Français debout … Debout, camarade, et tiens-toi droit ! ». Non mais vous vous rendez compte ? Dire ça en face à l'occupant ? Est-il sérieux de l’accuser d’ « intelligence avec l’ennemi » ? Non seulement ça a du style, mais il fallait oser ! J'appelle ça « Avoir de la gueule ».
Allez, je crache le morceau : je tire ces citations de l’excellente (quoique non sans faiblesses) biographie d’Henri Béraud par Jean Butin (Henri Béraud, Horvath, 1979). La mise au placard de cet auteur majeur de la première moitié du 20ème siècle permet de faire oublier en même temps qu’il fut un immense journaliste-reporter, à l’égal d’Albert Londres, dont il était l’ami, qui a donné son nom à la plus belle récompense dont rêvent les journalistes en France. Il n’y a pas de « prix Henri Béraud ». Et ça permet de faire oublier qu’on lui doit le prix Goncourt de 1922 (Le Vitriol de lune). En littérature aussi, c'était quelqu'un. Mais que peut un individu face à la doxa de l'opinion dominante ?
On peut lui reprocher diverses peccadilles, comme celle d’avoir été antisémite, mais qui ne l’était pas, à l’époque ? Aujourd'hui c'est tellement mal vu que tout le monde est philosémite ! Ce n’est pas Henri Béraud qui a écrit Bagatelles pour un massacre. Mais s’il n’aimait pas les juifs, il détestait aussi cordialement les Anglais (qui se sont pourtant fait massacrer dans la Somme en 1916). Ah oui, il avait encore le tort d’aimer Pétain. Comme à peu près 40.000.000 d’autres Français du temps. Il avait sûrement plein d'autres défauts. Ceux qui avaient fait les bons choix lui ont fait payer l'addition ... et au-delà.
Mais pour en parler plus à fond, je dois laisser la parole à mon ami Solko, qui sait par cœur tout son Béraud, jusque dans le moindre détail.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, henri béraud, jean butin, henri béraud éditions horvath, république, pamphlet, polémiste, pavés rouges béraud, nouveau dictionnaire des auteurs, traître à la patrie, françois mauriac, paul chack, ceux du blocus, hoang tham pirate, la bataille de lépante paul chack, nazisme, occupation allemande, libération de paris, épuration 1944, patriotisme, prix albert londres, louis-ferdinand céline, bagatelles pour un massacre
mardi, 08 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 3/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
3/9
De l'importance de la lecture.
Ce qui est sûr, c’est que l’art contemporain, la musique contemporaine, la poésie contemporaine (en ai-je bouffé, des manuscrits indigestes, futiles, vaporeux ou dérisoires, au comité de lecture où je siégeais !), tout cela est tombé de moi comme autant de peaux mortes. De ce naufrage, ont surnagé les œuvres de quelques peintres, de rares compositeurs, d’une poignée de poètes élus. Comme un rat qui veut sauver sa peau, j’ai quitté le navire ultramoderne. J'ai déserté les avant-gardes. C’est d’un autre rivage que je me suis mis à regarder ce Titanic culturel qui s’enfonçait toujours plus loin dans des eaux de plus en plus imbuvables.
Comment expliquer ce revirement brutal ? Bien malin qui le dira. Pour mon compte, j’ai encore du mal. Je cherche. Le vrai de la chose, je crois, est qu’un beau jour, j'ai dû me poser la grande question : je me suis demandé pourquoi, tout bien considéré, je me sentais obligé de m’intéresser à tout ce qui se faisait de nouveau.
Mais surtout, le vrai du vrai de la chose, c’est que j’ai fait (bien tardivement) quelques lectures qui ont arraché les peaux de saucisson qui me couvraient les yeux quand je regardais les acquis du 20ème siècle comme autant de conquêtes victorieuses et de promesses d'avenir radieux. J’ai fini par mettre bout à bout un riche ensemble homogène d’événements, de situations, de manifestations, d’analyses allant tous dans le même sens : un désastre généralisé. C’est alors que le tableau de ce même siècle m’est apparu dans toute la cohérence compacte de son horreur, depuis la guerre de 14-18 jusqu’à l’exploitation et à la consommation effrénées des hommes et de la planète, jusqu'à l’humanité transformée en marchandises, en passant par quelques bombes, quelques génocides, quelques empoisonnements industriels.
 Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
A tort ou à raison, j’ai conclu de cette lecture décisive qu’Hitler et Staline, loin d’être les épouvantails, les effigies monstrueuses et retranchées de l’humanité normale qui en ont été dessinées, n’ont fait que pousser à bout la logique à la fois rationnelle et délirante du monde dans lequel ils vivaient pour la plier au fantasme dément de leur toute-puissance. Hitler et Staline, loin d’être des monstres à jamais hors de l’humanité, furent des hommes ordinaires (la « Banalité du Mal » dont parle Hannah Arendt à propos du procès Eichmann). Il n'y a pas de pommes s'il n'y a pas de pommier. Ils se contentèrent de pousser jusqu’à l’absurde et jusqu’à la terreur la logique d’un système sur lequel repose, encore et toujours, le monde dans lequel nous vivons.
Hitler et Staline (Pol Pot, …) ne sont pas des exceptions ou des aberrations : ils sont des points d’aboutissement. Et le monde actuel, muni de toutes ses machines d’influence et de propagande, loin de se démarquer radicalement de ces systèmes honnis qu’il lui est arrivé de qualifier d’ « Empire du Mal », en est une continuation qui n’a eu pour talent que de rendre l’horreur indolore, invisible et, pour certains, souhaitable.
Un exemple ? L’élimination à la naissance des nouveau-nés mal formés : Hitler, qui voulait refabriquer une race pure, appelait ça l’eugénisme. Les « civilisés » que nous sommes sont convenus que c’était une horreur absolue. Et pourtant, pour eux (pour nous), c’est devenu évident et « naturel ». C’est juste devenu un « bienfait » de la technique : permettre de les éliminer en les empêchant de naître, ce qui revient strictement au même. C’est ainsi que, dans quelques pays où la naissance d’une fille est une calamité, l’échographie prénatale a impunément semé ses ravages.
 D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système
D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
Je citerai une troisième facette de ladite évolution : une réflexion tirée d’ouvrages d’économistes, parmi lesquels ceux du regretté Bernard Maris (à  commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
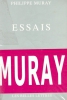 J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
Mais je dois reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
 Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude
Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
L'Histoire (le Pouvoir, la Politique), la Technique, l'Economie, donc : la trinité qui fait peur.
Restent les Lumières originelles : étonnamment et bien que je ne sache pas si le résultat est très cohérent, au profond de moi, elles résistent encore et toujours à l'envahisseur. Sans doute parce qu'en elles je vois encore de l'espoir et du possible.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, avant-garde, titanic, hannah arendt, les origines du totalitarisme, nazisme, staline, hitler, totalitarisme, stalinisme, banalité du mal, jacques ellul, le système technicien, le bluff technologique, günther anders, l'obsolescence de l'homme, bernard maris, charlie hebdo, antimanuel d'économie, jean-marc sylvestre, ultralibéralisme, philippe muray, l'empire du bien, exorcismes spirituels, éditions les belles lettres, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, une paire de bottes vaut shakespeare, éditions gallimard, george orwell essais articles lettres, jean-claude michéa, l'enseignement de l'ignorance, le moi assiégé, christopher lasch, la culture du narcissisme, michel houellebecq, la carte et le territoire, éditions l'encyclopédie des nuisances
dimanche, 29 novembre 2015
PANIQUE À BORD !

En janvier, ce fut un massacre : l’équipe de Charlie Hebdo, les clients de l’Hyper Cacher, tous des innocents qui ont payé de leur vie le fait d’être ce qu’ils étaient : des caricaturistes, des juifs, des polémistes, des vigiles, des rubriquards, des clients d’un magasin, … Le 11 janvier, une manifestation monstre de tous les révoltés par cet attentat. Au premier rang, un minuscule président de notre république, et un ex-président qui, toujours aussi hystérique, tente en vain de se frayer un chemin vers le premier rang et la grande photo inoubliable des acteurs de l’événement.
Tout sera fait pour « assurer la sécurité des Français », fut-il assené dans la foulée de ces meurtres. On ajouta au déjà immémorial « plan Vigipirate » le « plan Sentinelle » qui devait « assurer la sécurité des Français », nous fut-il seriné. Depuis le 13 novembre, on sait ce que nous a valu cette empilement de plans de sécurité, qui devaient théoriquement « assurer la sécurité des Français » (désolé de la répétition, c’est pour rendre l'incantatoire de la chose). Pour donner l’impression qu’il agit, le politichien moderne affiche des « mesures » destinées à figurer, une fois imprimées en photos martiales dans les journaux et dans l’esprit des gens, autant de preuves de l’efficacité du politichien.
Malheureusement pour notre misérable « chef des armées », ce petit curé balbutiant, cet orateur larvaire, ce lumignon éteint, ce panache gris dépourvu de panache, les attentats du 13 novembre lui ont fait éclater à la figure les preuves de son incompétence et de son ignorance. Mais comment cette catastrophe a-t-elle été rendue possible ?
Au risque de me répéter, bien que je ne sois pas spécialiste des questions de sécurité, et en m’appuyant sur ce que la mode correcte interdit désormais qu’on appelle le « simple bon sens », la France disposait d’un service de renseignement très efficace et performant : les RG ou Renseignements Généraux. Ce service était honni par tout ce que le pays comptait de gauchistes, il n'avait pas forcément les mains propres, mais il quadrillait le territoire à la façon d’un filet à mailles fines. Les hommes connaissaient bien le terrain, peu de poissons échappaient à leur vigilance, les informations remontaient.
Le frénétique-à-tics qui a gouverné la France pendant cinq ans, non content de sa fabuleuse invention de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques – en clair : non-remplacement d’un retraité sur deux dans la fonction publique d’Etat, qui a coûté 50.000 bonshommes à la police, à la gendarmerie et à l'armée), s’est mis en tête, sans doute pour gratter sur les budgets, de faire fusionner les RG (renseignement intérieur) et la DST (contre-espionnage). Le résultat le plus sûr de cette fusion forcée fut une désorganisation complète des services désormais placés sous l’étiquette DGSI. Les « cultures professionnelles », les façons de procéder des deux services étaient tellement différentes qu’il ne pouvait pas en être autrement. Comme de l'huile avec de l'eau, le mélange des deux n'a pas fait une mayonnaise, à peine une vinaigrette : si vous mettez de la vinaigrette dans un moteur, le moteur casse. Les autorités ont tout misé sur la « collecte des données » (moyens techniques, électroniques, informatiques). On voit ce qui en est sorti.
Or le point commun de tous les types qui flinguent depuis Mohammed Mehra, c’est qu’ils étaient bien fichés, mais qu’il n’y avait plus personne sur le terrain pour tirer le signal au moment où une action se préparait. J’en conclus que la décision de Nicolas Sarkozy de fusionner RG et DST a eu des conséquences criminelles. Je sais bien que si cette décision est une cause indéniable, elle n’est pas la seule, mais on peut être sûr qu’elle est pour une bonne part responsable des tragédies de 2015 en France.
Alors maintenant, est-ce que le minuscule Hollande a fait mieux ? La réponse est clairement « Non » ! Qu’est-ce qu’il a fait, après Charlie Hebdo ? Après l’Hyper Cacher ? Il a mis plein de soldats et de policiers (Sentinelle + Vigipirate) dans les rues, dans les gares, devant les églises et les synagogues. Il a transformé l'armée française en un corps de plantons. Là encore, on a vu le 13 novembre le résultat de ce déploiement ostentatoire des forces de l’ordre et des forces armées, on a constaté l’efficacité de ce dispositif impressionnant, qui n’était là en vérité, une fois de plus, que pour que les journaux publient des photos permettant aux lecteurs de croire qu’ils étaient protégés par les mesures prises par les « autorités ».
Qu’est-ce que c’est, une « collecte des données », quand il n’y a personne sur le terrain, personne pour les analyser, personne pour en tirer des conclusions pertinentes ? Ils sont très beaux, les moyens techniques dont disposent les services de renseignement, surtout depuis le vote récent de la loi qui porte ce nom, mais il n’empêche que le récipient où on les entasse est tellement plein de trous qu'une ménagère appellerait ça une passoire. Personne n’a rien vu venir. Pas plus que les Américains n’ont vu venir les pilotes-suicides des avions jetés sur le WTC. Mais il fallait rogner sur les moyens humains, sur les budgets, faire confiance aux experts du numérique. Ah, la technique, que c'est beau, la technique !
Alors maintenant l’état d’urgence. Je dis que l'état d'urgence est l'ultime branche à laquelle se raccrochent des gouvernants aux abois, dans une ultime tentative de dissimuler leur incompétence et leur lâcheté. Je ne peux m’empêcher de me référer au livre de Mireille Delmas-Marty Libertés et sûreté dans un monde dangereux (Seuil, 2010, voir mon billet du 3 mai 2015), où elle s’inquiète de ce que les lois pénales tendent à substituer à la répression d’infractions dûment constatées une répression préventive, fondée sur la dangerosité potentielle et supposée des individus. Ça permet de ratisser très large, au risque de "dommages collatéraux" contre des gens qui n'ont rien à se reprocher.
Une démocratie est un milieu ouvert à tous les vents, un « open space ». La verrouiller, c'est la mettre à mort. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas se défendre, je dis que pour se défendre elle doit se doter de bons outils : monsieur Hollande, ne commencez pas par faire disparaître l'état de droit, commencez par remettre ces outils (armée, police, renseignement) en état.
Dans Le Monde du 6 juin 2015, Delmas-Marty enfonçait le clou : « En France, le grand tournant remonte à la loi de 2008 sur la rétention de sûreté, adoptée par une "droite décomplexée" qui n’hésite pas à copier le modèle d’une loi allemande de la période nazie ». Tiens, encore un coup de Sarkozy (notez que le nom rime avec le dernier mot de la citation, regrettable hasard). De quoi se faire du mouron : l’état d’urgence est l’ennemi de l’Etat de droit. Les bien nommés passe-droits qu’il autorise sont autant de menaces en direction de la liberté.
Je sais bien que les gens ont peur, je sais bien que Daech et ses sbires ne sont pas des plaisantins, mais je n’ai pas l’intention de changer d’un iota ma façon de vivre du fait du risque terroriste. S'il y a un risque, tant pis : j'assume. Et faites bien attention à ceci : qui m’expliquera pourquoi des militants écologistes ont reçu des assignations à résidence ? Et quid de l’arbitraire et de la violence gratuite commise par les forces de l’ordre au cours des « perquisitions administratives » (voir les articles paraissant ces jours-ci dans l’excellente rubrique « Observatoire de l’état d’urgence » du Monde) ?
Dans l’état d’urgence, ce qui me fait peur, ce qui nous menace tous, ce sont les abus qui se commettent sous son couvert, ce dont des policiers eux-mêmes reconnaissent qu’ils profitent comme d’autant d’ « effets d’aubaine ». Je n’ai pas confiance dans des policiers qu’on laisse les mains libres et la bride sur le cou. Les terroristes ont d’ores et déjà gagné : la panique règne, au moins en haut lieu. Rien de pire qu’un régime qui règne en laissant régner la peur, et en appuyant sur ce redoutable accélérateur. Gardons-nous de céder à la panique. Quel espace va-t-il rester pour les partisans de la liberté ? Quel espace pour la liberté ? Faire face au danger, ça commence par ne rien changer à notre façon de vivre. A y changer quoi que ce soit, nous avons tout à perdre.
Oui, je suis inquiet : j'ai peur que les terroristes ne réussissent à nous rendre semblables à eux-mêmes (écoutez ici la remarquable explication (15' environ) de Tobie Nathan à ce sujet : il parle du Cambodge de Douch et du Berlin de Goebbels). De gauche, Hollande ? De gauche, Valls ? Ne me faites pas rire.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie hebdo, cabu, wolinski, bernard maris, charb, frères kouachi, 7 janvier, 11 janvier, 13 novembre, attentats paris, bataclan, plan vigipirate, plan sentinelle, france, français, politique, société, renseignements généraux, rg, dst, nicolas sarkozy, françois hollande, gauchistes, rgpp, dgsi, mohamed mehra, hyper cacher, 11 septembre, journal le monde, mireille delmas-marty, cambodge, pol pot douch s 21, nazisme, goebbels, écologistes, perquisitions administratives, assignation à résidence, sécurité liberté, tobie nathan, france culture
mercredi, 21 mai 2014
HENRI GODARD ET CELINE
CELINE LE PESTIFÉRÉ
Henri Godard n’a pas eu de chance dans la vie. Etudiant en Lettres, il aurait pu tomber sur les sonnets de Louise Labé, la poésie de Jean-Baptiste Rousseau ou les œuvres de Jean-Baptiste Gresset. Autrement dit, des sujets pépères, tranquilles, sans risque. Mais non, à vingt ans, la marmite de potion magique dans laquelle il se précipite n’est autre que celle des écrits de Louis-Ferdinand Céline.
Et pas n’importe quel titre. Tout de suite c’est D’un Château l’autre. Toute de suite l'essentiel. Vous savez, le bouquin où le pestiféré raconte Sigmaringen (qu'il orthographie « Siegmaringen » par dérision), Pétain fini. Accessoirement, le bébé Philippe Druillet (il raconte ça dans son récent Délirium) y a été soigné par le docteur Destouches (= Céline), parce que son nazi de père s'y était aussi réfugié.
On est alors en 1957. Godard a vingt ans. Résultat, quand, en 2011, Henri Godard propose le nom de Céline et qu’une main administrative, ne voyant aucun obstacle à la chose, inscrit ce nom parmi les célébrations culturelles nationales prévues (c'est alors le cinquantenaire de sa mort), monsieur Serge Klarsfeld, brandissant l'étendard de la « lutte contre l'antisémitisme », obtient en deux jours de Frédéric Mitterrand, alors ministre de la culture, qu’il le raie d’un trait de plume. Rien que le nom de Céline est honni des juifs. Henri Godard n’a pas de chance. Qu'on se le dise : monsieur Serge Klarsfeld est au nombre de ceux qui font la police de la pensée.
Remarquez, ça finira par devenir une habitude chez les amateurs de pestiférés : tout récemment, une vente aux enchères d’objets nazis n’a-t-elle pas été interdite par le conseil des ventes, sur recommandation d’Aurélie Filipetti, ministre de la culture, elle-même interpellée par le vice-président du « Conseil Représentatif des Institutions Juives de France » (Crif), monsieur Jonathan Arfi qui, la vente étant tout à fait légale, se référait à des « valeurs morales ».
Rebelote et censure identique il y a quelques jours, mais cette fois à la demande du responsable d’un « Comité de vigilance contre l’antisémitisme » ! Aux chiottes la légalité ! Vive les « valeurs morales » ! Celles qui sont du bon côté, évidemment ! Ah mais ! Quand on met ces choses bout à bout, ça finit par faire beaucoup. En période d'Inquisition, tout le monde ouvre le parapluie (« barabli », comme on dit en alsacien).
Il ne me viendrait pas à l’idée de me porter acquéreur d’un objet au motif qu’il porte une croix gammée. Il faut être un brin azimuté pour aimer ça. Mais l’idée d'interdire aux amateurs confits dans le culte nostalgique du troisième Reich de satisfaire leur goût bizarre ne peut, à mon avis, germer que dans des cerveaux aussi malades que ceux-ci. Il faut déjà être vigoureusement cintré de la voûte pour avoir l'idée de créer quelque « comité de vigilance » pour protéger les juifs en France aujourd'hui ! Vive la paranoïa au pouvoir ! Pour être une bonne victime, il faut le crier le plus fort possible.
C’est fou quand on pense au nombre de cinglés/victimes qui ont comme principale raison de vivre (dont ils ont fait une raison sociale : « les associations ») de passer leur temps à scruter les mouvements de leurs ennemis (les réacs, les fachos), de pousser les hauts cris dès qu’ils voient le plumet d’un cimier s’agiter au vent et d’appeler les autorités, au nom du Code Pénal et de la Morale, à faire peser la griffe de la Loi (ou plutôt des gens au pouvoir) sur les téméraires qui osent les défier.
Dieudonné est une autre victime récente de cette folie punitive. Je ne cultive aucunement le Dieudonné, ni en pot ni en plein champ, mais ces fulminations haineuses me laissent ahuri et pantois (au fait, quelqu'un a-t-il des nouvelles de la "quenelle" ?). C'est à se demander de quel côté est le Bien, de quel côté le Mal.
Qu’on se le dise, les flics des brigades « ANTI- » (anti-islamophobes, anti-homophobes, anti-antisémites, anti-sexistes, anti-fascistes, etc.) n’ont pas les yeux qui se croisent les bras, ils veillent de toutes leurs antennes et montent au créneau comme un seul homme à la moindre alerte. Et les autorités n’ont rien de plus pressé que de céder à leurs demandes, faites en l’occurrence au nom de la mémoire de l’Holocauste.
Henri Godard était bien gentil, finalement, en ne dénonçant, en 2011, qu’ « une forme de censure ». Je doute quant à moi que cette vigilance chatouilleuse et que cette intolérance exacerbée soient d’une quelconque efficacité contre une montée éventuelle du racisme et de l’antisémitisme. Je ferme la parenthèse.

S’intéresser à un pestiféré comme Céline comme l’a fait Henri Godard, c’est aimer vivre dangereusement. Roland Thévenet (un homme exaspérant et carrément indispensable) en a fait l’expérience, mais lui, c’était à propos de Henri Béraud, autre pestiféré de la Libération, injustement accusé de « collaboration », condamné à mort, gracié in extremis, que je ne place pas – littérairement, s’entend – au niveau de l’auteur de Voyage au bout de la nuit. Alors que le génie de Céline brille dans la collection Pléiade, le talent indéniable de Béraud croupit dans les oubliettes de l’histoire.
 Dire que Henri Godard a consacré sa vie à Céline serait exagéré, mais enfin, il ne dira pas que l’auteur n’a pas occupé une place centrale dans son travail universitaire. J’ai lu, lorsqu’elle a paru, la biographie (ci-contre) qu’il lui a consacrée (Gallimard, 2011) : c’est juste excellent. Je conseille à tous ceux qui sont curieux de savoir à quoi s’en tenir cette lecture roborative, rigoureuse, et même intransigeante avec Céline lui-même.
Dire que Henri Godard a consacré sa vie à Céline serait exagéré, mais enfin, il ne dira pas que l’auteur n’a pas occupé une place centrale dans son travail universitaire. J’ai lu, lorsqu’elle a paru, la biographie (ci-contre) qu’il lui a consacrée (Gallimard, 2011) : c’est juste excellent. Je conseille à tous ceux qui sont curieux de savoir à quoi s’en tenir cette lecture roborative, rigoureuse, et même intransigeante avec Céline lui-même.

Et puis je viens de lire A Travers Céline, la littérature (Gallimard, 2014). Le propos est évidemment tout autre. Henri Godard y raconte comment Céline est devenu inséparable de son parcours personnel. C’est là qu’il raconte la stupéfaction qui fut la sienne à la lecture de D’un Château l’autre (en 1957). Une stupéfaction du Tonnerre de Dieu. Je sais, pour l’avoir vécu, que certaines lectures, faites à un moment décisif, peuvent faire bifurquer une trajectoire individuelle. Ici, Godard peut dire que D'un Château l'autre a décidé de l’orientation de son existence.
Godard n’hésite pas à intituler son premier chapitre « Coup de foudre ». Il n’y a aucune raison de douter que c’en fut un véritable. Quand ça vous arrive à vingt ans, ça ne pardonne pas. Mais il raconte aussi comment, dix ans plus tard, il reçut un choc aussi violent en découvrant par le menu la substance de Bagatelles pour un massacre, long pamphlet de 1937 débordant d’une stupéfiante rage antisémite. Il compte le nombre d’occurrences du mot « juif » : « A eux tous, ils ne surgissaient pas moins de trente-sept fois en à peine quatre pages » (p. 75).
J’ai mis le nez dans les Bagatelles … Eh bien honnêtement, je trouve surtout que c’est de la bien mauvaise littérature. Et puis c’est quoi, ces arguments de « ballets-mimes » dont le bouquin est parsemé ? Je sais bien que Lucette Almanzor-Destouches, son épouse, était danseuse, et qu’elle donnait des cours dans la maison de Meudon, mais je ne vois pas bien l’intérêt, sauf le fait que la traduction en mots des ambiances et des mouvements des danseurs prend un aspect ridicule. Je n'y peux rien. Disons-le, Bagatelles ... m'est tombé des mains.

Alors je comprends bien que Henri Godard se soit senti tiraillé : d’un côté neuf chefs d’œuvre de la littérature française ; de l’autre la traînée d’immondices que le grand écrivain a incontestablement laissée derrière lui. Est-ce que celle-ci est une raison d’occulter ceux-là ? Je dis que non. Il faut savoir ce que l’on regarde. Et ce qu'on garde. Et regarder ce qui en vaut la peine. Appelons cela un clivage si vous voulez.
Je pense à Jean Richepin et à ses « Oiseaux de passage », que Georges Brassens a mis en musique : « Ce qui vient d’eux à vous, c’est leur fiente ». Voilà : les pamphlets sont à considérer comme autant de déjections excrétées de l’anus de Céline. Sans aller jusqu’à appeler « fouille-merde » les horrifiés et les scandalisés qui répugnent à Céline dans son ensemble au seul motif de ses pamphlets antisémites, j’ai envie de percevoir dans l'affichage de ce dégoût un prétexte à justifier une médiocrité de béotien. Le béotien est une figure de la bêtise. Et une bonne conscience à bon compte. Et le conformisme qui tient compagnie à la lâcheté.
Si j'écrivais, des lecteurs aussi fatigués, aussi paresseux, je n'en voudrais à aucun prix ! Et ne parlons pas de la mauvaise foi et de l'hypocrisie.
De toute façon, je garde cette idée formidable de Henri Godard, qui dit quelque part que Céline écrit pour mettre celui qui ouvre son bouquin au défi de le lire et, quand il l'a ouvert, d'aller au bout de sa lecture. Pas de meilleure définition de l'œuvre : Céline écrit à rebrousse-poil de son lecteur.
Le tigre de la provocation est tapi dans le moteur profond des ténèbres de l'écriture de Louis-Ferdinand Céline.
Voilà ce que je dis, moi.
Je mentionne pour mémoire La Mort de L.-F. Céline, l'excellent petit livre, beaucoup plus militant, que Dominique de Roux avait consacré à Céline, après avoir été le maître d'œuvre, me semble-t-il, de deux Cahiers de l'Herne qu'il avait élevés à son grand homme.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, louis-ferdinand céline, henri godard, antisémitisme, juif, klarsfeld, d'un château l'autre, philippe druillet, délirium, frédéric mitterrand, crif, nazisme, dieudonné, henri béraud, roland thévenet, solko, voyage au bout de la nuit, à travers céline la littérature, bagatelles pour un massacre, lucette almanzor, dominique de roux, la mort de l.-f. céline, les cahiers de l'herne
lundi, 21 janvier 2013
ELIAS CANETTI ET LA GUERRE DE 14
Pensée du jour :

C'EST LE JOUR D'OUVRIR LE KIL DE ROUGE ET D'ENTAMER LE SAUCISSON (DE LYON)
« Un professeur, d’une façon générale, ne devrait épouser que ses meilleurs élèves. Après le bachot ; et non avant. Pour créer une émulation ».
ALEXANDRE VIALATTE
Je viens de lire un passage, à propos, encore et toujours, je n'y peux rien, de la guerre de 1914-1918, passage qu’il faut absolument que je partage séance tenante. Il se trouve que je suis plongé dans les Ecrits autobiographiques d’un monsieur qui a reçu le prix Nobel. L’auteur s’appelle ELIAS CANETTI. Le livre est publié à la « Pochothèque ».

En l’ouvrant, je m’attendais à trouver quelqu’un qui raconte sa vie du haut du piédestal où a été édifiée sa statue de son vivant, parce que je garde en mémoire ELIE WIESEL, autre prix Nobel (de la Paix), qui parle sur un ton qui me l’a rendu antipathique. Jusqu’au son de sa voix, son timbre et son élocution m’agacent dès que je l’entends. Le ton de quelqu’un qui s’écoute lui-même quand il parle, et qui s’adresse à lui-même des congratulations pour l’effet qu’il se produit. On dirait qu'il n'arrête pas de se prendre pour un "Prix Nobel".
Eh bien, ELIAS CANETTI, pas du tout ! Selon toute vraisemblance, ELIAS CANETTI ne s’appelle pas ELIE WIESEL, ce qui est heureux. Il faut se féliciter de ce hasard et remercier le sort qui, finalement, fait bien les choses. Et je pense que l'oeuvre écrite d'ELIAS CANETTI consiste davantage que celle d'ELIE WIESEL.
 Je ne sais pas vous, mais moi, je ne supporte pas le ton de ce personnage qui se donne un tel air de sérieux quand il ouvre la bouche, puis qui parle sur le ton pontifiant de la componction propre au personnage de Tartufe dans la pièce de Molière, quand celui-ci se met à admonester et à faire la leçon autour de lui. ELIE WIESEL (ci-contre, avec sa façon de pencher la tête), a su intelligemment faire fructifier le petit capital offert par son statut de rescapé des camps de la mort. Je suis sûrement très injuste avec quelqu'un qui est devenu un icône unanimement célébrée.
Je ne sais pas vous, mais moi, je ne supporte pas le ton de ce personnage qui se donne un tel air de sérieux quand il ouvre la bouche, puis qui parle sur le ton pontifiant de la componction propre au personnage de Tartufe dans la pièce de Molière, quand celui-ci se met à admonester et à faire la leçon autour de lui. ELIE WIESEL (ci-contre, avec sa façon de pencher la tête), a su intelligemment faire fructifier le petit capital offert par son statut de rescapé des camps de la mort. Je suis sûrement très injuste avec quelqu'un qui est devenu un icône unanimement célébrée.
J’ai lu La Nuit. C’est son témoignage sur ce qu’il a vécu en déportation. Le malheur veut que je l’aie lu après d’autres ouvrages sur le même sujet. A commencer, évidemment, par Si c’est un homme, de PRIMO LEVI, que j’ai reçu comme un coup à l’estomac. De lui, on connaît moins La Trêve. Eh bien on a tort. Toujours est-il que Si c’est un homme impose le respect. Alors que La Nuit me touche un peu, et m’agace davantage, sans que je sache bien pourquoi. Peut-être à cause de la façon - immodeste selon moi - d'apparaître dans les médias.
ELIE WIESEL, tout le monde lui doit le respect dû à ceux que le nazisme a voulu faire disparaître de la surface de la planète. Mais personne n’est obligé de se soumettre au magistère du haut duquel il distribue les bons et les mauvais points d’un humanisme révisé par l’Holocauste.

 Parce que, sur les camps de la mort, j’ai aussi lu CHARLOTTE DELBO. Franchement, si j’avais un choix à faire, c’est devant le souvenir de cette femme admirable que je m’inclinerais, et devant les trois petits livres publiés aux éditions de Minuit sous le titre Auschwitz et après.
Parce que, sur les camps de la mort, j’ai aussi lu CHARLOTTE DELBO. Franchement, si j’avais un choix à faire, c’est devant le souvenir de cette femme admirable que je m’inclinerais, et devant les trois petits livres publiés aux éditions de Minuit sous le titre Auschwitz et après.
Quand on a refermé le dernier, même Si c’est un homme apparaît un peu « littéraire », c’est vous dire. Je ne peux lire cinq pages d’affilée sans être parcouru de secousses violentes. Il faut lire CHARLOTTE DELBO (1913-1985, collaboratrice de LOUIS JOUVET, avant et après la guerre), dont on fête le centenaire de la naissance.
Mais j’en reviens à ELIAS CANETTI, né dans une famille juive sépharade espagnole émigrée en Bulgarie. En fait, j’avais l’intention d’écrire la présente note en réaction à un passage de La Langue sauvée, lu ce matin et, comme d’habitude, je me suis laissé distraire en route.

ELIAS CANETTI EN 1919
La scène se passe à Zurich, en 1917. Les Français et les Allemands envoient en convalescence en Suisse des officiers plus ou moins gravement blessés, après les avoir échangés contre des prisonniers. Mme CANETTI et son fils marchent dans la rue, quand ils voient s’approcher un groupe d’officiers français, « dans leurs uniformes voyants ». Ils marchent lentement, calquant leur allure sur celle des plus lents. Beaucoup s’appuient sur des béquilles.
Soudain, un groupe d’officiers allemands, pareillement blessés et béquillants, avance à leur rencontre, tout le monde marche très lentement, se réglant sur les pas des moins valides. Le garçon s’affole et se demande ce qui va se passer. Il sait que la guerre fait rage, et que sa mère rejette passionnément jusqu’à l’idée que des hommes puissent s'entretuer pour des motifs incompréhensibles. Or, avec sa mère, il se trouve au milieu des deux groupes. Que va-t-il se passer ? Vont-ils en venir aux mains ?
Non, rien ne se passe, et l'adolescent reste stupéfait : « Ils n’étaient pas crispés de haine ou de colère comme je m’y attendais. Les hommes se regardaient tranquillement, amicalement, comme si de rien n’était ; certains se saluaient. Ils avançaient beaucoup plus lentement que les autres gens et le temps qu’ils mirent à se croiser me parut une éternité. L’un des Français se retourna, brandit sa béquille vers le ciel et s’écria : « Salut ! ». Un Allemand qui l’avait entendu l’imita ; il avait lui aussi une béquille qu’il remua au-dessus de sa tête, renvoyant à l’autre son salut en français ». Voilà. C’est tout. Cela aussi, c’est la guerre de 14.
Quand la scène se termine, le jeune ELIAS voit sa mère, face à la vitrine du magasin, qui tremble et qui pleure. Elle met du temps à se ressaisir, elle si soucieuse d'habitude de ne rien laisser paraître de ses états d’âme. C'est la seule occasion où le garçon verra sa mère verser des pleurs en public. La scène est racontée aux pages 198-199 du volume.
La grande hantise des chefs militaires des deux camps était de voir leurs hommes FRATERNISER avec l'ennemi. Tout simplement inacceptable. C’est la raison pour laquelle les unités stationnées par exemple au mont Linge (crêtes des Vosges) « tournaient » rapidement : comme les « ennemis » pouvaient quasiment se serrer la main, vu l’ahurissante proximité des deux tranchées, cigarettes et boîtes de conserves ne tardaient jamais à traverser la « ligne ». Très mauvais, dans un contexte belliqueux. Quand on a vu le visage d'un homme, quand on lui a serré la main, on n'a plus envie de lui tirer dessus.

LA FLEUR AU FUSIL
TROIS FRANÇAIS ONT FRATERNISÉ AVEC UN "BOCHE" : UN SCANDALE !
Je ne sais pas si l'excellent JACQUES TARDI (C’était la guerre des tranchées, Putain de guerre !, Varlot soldat, La Fleur au fusil, La Véritable histoire du soldat inconnu) connaît ce passage d’ELIAS CANETTI. Peut-être qu'il lui ferait plaisir autant qu'il m'a fait. J’imagine que ça ne calmerait pas sa rage, au moins égale à la mienne (voir mes notes dans la catégorie "monumorts"), devant l’indicible absurdité de la catastrophe qui a presque détruit l’Europe.

LA HONTE ! C'EST UN FRANÇAIS QUI PARLE !
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, alexandre vialatte, littérature, humour, guerre 1914-1918, grande guerre, première guerre mondiale, élias canetti, écrits autobiographiques, prix nobel littérature, prix nobel paix, élie wiesel, camps de la mort, camps d'extermination, extermination des juifs, juif, rescapé, nazisme, la nuit, si c'est un homme, primo levi, la trêve, holocauste, shoah, charlotte delbo, auschwitz et après, aucun de nous ne reviendra, deuxième guerre mondiale, la langue sauvée, france allemagne, fraternisation, jacques tardi, c'était la guerre des tranchées, putain de guerre, la fleur au fusil, soldat inconnu, patriotisme
mardi, 20 novembre 2012
L'EFFRAYABLE - ANDREAS BECKER
Pensée du jour :

"IDEOGRAMME PIETON" N°12
« L'année tire sur sa fin, pourquoi ne pas le reconnaître ? Il serait injuste de ne pas le dire, elle a été mauvaise, mais elle tire sur sa fin ».
ALEXANDRE VIALATTE
Ce n’est pas pour me vanter, mais j’ai lu un premier roman. Parfaitement ! C'est vrai que ça n'arrive pas souvent. Et je ne le regrette pas. Je ne l’aurais sans doute pas lu si je n’avais pas fait la rencontre de l'auteur. A une terrasse de café, bien sûr. Le bonhomme est original et intéressant, je dirai peut-être en quoi, mais éventuellement, ça ne presse pas. Je ne dirai pas la page où je crois l’avoir vu dessiner son autoportrait. En attendant, ne parlons que du livre. Il ressemble à son auteur : original et intéressant.

Le titre, d’abord : L’Effrayable (sic !), éditions de la Différence. L’auteur : ANDREAS BECKER. J’ai d’ailleurs été surpris de constater l’absence du mot dans une édition tout à fait récente du Grand Robert.
Mais le mot figure comme de juste dans le Nouveau Larousse Illustré de 1897-1904 (en 7 volumes), assorti de la définition suivante : « Qui est susceptible d’être effrayé, qui s’effraye aisément :"Certaines femmes affectent d’être plus EFFRAYABLES qu’elles ne le sont réellement" ». L’exemple retenu n’est-il pas délicieux ? Finalement, ANDREAS BECKER (né à Hambourg), ressuscite un terme parfaitement conforme à la belle morphologie de notre langue. Saluons. Et saluons les éditions de La Différence, grand éditeur de poésie devant l'éternel.

Si je dis que je suis arrivé au bout du livre, je sens que ça va faire mauvaise impression. C’est pourtant la vérité, mais dans un sens positif. Je veux dire qu’ANDREAS BECKER ne donne pas, c’est le moins qu’on puisse dire, dans l’espèce de fluide lavasse et fadasse, qui coule tout seul, que des flagorneurs au goût émoussé ou dépravé, ou tout simplement stipendiés ou lâches, qualifient de « style », et qui sert de moyen d’expression à tant de nos écrivains actuels.
Pour les noms des crétins ou des margoulins qui se font prendre pour des écrivains, je renvoie à l’excellent et salutaire vitriol publié par PIERRE JOURDE & ERIC NAULLEAU, Ed. Mots & Cie, en 2004, réédité chez Mango en 2008.
Le livre d'ANDREAS BECKER se mérite. Comme on dit dans le Guide Michelin : « Il est intéressant, (*), il mérite un détour (**) et il vaut le voyage (***) ». Simultanément et à la fois. C’est sûr que, quand on referme le bouquin, on se dit qu’il s’est passé quelque chose. Quelque chose de très fort. Quoi ? Pas facile à dire. Et pour être franc, ce n’est pas facile de parler de ce livre. Disons les choses franchement et simplement : pour commencer, l’obstacle du langage.
Car l’auteur passe son temps à triturer le vocabulaire (presque pas la syntaxe, si ça peut rassurer et encourager) en pratiquant ce qu’on appelle en bon français le procédé de la « resuffixation », bien connu des praticiens et connaisseurs de l’argot (« cinoche » pour « cinéma »).
Tenez, vous voulez un exemple ? Prenez les deux premières phrases : « Dans les temps j’ai eu-t-été une petite fille, une toute petite fillasse.
Je m’appelassais Angélique ».
L’auteur joue carte sur table et annonce la couleur : ce sera comme ça et pas autrement, et ce sera comme ça tout le long.
Et ce n’est pas une promesse d’ivrogne : il tient parole ! Rien que sur la première page, ce n’est que : « m’inscrissais, jurassé-crachoté, je m’en fichassais, foutassais, faisassais, j’aimassais, je n’avassais jamaissu ce que cela voulait dire : aimasser ». J’arrête, sinon, ça va vous dégoûter. Et ça, je ne voudrais pas. Mais vraiment pas. Parce que, en vérité, je vous le dis : ce livre contient une matière très forte (comme on parle de certaines boissons fermentées, vous savez).
Comme si l’auteur avait voulu nous mettre, en travers de la vue, un arbre assez gros pour cacher toute une forêt. Mais c’en est au point que je me demande s’il n’a pas fait cette forêt lexicale, extrêmement visible et envahissante, qu’on a l’impression qu’il n’y a que ça à voir, pour cacher un seul arbre. De quelle essence, l’arbre ? C’est une autre paire de manches.
Toujours est-il qu’en usant et abusant de ses suffixes proliférants, l’auteur a ses raisons. Si je peux me permettre d’en avancer une : sans être le seul suffixe ajouté, le « -asse » est largement majoritaire, pour ne pas dire carrément obsessionnel. Or, en français, on le trouve dans « connasse,pétasse, grognasse, pouffiasse, radasse, chiasse, vinasse, blondasse, fadasse, bécasse, … ». J’arrête. On a compris. Il y aurait un peu de misogynie sous-jacente dans cette dévalorisation, je n’en serais pas autrement surpris.
Ce qui est sûr, c'est que, d’un bout à l’autre du livre, c’est une obsession du dégoût, de la saleté, de la laideur, de la déchéance et de la déréliction qui court. Le visqueux a une place de choix. Pour dire l’ambiance, la couleur des murs crades. Une ambiance parfaitement concertée et voulue, évidemment. L’auteur veut à tout prix que le lecteur se mette au boulot. Il est certain que, sur le fond, il n’a pas tort, tant l’écrivain français d’aujourd’hui flatte la paresse et le narcissisme du lecteur, dans le satanique esprit de lucre induit et produit par l’époque.
Mais passons sur le suffixe, qui n’est, tout compte fait, qu’un procédé. Et venons-en au sujet. C’est vrai, ça : de quoi il parle, ce bouquin ? Eh bien pour tout dire, sincèrement, je ne sais pas exactement. Si, bien sûr, je sais qu’on est dans l’Allemagne hitlérienne, avant la guerre et jusqu’à la fin de la guerre, mais aussi après, et même jusqu’à aujourd’hui. Et puis qu’on est aussi parfois en France.
Le livre s'ouvre sur une cellule : est-ce une prison ? Un asile ? La cave de WOLFGANG PRIKLOPIL, où fut détenue pendant 8 ans NATASCHA KAMPUSCH ? Une personne est enfermée là : est-ce un garçon ou une fille ? Quoi qu'il en soit, son corps sert de déversoir aux appétits d'une autorité (le « dicteur », véritable trouvaille), ou alors Karminol, ou alors un troisième larron. On ne sait pas. Et c'est comme ça jusqu'à la fin. Par ailleurs, la personne enfermée est enchaînée à l'écriture : mais là encore, qui écrit ? On ne sait pas.
Et je crois qu’il est là, le nerf du livre : l’action se passe partout, à toutes les époques, et tout le monde y passe. Je veux dire que tout le monde dit "JE". Et je crois que ce que veut exprimer ANDREAS BECKER (je ne suis pas dans sa tête), c’est une certaine permanence désespérée de l’existence humaine. Si "JE" est n'importe qui, c'est le chaos. Il n'y a plus de sujets parlants, il n'y a plus que des objets dont on se sert, et des calculs.
Si ANDREAS BECKER a voulu décrire l'état d'une humanité d'avant la civilisation (ou d'après, ce qui n'est pas tout à fait pareil), il a gagné son pari. On est évidemment (entre autres) dans une Allemagne marquée de façon indélébile par l'expérience nazie, par la brutalité inouïe des "libérateurs" russes, puis par la normalisation imposée par la marchandisation de tout. Pour dire (peut-être) que l'horreur nazie est l'aboutissement logique d'un système, et que s'être débarrassé de l'une laisse l'autre (le système qui est le nôtre) totalement intact.
Si les suffixes posent un problème à la lecture, c’est une autre chose qui pose un problème de compréhension de l’ouvrage. TOUT le livre se déroule sous la présidence du JE. Mais qui est JE ? Impossible de répondre. Je préviens le lecteur : le JE passe par TOUS les personnages, successivement et sans prévenir. C’est un gros travail à fournir, de la part du lecteur qui, à la limite, serait en droit de réclamer une commission sur les droits d’auteur.
Le "JE" est en effet systématique, mais renvoie systématiquement à un narrateur différent, qu’il faut identifier si l’on veut reconstituer la cohérence de l’action. J’avoue que je n’ai pas tenté de tout reconstituer. C'est un "JE" « éparpillé façon puzzle » (Tontons flingueurs). Qui parle ? Est-ce Angélique ? Ange ? Paul Antoine ? Joachim ? Karminol ? Marie-Mi ? Grospère ? Joju ? José ? Tout le monde est dans tout le monde. Le chaos, je vous dis.
Le roman d’ANDREAS BECKER diffuse et dilue le « moi ». Tout le monde est promu narrateur du monde. Et c’est exactement pour ça que plus personne ne comprend rien au monde tel qu’il est, dans la réalité qui est la nôtre. En cela, ce livre colle à la réalité actuelle du monde (« éparpillé façon puzzle », lui aussi) d'une façon capable de nous en faire saisir le caractère irréductiblement incompréhensible.
En plus, où se situe l’action ? « Partout » serait évidemment faux. Il y a Palebourg, Siegershaven, d’autres lieux. C’est sûr, le lieu change en fonction du narrateur, mais comme le narrateur change sans arrêt, difficile de s’y retrouver. Ce qui passe, c’est une sorte d’état de sidération, qui est celui de l’enfant confronté à l’horreur innommable et qui, survivant à cette horreur, conserve intact cet état de sidération, qui devient une composante à part entière de sa personnalité. Il y a du psychotique dans la fragmentation universelle qui est à l'oeuvre ici. Je le dis comme je le sens : parvenir à réaliser ce programme est un véritable TOUR DE FORCE littéraire.
Enfin, l’action. Que dire de l’action ? Et sait-on, à l’arrivée, ce qui s’est passé ? Moi je vais vous dire : au moment de mourir, chacun d’entre nous sait-il ce qui s’est passé ? Non. Cela signifie qu’on ne sait pas exactement la nature et la portée de notre propre existence. Ici c'est la même chose.
Il y a du viol, de l’écriture (souvent compulsive ou frénétique), de la guerre, du sang et du sperme, de l’enfermement, des portes qui s’ouvrent (un peu) et restent fermées (beaucoup), des orifices qui s’ouvrent dans les deux sens (subir l’intrusion, faire sortir, ingérer, excréter). Il y a de la souffrance qui n’est même pas vécue comme souffrance, mais comme un fait brut devant lequel l'être reste ahuri, abasourdi. C’est vrai ça, pourquoi en rajouter ?
Pour résumer, il y a des horreurs, des horreurs et des horreurs. On n’en sort pas. C’est tout juste si le lecteur capte le dernier mot du livre : « survivant », pourtant tellement juste. Et pour dire ça, je vais vous dire, il y a un SOUFFLE qui transporte le lecteur : lisez, pour vous en convaincre, le chapitre extraordinaire qui commence à la page 197.
Ce n’est plus liquide : c’est une sorte de lave croûteuse et brûlante qui pousse devant soi le sens de ce qu’elle déplace et véhicule, et qui dans le même temps le crée et le détruit. Comme une alternative à l'écroulement heurté et rocailleux des mots passés par la chirurgie esthétique, qui marque le récit, partout ailleurs.
La dilution des JE, l’osmose des OÙ, le chaos des QUOI, l’interchangeabilité des COMMENT et des QUI, tout ça nous pose en fin de compte l’infernale question du POURQUOI. Vous savez, ce sont les catégories pour école de journalisme : « QUIS ? QUID ?UBI ? QUIBUS AUXILIIS ? CUR ? QUOMODO ? QUANDO ? ». Et à la question du pourquoi, le livre semble (je suis prudent) répondre : « Pour rien ».
J’arrête là. J'ai été long. Mais je le maintiens : s’il n’y avait pas le suffixe, comme procédé inflationniste et exagérément artificiel, comme « ultima ratio », comme obsession, j’oserais dire que L’Effrayable, d’ANDREAS BECKER, est un GRAND LIVRE. Et le remarquable hommage rendu par un Allemand à notre langue française. Merci, monsieur.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : photographie, alexandre vialatte, littérature, roman, andreas becker, l'effrayable, éditions de la différence, dictionnaire le robert, nouveau larousse illustré, jourde et naulleau, lecture, langue française, france, société, natascha kampusch, allemagne, hitler, nazisme
jeudi, 05 avril 2012
BOUALEM SANSAL CONTRE L'ISLAMISME
Là commence l’errance du frère aîné, qui veut refaire tout le père-iple du père, parce qu’il veut comprendre. Comprendre qui c’était, comment il a fait pour devenir ce qu’il fut, rouage dans une machine à exterminer pour commencer, pour finir « cheikh » respecté dans un minuscule bled algérien, où il est finalement massacré.
Le livre n’est pas seulement raté parce qu’il est « à thèse », mais aussi à cause de la forme de « journal » que l’auteur a choisie : le frère aîné, doué et brillant, rédige le journal de sa quête à la recherche du père dans une langue très maîtrisée ; mais le cadet, qui a failli virer voyou, en tenant lui-même son journal, ne peut espérer fournir au lecteur des outils d’analyse un peu sophistiqués, sous peine que le récit perde totalement en crédibilité : son niveau d’instruction l’interdit. Il en reste à l’instinct, aux réflexes primaires.
Ce qui manque donc au livre, pour devenir satisfaisant, c’est un point de vue englobant, plus élevé, capable d’entrer dans la question avec un peu de subtilité et d’intelligence. C’est tout à fait regrettable, car du coup, le récit reste à l’état de rudiment.
L’aîné, qui découvre la Shoah, a mené un recherche jusqu’au bout, pour « comprendre », comme dit le commissaire du quartier, Com’Dad, une recherche qui l’a conduit au suicide par asphyxie aux gaz d’échappement dans son propre garage. Il doit, comme il dit, « payer sans faute », pour son salaud de père.
Il faut bien dire que l’exposé de la découverte du nazisme du père par le fils a quelque chose de terriblement scolaire. L’auteur nous inflige ce que tout le monde sait sur des pages et des pages, et ne craint pas de donner l’impression d’un cruel ressassement.
Là où le récit acquiert de la force, à peu près au centre du livre, c’est quand Rachel explique la logique des nazis « de l’intérieur », comme un processus industriel rationnellement mis en place et en œuvre. L’examen froidement méthodique des capacités respiratoires d’un bébé et d’un adulte pour calculer les quantités de gaz « zyklon b » et le temps qu’ils mettront à mourir dans la chambre à gaz a quelque chose d’hallucinant, et pour tout dire, de très « culotté ».
Mais la thèse de BOUALEM SANSAL est découpée à la hache : que ce soit en Algérie ou dans les banlieues françaises, les islamistes djihadistes préparent pour l’humanité un système comparable à celui que les nazis ont fait subir au peuple juif, aux tziganes et à toutes sortes de « dégénérés » et d’ « Untermenschen ».
L’équation « islamistes = nazis » est aussi carrée que ça. Ce que confirme BOUALEM SANSAL lui-même, interviewé sur Youtube ou Dailymotion. On en pense ce qu’on veut évidemment. Par exemple, en Tunisie, RACHED GHANNOUCHI, le chef du parti islamiste Ennahda, a annoncé qu’il renonçait à inscrire la charia dans la constitution. En Egypte, ce n’est pas gagné, loin de là.
En tout cas, ce qui est clair, ce qui est sûr, c’est que, dans de nombreux pays musulmans, et à un moindre degré dans certaines banlieues françaises, des individus fanatiques, des groupes de musulmans extrémistes s’efforcent de grignoter du terrain jour après jour sur le territoire de la République. Et je n’ai qu’à moitié confiance, pour ce qui concerne la France, dans un gouvernement quel qu’il soit pour faire face au problème.
S’il y a un problème, ni MITTERRAND, ni CHIRAC, ni JOSPIN, ni SARKOZY ne l’ont résolu. Et ça fait trente ans que ça dure. Ça a commencé quand l’Etat français a démissionné de ses responsabilités en abandonnant la gestion « sociétale » (religion, activités culturelles ou sportives, etc.) des populations musulmanes aux « associations ». C’est-à-dire aux musulmans eux-mêmes. Les gouvernants auraient voulu entretenir un bouillon de culture anti-français, ils ne s’y seraient pas pris autrement. Appelons ça de la lâcheté, et puis n’en parlons plus.
Et Monsieur NICOLAS SARKOZY a la mirobolante idée de fusionner les Renseignements Généraux et la DST pour faire la DCRI (donnée à son pote SQUARCINI) en même temps que des économies, deux services qui n’avaient ni la même finalité, ni le même mode de fonctionnement, ni la même « culture ».
Cela donne la catastrophe policière du groupe dit « de Tarnac », et cela donne la catastrophe policière et humaine de MOHAMED MEHRA, à Toulouse et Montauban. Encore bravo. Au fait, pourquoi le tireur d’élite a-t-il reçu l’ordre (on ne fait pas ça sans en avoir reçu l’ordre exprès) de viser la tête ? Est-ce que ça ne serait pas pour l’empêcher de parler ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, DANS LES JOURNAUX, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, politique, société, religion, fanatisme, fondamentalisme, imam, cheikh, banlieue, salafiste, djihad, boualem sansal, algérie, shoah, nazisme, nazi, zyklon b, juif, tzigane, rached ghannouchi, ennahda, égypte, tunisie, musulman, islam, islamiste, mitterrand, jospin, chirac, sarkozy, hollande, dcri, mohamed mehra, toulouse, montauban
mercredi, 04 avril 2012
UN ALGERIEN JUGE LES ISLAMISTES
Je viens de lire Le Village de l’Allemand, de BOUALEM SANSAL. Pourquoi, me dira-t-on ? Eh bien l’occasion s’est présentée lors d’un précédent article au sujet de l’Islam. On trouve sur Internet un certain nombre de vidéos. J’ai visionné à tout hasard une interview de l’auteur, à propos de cet ouvrage, paru en 2008.
Le journaliste lui demandait s’il n’exagérait pas en faisant dans son livre un parallèle strict entre les islamistes algérien des GIA et les nazis des camps de la mort. L’auteur répond par la négative : il voit dans le projet des musulmans les plus radicaux (les « djihadistes ») se profiler une vision totalitaire de la société.
<object width="480" height="360"><param name="movie" value="https://www.youtube.com/v/uqKLHNNpsGc?version=3&h... name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="https://www.youtube.com/v/uqKLHNNpsGc?version=3&h..." type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
J’ai voulu en avoir le cœur net, en lisant le bouquin. Intuitivement, j’ai tendance à lui donner raison (voir le prêche plein de bonnes intentions totalement inopérantes (« nous devons nous maintenir vigilants ») d’ABDELWAHAB MEDDEB dans Libération du 2 avril, où il prononce lui-même le mot de « totalitaire », sans être forcé).
Ceci n’est pas exactement une note de lecture, et pour une raison simple : sur le plan romanesque, le livre est assez raté, alors que, par son sujet, il pose une question grave.
Comme bien souvent, quand un romancier se lance dans un livre « à thèse », le résultat est littérairement décevant, quand il n’est pas carrément nul. L’art fait toujours (ou presque) mauvais ménage avec la démonstration. Et aussi avec le militantisme. Car Le Village de l’Allemand (2008, disponible en Folio) est un roman « engagé ».
L’auteur s’insurge en effet, très fortement, contre l’infiltration de « guerriers » de l’Islam dans les banlieues françaises, depuis un certain (?) nombre d’années. On ne peut pas lui donner complètement tort. MARINE LE PEN a évidemment tort de souffler sur les braises des antagonismes, mais il y a de la vérité quand elle parle de « fascisme vert ».
Oui, il y a des « fascistes verts » en France. Que leur nombre (très faible) fasse « courir un risque à la République », c’est un fantasme d’une autre paire de manches, dont je me garderai de franchir le pas (comme dirait le Maire de Champignac). Mais on ne peut nier qu’il y a en France, aujourd’hui, des fanatiques.
Leur objectif est d’étendre leur emprise à visée totalitaire sur des parties de la population, disons pour aller vite, « d’origine maghrébine ». Ils se considèrent comme des soldats en guerre contre la civilisation européenne. J’en reparlerai prochainement.
Alors le bouquin de BOUALEM SANSAL, maintenant. Rachel et Malrich sont deux frères, nés de mère algérienne et de père allemand. Aïcha Majdali, du village d’Aïn Deb, a épousé Hans Schiller. Rachel est la contraction de Rachid et d’Helmut ; Malrich, celle de Malek et Ulrich. La vraisemblance de tout ça est relative, mais enfin bon.
Le père pourrait s’appeler le père-iple, tant sa trajectoire est compliquée, avant de débarquer dans ce tout petit patelin. Il fut officier SS, en poste dans différents camps de la mort. A la Libération, il suit une filière compliquée d’exfiltration des anciens nazis, qui passe par la Turquie, l’Egypte, et qui l’amène en Algérie, où il rendra quelques « services », avant d’être remercié et de prendre une retraite bien méritée, sous le nom de Hassan Hans, dit Si Mourad. Bon, pourquoi pas, après tout ?
L’action du bouquin se passe pendant la sale guerre que se livrent le gouvernement algérien et les islamistes du GIA (60.000 à 150.000 morts selon les sources). C’est dans cet affrontement que le couple arabo-allemand est massacré, dans une tuerie collective nocturne. Rachel fait le voyage, et tombe sur les papiers laissés par son père.
Voilà ce que je dis, moi.
J’ai essayé de faire court, mais ça finit demain.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, DANS LES JOURNAUX, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : boualem sansal, algérie, islam, islamisme, musulman, extrémiste, djihad, salafiste, salafisme, le village de l'allemand, gia, guerre civile, religion, fanatisme, abdelwahab meddeb, libération, presse, journaux, totalitaire, totalitarisme, nazi, nazisme, marine le pen, politique, société, mohamed mehra
lundi, 12 mars 2012
HERMANN BROCH : LES SOMNAMBULES
Les Somnambules, de HERMANN BROCH
Je m’en excuse par avance auprès de ceux (et surtout de celle – coucou, M.) que mes petites notes de lecture rebutent, mais je veux rendre un hommage appuyé à une grande œuvre littéraire du 20ème siècle, écrite par HERMANN BROCH entre 1928 et 1931, c’est-à-dire, il est bon de le souligner, avant l’avènement du nazisme au pouvoir.
Voilà un bouquin tout à fait ambitieux, dont les actions, situées de 1888 à 1918, chevauchent le passage au nouveau siècle. Il raconte, en gros, le début de la fin de l’Europe. On a déjà vu ça avec L’Homme sans qualités, de ROBERT MUSIL. Tiens, c'est drôle, ce sont deux Autrichiens.
J’ai dit LES actions, parce qu’il s’agit en fait d’un triptyque, qui met en scène trois personnages : l’officier noble Pasenow figurant le « Romantisme » ; le comptable Esch, l’ « Anarchie », et le déserteur Huguenau, le « Réalisme ». Un livre extraordinaire.
Une citation, p. 441, pourrait bien être à l’origine de ce pavé de plus de 700 pages : « ll est significatif qu’une époque complètement dévolue au trépas et à l’enfer doive nécessairement vivre dans un style qui n’est plus capable de produire d’ornement. ». L’architecture comme art de l’espace, la musique comme se résolvant en espace, l’architecture comme synthèse de la vie dans un espace donné, l’ornement étant comme la quintessence de ce rapport à l’espace.
Premier livre : Pasenow, ou le Romantisme. L’action se passe donc en 1888. Joachim von Pasenow fera une carrière militaire. Son identité se confond avec l’uniforme : « Ce qui est fait est fait, et quand on a pris l’habitude, dès sa dixième année, de porter l’uniforme, celui-ci vous entre dans la chair comme une tunique de Nessus et nul, Joachim moins que tout autre, ne peut alors dire où finit son moi, où commence l’uniforme. »
Il épousera la fille de la famille noble qui possède le domaine jouxtant celui de son père et réapparaîtra dans la dernière partie en Général Pasenow, rigide et, en un mot : militaire. Pour parodier le dernier titre paru de CHLOÉ DELAUME, on pourrait le désigner comme « un homme avec personne dedans ».
Dans la première partie, il hésite beaucoup au sujet de son avenir : doit-il suivre le chemin de ses inclinations ou de ses devoirs ? Il croise la route de la sensuelle Ruzena, Polonaise de basse extraction, aux tentations de laquelle il succombe, mais avec un certain sentiment de culpabilité de classe. Il croise la route de Bertrand, l’aventurier brillant et libre de ses désirs et de ses ambitions.
Mais il se conformera à l’exigence de la tradition, et épousera la carrière des armes et Elisabeth, qu’il apprécie modérément, mais qui appartient à la même caste. Elle sera d’ailleurs courtisée et momentanément séduite par le flamboyant Bertrand. Le monde dans lequel se déroule le roman semble exténué. Est-ce que l’ordre règne, se demande-t-on, devant les visibles ferments du désordre ?
« Quatorze minutes se sont écoulées depuis le premier signal et sitôt que l’aiguille aura atteint la quinzième minute, Peter, le domestique, administrera trois coups discrets au plateau de bronze. » (p. 111). L’ordre ancien semble s’imposer par la force, comme le vieux comte s’approprie le sac postal pour, seulement après, distribuer le courrier aux uns et aux autres. Mais les signes ne manquent pas qui montrent que l’ordre ancien se défait. Pasenow a parfois l’impression qu’il est réglé comme dans un cirque. Peut-être une autre façon de se dire qu’il est tout simplement vide.
Deuxième livre : Esch ou l’anarchie. L’action se passe en 1903. August Esch est un comptable, un employé de commerce de trente ans. Il se fait virer de son emploi. Son ami infirme, Martin Geyring, est un syndicaliste connu, sans doute anarchiste. Le point de ralliement est le café de la mère Gertrud Hentjen, lieu relativement minable.
La femme a trente-six ans et est veuve depuis quatorze ans. Esch, qui épousera la mère Hentjen, fume des cigares bon marché. Il rêve au nouveau monde. Il rêve d’y produire des spectacles de luttes féminines, pour lesquelles il commence d’ailleurs à recruter. Il trouve un emploi dans une grosse entreprise de commerce international, qui appartient au Bertrand du premier livre, qui mène une carrière de grand commerçant international. On est dans un temps où les individus sont devenus interchangeables. On sent parfois pointer la tentation philosophique.
C’est ici qu’est mentionné le somnambulisme : les somnambules sont les voyageurs du train qui dorment leur vie et ont cessé de croire aux discours de la « science » et de la « politique » (les « ingénieurs » et les « démagogues »). Le somnambule est l’homme à l’état gazeux, entre veille physique et envol spirituel : prisonnier.
Voilà ce que je dis, moi.
A finir demain.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, les somnambules, hermann broch, robert musil, l'homme sans qualités, pasenow ou le romantisme, esch ou l'anarchie, chloé delaume, nazisme, autriche, autrichien
dimanche, 29 mai 2011
TELEVISION : HITLER EN A RÊVE
EPISODE 1
Si l’on m’objecte que l’exemple est terriblement rebattu, je répondrai qu’il est excellent, et que c’est sans doute parce qu’il est excellent qu’il est, précisément, rebattu. Il s’agit du fameux « télécran » inventé en 1948 par George Orwell pour le monde fabuleux sur lequel règne Big Brother (lui aussi, tout le monde le connaît) : évidemment 1984. C’est l’écran quasi-magique qui fonctionne dans les deux sens : il retransmet les discours du chef bien-aimé, et il espionne les faits et gestes de la personne qui habite les lieux. Pour un roman d’anticipation, on peut dire que c’est réussi : exception faite de la séparation des deux fonctions (propagande et espionnage), d’une part dans la télévision, d’autre part dans la caméra de surveillance, tout le reste ou pas loin s’est réalisé, y compris la « novlangue » et la Police de la Pensée. Espionnage (donc sécurité) et propagande.
La seule vraie faiblesse du livre d’Orwell, c’est qu’il réserve le monde de 1984, exclusivement, aux régimes totalitaires, alors que les espaces où il s’est aujourd’hui épanoui et accompli s’intitulent pompeusement démocraties, comme j’essaie de le montrer. C’est dans les démocraties que s’est développée une industrie du divertissement qui passe pour une bonne part par la télévision. Et les démocraties ne sont pas épargnées par l’obsession de la sécurité : elles ont vu se multiplier les « mesures de sécurité », les « normes de sécurité ». C’est flagrant depuis le 11 septembre 2001, mais cela date de bien avant. L’industrie de la sécurité est une affaire qui marche (pas de grands magasins sans vigiles).
Moyennant quoi, l’individu n’a jamais été aussi libre de faire ce qu’il veut (ça c’est pour « démocratie »), mais je fais remarquer que, comme il veut les mêmes choses que tout le monde, il fait comme tout le monde : les gens se conduisent à peu près comme on attend qu’ils le fassent (mais attention, il ne faudrait surtout pas réduire ignoblement la liberté à la simple liberté de choix : même s’il y a d’innombrables marques, sortes et goûts de yaourts, ça reste des yaourts). La seule et vraie différence, c’est que ce résultat est obtenu sans violence physique, car ils adhèrent spontanément à ce monde, disant que, de toute façon, « ils n’ont rien à se reprocher », et que quand on est irréprochable, il n’y a pas de raison d’être choqué par les caméras de surveillance (le terrifiant « Souriez, vous êtes filmé. »). Pour ce qui est du divertissement ou des mœurs, à la question : « Pourquoi faites-vous ça ? », ils ont cette terrifiante réponse : « C’est mon choix ! ». Je ne suis pas le. C'est un système qui fonctionne d’une façon implacablement logique : sans la télévision et le divertissement, pas d’adhésion ; sans adhésion, pas de caméras de surveillance. Tout se tient.
Enfin, quand je dis « spontanément », je fais semblant. C’est là que la télévision, entre autres, dévoile une de ses fonctions principales. On sait qu’Adolf Hitler, en accédant au pouvoir en 1933, a créé aussitôt un Ministère de la Propagande, confié d’emblée à Joseph Goebbels. On sait que par là, il voulait développer la force de l’action de frapper les esprits, d’y pénétrer pour y introduire des idées, des images, des « valeurs » qui n’y étaient pas précédemment. Il voulait donner à cette action toute la dimension et toute la démesure dont il rêvait. Il fallait aussi que les esprits en question gardent l’impression que les idées qu’ils exprimaient ne germaient pas ailleurs qu’en eux-mêmes, et ne s’aperçoivent pas de l’intrusion. Exactement comme dans le film Maine-Océan, la scène nocturne où, pendant que le propriétaire de la maison dort profondément, quelques copains, qui ont un compte à régler, s’introduisent dans sa cuisine et vident consciencieusement son frigo et ses bouteilles en étouffant leur fou-rire.
J’ai déjà parlé d’Edward Bernays (le 16 mai), neveu de Freud, inventeur des « public relations », qui a su mettre à profit les concepts élaborés par son oncle, pour en tirer des préceptes « utiles ». Propaganda est paru en 1928 (éditions Zone, 12 euros). Comme le titre, le sous-titre est un aveu : « Comment manipuler l’opinion en démocratie ». Je ne résiste pas au plaisir de citer les deux premières phrases du bouquin : « La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays » (c’est moi qui souligne). A déguster lentement, non ? Et ce n’est pas un nazi qui parle, mais un Américain, un conseiller des présidents. Je cite la 4ème de couverture : « Un document édifiant où l’on apprend que la propagande politique au 20ème siècle n’est pas née dans les régimes totalitaires, mais au cœur même de la démocratie libérale américaine ». Ce n’est pas moi qui le dis : vous m’auriez taxé de parti pris.
Goebbels n’a eu qu’à piller, et il ne s’en est pas privé, les théories de Bernays pour développer les activités de son ministère de la Propagande. Mais ces théories ont aussi inspiré les gouvernants des régimes démocratiques. Car partout, sur la planète, leur grand problème a été au 20ème siècle de répondre à la question : « Comment obtenir des masses qu’elles obéissent ? ». Deux types de régimes servent à ça : les autoritaires et les démocratiques. Terreur, police, délation d’un côté. Liberté, bonheur, consommation de l’autre. Dans l’un, le bâton. Dans l’autre la carotte. Mais ne croyez pas que la question qui se pose, par exemple, dans la Tunisie de Ben Ali ne se pose pas dans nos belles démocraties. Il s’agit toujours d’obtenir la soumission, mais en prenant, cette fois, la mouche avec du miel. Il faut bien que les trouvailles de tonton Freud servent à quelque chose ! La théorie psychanalytique pour éviter la Terreur, en quelque sorte ! Qu'en aurait pensé Robespierre en 1793 ?
Tout a été dit sur le thème « nazisme et propagande ». Toujours, évidemment, pour condamner sans appel l’entreprise de formatage des masses voulue par Hitler. Mais ils tiennent coûte que coûte à en faire un repoussoir. Pour ériger nos belles démocraties en contre-modèle. Le nazisme, ses horreurs, sa propagande fonctionnent en épouvantail absolu : les commentateurs, en général, mettent l’accent sur le fossé, l’abîme qui sépare notre système du sien. C’est sûr, il n’y a rien de commun entre les deux. Mais en est-on si sûr que ça ?
Car, en matière de manipulation des foules, les nazi (et sans doute aussi Staline, il faudrait voir, parce que l’histoire du « petit père des peuples », comme propagande, ce n’est pas mal non plus) ont bel et bien piqué les idées d’un Américain. Les idées de Bernays servent de base large et solide, aux Etats-Unis, à tout ce qu’on appelle la propagande (ou publicité), la « communication », la manipulation des foules. Quand on nous bassine avec l’idée que l’Europe copie les Etats-Unis avec dix ans de retard, il faudrait rétablir le lien, le « missing link » (le chaînon manquant), qui n’est autre que Goebbels et le nazisme, qu’on présente le plus souvent comme une exception historique, ce soi-disant fossé qui dresse un mur infranchissable (petit hommage en passant au maire de Champignac, et à Franquin, bien sûr) entre lui et nous : il y a bel et bien continuité. La seule rupture, énorme évidemment, ce sont la Shoah, les chambres à gaz, le système concentrationnaire, la terreur, etc. (l’U.R.S.S. de Staline n’est pas loin derrière pour ce qui est des « performances », si l’on peut parler ainsi, elle est même peut-être devant) : en gros, toutes les procédures d’élimination pure, simple, brutale. Pour ce qui est de la liberté de l’esprit (je ne parle pas de la liberté d’expression), cela demande un examen approfondi.
Les Etats-Unis étant une démocratie, il n’était pas question pour eux de recourir à la terreur pour faire marcher toute la population au même pas. Mais ils étaient face à un problème : par quel moyen arriver au même résultat ? Il fallait quand même faire marcher le pays, le faire prospérer, croître et embellir. Comment diriger 122.780.000 de personnes (on est en 1930), sans violence, mais en étant aussi efficace ? La grande habileté de l’Amérique a été d’utilise à outrance la connaissance du psychisme humain (Freud et ses continuateurs, Bernays et Lippmann) pour obtenir l'adhésion des masses.
Je renverrai toujours, à ce sujet, à l’essai de Beauvois et Joule sur la « soumission librement consentie » : Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (quand les choses sont présentées habilement, l’individu, en régime de liberté, a tendance à se soumettre). Les auteurs, cependant, ne poussent pas au bout leur raisonnement dans ce qu’il a de critique : ils prennent le parti de l’optimisme libéral. Pour obtenir des masses qu’elles adhèrent, et même qu’elles désirent leur propre embrigadement, il suffit de perfectionner d’une part la connaissance de la psychologie des foules, d’autre part quelques techniques de communication bien venues.
A SUIVRE ...
20:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george orwell, télévision, littérature, big brother, liberté, hitler, nazisme, goebbels, edward bernays, sigmund freud, propagande, manipulation des foules, obéissance, soumission
vendredi, 20 mai 2011
ARCHITECTURE : HITLER A GAGNE
Il faudra bien qu’un jour on cesse de faire de Staline et Hitler des épouvantails, des incarnations d’un Mal définitivement enterré à des années-lumière de notre monde si heureusement né au chef d’œuvre qu’est la démocratie, dans l’histoire des sociétés humaines. Il faudra cesser de mettre les deux grands totalitarismes du 20ème siècle dans des parenthèses, comme des parois étanches qui en font des sortes d’exceptions historiques, des espèces de dérapages du flux normal de la grande Histoire : finalement des erreurs. Non : Staline et Hitler ne sont ni des dérapages, ni des exceptions, ni des erreurs. Ils sont l’expression, la conclusion logique, l’aboutissement « normal » d’un système né avec l’Europe industrielle (ça fait 150 ans, ou à peu près).
Qu’ils en aient été de sinistres caricatures ne change rien : Staline découle en pire du terrorisme d’Etat mis en place par Lénine (après tout, il a commencé sa carrière en attaquant des banques avec la bande qu’il dirigeait) ; Hitler découle en pire des traités qui ont suivi la guerre de 1914-1918 et des errements de la République de Weimar. Alors, c’est vrai : les doctrines de l’un et de l’autre, dûment condamnées, sont enfermées dans les placards, dans les caves et dans les archives. Mais elles ne sont pas restées sans postérité, sans descendants, sans héritiers dans notre monde très moderne, très actuel, pour tout dire. Le monde que nous héritons du passé doit aujourd'hui beaucoup à Staline et Hitler, comme j’ai essayé de le montrer pour l’eugénisme dans ma note du 12 mai dernier.
Pour voir si je ne délire pas, je me tourne vers un témoin irréfutable : Albert Speer, l’architecte de HITLER, son seul confident, paraît-il. Evidemment inscrit au Parti nazi, dont il devient rapidement l’architecte en chef, il a une conception de l’architecture qui épouse étroitement les visions du Führer, mais celui-ci va y insuffler toute l’ampleur de sa démesure. Et c’est quoi sa conception ? Par exemple, il invente « la valeur des ruines » : dans 1000 ans, il faudra que les ruines laissées soient aussi belles que celles, visibles aujourd’hui, de l'antiquité grecque. Dans leurs cartons, qu’est-ce qu’ils ont comme projets, les deux complices ? Le Reichstag, paraît-il (cf. Wikipédia), une coupole treize fois plus haute que Saint Pierre de Rome (131 mètres, ça nous porte à 1703 mètres : étrange). L’arche triomphale aurait pu contenir dans son ouverture l’Arc de Triomphe de l’Etoile (49,54 mètres). Pour le futur stade des « jeux aryens » à Nuremberg (après suppression des Jeux Olympiques), 400.000 places prévues. Bref, l'architecture nazi, c’est de l’impérial, du monumental, du triomphal de masse. Bref : surenchère, démesure, volonté de puissance (tiens tiens !).
Il faut dire que Mussolini a tenté de rivaliser avec Hitler, mais il n’avait pas les moyens. Consolons-le en lui répétant, sur son bulletin scolaire, que l’intention y était : « Bien, mais doit mieux faire, s’il veut accéder à la plus haute marche ». Côté Staline, c’est pas mieux, à voir les palais soviétiques, la magnifique Loubianka, à Moscou, vous savez, le palais du KGB de sinistre mémoire, remplacé par le moderne et riant FSB, et diverses autres grandioses réalisations dans les « démocraties populaires ». J’ai vu de mes yeux, en 1990, ce que Ceaucescu avait prévu de construire en plein Bucarest : un immeuble-ville, après avoir détruit sans sourciller quelques dizaines d’églises, dont certaines du 18ème siècle. Dans le même temps, il projetait de rassembler la population roumaine dans quelques dizaines de méga-villes, pour restituer à l’agriculture toute la surface disponible, moyennant la destruction pure et simple de quelque 5000 villages. Quand je me tue à vous dire que Hitler, il est pas mort. Est-ce que le gouvernement roumain d’aujourd’hui, forcément démocratique, on vous dit, sait désormais quoi faire de ce machin (je ne vois pas d’autre terme) ?
Mais du côté de chez nous, les pays « libres», comme toute le monde dit, qu’est-ce qu’on voit, éberlué ? Qu’est-ce que c’est, l’Empire State Building ? Qu’est-ce que c’est, les tours de Kuala Lumpur ? Burj Khalifa à Dubaï (828 mètres) ? Le stade de Maracaña ? Qu’est-ce que c’est, le plus grand pont du monde ? Le plus gigantesque barrage du monde (en Chine : le « Trois gorges ») ? Le tunnel le plus long du monde (en Suisse : le « Gothard »)? Etc., etc., on n’en finirait pas. Bon, vous avez compris : surenchère, démesure, volonté de puissance. Quand je vous disais que Staline et Hitler ne furent que l’expression caricaturale d’un système industriel voué par nature au gigantisme et à la compétition illimitée du gigantisme !
Je vais aggraver notre cas, à nous autres, les sociétés « démocratiques », qui se donnent en spectacle désirable à « toutes les dictatures antédiluviennes » (qu’on se demande comment elles ont pu se perpétuer). C’est à propos d’une autre trouvaille architecturale, vous savez, celle qui, moyennant finance, vous permet de gagner la Côte d’Azur le plus rapidement (sauf en cas de bouchon, d’accident ou de chute de neige un peu imprévue). Allez, lecteur, ne te fais pas plus bête que tu n’es. C’est évidemment l'autoroute. Tu sais, estimable lecteur, de quand ça date, l’autoroute ? De 1924 (77 kilomètres entre Milan et la région des lacs). Et tu ne devineras jamais où ça a été inventé ? Allez, je te le dis : Italie. Et qui est au pouvoir ? Mussolini. Et qui va se mettre à en fabriquer à n’en plus finir ? Adolf Hitler. Et à quoi ça devait servir prioritairement ? Acheminer les armées, les camions, les blindés, les canons, les chars. Evidemment, aujourd’hui, plus personne ne se pose la question : l’autoroute, c’est tellement plus pratique (tiens, c’est comme l’ordinateur, l’internet, le téléphone portable, la musique portable, etc.). L’autoroute, on l’emprunte (et on la rend à la sortie).
Moralité ? Toute le monde a compris : l'architecture et l'autoroute, qui structurent de fond en comble l’espace et le territoire de nos si désirables démocraties, nous ont été léguées par Hitler.
L’excellent Philippe Muray (y avait longtemps…) parle quelque part des fameuses tours du World Trade Center. Il parle, à leur propos de cataclysme architectural. Je trouve que c’est bien vu. Mais si l’on va par là, il faut bien dire que la tour Eiffel s’inscrit dans la lignée, au chapitre de l’archéologie des cataclysmes architecturaux (tour qui, au passage, a été prolongée « ad vitam aeternam » en 1909, année prévue de sa démolition, quand ce sont des militaires qui se sont rendu compte qu’elle pouvait rendre d’éminents services). La Tour Eiffel inaugure l’ère des exploits architecturaux. Ils ne cesseront plus. Je passe sur les projets que Le Corbusier, heureusement, n’a pas eu le temps ou l’occasion de concrétiser, restés à l’état de dessins : Paris rasé, sauf les monuments touristiques, pour dégager l’espace et y construire de gigantesques tours pour y mettre les masses ; Rio de Janeiro réduit à un gigantesque immeuble continu (sur des kilomètres), avec, évidemment, l’autoroute passant sur le toit.
Surenchère, démesure, volonté de puissance. Vous vous rappelez la devise si sublime des Jeux olympiques ? « Citius, Altius, Fortius ». Je n’ai même pas besoin de traduire, je pense ? Ce que nous condamnons aujourd’hui dans les camps de concentration, c’est l’espace même dans lequel nous vivons. Un espace concentrationnaire. La seule différence, c’est que pour nous, c’est payant.
Staline et Hitler sont les paroxysmes de la civilisation industrielle. Nous en sommes les continuateurs. Les héritiers, en quelque sorte.
Alors, vous croyez toujours qu’ils sont des aberrations de l'histoire ?
15:24 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : staline, hitler, dictature, architecture, totalitarisme, espace, autoroute, albert speer, berlin, nazi, nazisme, ceaucescu, mussolini, tour eiffel, le corbusier, philippe muray, jeux olympiques

