dimanche, 20 janvier 2019
HOUELLEBECQ
Je termine aujourd'hui ma "grande révision" des romans de Michel Houellebecq. Voici celui par lequel je suis finalement entré dans cette œuvre, unique dans la littérature française d'aujourd'hui. Des quatre billets d'origine (17 au 20 août 2011), j'ai fait un seul, trop long certes, mais dont j'ai éliminé énormément de graisse superflue. Il reste peut-être quelques bourrelets.

Une amie avait prêté à H. La Carte et le territoire, le petit dernier de l’auteur controversé. Le livre était là, sur la table, inoccupé, il s’ennuyait. Je l’ai ouvert – avec réticence. Autant l’avouer : je craignais le pire. Eh bien tenez-vous bien, je n’ai pas regretté. Franchement, c’est une heureuse surprise. J’ai donc lu récemment La Carte et le territoire. J’ai trouvé ce livre réjouissant.
L’action se passe aujourd’hui, ou peu s’en faut : il ne faut pas compter sur une reconstitution historique. Et l’époque, on entend la détestation. On sent que le narrateur ne peut pas la sentir. Et pour moi, ça tombe bien, c’est une attitude que non seulement je comprends, mais que je partage. Ce qui est vraiment bien, c’est que Michel Houellebecq, non seulement ne dit jamais « je » comme dans ces pseudo-romans que sont les soi-disant « auto-fictions », mais encore met en scène un personnage qui s’appelle Michel Houellebecq, qui meurt atrocement, soit dit en passant, dans la troisième partie.
Le personnage principal, c’est l’artiste Jed Martin, fils de l’architecte Jean-Pierre Martin, à la riche et belle carrière d’architecte, qui a pris sa retraite, un jour. Le roman commence sur l’impossibilité de finir le tableau dont le sujet consiste en Jeff Koons et Damien Hirst, les deux artistes les plus chers du marché de l’art contemporain. Déjà, cette impossibilité de finir un pareil tableau me rend le livre sympathique. Ça ne suffit pas, mais ça aide. D’autant que le futur tableau s’intitule « Jeff Koons et Damien Hirst se partageant le marché de l’art ».
Damien Hirst a réalisé l’œuvre d’art la plus chère de tous les temps, avec un véritable crâne humain recouvert de (environ) 8000 diamants authentiques. Il a, par cette « invention », gagné son bras de fer avec Jeff Koons. Ce dernier a dû chercher longtemps le moyen de se replacer au sommet du podium mais, apparemment, il n’a pas trouvé. Moralité : l’argent a eu la peau du sexe (cheval de bataille de Koons autour de 1992, voir la série de photos kitsch où Koons exhibe in vivo son membre à l'œuvre dans la Cicciolina extatique).
Dit autrement : la marchandise a triomphé de la morale, puisque pour « heurter les sensibilités », exhiber une copulation in vivo est dépassé : il faut maintenant des diamants, et des diamants comme s’il en pleuvait. Et ça ne heurte même plus personne. C’est sans doute ce dont Michel Houellebecq est convaincu, au moins apparemment, car ce tableau, que Jed Martin finira d’ailleurs par détruire, symbolise l’escroquerie cynique et arrogante que constituent désormais, d'une part la gratuité obscène, voire pornographique (et je ne parle pas forcément de sexe), de certains "gestes artistiques" contemporains (Koons vs Hirst), d'autre part l’étalage sans vergogne des montagnes de fric (Arnaud vs Pinault) sous le nez même de ceux que l’ultralibéralisme racle jusqu’à l’os.

Koons et Pinault : deux hommes d'affaires.
"La carte et le territoire" est une expression qu’on rencontre deux ou trois fois dans les Essais de Philippe Muray (Les Belles Lettres, 2010), ainsi que dans Festivus festivus (Fayard, 2005, p.389) : « La fameuse distinction de la carte et du territoire était encore rassurante : c'était la distinction du réel et de l'imaginaire ; mais il n'y a plus de territoire, et c'est le peuple de la carte qui s'exprime. Sans drôlerie, comme de juste. Sans imagination. Ou qui ne s'exprime pas du tout, d'ailleurs ». Cela ouvre comme un horizon, une sorte de profondeur de champ, sur notre monde désormais entièrement artificialisé.
Jed Martin a été photographe avant de virer peintre. Il a commencé par « trois cents photos de quincaillerie », avec « écrous, boulons et clefs à molette », tout ça en « lumière neutre », sur « fond de velours gris moyen ». Puis il a l’illumination, un jour où, sur une aire d’autoroute, son père lui demande d’acheter la carte Michelin du département. Ils sont dans la Creuse. Le passage vaut, comme on dit dans le Guide Michelin, le détour.
« Cette carte était sublime ; bouleversé, il se mit à trembler devant le présentoir. Jamais il n’avait contemplé d’objet aussi magnifique, aussi riche d’émotion que cette carte Michelin au 150.000ème de la Creuse, Haute-Vienne. L’essence de la modernité, de l’appréhension scientifique et technique du monde, s’y trouvait mêlée avec l’essence de la vie animale. » C’est le coup de foudre. On ne comprend pas bien, mais le roman, c’est aussi ça.
Donc Jed Martin est tombé amoureux des cartes Michelin. Il se fait une sorte de nom avec ses photos de cartes. Le titre de son exposition est d’ailleurs : « La carte est plus intéressante que le territoire ». Cela tombe bien : la Compagnie Financière Michelin est intéressée par cette mise en valeur inattendue. Et puis c'est l'occasion pour lui de tomber un peu amoureux d’Olga. Bref, je ne vais pas vous le refaire. Le premier thème du livre, c’est d’abord l’état du monde, pas brillant, on l’a vu.
Le deuxième thème, c’est le monde de l’esthétique, ou plutôt le monde de la beauté. Le père est architecte : la beauté qu’il élabore reste lestée par l’ « utile », le fonctionnel, le monde concret. Il conçoit des stations balnéaires. Il peut y avoir de l’art dans l’architecture, mais par principe, ça n’encourage pas l’oiseau à déployer ses ailes, ou alors il s’agit d’un oiseau attaché au sol, trop lourd pour voler, en quelque sorte. D’ailleurs le père ne se gêne pas pour qualifier de « totalitaires » les élucubrations urbanistiques de Le Corbusier, sorte d'Albert Speer des démocraties, au sujet de Paris ou Rio de Janeiro.
Jed, quant à lui, est un artiste. Il part de ses « objets de quincaillerie », dont l’exposition forme un « hommage au travail humain ». Il prend ensuite de l’altitude, avec les cartes Michelin, pour regarder le monde d’en haut, avec tout le sens conféré par les dessins, les formes, et puis surtout les noms.
Puis il devient peintre, avec des tableaux qui représentent le monde, ou plutôt qui essaient de dégager une signification du spectacle du monde. Les titres disent quelque chose : « Bill Gates et Steve Jobs s’entretenant du futur de l’informatique », « Aimée, escort-girl », « L’architecte Jean-Pierre Martin quittant la direction de son entreprise ».
Wong Fu Xin, un essayiste chinois qui a travaillé sur le peintre, le voit « désireux de donner une vision exhaustive du secteur productif de la société de son temps ». Le roman, à travers le personnage de Jed Martin, parle bien du monde. Et il en dit quelque chose, qui a quelque chose à voir avec l’étriqué qui enserre l’humanité depuis que l’économique (pour ne pas dire le financier) est seul aux manettes.
« Je veux rendre compte du monde… Je veux simplement rendre compte du monde ». C’est ce que répète Jed Martin qui, ayant pris de l’âge et marqué le monde de l’art de son empreinte, est interviewé pour la revue Art press. Pour dire, la dernière partie de son œuvre consistera, le matin, à poser son caméscope, à cadrer, par exemple « une branche de hêtre agitée par le vent », ou « une touffe d’herbe, le sommet d’un buisson d’orties, ou une surface de terre meuble et détrempée entre deux flaques ». Il déclenche, et vient récupérer son matériel le soir ou le lendemain. Il en tire par montage des « œuvres », « qui constituent sans nul doute la tentative la plus aboutie, dans l’art occidental, pour représenter le point de vue végétal sur le monde ». Le point de vue végétal sur le monde : cette trouvaille m’enchante.
Il y aura aussi ces composants électroniques, qu’il asperge d’acide sulfurique pour « accélérer le processus de décomposition ». A la suite d’un long travail qu’il est inutile de détailler, il aboutit à de « longs plans hypnotiques où les objets industriels semblent se noyer, progressivement submergés par la prolifération des couches végétales ».
Il fera subir un sort analogue à des photographies laissées à « la dégradation naturelle », puis à des « figurines jouets, représentations schématiques d’êtres humains ». On aura constaté que la place de l’homme, dans tout ça, est si réduite qu’elle a pour ainsi dire disparu.
Un autre thème apparaît au début de la troisième partie. Enfin, pas un « thème » : on change de roman, du moins en apparence. On était dans la « littérature », on entre dans le polar. L’écrivain Michel Houellebecq et son chien sont retrouvés, enfin, quand je dis « retrouvés », c’est beaucoup dire, car il n’y a plus que leurs têtes qui trônent sur des fauteuils, par la police, éparpillés aux quatre coins de la pièce, pas exactement « façon puzzle », comme dit Bernard Blier dans un des films français les plus célèbres de tous les temps. La façon dont les restes sont disposés évoque les toiles de Jackson Pollock, « mais un Pollock qui aurait travaillé presque en monochrome ».
L’assassinat a duré à peu près sept heures, selon les enquêteurs. Cette scène de crime m’a fait penser à Un Lieu incertain de Fred Vargas, où on lit : « Comme si le corps avait éclaté ». La police patauge, au sens propre, jusqu’à ce que Jed Martin fasse part à Jasselin, le policier, de la disparition du tableau « Michel Houellebecq écrivain » dont il lui avait fait cadeau.
Il y a des idées marrantes, dans cette troisième partie. Par exemple, l’auteur pensait-il à François Bégaudeau en créant un « brigadier Bégaudeau » qui face à la scène de crime se met à osciller sur lui-même : « il fallait juste aller le coucher c’est tout, dans un lit d’hôpital ou même chez lui, mais avec des tranquillisants forts » ? Par exemple, pensait-il à la « trilogie marseillaise » de Jean-Claude Izzo, en faisant boire à ses flics du whisky Lagavulin, comme celui que préfère Fabio Montale ? « Il est impossible d'envisager un travail de police sérieux sans une réserve d'alcool de bonne qualité (...) ».
« L’affaire est résolue », s’écrie Jasselin quand Jed Martin estime la valeur de son tableau à 900.000 euros. Il faut dire que l’exposition organisée par Franz a fait du peintre un homme très riche, qui peut acheter du jour au lendemain un vaste domaine. Trois ans plus tard, quand l’assassin est retrouvé (mort), le tableau est estimé à 12.000.000. Jed Martin est devenu une « valeur ». Il peut tout se permettre.
Le dernier pan de ce livre que je voudrais retenir, c’est la relation au père, qui quadrille pour ainsi dire le roman. Et c’est un des beaux aspects du livre. Le père intervient comme une ponctuation. Le mot « intervient » est d’ailleurs impropre : disons qu’il est là, présent à intervalles réguliers, tous les 25 décembre pour être précis, c’est le jour de l’année où ils prennent un repas en commun, et un repas de fête, qui plus est. En général, ce n’est pas très gai. Mais ce n’est pas lugubre non plus. L’événement est présenté comme allant de soi : le fils passe avec son père le réveillon de Noël. C’est tout simple, ça ne se discute pas.
C’est d’ailleurs intéressant, cette relation entre le fils et son père, car la mère est à peu près absente, simplement mentionnée comme un souvenir, mais un souvenir anodin. On apprend qu’à la vérité, elle s’est suicidée au cyanure. Cette absence de la mère change de l’habituelle dégoulinade de maternite aiguë dont sont atteints bon nombre de nos contemporains.
Jed Martin est étonné quand son père déclare, au cours de leur premier repas du roman, « dans une brasserie de l’avenue Bosquet appelée Chez Papa », avoir lu deux romans de Michel Houellebecq : « C’est un bon auteur, il me semble. C’est agréable à lire, et il a une vision assez juste de la société. ». C’est vrai qu’ « il y a une petite bibliothèque à la maison de retraite ». Il a donc du temps pour lire.
Le deuxième repas qu’ils partagent se passe chez le fils. D’abord en silence, au point que Jed s’assoupit. Et puis soudain : « Jed se figea. Ça y est, se dit-il. Ça y est, nous y voilà ; après des années, il va parler. » Cela ne viendra pas tout de suite, mais le père se met à parler. De lui, de son histoire, du choix de l’architecture, de l’organisation sociale, de la mère et de William Morris, le peintre d’un seul tableau (La Reine Guenièvre), de genre préraphaélite. Aussi architecte. Une belle scène, économe de moyens. Jean-Pierre Martin est malade, il le sait. Cette conversation lui tient donc lieu de testament, de chaîne de transmission, avant sa disparition prochaine. Et le fils recueille ce legs avec une grande attention.
Eh bien voilà. C’est La Carte et le territoire, écrit par Michel Houellebecq, écrivain.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, llittérature, michel houellebecq, france, la carte et le territoire, jeff koons, damien hirst, art contemporain, philippe muray, festivus festivus, guide michelinle corbusier, bill gates, steve jobs, art press
jeudi, 17 janvier 2019
HOUELLEBECQ
Je recycle aujourd'hui, en une seule fois, deux billets écrits en 2011 sur deux livres de Michel Houellebecq, au moment où je venais enfin de comprendre, grâce à La Carte et le territoire, l'importance de ses romans. Pourquoi "importance" ? Après tout ce temps, je crois y voir une figuration assez exacte de ce qui achemine la civilisation occidentale vers sa déchéance actuelle et sa destruction prochaine. Le système communiste a implosé, comme on sait, c'est-à-dire qu'il s'est effondré de l'intérieur, sous le poids de sa propre sénilité. Et je me demande si le même destin ne guette pas le système capitaliste, aujourd'hui encore tout fringant et triomphant, mais travaillé de l'intérieur par des forces que nul n'est capable de comprendre dans leur globalité et leurs interactions. J'ai beaucoup élagué tout ce qui m'est apparu superflu à la relecture (digressions, etc). J'ai laissé tout le reste. Je dois reconnaître que je n'ai guère développé le commentaire sur Plateforme. Un signe ? Mais de quoi ?


J’ai mis beaucoup de temps avant d’ouvrir un livre de Michel Houellebecq. Ce qui me repoussait, je crois l’avoir dit ici, c’est la controverse : il y a quelque chose de si futilement médiatique dans la présence éphémère du parfum de quelques noms dans l’air du temps, que je tenais celui-ci pour tout à fait artificiel, voire carrément illusoire, comme c’est le cas de la plupart des effervescences télévisuelles. Je suis devenu excessivement méfiant. En l’occurrence, j’avais tort.
J’ai donc commencé la lecture de Michel Houellebecq quand son dernier roman, La Carte et le territoire, fut placé, un peu par hasard, à proximité immédiate de ma main. J’ai dit grand bien du livre dans ce blog. J’en ai maintenant accroché deux autres à mon tableau de chasse : Les Particules élémentaires et Plateforme. Conclusion, vous allez me demander ? Voilà : je ne sais pas si on a à faire à un « grand » écrivain, je ne sais pas si ce sont des « chefs d’œuvre », comme les critiques patentés en décèlent à foison au fil des semaines. Je veux juste dire que ce sont des livres qui se situent au centre du paysage, pour qui espère comprendre quelque chose à la marche du monde actuel.
Donc, je ne sais pas si Michel Houellebecq est le digne successeur de Balzac et Proust. Ce que je sais, c’est qu’il travaille sur le monde qu’il a sous les yeux, qu’il dit quelque chose du monde tel qu’il est, et qu’il développe sur celui-ci un point de vue, une analyse, une proposition d’éclairage précise, une grille de lecture, si l’on veut.
C’est un romancier qui a pris position par rapport à la « civilisation occidentale », et qui a ceci de bien, s’il parle de lui, de le faire à distance respectable, hors de portée de tir de son propre nombril (malgré les apparences) et des ravages courants que celui-ci commet dans les rangs des « écrivains » français.
On peut trouver le point de vue développé par Michel Houellebecq d’une noirceur exécrable : pour résumer, grâce à la civilisation actuelle, exportée par l’Europe, moulinée avec la sauce techniquante, massifiante et consommante de l’Amérique triomphante, le monde actuel court à sa perte et, d’une certaine façon, est déjà perdu.
L’auteur met-il pour autant ses pas dans ceux de Philippe Muray, comme je l’ai suggéré ? Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que Philippe Muray a développé dès les années 1980 un regard analogue sur la réalité, d’une acuité de plus en plus grande, et un regard de plus en plus pessimiste.
Avant lui, plusieurs auteurs se sont inquiétés de l’évolution de notre monde : Günther Anders (L’Obsolescence de l’homme), Lewis Mumford (Les Transformations de l’homme), Hannah Arendt (La Crise de la culture), Christopher Lasch (La Culture du narcissisme), Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique), Guy Debord (La Société du spectacle), et quelques autres.
Pardon pour l’étalage, mais c’est parce qu’il y a un peu de tous ces regards dans les romans de Michel Houellebecq, tout au moins les trois que j’ai lus (publiés en 1998, 2001 et 2010, ce qui révèle quand même une certaine constance). La « patte » de Philippe Muray, c’est l’attention portée à un aspect particulier de la crise moderne : l’humanité est devenue peu à peu superflue, submergée par des objets techniques, des gadgets qui sont devenus pour elle si « naturels », mais en même temps si dominateurs, qu’elle est progressivement devenue une vulgaire prothèse de ses propres inventions. Philippe Muray le synthétise dans la notion de fête, dans l’abolition de tout ce qui permettait la différenciation (en particulier entre les sexes), dans le nivellement de toutes les « valeurs », et dans l'instauration unilatérale du règne de la positivité en tout, autrement dit de l'Empire du Bien (un des titres des Essais, éd. Les Belles lettres, 1991).
Les Particules élémentaires est un roman qui raconte quelle histoire, en fin de compte ? Janine Ceccaldi, une fille aux capacités intellectuelles hors du commun, épouse Serge Clément, qui entrevoit déjà (on est dans les années 1950) les immenses possibilités de la chirurgie esthétique. Puis elle rencontre Marc Djerzinski, homme talentueux qui œuvre dans le cinéma. Elle divorce pour l’épouser. De ces deux unions naîtront deux demi-frères : Bruno Clément et Michel Djerzinski.
Il y a donc l’histoire de Janine en pointillé. L’histoire d’Annabelle, qui a failli vivre une « belle histoire d’amour » avec Michel. L’histoire des ratages de Bruno qui, en compagnie de Christiane ou sans elle, hantera divers lieux où il espère connaître quelque aventure sexuelle.
A travers le personnage un peu pathétique de Janine, la mère, qui se fait appeler Jane, se formule une description somme toute caustique de l’ère baba-cool : délaissant les deux pères de ses enfants (et ses deux enfants par la même occasion), elle suit un genre de gourou, Francesco Di Meola, qui, s’étant fait pas mal d’argent, abandonne la Californie et Big Sur, où il a rencontré les dieux et les diables de la contre-culture, y compris l’imposteur Carlos Castaneda, celui qui était entiché de son sorcier yaqui, Don Juan Matus, dont il vendit les bobards à des millions d’exemplaires (mais ça, ce n’est pas dans le livre de Michel Houellebecq). Di Meola achète une propriété en Provence.
Janine-Jane (la mère) a baigné dans le jus contre-culturel, mais ce jus a tourné, ou alors il a aigri. Le bilan de son existence est « nettement plus catastrophique ». Et la mère des deux frangins aura une triste fin, dans une maison du village de Saorge, où vivent encore quelques illuminés post-soixante-huitards, dont « Hippie-le-Gris » et « Hippie-le-Noir », que Bruno appelle Ducon.
La scène est curieuse. Bruno est sous traitement de lithium pour raisons psychiatriques.
« Michel observa la créature brunâtre, tassée au fond de son lit, qui les suivit du regard alors qu’ils pénétraient dans la pièce. » Quant à Bruno, tout ce qu’il arrive à dire : « Tu n’es qu’une vieille pute… émit-il d’un ton didactique. Tu mérites de crever. ». « T’as voulu être incinérée ? Poursuivit Bruno avec verve. A la bonne heure, tu seras incinérée. Je mettrai ce qui restera de toi dans un pot, et tous les matins, au réveil, je pisserai sur tes cendres. »
Il y a souvent des problèmes, chez Michel Houellebecq, avec la transmission et avec la filiation. Un moment vaguement hallucinant, où Bruno se met à entonner à pleine voix "Elle va mourir la mamma", tout en insultant à qui mieux-mieux les hippies qui, d'après le testament maternel, vont hériter de la maison.
Face à Bruno, qui débloque sévèrement, le littéraire raté et hors du coup, Michel Houellebecq fait de Michel, en dehors d’un errant affectif quasiment indifférent à tout ce qui est humain, un biologiste à la pointe du « progrès », disons-le, une sorte de génie : son « testament » de chercheur s’intitule Prolégomènes à la réplication parfaite. Michel ne veut pas être emmerdé par les tribulations humaines ordinaires. Peut-être est-ce ce qui guide ses recherches.
Car ce testament s'avère porteur de tout l'avenir scientifique de l'humanité. Chacune de ses propositions révolutionnaires en sera plus tard dûment et scientifiquement prouvée. Autrement dit, le point culminant de son travail ouvre la voie à l’admission du clonage humain comme fondement institutionnel de l’humanité, ce qui débarrasse l'ancienne humanité (la nôtre) de tout le poids sentimental qui l'écrase.
Le livre évoque, depuis un moment du futur, l’extinction de la vieille race humaine. « On est même surpris de voir avec quelle douceur, quelle résignation, et peut-être quel secret soulagement les humains ont consenti à leur propre disparition. » [16 janvier : cela me fait penser à Soumission et à l'évidence tranquille avec laquelle l'islam s'impose en France en 2022.] On perçoit en positif cette post-humanité, qui adresse in fine sa gratitude à l’humanité archaïque : « Cette espèce aussi qui, pour la première fois de l’histoire du monde, sut envisager la possibilité de son propre dépassement ; et qui, quelques années plus tard, sut mettre ce dépassement en pratique ».
On est alors quelque part, dans ce regard rétrospectif, à la fin du 21ème siècle. Et la post-humanité rend alors hommage à l’humanité (la nôtre), qui fut si défectueuse, mais si touchante aussi. Glaçant, et très fort. Quand on ferme le livre, on se prend à espérer que c’est de la science-fiction. Mais ce n’est pas sûr.
La Carte et le territoire offrait une perspective analogue sur la disparition programmée de l’humanité, à travers l’œuvre en mouvement de Jed Martin, présenté comme un grand artiste de son temps. Plateforme nous plonge dans la décadence sexuelle de l'Occident en général et de l’Europe vieillissante en particulier. Le personnage principal, qui se nomme là encore Michel, est un obscur fonctionnaire aux Affaires Culturelles, un statut social négligeable. Au début du livre, Michel, qui vient de perdre son père, participe à un voyage organisé en Thaïlande. Il passe bien sûr par des « salons de massage ». Valérie fait partie du groupe, un groupe triste, hétérogène, et bête, avec ça !
Revenu à Paris, il démarre une relation vraiment amoureuse avec Valérie, qui travaille dans une entreprise de tourisme, sous la direction de Jean-Yves. Lui et Valérie, professionnellement, sont complémentaires. Ils gagnent confortablement leur vie. Une opportunité les propulse à la tête des villages Eldorador.
C’est dans un village de Cuba que Michel suggère à Jean-Yves, pour rétablir la situation de la société, de faire de ses villages des destinations pour un tourisme, disons … « de charme ». Tout se goupille à merveille, et l’entreprise est florissante, mais ces salauds d’islamistes feront tout capoter, avec à la clé l’insurrection de tout le féminisme français contre l’esclavage dégradant et le tourisme sexuel.
C’est sûr, l’humanité de Michel Houellebecq n’est pas belle à voir. Au fond, autant vaut qu’elle disparaisse, n’est-ce pas ? J'ai l'impression que les romans de Michel Houellebecq sont des applications romanesques pratiques de la pensée de Günther Anders (L'obsolescence de l'homme), de Hannah Arendt et de Guy Debord. Et le pire, c'est que ces romans paraissent être à peine de la science-fiction. Ce sont, et c'est Philippe Muray qui le dit à propos des Particules élémentaires, des romans de la fin. Très juste.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, les particules élémentaires, plateforme, la carte et le territoire, günther anders, l'obsolescence de l'homme, hannah arendt, la crise de la culture, christopher lasch, la culture du narcissisme, jacques ellul, guy debord, la société du spectacle, philippe muray, festivus festivus, l'empire du bien
mardi, 08 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 3/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
3/9
De l'importance de la lecture.
Ce qui est sûr, c’est que l’art contemporain, la musique contemporaine, la poésie contemporaine (en ai-je bouffé, des manuscrits indigestes, futiles, vaporeux ou dérisoires, au comité de lecture où je siégeais !), tout cela est tombé de moi comme autant de peaux mortes. De ce naufrage, ont surnagé les œuvres de quelques peintres, de rares compositeurs, d’une poignée de poètes élus. Comme un rat qui veut sauver sa peau, j’ai quitté le navire ultramoderne. J'ai déserté les avant-gardes. C’est d’un autre rivage que je me suis mis à regarder ce Titanic culturel qui s’enfonçait toujours plus loin dans des eaux de plus en plus imbuvables.
Comment expliquer ce revirement brutal ? Bien malin qui le dira. Pour mon compte, j’ai encore du mal. Je cherche. Le vrai de la chose, je crois, est qu’un beau jour, j'ai dû me poser la grande question : je me suis demandé pourquoi, tout bien considéré, je me sentais obligé de m’intéresser à tout ce qui se faisait de nouveau.
Mais surtout, le vrai du vrai de la chose, c’est que j’ai fait (bien tardivement) quelques lectures qui ont arraché les peaux de saucisson qui me couvraient les yeux quand je regardais les acquis du 20ème siècle comme autant de conquêtes victorieuses et de promesses d'avenir radieux. J’ai fini par mettre bout à bout un riche ensemble homogène d’événements, de situations, de manifestations, d’analyses allant tous dans le même sens : un désastre généralisé. C’est alors que le tableau de ce même siècle m’est apparu dans toute la cohérence compacte de son horreur, depuis la guerre de 14-18 jusqu’à l’exploitation et à la consommation effrénées des hommes et de la planète, jusqu'à l’humanité transformée en marchandises, en passant par quelques bombes, quelques génocides, quelques empoisonnements industriels.
 Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
A tort ou à raison, j’ai conclu de cette lecture décisive qu’Hitler et Staline, loin d’être les épouvantails, les effigies monstrueuses et retranchées de l’humanité normale qui en ont été dessinées, n’ont fait que pousser à bout la logique à la fois rationnelle et délirante du monde dans lequel ils vivaient pour la plier au fantasme dément de leur toute-puissance. Hitler et Staline, loin d’être des monstres à jamais hors de l’humanité, furent des hommes ordinaires (la « Banalité du Mal » dont parle Hannah Arendt à propos du procès Eichmann). Il n'y a pas de pommes s'il n'y a pas de pommier. Ils se contentèrent de pousser jusqu’à l’absurde et jusqu’à la terreur la logique d’un système sur lequel repose, encore et toujours, le monde dans lequel nous vivons.
Hitler et Staline (Pol Pot, …) ne sont pas des exceptions ou des aberrations : ils sont des points d’aboutissement. Et le monde actuel, muni de toutes ses machines d’influence et de propagande, loin de se démarquer radicalement de ces systèmes honnis qu’il lui est arrivé de qualifier d’ « Empire du Mal », en est une continuation qui n’a eu pour talent que de rendre l’horreur indolore, invisible et, pour certains, souhaitable.
Un exemple ? L’élimination à la naissance des nouveau-nés mal formés : Hitler, qui voulait refabriquer une race pure, appelait ça l’eugénisme. Les « civilisés » que nous sommes sont convenus que c’était une horreur absolue. Et pourtant, pour eux (pour nous), c’est devenu évident et « naturel ». C’est juste devenu un « bienfait » de la technique : permettre de les éliminer en les empêchant de naître, ce qui revient strictement au même. C’est ainsi que, dans quelques pays où la naissance d’une fille est une calamité, l’échographie prénatale a impunément semé ses ravages.
 D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système
D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
Je citerai une troisième facette de ladite évolution : une réflexion tirée d’ouvrages d’économistes, parmi lesquels ceux du regretté Bernard Maris (à  commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
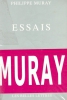 J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
Mais je dois reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
 Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude
Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
L'Histoire (le Pouvoir, la Politique), la Technique, l'Economie, donc : la trinité qui fait peur.
Restent les Lumières originelles : étonnamment et bien que je ne sache pas si le résultat est très cohérent, au profond de moi, elles résistent encore et toujours à l'envahisseur. Sans doute parce qu'en elles je vois encore de l'espoir et du possible.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, avant-garde, titanic, hannah arendt, les origines du totalitarisme, nazisme, staline, hitler, totalitarisme, stalinisme, banalité du mal, jacques ellul, le système technicien, le bluff technologique, günther anders, l'obsolescence de l'homme, bernard maris, charlie hebdo, antimanuel d'économie, jean-marc sylvestre, ultralibéralisme, philippe muray, l'empire du bien, exorcismes spirituels, éditions les belles lettres, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, une paire de bottes vaut shakespeare, éditions gallimard, george orwell essais articles lettres, jean-claude michéa, l'enseignement de l'ignorance, le moi assiégé, christopher lasch, la culture du narcissisme, michel houellebecq, la carte et le territoire, éditions l'encyclopédie des nuisances
lundi, 06 avril 2015
LA POSSIBILITÉ D’UNE ÎLE 1
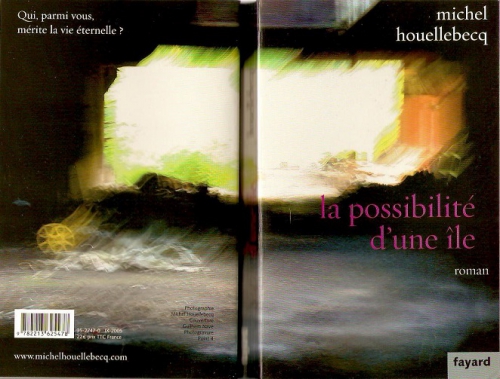
La photo de couverture est de Michel Houellebecq.
1/2
Houellebecq, je m’y suis mis tout récemment. J’étais rebuté par, pour le dire vite, le « battage médiatique » qui entourait la parution de chaque roman : deux camps s’affrontaient, parfois en paroles « musclées ». Tout ce bruit et cette fureur me paraissaient de mauvais augure. Je voyais dans ces affrontements je ne sais quel goût de l’auteur pour le monde « spectaculaire-marchand » et le feu des projecteurs. Je croyais que le fonds de commerce de l'écrivain « controversé » consistait à épater la galerie. J’avais tort.
Si les projecteurs se sont braqués sur Michel Houellebecq, la personne de l’auteur n’y est pour rien, mais bien ses livres. Que la personne, ensuite, se soit prise au jeu, c’est possible. Je le dis nettement : de cela, je me fous désormais éperdument.
C’est en voulant en avoir le cœur net que j’ai lu La Carte et le territoire (2010). C’était à l’été 2011 : mieux vaut tard que jamais. Ce fut immédiat, jubilatoire et lumineux : un très grand livre, d’un grand écrivain français. Enfin un roman qui parle du monde comme je le perçois, tellement malade. L’écrivain majeur de notre temps, loin devant tous les autres. Du coup, j’ai aligné dans la foulée Les Particules élémentaires (1998) et Plateforme (2001). Extension du domaine de la lutte (1994) a suivi à quelque temps de là. Inutile d’ajouter que le 6 janvier dernier, voyant Soumission sur un étal de librairie, je n’ai fait ni une ni deux (voir mon billet du 16 janvier).
Un sixième roman manquait à mon tableau de chasse : La Possibilité d’une île (2005). Dix ans après parution, je viens de corriger cet oubli impardonnable. C’est un gros livre (près de 500 pages). Je n’ai pas été déçu. D’une certaine façon, il est annoncé dès Les Particules …, et certains de ses passages annoncent étonnamment Soumission. On se rappelle que les travaux du savant Michel Djerzinski, à la fin des Particules …, rendent possible le clonage reproductif des humains.
Le « dispositif narratif » dépayse tout d’abord le lecteur : qui est Daniel24 ? Sur quoi fait-il un « commentaire » ? Et puis qui est ce Daniel1, qui semble contredire le titre de la 1ère partie ? Cela surprend, mais on s’y fait vite. Le livre est ambitieux, peut-être plus difficile d’accès, à cause tant du dit dispositif faisant alterner le « récit de vie » de Daniel1 et le « commentaire » de Daniel24 (puis Daniel25), que du thème ici exploré, qui tourne autour de la déception amère que procure l’existence humaine et de la quête d’immortalité qu’elle suscite.
On ne tarde pas à comprendre que Daniel24, plus tard Daniel25, est l’exacte réplique, à deux millénaires de distance, de Daniel1 : le clonage imaginé par Djerzinski dans les Particules … a permis la création d’une nouvelle espèce : les « néo-humains », qui n’a rien à voir avec l’ancienne humanité, dont les survivants de la grande extermination sont très vite retournés à l’état sauvage, primitif, rudimentaire.
Daniel1 a fait fortune en faisant le clown : les sketches comiques et scénarios, dont il faisait le clou de ses spectacles et de ses films avec un succès retentissant, portaient des titres comme « Broute-moi la bande de Gaza », « Deux mouches plus tard », « Le combat des minuscules », « On préfère les partouzeuses palestiniennes », et d’autres tout aussi suggestifs. Plus il provoquait, plus le succès grandissait.
Le choix du métier d'humoriste pour son personnage n'est certainement pas, de la part de Houellebecq, dû au hasard. On pensera aujourd’hui, bien sûr, à Dieudonné, mais il n’avait pas autant fait parler de lui en 2005. Rien de mieux qu'un « humoriste professionnel » pour mettre en scène la dérive subie dans notre monde par la fonction accordée au rire. Je pense au rôle purement instrumental que les médias de masse assignent aujourd’hui à l'hilarité. Rien de plus lugubre à mon avis que ces fantoches pas drôles, payés pour déclencher les rires, toujours mécaniques, même quand ils ne sont pas enregistrés.
Car avec les titres ci-dessus, Houellebecq met sur la scène romanesque une provocation à l’état pur, qui ricoche curieusement sur l’état actuel du comique médiatique entretenu à heure fixe par tout un tas de sinistres individus qui sévissent sur les plateaux pour « animer » des émissions et faire rire un public d’avance acquis à « la cause du rire ».
La grève à Radio-France m’a incidemment amené, consterné, à écouter, catastrophé, RTL : rien par exemple de plus ridicule que ces gens, réunis autour de la table d’un petit studio, qui font semblant de se tenir les côtes en écoutant les calamiteuses prestations routinières de Laurent Gerra. Atterré, j'ai tourné le bouton (vu les appareils actuels, c'est une image).
Le plus inquiétant est que les gens plébiscitent et redemandent de cette soupe. Sans doute pour ça qu’il y a des écoles pour la formation des désespérants « Nouveaux Comiques ». Je suis à côté de la plaque. Pas de ce monde-là. J’espère ne pas être le seul à crier grâce. Rien de plus lassant que ce métier de faire rire pour faire rire (décompresser, déstresser, soupape de sûreté, …). Coluche (pas toujours) et Desproges, eux, avaient un regard sur le monde et les gens.
Le rire est désormais un produit de consommation de masse, comme les autres compartiments de l’existence humaine, qui semblaient jusqu’il y a peu protégés par une cloison qui leur donnait l’aspect d’un vague mystère philosophique, quelque part entre le politique, le social et le médical. Etant entendu, chez les bien-pensants, je veux dire les fidèles qui se massent autour des prêtres, dans l’Eglise de l’Empire du Bien (comment pourrait-on se passer de Philippe Muray ?), qu’on peut rire de tout, sauf (suit la liste des gaz hilarants interdits à la vente).
Daniel1 est finalement un cynique exacerbé : « Finalement, le plus grand bénéfice du métier d'humoriste, et plus généralement de l'attitude humoristique dans la vie, c'est de pouvoir se comporter comme un salaud en toute impunité, et même de grassement rentabiliser son abjection, en succès sexuels comme en numéraire, le tout avec l'approbation générale » (p. 23). J'approuve vivement le mot "abjection".
Daniel1, dans le genre, se présente comme un désespéré fataliste, même si tout le monde lui reconnaît un talent indéniable. A se demander si La Possibilité d'une île n'a pas donné quelques idées à Dieudonné. Le livre ne s'est toutefois pas assez vendu pour cela. Combien d'exemplaires aurait-il fallu qu'il s'en écoule pour qu'on en finisse radicalement avec le métier d'humoriste ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, la possibilité d'une île, la carte et le territoire, les particules élémentaires, plateforme, extension du domaine de la lutte, houellebecq soumission, grève radio france, mathieu gallet, fleur pellerin, rtl, laurent gerra, coluche, pierre desproges, philippe muray, l'emppire du bien, bien-pensants, dieudonné, humoristes
samedi, 04 avril 2015
HOUELLEBECQ PAR NOGUEZ
2/2
 Alors maintenant, à part ça, le bouquin de Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, vous me direz ? Deux ingrédients : des pages d'un journal et des réflexions sur l'œuvre. D’abord les pages concernant Michel Houellebecq, extraites du journal tenu par l’auteur de 1991 à 2003, entrelardées de textes écrits par l’auteur pour la défense de l’écrivain, envoyés aux médias ou destinés au tribunal. Des lettres aussi qu'il lui a adressées. Ensuite, deux études : l’une sur le style houellebecquien, l’autre intitulée « Michel Houellebecq est-il réactionnaire ? ». En gros, quatre parties.
Alors maintenant, à part ça, le bouquin de Dominique Noguez, Houellebecq, en fait, vous me direz ? Deux ingrédients : des pages d'un journal et des réflexions sur l'œuvre. D’abord les pages concernant Michel Houellebecq, extraites du journal tenu par l’auteur de 1991 à 2003, entrelardées de textes écrits par l’auteur pour la défense de l’écrivain, envoyés aux médias ou destinés au tribunal. Des lettres aussi qu'il lui a adressées. Ensuite, deux études : l’une sur le style houellebecquien, l’autre intitulée « Michel Houellebecq est-il réactionnaire ? ». En gros, quatre parties.
Disons-le, l’étude du style m’est tombée des mains : un relevé énumératif consciencieux des tournures, formules, termes favoris de l’écrivain. Même si tout est juste et bien observé, c’est tout à fait indigeste, comme un découpage de cadavre à la morgue. Que celui qui est allé à l'école lise ! Comme l'écrit Alfred Jarry dans le "Linteau" des Minutes ... (qui, j'imagine, n'a pas de secret pour Noguez) : « ... car il n'y a qu'à regarder, et c'est écrit dessus ».
L’étude sur le « réactionnaire » supposé est en revanche intéressante, montrant que le concept est brumeux et marécageux à souhait, et qu'il fonctionne comme certains bars, où l'on signale au client : « Ici on peut apporter son manger ». Noguez donne trois ou quatre listes de gens peu recommandables, qualifiés successivement de « réactionnaires » par Daniel Lindenberg (Le Rappel à l'ordre) et quelques autres après lui : certains voisinages sont pour le moins étranges ou inattendus. Si "réactionnaire" est un concept, ce qui n'est pas sûr, il est singulièrement élastique, plastique et déformable dans toutes les sauces idéologiques. Pour autant, l’analyse est-elle efficace ? Peut-elle servir à quelque chose ? Pas sûr.
Les « éléments » du langage mouliné en permanence par les médias privatisés (qui ont contaminé les chaînes publiques, que plus grand-chose n'en distingue) se moque allègrement de ce qu’on appelait autrefois la « justesse des termes » (cela s’appelle aussi la « rigueur intellectuelle »). Le média spectaculaire régnant (la télévision) se contente de la vitesse et de l'éclat de l’expression, au mépris de son poids, de son exactitude et de sa profondeur. La catastrophe « Philippe Sollers » a triomphé. Briller est un impératif.
Je crois, monsieur Noguez, qu’il ne sert à rien de définir le mot « réactionnaire » : tout le monde s’en fout. Son rôle est de servir de flash (de piquouse), d’étiquette, d’identifiant immédiat, de blason, d'étendard, voire de mot de passe. Bientôt peut-être de lieu de détention.
C’est la tâche de purification lexicale assignée par les tenants de la nouvelle « bien-pensance » (p. 252) à quelques projectiles fabriqués spécialement à l'intention des survivants de l’esprit critique et de la liberté de penser (qu’il suffit, pour les disqualifier, de désigner « facho », « macho », « réac », « sexiste », « homophobe », et j’en passe). S’attarder sur le contour du mot « réactionnaire », je vais vous dire, c’est du temps perdu. Dans un duel arme au poing, l’explication rationnelle et argumentée est programmée pour échouer.
Dominique Noguez est écrivain. Je n’en doute pas. Pas plus qu’il ne doute des qualités de son livre Les Derniers jours du monde. Je dirai ce que j’en pense quand je l’aurai lu. Mais, comme Daniel1, le personnage de La Possibilité d’une île, il est foncièrement honnête (bien que j'ignore l'extension sémantique exacte du mot "foncièrement" dans ce contexte) où on lit : « ... j'étais, par rapport aux normes en usage dans l'humanité, d'une honnêteté presque incroyable » (p. 400), phrase qui sonne a posteriori comme une déclaration de théorie littéraire.
Car Houellebecq lui-même est honnête, en ce que ses livres ne se racontent pas d'histoire. Etonnant comme ses fictions romanesques semblent porteuses d'une vérité très nue, presque écorchée (peut-être ce qui le rend insupportable aux yeux de beaucoup). Houellebecq déclare ainsi à Frédéric Martel : « Je connais les réponses simples, celles qui vous font aimer de tous (…) ; si je ne les emploie pas ce n’est pas par provocation, mais par honnêteté » (cité p. 252). Noguez est donc honnête : il reconnaît que Houellebecq est un plus grand écrivain que lui. Il n’est pas jaloux. Il a au moins ce mérite, et cela m’incite à aller y voir de plus près.
Il écrit d’un roman de M. H. (Extension du domaine de la lutte) : « Après trois lectures, je tiens que ce roman est un des plus grands d’aujourd’hui. Je dis bien "d’aujourd’hui". Je n’en vois pas en effet qui disent mieux un certain nouvel air du temps – du temps social et économique – que celui-là » (pp. 29-30). Il écrit ça en 1994, c’est-à-dire avant Les Particules élémentaires, avant La Carte et le territoire. Je regrette quant à moi de l’avoir lu après ces deux livres, beaucoup plus forts et accomplis, auprès desquels Extension … fait un peu pâle figure, tout en tenant fort bien son rang : l’univers maintenant bien connu de l’auteur est déjà pleinement présent.
Noguez, tenant son journal, montre donc qu'il est intervenu en faveur de Michel Houellebecq, dans la presse comme critique, au tribunal comme témoin de la défense. Il lui écrit aussi des lettres, où il note ses impressions de lecture, par exemple sur Les Particules ….
Le procès intenté contre l’auteur de ce roman à parution ajoute au ridicule du motif le contradictoire de la chose : un directeur réclamant l’anonymat pour le camping qu’il dirige reproche à M. H. de donner des informations qui permettent de le reconnaître et situer. Evidemment, l’action en justice donne une publicité énorme à ce qui serait resté inaperçu et cru fictif s'il avait fait le mort. Conclusion de Noguez : « Cela ressemble fort à une opération publicitaire faite sur le dos de la littérature » (p. 62). Auguste en personne aurait dit « tout juste ».
Le procès intenté par Dalil Boubakeur, de la grande mosquée de Paris, suite à la publication de Plateforme, est plus crucial et plus révélateur. Houellebecq islamophobe ? Et alors, quand bien même ? Ne pas aimer l'islam est un droit, que je ne me prive pas d'exercer pour mon propre compte, moi qui suis, de façon générale, religio-incompatible. Noguez écrit : « Avoir un avis sur les religions, préférer l’une à l’autre ou les rejeter toutes relève de la liberté d’expression la plus élémentaire dans une démocratie comme la nôtre » (p. 211). Je ne peux qu’approuver. J'irais même volontiers plus loin, jusqu'à paraphraser Lino Ventura dans Les Tontons, à propos de Claude Rich, le petit ami de sa protégée : « ... il commence à me les briser menu ».
Et Noguez de rappeler que M. H. n’est pas le premier à traiter l’islam de « religion la plus stupide », avec des citations de Montaigne, Pierre Charron, Pascal, Spinoza, Tocqueville, etc. (p. 210). Voltaire n’a-t-il pas écrit une pièce de théâtre intitulée Le Fanatisme ou Mahomet le Prophète ? Jusqu’au respectable Claude Lévi-Strauss qui y voit « une religion de corps de garde » (p. 211, ce que l’actualité nous confirme tous les jours).
Là où j'ai le grand plaisir de me retrouver en bonne compagnie, dans ce livre, c’est chaque fois que Dominique Noguez aborde la question de la « bien-pensance » et de l’ambiance policière qu’elle tend à instaurer dans le monde de la pensée, de la création et de l’expression, amalgamant sans sourciller des actes répréhensibles ou délinquants et des personnages éventuellement déviants, mais pures créatures fictives. Noguez se paie en passant Claire Brisset, la « Défenseure » (!) des enfants, « une folle avérée » (p. 176, mais il ne la nomme que trois pages plus loin – par prudence ? –, je précise que c’est moi qui interprète) : certaines formules font du bien, c’est sûr. Du coup, on se sent moins seul.
Là aussi où j’ai l’impression de trouver une « tribu » où je puisse me sentir un peu moins mal dans mon époque, c’est en apprenant que Dominique Noguez a donné une conférence intitulée « Le livre sans nom » (BNF, 15 décembre 1999), qu’il évoque dans la note 48 (p. 165) : « J’y donnais, comme explication de la multiplication actuelle des procès en matière de littérature, "l’immense privatisation de tout à laquelle on assiste depuis une douzaine d’années" dans les sociétés occidentales capitalistes ou, plus exactement, dans la manière dont elles se donnent à voir. "Tandis que la fiction romanesque semble saisie d’un appétit de plus en plus grand de réalité, ajoutais-je, la réalité qu’elle veut ingurgiter se privatise et se dérobe. Il n’y a plus de nature, il y a des propriétés privées ; plus de pays, mais des multinationales ; plus de ville, mais des chaînes de magasins et des marques ; plus de foule, mais des individus qui peuvent interdire ou monnayer leur image." (Publié dans La Nouvelle Revue Française n° 555, octobre 2000) ». Je salue l'expression "l'immense privatisation de tout". Les curieux peuvent se reporter à mon billet du 17 mars, où j'évoque « La Grande Privatisation de Tout » (GPT pour les intimes). Depuis la publication de Houellebecq, en fait, il y a douze ans, Noguez à dû pouvoir constater la nette aggravation du processus. Mais quand même, ça fait plaisir de se retrouver en pays de connaissance. Je me dis : chouette, encore un que Laurent Joffrin ne doit pas porter dans son cœur !
Tiens, à propos de Laurent Joffrin, voici ce qu’on lit p. 229, à propos d’un article sur « les nouveaux réactionnaires » : « Pour sa phrase sur l’islam, "l’excellent Laurent Joffrin", explique-t-il [il s'agit de Houellebecq], l’a traité dans Le Nouvel Observateur de "beauf lambda" ». J’imagine que la phrase en question est celle où il qualifie l’islam de « religion la plus stupide » (voir plus haut). Je renvoie à mes deux billets consacrés à ce monsieur. Houellebecq et Noguez doivent se dire, à la façon de Courteline : « Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté de fin gourmet ». Si j’étais à leur place, c’est en tout cas ce qui me viendrait à l’esprit. Avec délectation.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, michel houellebecq, dominique noguez, houellebecq en fait, réactionnaire, lindenberg les nouveaux réactionnaires, alfred jarry, minutes de sable mémorial, philippe sollers, les derniers jours du monde, la possibilité d'une île, frédéric martel, extension du doomaine de la lutte, les particules élémentaires, la carte et le territoire, dalil boubakeur, grande mosquée de paris, plateforme, voltaire, le fanatisme ou mahomet le prophète, islam, claude lévi-strauss, claire brisset, laurent joffrin, le nouvel observateur
mardi, 27 janvier 2015
CHRISTINE ANGOT A LA HAINE 3/?
3
Que dit-elle, la pauvre Christine Angot, de Michel Houellebecq ? Dès le début de son papier, on comprend que c’est très mal emmanché : « Quand on m’a proposé, fin décembre, d’écrire sur Houellebecq, je n’ai pas voulu. Je n’avais pas envie de m’intéresser à lui, il ne s’intéresse pas au réel, qui est caché, invisible, enfoui, mais à la réalité visible, qu’il interprète, en fonction de sa mélancolie et en faisant appel à nos pulsions morbides, et ça je n’aime pas ». Le « réel caché », apparemment, c’est le grand truc de l’existence de Christine Angot. Mais ça commence quand même par une énormité : apprendre que Houellebecq ne s'intéresse pas au réel, ça fait quand même un choc culturel.
Moi, ce que je n'ai pas compris, c’est ce qu’Angot met derrière le mot « réalité » : selon elle, est réel ce qui « est caché, invisible, enfoui ». Ah bon. Dès que je le vois, j'en parle à mon cheval. Notez que je ne dis pas que c’est faux. C’est une option. Mais ce qui suit est aussi un symptôme intéressant. J'en suis même à me demander si tout ce qu'écrit Christine Angot n'est pas à considérer, en soi et en bloc, comme un énorme symptôme. Non monsieur, je n'ai pas dit "furoncle".
En gros, elle reproche à Houellebecq de braquer son regard sur le monde qu’il a sous les yeux, mais avec de telles lunettes mélancoliques et morbides que l’image qu’il en restitue dans ses livres est fausse et haïssable. Ah bon. Je crois bien que c’est là que nos routes se séparent, madame. Je crois justement que Houellebecq figure parmi les auteurs qui ne font pas les autruches face aux menaces que le monde tel qu'il s'annonce fait peser sur l'avenir de l'humanité. Lui au moins, il propose un regard sur ce monde. Il ne se contente pas de manier sa touillette dans sa tasse en plastique devant la machine à café. Et le monde dont il parle est tout à fait « réel ».
Parce que, si j’ai bien compris Christine Angot (et je crois que j’ai bien compris), il ne faut pas se contenter de la réalité visible, il faut creuser cette matière dans l’espoir d’atteindre l’essence des choses. Enfin, ce ne sont pas ses termes : « Ce qu’il y a derrière la réalité visible, c’est le réel. Et le réel c’est nous. Mais c’est le nous qu’on ne voit pas ». Oui, j’ai peut-être mal traduit. Si je dis « l’essence des êtres », ça vous va ? Remarquez que ça ne change pas grand-chose : je ne sais toujours pas ce que c'est. Trop vaporeux pour moi. Nébuleux si vous préférez. Vous dites gazeux ? Pourquoi pas ?
Pour Angot, la littérature est le territoire sur lequel règne le tout-subjectif. Je l’ai dit, c’est une option, bien dans le vent de cette époque de narcissisme exacerbé (ah, la rage du « selfie » ! Même que Miss Israël a failli déclencher un incident diplomatique en faisant un « selfie » où figurait Miss Palestine). Christopher Lasch, au secours !
Et l’invisible, elle s’y accroche comme un morpion au poil de cul. Pour être franc, l'invisible selon Christine Angot, je n'ai pas réussi à en attraper le fil. L'invisible, je le pressens au contraire dans la fin des Particules élémentaires, dans la fin de La Carte et le territoire. Houellebecq sait, lui, ce que c'est que l'invisible. Contrairement à ce qu'elle affirme, Christine Angot ne connaît de la réalité que la plus extérieure pelure de la surface des choses. Elle n'a rien compris au monde dans lequel elle vit. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Le réel dont elle s'occupe est étriqué, plat.
Selon elle, il faut que le grand écrivain (grade académique auquel elle postule visiblement, mais ce n'est pas gagné) persévère, continue à faire descendre le seau dans le puits à sec. Et pour en remonter devinez quoi : « Le sentiment que l’être a de son humanité ». Démerdez-vous avec ça. Il faut que le grand écrivain poursuive obstinément sa quête.
Forcément, tôt ou tard, il tombera sur « un mini-indice qui n’était pas visible. Et ça Houellebecq ne le fait jamais. Non seulement il ne le fait jamais, mais il le détruit, il le raille. Il raille Mai 68, l’humanisme, l’antiracisme, la psychanalyse, les universitaires, ceux qui essayent de trouver quelque chose de la réalité, ceux qui se disent que l’humain ça doit exister, et pas besoin d’avoir recours à Dieu pour ça ». On commence à comprendre l'idéologie sous-jacente, bien qu'elle prenne soin de s'affubler d'un faux-nez. J’avoue que le « mini-indice » me semble une trouvaille délicieuse. Des esprits malveillants insinueraient sûrement que Christine Angot s’embête à « chercher la petite bête ».
Au fond, ce que Christine Angot reproche à Houellebecq, c’est de ne pas faire dans ses livres l’éloge de la bien-pensance telle qu’elle règne aujourd’hui sur les esprits. C’est de ne pas donner dans la littérature sans bec et sans griffes. De ne pas se résigner à donner dans la littérature embryonnaire, celle qui se contente d'inventorier les éléments de l'embryon. Elle lui reproche d'ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il va, de plus en plus terrible.
Elle lui en veut beaucoup, parce qu’il refuse de pratiquer cette littérature nombrilique qui ne risque pas d’écailler le verni du monde tel qu’il va, tel qu’il est en train d’écraser l’humanité. Houellebecq ne creuse pas dans l’impalpable fumeux de ses impressions évanescentes pour en tirer quelque « mini-indice » jusque-là indiscernable.
Il ne cherche pas la petite bête, lui. Il regarde le monde d'une façon pas gaie, c'est sûr. Le monde qu'il décrit est sans âme, sans but. Angot aura beau dire : il fait son métier. Un grand métier. Elle ne fait pas le même. L'un fait de la littérature. L'autre fait de la fumée avec le symptôme dont elle constitue un exemplaire exemplaire.
Elle ne peut pas lui pardonner d'être dans le vrai.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, christine angot, michel houellebecq, journal le monde, christopher lasch, les particules élémentaires, la carte et le territoire
mardi, 20 janvier 2015
HOUELLEBECQ PAR BERNARD MARIS
J’ai raconté ici les impressions de lecture que m’a procurées Soumission de Michel Houellebecq (16 janvier). J’ai trouvé ce livre formidable. Je ne suis pas le seul. Il se trouve que le dernier article de Bernard Maris publié dans Charlie Hebdo avant sa mort était sur le bouquin. Il en disait grand bien.
On me dira que oui, un ami, personne n'en dirait du mal. Peut-être. Mais il se trouve que les semelles des chaussures d'Oncle Bernard laissent sur le sol les mêmes traces que ma propre lecture. Ça ne pouvait pas mieux. J’ai trouvé le texte sur un site de l’Internet (je n'ai évidemment pas pu trouver en kiosque le numéro avec Houellebecq en couverture, le numéro fatidique). Voici ce qu'y écrivait Bernard Maris :
« La conversion de Michel.
Hollande achève deux mandats catastrophiques. Le parti de la Fraternité musulmane émerge, côte à côte avec le PS, et le FN va l’emporter. Le PS fait alliance avec la Fraternité musulmane, l’UDI et l’UMP pour faire barrage au FN. Mohamed Ben Abbes devient président de la République, et Bayrou Premier ministre. Mais le PS abandonne à la Fraternité musulmane le ministère qui lui revient de droit, l’Education nationale. Ben Abbes propose une charia modérée, doucement réactionnaire, avec un retour à la famille et à la femme au foyer, et une privatisation de l’enseignement qui convient tout à fait à tout le monde.
Il offre aussi une incroyable vision d’avenir : l’Empire romain ! Le limes, de la Bretagne au désert du Sahara, en passant par l’Italie, la Turquie, la Grèce et l’Espagne. Ben Abbes en Auguste ou Marc Aurèle (en futur président d’une Europe élargie à la mare nostrum). En France, le chômage s’effondre, la violence aussi. Les catholiques sont choyés. On attend paisiblement les conversions. Elles arrivent, et d’abord dans l’Université, particulièrement arrosée en termes d’argent … et où la polygamie se développe. Sous l’impulsion de Ben Abbes, les pays arabes francophones plus l’Egypte et le Liban adhèrent à l’Europe, et l’équilibre linguistique européen se déplace en faveur de la France. La France est à nouveau grande. La nouvelle Pax Romana règne. Fin de la fable.
C’est un pur chef-d’oeuvre houellebecquien, c’est-à-dire :
1) une projection futuriste extraordinaire et crédible, comme dans tous les romans précédents. Elle est doublée d’une question politique majeure : l’identité, la patrie, la nation (« née à Valmy, morte à Verdun ») peuvent-elles exister sans transcendance ? Non. Il faut la Vierge pour Péguy, l’Etre suprême pour Robespierre, ou Dieu pour Ben Abbes, qui veut redonner à la France l’âme qu’elle eut pendant mille deux cents ans, de Clovis aux Lumières.
2) Un personnage principal détruit, désemparé, dépressif, malheureux en amour par son incapacité à retenir une femme, mais qui renaît dans le pari d’une conversion raisonnée, une conversion pascalienne, associée à un mariage de raison. Car, thème éternel houellebecquien, tout homme peut être sauvé par l’amour (ainsi, le père du héros). Le nôtre, trop égoïste, trop occidental et bien incapable de trouver l’amour par lui-même, le croisera par des marieuses. La polygamie lui fournira les jeunettes pour le sexe et la quadra pour la cuisine.
3) Enfin, un style désormais parfait, de nombreuses digressions philosophiques – comme toujours – et un humour digne du maître omniprésent dans le roman (Huysmans ; on comprend a posteriori où Houellebecq a puisé son style et son humour).
Et la misogynie, le machisme ? Aucune importance, c’est un roman, pas plus machiste que Bel-Ami, plutôt moins. Et la raillerie implicite de l’islam ? Elle n’existe pas. « L’islam accepte le monde tel quel » : toute la différence avec le catholicisme, qui ne peut qu’engendrer frustration perpétuelle. Encore un magnifique roman. Encore un coup de maître.
Bernard Maris. »
C'est éminemment subjectif (quoique ...), ce n'est pas une analyse, c'est encore moins une exégèse, et nous n’avons pas le même argumentaire, Maris et moi. Mais la conclusion est la même : on ne peut prétendre comprendre l’époque actuelle si l’on n’a pas lu les romans de Michel Houellebecq. Désolé, oncle Bernard, pour l'économie, j'ai plus de mal. Et sincèrement désolé, Christine Angot, contrairement à ce que vous dites, c'est toujours le moment de chroniquer Houellebecq. Et maintenant plus que jamais.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : je signale que, à mon grand étonnement et contre toute attente, les « critiques littéraires » du Masque et la Plume ont tous volé au secours du soldat Houellebecq, le dimanche 18, assommé sous les bombes aussi bien de la réalité que du déchaînement de haine provoqué par son livre chez les tenants du chaos intellectuel et de la morale-consensuelle-envers-et-contre-tout (certains n'allant pas tout à fait mais presque jusqu'à lui faire endosser la responsabilité morale de la tuerie de Charlie Hebdo). Grâces soient donc rendues au Masque et à la Plume. Mais attention, une fois ne fait pas une coutume.
Les stipendiés de l'édition sous toutes ses formes se sont apparemment résignés à reconnaître que Houellebecq aujourd'hui écrase de toute la hauteur de sa classe balzacienne le marigot littéraire français, où quelques batraciens scribouilleurs s'époumonent à faire prendre leurs coassements pour des meuglements. Certains « bons esprits » vont même (ou font semblant) jusqu'à croire qu'ils font œuvre de littérature. Mais cette fois, la « critique » autorisée s'empresse au secours de la victoire. On aura tout vu. Que les grenouilles gonflées d'orgueil fassent cependant attention : « La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva ».
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature française, michel houellebecq, soumission, islam, les particules élémentaires, la possibilité d'une île, plateforme, la carte et le territoire, extension du domaine de la lutte, bernard maris, charlie hebdo, cabu, oncle bernard, christine angot, chroniquer houellebecq, le masque et la plume, jérôme garcin, terrorisme
lundi, 03 octobre 2011
TROIS HOUELLEBECQ SINON RIEN (2)
Suite et fin.
Les Particules élémentaires est un roman qui raconte quelle histoire, en fin de compte ? Janine Ceccaldi, une fille aux capacités intellectuelles hors du commun, épouse Serge Clément, qui entrevoit déjà (on est dans les années 1950) les immenses possibilités de la chirurgie esthétique. Puis elle rencontre Marc Djerzinski, homme talentueux qui œuvre dans le cinéma. Elle divorce pour l’épouser. De ces deux unions naîtront deux demi-frères : Bruno Clément et Michel Djerzinski.
Il y a donc l’histoire de Janine en pointillé. L’histoire d’Annabelle, qui a failli vivre une « belle histoire d’amour » avec Michel. L’histoire des ratages de Bruno qui, en compagnie de Christiane ou sans elle, hantera divers lieux où il espère connaître quelque aventure sexuelle.
A travers le personnage un peu pathétique de Janine, la mère, qui se fait appeler Jane, se formule une description somme toute caustique de l’ère baba-cool : délaissant les deux pères de ses enfants (et ses deux enfants par la même occasion), elle suit un genre de gourou, Francesco Di Meola, qui, s’étant fait pas mal d’argent, abandonne la Californie et Big Sur, où il a rencontré les dieux et les diables de la contre-culture, y compris l’imposteur CARLOS CASTANEDA, celui qui était entiché de son sorcier yaqui, DON JUAN MATUS, dont il vendit les probables bobards à des millions d’exemplaires (mais ça, ce n’est pas dans le livre de HOUELLEBECQ). Di Meola achète une propriété en Provence.
Janine-Jane (la mère) a baigné dans le jus contre-culturel, mais ce jus a tourné, ou alors il a aigri. Le bilan de son existence est « nettement plus catastrophique ». Et la mère des deux frangins aura une triste fin, dans une maison du village de Saorge, où vivent encore quelques illuminés post-soixante-huitards, dont « Hippie-le-Gris » et « Hippie-le-Noir », que Bruno appelle Ducon.
La scène est curieuse. Bruno est sous traitement de lithium pour raisons psychiatriques. Soit dit en passant, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il fut un temps où l'organiste titulaire de l'orgue de Saorge n'était autre que RENÉ SAORGIN, sans que les deux noms eussent quelque rapport que ce fût.
« Michel observa la créature brunâtre, tassée au fond de son lit, qui les suivit du regard alors qu’ils pénétraient dans la pièce. » Quant à Bruno, tout ce qu’il arrive à dire : « Tu n’es qu’une vieille pute… émit-il d’un ton didactique. Tu mérites de crever. ». « T’as voulu être incinérée ? Poursuivit Bruno avec verve. A la bonne heure, tu seras incinérée. Je mettrai ce qui restera de toi dans un pot, et tous les matins, au réveil, je pisserai sur tes cendres. »
Il y a souvent des problèmes, chez HOUELLEBECQ, avec la transmission et avec la filiation. Un moment vaguement hallucinant, où Bruno se met à entonner à pleine voix "Elle va mourir la mamma", tout en insultant à qui mieux-mieux les hippies qui, d'après le testament maternel, vont hériter de la maison.
Face à Bruno, qui débloque sévèrement, le littéraire raté et hors du coup, MICHEL HOUELLEBECQ fait de Michel, en dehors d’un errant affectif quasiment indifférent à tout ce qui est humain, un biologiste à la pointe du « progrès », disons-le, une sorte de génie : son « testament » de chercheur s’intitule Prolégomènes à la réplication parfaite. Michel ne veut pas être emmerdé par les tribulations humaines ordinaires. Peut-être est-ce ce qui guide ses recherches.
Car ce testament s'avère porteur de tout l'avenir scientifique de l'humanité. Chacune de ses propositions révolutionnaires en sera plus tard dûment et scientifiquement prouvée. Autrement dit, le point culminant de son travail ouvre la voie à l’admission du clonage humain comme fondement institutionnel de l’humanité, ce qui débarrasse l'ancienne humanité (la nôtre) de tout le poids sentimental qui l'écrase.
Le livre évoque, depuis un moment du futur, l’extinction de la vieille race humaine. « On est même surpris de voir avec quelle douceur, quelle résignation, et peut-être quel secret soulagement les humains ont consenti à leur propre disparition. » On perçoit en positif cette post-humanité, qui adresse in fine sa gratitude à l’humanité archaïque : « Cette espèce aussi qui, pour la première fois de l’histoire du monde, sut envisager la possibilité de son propre dépassement ; et qui, quelques années plus tard, sut mettre ce dépassement en pratique ».
On est alors quelque part, dans ce regard rétrospectif, à la fin du 21ème siècle. Et la post-humanité rend alors hommage à l’humanité (la nôtre), qui fut si défectueuse, mais si touchante aussi. Glaçant, et très fort. Quand on ferme le livre, on se prend à espérer que c’est de la science-fiction. Mais ce n’est pas sûr.
La Carte et le territoireoffrait une perspective analogue sur la disparition programmée de l’humanité, à travers l’œuvre en mouvement de Jed Martin, présenté comme un grand artiste de son temps. Plateforme nous plonge dans la décadence sexuelle de l’Europe vieillissante. Le personnage principal, qui se nomme là encore Michel, est un obscur fonctionnaire aux Affaires Culturelles, un statut social négligeable. Au début du livre, Michel, qui vient de perdre son père, participe à un voyage organisé en Thaïlande. Il passe bien sûr par des « salons de massage ». Valérie fait partie du groupe, un groupe triste, hétérogène, et bête, avec ça !
Revenu à Paris, il démarre une relation vraiment amoureuse avec Valérie, qui travaille dans une entreprise de tourisme, sous la direction de Jean-Yves. Lui et Valérie, professionnellement, sont complémentaires. Ils gagnent confortablement leur vie. Une opportunité les propulse à la tête des villages Eldorador.
C’est dans un village de Cuba que Michel suggère à Jean-Yves, pour rétablir la situation de la société, de faire de ses villages des destinations pour un tourisme, disons … « de charme ». Tout se goupille à merveille, et l’entreprise est florissante, mais ces salauds d’islamistes feront tout capoter, avec à la clé l’insurrection de tout le féminisme français contre l’esclavage dégradant et le tourisme sexuel.
C’est sûr, l’humanité de MICHEL HOUELLEBECQ n’est pas belle à voir. Au fond, autant vaut qu’elle disparaisse, n’est-ce pas ? J'ai l'impression que les romans de MICHEL HOUELLEBECQ sont des applications romanesques pratiques de la pensée de GÜNTER ANDERS (L'obsolescence de l'homme), de HANNAH ARENDT et de GUY DEBORD. Et le pire, c'est que ces romans paraissent être à peine de la science-fiction. Ce sont, et c'est PHILIPPE MURAY qui le dit à propos des Particules élémentaires, des ROMANS DE LA FIN.
09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel houellebecq, littérature, les particules élémentaires, la carte et le territoire, plateforme
dimanche, 02 octobre 2011
TROIS HOUELLEBECQ SINON RIEN
J’ai mis beaucoup de temps avant d’ouvrir un livre de MICHEL HOUELLEBECQ. Ce qui me repoussait, je crois l’avoir dit ici, c’est la controverse : il y a quelque chose de si futilement médiatique dans la présence éphémère du parfum de quelques noms dans l’air du temps, que je tenais celui-ci pour tout à fait artificiel, voire carrément faux et illusoire, comme c’est le cas de la plupart des effervescences télévisuelles et autres. Je suis devenu excessivement méfiant. En l’occurrence, j’avais tort.
J’ai donc commencé la lecture de MICHEL HOUELLEBECQ quand son dernier roman, La Carte et le territoire, fut placé, un peu par hasard, à proximité immédiate de ma main. J’ai dit grand bien du livre dans ce blog. J’en ai maintenant accroché deux autres à mon tableau de chasse : Les Particules élémentaires et Plateforme. Conclusion, vous allez me demander ? Voilà : je ne sais pas si on a à faire à un « grand » écrivain, je ne sais pas si ce sont des « chefs d’œuvre ». Je peux dire que ce sont des livres qui comptent, et des livres qui sont plutôt du grain que de la balle, si l’image peut encore être comprise.
Je lui ferai un reproche, cependant : la place quasi-nulle qu’il fait à la musique. Et ce n’est pas le « Et allons-y pour les quintettes de Bartok… » (Particules, p. 157) qui me fera changer d’avis, d’autant plus que, si BELA BARTOK a écrit six quatuors à cordes, je ne sache pas qu’il ait composé autre chose qu’un quintette avec piano.
Des « grands » écrivains comme s’il en pleuvait, des cataractes de « chefs d’œuvre », c’est le quotidien de la rubrique « culture » des magazines, des revues spécialisées type Le Magazine littéraire, ou du supplément « livres » d’un « grand quotidien du soir ». C’est une surabondance de productions « indispensables », d’oeuvres « incontournables ».
Moi je vais vous dire, de deux choses l’une : ou bien il règne une immense complaisance, voire une veulerie démesurée, au sein du milieu sinistré, ce milieu sinistré que l’on n’appelle plus que par complaisance la « critique littéraire », genre « Le Masque et la plume » ; ou bien ces soi-disant « critiques » sont totalement incompétents, et n’ont plus qu’une idée très approximative de ce qu’est le littéraire. « Critiques littéraires » : quand j’entends cette expression, je pouffe, je me gausse, que dis-je : je m’esclaffe. Voilà : ils sont soit complaisants, soit incompétents, peut-être même les deux, mon général.
Le Monde des livres n’échappe pas à la règle, qui fait, en général et sauf exception, de ses papiers « critiques » de simples prospectus de promotion publicitaire au service d’un copain, ou de quelqu’un à qui on doit quelque chose, ou à qui on a l’intention de demander quelque chose, dans le jeu bien connu du « renvoi d’ascenseur ». Les lycéens appellent cette catégorie de premier de la classe « lèche-cul » (mais suspect est encore plus sale, si on décompose, essayez). Le bocal « littéraire », spécialement français, a quelque chose d’assez répugnant.
Donc, je ne sais pas si MICHEL HOUELLEBECQ est le digne successeur de BALZAC et PROUST. J’ignore si ses livres sont des Everest de la littérature. Ce que je sais, c’est qu’il travaille sur le monde qu’il a sous les yeux, qu’il dit quelque chose du monde tel qu’il est, et qu’il développe sur celui-ci un point de vue, une analyse, une proposition d’éclairage précis, une grille de lecture, si l’on veut. Si l’on est malveillant, on dira qu’il regarde de derrière des « lunettes » (vous savez, chez PIERRE BOURDIEU, celles du journaliste, celles qui déforment le monde).
C’est un romancier qui a pris position face à la « civilisation occidentale », et qui a ceci de bien, c’est que, s’il parle de lui, c’est à distance respectable, hors de portée de tir de son propre nombril et des ravages courants que celui-ci commet dans les rangs des « écrivains » français, pour le plus grand plaisir des jurés du Prix Inter en général et de PATRICIA MARTIN en particulier.
On peut trouver le point de vue développé par MICHEL HOUELLEBECQ d’une noirceur exécrable : pour résumer, grâce à la civilisation actuelle, exportée par l’Europe, moulinée avec la sauce techniquante, massifiante et consommante de l’Amérique triomphante, le monde actuel court à sa perte et, d’une certaine façon, est déjà perdu.
L’auteur met-il pour autant ses pas dans ceux de PHILIPPE MURAY, comme je l’ai suggéré ? Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que PHILIPPE MURAY a développé dès les années 1980 un regard analogue sur la réalité, d’une acuité de plus en plus grande, et un regard de plus en plus pessimiste.
Avant lui, plusieurs auteurs se sont inquiétés de l’évolution de notre monde : GÜNTER ANDERS (L’Obsolescence de l’homme), LEWIS MUMFORD (Les Transformations de l’homme), HANNAH ARENDT (La Crise de la culture), CHRISTOPHER LASCH (La Culture du narcissisme), JACQUES ELLUL (Le Système technicien, Le Bluff technologique), GUY DEBORD (La Société du spectacle), et quelques autres.
Pardon pour l’étalage, mais c’est parce qu’il y a un peu de tous ces regards dans les romans de MICHEL HOUELLEBECQ, tout au moins les trois que j’ai lus (publiés en 1998, 2001 et 2010, ce qui révèle quand même une certaine constance). La « patte » de PHILIPPE MURAY, c’est l’attention portée à un aspect particulier de la crise moderne : l’humanité est devenue peu à peu superflue, submergée par des objets techniques, des gadgets qui sont devenus pour elle si « naturels », mais en même temps si dominateurs, qu’elle est progressivement devenue une vulgaire prothèse de ses propres inventions. PHILIPPE MURAY le synthétise dans la notion de fête, dans l’abolition de tout ce qui permettait la différenciation (en particulier entre les sexes), dans le nivellement de toutes les « valeurs ».
A suivre...
09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel houellebecq, la carte et le territoire, les particules élémentaires, plateforme, philippe muray, littérature, critique littéraire, le magazine littéraire, le monde des livres, le masque et la plume, günter anders, lewis mumford, christopher lasch, jacques ellul, guy debord
dimanche, 04 septembre 2011
PHILIPPE MURAY CHEZ MICHEL HOUELLEBECQ
Je reviens à La Carte et le territoire, de Michel Houellebecq, dont j’ai parlé ici même du 17 au 20 août. Ben oui, je suis obligé. Je vous explique : j’ai retrouvé, dans un livre de Philippe Muray, l’emplacement où figure l’expression « la carte et le territoire ».
C’est à la page 389 de Festivus festivus (Fayard, 2005) : « La fameuse distinction de la carte et du territoire était encore rassurante : c’était la distinction du réel et de l’imaginaire ; mais il n’y a plus de territoire, et c’est le peuple de la carte qui s’exprime. Sans drôlerie, comme de juste. Sans imagination. Ou qui ne s’exprime pas du tout, d’ailleurs ». C’est intéressant. Il me semble qu’on doit pouvoir retrouver d’autres références à la même expression.
Lorsque le peintre Jed Martin expose ses photographies de cartes Michelin « départements », les choses se présentent ainsi : « L’entrée de la salle était barrée par un grand panneau, laissant sur le côté des passages de deux mètres, où Jed avait affiché côte à côte une photo satellite prise aux alentours du ballon de Guebwiller et l’agrandissement d’une carte Michelin « Départements » de la même zone. Le contraste était frappant : alors que la photo satellite ne laissait apparaître qu’une soupe de verts plus ou moins uniformes parsemée de vagues taches bleues, la carte développait un fascinant lacis de départementales, de routes pittoresques, de points de vue, de forêts, de lacs et de cols. Au-dessus des deux agrandissements, en capitales noires, figurait le titre de l’exposition : « LA CARTE EST PLUS INTÉRESSANTE QUE LE TERRITOIRE ». ». Fin de citation. Je note qu'il ne parle à aucun moment, dans son énumération, de la moindre localité, ni de la moindre indication écrite. Cela devrait mettre la puce à l'oreille.
J’ignore si Michel Houellebecq part des considérations de Philippe Muray (qui dit à peu près que le peuple est devenu virtuel, c’est-à-dire qu’il n’est plus réel, il est devenu « la transparence », comme il dit ailleurs), mais au cas où…, on ne sait jamais, ça voudrait dire que le personnage de Jed Martin ferait en quelque sorte la preuve de la chose, mais en faisant semblant de trouver cela positif.
Et il faut savoir que Philippe Muray dit le plus grand mal de l’esprit de « positivité », dans une époque qui fait tout pour éliminer la moindre « négativité », c’est-à-dire qui pense pouvoir éradiquer totalement le Mal. (Rappelez-vous la « Croisade contre l’Axe du Mal », lancée par un certain Beorge W. Bush.) Ainsi, l’humanité devient-elle, en ce temps béni, définitivement et au sens propre, sage comme une image.
Autrement dit, la seule fonction de l’art capable de dire vrai aujourd’hui, ce serait d’annoncer la disparition de l’homme. D’où, dans la dernière partie de la carrière de Jed Martin, le « point de vue végétal sur le monde », d’où les photos exposées à l’air libre, d’où les composants électroniques et les figurines aspergés d’acide.
Si j’ai bien compris, Jed Martin est l’artiste qui projette dans ses représentations cette humanité, pour dire exactement, en train de disparaître du paysage. Et si j’ai bien compris, le tableau « Damien Hirst et Jeff Koons (ou l'inverse ?) se partageant le marché de l’art » est une métaphore de la dérision qui a envahi ce qu’on appela, pendant deux millénaires (et le pouce), des valeursS. C’est drôle, aujourd’hui, même un escroc comme Jacques Chirac peut affirmer : « J’ai mes valeurs ». Ce qui choque, ici, c’est l’adjectif possessif « mes ». Comme si l’on pouvait simplement imaginer qu’il y ait des « valeurs » individuelles !
Philippe Muray parle des Particules élémentaires, de Michel Houellebecq, dans ses Essais (Editions Les Belles Lettres, 2010), de la page 1166 à la page 1173. L'article, paru en 1999, s'intitule "Et, en tout, apercevoir la fin ...". Si la critique littéraire consiste à s'efforcer de dégager le sens d'un roman, alors c'est de la critique littéraire. Je cite : « Le roman de Houellebecq est né du sentiment de la fin, et tous ses personnages se débrouillent, d'une façon ou d'une autre, avec ce sentiment. C'est lui qui donne à l'oeuvre son éclairage poignant, sa lumière sourde, son climat de catastrophe intarissable, insaisissable, irrattrapable ».
N'oublions pas que la doctrine de l'obsolescence programmée de tous les objets de consommation a été élaborée dans les années 1920. Et ce qui valait au début pour les choses, il est somme toute normal que cela s'étende de plus en plus à tout ce qui est humain et, en bout de course, à l'humain en personne. C'est la logique de la machine. Les deux écrivains sont visiblement cousins en littérature, dans leur façon de voir le monde. Il faut que je lise ce livre car, selon Philippe Muray, « Beaucoup de bavardages sont mis en danger par Les Particules élémentaires ». Si c'est vrai, ça me convient.
Conclusion : il y a chez Michel Houellebecq, non seulement un « regard sur le monde », mais en plus, il y a de la « pensée ». Ça, c’est un roman.
09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel houellebecq, les particules élémentaires, la carte et le territoire, philippe muray, george w. bush
samedi, 20 août 2011
MICHEL HOUELLEBECQ ROMANCIER
Un autre thème apparaît au début de la troisième partie. Enfin, pas un « thème » : on change de roman, du moins en apparence. On était dans la « littérature », on entre dans le polar. L’écrivain Michel Houellebecq et son chien sont retrouvés, enfin, quand je dis « retrouvés », c’est beaucoup dire, car il n’y a plus que leurs têtes qui trônent sur des fauteuils, par la police, éparpillés aux quatre coins de la pièce, pas exactement « façon puzzle », comme dit Bernard Blier dans un des films français les plus célèbres de tous les temps. La façon dont les restes sont disposés évoque les toiles de Jackson Pollock, « mais un Pollock qui aurait travaillé presque en monochrome ».
L’assassinat a duré à peu près sept heures, selon les enquêteurs. Cette scène de crime m’a fait penser à Un Lieu incertain de Fred Vargas, où on lit : « Comme si le corps avait éclaté ». La police patauge (c’est le cas de le dire). Jusqu’à ce que Jed Martin fasse part à Jasselin, le policier, de la disparition du tableau « Michel Houellebecq écrivain » dont il lui avait fait cadeau.
Il y a des idées marrantes, dans cette troisième partie. Par exemple, l’auteur pensait-il à François Bégaudeau en créant un « brigadier Bégaudeau » qui face à la scène de crime se met à osciller sur lui-même : « il fallait juste aller le coucher c’est tout, dans un lit d’hôpital ou même chez lui, mais avec des tranquillisants forts » ? Par exemple, pensait-il à la « trilogie marseillaise » de Jean-Claude Izzo, en faisant boire à ses flics du whisky Lagavulin, comme celui que préfère Fabio Montale ? « Il est impossible d'envisager un travail de police sérieux sans une réserve d'alcool de bonne qualité (...) ». Quant à moi, je choisirais plutôt du côté des « Speyside », moins « tourbés ». Ou alors un Irlandais, genre Bushmill, mais 10 ans d’âge.
« L’affaire est résolue », s’écrie Jasselin quand Jed Martin estime la valeur de son tableau à 900.000 euros. Il faut dire que l’exposition organisée par Franz a fait du peintre un homme très riche, qui peut acheter du jour au lendemain un vaste domaine. Trois ans plus tard, quand l’assassin est retrouvé (mort), le tableau est estimé à 12.000.000. Jed Martin est devenu une « valeur ». Il peut tout se permettre.
Le dernier pan de ce livre que je voudrais retenir, c’est la relation au père, qui quadrille pour ainsi dire le roman. Et c’est un des beaux aspects du livre. Le père intervient comme une ponctuation. Le mot « intervient » est d’ailleurs impropre : disons qu’il est là, présent à intervalles réguliers, tous les 25 décembre pour être précis, c’est le jour de l’année où ils prennent un repas en commun, et un repas de fête, qui plus est. En général, ce n’est pas très gai. Mais ce n’est pas lugubre non plus. L’événement est présenté comme allant de soi : le fils passe avec son père le réveillon de Noël. C’est tout simple, ça ne se discute pas.
C’est d’ailleurs intéressant, cette relation entre le fils et son père, car la mère est à peu près absente, simplement mentionnée comme un souvenir, mais un souvenir anodin. On apprend qu’à la vérité, elle s’est suicidée au cyanure. Cette absence de la mère change de l’habituelle dégoulinade de maternite aiguë dont sont atteints bon nombre de nos contemporains. Et c’est sans doute le seul point commun entre les livres de Michel Houellebecq et de Claude Arnaud (que j’ai dénigré précédemment).
Jed Martin est étonné quand son père déclare, au cours de leur premier repas du roman, « dans une brasserie de l’avenue Bosquet appelée Chez Papa », avoir lu deux romans de Michel Houellebecq : « C’est un bon auteur, il me semble. C’est agréable à lire, et il a une vision assez juste de la société. ». C’est vrai qu’ « il y a une petite bibliothèque à la maison de retraite ». Il a donc du temps pour lire.
J’avais des amis qui habitaient un grand appartement avenue Bosquet, au rez-de-chaussée, avec peu de lumière. Et puis Emmanuel D. a acheté dans une tour du « Front de Seine ». La classe. Il avait les moyens. Mais il paraît que c’est très chic quand même, l’avenue Bosquet, c’est dans le 7ème arrondissement parisien, celui où madame Rachida Dati a croqué la carotte de la mairie, avec ses dents de lapin (j’aurais dû dire « lapine », mais ç’aurait été mal interprété).
Le deuxième repas qu’ils partagent se passe chez le fils. D’abord en silence, au point que Jed s’assoupit. A ce moment, j’ai pensé au film Soleil vert : « Il eut la vision de prairies immenses, dont l’herbe était agitée par un vent léger, la lumière était celle d’un éternel printemps ». C’est le film que le vieux a demandé à visionner au moment où on l’euthanasie. Mais je dis ça parce que j’ai lu la fin.
« Jed se figea. Ça y est, se dit-il. Ça y est, nous y voilà ; après des années, il va parler. » Cela ne viendra pas tout de suite, mais le père se met à parler. De lui, de son histoire, du choix de l’architecture, de l’organisation sociale, de la mère et de William Morris, le peintre d’un seul tableau (La Reine Guenièvre), de genre préraphaélite. Aussi architecte. Une belle scène, économe de moyens. Jean-Pierre Martin est malade, il le sait. Cette conversation lui tient donc lieu de testament, de chaîne de transmission, avant sa disparition prochaine. Et le fils recueille ce legs avec une grande attention.
Eh bien voilà. C’est La Carte et le territoire, écrit par Michel Houellebecq, écrivain. Pas un immense chef d’œuvre : un excellent livre. Ce n’est pas si courant. Bon, il y a des facilités, par exemple dans le style ou le vocabulaire, il y a des coups de mou. Mais c’est un vrai bon travail de romancier. C’est de la littérature.
FIN
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la carte et le territoire, michel houellebecq, fred vargas, jean-claude izzo, william morris
vendredi, 19 août 2011
HOUELLEBECQ ET LA FIN DU MONDE
Donc Jed Martin est tombé amoureux des cartes Michelin. Il se fait une sorte de nom avec ses photos de cartes. Le titre de son exposition est d’ailleurs : LA CARTE EST PLUS INTERESSANTE QUE LE TERRITOIRE. Cela tombe bien : la Compagnie Financière Michelin est intéressée par cette mise en valeur inattendue. Et puis c'est l'occasion pour lui de tomber un peu amoureux d’Olga. Bref, je ne vais pas vous le refaire. Le premier thème du livre, c’est d’abord l’état du monde, pas brillant, on l’a vu.
Le deuxième thème, c’est le monde de l’esthétique, ou plutôt le monde de la beauté. Le père est architecte : la beauté qu’il élabore reste lestée par l’ « utile », le fonctionnel, le monde concret. En l’occurrence, il conçoit des stations balnéaires. Il peut y avoir (c’est même souhaitable) de l’art dans l’architecture, mais par principe, ça n’encourage pas l’oiseau à déployer ses ailes, ou alors il s’agit d’un oiseau attaché au sol, trop lourd pour voler, en quelque sorte.
Au passage, il est foncièrement positif que l'adjectif "totalitaire" soit accolé par Michel Houellebecq au nom de Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier, qui est l'Albert Speer (architecte d'Adolf Hitler) des démocraties modernes. Cet architecte au nom intouchable aujourd'hui, et quasiment sacré, est celui qui a, en quelque sorte, inventé la séparation de l'espace humain en fonctions.
C'est vrai qu'il attendait, pour achever les "parcours piétonniers", que les habitants aient dessiné leurs cheminements avec leurs pieds. Mais segmenter la vie humaine selon le moment de la journée (pour résumer : habitat, travail, consommation), il faut raisonner en termes, non seulement, de gestion de la population humaine, mais c'est, en plus, totalitaire. Regardez, par curiosité, ses projets pour Paris ou Rio de Janeiro. Voilà, c'était au sujet de l'architecture nazi.
Jed, quant à lui, est un artiste. Il part de ses « objets de quincaillerie », dont l’exposition forme un « hommage au travail humain ». Il prend ensuite de l’altitude, avec les cartes Michelin, pour regarder le monde d’en haut, avec tout le sens conféré par les dessins, les formes, et puis surtout les noms.
Puis il devient peintre, avec des tableaux qui représentent le monde, ou plutôt qui essaient de dégager une signification du spectacle du monde. Les titres disent quelque chose : « Bill Gates et Steve Jobs s’entretenant du futur de l’informatique », « Michel Houellebecq écrivain », « Aimée, escort-girl », « L’architecte Jean-Pierre Martin quittant la direction de son entreprise ».
Wong Fu Xin, un essayiste chinois qui a travaillé sur le peintre, le voit « désireux de donner une vision exhaustive du secteur productif de la société de son temps ». Le roman, à travers le personnage de Jed Martin, parle bien du monde. Et il en dit quelque chose. Bon, je ne vais pas plaquer mes considérations vaseuses, mais ça a quelque chose à voir avec l’étriqué qui enserre l’humanité depuis que l’économique (pour ne pas dire le financier) est seul aux manettes.
« Je veux rendre compte du monde… Je veux simplement rendre compte du monde ». C’est ce que répète Jed Martin qui, ayant pris de l’âge et marqué le monde de l’art de son empreinte, est interviewé pour la revue Art press. Pour dire, la dernière partie de son œuvre consistera, le matin, à poser son caméscope, à cadrer, par exemple « une branche de hêtre agitée par le vent », ou « une touffe d’herbe, le sommet d’un buisson d’orties, ou une surface de terre meuble et détrempée entre deux flaques ». Il déclenche, et vient récupérer son matériel le soir ou le lendemain. Il en tire par montage des « œuvres », « qui constituent sans nul doute la tentative la plus aboutie, dans l’art occidental, pour représenter le point de vue végétal sur le monde ». LE POINT DE VUE VEGETAL SUR LE MONDE. Je ne sais pas pourquoi, mais cette trouvaille m’enchante.
Il y aura aussi ces « composants électroniques », qu’il asperge d’acide sulfurique pour « accélérer le processus de décomposition ». A la suite d’un long travail qu’il est inutile de détailler, il aboutit à de « longs plans hypnotiques où les objets industriels semblent se noyer, progressivement submergés par la prolifération des couches végétales ».
Il fera subir un sort analogue à des photographies laissées à « la dégradation naturelle », puis à des « figurines jouets, représentations schématiques d’êtres humains ». On aura constaté que la place de l’homme, dans tout ça, est si réduite qu’elle a pour ainsi dire disparu. Si tout ça n’est pas de la métaphore ! La ficelle est même un peu grosse. Dommage que tout cela soit tout de même un peu trop explicité à la fin.
A suivre (ben oui)...
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel houellebecq, la carte et le territoire, littérature, le corbusier, adolf hitler, bill gates, steve jobs, art press
jeudi, 18 août 2011
LISEZ LA CARTE ET LE TERRITOIRE
Damien Hirst, pour ceux qui l’ignorent, a réalisé l’œuvre d’art la plus chère de tous les temps (à la fabrication, dirons-nous), avec un véritable crâne humain recouvert de (environ) 8000 diamants authentiques. A mon avis, ça défonce l’œuvre de Jeff Koons, visible autrefois dans Art press, où celui-ci se photographie avec sa verge en train de pénétrer dans la Cicciolina à cheval sur lui, tout ça dans des couleurs tendres, voire kitsch, et où la femme fait tout, par sa mimique, pour indiquer qu’elle est en train de jouir. Bon, c’est vrai, elle fait toujours la mimique de la jouissance féminine sur toutes les photos de la série, car il y a une série entière, bien entendu, on aurait tort de se priver.
Il a dû chercher longtemps le moyen de se replacer au sommet du podium, Jeff Koons, mais, apparemment, il n’a pas trouvé. Moralité : l’argent a eu la peau du sexe. Dit autrement : la marchandise a triomphé de la morale, puisque pour « heurter les sensibilités », exhiber une copulation « in vivo » est dépassé : il faut maintenant des diamants, et des diamants comme s’il en pleuvait. Et ça ne heurte même plus personne. C’est le stade, en quelque sorte, des icônes désicônisées.
C’est d’ailleurs ce dont Michel Houellebecq est convaincu, au moins apparemment, car ce tableau impossible à achever, que Jed Martin finira d’ailleurs par détruire, ça symbolise bien sûr (mais est-ce si sûr ?) l’escroquerie cynique et arrogante que constitue désormais l’étalage sans vergogne des montagnes de fric sous le nez même de ceux que l’ultralibéralisme racle jusqu’à l’os.
La Carte et le territoire, c’est curieux, on rencontre cette expression deux ou trois fois dans le volume des Essais de Philippe Muray. Un territoire, à proprement parler, c’est rigoureusement indéchiffrable : regardez une photo aérienne prise à la verticale, impossible de se repérer, de s’orienter, ni numéro de routes, ni nom de village ou de rivière. Et si on est au-dessus d’une forêt, je vous dis pas. En gros, face à une telle photo, vous êtes, comme on dit, paumé. Remarquez, c’est la même chose pour n’importe quelle photo : dans la presse, qu’est-ce qu’il en reste, comme information, si vous en supprimez la légende ?
Elle sert à ça, la carte : à donner toutes les légendes nécessaires pour qu’on sache bien ce qu’on est en train de regarder, à poser l’étiquette avec les noms sur les paysages. A donner des points de repère. A s'orienter. S'il n'y a pas de métaphore, là, c'est rudement bien imité : nous avons fabriqué une époque totalement dépourvue de valeurs, qui n'a plus aucun sens de la valeur des choses et des êtres, démunie de points de repère. En clair, TOUT est possible (et l'inverse aussi, naturellement).
Et Jed Martin a été photographe avant de virer peintre. Il a commencé par « trois cents photos de quincaillerie », avec « écrous, boulons et clefs à molette », tout ça en « lumière neutre », sur « fond de velours gris moyen ». Puis il a l’illumination, un jour où, sur une aire d’autoroute, son père lui demande d’acheter la carte Michelin du département. Ils sont dans la Creuse. Le passage vaut, comme on dit dans le Guide Michelin, le détour.
« Cette carte était sublime ; bouleversé, il se mit à trembler devant le présentoir. Jamais il n’avait contemplé d’objet aussi magnifique, aussi riche d’émotion que cette carte Michelin au 150.000ème de la Creuse, Haute-Vienne. L’essence de la modernité, de l’appréhension scientifique et technique du monde, s’y trouvait mêlée avec l’essence de la vie animale. » C’est le coup de foudre. On ne comprend pas bien, mais le roman, c’est aussi ça.
A suivre...
P. S. du 26 août : L'expression "la carte et le territoire" se trouve aussi (ou alors, en fait) dans le livre de Philippe Muray Festivus festivus, paru en 2005 chez Fayard, à la page 389 : « La fameuse distinction de la carte et du territoire était encore rassurante : c'était la distinction du réel et de l'imaginaire; mais il n'y a plus de territoire, et c'est le peuple de la carte qui s'exprime. Sans drôlerie, comme de juste. Sans imagination. Ou qui ne s'exprime pas du tout, d'ailleurs ». Cela ouvre comme un horizon, une sorte de profondeur de champ.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jeff koons, peinture, art press, damien hirst, art contemporain, cicciolina, philippe muray, la carte et le territoire
mercredi, 17 août 2011
DIRE DU BIEN DE MICHEL HOUELLEBECQ
Je n’avais encore lu aucun livre de Michel Houellebecq. Vous allez me demander pourquoi, peut-être. La raison en est simple, je crois d’ailleurs l’avoir déjà exposée ici, quoique pour une autre raison : il y avait une controverse, que dis-je, une dispute, un débat national ! Le sujet, tout simplement, faisait exploser l’audience dans les médias.
Et l’ébullition virtuelle (récurrente, il faut bien l’avouer, le carburant des médias n’étant rien d’autre que l’ébullition, quel que soit le combustible), tout simplement, ça me donne dans la minute, en plus de la nausée, un urticaire géant, massif, à donner même au unau des gestes fébriles et saccadés, voire capricants et convulsifs, c’est vous dire.
Il suffit que la mayonnaise médiatique « prenne » autour d’un individu, d’un phénomène, d’un événement pour que je fasse comme l’escargot : je me rétracte, je retourne au fond de la coquille utérine de ma surdité natale. C’est simple, tout ce qui a pour vertu de « faire parler les gens », je m’en protège par instinct comme d’une peste. Bon, c’est vrai, j’ai abordé ici plusieurs fois, par exemple, l’ « affaire » Strauss-Kahn, mais c’est parce que j’écoute beaucoup la radio. Vous dites : paradoxal ? Je veux bien. Mais qui est sans contradiction ?
Une amie avait prêté à H. La Carte et le territoire, le petit dernier de l’auteur controversé. Le livre était là, sur sa table, inoccupé, désœuvré même, il s’ennuyait. Je l’ai ouvert – avec réticence, mais je l’ai ouvert. Autant l’avouer : je craignais le pire. Eh bien tenez-vous bien, je n’ai pas regretté. Franchement, c’est une heureuse surprise. J’ai donc lu récemment deux ouvrages contrastés d’auteurs français d’aujourd’hui : Claude Arnaud, avec Qu’as-tu Fait de tes frères ?, et, donc, Michel Houellebecq, avec La Carte et le territoire.
Autant je trouve le premier dénué de toute force et de tout intérêt, frappé d’émasculation littéraire, autant je trouve le Houellebecq réjouissant et « couillu ». Enfin un livre d’un auteur français d’aujourd’hui qu’il ne faut pas se forcer, la mort dans l’âme, à boire jusqu’à la lie de la dernière page. Tiens, du coup ça me donne envie de lire les précédents.
Le Claude Arnaud, c’est du mètre linéaire, comme on dit dans les supermarchés, mais du linéaire à tous les étages du bouquin, dans les faits, dans les personnages, dans la construction, et surtout dans le regard sur le monde que c’est censé refléter : tout simplement, de regard, il n’y en a pas. Mai 1968, avec ce qui précède et tout ce qui suit, pourtant, ça devrait motiver le romancier, bon dieu ! Là non, rien, pas de regard du tout : si l’on veut, c’est un tableau aveugle sur l’époque. Cette époque, il s’est contenté de la vivre. Ça ne fait pas une littérature. Le secrétaire de séance se contente d’exposer, comme je disais, son compte-rendu de conseil d’administration.
Avec Michel Houellebecq pas du tout. L’action se passe aujourd’hui, ou peu s’en faut : il ne faut pas compter sur une reconstitution historique. Et l’époque, on l’entend pester contre. On sent qu’il ne peut pas la sentir. Et pour moi, ça tombe bien, c’est une attitude que non seulement je comprends, mais que je partage. Je pense à Philippe Muray qui, d’ailleurs, dans sa détestation du bocal littéraire parisien, épargne plutôt l’auteur de La Carte et le territoire, si je me souviens bien (voir son volume d’Essais, aux Belles Lettres).
Ce qui est vraiment bien, c’est que Michel Houellebecq, non seulement ne dit jamais « je » comme dans ces pseudo-romans que sont les soi-disant « auto-fictions », mais encore met en scène un personnage qui s’appelle Michel Houellebecq, qui meurt atrocement, soit dit en passant, dans la troisième partie. Mais attention, ce n’est pas une projection, ce serait plutôt un double, et c’est assez marrant. Car le pire, dans l’autofiction, c’est l’espèce de vortex auto-érotique où l’auteur masturbe à longueur de page des obsessions qui l’obsèdent. C’est, bien entendu, insupportable. Rien de tel ici.
Le personnage principal, c’est l’artiste Jed Martin, fils de l’architecte Jean-Pierre Martin, à la riche et belle carrière d’architecte, mais il a pris sa retraite, un jour. Le roman commence sur l’impossibilité de finir le tableau dont le sujet consiste en Jeff Koons et Damien Hirst, les deux artistes les plus chers du marché de l’art contemporain. Déjà, cette impossibilité de finir un pareil tableau me rend le livre sympathique. Ça ne suffit pas, mais ça aide. D’autant que le futur tableau s’intitule « Jeff Koons et Damien Hirst se partageant le marché de l’art ».
A suivre...

