lundi, 29 juillet 2024
JE SUIS DE GAUCHE-DROITE ...
... ET INVERSEMENT.
2/2
Dans les mœurs, au contraire, la civilisation européenne (puis occidentale) s'est ingéniée à remettre les normes en question, principalement depuis qu'elle vit sous le régime de la technique omniprésente et toute-puissante, de ses "progrès" et de ses innovations. Regardez pour ça, par exemple, la course au gigantisme des immeubles à laquelle se livrent les pays (Kuala Lumpur et autres tours de Babel). De tels exemples foisonnent.
A cet égard, on n'a pas assez noté à mon sens le caractère profondément subversif du culte de la nouveauté en matière technique : au rythme des inventions, les comportements, les psychologies, les coutumes et les structures mêmes de la société se sont trouvés bouleversés. J'adresse cette remarque à ceux qui pensent encore que la technique est neutre, et que le bien ou le mal qui arrive ensuite n'est que le fruit de l'usage qui en est fait par les hommes.
Cette façon d'intégrer dans nos modes de pensée l'idée des changements permanents dans nos modes de vie, je dirais même cette façon de valider le mouvement continu comme base principale de l'existence, cette façon d'accepter la subversion incessante de nos repères par le surgissement incessant du jamais vu dans notre quotidien, ne pouvait pas épargner le domaine des mœurs, en particulier des codes sociaux et des normes communes admises. Ecoutez le slogan impérieux : « BOUGEZ !!! », ne serait-ce que pour montrer que vous n'êtes pas mort.
Je ne suis ni philosophe, ni sociologue, ni quoi que ce soit, et il y aurait beaucoup à dire sur la promotion de l'individu depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (ouverture des droits sans limitation, émancipation totale, définitive et définitivement insatisfaite), sur la logique implacable du système économique capitaliste dans lequel s'est déroulée l'évolution (mercantilisation, privatisation et rentabilisation de tout), sur l'abandon par la gauche de la défense des classes exploitées pour se reporter sur des thèmes sociétaux (égalité homme / femme, P.M.A. pour toutes, et autres innovations "cruciales"), et sur nombre de sujets que le cadre de ce billet empêche d'examiner.
Je constate juste que, dans la société d'aujourd'hui, il n'existe plus aucun consensus sur la manière dont les gens doivent se comporter. Il faut dire que, en matière de mœurs, les codes sociaux résultent forcément d'un consensus autour de « ce qui va de soi » en matière de morale. Mais ce que George Orwell, dans ses Essais, appelait la "common decency", c'est-à-dire ce qu'il convient ou ne convient pas qu'un individu se permette de faire, est devenu incompréhensible.
Quels attardés se posent encore aujourd'hui la question de savoir "ce qui se fait" et "ce qui ne se fait pas" ? Bon, il y a bien quelques tabous qui résistent encore : « il faut respecter l'enfant », « on ne tue pas son prochain » ("ça ne se fait pas, ça n'est pas bien", Catherine Ringer ou Brigitte Fontaine), mais en dehors de ça, hein, l'univers des normes, des codes sociaux se trouve à mi-chemin entre l'EHPAD et le cimetière.
Ecoutez bien ce que dit le refrain : « Il faut en finir avec les stéréotypes », et vous aurez une idée de ce qui cherche à s'imposer comme nouveaux stéréotypes. Tout n'est certes pas permis, mais on n'en est pas loin. Comme le dit le tube ancien (1934) de Cole Porter : « Anything goes » : "tout est permis".
On ne parviendra plus à « refaire société », comme le regrettent ou le voudraient les prêcheurs et autres bonnes âmes, avec plus ou moins de conviction. On ne reviendra pas en arrière. Le refrain du « vivre-ensemble » est obsolète, c'est de l'histoire ancienne. La société comme "corps" (plus ou moins) homogène est morte et enterrée. Margaret Thatcher ignorait ce qu'est une "société" : elle ne connaissait que des "collections d'individus".
Des individus qui, soit dit en passant, en se fiant à des affinités électives, s'affilient à des « communautés » où ils puissent retrouver une certaine homogénéité de groupe. La doctrine anglo-saxonne a vaincu la tradition française, la France s'est mise au pli, pulvérisée en de multiples micro-sociétés, autant de ghettos qui se côtoient et se croisent sans se rencontrer.
Alors, avec tout ça, où suis-je, moi ? Pour ce qui est de l'économie, je crois toujours qu'il existe des classes sociales, bien que je sache que, dans le bréviaire marxiste, on ne peut parler de classes sociales qu'à propos de masses conscientes et organisées. Je crois à la justice sociale, à la bonne entente de tous sous condition de répartition équitable des richesses, à la restriction et à la réglementation des voracités qui s'exercent aux dépens des faibles et des précaires : pour tout ça, je reste définitivement de gauche.
En ce qui concerne les mœurs, en revanche, je demeure de droite. Je crois que nos désirs n'ouvrent pas forcément sur autant de droits "imprescriptibles". Et je reste stupéfait devant les revendications des homosexuels, des transsexuels, et plus récemment des associations qui exigent qu'on respecte la décision de certains adolescents qui ne savent pas encore quel sera leur sexe à l'avenir (voir le débat autour des "bloqueurs de puberté"). Je crois aussi que la valorisation souvent outrancière voire punitive des particularismes se situe aux antipodes de l'idée même de société.
Je parle évidemment des particularismes religieux, ethniques, sexuels, et de tout ce qu'on appelle complaisamment la « défense des minorités », au nom de laquelle on condamne le « sexisme », le « machisme », le « virilisme » (l'homme, c'est la violence), ainsi que toutes sortes de supposées « phobies » ("islamo-homo-trans-grosso-phobie"). Tous ces juges nieront bien sûr farouchement souffrir de quelque phobie que ce soit.
Personne ne songe plus à s'ériger en défenseur de la majorité : en dehors des élections, les gens qui constituent l'immense partie de la population sont invités à fermer leur gueule, comme si l'homme et la femme ordinaires, les quidams sans revendication de particularisme, bizarrerie ou spécificité dûment admise ou cataloguée, je veux dire comme si les gens normaux n'avaient plus droit de cité.
Car je crois qu'en société une certaine normalité est nécessaire, indispensable, et même souhaitable, quoi que puissent glapir ceux que ce simple mot exaspère. Nulle norme au monde n'a jamais fabriqué deux êtres humains absolument semblables. Quelle terrible menace l'idée fait-elle peser sur l'humanité ?
Je crois aux limites à ne pas dépasser, et cela quel que soit le sujet. Mais je suis réaliste : je sais qu'une telle attitude est vouée à disparaître, et destinée à connaître le même sort que les dinosaures. Je ne reconnais plus grand-chose du monde dans lequel j'ai vécu. Je regarde se défaire, morceau par morceau, le réel qui fut le mien. C'est comme ça et pas autrement. Pourtant, je suis toujours animé par une grande curiosité au sujet de ce qui se passe autour de moi, dans mon quartier, en France et dans le monde.
Alors, au fond de mon terrier, tout en persistant à sortir mon périscope pour ne pas rester aveugle sur la marche du monde, je m'entoure plus égoïstement d'assez de personnes amicales, d'assez de choses agréables, belles et bonnes, pour cultiver divers moyens d'éprouver de la joie. Et j'y arrive ... tant bien que mal.
09:00 Publié dans FAÇON DE REGARDER | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, extrême-gauche, extrême-droite, guy debord, in girum imus nocte et consumimur igni, george orwell, common decency, jean-claude michéa, libertariens, islamophobie, homophobie, sexisme, pierre de coubertin, jeux olympiques
dimanche, 28 juillet 2024
JE SUIS DE GAUCHE-DROITE ...
... ET INVERSEMENT !
1/2
Il y a fort longtemps (4 mai 2015), j'ai expliqué ici comment, en politique, je me définissais comme étant « d'extrême-gauche-droite ». Bon, d'accord, il y avait sans doute de la boutade dans la bravade ainsi que, probablement, de la galéjade dans la fanfaronnade (ne pas exagérer mon "extrémisme"), mais en même temps qu'un fond de vérité.
Mon raisonnement reposait, et repose toujours, sur une notion qui devrait être d'une clarté aveuglante pour tout le monde, ce qui n'est hélas pas le cas : la notion de limite. Les curieux qui rendent visite à ce blog de temps en temps connaissent ma conviction : l'absence de limites rend la vie impossible. J'ajoute : l'absence de limites rend impossible l'exercice même de la liberté. Car, contrairement à ce que pensent la plupart des gens (« Etre libre, c'est pouvoir faire ce que je veux »), la première et la plus grande des libertés est celle de dire NON !
A cet égard, on peut affirmer que la façon dont tourne le monde actuel tient de la maladie mentale, de la psychose parano-schizo-névrotique, de la folie des grandeurs et de la volonté de puissance réunies. Ecoutez-les tous, les artistes, théâtreux, peintres, sportifs, et tutti quanti.
Ils ne parlent que « de se surpasser », « d'être prêts à 300% », « de franchir les limites », « de se moquer des frontières », « d'abattre les cloisonnements », « de transgresser les normes », « de casser les codes » (voir Thomas Jolly, le maître d'œuvre de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques), « d'en finir avec les stéréotypes » et autres fadaises, fariboles et calembredaines, sur le modèle du funeste « citius, altius, fortius » du père Coubertin, le grand-prêtre et dieu tutélaire de la religion du sport. Le dépassement des limites est devenu la règle. Tout ce qui se présente sous les couleurs de l'écologie et de la défense de l'environnement en sait quelque chose.
Pour moi, au contraire, le principe du respect des limites devrait guider toutes les actions humaines. A croire que je suis moi-même écologiste dans l'âme. Mais absolument toutes, n'est-ce pas, et sans exception, et dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'action politique, de l'action des Etats, de l'action des entreprises (action économique), et de l'action des individus eux-mêmes. Tout n'est pas permis aux Etats, tout n'est pas permis aux responsables politiques, tout n'est pas permis aux acteurs économiques, tout n'est pas permis aux personnes.
Quand les Etats se croient tout permis, ils s'appellent Hitler, Staline, Pol Pot ou Khomeiny. En politique, cela s'appelle compromission, retournement de veste, corruption, addiction à l'exercice du pouvoir, etc. En économie, cela s'appelle loi de la jungle, exploitation à outrance des hommes et des choses, liberté pour les loups, prédation des plus voraces sur les plus faibles.
Au niveau des individus, cela s'appelle le grand n'importe quoi moral et psychologique, comme le spectacle cacophonique nous en est donné tous les jours dans le prisme médiatique : il est de plus en plus clair que plus grand monde ne sait à quelle vérité stable se raccrocher. Comme le dit le palindrome-film de l'immense Guy Debord : « In girum imus nocte et consumimur igni » (on peut lire la même phrase en commençant par la fin), « Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu ».
Or quels paradoxes observe-t-on autour de soi ? Quand on se déclare de droite, on est supposé être favorable au libéralisme économique, et parfois le plus extrême : rien ne doit entraver les initiatives. En ce qui concerne l'économie, en effet, on est opposé à toute régulation, à toute réglementation, à toute restriction du commerce et des échanges, à toute loi organisant le monde de l'entreprise et du travail. En gros et en bref : on veut pouvoir faire des affaires sans se faire emmerder par des gens qui n'ont pas bien compris l'importance de certains intérêts particuliers.
Mais étrangement, ces mêmes personnes (j'excepte ceux qu'on appelle "libertariens"), dès qu'on aborde les problèmes de mœurs, affichent une attitude plus ou moins rigoriste et conservatrice : la famille, c'est sacré — tu parles ! Il faut protéger le patrimoine et sa transmission. L'adultère, l'homosexualité, quelle horreur ! Bon, je ne sais pas dans quelle mesure cela reste vrai aujourd'hui. Passons. Reste la contradiction : où en est-on avec les limites ?
Chez les gens de gauche, c'est l'inverse : en économie, il faut contenir la voracité des appétits de tous ceux à qui les statistiques économiques, les chiffres de la croissance et les possibilités d'enrichissement servent de boussole et de Nord absolu. Pour eux, il faut protéger les travailleurs des contraintes excessives auxquelles les patrons voudraient les soumettre. En revanche, dans le domaine des mœurs, quand on est de gauche, toute contrainte, toute limitation, toute entrave est haïe, pourchassée, pourfendue. Les moindres désirs éprouvés par les individus génèrent automatiquement autant de droits imprescriptibles. Là aussi, contradiction : où en est-on avec les limites ?
Donc, qu'on soit de gauche ou de droite, dans ce schéma (un peu simpliste, je le reconnais), on se trouve face à une étrange contradiction : sous le pied du conducteur de droite, le frein devient l'accélérateur sous un pied de gauche, et le frein, sous le même pied de gauche, devient l'accélérateur du chauffeur de droite.
Comment font-ils pour s'y retrouver dans le fatras des pédales ? Comment peut-on soutenir d'un seul et même mouvement deux attitudes incompatibles entre elles ? Pour ma part, j'ai été un peu aidé, pour résoudre le problème, par la lecture des ouvrages de Jean-Claude Michéa (cliquer pour voir la notice).
C'est là qu'intervient la notion de LIMITES. Appelez ça des normes, et même des stéréotypes si vous voulez. C'est quoi, les normes ? C'est d'abord des statistiques qui servent à définir, par exemple, les dimensions de nos sièges, de nos crayons et stylos, de nos habitations, de nos villes : c'est la façon de fabriquer un environnement à notre mesure. La norme, c'est ce qui ne s'écarte pas trop de la moyenne. Il est clair que ce genre de normes ne se discute pas.
Suitetfin demain.
09:00 Publié dans FAÇON DE REGARDER | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, france, société, extrême-gauche, extrême-droite, guy debord, in girum imus nocte et consumimur igni, george orwell, common decency, jean-claude michéa, libertariens, islamophobie, homophobie, sexisme, pierre de coubertin, jeux olympiques
mardi, 08 mai 2018
LE MONDE DANS UN SALE ÉTAT
 4 juin 2016
4 juin 2016
1
Je ne sais pas si Paul Jorion[1] a raison quand il parle d’un « effondrement général » de l’économie, de l’extinction prochaine de l’espèce humaine et de son remplacement par une civilisation de robots indéfiniment capables de s’auto-engendrer et de s’auto-régénérer. Sans être aussi radical et visionnaire, je me dis malgré tout que la planète va très mal, et que l’espèce qui la peuple, la mange et y excrète les résidus de sa digestion, est dans un sale état.
Beaucoup des lectures qui sont les miennes depuis quelques années maintenant vont dans le même sens. Pour ne parler que des deux ans écoulés, qu’il s’agisse
1 - du fonctionnement de l’économie et de la finance mondiales (Bernard Maris[2], Thomas Piketty[3], Paul Jorion[4], Alain Supiot[5], Gabriel Zucman[6]) ;
2 - de la criminalité internationale (Jean de Maillard[7], Roberto Saviano[8]) ;
3 - des restrictions de plus en plus sévères apportées aux règles de l’état de droit depuis le 11 septembre 2001 (Mireille Delmas-Marty[9]) ;
4 - de la destruction de la nature (Susan George[10], Naomi Oreskes[11], Fabrice Nicolino[12], Pablo Servigne[13], Svetlana Alexievitch[14]) ;
5 - de l’état moral et intellectuel des populations et des conditions faites à l’existence humaine dans le monde de la technique triomphante (Hannah Arendt[15], Jacques Ellul[16], Günther Anders[17], Mario Vargas Llosa[18], Guy Debord[19], Philippe Muray[20], Jean-Claude Michéa[21], Christopher Lasch[22]),
[Aujourd'hui (8 mai 2018), j'ajouterais la littérature, avec évidemment Michel Houellebecq en tête de gondole, mais aussi la bande dessinée : j'ai été frappé récemment par l'unité d'inspiration qui réunit Boucq (Bouncer 10 et 11) ;

Derrière son drôle de masque, la dame à l'arrière-plan, dirige un clan d'amazones impitoyables, qui capturent toutes sortes d'hommes pour qu'ils les fécondent, et pour leur couper la tête juste après l'acte. Et ce n'est que l'une des nombreuses joyeusetés rencontrées.
Hermann (Duke 2) ;

Yves Swolfs (Lonesome 1) ;

et d'autres dans un déluge de sang, de violence, de cruauté gratuite et de bassesse dont j'ai bien peur que, sous le couvert de la fiction et du western, ils nous décrivent, avec un luxe de détails parfois à la limite de la complaisance, ce que certains philosophes et sociologues appellent un très actuel "grand réensauvagement du monde". La représentation de plus en plus insupportable et violente d'un monde fictif (je pense aussi à certains jeux vidéos) n'est-elle pas un reflet imaginaire d'une réalité que nos consciences affolées refusent de voir sous nos yeux ?]
quand on met tout ça bout à bout (et ça commence à faire masse, comme on peut le voir en bas de page), on ne peut qu'admettre l’incroyable convergence des constats, analyses et jugements, explicites ou non, que tous ces auteurs, chacun dans sa spécialité, font entendre comme dans un chœur chantant à l’unisson : l’humanité actuelle est dans de sales draps. Pour être franc, j’ai quant à moi peu d’espoir.
D’un côté, c’est vrai, on observe, partout dans le monde, une pullulation d’initiatives personnelles, « venues de la société civile », qui proposent, qui essaient, qui agissent, qui construisent. Mais de l’autre, regardez un peu ce qui se dresse : la silhouette d’un colosse qui tient sous son emprise les lois, la force, le pouvoir, et un colosse à l’insatiable appétit. On dira que je suis un pessimiste, un défaitiste, un lâche, un paresseux ou ce qu’on voudra pourvu que ce soit du larvaire. J’assume et je persiste. Je signale que Paul Jorion travaille en ce moment à son prochain ouvrage. Son titre ? Toujours d’un bel optimisme sur l’avenir de l’espèce humaine : Qui étions-nous ?
Car il n’a échappé à personne que ce flagrant déséquilibre des forces en présence n’incite pas à l’optimisme. Que peuvent faire des forces dispersées, éminemment hétérogènes et sans aucun lien entre elles ? En appeler à la « convergence des luttes », comme on l’a entendu à satiété autour de « Nuit Debout » ?
[8 mai 2018. Tiens, c'est curieux, voilà qu'on entend depuis des semaines et des semaines la même rengaine de l'appel à la convergence des luttes. C'est un mantra, comme certains disent aujourd'hui : une formule magique. Ce qu'on observe dans certains cercles contestataires, c'est plutôt la convergence des magiciens, sorciers, faiseurs-de-pluie et autres envoûteurs : ils dansent déjà en rond en lançant les guirlandes de leurs grandes idées et des incantations incantatoires autour du futur feu de joie qu'ils allumeront un de ces jours dans les salons dorés des lieux de pouvoir. Eux-mêmes y croient-ils ?]
Allons donc ! Je l’ai dit, les forces adverses sont, elles, puissamment organisées, dotées de ressources quasiment inépuisables, infiltrées jusqu’au cœur des centres de décision pour les influencer ou les corrompre, et défendues par une armada de juristes et de « think tanks ».
Et surtout, elles finissent par former un réseau serré de relations d’intérêts croisés et d’interactions qui fait système, comme une forteresse protégée par de puissantes murailles : dans un système, quand une partie est attaquée, c’est tout le système qui se défend. Regardez le temps et les trésors d’énergie et de persévérance qu’il a fallu pour asseoir l’autorité du GIEC, ce consortium de milliers de savants et de chercheurs du monde entier, et que le changement climatique ne fasse plus question pour une majorité de gens raisonnables. Et encore ! Cela n’a pas découragé les « climato-sceptiques » de persister à semer les graines du doute.
C’est qu’il s’agit avant tout de veiller sur le magot, n’est-ce pas, protéger la poule aux œufs d’or et préserver l’intégrité du fromage dans lequel les gros rats sont installés.
Voilà ce que je dis, moi.
[1] - Le Dernier qui s’en va éteint la lumière, Fayard, 2016.
[2] - Houellebecq économiste.
[3] - Le Capital au 21ème siècle.
[4] - Penser l’économie avec Keynes.
[5] - La Gouvernance par les nombres.
[6] - La Richesse cachée des nations.
[7] - Le Rapport censuré.
[8] - Extra-pure.
[9] - Liberté et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, 2010.
[10] - Les Usurpateurs.
[11] - N.O. & Patrick Conway, Les Marchands de doute.
[12] - Un Empoisonnement universel.
[13] - P.Servigne. & Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer.
[14] - La Supplication.
[15] - La Crise de la culture.
[16] - Le Système technicien, Le Bluff technologique.
[17] - L’Obsolescence de l’homme.
[18] - La Civilisation du spectacle.
[19] - Commentaire sur La Société du spectacle.
[20] - L’Empire du Bien, Après l’Histoire, Festivus festivus, …
[21] - L’Empire du moindre mal.
[22] - La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé.
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabrice nicolino, lettre à un paysan sur le vaste merdier, paul jorion, bernard maris, thomas piketty, alain supiot, gabriel zucman, jean de maillard, roberto saviano, mireille delmas-marty, susan george, naomi oreskes, pablo servigne, hannah arendt, jacques ellul, günther anders, mario vargas llosa, guy debord, philippe muray, jean-claude michéa, christopher lasch, houellebecq économiste, les marchands de doute, l'obsolescence de l'homme, la société du spectacle, festivus festivus, bande dessinée, hermann duke, boucq bouncer, yves swolfs lonesome, michel houellebecq
vendredi, 28 avril 2017
MICHÉA : NOTRE ENNEMI, LE CAPITAL
 Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.
Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.
Qu’on en juge : l’axe principal de son propos tel qu’il s’expose en quatre courts chapitres tient dans les quatre-vingts premières pages, les deux cent vingt-neuf suivantes étant consacrées à développer des « scolies » (alias "commentaires", numérotés de A à P), qui sont autant de greffes entées sur le tronc du raisonnement, et qu’il préfère, pour cette fois, regrouper à part. Et non content de cette "curiosité", chacune des scolies digresse en notes, souvent très copieuses et qui volent parfois en escadrille, annoncées en lettres minuscules cette fois.
Par-dessus le marché, son style d’exposition n’est pas fait pour faciliter la tâche au lecteur. Je ne nie pas la nécessité de la précision et de l’exactitude de l’expression. Mais, pour prendre un exemple dans la psychanalyse, entre la manière quasi-maniaque d’un Jacques Lacan et le langage accessible d’un Didier Anzieu, je choisis ce dernier, dont on suit en général le propos sans peine : le non-spécialiste lui en sait gré, quelle que soit la validité de ses thèses.
La langue de Michéa est faite de phrases à rallonge (celle qui commence page 65 s’achève vingt-cinq lignes plus bas, et quatre ou cinq pages plus loin, à cause des notes !), et qui plus est, de phrases souvent bourrées d'interruptions diverses, sous forme d’incises, de tirets, de parenthèses, qui finissent par noyer le fil conducteur sous les strates multiples. C’est sûr, l’auteur ne veut rien oublier, mais cette façon d’écrire, jointe au choix de la scolie, a quelque chose d’horripilant.
C'est ce que je reprochais, par exemple, à Bourdieu (du temps où je lisais ça), dont on se demande après combien d'incises et de propositions subordonnées la phrase qu'il vient de commencer va s'achever. C'était permis à Proust qui, lui, écrivait de la littérature. A quoi tient le besoin de certains intellectuels d'obscurcir à loisir leurs thèses, auxquelles je suppose pourtant qu'ils tiennent ?
C’est d’autant plus dommage, dans le livre de Michéa, que bien des remarques, dans le texte ou dans les notes, ont tout pour remplir d'aise le lecteur déjà un brin critique. Pour rester page 65, par exemple, Michéa s’en prend, en bas de page, à tous les intellectuels qui ont décidé de rénover le discours du capital en affublant leur entreprise du masque de la « déconstruction » ("neutralité axiologique" oblige : la belle blague). Il place ceci entre parenthèses : « comme en témoigne, entre autres, le fait que la carrière d’un universitaire français – du moins dans le domaine des « sciences sociales » – dépend avant tout, de nos jours, du nombre de génuflexions qu’il acceptera d’accomplir devant l’œuvre de Foucault et de Derrida ». Je goûte fort les guillemets à "sciences sociales".
Oui, la police universitaire est bien faite, et l'ordre économique et idéologique y règne. Cette mise en cause fait un bien fou, car la gauche soft, vous savez, la gauche sociétale qui s'est désintéressée des rapports de classes et des rapports de production pour se convertir à l'économie de marché et à la dérégulation morale, fait en effet régner dans les « sciences » humaines un terrorisme intellectuel qui paralyse et stérilise la pensée dans l’université française, où la cooptation, si elle n'est pas la règle absolue, pèse quand même de tout son poids.
Toujours sur un de ces papes de la « déconstruction » : « Certains se souviendront alors peut-être du jugement prophétique de Sartre. La pensée de Foucault – écrivait-il dès 1966 – est "le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx". L’université française contemporaine est là pour le confirmer » (p.61). Bien que je n'approuve pas trop la référence à Sartre, je trouve que s'en prendre à Foucault et Derrida, c'est ne pas manquer de courage, et l'on comprend que tous leurs émules s'entendent à merveille pour rejeter avec haine et hauteur Michéa parmi les plus fieffés "réactionnaires".
De même quand il s’en prend à une figure quasi-christique de la gauche moderne, sociétale et cosmétique, celle qui a promu le "mariage" des homosexuels : « Si, du reste, ces notions d’identité nationale et de continuité historique ne renvoyaient qu’à un simple "mythe populiste", une Christiane Taubira pourrait encore exiger – sous les applaudissements de cette même extrême-gauche libérale – la "repentance" collective des Français d’aujourd’hui pour des crimes commis aux XVI° et XVII° siècles par un petit nombre de leurs ancêtres » (p.33). Soit dit en passant, Taubira a, entre autres, été un temps l'égérie de Bernard Tapie ! Tiens, au fait, n’est-ce pas le baratineur Emmanuel Macron qui, en Algérie, a décrété que la colonisation avait été un "crime contre l’humanité" ? Repentons-nous, mes frères !!! En chemise et la corde au cou ! Comme les bourgeois de Calais (ça avait une autre gueule que la "jungle", sous la patte de Rodin).
La mise en cause du système capitaliste qui met la planète en coupe réglée et qui bourre les crânes à coups d’idéologie libertaro-marchande est donc tout à fait impeccable. Quel dommage que Jean-Claude Michéa n’arrive pas à débroussailler sévèrement la forêt emberlificotée de ses raisonnements !
Ses ennemis, nombreux, soyons-en sûr, s'en félicitent.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, littérature, sociologie, philosophie, jean-claude michéa, notre ennemi le capital, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, pierre bourdieu, michel foucault, jacques derrida, jean-paul sartre, christiane taubira, repentance, élection présidentielle, emmanuel macron, crime contre l'humanité, bernard tapie, les bourgeois de calais, auguste rodin
mardi, 17 janvier 2017
L’ARÊTE ET LE GOSIER 2
UNE GROSSE ARÊTE EN TRAVERS DU GOSIER
2/2
C’est cette double postulation de Jean-Claude Michéa (mais aussi Orwell, Christopher Lasch, ...) que Nicolas Truong, le journal Le Monde et autres contradicteurs n’ont pas envie de comprendre : d’une part, vers plus de justice sociale par la régulation de l’économie et une redistribution plus équitable des richesses (une étude d'Oxfam vient de montrer que huit individus possèdent aujourd'hui autant que la moitié pauvre de l'humanité), et d’autre part, vers des relations plus harmonieuses entre les individus par une modération consentie apportée à l'exercice de la liberté et à la réalisation de leurs désirs, et un renoncement à faire de chacun de ceux-ci un « droit ». Autrement dit : pour que le mot « société » veuille dire vraiment quelque chose de fort et de cohérent, il faut que tous ceux qui la composent (Etat, entreprise, groupes minoritaires divers, individus, …) admettent que soient posées des limites. Le grand mot est lâché : des limites. Pour le dire autrement : admettent qu'on équilibre la puissance excessive de leur moteur au moyen d'un limiteur de vitesse. En clair : admettent de devenir raisonnables. Ce n'est pas gagné.
Car c’est cela qui contrarie certaines croyances qui ont cours dans toutes sortes de milieux, du football et des hauts dirigeants d’entreprises, où il est convenu de ne pas être choqué des rémunérations extraterrestres (Zlatan Ibrahimovic payé 1.300.000 euros par mois au PSG, Carlos Ghosn, de Renault-Nissan-Mitsubishi, payé 15 millions d'euros en 2015, sans parler des "bonus" irrationnels empochés par les "traders" les plus "performants"), jusqu'aux milieux artistiques où, toutes disciplines confondues, la plus grande considération est réservée à ceux qui ont érigé en principe la transgression des principes, le franchissement des limites, et où l’on s’occupe avant tout de "faire bouger les lignes", de choquer, de heurter, de dépayser, de déranger, de bousculer, de mettre en question, au motif que, sinon, les gens s’assoupiraient dans leur confort intellectuel et culturel, dans la facilité caricaturale de leurs « stéréotypes » et de leurs « préjugés », et qu’il n’y a rien de pire que le « conservatisme » (Jan Fabre et son maniement préférentiel du sexe, de la violence et de la scatologie dans ses mises en scène et, plus généralement, le foutage de gueule en vigueur chez les "artistes-plasticiens" de maints cercles de l'art contemporain).
A noter que tous ces "révolutionnaires", "iconoclastes", "rebelles" et autres "subversifs" sont finalement de grands conservateurs : ils ne tiennent pas du tout à ce que l'ordre des choses change en quoi que ce soit. Ils ne veulent pas tuer la poule aux œufs d'or qui leur déverse l'argent du mécène ou du contribuable : leur seule ambition est de modifier à leur gré la seule couche mince de l'épiderme des choses, en même temps que la perception que les gens en ont, et d'exercer leur intimidation sur les gogos un peu masochistes qui, parce qu'ils ont payé leur place, sont tombés en leur pouvoir et applaudissent à la fin.
Les deux ultralibéralismes (l'économique et le sociétal), bien qu'on ait coutume de tracer entre eux une ligne de fracture bien artificielle entre "droite" et "gauche", sont en fait de faux adversaires et de vrais complices, car ils se rejoignent fraternellement. La variante économique, doctrine fanatique, ne voit pas d'objection à l’enrichissement illimité, et quel que soit le prix à payer de la part des humains et de la nature, et se propose de tout privatiser (pour le rentabiliser), des entreprises autrefois publiques et des autoroutes jusque, bientôt, aux rues de nos villes et à l’air que nous respirons.
La variante sociétale, quant à elle, tout aussi fanatique, fait de l’égalitarisme et de l'indifférenciation dogmatique un programme impérieux et, par exemple, de la revendication homosexuelle une stupéfiante revendication « de gauche », au motif qu’il faut « décloisonner », « abattre les frontières », et contester par exemple la légitimité de supposés « stéréotypes » (coucou les revoilà) : on renvoie dans les ténèbres de l’archaïsme le slogan « un papa, une maman », au même titre que la nécessité de points de repère stables et différenciés pour la construction du psychisme de l’enfant, nécessité présentée par les promoteurs du mariage homo comme purement "fantasmatique" (dixit Irène Théry, membre du Conseil Supérieur de la Famille, auteur d'un rapport sur le sujet avant la loi Taubira). Il faut vivre et bouger avec son temps, c'est la "doxa". Gare aux contrevenants !
"Droite" économique et "gauche" sociétale, qui refusent de se dire bonjour quand elles se croisent dans la rue, sont pourtant animées par le même moteur, résumé dans un slogan : « No Limit ». C'est ainsi qu'on pourrait interpréter l'instauration du mariage homosexuel, moins comme une victoire de cette "gauche" qui plastronne, que comme l'aboutissement tout à fait logique d'un système, autrement dit comme un triomphe de l'ultralibéralisme en matière de mœurs. Je livre cette divertissante réflexion à la gamberge des bien-pensants de la gauche morale et homophile et du staff de campagne de l'ultralibéral chrétien François Fillon.
Inutile de dire que, selon moi, les acteurs de ces deux options ultralibérales sont les seuls véritables extrémistes, qui véhiculent avec complaisance l’idée qu’ils sont les seuls défenseurs du « Progrès », les seuls à « aller de l’avant » (cf. Le Complexe d'Orphée, Climats, 2011, du même Jean-Claude Michéa, où l'auteur formule l'interdit auquel tous les autoproclamés « progressistes » doivent se conformer : "tu ne regarderas jamais en arrière", sous peine de), à lutter contre « tous les conservatismes », « tous les immobilismes », et qui se gargarisent à déconsidérer leurs contradicteurs sous la défroque honteuse de divers vocables chargés en eux-mêmes d’une puissante charge négative, vocables qui vont de « pessimistes congénitaux » à « fachos », en passant par « passéistes », « antiprogressistes », « nostalgiques », « dinosaures » ou « réactionnaires » (avec la variante « néoréacs »), tous destinés à disqualifier ceux à qui ils s’adressent. A ceux qui l'accusent d'être opposé à tout progrès, Michéa répond très justement que c'est faux : il n'est opposé qu'au dogme du « progressisme » échevelé dont se targuent les partisans de l'ultralibéralisme.
Les djihadistes (plus d'actualité que "khmers rouges") de l'ultralibéralisme, qu’ils soient de l’espèce « économique » ou de l’espèce « sociétale », sont les seuls, c’est entendu, à défendre leur idée particulière du « Progrès » mais un progrès réduit à sa seule dimension de « potentiel d’innovation » : technique pour la première, sociétale pour la seconde.
Tous deux s'entendent comme larrons en foire, malgré les bisbilles apparentes et les dénégations. Les uns travaillent activement à chasser l’homme de la maîtrise de ses outils et à créer des objets qui le dépassent et lui échappent, du genre voiture autonome, smartphone, maison connectée ou « humanité augmentée », juste au motif que, à leurs yeux, « il y a un marché pour ces produits », avec en perspective le sort mirobolant qu’ils réservent à l'humanité : devenir une simple prothèse de ses machines.
Les autres, fascinés par un discours qui se présente comme « indéfiniment progressiste et émancipateur », n’ont de cesse que d’ajouter, au nom (ou au prétexte) de la liberté, de nouvelles libertés et de nouveaux droits à ceux déjà reconnus aux individus. On voit mijoter en ce moment la Gestation Pour Autrui (GPA) et l’extension du droit de la filiation aux couples homosexuels.
Alors maintenant, le titre du bouquin de Jean-Claude Michéa : Le Capital, notre ennemi ? Qu’en penser ? Eh bien au risque de passer pour présomptueux, voici ce que j’en pense. Cela tient en peu de mots : je pense que le capitalisme a définitivement gagné la partie, et que la citation de Rosa Luxemburg, que l’auteur à placée en exergue (« La lutte contre cet ordre est une nécessité pour la conservation de l’humanité »), est caduque depuis lurette. C’en est fait, l’humanité a perdu la guerre. Et certains ont beau faire les fiers (« On ne peut pas laisser faire ça ! Nous ne mourrons pas sans combattre ! »), la cause est entendue. Vous avez dit « défaitiste » ? A tort ou à raison, je dis « réaliste et lucide ». Mais ce n'est pas que je méprise pour autant les barouds d'honneur. Au contraire, j'encourage et quand quelqu'un dit : « Faut y aller ! », je dis : respect ! Chacun son truc.
On trouve sur le blog de Paul Jorion une vidéo où un journaliste de télé néo-zélandais dialogue avec Guy McPherson, professeur de biologie évolutive à l’université d’Arizona, que j’engage tout le monde à visionner, juste parce qu’elle décoiffe carrément, y compris, dans mon cas, les patinoires à mouches. Guy McPherson accorde (avec le sourire) à l’humanité un délai de survie de moins de dix ans. Il ne se fait pas de souci pour la planète, qui aura, après notre disparition, quelques millions d’années pour se régénérer. Inutile de dire que le journaliste (Paul), en s'agitant (il faut dire qu'il est un spectacle à lui tout seul), traduit l'incrédulité totale dans laquelle la population ordinaire est prête à accueillir ce genre de message (pour ceux qui comprennent l'anglais ; traduction en option sur le blog lui-même).
Que Guy McPherson, avec son air péremptoire et sûr de lui, bluffe, dise des conneries ou qu’il se trompe sur le délai, il a au moins raison sur un point : la fin du système est programmée. Mis en place d'abord par la civilisation européenne, et porté à son paroxysme par sa variante cancéreuse, matérialiste et conquérante, je veux parler de sa variante américaine, ce système aura entraîné dans son suicide (long comme un siècle sans pain) tout ce qui se sera laissé prendre à la glu de son mirage de bonheur matériel et de progrès technique.
Et ça fait pas mal de monde. Moi compris.
Ce n'est pas drôle du tout, je sais.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude michéa, george orwell, orwell anarchiste tory, christopher lasch, le seul et vrai paradis, la culture du narcissisme, journal le monde, nicolas truong, redistribution des richesses, ong oxfam, zlatan ibrahimovic, carlos ghosn, renault-nissan, bonus traders, jan fabre, irène théry, conseil supérieur de la famille, mariage homosexuel, manif pour tous, un papa une maman, christiane taubira, loi taubira, no limit, michéa le complexe d'orphée, djihadistes, khmers rouges, ultralibéralisme, gestation pour autrui, gpa, rosa luxemburg, paul jorion, blog paul jorion, guy mcpherson, notre ennemi le capitalisme, éditions climats
lundi, 16 janvier 2017
L’ARÊTE ET LE GOSIER 1
UNE GROSSE ARÊTE EN TRAVERS DU GOSIER :
JEAN-CLAUDE MICHEA
1/2
Décidément, il y a quelque chose qui ne passe pas avec Jean-Claude Michéa, qui vient de publier Notre ennemi, le capitalisme (Climats, 2017). (Toutes mes excuses pour l'erreur sur le titre exact, qui est Notre Ennemi, le Capital.) Ce trublion reste en travers de la gorge d'un tas de gens en place. Et curieusement, il dérange autant à droite qu’à gauche. Normalement, on sait très bien ce que c'est, la droite et la gauche. La différence est bien carrée : d'un côté les rouges, la révolution, le prolétariat ; de l'autre les blancs, le patronat, le capital. Là, on ne sait plus très bien.
Dans quelle case et sous quelle étiquette faut-il ranger Michéa ? Le Monde et Le Figaro hésitent, pataugent. Les points de repère reçus en héritage sont brouillés. Le premier en fait un "conservateur" bon teint. Le Figaro n’affiche pas directement sa perplexité, puisqu’on peut lire dans son numéro du 13 janvier l’interview croisée du philosophe et de son ancienne élève, Laetitia Strauch-Bonart, devenue elle-même philosophe, qui a pris à présent ses distances avec lui, et proclame son adhésion au capitalisme. La sacro-sainte neutralité du journaliste (Eugénie Bastié) peut sortir la tête haute de l'épreuve.
Le Monde y va plus carrément dans l'antipathie (ce n'est pas la première fois), qui lui consacre quatre pleines pages dans son numéro du 11 janvier : deux à la réception de l’œuvre dans la génération de ceux qui « ont moins de trente ans (…) et se réclament de penseurs comme Jean-Claude Michéa dans leur combat contre l’idéologie du progrès » ; deux autres à la recension du dernier ouvrage que l’auteur vient de publier, augmentée de trois commentaires, dont un de la déjà nommée Laetitia Strauch-Bonart et un autre du journaliste de la maison, Nicolas Truong (c'est lui qui s'y colle chaque fois qu'il est question de Michéa dans la rédaction).
Ce qui reste en travers du gosier de cette escadrille de braves journaleux, c’est que la thèse de Michéa sort de leurs sentiers intellectuels battus, rebattus, remâchés et rabâchés. Sur ces sentiers devenus des autoroutes, on présente comme une évidence, à droite, le mariage de la dérégulation généralisée en matière économique et d’un grand rigorisme en matière de mœurs, mariage bizarre et somme toute paradoxal, quoique très puissamment installé dans le paysage, incarné dans les positions affirmées dernièrement par François Fillon (ultralibéral et chrétien).
A gauche, c’est l’inverse : on donne libre cours à la liberté des individus en matière de mœurs, et l’on est prêt à leur ouvrir sans cesse de nouveaux « droits », fût-ce à l’infini, mais on souhaiterait (un peu) tenir les rênes courtes aux forces du marché, jugées aveugles et produisant injustices et inégalités criantes. Comme l'écrit la journaliste Fabienne Darge dans Le Monde daté 15-16 janvier, à propos d'un spectacle : « C'est toute une histoire qui prend corps ici, celle de ce moment particulier, le milieu des années 1970, où les soixante-huitards les plus lucides - et Foucault est des leurs - se rendent compte que la partie est déjà perdue, que la révolution est en train d'échouer sur le plan de la lutte des classes, mais qu'il reste une carte à jouer sur le terrain de la libération des mœurs ». Lucidité, vraiment ? Ou résignation ? En clair : puisque davantage de justice sociale est impossible, éclatons-nous et profitons de la vie pour explorer des voies de jouissance renouvelées. Une telle phrase résume en effet à merveille la capitulation finale de la gauche morale devant les forces du marché : ce n'est même plus "les rênes courtes", c'est carrément la désertion du champ de bataille, et, selon Fabienne Darge, le "grand philosophe" Michel Foucault est le prophète de cette désertion (et de cette "conversion").
A droite donc, l’accumulation indéfinie de richesses, mais une société plutôt « tenue » ("tradi", comme on dit) en matière de mœurs ; à gauche, une économie fermement tenue en laisse (très élastique, la laisse), mais des libertés et « droits » individuels proliférants. Si c'était une figure de rhétorique, on dirait un "chiasme", à cause du croisement.
La particularité de Jean-Claude Michéa, c'est d'analyser ces deux tableaux comme une double contradiction : on ne peut être à la fois « laxiste » et « rigoriste », même si les termes de l’équation s'inversent en passant de gauche à droite et réciproquement. Il y a incompatibilité entre les deux moitiés des personnes qui soutiennent la chose. La contradiction, pour lui, saute aux yeux.
Pour moi, qui ne suis pas philosophe (et que, pour être franc, la philosophie et l’armature argumentative qui va avec fatiguent assez vite : j'ai toujours été rétif aux cours de "philosophie-langue-étrangère"), c'est Jean-Claude Michéa qui a raison : non, on ne peut pas être dans le même temps laxiste et rigoriste. Si je veux reformuler en termes simples sa thèse fondatrice, je dirai qu'il tente de répondre à une question anthropologique de base : l’homme est-il dieu ou existe-t-il des limites à ses activités ? Tout est-il, au nom de la liberté, permis dans les pratiques des individus, des entreprises, des Etats ? C'est vrai que, posée comme ça, la question semble tout de suite plus limpide. En d'autres termes, l'homme est-il IndiviDieu ? A la base de l'interrogation de Michéa, il y a probablement, dans la lignée de George Orwell, la question morale.
Je prends un exemple hors-sujet : faut-il suivre Yann Robin, jeune compositeur dont le gros machin sonore à base de violoncelle torturé, un « concerto » paraît-il, a été diffusé sur France Musique le 14 janvier, quand, digne successeur du Luciano Berio des Sequenze, il déclare à une certaine Odile Sambe de Ricaud qu’il faut pousser les instruments dans leurs derniers retranchements, leur faire cracher leurs poumons (là, c'est moi qui parle, remarquez que je n’ai pas dit « glavioter leurs éponges », on sait se tenir), et qu’il ne revendique hautement de limites que celles de son imagination et celles, techniques, des interprètes de sa musique ? (Oui, j'ai écouté ça. Ci-dessous Sequenza III par Cathy Berberian, pour donner une idée des "derniers retranchements".)
Les fervents diront qu’ « on n’arrête pas le progrès », et que l’histoire de la musique occidentale, des premières polyphonies et de l’Ars nova de Guillaume de Machaut jusqu’à Beethoven, Schönberg et Messiaen, n’est à elle seule qu’une longue illustration de ce qu’est, en soi, le « Progrès ». Je dirai que si les critères de composition n’ont pas cessé de changer, ce n’est aucunement la preuve d’un « Progrès » en musique, comme le soutenait mordicus l'incarnation du soviet musical suprême Pierre Boulez, mais tout au plus d’une évolution et de changements divers que le temps a accumulés.
Si l’on ne peut que constater que les compositeurs n’ont cessé d’innover au cours du temps, cela n’autorise personne à faire de l’innovation – vaste suite de faits observables, mais neutres, quoi qu'on puisse en dire – l'objectif final de la création. Ce serait transformer (magie !) un fait en but, probablement dans l'intention de conférer je ne sais quel "sens" à l'Histoire (un pas que Boulez n'hésite pas à franchir). L'histoire de la musique se raconte "a posteriori" : faire de l'innovation une condition "a priori" met donc la charrue devant les bœufs. La manipulation tient du canular ou du tour de passe-passe. Et Boulez, malgré son épouvantable façon de se prendre au sérieux, est un blagueur.
Voilà : l’homme est-il dieu ? Doit-il poser des limites à son ambition ? C’est donc à ces questions que Jean-Claude Michéa s’efforce de répondre depuis ses premiers travaux sur George Orwell, qu’un de ses ouvrages désignait comme un « anarchiste tory », formule étrange aux yeux d'un membre patenté de l’intelligentsia « degôche » : comment peut-on être à la fois anarchiste (supposé plutôt à gauche) et conservateur (supposé de droite) ? C’est ce que ne comprend pas Nicolas Truong dans son commentaire de Notre ennemi, le capital, dans Le Monde du 11 janvier.
Le journaliste l’avoue d’entrée de jeu : « C’est un professeur de philosophie de lycée [on a compris : pas un « philosophe » au sens plein, selon le journaliste], à présent retraité [merci pour lui] qui séduit autant dans les milieux libertaires qu’au sein des cénacles identitaires, un auteur prisé aussi bien par certains lecteurs du "Diplo" que par la jeune garde du Figaro ». C’est bien ça, la perplexité du Monde : Michéa est-il d’extrême-droite ou d’extrême-gauche ? Est-il un "anarchiste" ou un "tory" ? Réponse : les deux, mon général (ou plutôt : un peu des deux). C’est aussi mon cas, comme j’ai tenté de l’expliquer ici même le 4 mai 2015.
On ne pourra pas contester, j'espère, que j'ai un peu de continuité dans les idées. Mais Jean-Claude Michéa s'est davantage concentré sur le domaine, et depuis bien plus longtemps : il est un peu plus crédible.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, jean-claude michéa, notre ennemi le capitalisme, journal le monde, journal le figaro, laetitia strauch-bonart, éditions climats, nicolas truong, journalistes, politique, société, françois fillon, ultralibéralisme, yann robin, france musique, odile sambe de ricaud, musique, composition musicale, musique ancienne, musique contemporaine, ars nova, guillaume de machaut, beethoven, schönberg, messiaen, pierre boulez, dodécaphonisme, sérialisme, musique sérielle, george orwell, eric blair, george orwell anarchiste tory, fabienne darge, michel foucault, luciano berio, sequenza iii, cathy berberian
lundi, 09 janvier 2017
LA GAUCHE COSMÉTIQUE 1
1/3 – La gauche esthétique.
Je dois être singulièrement bouché ou infirme de la comprenette. Voilà-t-il pas un commentateur politique qui, étudiant les affiliations politiques des jeunes (de tel âge à tel âge), déclare qu'une partie (sur quatre) rejoint les réacs, dont le chef de file s'appelle, d'après lui, Jean-Claude Michéa. Jean-Claude Michéa, un réac ! J'avoue que sur le moment, ça m'a bien fait rire. Pour quelle raison ? Je crois que, dans le fond, elle est assez claire.
Je commencerai par une remarque de vocabulaire : tous les journalistes, commentateurs et politiciens ont à la bouche la phrase de Camus : « Mal nommer les choses, c'est ajouter aux malheurs du monde », mais aucun d'eux ne peut s'empêcher dans la phrase suivante d'ajouter aux malheurs du monde en posant de mauvais mots sur les choses. Ainsi du mot "réac", qui fonctionne aujourd'hui comme une insulte réduisant son destinataire à une pauvre petite chose idéologique, indigne de considération.
Pour répondre plus sérieusement à la question que je me suis posée, je dirai que, de façon insistante, Michéa, au fil de ses ouvrages, s'en prend en effet au mythe du progressisme sociétal. Il part d’une observation originale : les gens dits « de droite » (tenez, au hasard, François Fillon) sont rigoristes en matière de mœurs, mais favorables aux privatisations et à la dérégulation totale de l’économie. Ici la contradiction est directement perceptible : laisser-faire (« libérer les énergies », comme dit Pierre Gattaz) d’un côté, pérennité de traditions et d’interdits de l’autre (« fais pas ci fais pas ça », comme dit Jacques Dutronc).
L’IndiviDieu.
Les gens qui se proclament « de gauche », tout au contraire, voudraient encadrer la vie économique dans des lois et règlements, mais déréguler totalement les mœurs pour laisser libre cours aux désirs des individus. Ils se sont mis à promouvoir une démarche indéfiniment « progressiste et émancipatrice » : accroissement permanent des droits des individus, épanouissement personnel, accomplissement de soi-même, et autres fables dans l’air du temps, fondées sur la conviction que les perspectives d’émancipation sont sans limite. Ce n’est même plus d’individu qu’il faut parler, mais d’IndiviDieu, sur le moindre désir duquel est façonnée la loi. C’est du sur-mesure.
Mais la contradiction, ici, est plus étrange. C’est en effet Margaret Thatcher qui, avec Ronald Reagan, a impulsé la "révolution financière" de l'économie, et remis en selle l'extrémisme capitaliste tel qu'il tyrannisait le petit peuple dans la deuxième moitié du XIX°siècle, qui déclarait qu’elle ne savait pas ce qu’était un « peuple », et qu’elle ne connaissait que des « individus ». L’ultralibéralisme ignore en effet ce qu’est une société : il n’existe pour lui que des collections d’individus. Cela tombait bien : la « gauche » s’est emparée du concept en l’appliquant cette fois à l’univers des mœurs. La contradiction (disons l'hypocrisie) ici consiste à adopter pour promouvoir une idée l'arme idéologique de l'adversaire que l'on combat.
Cette contradiction, partagée au fond par les tenants de la "gauche" et de la "droite", quoiqu'en sens inverse, est allègrement portée et colportée sans être vue comme telle par ceux qui la professent.
Or Jean-Claude Michéa (par exemple dans L'Empire du moindre mal) ne fait que mettre le doigt sur un manque évident de cohérence : comment peut-on sans se contredire condamner et combattre le libéralisme quand il s'agit d'économie, et en faire un éloge sans nuance en matière de mœurs ? A l'inverse, comment peut-on sans se contredire laisser financiers et actionnaires faire la loi, et prêcher en matière de mœurs un conservatisme rigoriste ? Il n'y a guère que les libertariens américains qui soient cohérents, puisqu'ils voudraient voir disparaître l'Etat régulateur en même temps qu'ils laissent aux individus toute liberté de mode de vie.
J'ai déjà dit (par exemple ici, ou là) que d'une part, selon moi, il n'y aura un minimum de justice sociale que sous la protection des lois et de l'Etat régulateur, mais que d'autre part tous mes désirs (avoir un enfant, m'envoyer en l'air, etc.) ne me donnent pas tous les droits. Tous les désirs ne sont pas légitimes du seul fait qu'on les éprouve, sinon il faudrait remettre en liberté séance tenante tous les pédophiles, violeurs, etc. Le point de cohérence de cette conception, c'est la notion de limite : il existe des limites qu'il n'est pas bon d'outrepasser. Mieux : il existe des limites qu'on n'a pas le droit d'outrepasser. Non, tout n'est pas permis, qu'on soit un Etat, une entreprise ou un individu. C'est une morale si l'on veut. C'est un choix anthropologique. C'est aussi ce qui fait de moi (et de quelques autres, heureusement) une anomalie politique, puisque cela me définit comme étant de "gauche-droite".
La gauche s'est mise à colporter ce mythe du progressisme sociétal le jour où elle s'est rendue à l'ennemi en rase campagne, en abandonnant toute perspective de progrès social (ne parlons même pas de perspective révolutionnaire, ça fait longtemps que). Le progrès social, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui chemine vers plus de justice, c'est-à-dire vers une diminution des inégalités au moyen d'une redistribution plus équitable des richesses produites. A cet égard, je suis resté obstinément attaché à la gauche aussi solidement que le byssus ancre la moule à son rocher.
Or à cet égard, rien ne va plus. Comme le disent quelques économistes (Thomas Piketty dans son Le Capital au XXI°siècle, ou Daniel Cohen), le tsunami des inégalités de revenus a tout emporté sur son passage : 1% de la population américaine a capté 50% de la production des richesses dans les trente dernières années. Pendant ce temps, les working poors se multiplient dans les pays développés (huit millions en France, chiffre INSEE). Que propose le Parti socialiste, cette salle des pas perdus qui incarna, paraît-il, les idéaux de gauche ? Et qu'a-t-il fait pour remédier à ce problème intolérable ? Rien.
Putasserie socialiste.
La véritable putasserie qui fait de la soi-disant gauche une monstruosité morale et idéologique, c'est qu'elle s'est livrée à un tour de passe-passe inouï (un véritable "coup de bonneteau"), quand elle a supprimé de son programme le progrès social pour y substituer le "progrès sociétal", une immondice en même temps qu'une imposture et une trahison, et qu'elle a cessé de prendre la défense de ceux qui sont dans la nécessité de travailler pour vivre (c'est-à-dire pas tout le monde, mais pas loin). Du coup, elle a détourné les yeux de la basse réalité, c'est-à-dire de la montée irrésistible de la pauvreté. Les socialos s'écrient, comme Jean Gabin dans La Traversée de Paris : « Salauds d'pauvres ! ».
Qu'est-ce qu'elle dit, cette gauche sociétale ? Elle enfume. En déclarant qu'elle accepte la société de marché, la soi-disant gauche s'est inclinée devant la loi du marché, vous savez, cet autre nom de la loi de la jungle. La gauche cosmétique a capitulé devant le capital. Pour la faire taire, le capitalisme financiarisé lui a laissé un os à ronger : le "progrès sociétal", une marchandise bourrée d’un fort potentiel d’innovation, pour qu'elle la boucle sur l'essentiel : la conservation de l'ordre marchand, priorité absolue de ceux qui détiennent la richesse et refusent de la partager. C’est à cette condition que le capital a laissé la « gauche » gouverner.
Ayant ainsi vendu son âme, c'est devenu une gauche purement esthétique et cosmétique. Sa seule ambition (du « changer la vie » de François Mitterrand au « le changement, c'est maintenant » de François Hollande) fut désormais de repeindre les boiseries et de changer les papiers peints, sans toucher aux fondations, ni même modifier l'architecture en quoi que ce soit. Son seul discours devint un pur baratin baratinant. Ce fut la gauche baratineuse.
Parmi toutes les hautes figures de faussaires engagés sous la bannière du Parti Socialiste, le plus brillant représentant fut indéniablement Jack Lang, figure indépassable de l’abjection et de la pourriture politiques, qui finit ses jours dans l'orgueilleuse opulence des dignités octroyées.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, parti socialiste, françois hollande, françois mitterrand, jean-claude michéa, philisophie, réactionnaire, pierre gattaz, jacques dutronc, jack lang, société de marché, capitalisme, changer la vie, le changement c'est maintenant, margaret thatcher, ronald reagan, ultralibéralisme, redistribution des richesses
samedi, 28 mai 2016
NARCISSE SERA LE GENRE HUMAIN
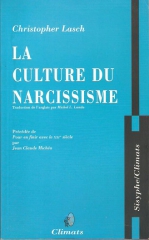 1
1
La Culture du narcissisme (Climats, 1979) est la « Sublime Porte » par laquelle j’étais entré dans l’œuvre de Christopher Lasch (après avoir été incité à lire l’œuvre de ce penseur puissant par la première page de L’Enseignement de l’ignorance, de Jean-Claude Michéa, tout petit livre au titre percutant et pertinent). J’avais lu ce maître-livre en 2006. Dix ans après, j’y suis revenu, et je ne le regrette pas : la teneur du propos m’apparaît, me semble-t-il, de façon plus claire et probante qu’à la première lecture.
Christopher Lasch commence très fort. Pour donner le ton, dernière phrase de la préface de l’auteur : « Le refus du passé, attitude superficiellement progressiste et optimiste, se révèle, à l’analyse, la manifestation du désespoir d’une société incapable de faire face à l’avenir ». Avis à tous les fidèles croyants qui se prosternent devant le dieu « Progrès », devant la moindre « avancée » sociétale et devant la moindre innovation technique, et qui pensent régler les problèmes actuels en persévérant dans la même voie, par exemple en ajoutant de la technique à la technique pour résoudre les problèmes posés par l'expansion des moyens techniques.
Le même mépris pour les incroyants, la même foi, le même aveuglement, le même fanatisme les poussent à traiter de « passéistes », « nostalgiques », « archaïques », « arriérés », « dépassés », « obsolètes » et autres fadaises à la mode, si possible injurieuses, ces affreux pessimistes qui, face à la montée des multiples menaces suspendues au-dessus de l’humanité et de la planète, regardent la réalité en face, et crient « au fou ! ». Bien sûr sans aucune chance d’être entendus. "Au fou ! Au fou !" Damia chantait déjà ça il y a fort longtemps (« Tout fout le camp », 2'51", 1937 ou 1939, suivant les sources en ligne - "Damia" ou "Raymond Asso", le parolier).
Ce que j’apprécie dans la prose de Christopher Lasch, c’est d’abord l’effort de lucidité sur le sens qu’il faut accorder à la façon dont la civilisation évolue, et que le système en place présente comme le Progrès, forcément désirable. Et l’effort est intense : que n’a-t-il pas lu pour alimenter sa réflexion ! Le nombre et la diversité des auteurs chez lesquels il puise impressionnent.
Ensuite, je suis reconnaissant à Christopher Lasch de ne pas se payer de mots, je veux dire qu’il ne se réfère pas aux grands penseurs qui ont élaboré de complexes systèmes philosophiques très abstraits, purement théoriques (Kant, Hegel, Heidegger, …), et qui vous martèlent le crâne à coups de concepts abstrus et baragouineux. Les paroles verbales, c’est pas son truc. L’auteur ne s’adresse pas à de purs esprits, à des initiés, à des spécialistes : il veut se faire comprendre du vulgum pecus. Cela tombe bien : je suis du vulgum pecus. S’il est philosophe, c’est à hauteur d’homme ordinaire.
Pour faire contraste, je viens de faire l’effort de tenter de relire La Barbarie de Michel Henry (Grasset, 1987) : je n'ai pas pu, il m’est tombé des mains. Il y a des phrases qui me font hurler de rire : « Mais l’auto-affection n’est pas un concept vide ou formel, une proposition spéculative, elle définit la réalité phénoménologique de la vie elle-même – une réalité dont la substantialité est sa phénoménalité pure et dont la phénoménalité pure est l’affectivité transcendantale » (p.30-31). Faut-il vous l’envelopper ? Rien à voir avec La Défaite de la pensée, d’Alain Finkielkraut, paru la même année. Le pire, c’est que l’auteur de cette phrase (qui n’est pas la pire qui se puisse trouver) devait en être assez fier.
Le registre auquel se tient Christopher Lasch, tout à fait concret, recourt heureusement à des écrivains, sociologues, chercheurs qui, observant leur époque et s’interrogeant sur la direction prise par la civilisation et sur la signification des innovations techniques et sociétales qu’elle met en place, proposent des analyses qui tantôt applaudissent à la façon dont la société évolue, tantôt critiquent tel ou tel aspect de cette évolution, mais d’une façon qui selon l’auteur ne va pas au fond des choses ou tape à côté de la cible. Lasch s'en prend à la façon dont les différents pouvoirs tentent d'imposer des représentations qui leur soient idéologiquement favorables, plus ou moins relayés par les auteurs auxquels il se réfère. Il soumet à des critiques de fond, les plus englobantes possibles, ces représentations et les discours qu'elles fabriquent.
Que dit Christopher Lasch de la société américaine et de la civilisation qu’elle a fini par imposer au reste du monde, y compris à toutes sortes d’islamo-machins qui traitent (officiellement, car il faut regarder derrière le rideau pour savoir ce qu’il en est en réalité) les Etats-Unis de « Grand Satan » ? Eh bien, pour tout dire, il n’est pas fier du résultat, non plus que de la tournure qu’ont prise les choses au moment où il publie son livre (1979, c’était hier).
Il puise son pessimisme, je l’ai dit, dans des écrits de tous horizons, qui vont d’ouvrages de sciences humaines, philosophiques ou autres, à la littérature pure. Ce qu’il cherche, c’est à s’imprégner de la façon dont ces écrivains perçoivent le monde dans lequel ils vivent, dont ils l’interprètent et en rendent compte. De tout ce matériau qu’il s’efforce de synthétiser, il élabore sa propre interprétation en la situant au fur et à mesure par rapport à eux.
La tendance dominante qui permet de comprendre et d’expliquer ce qui se passe est, selon lui, au premier chef, le narcissisme. Le titre de son premier chapitre, « L’invasion de la société par le moi », n'y va pas par quatre chemins. Il attribue la montée irrésistible du narcissisme dans la psychologie collective à une résignation devant l’ordre des choses, que les gens ont longtemps espéré pouvoir changer, et qui s’est révélé beaucoup plus rétif aux changements qu’ils ne l’envisageaient.
D’où un certain désenchantement : « Après le tumulte politique des années 1960, les Américains se sont repliés vers des préoccupations purement personnelles. N’ayant pas l’espoir d’améliorer leur vie de manière significative, les gens se sont convaincus que, ce qui comptait, c’était d’améliorer leur psychisme » (p.31). S’ensuivent un tas d’activités qui se développent autour des soins du corps et de l’âme, et un centrage de l’attention sur soi-même.
J’ajoute pour mon compte qu’on a pu observer l’invraisemblable allongement des rayons consacrés par les supermarchés du livre aux rubriques « bien-être » et « développement personnel ». Et tout cela est produit par le désinvestissement du politique, c’est-à-dire par l’abandon de l’idée qu’une volonté politique peut agir sur le réel pour le transformer et l’améliorer. Ce que Hannah Arendt considère comme l'activité humaine la plus noble est l'action, et dans la sphère politique : la faculté d'agir collectivement pour orienter la société dans telle ou telle direction. C'est en cette affirmation de la liberté que les gens, selon Lasch, ne croient plus.
A la longue, ce besoin régressif d’être pris en charge, ce besoin que quelqu’un vous donne des conseils sur la marche à suivre, ce besoin que quelqu’un vous mette en sécurité et vous donne la solution du bonheur immédiat a, depuis l’écriture du livre de Christopher Lasch, donné naissance à un monde où les gens, se sentant de moins en moins autonomes, ont remis les clés de leur existence à je ne sais combien de « spécialistes », « entraîneurs » et autres « guides spirituels » plus ou moins illuminés. Le métier de « coach » prolifère comme la vermine, comme si les gens avaient perdu leur propre nord. Il y a ici à l'oeuvre un processus d'infantilisation.
De quoi se demander, quand les populations elles-mêmes sont dans un tel état de délabrement intérieur, ce que devient la volonté de liberté, condition sine qua non de l’exercice effectif de la démocratie.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, christopher lasch, éditions climats, la culture du narcissisme, jean-claude michéa, l'enseignement de l'ignorance, société, chanson, damia tout fout le camp, philosophie, michel henry la barbarie, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, états-unis grand satan, hannah arendt, condition de l'homme moderne
mercredi, 30 mars 2016
JEAN-CLAUDE MICHÉA ANTILIBÉRAL
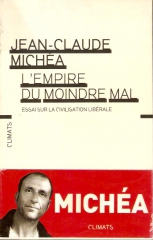 Je viens de relire L’Empire du moindre mal (Climats, 2007) de Jean-Claude Michéa, le professeur de philosophie de Montpellier, l’auteur de l’excellent L’Enseignement de l’ignorance (Climats, 1999), à qui l’on doit de pouvoir lire en français un auteur aussi important que l’Américain Christopher Lasch (La Culture du narcissisme, Le Seul et vrai paradis, Le Moi assiégé, …). Michéa s’est aussi intéressé à George Orwell (G.O. anarchiste tory, G.O. éducateur).
Je viens de relire L’Empire du moindre mal (Climats, 2007) de Jean-Claude Michéa, le professeur de philosophie de Montpellier, l’auteur de l’excellent L’Enseignement de l’ignorance (Climats, 1999), à qui l’on doit de pouvoir lire en français un auteur aussi important que l’Américain Christopher Lasch (La Culture du narcissisme, Le Seul et vrai paradis, Le Moi assiégé, …). Michéa s’est aussi intéressé à George Orwell (G.O. anarchiste tory, G.O. éducateur).
Avec l’ouvrage présent, Michéa a écrit un bon livre, malgré ce que j’estime être un défaut, mais que l’auteur cultive avec soin comme un plaisir : farcir son texte de ce qu’il appelle des « scolies » (un scoliaste était un commentateur), qui apparaissent comme autant de digressions, comme il y a, dans la grotte de Rouffignac, plusieurs « diverticules » à partir de la galerie principale. Bon, ces notes sont regroupées en fin de chapitre, mais elles n’empêchent pas, hélas, la présence de notes en bas des pages. Passons : le texte proprement dit est assez intéressant pour faire oublier cette ombre au tableau.
Jean-Claude Michéa étudie dans ce bouquin les principes qui sous-tendent la conception libérale de la civilisation (il dit « civilisation libérale »). J’ai bien du mal, pour ma part, à entrer dans des problématiques philosophiques. Ou plutôt, peut-être, dans la formulation philosophique d’une problématique. Je ne suis décidément pas philosophe, tout au moins dans un sens canonique, scolaire, universitaire, bref : conceptuel.
Je me console en grappillant, en picorant dans mes lectures de quoi alimenter mes réflexions et plus souvent, soyons honnête, confirmer mes convictions (argumenter dans un débat vise moins à convaincre autrui qu'on a raison qu'à renforcer ses propres convictions). Qu'on n'attende donc pas ici un compte rendu en forme du livre de Michéa : j'y ai pioché, sans vergogne, ce qui m'intéressait, pas plus. Je ne me rappelais plus où j’avais trouvé l'idée comme quoi on observe une étrange contradiction dans le champ des idées politiques : je me demandais pourquoi les « libéraux » économiques étaient forcément classés à droite, alors qu’on rangeait à gauche les « libéraux » sociétaux.
Que je le veuille ou non, je me retrouve en effet très loin, tout là-bas à droite, quand on parle de mariage homosexuel, de « minorités visibles », de repentance à l’égard des anciens peuples colonisés, de contrition sur l'île de Gorée en mémoire des esclaves de la « traite atlantique », de tolérance à l’égard du voile islamique, et de tout ce qui « milite » pour des « causes » (antiracisme, féminisme, etc.), alors qu’en matière d’économie et de politique, on me cataloguera très loin sur la gauche, au seul motif que je crois en un idéal de justice sociale, de lutte contre les inégalités (à ne surtout pas confondre avec toutes les « revendications d’égalité ») et de redistribution des richesses, dans la lignée des analyses de Thomas Piketty dans Le Capital au XXI° siècle.
J’essayais d’expliquer ce drôle de paradoxe ici même le 4 mai 2015. En cherchant le principe unificateur à même de surmonter la contradiction ci-dessus, j’en arrivais à la conclusion que j’étais nettement antilibéral. Une trouvaille ! Et ce qui résout la dissonance apparente, c'est que, selon moi, le fait de vivre en société interdit de se croire tout permis, qu’on soit un chef d’entreprise, un financier ou un individu lambda, ou qu’on soit arabe, noir, homosexuel, handicapé, femme ou normal.
Tout n’est pas permis, que ce soit dans le monde de l’entreprise, du travail, de la finance, ou dans le monde des mœurs, des coutumes, des comportements. Pour tout dire, le désir, quel qu'il soit, ne légitime pas n'importe quoi. Il est incroyable que certains, du seul fait qu'ils désirent quelque chose, revendiquent cette chose comme un "droit", sous prétexte d' "égalité". Il faut des limites à l'entrepreneur, de même que l'individu est contenu dans une peau. Pourtant, selon les catégories communes, je reste quand même à la fois "progressiste" et "conservateur". Comment se fait-ce ?
En fait, j’ai trouvé, en relisant Michéa, où cet apparent paradoxe figurait : dans les premières pages de L’Empire du moindre mal. Je cite tout le paragraphe : « Mais parler de "logique libérale" implique également que, par-delà la multiplicité des auteurs et les nombreuses différences qui les opposent sur tel ou tel point, il est possible de traiter le libéralisme comme un courant dont les principes non seulement peuvent, mais, en fin de compte, doivent être philosophiquement unifiés. C’est évidemment ce point que de nombreux lecteurs hésiteront à concéder. Car si tel est bien le cas, cela rend beaucoup plus difficile l’opération habituelle de ceux qui, à l’image d’une grande partie de la gauche et de l’extrême-gauche contemporaines, s’emploient à opposer radicalement le libéralisme politique et culturel (défini comme l’avancée illimitée des droits et la libéralisation permanente des mœurs) et le libéralisme économique – les développements émancipateurs du premier étant fondamentalement indépendants des nuisances du second » (p.15-16). Bon sang, mais c’est bien sûr ! Ah ça c’est vrai que la gauche sociétale en prend pour son grade. A raison.
Pour moi, s'il n’y avait qu’un paragraphe à garder de tout le livre, ce serait celui-là. C’est vrai, ensuite, l’auteur entre dans des analyses subtiles et documentées et s’efforce d’appuyer sa thèse sur une argumentation probante, mais l’essentiel est dit. Je dirais presque que ça me suffit. Le reste ne fait que confirmer ce qu’on sait déjà : pour le libéralisme, surtout dans sa version fanatique, intégriste et débridée, il n’y a pas d’universaux, à l’exception, du strict point de vue de l’individu (qui est par nature égoïste), de son intérêt à lui.
Partant de là, il ne faut pas que des lois à valeur universelle viennent entraver le libre jeu de la poursuite de son intérêt par chacun : « L’autorité du Droit libéral n’est, en effet, légitime, on l’a vu, que parce qu’elle se borne à arbitrer le mouvement brownien des libertés concurrentes, sans jamais faire appel à d’autres critères que les exigences de la liberté elle-même ; lesquelles se résument, pour l’essentiel, à la seule nécessité de ne pas nuire à autrui » (p.38). Michéa, au fond, est d’accord avec Alain Supiot (La Gouvernance par les nombres), qui dit que le système actuel tend irrésistiblement à substituer à des Lois surplombantes auxquelles tout le monde serait indistinctement soumis, la généralisation du Contrat, dans lequel tout litige serait réglé, mettons, par un « Tribunal arbitral ». Car les libertés étant "concurrentes", il faut un arbitre.
Jean-Claude Michéa ajoute que la société libérale fait une confiance absolue, d’une part au Marché, d’autre part au Droit, qui « suffisent par eux-mêmes à engendrer toutes les dispositions culturelles indispensables à l’intégration communautaire des individus » p.135). Ce qu’elle cherche à établir, c’est « un ordre humain efficace » (ibid., je souligne).
Il résume ainsi la vie en société selon les tenants de la civilisation libérale : l’aptitude des individus, « pour l’essentiel, à conclure des affaires et à respecter des contrats » (ibid.). Dans un tel système, il ne faut pas s’étonner de voir saper l’ordre patriarcal, puisque sont discréditées « toutes les références à une loi symbolique » (p.173). Fini les Vérités universelles, place aux « parties contractantes ».
Enfin un bon terrain libéral, où l’on verra s’appliquer la célèbre citation de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit ». La morale finale de la civilisation libérale est : liberté pour les loups.
Cette société est produite, disons-le, par une vision protestante de l’humanité, vision éminemment pessimiste : l'humanité sans perspective autre que réduite aux échanges marchands. Michéa parle même d’une « anthropologie désespérée » (p.197). Ah oui, Philippe Muray a bien raison de dire que "le protestantisme est une idée catholique devenue folle".
Paul Jorion (voir ici deux derniers jours) a raison d’être pessimiste au sujet de l’avenir de l’humanité. Oui, définitivement sans doute, comme Jean-Claude Michéa, je suis un antilibéral.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-claude michéa, l'empire du moindre mal, société, civilisation, l'enseignement de l'ignorance, éditions climats, christopher lasch, la culture du narcissisme, le seul et vrai paradis, le moi assiégé, ultralibéralisme, thomas piketty, le capital au 21° siècle, alain supiot, la gouvernance par les nombres, lacordaire, philippe muray, paul jorion
mardi, 08 décembre 2015
LE VINGTIÈME SIÈCLE ET LES ARTS 3/9

ESSAI DE RECONSTITUTION D’UN ITINÉRAIRE PERSONNEL
(récapitulation songeuse et un peu raisonnée)
3/9
De l'importance de la lecture.
Ce qui est sûr, c’est que l’art contemporain, la musique contemporaine, la poésie contemporaine (en ai-je bouffé, des manuscrits indigestes, futiles, vaporeux ou dérisoires, au comité de lecture où je siégeais !), tout cela est tombé de moi comme autant de peaux mortes. De ce naufrage, ont surnagé les œuvres de quelques peintres, de rares compositeurs, d’une poignée de poètes élus. Comme un rat qui veut sauver sa peau, j’ai quitté le navire ultramoderne. J'ai déserté les avant-gardes. C’est d’un autre rivage que je me suis mis à regarder ce Titanic culturel qui s’enfonçait toujours plus loin dans des eaux de plus en plus imbuvables.
Comment expliquer ce revirement brutal ? Bien malin qui le dira. Pour mon compte, j’ai encore du mal. Je cherche. Le vrai de la chose, je crois, est qu’un beau jour, j'ai dû me poser la grande question : je me suis demandé pourquoi, tout bien considéré, je me sentais obligé de m’intéresser à tout ce qui se faisait de nouveau.
Mais surtout, le vrai du vrai de la chose, c’est que j’ai fait (bien tardivement) quelques lectures qui ont arraché les peaux de saucisson qui me couvraient les yeux quand je regardais les acquis du 20ème siècle comme autant de conquêtes victorieuses et de promesses d'avenir radieux. J’ai fini par mettre bout à bout un riche ensemble homogène d’événements, de situations, de manifestations, d’analyses allant tous dans le même sens : un désastre généralisé. C’est alors que le tableau de ce même siècle m’est apparu dans toute la cohérence compacte de son horreur, depuis la guerre de 14-18 jusqu’à l’exploitation et à la consommation effrénées des hommes et de la planète, jusqu'à l’humanité transformée en marchandises, en passant par quelques bombes, quelques génocides, quelques empoisonnements industriels.
 Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
Au premier rang de ces lectures, je crois pouvoir placer Les Origines du totalitarisme, de Hannah Arendt : un panorama somme toute effrayant sur l'histoire longue de l'Europe. A tort ou à raison, j’ai déduit de ce livre magnifique et complexe que le nazisme et le stalinisme étaient non pas des parenthèses monstrueuses de l’histoire, mais deux formes de parfait accomplissement du système capitaliste, en phases simultanées de rationalisation intégrale de la vie et de despotisme halluciné de l’irrationnel. Un système totalitaire met en œuvre de façon parfaitement rationnelle un délire absolu. A moins qu'il ne mette en œuvre de façon totalement délirante un absolu de la Raison.
A tort ou à raison, j’ai conclu de cette lecture décisive qu’Hitler et Staline, loin d’être les épouvantails, les effigies monstrueuses et retranchées de l’humanité normale qui en ont été dessinées, n’ont fait que pousser à bout la logique à la fois rationnelle et délirante du monde dans lequel ils vivaient pour la plier au fantasme dément de leur toute-puissance. Hitler et Staline, loin d’être des monstres à jamais hors de l’humanité, furent des hommes ordinaires (la « Banalité du Mal » dont parle Hannah Arendt à propos du procès Eichmann). Il n'y a pas de pommes s'il n'y a pas de pommier. Ils se contentèrent de pousser jusqu’à l’absurde et jusqu’à la terreur la logique d’un système sur lequel repose, encore et toujours, le monde dans lequel nous vivons.
Hitler et Staline (Pol Pot, …) ne sont pas des exceptions ou des aberrations : ils sont des points d’aboutissement. Et le monde actuel, muni de toutes ses machines d’influence et de propagande, loin de se démarquer radicalement de ces systèmes honnis qu’il lui est arrivé de qualifier d’ « Empire du Mal », en est une continuation qui n’a eu pour talent que de rendre l’horreur indolore, invisible et, pour certains, souhaitable.
Un exemple ? L’élimination à la naissance des nouveau-nés mal formés : Hitler, qui voulait refabriquer une race pure, appelait ça l’eugénisme. Les « civilisés » que nous sommes sont convenus que c’était une horreur absolue. Et pourtant, pour eux (pour nous), c’est devenu évident et « naturel ». C’est juste devenu un « bienfait » de la technique : permettre de les éliminer en les empêchant de naître, ce qui revient strictement au même. C’est ainsi que, dans quelques pays où la naissance d’une fille est une calamité, l’échographie prénatale a impunément semé ses ravages.
 D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système
D’ailleurs c’est au sujet de la technique que, grâce à un certain nombre d’autres lectures, s’est poursuivi le travail qui a fini par saper en moi, jusqu'aux fondations, la croyance dans le « Progrès ». Les ouvrages de Jacques Ellul (Le Système technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
technicien, Le Bluff technologique) ont, entre autres, marqué cette facette de l’évolution. La lecture récente de L’Obsolescence de l’homme, de Günther Anders (premier mari de Hannah Arendt), n’a rien fait pour arranger ma vision des choses.
Je citerai une troisième facette de ladite évolution : une réflexion tirée d’ouvrages d’économistes, parmi lesquels ceux du regretté Bernard Maris (à  commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
commencer par les deux volumes de son Antimanuel d’économie), assassiné en janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo. Dans ses débats hebdomadaires avec l’ultralibéral Jean-Marc Sylvestre, le vendredi, il m’avait ouvert les yeux sur la possibilité de conserver une société humaniste fondée sur le partage et la redistribution des richesses, en opposition frontale avec les tenants de la dérégulation illimitée de l’économie (« pour libérer les énergies », autrement dit pour entrer dans la grande compétition planétaire, forme économique de la guerre de tous contre tous).
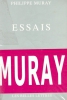 J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
J’allais oublier, dans l’énumération de ces lectures décisives, celle, plus récente, de l’énorme pavé (1764 pages) des Essais de Philippe Muray (L'Empire du Bien, Après l'Histoire I, II, Exorcismes spirituels I, II, III, IV, Les Belles Lettres, 2010, que j'ai lus dans l'ardeur et la gratitude). Cette ponceuse puissante a achevé de me décaper des dernières traces du verni de l’ancienne dévotion qui me faisait m’agenouiller devant l’idole « Modernité ». C'est au Philippe Muray des Essais que je dois de m'être débarrassé des derniers remords que j'aurais pu nourrir suite à la grande volte-face qui s'est opérée en moi en face de la « Modernité ».
Mais je dois reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
reconnaître que Muray avait été précédé, trente ans auparavant par le mémorable La Défaite de la pensée (Alain Finkielkraut, Gallimard, 1987, lu à parution et plusieurs fois relu), qui avait préparé et balisé le chemin, avec son désormais célèbre chapitre « Une paire de bottes vaut Shakespeare ».
 Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude
Il faudrait citer bien d'autres lectures (les quatre volumes d'Essais, articles, lettres de George Orwell, les bouquins de Jean-Claude Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
Michéa (L'enseignement de l'ignorance, L'Empire du moindre mal, ...), La Culture du narcissisme, Le Moi assiégé de Christopher Lasch, ...). Inutile, peut-être, de dire que quand j'ai découvert Michel Houellebecq (c'était avec La Carte et le territoire), la "conversion" était accomplie. C’en était fini des mirages du Progrès. J'avais choisi mon camp : celui des « Dissidents de l'époque » (infiniment préférable à celui, tellement commode, de "réactionnaires").
L'Histoire (le Pouvoir, la Politique), la Technique, l'Economie, donc : la trinité qui fait peur.
Restent les Lumières originelles : étonnamment et bien que je ne sache pas si le résultat est très cohérent, au profond de moi, elles résistent encore et toujours à l'envahisseur. Sans doute parce qu'en elles je vois encore de l'espoir et du possible.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, musique contemporaine, avant-garde, titanic, hannah arendt, les origines du totalitarisme, nazisme, staline, hitler, totalitarisme, stalinisme, banalité du mal, jacques ellul, le système technicien, le bluff technologique, günther anders, l'obsolescence de l'homme, bernard maris, charlie hebdo, antimanuel d'économie, jean-marc sylvestre, ultralibéralisme, philippe muray, l'empire du bien, exorcismes spirituels, éditions les belles lettres, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, une paire de bottes vaut shakespeare, éditions gallimard, george orwell essais articles lettres, jean-claude michéa, l'enseignement de l'ignorance, le moi assiégé, christopher lasch, la culture du narcissisme, michel houellebecq, la carte et le territoire, éditions l'encyclopédie des nuisances
dimanche, 25 janvier 2015
CHRISTINE ANGOT A LA HAINE 1/?
Quelqu’un qui se fait appeler Scarlett a laissé un commentaire ici même il y a quelques jours. Pour résumer, elle me traitait de « patate ». Je me suis dit aussitôt que le mot n’était guère aimable à l’égard du tubercule (famille des solanacées, à laquelle appartiennent, entre autres, le tabac, le datura et l’aubergine) : je suis bien moins appétissant dans l’assiette. Je réussis cependant assez bien le gratin « dauphinois » (les guillemets à cause du gruyère, il paraît que c’est hétérodoxe).
La moutarde est montée au nez de la charmante personne en lisant les propos dont je gratifiais une de ses idoles, en la personne de Christine Angot. Pas même la personne : le personnage qui se présente comme écrivain. J’admets que les mots pouvaient être interprétés de façon désobligeante. Je comparais en effet cet « écrivain » à un fruit qui se serait trompé d’arbre. Tout ça pour dire que la littérature sortie de la plume de la dame n’est pas précisément « ma tasse de thé ». Et après tout, la liberté d’opinion n’est pas un vain mot. J’espère.
 Je suis d’ailleurs effaré de l’écho rencontré par les livres de la dame : faut-il que la magistrale analyse proposée par Christopher Lasch ait été prémonitoire. Pensez que son génial La Culture du narcissisme (Climats, 2000, préface de Jean-Claude Michéa) a été publié en 1979 aux Etats-Unis. A croire que Lasch avait anticipé dès cette époque la mise en devanture des livres de madame Christine Angot.
Je suis d’ailleurs effaré de l’écho rencontré par les livres de la dame : faut-il que la magistrale analyse proposée par Christopher Lasch ait été prémonitoire. Pensez que son génial La Culture du narcissisme (Climats, 2000, préface de Jean-Claude Michéa) a été publié en 1979 aux Etats-Unis. A croire que Lasch avait anticipé dès cette époque la mise en devanture des livres de madame Christine Angot.
Il a même intitulé le premier chapitre de son livre « L’invasion de la société par le moi ». Ce titre, ça fait un peu "pan dans la gueule" : la peste soit du moi, en vérité, si c'est pour tomber dans la bouillasse et la platitude la plus triviale. En gros et pour aller vite, il pensait que cette invasion n’était pas de très bon augure (c'est le moins qu'on puisse dire) pour un diagnostic sur l’état moral, culturel et psychologique futur de la civilisation en général et en particulier de nos sociétés américanisées.
En France, il se passe en littérature contemporaine ce qui s'est passé ailleurs : en musique, décrétons que tous les sons possibles et imaginables, bruits compris, sont musicaux. En arts plastiques, décrétons que tout le réel est artistique. En littérature, Angot illustre à merveille la tendance : décrétons que tout le déroulement de la vie quotidienne d'un individu lambda (raconté, s'il vous plaît, par un auteur qui porte le même nom que le narrateur) est littéraire. En l'occurrence, cela donne, avec Christine Angot, des conversations de dames pipi.
Je ne veux pas savoir qui a eu l'idée foireuse d'ériger ça, très pompeusement, en « autofiction ». Foireuse, l'idée : « ... comme dict le proverbe : "A cul de foyrard toujours abonde merde"» (Gargantua, IX).
Mais ce n’est pas cette « littérature » vantée par Angot (involutive dans sa platitude jusqu’à la saturation de l’exaspération) qui m’occupe ici, bien que l’auteur ait quelques peccadilles à se reprocher. « Peccadilles » est même inscrit dans son casier judiciaire, depuis sa condamnation pénale (à deux reprises) pour s’être acharnée à faire des livres de vautour en pillant, vampirisant et s’appropriant la vie privée d'une dame qui a eu le malheur d'être l' « ex-femme de son nouveau compagnon » (dixit l’encyclopédie en ligne). Sans que la moindre question morale lui effleure la conscience. George Orwell appelait ce sens moral la « common decency ». Jean-Claude Michéa traduit la formule par "décence ordinaire". Mais Christine Angot a d'autres chats à fouetter.
Si elle s’était contentée de continuer à éplucher ses patates (voir plus haut), je l’aurais laissée dans sa cuisine. Mais voilà, elle ne s'est pas contentée. Voilà qu'elle se mêle de littérature. Voilà qu'elle se pose en juge. Voilà qu'elle décrète ce qui est littéraire et ce qui ne l'est pas. Tout ça parce qu'elle ne peut pas encadrer les romans de Michel Houellebecq. Et dans Le Monde, s'il vous plaît. Elle n'aurait pas dû. Et pour faire bonne mesure, Le Monde (des livres, 16 janvier) fait figurer le libelle de Christine Angot dans un dossier intitulé "Ecrivains contre la terreur". Je trouve la plaisanterie de très mauvais goût.
Je vais encore me faire traiter de sale macho sexiste. Patriarcal. Réactionnaire. Archaïque. Bourré de stéréotypes. J'assume d'avance. Tiens, dites-moi de qui est ce vers : « Je fume au nez des dieux de fines cigarettes ». Gogol vous donne la réponse en 0,28 seconde. A condition de connaître le vers en question.
« Au nez des dieux », j'insiste.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, littérature française, christine angot, journal le monde, le monde des livres, critique littéraire, christopher lasch, la culture du narcissisme, jean-claude michéa, george orwell, common decency, michel houellebecq, jules laforgue, macho, machisme, sexisme, réactionnaire, réac, stéréotype
lundi, 05 septembre 2011
TU VAS RANGER TES GENRES ?!
On n’en finit jamais avec les innovations. La première fois que j’ai assisté en spectateur à un débat sur le GENRE, c’était en salle fumeur. Deux estimables collègues, pas trop vieux (c’est-à-dire plus jeunes que moi) faisaient assaut de considérations « branchées » sur cette notion alors entièrement nouvelle (au moins pour moi, mais je suis long à la détente). Ça avait l’air intelligent, ça avait même l’air intellectuel, voire intello. Effectivement, c’était intello. Là, je suis infirme. Si si, je vous jure !
J’ai consacré un petit article, récemment et ici même, à l’introduction du « genre » dans des manuels de « Sciences et Vie de la Terre », en tant que notion à part entière. J’en ai dit tout le mal que j’en pense : en gros, la notion de genre est totalement inutile. L’enseigner en tant que telle n’est absolument pas innocent. Pour résumer, ma thèse est que le hasard de la conception dote chacun d’un sexe anatomique et que, ensuite, c’est à chacun de se débrouiller avec dans la vie, en fonction de ce que celle-ci lui présente comme expériences.
Ce n’est pas l’avis des promoteurs du « genre », évidemment, y compris du délicieux et suave RAPHAËL ENTHOVEN, qui sévit sur France Culture. Enseigner le genre à des adolescents, qu’on le veuille ou non, c’est leur présenter leur évolution sexuelle comme une croisée des chemins, où ils vont mettre en œuvre leur liberté et leur raison, pour décider en pleine conscience : moi, garçon, moi, fille, ai-je envie de vivre ma partie féminine ou ma partie masculine, puisqu’on m’a persuadé qu’il y a une part de masculin dans le féminin et inversement ? Ils ou elles choisiront donc délibérément, pour eux-mêmes, le yaourt masculin ou le yaourt féminin sur le rayon de l’hypermarché de la consommation sexuelle. Et pourquoi pas les deux ? La bisexualité comme avenir de l’humanité ?
La morale de tout ça, c’est qu’on présente l’homosexualité exactement à égalité avec l’hétérosexualité, et ce, au nom du combat contre la norme, obligatoirement mauvaise. Et surtout, il faut empêcher coûte que coûte le jeune d’éprouver le moindre sentiment de culpabilité si par hasard il n’entre pas dans le moule de cette effroyable norme. Il faut surtout que le jeune se sente libre, on se tue à vous le dire !
Conclusion : les mêmes éducateurs qui en appellent à grands cris à conforter et renforcer les « points de repère psychologiques » qui permettent aux jeunes de « se construire », ont entrepris de détruire ces « points de repère » en militant (ça aussi, c’est un problème) pour accroître la confusion dans les esprits. Autrement dit, on voudrait faire de la propagande pour l’homosexualité, on voudrait y encourager, on voudrait faire du prosélytisme homosexuel, on ne s’y prendrait pas autrement.
Eh bien, pendant qu’on solde les cadres de ce qui structure l’humanité depuis la nuit des temps (j’ai nommé la DIFFERENCE DES SEXES), l’offensive continue. Et puisqu’il s’agit de détruire cet ennemi à la racine, elle continue en amont de l’adolescence, pour remonter jusqu’à l’âge le plus tendre. Et le champ qu’il s’agit de nettoyer de tous les miasmes de la différenciation sexuelle, c’est maintenant le champ du JOUET. Parfaitement messieurs-dames.
Parce qu’on ne le dira jamais assez : il y a quelque chose de totalitaire dans le fait de donner au petit garçon des petites voitures ou des soldats, et à la petite fille des poupées dans des poussettes. Les parents ne se rendent pas à quel point ils orientent abusivement l’esprit de leur progéniture : c’est du terrorisme parental !
C’est donc entendu : tu es un garçon, tu joueras à la guerre en miniature, et ça te préparera à donner ta vie pour ton pays quand tu auras l’âge ; tu es une fille, tu joueras à la maman, et ce faisant tu répéteras longtemps à l’avance les gestes qu’il faudra faire quand tu auras ton premier.
C’est donc entendu : tu subiras un horrible conditionnement, un ignoble lavage de cerveau. C’est ce que les féministes et adeptes de la théorie du genre (qui est bel et bien une théorie, malgré RAPHAEL ENTHOVEN) appellent un déterminisme, un surdéterminisme, un dressage ou je ne sais quoi. C’est ce qu’ils trouvent absolument insupportable.
D’abord, ces gens-là sont ignares, ou ils font semblant : ils ne savent pas qu’il existe des garçons qui n’aiment pas jouer au foot ? Ils ignorent que certaines filles sont des « garçons manqués », comme il ne faut plus dire ? Les bras m’en tombent : les gamins n’ont pas attendu les savantasses intellos machins pour indiquer à leurs parents leurs préférences en matière de jeux et de jouets, quittes à ne pas respecter le « schéma dominant », quittes à tomber sur des becs qui les font plus ou moins souffrir.
Ensuite, il ne faut pas être passé par de grandes écoles de psychologie ou de psychanalyse pour se rendre compte que le schéma est exactement l’inverse de celui qu’avancent les adeptes du « genre ». Pourquoi offre-t-on, EN REGLE GENERALE, soldats et voitures au garçon ? Pourquoi offre-t-on, EN REGLE GENERALE, des poupées aux filles ?
Est-ce que par hasard ça ne serait pas parce que le petit garçon veut ressembler à son père, et l’imiter ? Ecoutez deux garçons discuter dans la cour de récréation : « C’est mon père qui est le plus fort, le plus riche ! – Ouais, mais c’est mon père qui a la plus grosse voiture, la plus grosse … ! » ? Ou deux filles : « C’est ma mère qui est la mieux habillée ! – Ouais, mais c’est ma mère qui est la plus belle ! » ? Non, je ne vais pas prétendre que tout ça, c’est inné, évidemment. Mais je n’invente rien si je dis, après les plus hautes autorités en la matière, que le gamin a BESOIN de s’identifier au parent de même sexe (et accessoirement d’essayer de séduire le parent de l’autre sexe).
Quoi, vous me dites que ce serait déjà le résultat d’un conditionnement ? Mais moi, digne et sans faire de chichis, je rétorque : « ET ALORS ? ». Vous avez vraiment l’intention d’éradiquer jusqu’à la moindre trace de conditionnement dans l’éducation de l’être humain ? C’est la notion de conditionnement qui vous taraude à ce point la comprenette ? Mais, messieurs-dames, je regrette : c’est vous qui êtes totalitaires, et mine de rien – et c’est d’ailleurs très drôle – vous rejoignez la bande de ces éducateurs post-soixante-huitards, qui s’interdisaient d’intervenir de façon autoritaire dans le « parcours éducatif » de l’enfant, comptant sur son développement spontané pour qu’il arrive par lui-même à s’éduquer et à s’instruire.
S’inspirant de Libres enfants de Summerhill, de ALEXANDER SUTER NEILL (éditions Maspero, 1971), des allumés de l’éducation sans contrainte avaient ouvert des « écoles », comme celle du « Tournesol », dans la région lyonnaise. Je me souviens de Journal d’un éducastreur (éditions Champ libre, 1971), d’un nommé JULES CELMA. Il est sorti de tout ça la certitude plus ou moins affirmée qu’une telle démission de l’autorité adulte, selon l’exigence de « libre épanouissement » de l’enfant, débouche sur quelque chose qui a à voir avec la violence, la tyrannie et l’homosexualité (dans le livre de CELMA). Et toutes ces « écoles nouvelles » ou presque, fondées sur les meilleures intentions du monde, ont lamentablement (et heureusement) fait naufrage.
Il existe quantité de définitions de ce qu’est, doit être ou devrait être un ADULTE (« avoir pardonné à ses parents » SAINT-EXUPERY, « être adulte, c’est être seul » JEAN ROSTAND, « un enfant gonflé d’âge », ça c’est de la détestable et confusionniste SIMONE DE BEAUVOIR, etc.). Je proposerais volontiers quant à moi celle-ci : un parent, un éducateur est adulte quand il exerce l’autorité que, en vertu de sa fonction, la société lui délègue. Il est adulte quand il accepte d’être celui qui conditionne celui dont il a la charge.
Eduquer, c’est vouloir donner une forme et une structure à un esprit, à une personne. Imagine-t-on qu’il puisse y avoir une formation sans aboutissement à une forme ? Mettez une boule d’argile sur un tour de potier, n’y mettez surtout pas les mains, et puis admirez le résultat. De toute façon, la liberté du gamin est forcément respectée, du fait du RATAGE plus ou moins grand des efforts de l’adulte. Toute éducation est, qu’on le veuille ou non, plus ou moins RATÉE. Je ne sais plus qui affirmait : « Il y a trois métiers impossibles : éduquer, enseigner, psychanalyser ».
Le GENRE, finalement, va tout à fait dans le sens de la doctrine d’enseignement actuellement en vigueur : faire en sorte que ce soit l’élève lui-même qui « construise son propre savoir ». Comme le disait excellemment JAIME SEMPRUN (L’Abîme se repeuple, éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 1997) :
« Quand le citoyen écologiste prétend poser la question la plus dérangeante en demandant : Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?, il évite de poser cette autre question, réellement inquiétante : A quels enfants allons-nous laisser notre monde ? »
Oui : à quels enfants allons-nous laisser notre monde ? Ce n’est pas pour rien que JEAN-CLAUDE MICHÉA cite cette interrogation à la fin de son minuscule et lumineux livre L’Enseignement de l’ignorance (Editions Climats, 1999).
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : genre, éducation sexuelle, sexe, gender studies, manuels de svt, raphaël enthoven, france culture, homosexualité, bisexualité, éducation, a s neill, jules celma, jaime semprun, jean-claude michéa

