lundi, 20 avril 2015
QUAND HOUELLEBECQ INTERVIENT
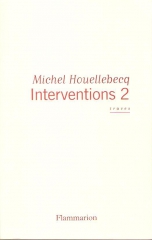 Je n’ai pas tout compris dans la méthode de publication, réédition, distribution et redistribution des textes que Michel Houellebecq a donnés à droite et à gauche depuis que ses écrits sont publiés (1988, je crois, pour des poèmes en revue). Toujours est-il et quoi qu’il en soit, je viens de lire Interventions 2 (Flammarion, 2009). On dira que je fais une fixation.
Je n’ai pas tout compris dans la méthode de publication, réédition, distribution et redistribution des textes que Michel Houellebecq a donnés à droite et à gauche depuis que ses écrits sont publiés (1988, je crois, pour des poèmes en revue). Toujours est-il et quoi qu’il en soit, je viens de lire Interventions 2 (Flammarion, 2009). On dira que je fais une fixation.
Je ne rejette pas a priori l’hypothèse de la pathologie, mais que voulez-vous, quand vous mettez le pied dans un patelin où, à votre grand étonnement, vous avez soudain l’impression de rentrer à la maison tellement c’est comme ça que vous vous racontiez l’histoire et que vous vous peigniez le paysage, vous avez envie de vous arrêter là, et d’en savoir un peu plus long, ne serait-ce que pour vérifier que vous ne rêvez pas.
Il se trouve simplement que j’ai découvert en 2011, avec La Carte et le territoire, un écrivain qui surpasse de très loin le niveau du vulgum pecus littéraire français. Et que j’ai eu envie de creuser la question. Je dois dire qu’en creusant, je n’ai pas été déçu des matières que ma rivelaine amenait au jour, à mesure que j’avançais dans le filon.
Interventions 2 est ce qu’on appelle un « recueil ». Forcément, il y a « à boire et à manger » : des textes de longueurs, de natures, de genres et de thématiques différents, qui ont été demandés à l’auteur entre 1992 et 2008. Sans compter l’avant-propos, il s’ouvre et se ferme sur des règlements de comptes. Le premier (« Jacques Prévert est un con ») n’a pas besoin d’explication. Le titre annonce la couleur et se suffit à lui-même.
En revanche, le titre « Coupes de sol », qui clôt l'ouvrage, reste énigmatique tant qu’on ne sait pas que Houellebecq est sorti de la même « Agro » que Robbe-Grillet, et que la « coupe de sol » est une des bases, paraît-il, de l’enseignement agronomique. Cela n’empêche pas le condisciple à retardement d’infliger une bonne avoinée littéraire à son prédécesseur : non, Houellebecq n'aime pas le pape du "Nouveau Roman". Je le comprends.
C’est que Houellebecq a fait des choix (il ne le dirait peut-être pas comme ça : des choix qui se sont imposés ou qu’il n’a pu refuser de faire, il a une conception pessimiste de la liberté humaine), il a pris position, ce qui l’autorise à porter des jugements.
Si certains trouveront ceux-ci péremptoires et injustes, c’est qu’ils ont l’esprit « errant et sans patrie » de ceux qui, prenant tout ce qui vient au motif qu’il ne faut rejeter ou exclure rien ni personne, s’interdisent de porter quelque jugement que ce soit sur qui ou quoi que ce soit, mais attention : en interdisant absolument à quiconque de ne pas être d’accord avec eux, sous peine de correctionnelle. Pour eux, affirmer des choix et porter des jugements, c'est forcément être facho. Si tout au moins choix et jugements osent s'écarter de leur ligne.
Je veux parler de tous les obsédés du consensus moral, tous les flics tolérantistes qui peuplent la gauche raplapla, dépourvus de ce moyen de jugement qui permet de distinguer le bon et le mauvais, le juste et l’injuste, le beau et le laid, – ce moyen qu’on appelait un CRITÈRE, à l’époque où les « valeurs » étaient encore des échelles, qui permettaient de placer êtres, choses, langages, systèmes, œuvres d’art à des altitudes différentes. Cette époque ténébreuse et heureusement révolue, où l’on avait encore l’infernal culot d’appeler un chat un chat.
Je laisse Robbe-Grillet aux amateurs, s’il y en a encore. Je m’arrête sur Prévert, le poète préféré des enseignants masochistes qui aiment se faire flageller en faisant apprendre « Le Cancre » à leurs élèves multiculturels : « Il dit oui avec la tête, mais il dit non avec le cœur, il dit oui à ce qu’il aime, il dit non au professeur, et gnagnagna et gnagnagna ». Prévert illustre à merveille la niaiserie irréversible qui a saisi la société française au moment où elle a commencé à sacraliser « le monde merveilleux de l’enfance ».
Houellebecq met le monsieur dans le même sac que Vian, Brassens et Boby Lapointe (qu’il écrit « Bobby », l’ignorant), dont il trouve les jeux de mots stupides. Tant pis, c’est son droit. Question de génération sans doute. Vian, je le lui laisse assez volontiers, mais Brassens et Lapointe, je ne suis pas d’accord : ils ont poussé leur rhizome trop loin dans mon oreille pour que je puisse seulement songer à en arracher la moindre radicelle. S’agissant de Brassens et Lapointe, je perds tout esprit critique.
Jacques Prévert souffre, aux yeux de Houellebecq d’un certain nombre de tares. Certes et hélas, « il a quelque chose à dire », « Malheureusement, ce qu’il a à dire est d’une stupidité sans borne ». Il enfonce le clou : « Sur le plan philosophique et politique, Jacques Prévert est avant tout un libertaire ; c’est-à-dire, fondamentalement, un imbécile ». Il n’a pas tort. Pour terminer : « Si Jacques Prévert est un mauvais poète, c’est avant tout parce que sa vision du monde est plate, superficielle et fausse ». J’avoue que ces quatre pages m'ont fait un bien fou. Un fier encouragement à poursuivre la lecture.
Le propre d’un recueil, c’est d’être d’un intérêt inégal. C’est dans sa nature. Certains textes (critique cinéma, critique art, critique poésie, …) ne me disent guère. C’est le cas, en particulier d’ « Opera Bianca », suite de courts textes destinés à accompagner l’ « installation mobile et sonore conçue par le sculpteur Gilles Touyard ».
Je ne connais pas les œuvres de Gilles Touyard, mais en apprenant que « la musique est due à Brice Pauset », c’est plus fort que moi, je ferme toutes les écoutilles. Peut-être à cause du traumatisme que constitue la production sonore (je n'ai pas dit la « musique ») de ce monsieur, tout fier de reproduire, par exemple, les sons enregistrés d'un aspirateur en fonctionnement.
D’autres retiennent sans effort mon attention. C’est le cas d’un article daté de 1992 (« Approches du désarroi »), un vrai petit chef d’œuvre synthétique et analytique sur l'époque que nous vivons, dont je conseille vivement la lecture. C’est aussi le cas de « Philippe Muray en 2002 ». C’est encore le cas d’un entretien avec des gars de Paris-Match. Quelques autres.
La loi du genre, quoi.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, critique littéraire, michel houellebecq, interventions 2, éditions flammarion, la carte et le territoier, jacques prévert, jacques prévert est un con, alain robbe-grillet, nouveau roman, prévert le cancre, boris vian, georges brassens, tonton georges, boby lapointe, paris match, musique contemporaine, brice pauset
dimanche, 25 janvier 2015
CHRISTINE ANGOT A LA HAINE 1/?
Quelqu’un qui se fait appeler Scarlett a laissé un commentaire ici même il y a quelques jours. Pour résumer, elle me traitait de « patate ». Je me suis dit aussitôt que le mot n’était guère aimable à l’égard du tubercule (famille des solanacées, à laquelle appartiennent, entre autres, le tabac, le datura et l’aubergine) : je suis bien moins appétissant dans l’assiette. Je réussis cependant assez bien le gratin « dauphinois » (les guillemets à cause du gruyère, il paraît que c’est hétérodoxe).
La moutarde est montée au nez de la charmante personne en lisant les propos dont je gratifiais une de ses idoles, en la personne de Christine Angot. Pas même la personne : le personnage qui se présente comme écrivain. J’admets que les mots pouvaient être interprétés de façon désobligeante. Je comparais en effet cet « écrivain » à un fruit qui se serait trompé d’arbre. Tout ça pour dire que la littérature sortie de la plume de la dame n’est pas précisément « ma tasse de thé ». Et après tout, la liberté d’opinion n’est pas un vain mot. J’espère.
 Je suis d’ailleurs effaré de l’écho rencontré par les livres de la dame : faut-il que la magistrale analyse proposée par Christopher Lasch ait été prémonitoire. Pensez que son génial La Culture du narcissisme (Climats, 2000, préface de Jean-Claude Michéa) a été publié en 1979 aux Etats-Unis. A croire que Lasch avait anticipé dès cette époque la mise en devanture des livres de madame Christine Angot.
Je suis d’ailleurs effaré de l’écho rencontré par les livres de la dame : faut-il que la magistrale analyse proposée par Christopher Lasch ait été prémonitoire. Pensez que son génial La Culture du narcissisme (Climats, 2000, préface de Jean-Claude Michéa) a été publié en 1979 aux Etats-Unis. A croire que Lasch avait anticipé dès cette époque la mise en devanture des livres de madame Christine Angot.
Il a même intitulé le premier chapitre de son livre « L’invasion de la société par le moi ». Ce titre, ça fait un peu "pan dans la gueule" : la peste soit du moi, en vérité, si c'est pour tomber dans la bouillasse et la platitude la plus triviale. En gros et pour aller vite, il pensait que cette invasion n’était pas de très bon augure (c'est le moins qu'on puisse dire) pour un diagnostic sur l’état moral, culturel et psychologique futur de la civilisation en général et en particulier de nos sociétés américanisées.
En France, il se passe en littérature contemporaine ce qui s'est passé ailleurs : en musique, décrétons que tous les sons possibles et imaginables, bruits compris, sont musicaux. En arts plastiques, décrétons que tout le réel est artistique. En littérature, Angot illustre à merveille la tendance : décrétons que tout le déroulement de la vie quotidienne d'un individu lambda (raconté, s'il vous plaît, par un auteur qui porte le même nom que le narrateur) est littéraire. En l'occurrence, cela donne, avec Christine Angot, des conversations de dames pipi.
Je ne veux pas savoir qui a eu l'idée foireuse d'ériger ça, très pompeusement, en « autofiction ». Foireuse, l'idée : « ... comme dict le proverbe : "A cul de foyrard toujours abonde merde"» (Gargantua, IX).
Mais ce n’est pas cette « littérature » vantée par Angot (involutive dans sa platitude jusqu’à la saturation de l’exaspération) qui m’occupe ici, bien que l’auteur ait quelques peccadilles à se reprocher. « Peccadilles » est même inscrit dans son casier judiciaire, depuis sa condamnation pénale (à deux reprises) pour s’être acharnée à faire des livres de vautour en pillant, vampirisant et s’appropriant la vie privée d'une dame qui a eu le malheur d'être l' « ex-femme de son nouveau compagnon » (dixit l’encyclopédie en ligne). Sans que la moindre question morale lui effleure la conscience. George Orwell appelait ce sens moral la « common decency ». Jean-Claude Michéa traduit la formule par "décence ordinaire". Mais Christine Angot a d'autres chats à fouetter.
Si elle s’était contentée de continuer à éplucher ses patates (voir plus haut), je l’aurais laissée dans sa cuisine. Mais voilà, elle ne s'est pas contentée. Voilà qu'elle se mêle de littérature. Voilà qu'elle se pose en juge. Voilà qu'elle décrète ce qui est littéraire et ce qui ne l'est pas. Tout ça parce qu'elle ne peut pas encadrer les romans de Michel Houellebecq. Et dans Le Monde, s'il vous plaît. Elle n'aurait pas dû. Et pour faire bonne mesure, Le Monde (des livres, 16 janvier) fait figurer le libelle de Christine Angot dans un dossier intitulé "Ecrivains contre la terreur". Je trouve la plaisanterie de très mauvais goût.
Je vais encore me faire traiter de sale macho sexiste. Patriarcal. Réactionnaire. Archaïque. Bourré de stéréotypes. J'assume d'avance. Tiens, dites-moi de qui est ce vers : « Je fume au nez des dieux de fines cigarettes ». Gogol vous donne la réponse en 0,28 seconde. A condition de connaître le vers en question.
« Au nez des dieux », j'insiste.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, littérature française, christine angot, journal le monde, le monde des livres, critique littéraire, christopher lasch, la culture du narcissisme, jean-claude michéa, george orwell, common decency, michel houellebecq, jules laforgue, macho, machisme, sexisme, réactionnaire, réac, stéréotype
dimanche, 02 octobre 2011
TROIS HOUELLEBECQ SINON RIEN
J’ai mis beaucoup de temps avant d’ouvrir un livre de MICHEL HOUELLEBECQ. Ce qui me repoussait, je crois l’avoir dit ici, c’est la controverse : il y a quelque chose de si futilement médiatique dans la présence éphémère du parfum de quelques noms dans l’air du temps, que je tenais celui-ci pour tout à fait artificiel, voire carrément faux et illusoire, comme c’est le cas de la plupart des effervescences télévisuelles et autres. Je suis devenu excessivement méfiant. En l’occurrence, j’avais tort.
J’ai donc commencé la lecture de MICHEL HOUELLEBECQ quand son dernier roman, La Carte et le territoire, fut placé, un peu par hasard, à proximité immédiate de ma main. J’ai dit grand bien du livre dans ce blog. J’en ai maintenant accroché deux autres à mon tableau de chasse : Les Particules élémentaires et Plateforme. Conclusion, vous allez me demander ? Voilà : je ne sais pas si on a à faire à un « grand » écrivain, je ne sais pas si ce sont des « chefs d’œuvre ». Je peux dire que ce sont des livres qui comptent, et des livres qui sont plutôt du grain que de la balle, si l’image peut encore être comprise.
Je lui ferai un reproche, cependant : la place quasi-nulle qu’il fait à la musique. Et ce n’est pas le « Et allons-y pour les quintettes de Bartok… » (Particules, p. 157) qui me fera changer d’avis, d’autant plus que, si BELA BARTOK a écrit six quatuors à cordes, je ne sache pas qu’il ait composé autre chose qu’un quintette avec piano.
Des « grands » écrivains comme s’il en pleuvait, des cataractes de « chefs d’œuvre », c’est le quotidien de la rubrique « culture » des magazines, des revues spécialisées type Le Magazine littéraire, ou du supplément « livres » d’un « grand quotidien du soir ». C’est une surabondance de productions « indispensables », d’oeuvres « incontournables ».
Moi je vais vous dire, de deux choses l’une : ou bien il règne une immense complaisance, voire une veulerie démesurée, au sein du milieu sinistré, ce milieu sinistré que l’on n’appelle plus que par complaisance la « critique littéraire », genre « Le Masque et la plume » ; ou bien ces soi-disant « critiques » sont totalement incompétents, et n’ont plus qu’une idée très approximative de ce qu’est le littéraire. « Critiques littéraires » : quand j’entends cette expression, je pouffe, je me gausse, que dis-je : je m’esclaffe. Voilà : ils sont soit complaisants, soit incompétents, peut-être même les deux, mon général.
Le Monde des livres n’échappe pas à la règle, qui fait, en général et sauf exception, de ses papiers « critiques » de simples prospectus de promotion publicitaire au service d’un copain, ou de quelqu’un à qui on doit quelque chose, ou à qui on a l’intention de demander quelque chose, dans le jeu bien connu du « renvoi d’ascenseur ». Les lycéens appellent cette catégorie de premier de la classe « lèche-cul » (mais suspect est encore plus sale, si on décompose, essayez). Le bocal « littéraire », spécialement français, a quelque chose d’assez répugnant.
Donc, je ne sais pas si MICHEL HOUELLEBECQ est le digne successeur de BALZAC et PROUST. J’ignore si ses livres sont des Everest de la littérature. Ce que je sais, c’est qu’il travaille sur le monde qu’il a sous les yeux, qu’il dit quelque chose du monde tel qu’il est, et qu’il développe sur celui-ci un point de vue, une analyse, une proposition d’éclairage précis, une grille de lecture, si l’on veut. Si l’on est malveillant, on dira qu’il regarde de derrière des « lunettes » (vous savez, chez PIERRE BOURDIEU, celles du journaliste, celles qui déforment le monde).
C’est un romancier qui a pris position face à la « civilisation occidentale », et qui a ceci de bien, c’est que, s’il parle de lui, c’est à distance respectable, hors de portée de tir de son propre nombril et des ravages courants que celui-ci commet dans les rangs des « écrivains » français, pour le plus grand plaisir des jurés du Prix Inter en général et de PATRICIA MARTIN en particulier.
On peut trouver le point de vue développé par MICHEL HOUELLEBECQ d’une noirceur exécrable : pour résumer, grâce à la civilisation actuelle, exportée par l’Europe, moulinée avec la sauce techniquante, massifiante et consommante de l’Amérique triomphante, le monde actuel court à sa perte et, d’une certaine façon, est déjà perdu.
L’auteur met-il pour autant ses pas dans ceux de PHILIPPE MURAY, comme je l’ai suggéré ? Je n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que PHILIPPE MURAY a développé dès les années 1980 un regard analogue sur la réalité, d’une acuité de plus en plus grande, et un regard de plus en plus pessimiste.
Avant lui, plusieurs auteurs se sont inquiétés de l’évolution de notre monde : GÜNTER ANDERS (L’Obsolescence de l’homme), LEWIS MUMFORD (Les Transformations de l’homme), HANNAH ARENDT (La Crise de la culture), CHRISTOPHER LASCH (La Culture du narcissisme), JACQUES ELLUL (Le Système technicien, Le Bluff technologique), GUY DEBORD (La Société du spectacle), et quelques autres.
Pardon pour l’étalage, mais c’est parce qu’il y a un peu de tous ces regards dans les romans de MICHEL HOUELLEBECQ, tout au moins les trois que j’ai lus (publiés en 1998, 2001 et 2010, ce qui révèle quand même une certaine constance). La « patte » de PHILIPPE MURAY, c’est l’attention portée à un aspect particulier de la crise moderne : l’humanité est devenue peu à peu superflue, submergée par des objets techniques, des gadgets qui sont devenus pour elle si « naturels », mais en même temps si dominateurs, qu’elle est progressivement devenue une vulgaire prothèse de ses propres inventions. PHILIPPE MURAY le synthétise dans la notion de fête, dans l’abolition de tout ce qui permettait la différenciation (en particulier entre les sexes), dans le nivellement de toutes les « valeurs ».
A suivre...
09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel houellebecq, la carte et le territoire, les particules élémentaires, plateforme, philippe muray, littérature, critique littéraire, le magazine littéraire, le monde des livres, le masque et la plume, günter anders, lewis mumford, christopher lasch, jacques ellul, guy debord

