mardi, 12 février 2019
J'AI LU SÉROTONINE 1
1 - La toile de fond.
J’ai donc lu Sérotonine de Michel Houellebecq. Je me garderai de faire l’éloge de l’auteur et de son roman. Je me garderai aussi de raconter l’histoire qu’on y trouve, au demeurant assez mince, où le scénario ressemble assez à l’idée qu’on se fait d'une « marche au supplice », mais dans un état proche de l'hébétude (je crois que c'est dans Ennemis publics (2008) qu'on trouve ce mot sous la plume de l'auteur pour qualifier sa propre attitude). Aujourd'hui, je me contenterai de dire, aussi directement que possible, les réflexions que m’inspire la lecture de ce livre.
Ce n’est pas forcément facile. D’abord la question du style. Bien des « gens autorisés » lui reprochent sa platitude, sans se rendre compte que cette platitude correspond en tout point au projet littéraire : un style volontairement décharné au milieu et famélique sur les bords, sans belles phrases, sans substance charnue, l’image exacte du « moi » de Florent-Claude Labrouste, le protagoniste. De toute façon, Houellebecq a répondu par avance à toute critique de son style dans sa Lettre à Lakis Proguidis (1997) : « Pour tenir le coup, je me suis souvent répété cette phrase de Schopenhauer : "La première – et pratiquement la seule – condition d’un bon style, c’est d’avoir quelque chose à dire." ». « Quelque chose à dire » ! Pour ça, on peut lui faire confiance.
Ce projet, quel est-il ? Je ne suis pas dans la tête de celui qui l’a conçu et réalisé, mais il ne me semble pas absurde de le formuler ainsi : « Description méticuleuse de la loque intérieure que la civilisation occidentale, matérialiste et consommationniste, a faite de l’individu ». Une loque intérieure, le sac vide de la peau de Saint Barthélémy, qui fut écorché, comme on sait. Voilà l'individu occidental tel que Houellebecq nous le montre, à travers le personnage de Florent-Claude Labrouste.

Visible sur le mur du fond de la Sixtine.
Je n’ai pas réussi à retrouver dans quel texte Houellebecq émet explicitement cette idée de l'inanité infligée par la civilisation technique à l'individu moderne, mais il me semble bien que. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, à la lecture de Sérotonine, j’ai retrouvé l’impression produite par Extension du domaine de la lutte, où le personnage, éprouvant la liquéfaction de ses raisons de vivre, fait face à ce vide.
Comment s’y est prise notre civilisation pour aboutir à ce paysage intérieur dévasté ? C’est la question cruciale que posent les romans de Houellebecq en général, et celui-ci en particulier.
J’essaie de comprendre depuis longtemps comment cette civilisation, qui a façonné le monde d'aujourd'hui de façon ineffaçable (non, pas de jugement de valeur : un fait), a pu aboutir à cette façon de désastre humain. C'est sûr, notre romancier est loin d’être le premier ni le seul à faire ce constat. Mais il est certainement le seul à donner à celui-ci une forme littéraire aussi achevée, aussi pertinente.
Oui, comment en est-on arrivé là ? A cette question, du point de vue qui est le mien au fond de mon terrier, je réponds qu’il y a d’abord la production des objets, renforcée plus tard par leur promotion, au moyen de la publicité, cette arme de décervelage massif : la marchandise s’est imposée en tant que « bien » dans nos représentations du monde, disant au « moi » de l'individu : "Ôte-toi de là que j'm'y mette". Houellebecq le dit : « ... la publicité vise à vaporiser le sujet pour le transformer en fantôme obéissant du devenir » (Approches du désarroi, 1992). Comment fonctionne l'image publicitaire ? C'est tout simple : en conduisant l'énergie du désir vers un objet marchand. Le désir humain réduit à la marchandise. De ce point de vue, tout ce qui est humain est transformé en marchandise.
De « moyen » qu’elle était, la marchandise, élevée à la dignité de « fin » par la publicité, a acquis, grâce à celle-ci, une aura, un surcroît de dignité, une intensité d'« être » supplémentaire, quoique fantomatique. Elle a progressivement gagné du terrain dans nos imaginaires, occupant de plus en plus de place dans nos désirs, les dirigeant toujours davantage vers le monde des objets et se substituant à d’autres désirs, qui venaient auparavant de l’intérieur. La publicité est même devenue un objet d’étude à part entière, jusqu’au sein de l’université, c’est vous dire que la moisissure a gagné le centre du cerveau.
Et puis sont arrivés les moyens de communication de masse. Après le téléphone, première intrusion du monde extérieur dans l'univers domestique et première « connexion », il y eut d’abord la radio, dont l’écoute, dans le premier 20ème siècle, nous est presque présentée comme religieuse, la famille réunie communiant autour du « poste ».

C’est précisément contre l’irruption de la radio dans le cercle familial que s’insurge violemment le philosophe Günther Anders dans L’Obsolescence de l’homme, au motif qu’elle capte toute l’énergie d’attention que son absence permettait de consacrer à ses proches. Elle capte l’oreille de l’auditeur, c’est-à-dire qu’elle le rend captif et le détourne de sa propre existence. Le chant des sirènes, quoi.
La radio est, selon Anders, un intrus, un parasite, une interférence qui s’interpose indûment comme un écran entre les personnes qui vivent sous le même toit, induisant une forme de relâchement dans leurs relations. Il n’a pas complètement tort, même si l’appareil en question s’est fondu dans le paysage avec le temps, au point que tout le monde vit avec et que son absence paraît presque inconvenante.
Quant à la télévision, c'est pire, car si l’effet de la radio n’est pas niable, mais somme toute limité, l’évidence est encore plus éclatante s’agissant du petit écran, et son effet encore plus dévastateur : la fascination produite sur les gens présents dans la pièce est telle que les regards sont irrésistiblement attirés par l’image animée, et plus personne ne s’adresse à son voisin. Bon, c’est vrai, je me rappelle des soirées chez M. Bachelard, à Tence, quand la télé était encore rare (et en NB) : l’ambiance était souvent déchaînée lors des premiers Interville (Guy Lux, Léon Zitrone, Simone Garnier).
Même chose pour le Tournoi des 5 nations regardé en famille et commenté par Roger Couderc (« Allez les petits ! ») ou, en 1990, au camping de Mamaia, sur la Mer Noire, où cinquante personnes et plus se rassemblaient le soir venu devant la lucarne allumée. Cela ne change rien au diagnostic : la télé impose son ordre aux individus, comme la flamme attire les phalènes, faisant de chaque téléspectateur une solitude à côté des autres solitudes. La télé emporte dans son nulle part, morceau par morceau, la vie intérieure de l'individu, pour la remplacer par une foule innombrable de fantômes. L'individu moderne est habité par des fantômes qui, dans le miroir, ont tellement pris son aspect qu'il les prend pour lui-même.
Le stade provisoirement ultime de ce processus de dépossession de soi par les moyens de communication de masse est évidemment atteint par le déferlement récent du smartphone sur le pauvre monde. Chacun emporte avec lui, dans tous ses mouvements, sa radio, sa télé, son téléphone, sa machine à écrire. Et sous ce volume restreint et maniable, il emporte tout son « moi », qu'il a « externalisé » (essayez de l'en priver, pour voir !). Et beaucoup d’utilisateurs tiennent ce « moi » à la main en toute circonstance, prêts à répondre dans l’instant au moindre stimulus. Le plus renversant dans l'affaire, c'est l'ahurissant degré de consentement des individus à la chose, au motif diabolique que « ça peut rendre bien des services ». L'innovation technologique, c'est Ève tendant la pomme à Adam. C'est Faust tenté par Méphisto.
Par-dessus tout ça, la faculté de se connecter avec la planète entière dès qu’on le veut : grâce à cet outil, l’individu ressemble à l’araignée qui, au centre de sa toile, semble exercer un pouvoir absolu sur son entourage immédiat (fût-il au bout du monde), sauf que si ça lui donne l’impression de vivre intensément l’instant présent (ne rien manquer de ce qui se dit, se sait, se raconte, ...), il n’a jamais été aussi réellement seul.
Pas de plus flagrante image de solitude que celle de passagers du bus ou du métro concentrés sur ce qui se passe sur leurs écrans personnels : l’individu est réduit à lui seul, et les autres, bien concrets dans leur chair et leurs os, bien palpitants de vie, ont disparu. Le smartphone a réinventé l’onanisme social, cette "délectation morose". Comment une quelconque société digne de ce nom pourrait-elle survivre en tant que société dans ce contexte ? Un jour viendra peut-être (on peut rêver) où les individus se rendront compte que, loin d'être des araignées au centre de leur toile, ils sont la mouche qui vient se prendre dans les filets tissés par d'autres gourmands arthropodes.
Ainsi, étape après étape, la civilisation technique a trouvé des moyens de plus en plus sophistiqués de s'introduire dans la conscience, dans la mémoire, dans les affects, dans les goûts, dans les choix des individus, pour remplacer ce qui tenait autrefois à leur "personnalité propre" par une personnalité d'emprunt, largement virtuelle, largement fabriquée par une instance extérieure, et beaucoup plus docile aux exigences du système. Et avec le siphonnage des données personnelles par facebook et consort, le système n'a pas fini de vider l'individu de son « moi ». Houellebecq le dit (Approches du désarroi) : « Les techniques d'apprentissage du changement popularisées par les ateliers "New Age" se donnent pour objectif de créer des individus indéfiniment mutables, débarrassés de toute rigidité intellectuelle ou émotionnelle ». Les gens ne savent plus où se trouve leur désir : ils ont perdu la source d'eux-mêmes.
C’est cette invasion progressive du moi par des sollicitations extérieures, dotées de toutes les apparences de la proximité, de la vie et de la familiarité, qui fait dire à Georges Bernanos (je crois bien que c’est dans La France contre les robots, 1944) que la civilisation technique est « une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure » : dépossédé de lui-même, l’individu ne s’appartient plus, il appartient corps et âme à toutes les réquisitions qui ne cessent de le convoquer hors de lui, en provenance du monde extérieur (fil twitter, facebook, telegram, instagram, amstramgram, …). Il ne peut plus être dans l’action : il est paralysé dans la réaction à ce qui vient du dehors.
Le moi individuel s’en trouve fragmenté en autant de petits bouts que de sollicitations reçues. Car le pire, c’est que ces petits bouts, en s’accumulant, ont fini par former une foule fantomatique qui s’agite à l’intérieur et qui, en le remplissant d’artefacts, lui a refaçonné un « moi » presque complet (et constamment renouvelé par un flux permanent, parfois obsessionnel), un « moi » exogène sur lequel l’individu a de moins en moins de prise (et je ne parle pas de la relation au temps : il peut oublier son texto d'il y a dix minutes, seul le « réseau » n’oubliera rien de ce qu’il y a laissé). Dans ces conditions, peut-on encore parler de volonté ? De libre-arbitre ? Dans l’expression du « désir », impossible de savoir quelle est la part du « moi » authentique et la part de propagande ingurgitée. C'est peut-être pour ça que Michel Houellebecq se méfie du désir : « Si l'on considère que le désir est mauvais, ce qui est mon cas ... » (Entretien avec Christian Authier, 2002).
C’est si vrai que la crise des gilets jaunes a mis en lumière l’illusion de susciter une relation humaine au moyen de « l’ouverture » électronique sur le monde : combien de fois n’a-t-on pas entendu parler, au cours des reportages sur les ronds-points, d’une forme neuve de « socialisation », certains allant même jusqu’à déclarer qu’ils avaient trouvé une espèce de « famille » ? Preuve que la vraie socialisation passe par la relation interpersonnelle directe. Un « réseau », ça vous bombarde de propagandes diverses ou d’éructations haineuses : c’est bon pour fixer des rendez-vous, pas pour se faire d’improbables « amis ».
Alors Houellebecq, dans tout ça ? Eh bien selon moi, avec Sérotonine, on est en plein dans ce paysage, perdu au milieu de nulle part, seul. La plus forte impression d’ensemble qui se dégage du livre est vraiment le sentiment d’une solitude irréparable et définitive, une solitude dense, massive et compacte, qui s’épaissit à mesure que le moi du personnage se met à flotter et à se diluer dans l’air, de plus en plus évanescent. Je connais peu d'écrivains capables de traduire en littérature avec une telle justesse le sort commun fait par le monde réel à l'individu ordinaire. Il faut beaucoup de compassion envers l'espèce humaine pour donner une forme littéraire aussi accomplie au désespoir. Je peux me tromper, mais je persiste à penser que Michel Houellebecq appartient à cette espèce d'hommes qui ont nourri un espoir infini dans l'avenir de l'humanité, et qui se sont cassé le nez sur la réalité. Peut-être son ambition est-elle de traduire en littérature l'absolu de la DÉCEPTION.
Tel est, selon moi, le paysage humain qui sert de territoire aux personnages de Michel Houellebecq, et en l’occurrence à Florent-Claude Labrouste.
Tout ça pour dire à quel point Sérotonine parle du monde tel qu'il est, et à quel point il entre en résonance avec l'idée que je m'en fais.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : Prochainement, quelque chose de plus consistant sur le livre lui-même.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, michel houellebecq, sérotonine, florent-claude labrouste, éditions flammarion, georges bernanos, la france contre les robots, twitter, facebook, instagram, smartphone, lettre à lakis proguidis, interventions 2, extension du domaine de la lutet, approches du désarroi, günther anders, l'obsolescence de l'homme, adam et ève, faust et méphisto
lundi, 20 avril 2015
QUAND HOUELLEBECQ INTERVIENT
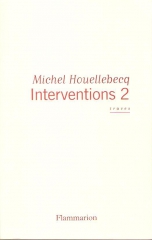 Je n’ai pas tout compris dans la méthode de publication, réédition, distribution et redistribution des textes que Michel Houellebecq a donnés à droite et à gauche depuis que ses écrits sont publiés (1988, je crois, pour des poèmes en revue). Toujours est-il et quoi qu’il en soit, je viens de lire Interventions 2 (Flammarion, 2009). On dira que je fais une fixation.
Je n’ai pas tout compris dans la méthode de publication, réédition, distribution et redistribution des textes que Michel Houellebecq a donnés à droite et à gauche depuis que ses écrits sont publiés (1988, je crois, pour des poèmes en revue). Toujours est-il et quoi qu’il en soit, je viens de lire Interventions 2 (Flammarion, 2009). On dira que je fais une fixation.
Je ne rejette pas a priori l’hypothèse de la pathologie, mais que voulez-vous, quand vous mettez le pied dans un patelin où, à votre grand étonnement, vous avez soudain l’impression de rentrer à la maison tellement c’est comme ça que vous vous racontiez l’histoire et que vous vous peigniez le paysage, vous avez envie de vous arrêter là, et d’en savoir un peu plus long, ne serait-ce que pour vérifier que vous ne rêvez pas.
Il se trouve simplement que j’ai découvert en 2011, avec La Carte et le territoire, un écrivain qui surpasse de très loin le niveau du vulgum pecus littéraire français. Et que j’ai eu envie de creuser la question. Je dois dire qu’en creusant, je n’ai pas été déçu des matières que ma rivelaine amenait au jour, à mesure que j’avançais dans le filon.
Interventions 2 est ce qu’on appelle un « recueil ». Forcément, il y a « à boire et à manger » : des textes de longueurs, de natures, de genres et de thématiques différents, qui ont été demandés à l’auteur entre 1992 et 2008. Sans compter l’avant-propos, il s’ouvre et se ferme sur des règlements de comptes. Le premier (« Jacques Prévert est un con ») n’a pas besoin d’explication. Le titre annonce la couleur et se suffit à lui-même.
En revanche, le titre « Coupes de sol », qui clôt l'ouvrage, reste énigmatique tant qu’on ne sait pas que Houellebecq est sorti de la même « Agro » que Robbe-Grillet, et que la « coupe de sol » est une des bases, paraît-il, de l’enseignement agronomique. Cela n’empêche pas le condisciple à retardement d’infliger une bonne avoinée littéraire à son prédécesseur : non, Houellebecq n'aime pas le pape du "Nouveau Roman". Je le comprends.
C’est que Houellebecq a fait des choix (il ne le dirait peut-être pas comme ça : des choix qui se sont imposés ou qu’il n’a pu refuser de faire, il a une conception pessimiste de la liberté humaine), il a pris position, ce qui l’autorise à porter des jugements.
Si certains trouveront ceux-ci péremptoires et injustes, c’est qu’ils ont l’esprit « errant et sans patrie » de ceux qui, prenant tout ce qui vient au motif qu’il ne faut rejeter ou exclure rien ni personne, s’interdisent de porter quelque jugement que ce soit sur qui ou quoi que ce soit, mais attention : en interdisant absolument à quiconque de ne pas être d’accord avec eux, sous peine de correctionnelle. Pour eux, affirmer des choix et porter des jugements, c'est forcément être facho. Si tout au moins choix et jugements osent s'écarter de leur ligne.
Je veux parler de tous les obsédés du consensus moral, tous les flics tolérantistes qui peuplent la gauche raplapla, dépourvus de ce moyen de jugement qui permet de distinguer le bon et le mauvais, le juste et l’injuste, le beau et le laid, – ce moyen qu’on appelait un CRITÈRE, à l’époque où les « valeurs » étaient encore des échelles, qui permettaient de placer êtres, choses, langages, systèmes, œuvres d’art à des altitudes différentes. Cette époque ténébreuse et heureusement révolue, où l’on avait encore l’infernal culot d’appeler un chat un chat.
Je laisse Robbe-Grillet aux amateurs, s’il y en a encore. Je m’arrête sur Prévert, le poète préféré des enseignants masochistes qui aiment se faire flageller en faisant apprendre « Le Cancre » à leurs élèves multiculturels : « Il dit oui avec la tête, mais il dit non avec le cœur, il dit oui à ce qu’il aime, il dit non au professeur, et gnagnagna et gnagnagna ». Prévert illustre à merveille la niaiserie irréversible qui a saisi la société française au moment où elle a commencé à sacraliser « le monde merveilleux de l’enfance ».
Houellebecq met le monsieur dans le même sac que Vian, Brassens et Boby Lapointe (qu’il écrit « Bobby », l’ignorant), dont il trouve les jeux de mots stupides. Tant pis, c’est son droit. Question de génération sans doute. Vian, je le lui laisse assez volontiers, mais Brassens et Lapointe, je ne suis pas d’accord : ils ont poussé leur rhizome trop loin dans mon oreille pour que je puisse seulement songer à en arracher la moindre radicelle. S’agissant de Brassens et Lapointe, je perds tout esprit critique.
Jacques Prévert souffre, aux yeux de Houellebecq d’un certain nombre de tares. Certes et hélas, « il a quelque chose à dire », « Malheureusement, ce qu’il a à dire est d’une stupidité sans borne ». Il enfonce le clou : « Sur le plan philosophique et politique, Jacques Prévert est avant tout un libertaire ; c’est-à-dire, fondamentalement, un imbécile ». Il n’a pas tort. Pour terminer : « Si Jacques Prévert est un mauvais poète, c’est avant tout parce que sa vision du monde est plate, superficielle et fausse ». J’avoue que ces quatre pages m'ont fait un bien fou. Un fier encouragement à poursuivre la lecture.
Le propre d’un recueil, c’est d’être d’un intérêt inégal. C’est dans sa nature. Certains textes (critique cinéma, critique art, critique poésie, …) ne me disent guère. C’est le cas, en particulier d’ « Opera Bianca », suite de courts textes destinés à accompagner l’ « installation mobile et sonore conçue par le sculpteur Gilles Touyard ».
Je ne connais pas les œuvres de Gilles Touyard, mais en apprenant que « la musique est due à Brice Pauset », c’est plus fort que moi, je ferme toutes les écoutilles. Peut-être à cause du traumatisme que constitue la production sonore (je n'ai pas dit la « musique ») de ce monsieur, tout fier de reproduire, par exemple, les sons enregistrés d'un aspirateur en fonctionnement.
D’autres retiennent sans effort mon attention. C’est le cas d’un article daté de 1992 (« Approches du désarroi »), un vrai petit chef d’œuvre synthétique et analytique sur l'époque que nous vivons, dont je conseille vivement la lecture. C’est aussi le cas de « Philippe Muray en 2002 ». C’est encore le cas d’un entretien avec des gars de Paris-Match. Quelques autres.
La loi du genre, quoi.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature française, critique littéraire, michel houellebecq, interventions 2, éditions flammarion, la carte et le territoier, jacques prévert, jacques prévert est un con, alain robbe-grillet, nouveau roman, prévert le cancre, boris vian, georges brassens, tonton georges, boby lapointe, paris match, musique contemporaine, brice pauset

