jeudi, 04 juillet 2024
JEAN-SÉB. ...
... L'ÉVEREST.
J'ai déjà raconté ici comment je suis venu à faire très tôt de l'écoute de la musique un aliment auditif aussi indispensable et vital que l'air que je respirais. Cela se passait (j'avais entre 6 et 7 ans) au 39, cours de la Liberté à Lyon, chez le docteur où j'étais en pension provisoire, assortie d'une éphémère inscription à l'école Ozanam, bourrée de soutanes, de "tables vertes" et de pupitres à abattant.
Donc, sur la commode de la chambre de mes grands-parents, le tourne-disques et, dans le grand placard aux portes coulissantes, les 78 tours et 33 tours (on ne disait pas encore vinyles). A tout seigneur tout honneur : sur le Teppaz, l'Etude opus 25 n°11 de Chopin (par Braïlowski ?), avec ses cascades fluides à la main droite virevoltant et dansant autour de la solide armature du thème structurant. Pas loin derrière, l'ouverture de Tannhäuser avec ses deux cors (et une clarinette basse, me semble-t-il). J'ai fait sur ces deux une authentique "fixation".

Première mesure de l'Etude op.25 n°11 de Chopin (après les quelques mesures de l'introduction).
Sans exagérer, ces deux-là, mes "œuvres princeps" en quelque sorte, je les remettais régulièrement vingt ou trente fois de suite, jusqu'à ce que ma grand-mère, si douce épouse de son médecin de mari, me fasse comprendre courtoisement que ça commençait à bien faire. Ce qui me fascinait, c'était de découvrir qu'on pouvait marier deux lignes mélodiques complètement différentes, sans que l'œuvre perde pour autant un seul gramme de sa force et de son charme. Les savants appellent ça "contrepoint", ou "écriture horizontale", opposée à la verticalité de l' "harmonie".
Dans le même genre il y eut aussi le fabuleux duo des flûtes au début de La Moldau de Smetana, qui mariaient leurs volutes acrobatiques. La septième de Beethoven par Furtwängler, avec le deuxième concerto de Rachmaninov par Leonard Pennario, n'est venue qu'un peu plus tard. Oh, bien sûr, en cherchant un peu, il y eut encore un certain nombre d'autres disques, mais qui ont laissé des traces moins profondes dans mon disque dur.
J'ai encore, néanmoins, dans l'oreille cette chanson gravée sur une cire illustrée en couleur, depuis longtemps perdue corps et bien : « Ah mesdames, voilà du bon fromage, voilà du bon fromage au lait qui vient du pays de celui qui l'a fait ! ». Alors là, on peut dire que voilà du texte !!! Ensuite, de fil en anguille, j'ai embrayé sur les 78 tours récupérés de je ne sais où par mes parents, dans le beau meuble Schaublorenz regroupant la radio stéréo et l'électrophone : « Qu'il fait bon chez vous, maître Pierre ! », « Les filles de Cadix » et quelques autres raretés anciennes.
Et puis les 33 tours du coffret de 10 vinyles classiques de la "Guilde du disque" qui offrait tous les grands tubes de la "grande musique" où il était question de "Mont chauve", de "Polovtsiennes", de "Danse macabre" et d' "Apprenti sorcier". Et puis la curieuse sonorité de la guitare rock d'un nommé Duane Eddy, et puis les Shadows, et puis ... et puis ... Je n'en finirais pas. J'ajoute, pour clore sur cette "entrée en musique", que je n'ai pas tardé à succomber à une autrement grave addiction : la radio. C'étaient les Grandes Ondes, et avant tout Europe N°1, avec tout ce que les variétés françaises ou anglo-saxonnes pouvaient offrir de chanteurs et de groupes yéyés, "Salut les Copains", rock, pop et chansons "à texte".
Tous ces préliminaires étaient peut-être nécessaires pour en arriver à mon entrée dans le bureau du Grand Patron, le "Saint des saints" de toute la musique européenne : tout le monde a compris, j'espère, pourquoi j'ai intitulé le présent billet "Jean-Séb.". Or, on n'entre pas dans cette cathédrale comme dans un moulin. Il faut trouver un intermédiaire qui accepte de vous introduire. L'ambassadeur qui m'apporta la convocation s'appela, je n'ai pas honte de le dire, Jacques Loussier.
Comment ce "Play Bach n°1" s'est-il retrouvé à inaugurer ma collection ? J'ai oublié. J'avais 16 ans, mes parents, qui voulaient sans doute favoriser mon goût visible, audible et prononcé pour la musique, m'avaient offert un imposant électrophone stéréo Philips, dont le couvercle était constitué par deux hauts-parleurs à brancher et à disposer de telle et telle manière.

Quand j'ai entendu pour la première fois le pianiste jouer le "Prélude n°1", et surtout quand il attaque le tempo accéléré où, avec ses complices Garros et Michelot, il métamorphose l'imperturbable régularité en un morceau diablement syncopé, comme le font les jazzmen dans leurs improvisations, je me suis dit aussitôt qu'un monde s'ouvrait à ma curiosité. Qu'est-ce que c'était que cette musique qui autorisait qu'une telle modernité pût impunément s'en servir sans dénaturer pour autant les bases harmoniques et mélodiques de sa composition ? Il y avait là, pour mes oreilles, quelque chose d'énorme et de profond qui s'ouvrait. C'était Jean-Sébastien !
Je me suis procuré, au fur et à mesure de leur parution, les cinq albums de "Play Bach" du trio Loussier-Garros-Michelot. Le plus étonnant, c'est qu'après six décennies, ils figurent toujours dans ma discothèque, alors que d'autres cires estimables se sont perdues en route. Oh, certes pas dans l'état neuf où je les avais trouvés, mais encore assez nets pour passer sans trop de désagréments sur la platine vinyle. Et si je ne les écoute plus aujourd'hui avec l'émerveillement de la découverte, j'y prends encore un plaisir extrême.
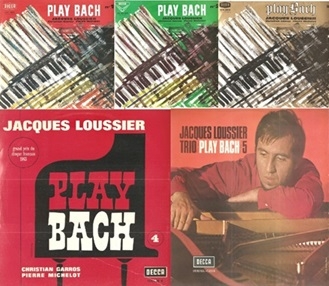
Les cinq disques qui ont ouvert mes oreilles aux fondamentaux universels de la musique européenne.
Pour être franc et complet, il faut que j'ajoute l'autre clé artistement ouvragée qui ouvre sur le monde jean-sébastianesque : le groupe dirigé par Ward Swingle, grand connaisseur et grand "passeur" des œuvres du Grand Maître. J'ai nommé "Les Swingle Singers". En leur sein, on comptait Christiane Legrand, la propre sœur de Michel, ainsi que d'autres anciens membres du groupe de jazz vocal Les Double Six (dont Swingle lui-même). Le titre de leur disque : Jazz Sébastien Bach.

Quoi qu'il en soit et qu'il s'agisse du trio Loussier ou des Swingle, cette époque fut comme une rampe de lancement. Je me suis mis à guetter toutes les apparitions de Jean-Sébastien dans le paysage. Ce furent alors les "Cycles Bach" organisés dans diverses salles et églises de Lyon, auxquels j'assistais en compagnie d'Alain, un vieux pote. Nous eûmes droit, par exemple, à de grandioses Brandebourgeois dans le transept de Saint Pothin et à une grandiose Passacaille et fugue à Saint Bonaventure. Alain et moi fûmes fidèles à Bach pendant quelques années, jusqu'à ce que nos trajectoires divergeassent (oui oui, l'imparfait du subj.).
Et puis il y eut les disques. Le premier de ma centaine de vinyles "Jean-Séb." fut celui des Sonates et Partitas pour violon seul, déniché dans les bacs de La Clinique du tourne-disques, magasin de la rue Joseph-Serlin, jouées par un certain Jean Champeil.

Je dois dire que cette galette m'a percuté de plein fouet, à cause d'un morceau que tous les amateurs connaissent comme "l'Everest" du violon pour les instrumentistes : la "Chaconne", le feu d'artifice de 14 juillet qui clôt la 2ème Partita. Champeil était violon solo chez Lamoureux et soliste à l'Opéra de Paris. Certes pas le plus grand violon de tous les temps, mais c'est quand même ce deuxième ou troisième "couteau" qui m'a apporté la révélation de cet incontournable et absolu chef d'œuvre. Merci monsieur. Et puis cerise sur le gâteau : un gros cahier imprimé sur papier bible avec la partition, dont la version originale de la Ciaccona, de la main même de Bach !!!

Ci-dessus les quatre premières mesures de la "Ciaccona".
On dira sans doute que je suis entré dans l'univers Bach par la petite porte, presque la "porte de service", comme on disait à Paris autrefois. Je le reconnais sans problème et sans honte. Mais franchement, Jacques Loussier, Christian Garros et Pierre Michelot comme Grands Chambellans chargés de vous introduire dans le Salon d'Honneur en clamant votre nom, il y a pire. Bon, c'est vrai que, étant allé entendre un concert donné par le trio à la salle Molière, j'avais trouvé glaçante l'ambiance dans laquelle il s'était déroulé : tous trois dans le contrôle, très sérieux et très guindés dans leur costard noir, chemise blanche et nœud pap., pour moi qui passais régulièrement des soirées dans la cave joyeuse et enfumée du Hot Club de Lyon, ça la fichait plutôt mal.
Reste cependant la raison d'être de ce billet : le monument Jean-Sébastien, avec les innombrables ouvriers qui se chargent de l'entretenir et de le faire briller. Je pense par exemple à madame Corinne Schneider, grâce à qui le culte de cette musique perdure sur France Musique tous les dimanches matins, perpétuant pour les vieux fidèles comme moi l'action d'un Jacques Merlet, d'auguste mémoire. C'est un drôle de monument, ce « vieux Bach », comme l'appelait avec un immense respect l'empereur Frédéric II : nul jusqu'à ce jour n'a réussi à en accomplir un tour complet ni à en épuiser la substance.
Mais Jean-Sébastien Bach n'a pas besoin de l'éloge du minuscule quidam qui se permet ici de célébrer ce géant.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jean sébastien bach, tourne-disques teppaz, lyon, cours de la liberté, 78 tours, vinyle, 33 tours, frédéric chopin, étude opus 25 n°11, ouverture de tannhäuser, braïlowski, richard wagner, polyphonie, contrepopint, bedrich smetana, la moldau, la septième de beethoven, rachmaninov concerto piano n°2, léonard pennarion, guilde du disque, danse macabre, apprenti sorcier, unenuit sur le mont chauve, salut les copains, duane eddy, rock'n roll, jacques loussier, christian garros, pierre michelot, loussier play bach, swingle singers, christiane legrand, double six, jazz sébastien bach, ward swingle, cycle bach, saint pothin, saint bonaventure, concertos brandebourgeois, passacaille et fugue, la chaconne de bach, jean champeil, lyon salle molière, france musique, corinne schneider, jacques merlet
vendredi, 15 septembre 2023
DES PERLES COMME ...
... S'IL EN PLEUVAIT.
Oui, je sais, j'écoute un peu trop la radio, mais que voulez-vous, c'est comme ça, et ça fait si longtemps. Dans le brouillard qui s'épaissit et s'approfondit parfois à l'excès, il arrive à mon oreille d'être piquée par l'aiguillon des trouvailles — involontaires en général — de tous ces gens autorisés à causer dans le poste. Autant de bonbons que je laisse au lecteur le soin d'apprécier.
*
***
*
Entendu sur France Musique hier soir. Benjamin François (ou Arnaud Merlin ?) présente le programme du concert de 20 heures, qui commence par une œuvre de Pouët-Pouët Boulez : « Le Sacre du printemps n'a pas perdu une ride depuis sa création ».
***
Sur France Culture, le 6 septembre 2023 à 12 h. 11 environ. On parle d'un film quelconque : « Une actrice qui a eu un accident de voiture et qui a disparu de la circulation ».
***
Toujours France Q, le 27 avril 2023 vers 12 h.40 : « Doubler la facture par deux ».
***
France Q, 9 septembre vers 7 heures 17, dans la bouche de Quentin Laffay (on est samedi) : « Le Tombereau de Couperin, de Maurice Ravel ». Répété tel quel dans la "désannonce".
***
France Culture encore, le 14 août dernier vers 7 heures 03. On parle de migrants et de passeurs, qui se donnent rendez-vous le long de La Canche, fleuve côtier du Pas-de-Calais, par souci de discrétion : « Ils remontent le fleuve jusqu'à la Manche ».
***
Philippe Manière, "consultant" en je ne sais quoi (entreprise "Vae Solis" = "Malheur à l'homme seul"), sur France Culture , le 30 janvier 2023 à 8 h. 08 : « Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire ».
***
A propos de Carlos Ghosn, le 20 novembre 2018 à 7 h. 02, dans la bouche du journaliste Hakim Kasmi : « Même le Medef se pourfendra d'une lettre ».
***
Le 10 octobre 2018, sur France Culture vers 8 heures 20 : « Ces nouveaux députés La République en Marche n'ont pas la rouardise des députés du vieux monde ».
***
A SUIVRE .......
09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, carlos ghosn, france culture, france musique, journalistes, hakim kasmi, la république en marche, philippe manière, migrants, quentin laffay, maurice ravel, le tombeau de couperin, benjamin françois, arnaud merlin, pierre boulez, stravinsky, le sacre du printemps
lundi, 10 janvier 2022
RACHMANINOV : UN PLAGIAT ?
Ce dimanche 9 janvier 2022, voilà-t-il pas que j'entends le début d'une émission de France Musique que je n'écoute jamais (c'est le dimanche, c'est l'heure de la sieste, et puis on n'est pas obligé). Et qu'est-ce qu'il passe comme disques, le Jean-Yves Larrouturou qui cornaque le créneau ? Des enregistrements de la musique de Clara Wieck-Schumann. J'adore les compositions de Clara Schumann, mais qu'est-ce qu'il a besoin de rattacher son programme à la lutte des femmes ? Il y a là pour moi quelque chose d'incompréhensible : en quel honneur des œuvres d'art devraient-elles être mises au service de causes que leurs créateurs n'ont pas songé un instant à promouvoir ou à défendre ? Passons sur le stéréotype féministe en vigueur.
Il s'agit de la Ballade opus 6 n°4 jouée par Marie-Josèphe Jude, mais je n'ai pas entendu l'annonce du morceau. Je me dis : ça c'est du Rachmaninov, nom de Zeus !!! Et puis je file dans mes CD du Russe, j'essaie avec les Etudes-Tableaux par Nicholas Angelich : chou-blanc ! Je me rabats sur les Préludes par Abdel Rahman El Bacha : Bingo !!! A la première plage. Je n'en demandais pas tant. Il s'agit de l'opus 3 n°2. Si l'on excepte les deux-trois accords d'intro de Rachmaninov, les mesures initiales sont quasiment identiques. Je vous laisse écouter les deux pour comparer, mais je ne serais pas étonné qu'on me dise que Rachmaninov a purement et simplement plagié la compositrice, au moins dans le début de l'œuvre. Cette magique succession d'accords qui m'ont tenu compagnie durant des insomnies entières, se pourrait-il que ? Je suis peut-être le dernier des derniers à découvrir ça. Et alors ?
Bon, c'est sûr et vrai qu'après avoir écouté les deux pièces, on est obligé de reconnaître que, même si les premières mesures sont un peu "copie-conforme", les deux univers n'ont finalement pas grand-chose à voir, et que ce qu'on peut appeler poésie dans l'œuvre de Clara Schumann devient recherche de la virtuosité dans celle de cet authentique maître du piano qu'était Sergeï Rachmaninov (en quoi Clara Schumann n'avait rien à lui envier, à ce qu'on dit). N'empêche que ça fait drôle. Faut-il que j'aie été marqué par le père Rachmaninov (ça a commencé il y a très-trop longtemps avec son concerto n°2 par Léonard Pennario et je ne sais plus quel orchestre ou quel chef - peut-être Vladimir Golschmann, en tout cas c'était sur le Teppaz du 39 cours de la Liberté) pour mettre le doigt sur l'emprunt qu'il a fait à la talentueuse Clara Wieck-Schumann tant célébrée par les cohortes musico-féministes.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, clara schumann, sergueï rachmaninov, france musique, clara wieck, robert scumann, rachmaninov études tableaux, rachmaninov préludes, evgueni kissin, leonard pennario, jean-yves larrouturou
mercredi, 07 juillet 2021
ÉDOUARD COMMETTE, ORGANISTE LYONNAIS

Édouard Commette (1883-1967) est, paraît-il (je n'ai pas vérifié l'info), le premier organiste à avoir enregistré un disque consacré à l'orgue (en 1928). Je ne l'ai pas connu, mais je l'ai peut-être entendu sans savoir que c'était lui (j'ai l'âge), dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon, dont il était le titulaire de l'orgue (de 1904 à 1965, selon Maurice Vanario). Oh, ce n'est pas que les "grandes orgues" de notre cathédrale Saint-Jean-Baptiste jouissent d'une énorme réputation. La preuve, c'est qu'elles n'attirent guère les vedettes de l'instrument. J'imagine que leur emplacement, encaissé dans le transept de l'édifice au lieu de figurer majestueusement au-dessus de l'entrée comme c'est très souvent le cas, n'est pas pour rien dans ce relatif dédain. Mais enfin cela reste un bel orgue, même si ce n'est pas celui qu'Edouard Commette a connu (impossible de dénicher une photo de l'ancien, détrôné autour de 1990).

Inutile de préciser que les touristes viennent plutôt voir l'horloge astronomique qu'entendre l'orgue photographié en 1996 par Marcos Quinones.
Edouard Commette, de même que son élève et successeur au même poste Joseph Reveyron (1917-2005), il a refusé de quitter sa ville quand des propositions un peu alléchantes lui ont été faites ailleurs. Si je ne l'ai pas connu, j'ai fréquenté la classe de son fils, qui enseignait le français au Lycée Ampère, et qui ne m'a pas laissé grand souvenir. J'ai échangé quelques mots insignifiants avec lui un soir où un hommage officiel était rendu à son père, sans doute pour le centième anniversaire de sa naissance : j'ai oublié si c'était à Saint-Bonaventure ou à Saint-Jean (je dirais plutôt Saint-Jean, l'autre orgue étant tenu par Marcel Paponaud (1893-1988), un autre illustre inconnu, mais quand on est le titulaire, on ne se laisse pas déloger).
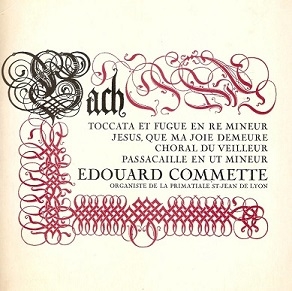
Si je parle ici d'Edouard Commette, c'est d'une part que je viens de remettre la main sur un vieux vinyle 25cm que j'ai énormément écouté au cours de mon existence parce qu'il contient une version magnifique à mes oreilles de la Passacaille et fugue en ut mineur de Jean-Sébastien Bach. Je ne sais ce qu'en penserait la "Tribune des Critiques de disques", et ça m'est bien égal.
On dénombre à ce jour 2751 visionnages de ce youtube posté en 2012 par Vincent Ograou. Logique.
C'est, d'autre part, parce qu'en fouinant dans les photographies de Georges Vermard [qui fut photographe au défunt journal L'Echo-Liberté] conservées à la Bibliothèque Municipale de Lyon, je suis tombé sur quelques clichés représentant le maître. J'avoue que j'ai été saisi par cette tête d'oiseau de nuit, par ce visage calviniste à la Gustav Leonhardt, par ce profil sans menton, par ces doigts puissants et frêles qui ont toujours préféré le relatif anonymat d'une capitale provinciale aux lumières d'une renommée plus grande dans la capitale nationale ou aux claviers de quelque instrument autrement prestigieux.

Oui, j'ai été saisi par — qu'on m'excuse — la beauté du portrait que ces photos de Georges Vermard, dressent, trois ou quatre ans avant sa mort, de ce musicien généralement ignoré aujourd'hui. Pensez, mon ami F., grand mélomane et une oreille d'ingénieur du son, ignorait ce nom jusqu'à ce que je lui en parle.

Que le lecteur veuille bien considérer ce petit billet comme un obscur hommage à un grand organiste resté obscur par choix.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : en 1974, la ville de Lyon a donné le nom d'Edouard Commette à une toute petite place, prise entre l'avenue Adolphe Max et la place Saint-Jean, non loin donc du lieu où l'organiste a exercé son art durant toute une vie consacrée à la musique. Depuis la prise de photo par Marcos Quinones en 1991, des arbres ont été replantés, et un marché — tour à tour livres et bio — se tient, m'a-t-on dit, le samedi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, musique, musique d'orgue, édouard commette, jean-sébastien bach, passacaille et fugue en ut mineur, photographie, photographes, georges vermard, marcos quinones, joseph reveyron, france musique, tribune des critiques de disques, vincent ograou, journal l'écho liberté, jérémie rousseau
jeudi, 18 février 2021
DES MUSICONS ...
... COMME S'IL EN PLEUVAIT.
« Les com ... positeurs con ... temporains, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ! »
(réplique célébrissime d'un film illustrissime).
Une minute exactement, rien que pour le thème principal (d'abord au poing — "happy birthday to you" fredonné par Ventura —, ensuite au banjo).

Partition normale (Michel Magne).
***
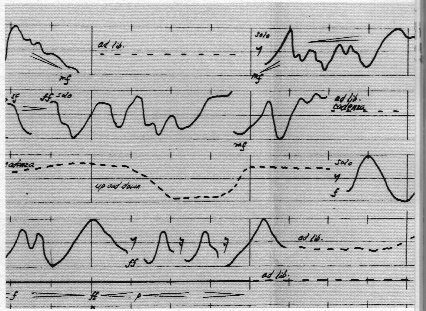
"Partition" d'Edgar Varèse.
Je cite cette réplique-culte parce que j'ai chopé France Musique ce soir ("Les Mercredis de la contemporaine") et que les prouesses du quatuor Diotima ont abouti à un drôle de résultat : les musiciens ont joué une musique qui a fini par me faire bien rigoler. Avouez que je leur devais bien ce petit billet en reconnaissance de leurs bienfaits dans une période qui ne prête pas précisément à la rigolade.
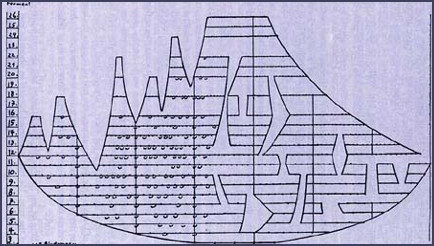
"Partition" de Karlheinz Stockhausen.
Le sourire narquois a commencé à naître avec le quatuor à cordes de Bruno Mantovani, pour s'épanouir en rire franc et massif au fur et à mesure que celui d'Enno Poppe déroulait ses superpositions de lignes qui se voulaient certainement d'une gravité peu encline à la bonne humeur. Au moment où j'écris ces mots, la plume de Pascal Dusapin égrène des notes qui me semblent un peu moins exotiques ou barbares.
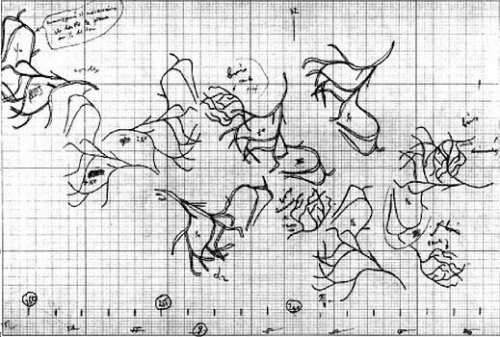
"Partition" de Iannis Xenakis.
Je dirai quand même, pour la défense des artistes, qu'ils soient concepteurs ou exécutants, qu'aussi longtemps que les premiers n'obligent pas les derniers à frapper leurs Stradivari-Amati-Guarneri-Bergonzi avec leurs archets hors de prix, tout ce petit monde est en droit de prétendre que les assemblages de sons produits par les instruments restent de la musique musicale.
Mais on n'est pas forcé de les croire.
***

Partition normale (Olivier Messiaen).
***
Dans le "monde d'après", on fera comme avant, "en un peu pire" (citation).
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique contemporaine, france musique, les tontons flingueurs, michel magne, edgar varèse, quatuor diotima, les mercredis de la contemporaine, karlheinz stockhausen, bruno mantovani, enno poppe, pascal dusapiniannis xenakis, stradivarius, olivier messiaen
mercredi, 24 juin 2020
ÉTERNITÉ DE JEAN-SÉBASTIEN BACH
10'55" de pur bonheur.
Voici l'Art de la Fugue (partie finale) comme je ne l'avais jamais entendu. Le monsieur qui a transcrit pour ensemble vocal cette partie d'un chef d'œuvre absolu de l'histoire de la musique occidentale s'appelle Harry van der Kamp. Il est néerlandais. Il a fondé et dirige le "Gesualdo Consort Amsterdam".
Il fait chanter la mélodie ô combien complexe sur un texte tiré de l'Evangelisches Gesangbuch : « Ein selig Ende mir bescher, am Jüngsten Tag erweck mich, Herr, dass ich dich schaue ewiglich. Amen, Amen, erhöre mich ! ».
Le contrepoint XIX est une fugue à trois sujets. Il faut se rendre compte, déjà, de ce qu'est une fugue à 4 voix (la fugue n°4 du CBT est à 5 voix) : un seul sujet, mais que le compositeur triture et torture dans tous les sens (inverse, miroir, miroir inversé, ...), c'est déjà de la grande ébénisterie d'art.
Alors imaginez la même difficulté, mais multipliée par trois (en exponentiel). Et ça a l'air abstrait, mais quand vous écoutez, ça vous transporte : on peut toujours chercher comment c'est fait..

L'écriture du "vieux Bach", comme l'appelait avec un infini respect Frédéric II de Prusse, qui peut s'enorgueillir d'être le destinataire de L'Offrande Musicale (mais c'est une autre histoire). Les portées sont tracées au "rastrum", ce porte-plume à cinq plumes alignées dont John Eliot Gardiner parle dans son merveilleux bouquin : Musique au château du ciel (Flammarion, 2014).
Quant à l'inachèvement de ce dernier contrepoint, je ne me lasse pas de réécouter avec ferveur les dernières mesures qui laissent l'auditeur en suspension dans un brouillard voluptueux, et je laisse les musicologues se disputer autour des savantes conclusions qu'il faut en tirer.
Que l'inscription apposée après les dernières notes (« Sur cette fugue où le nom de B.A.C.H. [si bémol-la-do-si bécarre en notation germanique] est utilisé en contre-sujet, l'auteur est mort. ») dans la partition manuscrite soit ou non une affabulation, ce n'est pas un problème : si non è vero, ben trovato.
Enfin, je me permets de reléguer bien loin sur le rayon la version clavecin du grand et très calviniste Gustav Leonhardt, qui s'est permis d'ajouter au contrepoint inachevé une broderie de sa façon : ça ne se fait pas, même quand on s'appelle Leonhardt. Autant je ne me formalise pas trop de ce que Friedrich Cehra achève la partition du Lulu d'Alban Berg, autant, s'agissant de JSB, je dis : « Pas touche ! ».
Dire que le disque existe depuis 2005, et que je ne le connaissais pas (label Sony) ! Merci à France Musique en général et à Madame Corinne Schneider en particulier, qui presque tous les dimanches de cette année à partir de sept heures du matin (je suis du genre "couche-tôt-lève-tôt"), m'ont toujours fait passer de bons moments, souvent d'excellents et, en quelques occasions, des moments extraordinaires de pure jouissance musicale, et peut-être même spirituelle, comme c'est arrivé ce dimanche 21 juin, en écoutant cette version vocale de L'Art de la Fugue.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jean-sébastien bach, l'art de la fugue, the art of the fugue, harry van der kamp, gesualdo consort amsterdam, gustav leonhardt, france musique, corinne schneider, le bach du dimanche, friedrich cehra, alban berg lulu, clavier bien tempéré
dimanche, 21 juin 2020
CHANTER ENSEMBLE
On est à une table bien garnie au milieu de joyeux convives, on voit les cuisinières s'activer, on entend les bruits de l'auberge, les couteaux et fourchettes sur les assiettes. On a mangé et bu. Il ne reste plus qu'à chanter. Cela se passe à Tbilissi (Georgie). Le film de la série "Petites planètes" (Vincent Moon) dure 8'47". J'ai eu du mal à le retrouver sur l'internet après en avoir entendu à peine quelques secondes magiques je ne sais plus quand sur France Musique. Le chant commence à 1'12", une simple mise en bouche avant d'en arriver à l'essentiel, qui se produit à 3'18". Je ne sais pas ce qui se passe. Ecoutez ce refrain : c'est renversant. Le collectif qui prend le relais à 7'20", c'est pour la bonne humeur finale de l'au-revoir.
Ce qui se passe entre 3'18" et 7'20", je me le repasse en boucle. C'est tout le mal que je souhaite au visiteur qui apprécie les harmonies subtiles.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : série petites planètes, vincent moon, tbilissi, musique de georgie, musique, france musique
mercredi, 08 avril 2020
CORONAVIRUS : NE PAS CESSER D'APPLAUDIR
Les percussionnistes de Radio France sont confinés comme tout le monde. Cela ne les empêche pas d'applaudir, comme tout le monde, les personnels de santé (n'oublions pas les caissières, les éboueurs, ...). Ils donnent, en restant chacun chez soi, Clapping music de Steve Reich. La vidéo est époustouflante.

Didier Benetti, Gabriel Benlolo, Emmanuel Curt, François Desforges, Benoît Gaudelette, Jean-Claude Gengembre, Florent Jodelet, Nicolas Lamothe, Renaud Muzzolini, Francis Petit, Gilles Rancitelli, Rodolphe Théry (montage et mixage).
***
Bravo messieurs. Moi aussi j'applaudis (pas aussi savamment).
06:57 Publié dans L'ETAT DU MONDE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : coronavirus, musique, france musique, percussionnistes radio france, clapping music, steve reich
dimanche, 30 juin 2019
VARÈSE AVAIT TOUT COMPRIS
IL N'Y A PAS DE MUSIQUE SANS SONS,
MAIS IL Y A DES SONS SANS MUSIQUE.
Précision : j'ai pris Varèse pour faire le titre, mais il va de soi que le propos de ce billet s'adresse à tous les compositeurs du 20ème siècle, et même au-delà, aux autres artistes. L'idée générale est la suivante : pour avoir une idée de l'état moral de la civilisation actuelle et du soi-disant "Progrès" qui la guide et l'anime, regardez les œuvres des artistes, et écoutez les œuvres des compositeurs de musique savante.
***
Pelléas et Mélisande-1907, Le Sacre du printemps-1913, Désert-1954 : Claude Debussy, Igor Stravinsky, Edgar Varèse. Autant de scandales éclatés dans la France de la première moitié du 20ème siècle. Fontaine-1917, c’est l'urinoir signé R. Mutt, alias de Marcel Duchamp. Et vlan, encore un scandale. Merda d’artista-1961, c’est Piero Manzoni. Le gobelet d’urine, c’est je ne sais plus qui. Cloaca (la machine à faire caca), c'est Wim Delvoye en 2000. Derniers scandales en date : le « Vagin de la reine », d’Anish Kapoor à Versailles, les « Tulipes » de Jeff Koons, le « plug anal » de Paul Mc Carthy au milieu de la place Vendôme, j’arrête là.
Au théâtre, à l’opéra, on ne compte plus les metteurs en scène qui ont « dépoussiéré » les œuvres majeures du répertoire à coups d’attentats contre les « routines » d’un public « paresseux » et « encroûté », pour « nettoyer les écuries d’Augias » ou « faire souffler un vent nouveau » (rayer la mention inutile). Tiens, dans le Don Giovanni donné ces temps-ci à Strasbourg, Leporello met du poison dans les plats, Donna Anna jette du vin à la figure du séducteur et le Commandeur devient barman : vous le sentez, « l'air frais et vivifiant » ?
Dans le domaine esthétique tout entier, l’histoire du 20ème siècle est jalonnée par les pierres blanches des scandales. Les milieux artistiques, qu’on disait conservateurs, se sont mis au goût du jour et ont adopté le langage cérébral qui convient pour donner à toutes sortes de nouveautés le poids de l’intellect. On s’est mis à idolâtrer les avant-gardes et à guetter l’inouï et le jamais vu. Tous les arts sont touchés par ce phénomène, mais je parlerai ici principalement du domaine musical.
Les beaux esprits qui se font des piquouses à l’air du temps, et tombent dans tous les panneaux pour avoir l’air bien informés, en tirent argument pour en conclure que, quand une œuvre est novatrice, elle commence par « heurter les sensibilités », mais finit toujours par devenir un « classique », sur le refrain : « On s’habitue à tout ». C'est parfois vrai, mais loin d’être la règle (tiens, pour voir si vous le trouvez « classique », essayez la "première" de Déserts de Varèse (27'15") en 1954, et accrochez-vous, je parie que le Sacre de Stravinsky prendra des airs de Mozart. Frank Zappa admirait Varèse).
Ce qui est amusant, c'est que Varèse, qui avait peut-être prévu l'accueil "festif", se débrouille pour qu'il y ait par épisodes plus de bruit sur la scène que dans la salle.
Et le public, dans tout ça ? Eh bien le public, lui, dans sa plus grande partie, est resté sur place. Pendant que les arts (musique, peinture, etc.) montaient dans le TGV et prenaient la voie rectiligne et scintillante de la modernité, le public en restait au pas mesuré du laboureur à sa charrue, derrière son cheval, les sabots dans la glèbe. Et la technique ne l’a pas aidé, on peut le dire, à accélérer l’allure, contrairement à ce qu’on pourrait penser a priori.
Car la technique au 20ème siècle, en plus de donner des moyens révolutionnaires aux compositeurs (qui se sont jetés dessus comme des prédateurs affamés : onde Martenot, Theremine, magnétophone, sampler, etc.), a apporté au public tout ce qu’il fallait pour entretenir son naturel conservatisme esthétique. D’abord la radio, puis la télévision, qui caressent forcément l’auditeur dans le sens du poil ; mais aussi la conservation (enregistrement) et la reproduction (disques) de la musique en train de se faire : ça paraît inconcevable aujourd’hui, mais il fallait auparavant sortir de chez soi pour entendre de la musique, ou alors la pratiquer soi-même pour en faire à la maison.
Du coup, la musique en train de se donner en concert en direct a perdu de sa prégnance et de sa surface commerciale (je ne parle pas du rap). Ce qu’on appelle « musique contemporaine » est devenu une option parmi cent cinquante autres, puisque, grâce à la technique, toutes les musiques sont devenues « contemporaines ».
Et par la vertu des moyens de reproduction, toutes les musiques ont acquis les vertus domestiques de la consommation individuelle, voire solitaire, pour ne pas dire égoïste. Et les étiquettes (on pourrait dire « compartiments », « cases », « ghettos », …), dans les rayons « musique » de la FNAC, se sont mises à proliférer et se multiplier. Pierre Bouteiller avait mis un "s" à "musique" quand il dirigeait l'antenne musicale publique (ceci pour dire que l'élite intellectuelle se fait volontiers la messagère de tout ce qui voudrait la voir morte et en enfer).
Pour ce qui est des musiques savantes, je veux parler des avant-gardes, tout ce beau monde a décidé d’oublier le grand public et d’en revenir à la bonne vieille doctrine de « l’art pour l’art » : moi l’artiste, moi le compositeur, j'oublie que la musique est faite pour être entendue et appréciée par des oreilles humaines, je suis désormais l'explorateur des possibles, l’expérimentateur des formes, le chercheur en blouse blanche, je combine et fabrique au fond de mon laboratoire, j’en sors pour offrir mes trouvailles au monde, et tant pis pour les mélomanes, qui n’ont qu’à me suivre, s’ils ne sont pas trop fossilisés dans une tradition paralysante. Une petite élite d’amateurs préoccupés de « vivre avec leur temps », ça me suffira.
Aparté : j’ai longtemps fait partie de ces gens-là. Je n’en éprouve ni honte ni fierté : cela fut. Cela n'est plus. J'en ai gardé de fort rares prédilections. Mais le plus souvent, je suis obligé de fermer les écoutilles, en me demandant pourquoi les compositeurs modernes et d'aujourd'hui ont banni de leurs préoccupations l'intention de procurer à leurs auditeurs une émotion musicale. Comme s'il était interdit désormais au public d'éprouver du plaisir, et pourquoi pas, de la jouissance. Dans l'immense majorité de sa production, la musique contemporaine déteste le plaisir. (ajouté le 5 juillet)
Le grand public a réagi avec bon sens et à-propos : il a déserté les salles, se disant qu’on ne paie pas son billet d’entrée pour se faire marcher sur les tympans par des bataillons de sons chaussés de bottes à clous (ou inversement, pour chercher dans une botte de foin trois pets inodores qui se courent après). Les directeurs de salles et programmateurs de concerts ont fini par comprendre. En sadiques modérés, ils ont adopté la stratégie du sandwich : une tranche de Stockhausen entre une Quatrième de Beethoven et une Ouverture de Mozart, convaincus qu’à la longue le public s’y fera : « Nous avons les moyens de vous faire aimer la contemporaine » (dit - presque - le SS "Papa Schulz"-Francis Blanche dans Babette s'en va-t-en guerre).
Mais globalement, disons-le, le grand public a résisté à ce qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'est un fait : pour entrer dans la musique contemporaine, il faut quelques clés. En particulier, il ne faut pas ignorer que la musique a quelque chose à voir avec le mouvement de l'histoire. Il faut se faire une idée des grandes "problématiques" touchant la tonalité, la mélodie, les timbres, les instruments, la notion d'œuvre (pièces aléatoires de Boucourechliev et autres), l'auditoire (cf. le célèbre 4'33" de Jogn Cage) et autres fantaisies théoriques.
Or le grand public n'avait pas une vue très claire des bouleversements intervenus dans la réalité globale du monde. L'époque, et donc la musique étaient radicalement nouvelles. Quelques révolutions bien réelles avaient eu lieu, changeant de fond en comble les conditions de l'existence et des productions esthétiques. Que peut-on chanter, que peut-on écrire, après deux guerres mondiales, après la bombe atomique, après Auschwitz ? Sûrement pas l'adagio d'Albinoni. L'histoire était passée par là.
En vociférant contre le compositeur qui, selon lui, massacre la "musique", le grand public se trompe de cible (idem en peinture : "Un gamin de cinq ans en ferait autant") : c’est contre l’époque capable d'engendrer de tels monstres, que devraient s’élever les récriminations. Bizarrement, l'auditeur supporte aisément la réalité générale dans laquelle il vit, mais hurle contre des objets esthétiques qui n'en sont que les produits.
Il faut s'en convaincre : la musique contemporaine a tout compris du temps dans lequel elle est composée : elle porte très naturellement les clameurs politiques, les tumultes guerriers, les misères noires, les drames affreux, le chaos sensoriel et l'anarchie conceptuelle qui ont pris les commandes de l'humanité. Il n'y a plus des sons proprement musicaux et spécifiquement organisés sortis d'instruments fabriqués pour ça.
Tous les sons sont devenus égaux, y compris ceux qu'on appelait "bruits" avant que Pierre Schaeffer n'en fasse des "objets musicaux". Par exemple, j'avais assisté à une répétition où les jeunes violonistes, obéissant à Ivo Malec, devaient frapper (pas trop fort, mais "a tempo") le bois de l'instrument avec le bois de l'archet ("Musique nouvelle", Lyon, 1981). Bien des compositeurs sont arrivés à faire pire. Le 20ème siècle ne pouvait pas espérer mieux pour le domaine musical que ce champ de batailles.
La musique faite au 20ème siècle, qui porte tous les bruits et toutes les fureurs du monde, ressemble trait pour trait au siècle où elle a vu le jour (oui, je sais qu'on est au 21ème). Pleine de vacarmes, d'horreurs et de tortures sans précédent, elle est en parfaite adéquation avec lui. C'est l'attitude face au siècle qui doit façonner l'attitude face aux arts, et c'est encore loin d'être le cas. Comme s'il y avait une césure entre les deux. A moins que l'auditeur ne vive dans une bulle protectrice.
Berg, Schönberg, Prokofiev, Partch, Ligeti, Stockhausen, Boulez, Gubaidulina, Barraqué, Schwarz, Xénakis, Penderecki, Nancarrow, Zimmermann, Webern, Boucourechliev, Cage, Berio, Kagel, Greif et tous les autres, ils ont tout compris au siècle, et ils ont composé la musique qui entrait le plus fort en résonance avec lui. Et le grand public, sans même s'en rendre compte, étranger à toutes ces musiques de son temps, vit hors de son propre siècle.
Le grand public n’a pas compris que s’il juge insupportable beaucoup de la musique contemporaine, c’est parce que c’est le siècle qui est insupportable, et que la musique ne fait que l'exprimer. Alors que lui, grand public, qui veut continuer à supporter l'existence, continue à vivre comme si étaient réunies comme avant toutes les conditions pour vivre harmonieusement. Le grand public a mis la tête dans le sable. Les tumultes, les rages, les catastrophes peuvent bien se déchaîner, le grand public se déchaîne quant à lui contre les œuvres qui, dans leur forme ou dans leur contenu, le mettent face à cette réalité sauvage.
Le monde est enragé, mais « la vie continue ». La réalité peut devenir atroce, mais il faut pouvoir continuer à dormir le cœur en paix et à passer des repas tranquilles. Et si, pour mon compte personnel, je déteste une majeure partie de ce qui se fait en musique savante aujourd’hui, c’est parce que je l'inclus dans le tableau d'ensemble. Je sais que notre temps est de moins en moins présentable et habitable (ce qui ne m'empêche pas de jouir de ma petite existence).
J’ai une fois pour toutes cessé d’adhérer à l’ignoble fiction du « Progrès », et cette antipathie va aussi, bien évidemment, aux œuvres qui en sont le fruit. Je coupe le son lorsque viennent les « mercredis de la contemporaine » sur France Musique, sauf en de très rares occasions où, en pleine célébration du culte des sons, du bruit et de la fureur, je vois se dessiner le visage d’une vraie mélodie qui me susurre à l’oreille : « Non, tout n’est pas perdu ».
Voilà ce que je dis, moi.
***
Quelques phrases d'un baratin que j'avais pondu ici même le 9 décembre 2015. Je n'ai guère progressé.
Qui adhère avec enthousiasme à l’époque, est logiquement gourmand d’art contemporain, de musique contemporaine. Qui est rebuté par l’art contemporain, en toute logique, devrait diriger sa vindicte contre l’époque dont celui-ci est issu, et non pas seulement contre l'art qu'elle produit..
L’art contemporain découle de son époque. Tout ce qui apparaît minable dans l’art contemporain découle logiquement du minable de l’époque qui le produit. Ce n’est pas l’art qui pèche : c’est l’époque. Nous avons l’art que notre époque a mérité. Quand la laideur triomphe, c’est que l’époque désire la laideur.
Mais si l’on admet que c’est l’époque qui produit cet art déféqué, c’est moins l’art qui est à dénoncer que l’époque qui l’a vu et fait naître, tout entière.
Mais il y a une certaine continuité. Ajouté le 9 août 2019.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, edgar varèse, stockhausen, france musique, france musique, claude debussy, pelléas et mélisande, igor stravinsky, le sacre du printemps, varèse déserts 1954, marcel duchamp, ready-made, merda d'artista, jeff koons, paul mc carthy, wolfgang amadeus mozart, don giovanni, art contemporain, arcon, pierre bouteiller, john cage, boucourechliev, pierre schaeffer, traité des objets musicaux
VARÈSE AVAIT TOUT COMPRIS
IL N'Y A PAS DE MUSIQUE SANS SONS,
MAIS IL Y A DES SONS SANS MUSIQUE.
Précision : j'ai pris Varèse pour faire le titre, mais il va de soi que le propos de ce billet s'adresse à tous les compositeurs du 20ème siècle, et même au-delà, aux autres artistes. L'idée générale est la suivante : pour avoir une idée de l'état moral de la civilisation actuelle et du soi-disant "Progrès" qui la guide et l'anime, regardez les œuvres des artistes, et écoutez les œuvres des compositeurs de musique savante.
***
Pelléas et Mélisande-1907, Le Sacre du printemps-1913, Désert-1954 : Claude Debussy, Igor Stravinsky, Edgar Varèse. Autant de scandales éclatés dans la France de la première moitié du 20ème siècle. Fontaine-1917, c’est l'urinoir signé R. Mutt, alias de Marcel Duchamp. Et vlan, encore un scandale. Merda d’artista-1961, c’est Piero Manzoni. Le gobelet d’urine, c’est je ne sais plus qui. Cloaca (la machine à faire caca), c'est Wim Delvoye en 2000. Derniers scandales en date : le « Vagin de la reine », d’Anish Kapoor à Versailles, les « Tulipes » de Jeff Koons, le « plug anal » de Paul Mc Carthy au milieu de la place Vendôme, j’arrête là.
Au théâtre, à l’opéra, on ne compte plus les metteurs en scène qui ont « dépoussiéré » les œuvres majeures du répertoire à coups d’attentats contre les « routines » d’un public « paresseux » et « encroûté », pour « nettoyer les écuries d’Augias » ou « faire souffler un vent nouveau » (rayer la mention inutile). Tiens, dans le Don Giovanni donné ces temps-ci à Strasbourg, Leporello met du poison dans les plats, Donna Anna jette du vin à la figure du séducteur et le Commandeur devient barman : vous le sentez, « l'air frais et vivifiant » ?
Dans le domaine esthétique tout entier, l’histoire du 20ème siècle est jalonnée par les pierres blanches des scandales. Les milieux artistiques, qu’on disait conservateurs, se sont mis au goût du jour et ont adopté le langage cérébral qui convient pour donner à toutes sortes de nouveautés le poids de l’intellect. On s’est mis à idolâtrer les avant-gardes et à guetter l’inouï et le jamais vu. Tous les arts sont touchés par ce phénomène, mais je parlerai ici principalement du domaine musical.
Les beaux esprits qui se font des piquouses à l’air du temps, et tombent dans tous les panneaux pour avoir l’air bien informés, en tirent argument pour en conclure que, quand une œuvre est novatrice, elle commence par « heurter les sensibilités », mais finit toujours par devenir un « classique », sur le refrain : « On s’habitue à tout ». C'est parfois vrai, mais loin d’être la règle (tiens, pour voir si vous le trouvez « classique », essayez la "première" de Déserts de Varèse (27'15") en 1954, et accrochez-vous, je parie que le Sacre de Stravinsky prendra des airs de Mozart. Frank Zappa admirait Varèse).
Ce qui est amusant, c'est que Varèse, qui avait peut-être prévu l'accueil "festif", se débrouille pour qu'il y ait par épisodes plus de bruit sur la scène que dans la salle.
Et le public, dans tout ça ? Eh bien le public, lui, dans sa plus grande partie, est resté sur place. Pendant que les arts (musique, peinture, etc.) montaient dans le TGV et prenaient la voie rectiligne et scintillante de la modernité, le public en restait au pas mesuré du laboureur à sa charrue, derrière son cheval, les sabots dans la glèbe. Et la technique ne l’a pas aidé, on peut le dire, à accélérer l’allure, contrairement à ce qu’on pourrait penser a priori.
Car la technique au 20ème siècle, en plus de donner des moyens révolutionnaires aux compositeurs (qui se sont jetés dessus comme des prédateurs affamés : onde Martenot, Theremine, magnétophone, sampler, etc.), a apporté au public tout ce qu’il fallait pour entretenir son naturel conservatisme esthétique. D’abord la radio, puis la télévision, qui caressent forcément l’auditeur dans le sens du poil ; mais aussi la conservation (enregistrement) et la reproduction (disques) de la musique en train de se faire : ça paraît inconcevable aujourd’hui, mais il fallait auparavant sortir de chez soi pour entendre de la musique, ou alors la pratiquer soi-même pour en faire à la maison.
Du coup, la musique en train de se donner en concert en direct a perdu de sa prégnance et de sa surface commerciale (je ne parle pas du rap). Ce qu’on appelle « musique contemporaine » est devenu une option parmi cent cinquante autres, puisque, grâce à la technique, toutes les musiques sont devenues « contemporaines ».
Et par la vertu des moyens de reproduction, toutes les musiques ont acquis les vertus domestiques de la consommation individuelle, voire solitaire, pour ne pas dire égoïste. Et les étiquettes (on pourrait dire « compartiments », « cases », « ghettos », …), dans les rayons « musique » de la FNAC, se sont mises à proliférer et se multiplier. Pierre Bouteiller avait mis un "s" à "musique" quand il dirigeait l'antenne musicale publique (ceci pour dire que l'élite intellectuelle se fait volontiers la messagère de tout ce qui voudrait la voir morte et en enfer).
Pour ce qui est des musiques savantes, je veux parler des avant-gardes, tout ce beau monde a décidé d’oublier le grand public et d’en revenir à la bonne vieille doctrine de « l’art pour l’art » : moi l’artiste, moi le compositeur, j'oublie que la musique est faite pour être entendue et appréciée par des oreilles humaines, je suis désormais l'explorateur des possibles, l’expérimentateur des formes, le chercheur en blouse blanche, je combine et fabrique au fond de mon laboratoire, j’en sors pour offrir mes trouvailles au monde, et tant pis pour les mélomanes, qui n’ont qu’à me suivre, s’ils ne sont pas trop fossilisés dans une tradition paralysante. Une petite élite d’amateurs préoccupés de « vivre avec leur temps », ça me suffira.
Aparté : j’ai longtemps fait partie de ces gens-là. Je n’en éprouve ni honte ni fierté : cela fut. Cela n'est plus. J'en ai gardé de fort rares prédilections. Mais le plus souvent, je suis obligé de fermer les écoutilles, en me demandant pourquoi les compositeurs modernes et d'aujourd'hui ont banni de leurs préoccupations l'intention de procurer à leurs auditeurs une émotion musicale. Comme s'il était interdit désormais au public d'éprouver du plaisir, et pourquoi pas, de la jouissance. Dans l'immense majorité de sa production, la musique contemporaine déteste le plaisir. (ajouté le 5 juillet)
Le grand public a réagi avec bon sens et à-propos : il a déserté les salles, se disant qu’on ne paie pas son billet d’entrée pour se faire marcher sur les tympans par des bataillons de sons chaussés de bottes à clous (ou inversement, pour chercher dans une botte de foin trois pets inodores qui se courent après). Les directeurs de salles et programmateurs de concerts ont fini par comprendre. En sadiques modérés, ils ont adopté la stratégie du sandwich : une tranche de Stockhausen entre une Quatrième de Beethoven et une Ouverture de Mozart, convaincus qu’à la longue le public s’y fera : « Nous avons les moyens de vous faire aimer la contemporaine » (dit - presque - le SS "Papa Schulz"-Francis Blanche dans Babette s'en va-t-en guerre).
Mais globalement, disons-le, le grand public a résisté à ce qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'est un fait : pour entrer dans la musique contemporaine, il faut quelques clés. En particulier, il ne faut pas ignorer que la musique a quelque chose à voir avec le mouvement de l'histoire. Il faut se faire une idée des grandes "problématiques" touchant la tonalité, la mélodie, les timbres, les instruments, la notion d'œuvre (pièces aléatoires de Boucourechliev et autres), l'auditoire (cf. le célèbre 4'33" de Jogn Cage) et autres fantaisies théoriques.
Or le grand public n'avait pas une vue très claire des bouleversements intervenus dans la réalité globale du monde. L'époque, et donc la musique étaient radicalement nouvelles. Quelques révolutions bien réelles avaient eu lieu, changeant de fond en comble les conditions de l'existence et des productions esthétiques. Que peut-on chanter, que peut-on écrire, après deux guerres mondiales, après la bombe atomique, après Auschwitz ? Sûrement pas l'adagio d'Albinoni. L'histoire était passée par là.
En vociférant contre le compositeur qui, selon lui, massacre la "musique", le grand public se trompe de cible (idem en peinture : "Un gamin de cinq ans en ferait autant") : c’est contre l’époque capable d'engendrer de tels monstres, que devraient s’élever les récriminations. Bizarrement, l'auditeur supporte aisément la réalité générale dans laquelle il vit, mais hurle contre des objets esthétiques qui n'en sont que les produits.
Il faut s'en convaincre : la musique contemporaine a tout compris du temps dans lequel elle est composée : elle porte très naturellement les clameurs politiques, les tumultes guerriers, les misères noires, les drames affreux, le chaos sensoriel et l'anarchie conceptuelle qui ont pris les commandes de l'humanité. Il n'y a plus des sons proprement musicaux et spécifiquement organisés sortis d'instruments fabriqués pour ça.
Tous les sons sont devenus égaux, y compris ceux qu'on appelait "bruits" avant que Pierre Schaeffer n'en fasse des "objets musicaux". Par exemple, j'avais assisté à une répétition où les jeunes violonistes, obéissant à Ivo Malec, devaient frapper (pas trop fort, mais "a tempo") le bois de l'instrument avec le bois de l'archet ("Musique nouvelle", Lyon, 1981). Bien des compositeurs sont arrivés à faire pire. Le 20ème siècle ne pouvait pas espérer mieux pour le domaine musical que ce champ de batailles.
La musique faite au 20ème siècle, qui porte tous les bruits et toutes les fureurs du monde, ressemble trait pour trait au siècle où elle a vu le jour (oui, je sais qu'on est au 21ème). Pleine de vacarmes, d'horreurs et de tortures sans précédent, elle est en parfaite adéquation avec lui. C'est l'attitude face au siècle qui doit façonner l'attitude face aux arts, et c'est encore loin d'être le cas. Comme s'il y avait une césure entre les deux. A moins que l'auditeur ne vive dans une bulle protectrice.
Berg, Schönberg, Prokofiev, Partch, Ligeti, Stockhausen, Boulez, Gubaidulina, Barraqué, Schwarz, Xénakis, Penderecki, Nancarrow, Zimmermann, Webern, Boucourechliev, Cage, Berio, Kagel, Greif et tous les autres, ils ont tout compris au siècle, et ils ont composé la musique qui entrait le plus fort en résonance avec lui. Et le grand public, sans même s'en rendre compte, étranger à toutes ces musiques de son temps, vit hors de son propre siècle.
Le grand public n’a pas compris que s’il juge insupportable beaucoup de la musique contemporaine, c’est parce que c’est le siècle qui est insupportable, et que la musique ne fait que l'exprimer. Alors que lui, grand public, qui veut continuer à supporter l'existence, continue à vivre comme si étaient réunies comme avant toutes les conditions pour vivre harmonieusement. Le grand public a mis la tête dans le sable. Les tumultes, les rages, les catastrophes peuvent bien se déchaîner, le grand public se déchaîne quant à lui contre les œuvres qui, dans leur forme ou dans leur contenu, le mettent face à cette réalité sauvage.
Le monde est enragé, mais « la vie continue ». La réalité peut devenir atroce, mais il faut pouvoir continuer à dormir le cœur en paix et à passer des repas tranquilles. Et si, pour mon compte personnel, je déteste une majeure partie de ce qui se fait en musique savante aujourd’hui, c’est parce que je l'inclus dans le tableau d'ensemble. Je sais que notre temps est de moins en moins présentable et habitable (ce qui ne m'empêche pas de jouir de ma petite existence).
J’ai une fois pour toutes cessé d’adhérer à l’ignoble fiction du « Progrès », et cette antipathie va aussi, bien évidemment, aux œuvres qui en sont le fruit. Je coupe le son lorsque viennent les « mercredis de la contemporaine » sur France Musique, sauf en de très rares occasions où, en pleine célébration du culte des sons, du bruit et de la fureur, je vois se dessiner le visage d’une vraie mélodie qui me susurre à l’oreille : « Non, tout n’est pas perdu ».
Voilà ce que je dis, moi.
***
Quelques phrases d'un baratin que j'avais pondu ici même le 9 décembre 2015. Je n'ai guère progressé.
Qui adhère avec enthousiasme à l’époque, est logiquement gourmand d’art contemporain, de musique contemporaine. Qui est rebuté par l’art contemporain, en toute logique, devrait diriger sa vindicte contre l’époque dont celui-ci est issu, et non pas seulement contre l'art qu'elle produit..
L’art contemporain découle de son époque. Tout ce qui apparaît minable dans l’art contemporain découle logiquement du minable de l’époque qui le produit. Ce n’est pas l’art qui pèche : c’est l’époque. Nous avons l’art que notre époque a mérité. Quand la laideur triomphe, c’est que l’époque désire la laideur.
Mais si l’on admet que c’est l’époque qui produit cet art déféqué, c’est moins l’art qui est à dénoncer que l’époque qui l’a vu et fait naître, tout entière.
Mais il y a une certaine continuité. Ajouté le 9 août 2019.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, edgar varèse, stockhausen, france musique, france musique, claude debussy, pelléas et mélisande, igor stravinsky, le sacre du printemps, varèse déserts 1954, marcel duchamp, ready-made, merda d'artista, jeff koons, paul mc carthy, wolfgang amadeus mozart, don giovanni, art contemporain, arcon, pierre bouteiller, john cage, boucourechliev, pierre schaeffer, traité des objets musicaux
jeudi, 18 avril 2019
POURQUOI J'ÉCOUTE FRANCE CULTURE ...
... ET FRANCE MUSIQUE
Il paraît que la chaîne France Culture est écoutée par 1.527.000 personnes, selon les calculs les plus récents de Médiamétrie. Cette raison sociale d'une entreprise qui mesure les audiences des chaînes, signe bien une des folies de l'époque, qui consiste à évaluer en temps réel les effets des actions humaines. Il faut, selon cet impératif (importé d'Amérique), fixer des objectifs chiffrés précis à tout ce que nous faisons. Cela permet à l'évaluateur (le juge des travaux finis) de vous dire que si, à 90% des objectifs remplis, vous avez le satisfecit de l'employeur, à 20%, vous êtes un raté, vous n'avez pas votre Rolex à 50 ans, et vous ne méritez pas de faire partie de la glorieuse équipe qui permet à l'entreprise qui a la bonté de vous employer de faire la course en tête des profits boursiers.
Le chiffre de Médiamétrie, que je trouve plutôt réconfortant, constitue paraît-il, la plus spectaculaire progression des chaînes radiophoniques. Pourquoi est-ce que j'écoute assez assidûment cette radio ? D'abord la publicité. J'ai cessé depuis des décennies de me brancher sur Europe 1 (il est préhistorique, le temps où l'on pouvait entendre à la file trois chansons, et sans interruption s'il vous plaît) et RTL. Je laisse de côté toutes les autres chaînes radio, locales, thématiques, mercantiles.
Toutes ces chaînes sont absolument insupportables, d'abord par le temps consacré à la publicité, cette déjection qui enrobe ses excréments dans un emballage rutilant, scintillant et resplendissant. Il me semble que le financement par la publicité de presque tous les organes chargés de nous faire parvenir les faits et le sens du monde (les "informations") est le signe le plus sûr que nous sommes en train, comme des rats, de quitter le navire de la civilisation : l'idée seule qu'un produit ou une marchandise soit soudain doté de l'être et de la dignité d'une personne, mais aussi d'un pouvoir (le caractère impérieux du commandement permanent : « Achetez, nom de dieu, ou il vous en cuira »), par la seule magie des mots et des images, est inconciliable avec l'idée que je me fais de la vie normale.
Ensuite à cause du saucissonnage de ces émissions en "séquences" qui vous étourdissent à force de sautiller d'un sujet à l'autre, je veux dire en tranches de plus en plus fines destinées à estourbir l'auditeur et à l'empêcher de zapper, à l'image des clips vidéo qui ne comportent presque pas de plans de plus de deux secondes. La norme médiatique est aujourd'hui au sautillement permanent : pas possible d'avoir un plan fixe, et ne parlons pas du "plan-séquence". A cet égard, la "matinale" de France Culture est un peu exaspérante, à cause de la multitude des intervenants (mais multitude très modérée quand on regarde la concurrence). Autre motif d'exaspération : l'obsessionnelle rengaine qui consiste à rappeler à la fin de chaque séquence qu'on peut la réécouter sur le site internet de la station. Le saucissonnage, voilà donc une des trois raisons pour lesquelles j'ai laissé tomber France Inter, il y a lurette.
La deuxième raison, c'est le ton sur lequel se déroulent un grand nombre d'émissions : la bonne humeur de commande, la gaieté sur ordre, les éclats de rires forcés à toutes les niaiseries considérées comme de l'humour, et plus généralement le règne odieux des humoristes dans l'audiovisuel. Je suis stupéfait de ce que le rire puisse figurer comme item obligatoire dans le cahier des charges de tant d'émissions. Si vraiment les producteurs se sentent contraints par les enquêtes marketing de répondre à une demande pressante des populations, je suis très inquiet au sujet de l'état moral et intellectuel de celles-ci. Tout cela fait donc de la plupart des canaux audiovisuels (et médiatiques en général) quelque chose d'infréquentable.
La troisième raison est évidemment l'invasion de la chaîne publique (France Inter) par la diarrhée publicitaire (ah, les "mentions légales" débitées à toute allure en fin de message !), cette défécation qui empuantit toute parole humaine de sa souillure, à l'image de ces créatures dégoûtantes de la mythologie antique (leur nom m'échappe) qui venaient déposer leurs "matières" dans les assiettes des convives. La publicité me rend la réalité carrément immangeable. On ne dira jamais assez la dimension polluante de la publicité. On ne dira jamais assez combien la publicité transforme le "temps de cerveau humain disponible" (Patrick Le Lay) en merde puante, juste digne de la chasse d'eau. Et je prends toujours très au sérieux le slogan plus que demi-séculaire de l'inoubliable Hara Kiri, qui énonce une vérité profonde.

A dire vrai, les séquences d' "auto-promotion" qui parsèment l'antenne de France Culture me fatiguent. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel reste la possibilité pour l'auditeur de fixer son attention dans la durée sur un thème précis : écouter des gens qui vous apprennent des choses, voilà ce que j'attends des radios que j'écoute, qu'il s'agisse de mots ou de sons musicaux (c'est-à-dire France Culture et France Musique). On n'est pas assailli par une armée de petites crottes, comme autant de balles de mitraillette. On peut se poser sur des plages un peu tranquilles et pas trop peuplées.
Et je garde bien entendu la liberté de tourner le bouton quand j'en ai assez.
Interpellation : comment, vous ne parlez à aucun moment dans votre billet de la télévision. Réponse : ah bon ? Il y a quelque chose à dire de la télévision ?
lundi, 28 janvier 2019
MICHEL LEGRAND
Je n'ai jamais vu Les Demoiselles de Rochefort. Je n'ai jamais vu Les Parapluies de Cherbourg. C'était au-dessus de mes forces. Pas parce que je n'aimais pas le cinéma : je me suis longtemps et abondamment laissé aller avec abandon et délice à ce loisir paresseux. Je me suis calmé. Non, si je n'ai jamais pu consentir à visionner les films du tandem Demy-Legrand, c'est parce que je ne pouvais me faire à l'idée de consommer bêtement de la platitude et de la niaiserie mises en musique, fût-elle techniquement irréprochable, comme c'est le cas.
Belle trouvaille en vérité ! Il m'est arrivé de jouer à ça en famille, et de chanter à plusieurs des paroles du genre : « Peux-tu fermer la fenêtre, s'il te plaît ? » ou « Je trouve la soupe un peu salée ce soir » (essayez, ça peut mettre tout le monde de très bonne humeur). Mais ce n'est jamais allé plus loin. Oui, c'est vrai, Michel Legrand n'a pas tort quand il dit du mal du récitatif, vous savez, ces morceaux d'opéra chantés qui racontent l'action en cours, en attendant la prochaine aria : c'est de la musique par défaut. Quand on pense à Mozart, ce qu'on a en tête, c'est l'air d'Osmin, c'est l'air de Cherubino, c'est l'air du "catalogue" (« Ma in Ispania son giá mille e tre »), c'est l'air de la Comtesse, ce ne sont jamais les "dialogues", fussent-ils chantés. Mais les dialogues chantés des films de Demy-Legrand ne sont même pas des récitatifs !
Et ce n'est pas le quadruple passage, dans la seule journée du samedi 26 sur France Musique, de la recette du "cake d'amour" tirée du film Peau d'âne qui va me faire changer d'avis : quelle bouse, en vérité ! Non, Michel Legrand est certes un excellent musicien, il est certes sorti du Conservatoire et de la classe de Nadia Boulanger, mais sa trouvaille de mettre en musique les plus plats des dialogues du quotidien, franchement, ça ne passe pas. Et puis je vais vous dire ce que je pense de Michel Legrand compositeur : c'est un Américain, point c'est tout. Pour moi, ça fait beaucoup de soupe à grand orchestre et à grand spectacle, genre Broadway. Quelque chose de globalement pas très intéressant.
Ce que je retiens plutôt de Michel Legrand, c'est d'abord sa détestation de Pierre Boulez. C'est sûr : deux mondes sans aucune intersection. Les deux ne font pas le même métier. Le brave et savant Christian Merlin (France Musique), dans son émission du dimanche matin sur l'orchestre, m'a fait aimer cette détestation en passant un (trop long) extrait d'Eclats (de Boulez, précisément), improbable assemblage de sons prétendument musicaux, où l'auditeur s'exténue en vain à se frayer un chemin carrossable. Je ne supporte pas que le "compositeur" (gourou si vous voulez) s'impose à l'amateur par le pouvoir d'intimidation qu'il prend sur lui (Boulez dit une seule chose : « C'est moi qui sais, c'est à l'auditeur de se plier. »). Boulez reste pour moi l'incarnation du despotisme dans l'univers musical. Que voulez-vous retenir de ses mélodies ? Il n'en veut à aucun prix. J'adore en cette circonstance la franchise de Michel Legrand, même si je ne goûte guère sa musique.
En revanche, j'avoue priser très fort quelques productions de ce dernier. Quelques chansons, mais sans film à l'appui. Tenez, celle-ci s'appelle Sérénade du XX° siècle. Ça raconte le changement de civilisation que constitue l'invention du gratte-ciel, avec les conséquences que cela entraîne sur les déclarations d'amour.
Oui, il a fait d'excellentes chansons, souvent enracinées dans le jazz (« Quand ça balance, alors là, je suis chez moi »). J'ajoute que j'ai toujours eu un grand plaisir à écouter les interviews de Michel Legrand, comme ce "Grand Entretien" rediffusé en intégralité samedi dernier sur France Musique.
Ce qui me rend sympathique Michel Legrand (et ce qui le rend populaire), c'est qu'il a refusé toute sa vie d'être "moderne", tout en étant, avec un grand talent, pleinement dans son époque. Ce n'est déjà pas si mal.
Voilà ce que je dis, moi.
jeudi, 26 janvier 2017
PHILIPPE MANOURY
Menus propos tombés de la bouche d'un professeur au Collège de France.
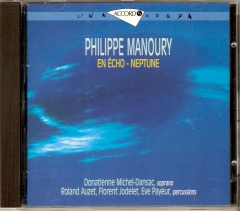 Philippe Manoury est un compositeur de musique contemporaine. Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais de lui, en dehors de quelques œuvres entendues en concert (oui, oui, c'est arrivé), que les sons sortis de ma chaîne audio quand, étourdi par les sirènes de la "modernité", j'avais commis la bévue de me procurer et de poser dans l'appareil idoine les galettes circulaires portant, gravés dans leurs sillons numériques, les bruits
Philippe Manoury est un compositeur de musique contemporaine. Je ne connais pas le monsieur. Je ne connais de lui, en dehors de quelques œuvres entendues en concert (oui, oui, c'est arrivé), que les sons sortis de ma chaîne audio quand, étourdi par les sirènes de la "modernité", j'avais commis la bévue de me procurer et de poser dans l'appareil idoine les galettes circulaires portant, gravés dans leurs sillons numériques, les bruits 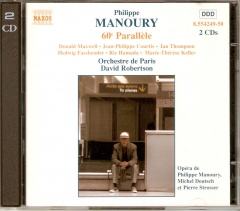 sortis de Neptune ou En Echo (label Accord, avec l'inévitable Donatienne Michel-Dansac dans le rôle de l'appât féminin), l'opéra 60è parallèle (label Naxos, direction David Robertson), La Partition du ciel et de l'enfer ou Jupiter (label IRCAM, sous la direction du commissaire du peuple Pierre Boulez, le délégué du soviet musical suprême). Assez peu en fin de compte. J'avoue que je ne les ai pas réécoutés pour l'occasion. Mais c'est juste pour que personne ne vienne me dire que je parle en totale ignorance de cause. J'ajoute qu'il m'est arrivé de trouver ici ou là de la musique dans ce que j'entendais. Pour dire que je ne suis pas complètement hermétique à ce qui se fait aujourd'hui en matière de musique : il m'arrive même de ne pas tourner le bouton les soirs, en général malheureux, où le programme est réservé aux "musiques d'aujourd'hui" (mais franchement, les œuvres diffusées hier soir par M. Franz Musik, de Gilbert Amy et Philippe Hurel, offrent une musique chétive, aride, squelettique : des vieux rapiats, des Harpagons de la musique ; les adeptes diront qu'ils n'ont gardé que l'essentiel, mais je n'ai pas envie de ronger les os).
sortis de Neptune ou En Echo (label Accord, avec l'inévitable Donatienne Michel-Dansac dans le rôle de l'appât féminin), l'opéra 60è parallèle (label Naxos, direction David Robertson), La Partition du ciel et de l'enfer ou Jupiter (label IRCAM, sous la direction du commissaire du peuple Pierre Boulez, le délégué du soviet musical suprême). Assez peu en fin de compte. J'avoue que je ne les ai pas réécoutés pour l'occasion. Mais c'est juste pour que personne ne vienne me dire que je parle en totale ignorance de cause. J'ajoute qu'il m'est arrivé de trouver ici ou là de la musique dans ce que j'entendais. Pour dire que je ne suis pas complètement hermétique à ce qui se fait aujourd'hui en matière de musique : il m'arrive même de ne pas tourner le bouton les soirs, en général malheureux, où le programme est réservé aux "musiques d'aujourd'hui" (mais franchement, les œuvres diffusées hier soir par M. Franz Musik, de Gilbert Amy et Philippe Hurel, offrent une musique chétive, aride, squelettique : des vieux rapiats, des Harpagons de la musique ; les adeptes diront qu'ils n'ont gardé que l'essentiel, mais je n'ai pas envie de ronger les os).
Il se trouve que monsieur Manoury prononce aujourd'hui même la "leçon inaugurale" des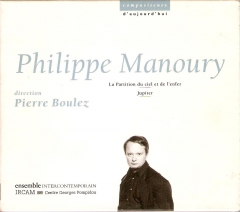 cours qu'il va donner pendant un an dans le collège le plus ancien de France (c'était sous François premier). A ce titre, il était invité hier à la table d'une antenne franzkulturelle pour expliquer tant que faire se peut comment il envisageait sa tâche. Il a profité de la tribune ainsi offerte pour asséner quelques-unes des sottises admises et véhiculées dans les milieux de la branchouille musico-moderniste.
cours qu'il va donner pendant un an dans le collège le plus ancien de France (c'était sous François premier). A ce titre, il était invité hier à la table d'une antenne franzkulturelle pour expliquer tant que faire se peut comment il envisageait sa tâche. Il a profité de la tribune ainsi offerte pour asséner quelques-unes des sottises admises et véhiculées dans les milieux de la branchouille musico-moderniste.
Soit dit pour commencer, le monsieur n'a rien contre les musiques de divertissement (merci pour elles), mais il ajoute dans la foulée que son domaine, c'est la "musique savante", qu'on se le dise. Je rétorquerai au monsieur que ce que j'attends, dans les musiques "savantes", ce n'est justement pas ce qu'elles contiennent de savant, mais un assemblage de sons musicaux qui me touche (je peux aussi être irrité ou indifférent). C'est parce qu'elles provoquent chez moi des résonances, des mouvements intérieurs divers et diversement puissants. Ce que les "spécialistes" de l'âme humaine appellent "affects" ou "émotions".
Je n'ai pas recopié mot à mot les convictions que Philippe Manoury a exprimées lors de l'entretien, et je citerai ses propos, comme on dit, "en substance". Le premier truisme formulé est un lieu commun : « Tous les compositeurs de l'histoire ont été des "contemporains" : il n'y a jamais eu d'autre musique que contemporaine ». Rien à dire de cette vérité d'évidence, sauf à préciser que les techniques d'enregistrement ont rendu "contemporaines" presque toutes les musiques produites par l'humanité depuis les origines, et que la musique dite contemporaine n'est plus qu'une modalité parmi l'infinité des autres. On est sur un marché où l'offre est pléthorique. Il y a du gavage et de la saturation dans la production musicale d'aujourd'hui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la demande ne suit pas. A moins que ça veuille dire autre chose (genre formatage, mise au pas des individus en passant par l'oreille, ...).
Quoi qu'il en soit, le fait d'enregistrer les sons pour qu'on puisse les réécouter à volonté les rend en effet potentiellement (et exactement) contemporains. On peut même dire que toute la musique existant ou ayant existé (celle qui a eu soit la chance d'arriver après l'idée géniale qu'il était possible d'écrire les sons musicaux, soit le temps de se faire enregistrer dans la collection Ocora Radio France avant de disparaître) nous est contemporaine. Les compositeurs qui s'estiment honnis n'ont qu'à protester et accuser les moyens techniques modernes de leur gâcher le métier, au lieu de bêler en chœur que ce sont « de formidables outils de création ».
La concurrence règne en maîtresse impitoyable : que la contemporaine pâtisse de la chose, au fond, rien de plus normal. Le créneau est étroit et on ne devrait pas être surpris que ce genre de musique (produire du "jamais ouï") ne concerne en fin de compte qu'un "marché de niche". Mais c'est le corollaire du raisonnement qui est intéressant : « Les compositeurs de l'histoire ont été des expérimentateurs ». Alors ça, c'est évidemment faux.
Que l'évolution (je n'ai pas dit le "progrès") de la musique ait accompagné une évolution des sensibilités liée aux changements sociaux et, si l'on veut, à l'édification progressive d'une civilisation, cela ne signifie en aucune manière que les compositeurs aient été, par profession, des "expérimentateurs". L'idée me semble juste risible.
C'est plutôt l'aveu de toute une conception : le compositeur d'aujourd'hui travaille dans son laboratoire au milieu de ses cornues et athanors, conçoit des protocoles d'expérience sophistiqués, explore le possible, fait des calculs, des hypothèses, des mélanges, des précipités. Puis un jour il en sort pour apporter au public agenouillé la "bonne nouvelle" (mot à mot grec, ça donne "évangile") : ça s'appelle une "création mondiale". Moralité : le compositeur d'aujourd'hui est un asocial. Le paradoxe, c'est qu'il est en même temps un marchand qui veut placer son produit. Par-dessus le marché, il se veut un prescripteur doté de l'autorité qui l'autorise à se donner le grand rôle.
Ce qu'il produit, moi j'appelle ça, sur le modèle imposé dans le milieu des "artistes-plasticiens", de la musique conceptuelle, c'est-à-dire du genre où le public est invité à se gratter le crâne ou le menton d'un air pénétré pour donner l'impression qu'il est descendu dans ses propres profondeurs pour s'interroger gravement sur le sens de tout ça. Mélasse dont il sort en général en déclarant à qui veut l'entendre que, tout bien réfléchi, « cela est intéressant ». Sûr que personne ne lui demandera s'il trouve intéressants telle "Fricassée parisienne" ou tel des Octonaires de la vanité du monde (Paschal de l'Estocart). La musique est certes faite pour être ouïe, mais elle est d'abord faite pour être jouie (j'assume le barbarisme, à moins que ce ne soit un solécisme).
Autre sujet d'hilarité, c'est quand le professeur au Collège de France (en CDD, heureusement) compare la musique contemporaine à une langue étrangère qu'il faut apprendre pour la comprendre. Cela se passe en deux temps.
Premier temps, une apostrophe à l'intervieweuse : « Quand vous allez en Chine et que vous ne connaissez pas la langue, si vous voulez vous faire comprendre, il va bien falloir que vous appreniez le chinois ». Autrement dit, pour comprendre un langage que vous ignorez, il faut l'apprendre. Même chose, donc, pour la musique contemporaine. Pure et simple intimidation. Soit dit en passant, je note que Philippe Manoury reconnaît ici, peut-être sans s'en rendre compte, que la musique qu'il écrit est a priori, aux oreilles du public, une langue étrangère. Prenons cela comme un aveu : Philippe Manoury est un prof de langue étrangère, il est au-dessus, et ses élèves (son public) ne savent pas. Il faut donc qu'il leur inculque.
Deuxième temps : « Est-ce que vous pouvez me dire, quand vous écoutez du Mozart, ce qu'il y a à comprendre ? ». Autrement dit, quand vous écoutez de la musique, il n'y a rien à "comprendre". Donc rien à "apprendre". Prenons cela comme un autre aveu : face à la musique, Philippe Manoury est notre égal, notre semblable, notre frère.
Conclusion et en résumé : un exemple lumineux de "double langage". Oh, Manoury, il faudrait savoir ce que tu veux. Dis-nous : il faut apprendre, ou il n'y a rien à apprendre ? Faut-il ou non éduquer le public ? La musique est-elle faite pour l'intellect ? Ou bien pour la sensibilité ? Tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre.
Cette idée de compréhension, ou plutôt cette grande plainte d'être un grand "incompris" poussée par tous les "innovateurs" (qui se disent "créateurs" et se plaignent que le public "ne suive pas"), est un refrain qui date de très longtemps : c'est aux destinataires des œuvres de s'adapter aux inventions de leurs auteurs. Le devoir premier des compositeurs n'est en aucune manière de chercher à plaire, ce qui serait bassement servile. Car la musique contemporaine nécessite une "éducation" spécifique : sans doute ce qu'on appelle "dresser" l'oreille. C'était donc ça ! Manoury et ses semblables se considèrent comme des dompteurs face à des fauves : il faut dresser les oreilles des contemporains pour les plier aux impératifs de la nouveauté. On appelle ça le cirque.
Monsieur Manoury, comme la plupart des gens qui "font" dans les arts contemporains, veut à toute force que son public retourne sur les bancs de l'école pour apprendre pour quelles raisons il doit aimer ses œuvres. Pour monsieur Manoury, le public est dans son tort, c'est lui qui devrait faire l'effort. Tout ça parce que, s'il n'aime pas ce qu'on lui donne, c'est qu' « il n'a pas assez l'habitude ». Moi je dis qu'on aura beau m'expliquer que je devrais me sentir coupable de mes refus d'admettre comme de la musique toutes les "new things" qui se présentent à mes oreilles endolories, quand ça veut pas, ça veut pas, et puis c'est tout.
Car cette histoire d'habitude, j'ai envie de dire : ben v'là aut'chose ! Je pose une question : est-ce seulement à cause de l'habitude que les gens du peuple qui dansaient sur les places dans les fêtes autrefois aimaient les sons qui sortaient de la flûte, du tambourin, de la cabrette ou de l'accordéon ? Ou bien ne serait-ce pas plutôt parce que ces sons sont organisés selon les lois d'une harmonie naturelle ? Le grand mot est lâché.
On me dira qu'il ne faut pas confondre musiques "savante" et "populaire". Je ne vois vraiment pas ce que ça change à la question de fond : on n'écoutait pas les mêmes choses dans les hautes et basses classes, c'est certain. Mais c'est justement là, et pas ailleurs, qu'il faut situer le problème des "habitudes" (traduit en Bourdieu, ça donne "habitus", au moins en gros), qui chiffonne monsieur Manoury.
Au fond, pourquoi le public, depuis le début du XX° siècle, tourne-t-il en masse le dos à la musique contemporaine ? N'est-ce pas précisément parce qu'elle a outrepassé les limites imposées aux sons musicaux par la nature ? Car en musique, comme en d'autres domaines, la question des limites ne se laisse pas évacuer facilement. Pourquoi les directeurs de salles et les chefs d'orchestre sont-ils obligés d'emboquer le public en insérant dans leurs programmes une tranche de contemporaine entre deux tranches de "classique" ? Espèrent-ils que le public, à la longue, lassé de résister, rendra les armes ?
Last but not least, Philippe Manoury déclare : « Je serais bien incapable de vous dire, quand je compose, ce qu'il faudrait faire pour que ma musique soit bien reçue ». Traduction en langage humain : « Quand je compose, j'ai autre chose à faire qu'à penser aux gens auxquels ma musique est destinée ! Pour moi, le destinataire n'existe pas ! ». En français mot à mot : rien à foutre que ma musique plaise ou non.
On me rétorquera que Beethoven lançait à Schuppanzigh : « Eh ! Que m'importent vos boyaux de chat, quand l'inspiration me visite ! ». Je répondrai juste que tout le monde n'est pas Beethoven. Mieux : en face d'un Beethoven, combien de domestiques ? Combien de nos "innovateurs" ont du génie ? Je crois pouvoir répondre : faire de l'innovation sonore un critère de la composition musicale d'aujourd'hui est le meilleur moyen de nous épargner l'émergence d'un génie. Et d'établir durablement e règne des bidouilleurs de sons.
Le génie porte un monde, il ne se réduit pas à l'innovation, qui n'est au fond qu'un résidu. Le véhicule d'une intention, si vous voulez. Le génie, c'est juste une question d'altitude dans l'intention.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique contemporaine, philippe manoury, ircam, pierre boulez, donatienne michel-dansac, david robertson, france musique, gilbert amy, philippe hurel, france culture, musique savante, collège de france, schuppanzigh, ludwig van beethoven, musique classique, musique
jeudi, 19 janvier 2017
MASCULINITÉ ET MODERNITÉ
De la pratique de l’auto-mutilation en musique.
Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve difficile de trouver dans le paysage musical un ensemble vocal dans lequel on n’entende pas une ou plusieurs voix dont le rayon perce avec plus ou moins de brutalité le nuage sonore, normalement « fondu », quand il est capable de « sonner » dans l’oreille de l’auditeur comme si le collectif de chanteurs, à force d’homogénéité dans l’émission des sons, ne montait que d'un seul gosier. Or il me semble avoir pu remarquer que, le plus souvent, cette voix qui a du mal à « se fondre » dans le chœur, c'est celle du haute-contre. Pas moyen de tomber sur un groupe dépourvu de haute-contre.
Pourtant allez sur France Musique écouter l’ensemble Huelgas de Paul van Nevel, dont le concert autour du Livre de chœur d’Eton (répertoire religieux de la période des Tudor) était retransmis le 17 janvier, et vous éprouverez le sentiment de la perfection du chant collectif a cappella. Et ce soir-là, s’il y avait un « ténorino », nulle trace de haute-contre. Le chant choral évite autant que possible l’expression des individualités : chacune est invitée à faire sienne le mot que Mathias Grünewald fait sortir de la bouche d'un Saint Jean-Baptiste pointant son index vers le crucifié : « Illum oportet crescere, me autem minui ».

En français libre : c’est lui qui doit grandir, moi je dois me faire tout petit. Chanter en chœur est un exercice d’humilité, j'en sais quelque chose, pour avoir chanté plusieurs années sous la direction de Bernard Tétu (chœurs de l'ONL). Pour la beauté de l'ensemble, il faut que la fierté de chacun soit mise en berne. C’est la raison pour laquelle la version donnée des madrigaux de Carlo Gesualdo par le Quintetto Vocale Italiano d’Angelo Ephrikian sonne aussi singulière, voire étrange, parmi les versions disponibles : ses membres sont des solistes.
Ce que je reproche à quelqu’un comme Dominique Visse, qui dirige l’ensemble Clément Janequin, est sa façon particulière, aigre et métallique, d’émettre le son, qui tient pour une part à son timbre, mais aussi à ce qu’il est haute-contre (alors que sa voix parlée serait plutôt celle d'un baryton - léger, lourd-léger ou poids welter, je n'en sais rien).
Pour avoir le son dans l'oreille (5'46"). Je précise que le problème que j'ai avec la voix de Dominique Visse ne m'empêche pas d' "ouyr les cris de Paris" (ci-dessus) avec la délectation du mélomane tout prêt à s'enthousiasmer pour le travail de virtuose du quintette vocal qu'il a réuni : c'est du "travail à la petite scie", si cela veut encore dire quelque chose à quelqu'un. L'ensemble Clément Janequin a commis quelques objets sonores dignes de marquer à jamais l'oreille de l'amateur. On peut s'en convaincre en écoutant, par exemple, une "Fricassée parisienne", dans le CD du même titre.
Il est hélas bien rare que le haute-contre, dans quelque ensemble vocal que ce soit, ne se fasse pas remarquer. Cela tient sans doute au fait qu’un timbre masculin, quand il se fait entendre dans un registre normalement réservé aux femmes, ne « sonne » pas comme les autres malgré une tessiture identique. Cela pourrait passer pour bizarre, mais je postule cette hypothèse qu'il existe, sous les couches superposées de la "culture", au moins une couche imputrescible de "nature" : sous le déguisement féminin, quelque chose de masculin consiste, persiste et résiste.
Même Philippe Jarrousky, la coqueluche actuelle de toutes les scènes baroques, est reconnaissable à son timbre, alors même que sa voix pourrait passer à s’y méprendre pour une voix féminine. Il n’y a pas à tortiller : le transsexualisme, complet (mais est-il jamais complet ?) ou seulement vocal, est un rêve bien difficile et coûteux à réaliser. A propos de Jarrousky, on trouve dans l’encyclopédie en ligne cette précision : c’est « son aisance et son plaisir d’interprétation dans ce registre » qui a décidé de son choix. C’est son droit, évidemment : son plaisir lui appartient, mais c'est son plaisir à lui.
Je pourrais développer en soulignant que, question durée ou intensité, le plaisir féminin n'a pas grand-chose à voir avec le masculin, mais le terrain pourrait vite devenir glissant. Je me contenterai de signaler l'aberration qui consiste pour un homme à espérer un jour éprouver ce qu'éprouve la femme (quand elle a la chance de voir l'orgasme lui arriver) en se comportant comme elle dans l'amour. Le plaisir masculin est ce qu'il est, voilà tout : intense, mais bref. Ne pas confondre verbe d'action et verbe d'état. Je n'ai guère envie d'envier ma voisine pour ce qu'il y a dans son assiette.
Ce qui me gêne dans cette affaire, c’est que le haute-contre (ou contre-ténor, ou falsettiste, ou sopraniste ou que sais-je, pour les différences, voyez un spécialiste) est devenu une figure incontournable du paysage musical. Il en vient de partout, et tous techniquement très au point, souvent talentueux, si bien que le marché est de plus en plus encombré. Cette espèce d’anomalie d’attribution (erreur de casting si vous voulez) s’est répandue, jusqu’à faire paraître étranges les ensembles vocaux qui n’en comprennent pas un ou deux.
Je dis bien « anomalie », parce qu’il ne faut pas oublier comment les « Saints-Pères » successifs ont fabriqué les haute-contre à Rome : prenez les jeunes garçons qui ont la plus jolie voix, castrez-les avant la mue de la puberté et faites-les chanter à la Chapelle Sixtine. C'est là (et sans doute pas que là) que les prélats, évêques et cardinaux prenaient leur pied.
Alors c’est vrai, aujourd’hui, les hommes qui choisissent une telle voie pour leur voix ne subissent plus pareille mutilation, et c’est à force d’entraînement, de travail et de technique qu’ils obtiennent un résultat satisfaisant. La tessiture ne change plus rien à l'anatomie. Mais je ne peux pas m’empêcher de me dire qu’il y a là quelque chose qui ressemble à ce qu’on appelle « automutilation », vous savez, ces pratiques des prisonniers qui avalent des fourchettes ou des bidasses de 14-18 qui se coupaient quelques doigts pour ne pas monter au front.
N’est-ce pas en effet s’automutiler que de renoncer à un attribut du masculin quand on est doté physiquement de ce sexe ? A ce propos, qu’on ne compte pas sur moi pour adhérer à la fable du « genre », puisqu’on sait immémorialement que, si la nature dote l’homme de caractères sexuels précis – les exceptions (« intersexuées » comme on dit quand on est LGBT) sont rarissimes – l’homme en fait ensuite plus ou moins ce qu’il veut. Il exerce la liberté que lui permet la culture dans laquelle il a grandi, à moins que ce soit celle qu’il a décidé de prendre, comme toute l’histoire de l’humanité en est littéralement farcie : l'histoire des fantaisies humaines en matière sexuelle est définitivement inépuisable. Alors franchement, la petite écume de vaguelette de risée du « genre », non merci.
Je suis frappé de l’aisance avec laquelle le coin du registre de la voix féminine des hommes est entré dans le beurre mou des cercles mélomaniaques de nos sociétés. Je me dis qu’à ce stade, ça tient du fait de civilisation. Freud nous avait bien fait la leçon sur la part féminine qui sommeille en tout homme (et la part masculine chez toute femme).
Je constate cependant que ce qui n’était là que comme la part dormant dans l’inconscient des individus, sous la surveillance du rôle social assigné à chacun par « l’ordre patriarcal » (désormais obsolète, que les cercles militants se rassurent), a eu l’occasion de se réveiller, sous la poussée féministe. « Macho » est désormais une insulte, on stigmatise la « virilité » et la dévirilisation des mecs a atteint, dans des portions non négligeables d'une population plutôt jeune, une sorte de rythme de croisière (je parle de ce dont je suis témoin) qui donne lieu de croire à l’amorce d’une vraie dynamique dans ce sens. Je le constate dans les rues, au nombre de poches marsupiales, attribut normal de la kangouroute, dont s’affublent les jeunes pères qui ont, comme on disait autrefois, « charge d’âme ».
Quand les féministes (M.L.F., bien connu) et les homosexuels (F.H.A.R., pour Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire ! Si ! C'est comme je dis !) partaient à l'assaut de vastes territoires.
Revue Actuel, n°25, novembre 1972.
La débandade du phallus ? C’est devenu une enseigne, presque l’image de marque des types qui veulent « vivre avec leur temps ». Le mâle qui tient à sa réputation de « moderne » est du genre arrondi aux angles, il a perdu de sa rugosité, il est devenu « tendre et aimant », « gentil » et « doux ». Il ne répugne même pas à se mettre en ménage avec un homologue. Mais je dis que ce n’est pas parce qu’on n’est pas un « gentil garçon » qu’on est méchant pour autant. On peut même être un "normal". Il y avait déjà un rien de commisération quand on disait jadis de quelqu’un que c’était un « brave homme ».
Après tout, c’est l’époque qui veut ça. Il suffit aujourd’hui, bien souvent, d’appuyer sur des boutons pour voir se réaliser les tâches : les travaux de force se sont faits rares. On peut se dire que les féministes ne sont sans doute redevables de plusieurs de leurs conquêtes qu’à la popularisation d’une foule d’outils dont le maniement a été rendu toujours plus facile par les progrès de la technique. Plus besoin de muscles ! La technique a rendu le mâle superfétatoire. La technique a rendu bien des services à la cause féministe.
Aujourd'hui, tout le monde, tous sexes confondus, est en mesure de « caresser son téléphone » pour aboutir là où il voulait. L’égalité homme-femme ne commence-t-elle pas là ? On a entendu les féministes tonitruer pour des publicités jugées « dégradantes » pour l'image de la femme, pour la représentation insuffisante de leur sexe dans le personnel politique, pour l'absence de femmes dans la pré-liste des "nominés" au Festival 2015 de la BD d'Angoulême. On attend encore leur glapissements pour réclamer la parité face au marteau-piqueur ou aux travaux de terrassement quand par hasard ils sont manuels.
Pour revenir à la musique, il y a fort à parier que l’énorme vague de contreténors qui a déferlé sur le monde musical, baroque en particulier, entre en résonance avec cette tendance de fond qui exige de l'homme occidental qu'il se dévirilise, en gros depuis les années 1970. C’est pourquoi on a peut-être quelque raison d’observer (en le déplorant), au sujet de l’homme d’aujourd’hui, que "le doute l’habite".
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chant choral, ensemble vocal, haute-contre, contreténor, falsettiste, sopraniste, france musique, ensemble huelgas, paul van nevel, livre de chœur d'eton, chant a cappella, mathias grünewald, saint jean-baptiste, illum oportet crescere me autem minui, crucifixion, choeurs de l'orchestre national de lyon, bernard tétu, carlo gesualdo, madrigaux gesualdo, quintetto vocale italiano, angelo ephrikian, dominique visse, ensemble clément janequin, philippe jarrousky, castrat chapelle sixtine, automutilation, théorie du genre, lgbt, féminisme, mlf, fhar, front homosexuel d'action révolutionnaire, revue actuel, débandade du phallus, festival bd angoulême
lundi, 16 janvier 2017
L’ARÊTE ET LE GOSIER 1
UNE GROSSE ARÊTE EN TRAVERS DU GOSIER :
JEAN-CLAUDE MICHEA
1/2
Décidément, il y a quelque chose qui ne passe pas avec Jean-Claude Michéa, qui vient de publier Notre ennemi, le capitalisme (Climats, 2017). (Toutes mes excuses pour l'erreur sur le titre exact, qui est Notre Ennemi, le Capital.) Ce trublion reste en travers de la gorge d'un tas de gens en place. Et curieusement, il dérange autant à droite qu’à gauche. Normalement, on sait très bien ce que c'est, la droite et la gauche. La différence est bien carrée : d'un côté les rouges, la révolution, le prolétariat ; de l'autre les blancs, le patronat, le capital. Là, on ne sait plus très bien.
Dans quelle case et sous quelle étiquette faut-il ranger Michéa ? Le Monde et Le Figaro hésitent, pataugent. Les points de repère reçus en héritage sont brouillés. Le premier en fait un "conservateur" bon teint. Le Figaro n’affiche pas directement sa perplexité, puisqu’on peut lire dans son numéro du 13 janvier l’interview croisée du philosophe et de son ancienne élève, Laetitia Strauch-Bonart, devenue elle-même philosophe, qui a pris à présent ses distances avec lui, et proclame son adhésion au capitalisme. La sacro-sainte neutralité du journaliste (Eugénie Bastié) peut sortir la tête haute de l'épreuve.
Le Monde y va plus carrément dans l'antipathie (ce n'est pas la première fois), qui lui consacre quatre pleines pages dans son numéro du 11 janvier : deux à la réception de l’œuvre dans la génération de ceux qui « ont moins de trente ans (…) et se réclament de penseurs comme Jean-Claude Michéa dans leur combat contre l’idéologie du progrès » ; deux autres à la recension du dernier ouvrage que l’auteur vient de publier, augmentée de trois commentaires, dont un de la déjà nommée Laetitia Strauch-Bonart et un autre du journaliste de la maison, Nicolas Truong (c'est lui qui s'y colle chaque fois qu'il est question de Michéa dans la rédaction).
Ce qui reste en travers du gosier de cette escadrille de braves journaleux, c’est que la thèse de Michéa sort de leurs sentiers intellectuels battus, rebattus, remâchés et rabâchés. Sur ces sentiers devenus des autoroutes, on présente comme une évidence, à droite, le mariage de la dérégulation généralisée en matière économique et d’un grand rigorisme en matière de mœurs, mariage bizarre et somme toute paradoxal, quoique très puissamment installé dans le paysage, incarné dans les positions affirmées dernièrement par François Fillon (ultralibéral et chrétien).
A gauche, c’est l’inverse : on donne libre cours à la liberté des individus en matière de mœurs, et l’on est prêt à leur ouvrir sans cesse de nouveaux « droits », fût-ce à l’infini, mais on souhaiterait (un peu) tenir les rênes courtes aux forces du marché, jugées aveugles et produisant injustices et inégalités criantes. Comme l'écrit la journaliste Fabienne Darge dans Le Monde daté 15-16 janvier, à propos d'un spectacle : « C'est toute une histoire qui prend corps ici, celle de ce moment particulier, le milieu des années 1970, où les soixante-huitards les plus lucides - et Foucault est des leurs - se rendent compte que la partie est déjà perdue, que la révolution est en train d'échouer sur le plan de la lutte des classes, mais qu'il reste une carte à jouer sur le terrain de la libération des mœurs ». Lucidité, vraiment ? Ou résignation ? En clair : puisque davantage de justice sociale est impossible, éclatons-nous et profitons de la vie pour explorer des voies de jouissance renouvelées. Une telle phrase résume en effet à merveille la capitulation finale de la gauche morale devant les forces du marché : ce n'est même plus "les rênes courtes", c'est carrément la désertion du champ de bataille, et, selon Fabienne Darge, le "grand philosophe" Michel Foucault est le prophète de cette désertion (et de cette "conversion").
A droite donc, l’accumulation indéfinie de richesses, mais une société plutôt « tenue » ("tradi", comme on dit) en matière de mœurs ; à gauche, une économie fermement tenue en laisse (très élastique, la laisse), mais des libertés et « droits » individuels proliférants. Si c'était une figure de rhétorique, on dirait un "chiasme", à cause du croisement.
La particularité de Jean-Claude Michéa, c'est d'analyser ces deux tableaux comme une double contradiction : on ne peut être à la fois « laxiste » et « rigoriste », même si les termes de l’équation s'inversent en passant de gauche à droite et réciproquement. Il y a incompatibilité entre les deux moitiés des personnes qui soutiennent la chose. La contradiction, pour lui, saute aux yeux.
Pour moi, qui ne suis pas philosophe (et que, pour être franc, la philosophie et l’armature argumentative qui va avec fatiguent assez vite : j'ai toujours été rétif aux cours de "philosophie-langue-étrangère"), c'est Jean-Claude Michéa qui a raison : non, on ne peut pas être dans le même temps laxiste et rigoriste. Si je veux reformuler en termes simples sa thèse fondatrice, je dirai qu'il tente de répondre à une question anthropologique de base : l’homme est-il dieu ou existe-t-il des limites à ses activités ? Tout est-il, au nom de la liberté, permis dans les pratiques des individus, des entreprises, des Etats ? C'est vrai que, posée comme ça, la question semble tout de suite plus limpide. En d'autres termes, l'homme est-il IndiviDieu ? A la base de l'interrogation de Michéa, il y a probablement, dans la lignée de George Orwell, la question morale.
Je prends un exemple hors-sujet : faut-il suivre Yann Robin, jeune compositeur dont le gros machin sonore à base de violoncelle torturé, un « concerto » paraît-il, a été diffusé sur France Musique le 14 janvier, quand, digne successeur du Luciano Berio des Sequenze, il déclare à une certaine Odile Sambe de Ricaud qu’il faut pousser les instruments dans leurs derniers retranchements, leur faire cracher leurs poumons (là, c'est moi qui parle, remarquez que je n’ai pas dit « glavioter leurs éponges », on sait se tenir), et qu’il ne revendique hautement de limites que celles de son imagination et celles, techniques, des interprètes de sa musique ? (Oui, j'ai écouté ça. Ci-dessous Sequenza III par Cathy Berberian, pour donner une idée des "derniers retranchements".)
Les fervents diront qu’ « on n’arrête pas le progrès », et que l’histoire de la musique occidentale, des premières polyphonies et de l’Ars nova de Guillaume de Machaut jusqu’à Beethoven, Schönberg et Messiaen, n’est à elle seule qu’une longue illustration de ce qu’est, en soi, le « Progrès ». Je dirai que si les critères de composition n’ont pas cessé de changer, ce n’est aucunement la preuve d’un « Progrès » en musique, comme le soutenait mordicus l'incarnation du soviet musical suprême Pierre Boulez, mais tout au plus d’une évolution et de changements divers que le temps a accumulés.
Si l’on ne peut que constater que les compositeurs n’ont cessé d’innover au cours du temps, cela n’autorise personne à faire de l’innovation – vaste suite de faits observables, mais neutres, quoi qu'on puisse en dire – l'objectif final de la création. Ce serait transformer (magie !) un fait en but, probablement dans l'intention de conférer je ne sais quel "sens" à l'Histoire (un pas que Boulez n'hésite pas à franchir). L'histoire de la musique se raconte "a posteriori" : faire de l'innovation une condition "a priori" met donc la charrue devant les bœufs. La manipulation tient du canular ou du tour de passe-passe. Et Boulez, malgré son épouvantable façon de se prendre au sérieux, est un blagueur.
Voilà : l’homme est-il dieu ? Doit-il poser des limites à son ambition ? C’est donc à ces questions que Jean-Claude Michéa s’efforce de répondre depuis ses premiers travaux sur George Orwell, qu’un de ses ouvrages désignait comme un « anarchiste tory », formule étrange aux yeux d'un membre patenté de l’intelligentsia « degôche » : comment peut-on être à la fois anarchiste (supposé plutôt à gauche) et conservateur (supposé de droite) ? C’est ce que ne comprend pas Nicolas Truong dans son commentaire de Notre ennemi, le capital, dans Le Monde du 11 janvier.
Le journaliste l’avoue d’entrée de jeu : « C’est un professeur de philosophie de lycée [on a compris : pas un « philosophe » au sens plein, selon le journaliste], à présent retraité [merci pour lui] qui séduit autant dans les milieux libertaires qu’au sein des cénacles identitaires, un auteur prisé aussi bien par certains lecteurs du "Diplo" que par la jeune garde du Figaro ». C’est bien ça, la perplexité du Monde : Michéa est-il d’extrême-droite ou d’extrême-gauche ? Est-il un "anarchiste" ou un "tory" ? Réponse : les deux, mon général (ou plutôt : un peu des deux). C’est aussi mon cas, comme j’ai tenté de l’expliquer ici même le 4 mai 2015.
On ne pourra pas contester, j'espère, que j'ai un peu de continuité dans les idées. Mais Jean-Claude Michéa s'est davantage concentré sur le domaine, et depuis bien plus longtemps : il est un peu plus crédible.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, jean-claude michéa, notre ennemi le capitalisme, journal le monde, journal le figaro, laetitia strauch-bonart, éditions climats, nicolas truong, journalistes, politique, société, françois fillon, ultralibéralisme, yann robin, france musique, odile sambe de ricaud, musique, composition musicale, musique ancienne, musique contemporaine, ars nova, guillaume de machaut, beethoven, schönberg, messiaen, pierre boulez, dodécaphonisme, sérialisme, musique sérielle, george orwell, eric blair, george orwell anarchiste tory, fabienne darge, michel foucault, luciano berio, sequenza iii, cathy berberian
dimanche, 03 avril 2016
PHOTOGRAPHIE
*******************
"TU ES PETRUS"
("Tu es pierre")
La même pierre au cou d'un corps en berne :
la forteresse de l'homme n'en finit pas de s'engloutir.
La même pierre a creusé l'amnésie dans les opulences.
La même pierre désemplit les reflets trop obéissants.
La même pierre déloge la foule trop instable des signes
à la surface intense des impératoires.
La même pierre prémédite la première cervicale :
peut-être la colonne du sens verra de nos erreurs ingénieuses
la forme élaborée d'une prison vivable.
********************
Pure coïncidence : ce matin, au programme de "Sacrées musiques", l'émission de Benjamin François, plusieurs œuvres portant le titre "Tu es petrus" : Mendelssohn, Fauré, Duruflé, ... Je n'en tire aucune conclusion. Benjamin François diffuse ensuite l'oratorio Historia der Auferstehung Jesu Christi, chef d'œuvre de Heinrich Schütz, dans diverses interprétations. Celle dont je dispose (35 francs à la Fnac) est dirigée, en 1980, par Louis Devos, à la tête de "Musica polyphonica". Kurt Widmer est l'Evangéliste. Sur la pochette, La Résurrection d'Albrecht Bouts (à ne pas confondre avec Dieric). Cette version me donne toute satisfaction, bien que Benjamin François ne l'ait pas inscrite à son programme. Et malgré le ton condescendant de la notice du "Guide" de Diapason : la Tribune des critiques de disques fait toujours ses ravages : je me rappelle parfaitement le 2° concerto de Rachmaninov, la première fois que je l'ai entendu. C'était par un certain Léonard Pennario. Qui connaît ce grand pianiste ?
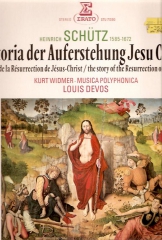
jeudi, 09 avril 2015
LES AMOUREUX DU "BIEN PUBLIC"
Le bien public coûte trop cher. Le bien commun est devenu hors de prix. L’Etat n’a plus les moyens. Ce qui « faisait société » se délite de plus en plus vite. Tout ce qui fait l’existence humaine doit rapporter. Cracher du cash. A qui ? A ceux qui réclament du 12 % de rendement annuel. Faut-il les appeler des investisseurs ? Des spéculateurs ? Des requins ? Des vautours ? La réponse à toutes ces questions : privatisons.
Je ne donnerais pas cher de la peau de Radio France. Si le petit copain et grand protégé de l'onctueux Frédéric Mitterrand, a été mis à sa tête, c’est précisément pour faire ce qui a déclenché la grève. Une grève qui a ouvert en grand les robinets musicaux sur les chaînes de la radio (publique pour combien de temps encore ?).
La première idée de Mathieu Gallet, quand il est arrivé, était paraît-il de vendre les murs de la « Maison Ronde », pour pouvoir les louer. C’est curieux, au même moment le ministère de la Défense envisageait de vendre des matériels militaires à des investisseurs, qui seraient en quelque sorte devenus des bailleurs de l’armée française.
L’Etat vend à tour de bras des bâtiments prestigieux pour qu’ils soient transformés en hôtels de grand luxe ou en logements somptueux. Gérard Collomb, merdelyon, a vendu l’Hôtel-Dieu avec sa façade et son dôme de Soufflot.
D’une main, les « autorités » en charge du bien public, du « vivre ensemble » et autres vieilles lunes passées de mode, font argent de tout, bradent, bazardent, soldent, liquident, alors qu’ils posent l’autre sur leur cœur chaque fois qu’il faut lancer des incantations appelant à « refaire société », à « se rassembler ».
Il se passe avec Radio France ce qui se passe ailleurs depuis quelques dizaines d’années : la Grande Privatisation de Tout. Les Etats défèquent du Bien Commun comme s’ils avaient la colique. L’Etat français mettra combien de temps à tirer la chasse d'eau sur France Inter, France Culture et France Musique ?
J'ai l'impression d'entendre l'ultra-libérale Fleur Pellerin, vous savez, cette fan de l'accord de libre-échange transatlantique TAFTA, murmurer : « Le plus tôt sera le mieux ».
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges brassens, les amoureux des bancs publics, radio france, grès radio france, france inter, france culture, france musique, mathieu gallet, frédéric mitterrand, maison ronde, lyon, gérard collomb, hôtel-dieu lyon, fleur pellerin, accord de libre-échange transatlantique, tafta, ttip
mercredi, 04 mars 2015
MORT DE LA MÉLODIE
5
Car disons-le : c’est la musique qui est faite pour l’oreille, et pas l’inverse. L'oreille, elle est faite pour saisir les bruits du monde, les voix des hommes, le chant du merle au printemps juste avant le lever du jour. Quand quelqu'un juge assez satisfaisante pour autrui la suite de sons qu'il vient d'inventer, alors oui, il les fait entendre à bon droit à ses semblables. C'est en vue de leur procurer un plaisir.
De quel droit les compositeurs de musiques d'avant-garde maltraitent-ils l'oreille des gens ordinaires ? Car la mélodie, selon moi, a une affinité particulière avec l’oreille. Et il ne me semble pas être, parmi les amateurs de musique, un cas exceptionnel. Et s’il faut lâcher des gros mots, en voici un : cette affinité de la mélodie avec l’oreille est naturelle. Je veux dire : fondée sur des lois de la nature (consonance, intervalles, harmonie, ...).
Je sais, cette affirmation ne va pas précisément dans la même direction que l’air du temps, vous savez, cet air qui vous serine la rengaine : « Tout ce qui est humain est culturel. Rien de ce qui est humain n’est naturel ». Ben si ! Désolé ! Peut-être que c'est ça, après tout, qu'ils ont derrière la tête, les "transhumanistes" de la Silicon Valley, qui sont en train de préparer l'avènement de "l'homme augmenté" ?
Jusqu'à plus ample informé, je reçois tout ce qui me vient de l'univers sonore de mes organes de perception sensorielle. A chacun d'en perfectionner l'usage s'il le peut. J'aime que la musique, aussi poussée que soit sa complexité technique, ne devienne pas un pur concept : on observe à suffisance les dégâts du purement conceptuel dans les arts plastiques. J'aime que la musique n'oublie jamais qu'à l'origine, elle ne sort pas d'un pur esprit, mais du plaisir physique d'une expérience sensorielle.
Non, tout n'est pas, dans l'homme, façonné par la culture : il y a dans l'homme un noyau de nature irréfragable. J’en veux percevoir un indice probant dans le fait que, si les révolutions dans le langage musical opérées par le 20ème siècle étaient exclusivement des faits de culture, l’oreille de monsieur tout le monde s’y serait habituée au fil du temps, tout comme elle s’est habituée aux "dissonances" du quatuor du même nom de Mozart, aux plus abstruses des Variations Diabelli, aux longueurs de Lohengrin et Parsifal, etc.
Or on est obligé de constater qu’un siècle après les innovations radicales de Schönberg, Berg et Webern, l’oreille de monsieur tout le monde est à peine moins rétive à supporter le résultat de leurs cogitations révolutionnaires. J'ai l'impression qu'il reste assez de nature dans l'humanité pour penser que celle-ci « résiste encore et toujours à l'envahisseur ».
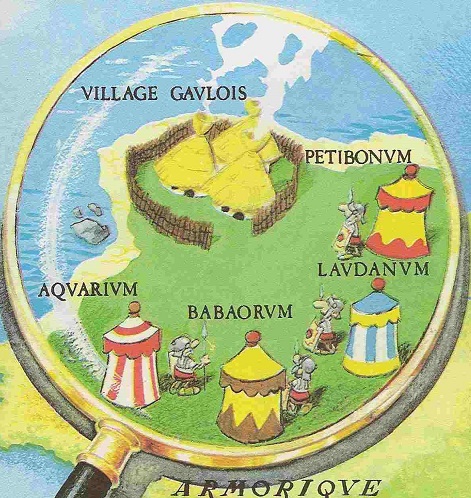
Si les musiques d’avant-garde du 20ème siècle étaient de même nature que celles, dans le passé, qui se sont fondues dans l’ensemble des styles précédents pour constituer ce qu’on désigne communément sous l’appellation extensive « Musique Classique », Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, chanterait avec sa joie et son exubérance coutumières les aberrations dodécaphoniques de Schönberg et les autres ou, pire, de l’école de Darmstadt (Boulez, Stockhausen et toute la bande).
Darmstadt, vous savez, ce sont ces commissaires du peuple et autres staliniens qui n’avaient rien de plus pressé que d’ « organiser la totalité de l’espace sonore en dehors de toute subjectivité » (autrement dit d’éliminer de la musique jusqu’au souvenir de l’humain). Quelle terrible chose, quand on y réfléchit ! Une musique scientifique, quoi ! "Surtout ne me parlez pas de plaisir", nous dit toute la chimie sonore sortie du laboratoire de Pierre Boulez ! Pierre Boulez traîne le boulet de sa haine de la subjectivité - hormis de la sienne, c'est entendu.
Dans un monde de plus en plus déshumanisé, pas d'autre solution qu'une musique déshumanisée ! Les sciences cognitivo-comportementales dissèquent bien le cerveau pour y traquer les sièges des sentiments, des émotions ! Pourquoi le physico-chimisto-mathématicien Pierre Boulez ne pourrait-il prétendre plonger l'auditeur moderne dans les éprouvettes de la paillasse où il officie ? Eh bien non.
Que Renato, le ténor napolitain, se refuse encore « avec entêtement » (tonton Georges, « Le Cocu », mais c'est à propos du « port de la feuille de vigne ») à mémoriser et vocaliser l'aberration dodécaphonique, que l’oreille d’une telle masse de gens ordinaires, résolument non-scientifiques, freine des quatre fers et s’interdise obstinément de calquer le rythme de ses pas sur celui des grands innovateurs de la musique moderne, cela devrait au moins poser question aux plus lucides et aux moins doctrinaires d’entre eux. Je ne suis pas sûr que la question soit parvenue à leur conscience.
Et ce n'est pas faute d' « éducation », si une majorité de la population reste aujourd'hui imperméable aux théories modernes de la musique : qu'est-ce que les responsables de France Musique, de festivals "Présence" (Paris), de salles de concerts lui en ont fait bouffer, de la contemporaine, à la population ! En tranches, en pâtés, en sauce, en ragoût, à la broche ! La tactique est bien connue : pour que l'oreille du vulgum pecus s'habitue, il suffit de glisser une tranche de John Cage entre deux symphonies de Mozart ! Eh bien non, le gavage forcé, l'endoctrinement, le bourrage de crâne, ça ne suffit pas : on ne change pas comme ça les lois de la nature (tonalité, consonance, intervalles, harmonie ...).
Et ce n'est pas davantage en essayant d'instiller un sentiment de culpabilité dans cette population arrogamment qualifiée de retardataire qu'on y arrivera : quand un humain ordinaire, normalement constitué, écoute son sentiment profond à l'écoute des élucubrations de John Cage ou de Pierre Boulez, il se dit que non, là, impossible de s'y retrouver.
Peut-être s'est-il passé dans la musique la même chose qu'en politique ? Vous savez bien, tous ces poissons rouges, dans leur bocal. Le public qui déserte les salles de concerts où l'on joue Luciano Berio, Takemitsu Toru, John Cage, André Boucourechliev, Pascal Dusapin, Elliott Carter, Georges Aperghis, Gilbert Amy, Jean Barraqué, Claude Ballif, Henri Dutilleux, Witold Lutoslawski, Philippe Manoury, Klaus Huber, György Kurtag, (je fais courte la liste des nuisances) ..., ce public n'a-t-il pas quelque ressemblance avec le public qui, les jours d'élections, vote avec les pieds en allant à la pêche, refusant de s'entendre chanter plus longtemps les vieilles rengaines, par des hommes politiques aux discours usés jusqu'à la corde ? N'y a-t-il pas là un autre exemple (inattendu) de fracture séparant le peuple des élites qui le gouvernent ?
Peut-être aussi ces compositeurs et la légion de leurs affidés sont-ils trop savants. Je leur dis simplement : rendez-nous la mélodie. Faites simple, soyez sympas : pensez à l'auditeur futur. Nous ne demandons pas grand-chose, finalement. Ne laissez pas une science musicale purement théorique, abstraite, voire déshumanisée, aussi avancée soit-elle, régner en despote totalitaire sur votre musique : réhumanisez vos sources d'inspiration. Destinez vos compositions à des auditeurs concrets, aux gens qui existent, qui ont des sens affûtés, qui ont envie d'éprouver du plaisir quand ils vont au concert. Rendez-nous le plaisir simple de la perception sensorielle des sons musicaux.
Donnez-nous envie de chanter votre musique. Est-ce demander l'impossible ?
Voilà ce que je dis, moi.
Fin (pour le moment)
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, musique contemporaine, avant-garde, transhumanisme, silicon valley, mozart quatuor dissonances, beethoven variations diabelli, wagner, parsifal, lohengrin, schönberg, alban berg, anton webern, astérix, musique classique, école de vienne, école darmstadt, boulez, stockhausen, dodécaphonisme, musique sérielle, georges brassens le cocu, france musique, festival présence, paris, john cage
samedi, 28 février 2015
MORT DE LA MÉLODIE
1/3
Je suis, depuis « ma plus tendre enfance », un gros consommateur de musique. La voracité de mon appétit en la matière, en même temps qu'elle saturait jusqu'à l'exaspération l'espace sonore des gens qui m'entouraient, m’a fait parfois effleurer, parfois côtoyer l’univers des musiciens, parfois même y poser un pied (j’ai chanté pendant plusieurs années dans un ensemble de solide réputation). Certains disent que j’ai écouté la radio ou collectionné les disques de façon déraisonnable. J’avoue : je suis, depuis toujours, fou de musique. Littéralement.
J’ai aussi beaucoup fréquenté les lieux où la musique se faisait, et j’ai pratiqué quelques instruments (bugle [j'essayais de copier le sublime solo de Bubber Miley au cornet, dans je ne sais plus quel Duke Ellington précoce, au grand dam du médecin qui avait sa consultation juste au-dessus de ma chambre], guitare, piano, clarinette, … ), jusqu’à ce que je prenne conscience, dans un éclair de lucidité résignée, que, dans la pratique instrumentale, je manifestais une envie et un goût notablement supérieurs au talent effectif que je déploierais jamais dans leur maniement.
J’ai donc été forcé de me réfugier, dans un mouvement de retraite déçue et tardive (on ne renonce pas aisément), derrière le rempart d’une névrose aussi mélomaniaque qu’obsessionnelle. Pour dire, c’en est au point que si, en pleine discussion passionnée sur la marche de la planète avec quelques convives, parviennent à mon oreille des échos de l’adagio de la sonate opus 106 ou de l’aria de basse « Mein teurer Heiland » dans la Saint-Jean, mon esprit déserte aussitôt la table, pour s’isoler en compagnie de Ludwig Van ou de Jean-Sébastien.
Obsessionnel, c’est bien ce que je me dis, mais que voulez-vous y faire ? C’est sûrement un symptôme, n’est-ce pas ? Je me pose parfois la question de savoir, si l’on me demandait quel est le fil conducteur qui sous-tend mon existence, si ce ne serait pas l’ensemble des sons musicaux qui se sont introduits depuis les origines, en passant par l’oreille, jusqu’aux couches les plus profondes. Inatteignables, même par fracturation hydraulique.
Tout ça pour dire que, sans la musique, je serais comme un poisson hors de l’eau. Et que, après d’invraisemblables vagabondages, motivés par une curiosité que j’ai renoncé à comprendre, dans les musiques les plus diverses, les plus exotiques, les plus modernes, les plus hétéroclites et même les plus improbables, j’ai fini par déblayer le terrain de mes choix racinaires. J’ai fini par choisir. Or choisir, c’est éliminer.
Du magma sonore où mes oreilles ont depuis toujours traîné leurs guêtres, j’ai donc retiré un petit nombre de formes restées à même de combler mes besoins d’émotion musicale. Et cette décantation opérée par le temps qui passe en a éloigné d’autres désormais inaptes à satisfaire mon attente. Tout m'est resté dans l'oreille, mais filtré. Parmi les filtres qui motivent ce jugement, celui qui vient en premier, loin devant les autres, s’appelle la mélodie. Or c’est là que « ça fait problème » aujourd’hui. Oui, la mélodie.
Si l’on excepte la chanson et la pop music (en gros, les « variétés »), j’ai parfois l’impression que la notion même de mélodie a disparu des musiques que toute l’époque actuelle produit. Ecoutez « Les lundis de la contemporaine », d’Arnaud Merlin, le lundi soir ou les « Alla breve » d’Anne Montaron cinq minutes tous les jours, bref, ce qu’on appelle couramment la « musique contemporaine » (Dieu sait que j'en ai bouffé !).
Ecoutez une bonne partie de la musique que font les musiciens de jazz aujourd’hui. Ecoutez toutes les musiques qu’on a regroupées sous l’étiquette « Electro » ou « Techno ». Ecoutez du « Rap » ou du « Slam » : à peine si on peut y dénicher, de loin en loin, quelques souvenirs de traces d’une mélodie quelconque. Pour trouver une ligne de notes qui montent et qui descendent, qui soit assez structurée pour procurer une forme musicale à l’oreille. Car toute vraie mélodie est structurée : tout Berlioz en est une preuve éclatante (« Premiers transports que nul n'oublie ! Premiers aveux, premiers serments de deux amants, Sous les étoiles d'Italie ... », l'air de contralto est un modèle).
Conséquence de cette disparition : on ne peut plus chanter la musique qui se crée jour après jour. Or j’estime que pouvoir chanter ce que j’ai entendu est une façon de prolonger l’émotion ressentie à l’écoute. Comme si les compositeurs et improvisateurs actuels (depuis les « révolutions » du tout début du 20ème siècle) voulaient priver leurs auditeurs de ce plaisir. Les empêcher de jouir intérieurement du fruit de leur travail et de leur inspiration. Comme s’ils considéraient comme une démagogie méprisable d’imaginer une musique faite tout simplement pour plaire aux gens ordinaires. Comme s’ils n’aimaient pas les gens à qui ils destinent leurs créations.
Ils ont cessé de s’appuyer sur des suites de notes chantables par tout le monde. A part dans la chanson et la variété (et encore, pas toujours). Ceux qui se risquent à en écrire malgré tout (Karol Beffa, Olivier Greif, Philippe Boesmans, …), tout en utilisant les moyens modernes du langage musical, font presque figure d’exceptions, de survivants vaguement moisis ou momifiés d’une ère dinosaurienne (quoique de multiples dignitaires se soient inclinés devant le cadavre d'Olivier Greif).
Les plus « modernes » et autres « avant-gardistes », considérés comme le fin du fin de la musique, surtout dans la « musique contemporaine », étant ceux qui ne hiérarchisent plus les sons en « musicaux » et « non-musicaux », dans des œuvres où les sons produits par les instruments hérités de l’histoire ne sont plus qu’un cas particulier parmi l’ensemble des sons utilisables, où sont inclus toutes sortes de bruits, même les plus triviaux (le compositeur (!) Brice Pauset aime bien le bruit de l'aspirateur).
C’est pourtant la mélodie qui fait l’âme de la musique, je veux dire de la musique humaine, celle qui se partage, le socle puissant de ce qu’on appelait autrefois la « musique populaire ». Charles Trenet le dit bien : « Longtemps après que les poètes ont disparu, Leurs chansons courent encore dans les rues ». Et ça dépassait le petit univers de la chanson : c’était vrai pour l’opéra, la symphonie, le concerto, etc.
Ce qu’on appelait le « thème », ce qui faisait en quelque sorte sa carte d’identité, ce qui permettait de le fredonner à quelqu’un pour le lui faire reconnaître, c’était ça : la mélodie. Eh bien c’est fini : un cataclysme consensuel et silencieux s’est produit au 20ème siècle qui a englouti la mélodie.
De l'invention majeure de la musique occidentale, en plus d'être une musique écrite, je veux parler de la gamme par tons, je veux parler de la tonalité, un système établi, dit-on, par Guido d'Arezzo (« Ut queant laxis Resonare fibris Mira gestorum Famuli tuorum ...» = do, ré, mi fa ...), le système qui a produit toute la musique tonale, toute la polyphonie et toute la musique symphonique, bref, tout le patrimoine de la musique européenne, le 20ème siècle a voulu faire table rase.
Pour être moderne, il faudrait dire « a remis les compteurs à zéro ». Il se trouve que l'humanité, depuis ses origines, n'a jamais « remis les compteurs à zéro ». On ne recommence jamais la même chose.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, mélodie, bubber miley, duke ellington, jazz, passion selon saint jean, jean-sébastien bach, sonate hammerklavier, ludwig van beethoven, france musique, musique contemporaine, les lundis de la contemporaine, alla breve anne montaron, arnaud merlin, karol beffa, olivier greif, philippe boesmans, charles trenet, l'âme des poètes, longtemps longtemps longtemps, guido d'arezzo
lundi, 10 novembre 2014
LES MATINS DE FRANCE CULTURE
5
J’ai donc tiré un trait sur la matinée de France Musique. A regret. Je n’en suis pas encore là avec la Matinale de France Culture. Heureusement. Après avoir cassé tant de sucre sur leur dos, je peux bien dire que Marc Voinchet et Brice Couturier ne sont pas encore tout à fait aussi insupportables que les deux équipes de musiqueux dont j'ai parlé. Qu'il leur arrive même de faire des parcours sans faute. Et même d'être brillants. Ce n'est pas tous les jours, mais après tout c'est normal.
Que les chroniqueurs sont tous plus ou moins intéressants et pertinents. Comme de juste, ça dépend. A la notable exception irrémédiable de l’infernal curé moralisateur, prêcheur et brasseur des grands mots de l’air du temps qui donne des leçons à tout le monde du haut de son « gros doigt grondeur » pointé vers les coupables. (J'emprunte le "gros doigt grondeur" au Sarajevo Tango du dessinateur Hermann.)
Je parle du moderne nettoyeur d’écuries, du terrifiant khmer rouge, de ce Saint-Just (Savonarole ? Jochanaan ? On a l'embarras du choix) quoiqu'au petit pied, qui a nom EDWY PLENEL, qui tient en réserve force de piques pour, le jour venu, pouvoir y planter autant de têtes que voudra ce moderne Fouquier-Tinville.
Ce n’est pas tant le fait qu'il milite pour une République Irréprochable et qu'il dénonce la corruption des élites politiques. C'est très bien, c'est même louable, mais il le fait sur un ton, mais un ton, … pour tout dire, un ton qui rend indéfendable la cause qu'il défend. Ma parole, il se prend pour Bossuet montant en chaire pour apostropher le Roi et les puissants ! Mais n'est pas qui veut l'Aigle de Meaux, monsieur Plenel. Ne pas confondre l'ampleur de l'éloquence avec l'enflure de la suffisance. La quête morale ne justifie pas ces égarements de l'ego.
Pour tout dire, il le fait dans un tel langage, avec de telles intonations, de tels accents dans la voix que ça me donne envie de corrompre ou d’être corrompu, enfin, de m'enfoncer dans la corruption avec délectation, rien que pour le contredire. Qu'on m'en donne seulement les moyens, et on verra. J’espère pour lui qu’il est vraiment intègre et que son niveau de vie correspond à ses ressources, sans ça je ne serai pas le dernier à manier le bâton (ou alors le « Ciseau à merdre et le Bâton-à-physique » du Père Ubu, j'irai même peut-être jusqu'au « supplice du petit bout de bois dans les oneilles ») à la prochaine prise de la Bastille.
Mais en dehors de ce sinistre personnage, les autres chroniqueurs, leurs propos, leurs prises de position, « ça dépend, si y a du vent, si y pleut … » (Fernand Raynaud, Le Fût du canon). Et puis c’est beaucoup affaire de préférences personnelles, de ses sympathies, de ses propres choix de vie, et au total cela m’amène à relativiser : si j’écoute encore les Matins de France Culture, ce n’est pas seulement parce que c’est bien pire sur les autres chaînes de radio, c’est aussi parce que je trouve ici – peu ou prou – mon compte.
Les invités aussi sont pour beaucoup dans le résultat final. Je persiste et je maintiens : consacrer certaines émissions à « l’invité politique » est le type de la fausse bonne idée. C’est même une exécrable caricature de bonne idée qui, comme de juste et de bien entendu, ne saurait offrir autre chose que le son de cloche terriblement convenu et attendu émis par la personne, payée pour tenir le rôle qu’elle joue sur la scène « politique » française, comme en ont administré la preuve les derniers invités, Michel Barnier, Fleur Pellerin et Valérie Rabault. Je fais une petite exception pour Yannick Jadot, mais il n’était pas là seulement pour parler politique.
Non, monsieur Voinchet, vous ne leur ferez jamais avouer qu’ils ont eu tort : ils ont retenu la leçon reçue en son temps par Lionel Jospin. Il faut les comprendre : s’ils « fendent l’armure », s’ils font à votre micro preuve de sincérité ou passent aux aveux, ils savent qu’une meute aboyante et impitoyable se lancera aussitôt à leur poursuite, excitée par des piqueurs trop heureux de sonner un hallali et de les voir mis à mort politiquement. Accessoirement de faire de la place pour le gibier suivant.
Mettre un politicien devant ses contradictions, c’est toujours peine perdue : il vous servira, au choix, selon son talent de cuisinier et sa conviction d’homme intègre (comment en douter ?), de la langue de bois, de la dénégation, de l’argumentaire alambiqué, du raisonnement amphigourique, ou encore des chiffres qui prouvent irréfutablement qu’il a raison et qu'il n'a jamais, au grand jamais, menti.
Le cas des hommes politiques français pris dans leur ensemble étant désespéré, quel besoin France Culture a-t-il d’entretenir auprès de la population l’illusion qu’ils existent et agissent efficacement en procurant une tribune d’expression à ces gens minuscules qui ne maîtrisent rien d’autre (mais à merveille) que le discours bétonné qu’ils dévident et récitent complaisamment ? Ils sont tous amoureux du statu quo.
Pour les autres invités, j’imagine que dénicher des gens très au fait d’une situation, très compétents dans leur domaine et qui sachent à peu près se tenir devant un micro n’est pas une mission des plus facile. Parmi les plus récents, on ne peut nier ces qualités à Yves Coppens, bien qu’il n’ait plus grand-chose de foncièrement nouveau à apporter depuis son formidable Pré-ambules : les premiers pas de l’homme. Mais il a atteint un âge vénérable et mérite le respect. Et toujours le ramener à la découverte de Lucy (si possible in the sky), franchement, ça fait rengaine.
Je ne vais pas m’amuser à établir un tableau d’honneur, puis un tableau d’horreur, ce serait ajouter un palmarès personnel aux déjà trop nombreux qui paraissent pour satisfaire l’obsession moderne de l’évaluation et du classement (en notant au passage que c’est le moment que choisissent des « spécialistes » pour proposer d’abolir la notation à l’école : l’époque n’est pas à un paradoxe près).
Mais je pense au cas d’Alberto Saviano, dont j’avais lu avec intérêt et inquiétude l’excellent Gomorra. Qu’est-ce qui vous a pris, monsieur Voinchet, de l’interroger sur sa situation personnelle (cible des mafias, gardes du corps, …), alors que le sujet de son livre à lui seul méritait toute la place ? La dérive « people » et « presse à sensation » n’est pas loin.

N’avait-il donc rien à dire de ses trouvailles sur les tenants et aboutissants des trafics de cocaïne ? Voilà qui aurait été intéressant. « Caramba ! Tout est à recommencer ! » (ou « Caramba ! Encore raté ! », au choix). Sur le même sujet, bien que plus général (l’auteur travaille sur l’économie criminelle et ses circuits financiers), je pense à Jean de Maillart, qu’il me semble au reste avoir entendu aux « Matins », il y a longtemps.

Donner priorité à l’anecdote sur le fond, c’est d’ailleurs une tendance de l’animateur, qui focalise souvent ses questions sur la personne invitée plutôt que sur le sujet (un ouvrage récemment paru, par exemple) qui a motivé sa venue. Une autre tendance regrettable est cette manie qu’il a de ramener le propos à des formules connues, à des références au passé, à des situations, à des catégories, voire à des lieux communs, alors qu’il faudrait amener la personne à creuser ce que sa démarche et son travail apportent de vraiment nouveau. L’impression qui se dégage de cette façon de procéder est celle d’un échange superficiel : au bout du compte, on a effleuré l’essentiel. J’ajoute que ce n’est pas toujours le cas.
Si j'avais un souhait à formuler pour l'avenir, ce serait, monsieur Voinchet, de vous prier d'en finir avec cette impression de sprint permanent, véritable carcan communicationnel. Je ne suis pas sûr que ce soit en votre pouvoir, même si vous êtes d'accord avec moi. Mettons que je ne comprends rien aux nécessités qui commandent aux orientations d'une chaîne de service public, et n'en parlons plus.
Dernière observation (attristée) sur l’évolution de France Culture en général et des Matins en particulier : sauf erreur de ma part, en 2013, la « grille d’été » a été mise en place fin juillet, mais en 2014 dès la fin juin, et pour huit ou neuf semaines au lieu de cinq. Sachant que Marc Voinchet et Brice Couturier sont employés comme « Intermittents du Spectacle », j’en conclus que France Culture fait des économies budgétaire, en laissant l'ardoise à l’UNEDIC.
Encore bravo, le service public !
Voilà ce que je dis, moi.
FIN
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : radio france, france musique, vincent josse, émilie munéra, marc voinchet, brice couturier, hermann, sarajevo tango, edwy plenel, père ubu, ubu roi, fernand raynaud, politique, société, france, michet barnier, fleur pellerin, valérie rabault, yannick jadot, lionel jospin, yves coppens lucy, pré-ambules, alberto saviano, gomorra, intermittents du spectacle
dimanche, 09 novembre 2014
LES MATINS DE FRANCE MUSIQUE
4
Bon, je critique, je critique, mais ça ne m’empêchera pas de continuer à écouter la « Matinale » de France Culture. De toute façon, je souffre d’une allergie si forte à l’intoxication publicitaire et au harcèlement auquel se livre, du trisaïeul à la dernière née en passant par la ribambelle des oncles, tantes et cousins, toute la famille proliférante de l' « Entertainment » qui répand ses ravages dans toute la sphère médiatique en général et dans les chaînes de radio en particulier (même France Inter), qu’en comparaison, France Culture fait figure d’oasis d’intelligence raffinée dans le désert de la vulgarité commerçante et bourreuse de crâne. Je tiens d'autres comparaisons tout aussi flatteuses à la disposition des maîtres de la chaîne.
Je regrette tout au plus de constater que le prurit du saucissonnage des tranches horaires a gagné d’autres chaînes. Du coup, tout le monde est pris des mêmes démangeaisons : « Est-ce que ça vous chatouille ? Ou bien est-ce que ça vous gratouille ? ». Prenez France Musique entre 8 et 12 heures, qu’est-ce qu’on entend ? On a regroupé dans ce créneau (un morceau de roi, que dis-je, un pavé) deux émissions précédentes : l'une, sur une heure et demie ou deux, de 7 à 9, s'occupait de l'actualité des spectacles de musique ; l'autre, en fin d'après-midi, traitait de l'actualité du disque. On en a fait un parallélépipède compact : quatre heures. Sans doute pour écraser le matin entier d'un seul coup. Un pousse-au-crime, je veux dire une invitation à zapper, et même à couper l'antenne. Ou alors à passer l'aspirateur, pour couvrir.
De 8 à 10, un couple très accueillant, très gentil, très gai, très convivial – appelons-les Vincent et Nicolas – se renvoie la baballe, interrogeant Untel ou Unetel, passant du coq à l’âne, puis d’un extrait du Trouvère au dernier rap d’Akhenaton, du chant de la Renaissance au jazz, de Beethoven à Sylvie Vartan. La pop music, la « musique contemporaine » et les « musiques ethniques » ne sont pas oubliées.
J’exagère à peine (cherchez l’intruse, et encore, je ne suis pas sûr). « Il en faut pour tous les goûts, monsieur ». Paraît-il. Je réponds que c'est de la pêche au filet à mailles fines, vous savez, celui qui attrape absolument tout, jusqu'aux alevins, quitte à jeter ensuite par-dessus bord l'auditeur qui ne fait pas la maille ou qui appartient à une espèce immangeable.
Toujours cette obsession d'ouvrir la chaîne, de conquérir de nouveaux publics, d'accroître l'audience. Sur la base de ce raisonnement infernal : « Celui qui renonce à croître et embellir est condamné à dépérir ». Il faut changer, et on nous l'a seriné : le changement, c'est maintenant. Vivons heureux en attendant la mort, répondait Pierre Desproges. Définitif comme un absolu moral.
En fait, il s’agit simplement d’une émission conçue et organisée pour faire la promotion des gens qui font de la musique. Quelle musique ? Toutes les musiques. Quels gens ? Toutes les sortes, je vous jure. Cela fait très bien dans un cahier des charges : pas d'exclusive, on est tolérant, on est très ouverts à tout.
Traduire : surtout ne pas choisir, car choisir c'est éliminer, or éliminer c'est juger, or il est interdit de juger, donc on prend tout, sans discrimination – en profanant, sous le coup d’un arrêt pris par les autorités de la novlangue, sans doute sans le savoir, en prostituant le magnifique vocable de « discrimination » aux origines si nobles, et si exact dans son vrai champ d'application : renoncer à discriminer, c'est, au sens propre, perdre le jugement. Mais l'esprit s'est désormais égaré, il bat la campagne. On appelle ça « l'ouverture à tout prix ». On a même ouvert les asiles de fous, c'est vous dire.
On prend tout. Aussi excellent dans un budget prévisionnel que de citer les nanotechnologies dans un dossier en vue d'un financement, quand on est un laboratoire de pointe en quête de subsides pour la recherche (argument décisif par les temps qui courent). Quoi qu’il en soit, attendez-vous à deux heures entièrement coupées en tranches minces, napolitaines. Le principe de fabrication de la pâte feuilletée, sauf que là, les couches, étant incompatibles, ne se mélangeront pas et continueront à vivre chacune dans son ghetto. La mayonnaise fout le camp en vinaigrette.
Là encore je citerai la chanson Embrasse-les tous de Georges Brassens : « Cœur d'artichaut, tu donnes une feuille à tout le monde ». Un communautarisme sourcilleux a contaminé France Musique, dans la joie et la gaieté. La recette ? La même que celle qu'appliquent les « DJ » : le « sampling », ou échantillonnage. Vous savez, ça consiste à couper, coller, couper, coller, couper, coller, ... Appelons-ça de la création, et passez muscade.
L'invité (l'autre jour le dessinateur Cabu) est même sommé de la boucler pour écouter un intermède musical en direct (le même jour, un guitariste). Cabu est bien gentil de se taire pour écouter une musique dont il n'a strictement rien à cirer. Lui, son truc, c'est Cab Calloway et Charles Trénet. Tiens, demandez-lui de chanter Mam'zelle Clio, la prochaine fois que vous le verrez : « Mam'zelle Clio, Mam'zelle Clio, La première fois, je me rappelle, C'était chez des amis idiots ». Trénet, c'est aussi ma longueur d'onde (entre autres).
Mais j'ajoute que nous aussi, auditeurs, nous sommes bien gentils d'écouter des musiques dont nous n'avons rien à faire. - Vous manquez à l'exigence de tolérance, monsieur. - Eh bien tant pis ! J'appuierai sur le bouton pour éteindre votre radio, et vous n'en saurez rien.
De 10 à 12, changement d'équipe, mais topo identique, sauf que là, c’est moins la promotion des acteurs vivants de la scène musicale que la publicité pour les traces matérielles et sonores qu’ils laissent ou ont laissées dans l’histoire de la reproduction musicale. En clair : on promotionne le disque. On est payé pour ça : on croule sous les envois des maisons de disques, et toutes attendent au moins une petite fenêtre publicitaire pour leurs produits chéris.
C’est vrai qu’il y a du choix, je veux dire que le couple là encore très accueillant, très gai, etc... qui mène l’embarcation – appelons-les Emilie et Rodolphe (que Denisa Kerchova appelait "rudolfino", ce qui n'avait pas l'air de lui plaire) – s’efforce de faire partager les goûts très éclectiques de l’un ajoutés aux goûts très éclectiques de l’autre, le tout additionné de ce que la maison reçoit des labels de production. Moralité : il y en a pour tous les éclectismes : du plus contemporain au plus préhistorique. Plus éclectique, tu meurs !
Le mot d'ordre impérial, impérieux et impératif, c'est : « Gloire au Multicul ! Tout pour le Multicul ». J’exagère à peine : « multi » devant « culture », c'est aussi impressionnant pour les donneurs d'ordre et les accordeurs de budget que « nano » devant « technologie ». Nous sommes enjoints (par qui ?) de favoriser l'avènement de la « Société multiculturelle ».
Or il n'y a pas plus multiculturel que moi. Simplement, ça me dégoûte quand ce qui devrait se contenter de rester un simple fait observable, tout juste un effet découlant d'une longue pratique, devient un Commandement dans de nouvelles Tables de la Loi. Quand ce qui aurait dû rester une modeste, une humble conséquence découlant de certains choix d'existence est statufié pour être élevé sur le piédestal majestueux des Buts, des Fins et des Conditions sine qua non (expression qu'il faut écrire "sinéquanone" pour faire moderne). Quand l'effet se divinise en Principe et en Exigence.
Bref, entre la promotion des personnes (8-10) qui font la « musique vivante » et la promotion des disques (10-12) sûrement mémorables qui viennent de paraître, sachez que désormais, sur France Musique, pas moyen d’échapper à la publicité, à l’interview complaisante, à l’émerveillement dévotieux et à toutes les manifestations possibles d’admiration fervente. Un petit sucre cependant dans l'acidité de cette remarque : Munéra et Bruneau-Boulmier ne se gênent pas pour aligner les disques, chefs d'orchestre ou solistes dont la tête ne leur revient pas. Il faut dire qu'il ne les ont pas en direct, et ça, ça facilité peut-être.
Qu’on se le dise : les Matins de France Musique sont une succursale de Publicis, Havas et Séguéla (l'auteur inénarrable mais révélateur comme un aveu de classe de : « Quand on n'a pas de Rolex à cinquante ans .... ») et compagnie.
On pourrait dire aussi que France Musique le matin, c’est l’équivalent radiophonique de « Télé-Achat ». Il faut vendre. Quels terribles temps nous vivons !
J’ai tiré un trait sur France Musique le matin.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : radio france, france culture, les matins de france culture, marc voinchet, brice couturier, france musique, entertainment, vincent josse, nicolas lafitte, pierre desproges, georges brassens, embrasse-les tous, cabu, charles trénet, émilie munéra, rodolphe bruneau-boulmier, multiculturalisme
dimanche, 22 juin 2014
CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 1/3
Nikolai Grozni, Wunderkind, Plon, « Feux croisés », 2013

Je ne comprends vraiment pas l'expression de Patti Smith, "prose miroitante", posée bien en évidence sur le guéridon de l'entrée du volume.
Je le dis sans ambages : Wunderkind, du Bulgare Nikolai Grozni, n’est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Peut-être même n’est-il que pour quelques-uns (comme La Chartreuse de Parme, dont le point final s'écrit « to the happy few »). Ce que je ne souhaite pas à l’auteur. Car c’est un livre admirable. Mais Grozni n’a pas choisi la facilité, c’est le moins qu’on puisse dire.
Moi, il m’est rentré dans le chou direct et frontal. Je dirais comme Lino Ventura : « C’est du brutal ». Sauf que là, de la première à la dernière page, personne ne rit, ni les personnages, ni le lecteur. C’est un livre qui vous fait prendre un bain de granit : « Le ciel de Sofia est en granit ». C’est la première phrase. Or nager dans le granit, ce n’est pas évident. Un bain dans un passé sinistre pas si lointain : l’action commence à Sofia, Bulgarie, le 3 novembre 1987 et finit deux ans plus tard, au moment de la chute du mur de Berlin.
On passe trois cents pages enfermé dans l’étroite cellule qu’était un pays communiste où, quand on n’a pas à faire à un mouchard, c’est que c’est un bureaucrate ou un « agent en civil ». Parfois un militaire chargé d'enseigner l'éducation physique, armé de son Makarov 9 mm. En tout cas un médiocre qui peut à tout moment vous menacer de son pouvoir. L’effet est poignant. Comme le narrateur, le lecteur se sent à l'étroit, en permanence traqué par les yeux malveillants au service du « Parti ». Et les yeux sont partout, et ils cognent à l’occasion.
Car ce livre met le lecteur à l’épreuve. Comment fait l’auteur pour lui donner l’impression de passer par les épreuves où lui-même est passé ? Mystère. Ce qui est sûr c’est que c’est violent. Et d’autant plus violent qu’il raconte une guerre impitoyable. Cette guerre de destruction voit s’affronter deux ennemis : Frédéric Chopin et le Communisme (avec tout le système soviétique en prime). Et je peux vous dire qui a gagné : c’est Chopin. Mais à quel épouvantable prix !
Je dois dire, pour être honnête, que, comme lecteur, je suis dans une position singulière, qui ne fait pas de moi un élément statistique décisif. Car moi, Chopin, j’avais huit ans. J'étais vacant, donc disponible, il m’est tombé dessus. Pendant des jours et des jours, j’ai passé et repassé sur le Teppaz du 39 Cours de la Liberté la face du 78 tours où je n’ai jamais su quel pianiste (Braïlovski ?) avait gravé l’étude opus 25 n°11.
Combien de fois l’ai-je fait tourner, pour que le chant implacable et volontaire de la main gauche et les cataractes étincelantes de la droite soient définitivement imprimés, fondus ensemble dans les battements d’un cœur gros comme l’univers, au plus profond de mes profondeurs ? Quarante ? Cinquante ? Cent ? En tout cas, Grand-mère n’en pouvait plus et demandait grâce. J’étais impitoyable. J'avais une excuse : Chopin m’avait révélé la vraie vie.
Le plus étonnant : j’ignorais le nom du compositeur, seule la musique, pendant de longues années, est remontée régulièrement de tout au fond vers la surface, inoubliée et pour ainsi dire originaire, comme un événement fondateur, mais aussi comme un point aveugle. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché : quel enchanteur pouvait avoir écrit cette musique prodigieuse ? Je n’ai plus entendu ce morceau par la suite. Il vivait quelque part, comme un point d’interrogation obstiné.
C’est le hasard d’une programmation de France-Musique entendue sur un mauvais transistor, quelque part au fin fond de la Haute-Loire, qui m’a valu, beaucoup plus tard, de pouvoir enfin nommer l’œuvre et attribuer sa paternité au grand Polonais de France. Je le dis sans fioritures : une commotion ! Un ébranlement vertébral ! A l’instant même, je retrouvais le paradis perdu, pas moins. Je n’y peux rien : c’est comme ça que ça s’est passé.
Ensuite, mon carquois s'est garni d'autres flèches. Le Nocturne opus 48 n°1, par exemple, avec cet extraordinaire changement de tonalité qui suit l'exposé du thème, pour annoncer la brutale mutation de l'humeur, avant le retour à une sorte de paix, mais crépusculaire. Ou bien le Scherzo n°3 (op. 39), avec ses contrastes complexes qui déboulent (« presto con fuoco ») dans une sorte de folie furieuse. Mais l'Etude opus 25 n°11 gardera toujours pour moi le même ineffaçable aspect inaugural que « la première fille qu'on a tenue dans ses bras » (comme dit Tonton Georges).
Devenu le profond sillon dans lequel cette œuvre s’est déposée, je m’autorise à voir dans l’auteur de Wunderkind une sorte de frère éloigné dans l’espace et dans le temps, qui m’apporte soudain sur un plateau les mots et les phrases qui collent exactement à l’idée, jamais formulée, que je me faisais de la musique de Frédéric Chopin.
Là où il est très fort, c’est qu’il m’a fait découvrir des choses que je savais déjà.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, nicolai grozni, bulgarie, roman, wunderkind, éditions plon, collection feux croisés, communisme, urss, guerre froide, parti communiste, sofia, musique, frédéric chopin, études opus 10, études opus 25, france musique
jeudi, 12 décembre 2013
UNE MUSIQUE POUR SPECIALISTES

FRAGMENT DE SEQUENZA III
J’en étais resté à conspuer la littérature et la musique « de laboratoire », dont sont férus tant d’adeptes de la « Modernité ».
Je me demande même si ce n’est pas la « Modernité » en soi qui a fini par me rebuter : j’ai déjà dit ici le mal que je pensais des Sequenze (pour écouter Sequenza III, cliquez ici : 8 minutes de rigolade garanties) de Luciano Berio. Même chose pour ce que les artistes, depuis une quarantaine d’années, se complaisent à appeler – précisément – des « performances » (je sais, je sais, ça vient de l’anglais, ça ne veut pas dire la même chose).
A propos de performance, je me souviens d’un spectacle inénarrable, superbement gratiné dans le genre, vu au Centre d’Art Plastique de Saint Fons, alors dirigé par un véritable apôtre en la matière (J.-C. G), homme terriblement sympathique au demeurant.
Imaginez une baignoire solidement fixée au plafond avec un individu dedans, poussant à intervalles irréguliers de petits glapissements, pendant qu’un liquide jaunâtre goutte par la bonde mal fermée, qu’une comparse va lentement déposer de petits tas de sable aux coins d’un quadrilatère, et qu’un autre, en uniforme de varappeur, fait le tour de la salle sans mettre un pied au sol. Les murs avaient été préparés en vue de l’acrobatie. Si quelqu'un peut m'expliquer ...
La « Modernité », en démocratisant à tout va la création, en autorisant ainsi tous les charlatans à vendre en salade leurs potions vendues comme des panacées, qu’il s’agisse de musique, de peinture ou de littérature, la « Modernité » a inauguré l’ère de l’esbroufe, de l’épate et du n’importe quoi.
Impossible pour un public non initié de faire le départ entre les gens « sérieux » (au nombre desquels, malgré les apparences, je compte Luciano Berio) et ces batteurs d’estrade et autres cabotins. Et je ne parle pas du snobisme qui fournit à la « Modernité » des adeptes qui se piquent de figurer dans toutes les avant-gardes, et qui promeuvent par bêtise ou par calcul les derniers gadgets à la mode qui font fureur dans les salons des « branchés ».
Ce qui fait, résultat des courses, que, d’une part, les compositeurs sérieux et savants se sont retirés bien à l’abri des murs de leurs laboratoires, et d'autre part ont oublié, tout simplement, l’auditeur. Ils ont élaboré, dans leurs cornues et leurs athanors de plus en plus compliqués et tarabiscotés, des univers sonores qui n’étaient plus faits pour provoquer émotions et plaisir chez l’auditeur, mais pour répondre à des programmes quasiment scientifiques.
Que leur musique plaise à quelqu’un semble être devenu le cadet des leurs soucis. Pourvu que leurs œuvres ainsi conçues recueillent l’estime et l’admiration du petit cercle de leurs confrères, ainsi que de quelques privilégiés, voilà leur bonheur « samsufi ». Ce qui compte avant tout, c'est d'être reconnus par leurs pairs.
J’imagine que des auditeurs soucieux de paraître « au courant » n’ont rien de plus pressé que de se sentir flattés qu’on leur propose des œuvres d’accès difficile : peut-être s’enorgueillissent-ils de paraître comprendre ce qui se passe. Après tout, depuis Balzac et même avant, on sait que la vanité aime à se nicher parfois de façon surprenante.
Mais je me dis aussi que lorsque les sons entendus offusquent l’oreille qui les reçoit, lorsqu’ils sont ressentis par elle comme une langue inconnue, voire comme une forme d’agression, il y a peut-être une raison objective à cela. Que se passe-t-il donc dans ces œuvres musicales où l’auditeur se sent intimement tenu au collet et menacé par plus imposant que lui ? Qu’est-ce qui les différencie d’œuvres plus « classiques » (certains diront plus « conventionnelles ») au niveau de la réception ? Cette question m’intrigue et me turlupine (de cheval) depuis longtemps.
La réponse n’est pas évidente. Les adeptes de la Modernité pointeront son aspect éminemment « culturel » (c'est comme entre sexe et genre, la plaisanterie bien connue). Je veux dire qu’ils traiteront de préjugés et de stéréotypes les « attachements excessifs » aux musiques (aux « codes ») héritées du passé. Ils accuseront peut-être les industries de diffusion et de reproduction musicale (radio, disque, …) de distribuer dans les oreilles ces codes d’un conformisme épouvantable.
Mais je finis par me demander s’il n’y a pas dans beaucoup de « musiques contemporaines » (disons expérimentales, dissonantes, violentes, …) une attitude d’INTIMIDATION chez des artistes qui ne cherchent plus principalement à plaire à quelqu’un, mais qui se considèrent davantage comme des spécialistes, maîtres d’une technique qui échappe à celui qui écoute.
Des musiques qui se situent plus haut que leurs auditeurs. Devant lesquelles ils sont contraints de se montrer humbles, pour ne pas dire humiliés, l’artiste se présentant comme CELUI QUI SAIT. Celui qui sait domine celui qui ne sait pas. Il y a dans ce fonctionnement une « histoire de pouvoir » (rien à voir avec les fariboles racontées autrefois par le « sorcier » Carlos Castaneda). Juste une histoire de pouvoir. Quasiment politique.
Non que les musiques plus classiques ne fussent parfois diaboliquement savantes (je pense à certaines des Variations Diabelli de Beethoven). Et techniquement, elles étaient largement hors de portée du vulgum pecus. Mais les compositeurs se souciaient de la réception de leurs œuvres. Ils écrivaient leur musique pour quelqu’un. Ils pensaient à quelqu’un quand ils écrivaient leur musique. Ils étaient déçus, voire mortifiés, quand l’accueil du public, lors du concert inaugural, ne consacrait pas une réussite. Témoin Bizet, quand il vit siffler sa Carmen. Il est mort peu de temps après, sans avoir le temps d'assister au triomphe, aujourd'hui planétaire, de son opéra.
Le dodécaphoniste, ce révolutionnaire de laboratoire, se fout éperdument de la façon dont son œuvre sera reçue. Son idée, c’est de composer une œuvre satisfaisante pour son esprit. Il ressemble en cela au mathématicien devant son tableau noir, qui se réjouit d’avoir trouvé une belle formule bien géniale.
Mais à la différence du mathématicien, qui se contente de proposer sa trouvaille aux autres mathématiciens, à travers des revues très spécialisées, voire confidentielles, le dodécaphoniste met son œuvre sur la place publique et somme brutalement les foules de manifester de l'enthousiasme, c'est-à-dire d’apprécier et de comprendre la grandeur et la complexité de son travail.
L'insondable bêtise prétentieuse de cette attitude saute aux yeux : il n'a jamais été prévu par Einstein que sa théorie de la relativité (restreinte ou générale) fût comprise par d'autres que le petit nombre de ses pairs. Il y a une espèce de terrorisme culturel à envisager pour la musique dodécaphonique une diffusion aussi large que pour la quarantième de Mozart. On ne peut faire entrer des foules dans un laboratoire. C'est une musique faite par des spécialistes pour des spécialistes, n'en déplaise à Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Jean-Pierre Derrien et Florent Boffard.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : musique, musique sérielle, musique dodécaphonique, arnold schönberg, luciano berio, sequenza iii, modernité, art performance, jean-pierre derrien, france musique, karlheinz stockhausen, florent boffard
mercredi, 11 décembre 2013
UNE MUSIQUE POUR SPECIALISTES

MUSIQUE POUR LABORATOIRE
Malgré un siècle de diffusion, la musique sérielle rebute toujours le public ordinaire. Comment se fait-ce ? Que se proposent Jean-Pierre Derrien et Florent Boffard sur l’antenne de France Musique le vendredi matin ? Ni plus ni moins que d’éduquer le peuple jusqu’à ce qu’il n'en puisse plus de résister à tant d'insistance et de sollicitude, et qu'enfin, il consente à aimer le système dodécaphonique inventé au début du 20ème siècle par Arnold Schönberg.
Mais je me dis que, si en un siècle on n’y est pas arrivé, c’est qu’il y a quelque chose de plus que la surdité ou le conservatisme du public qui est en cause. Peut-être y a-t-il quelque chose de rédhibitoire dans la musique inventée elle-même. Une limite infranchissable aux oreilles ordinaires et normales. Un noyau dur inassimilable. J'y reviendrai un de ces jours.
« Musique contemporaine » donc ? Je me demande si cette étiquette ne sert pas à marquer une frontière : celle du rapport entretenu par chacun à la modernité. A la droite de Jean-Pierre Derrien (voir plus haut) siégeront tous les justes, tous les promis au salut accordé aux héros qui « vivent avec leur temps ». A l’oreille de ceux-là, je me permettrai juste de susurrer ce mot de Cromwell : « Ceux qui épousent leur époque prennent le risque d’être souvent veufs ».
A la gauche de Florent Boffard, tous les racornis cramponnés à de vieilles lunes comme sont la mélodie, la consonance ou la sensation de plaisir et d’émotion auditifs, promis aux poubelles de l’Histoire qu’il a adroitement placées sous leurs pas. Ceux-là, je me promets de les encourager à rester sourds aux sirènes de la « modernité », et de ne pas sectionner les quelques racines que le 20ème siècle n’a pas réussi à couper avec les temps anciens.
Ces attardés de la préhistoire égarés dans la modernité ressemblent à l’antique caricature des cancres, ceux qui se blottissent au fond de la classe, tout contre le radiateur. Comme le disait un comique des années 1950 – Jacques Bodoin (on peut le voir sur Youtube) – : « C’est là qu’ils s’épanouissent ».
Ceux-là ont garni leurs oreilles du même épais bouchon de cire que les marins d’Ulysse avaient mis à l’approche du rocher des Sirènes. Ceux-là, je le dis aux dévoués Derrien et Boffard, sont définitivement perdus pour la science, hermétiques à toute musique expérimentale, à toute innovation en art. Soyons net, voire péremptoire : hostiles à tout progrès.
Bon, peut-être. Mais pas complètement sûr. Peut-être douteux. Pour vous dire combien je me suis endurci dans mon épaisseur de bouseux béotien resté les pieds enfoncés dans sa glèbe natale, il m’arrive même d’imaginer que l’hypothèse est complètement fausse, même si ça doit contrarier Jean-Pierre Derrien et Florent Boffard.
Et si, après tout, c’étaient les réticents qui avaient raison ? Et si, au contraire des décrets de la « doxa », il était complètement stupide de parler de « Progrès » en musique ? Et s'il y avait quelque imposture à vouer un culte à la déesse « Innovation », quand il s'agit des arts, et de faire d'elle l'arbitre départageant l' « obsolète » et le « vivant » ? Qu’est-ce qui pousse Jean-Pierre Derrien à se prosterner aux pieds de la statue « révolutionnaire » d’Arnold Schönberg ? Je demande qu’au moins on examine ces questions.
Je me demande en effet s’il ne s’est pas passé dans la musique la même chose que dans la peinture et la littérature. Finalement, qu’est-ce que c’est, l’abstraction en peinture ? J’y vois pour ma part deux aspects. D’abord – j’en ai parlé –, c’est la disparition du visage de l’homme et du monde des représentations picturales, l’effacement de la figure humaine, et son remplacement par l’exploitation de toutes les possibilités expressives des moyens techniques à la disposition des peintres.
Ensuite, c’est l’irruption dans le domaine des arts de l’esprit de système, des grandes théories et doctrines. N’est-il pas révélateur qu’un livre considéré comme l’un des trois chefs d’œuvres littéraires du 20ème siècle soit Ulysse, cet ouvrage improbable où le romancier s’est lancé le défi de placer, outre une foule de contraintes langagières, successivement TOUTES les figures de style. Les spécialistes en ont dénombré une petite centaine. L'Ou.Li.Po. de Queneau et Le Lionnais n'est pas loin.
J’ai lu Ulysse en 2009, moi qui ne suis pas spécialiste, et non seulement je n’ai pas cherché à faire cet inventaire, mais je n’ai pas honte d’avouer que ce livre m’a intéressé, sans toutefois me subjuguer. Le côté « performance sportive » attaché aux œuvres proclamées « chefs d’œuvre de la Modernité » me laisse froid. Mais peut-être l'ai-je lu trop tard. J'aurais dû le faire quand la Modernité me laissait encore pantois d'enthousiasme, et ne m'avait pas encore laissé voir son cœur desséché et momifié.
L’expérience de laboratoire, en littérature comme en musique, c’est d'abord fatigant.
Voilà ce que je dis, moi.
09:01 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : art, musique, musique contemporaine, dodécaphonisme, musique sérielle, jean-pierre derrien, florent boffard, france musique, arnold schönberg, oulipo, raymond queneau, le lionnais, james joyce, ulysse, modernité
dimanche, 08 décembre 2013
UNE MUSIQUE POUR SPECIALISTES
UNE MUSIQUE INTERDITE AU PUBLIC
J’ai évoqué récemment le compositeur Arnold Schönberg. L’actualité France Musicienne m’amène à y revenir. C’est dit : la plupart des mélomanes d’aujourd’hui sont des imbéciles et/ou des réactionnaires. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le délicat, ironique et précieux Jean-Pierre Derrien, lors de son émission musicale du vendredi matin.

Pour être tout à fait juste, j’ajoute qu’il n’a pas dit ça. L'homme est trop poli et courtois pour ça. Mais c’est ce que j’ai déduit de la façon dont il a présenté la figure d’Arnold Schönberg : à quelques minutes de distance, après avoir insisté sur le caractère « révolutionnaire » de l’homme, il a dit successivement : « La figure aimée d’Arnold Schönberg », puis : « Arnold Schönberg le mal-aimé ». Petite contradiction en apparence.
En fait, on voit bien que dans un premier temps il déclare sa flamme au compositeur, puis qu’ensuite, il regrette que le public ne se précipite pas en masse aux auditions du Pierrot lunaire et aux représentations de Moses und Aron. On apprend que son invité Florent Boffard, pianiste tout à fait estimable, a publié un CD regroupant les œuvres pour piano, auquel est adjoint un DVD où il se met en tête de dévoiler à l’éventuel auditeur les tenants et les aboutissants de la musique du Viennois, disant que lorsqu’il prend soin d’expliquer les ressorts de cette musique, elle est bien mieux accueillie par les auditeurs.
Et c’est précisément ce point qui retient mon attention. Car je me dis que, quand même, Arnold Schönberg est né en 1874, qu’il est mort en 1951, et qu’il a inventé son système (je dis bien « système ») dodécaphonique au tournant des 19ème et 20ème siècles. Je veux dire que ça fait plus d’un siècle que ce système a été mis au point, et que ça a quelque chose d’extraordinaire. Oui, j’ai bien dit « extraordinaire ».
Ben oui quoi, n’est-ce pas authentiquement extraordinaire que cent ans après son invention, la musique ainsi produite ait encore besoin d’être expliquée au bon peuple, assez benêt pour s’obstiner à ne pas saisir les beautés qu’elle recèle ? Qu’il faille faire œuvre de pédagogie pour le faire changer son hostilité en amour ?
Que les programmateurs de concerts obligent le public à en avaler une dose judicieusement placée entre deux œuvres plus conventionnelles, en espérant qu’il s’habituera ? Que le dit public persiste dans sa répugnance à reconnaître son caractère révolutionnaire ? Cent ans d’une inébranlable résistance de masse aux inventions des compositeurs adeptes du sérialisme, cela devrait leur poser question, à Jean-Pierre Derrien et Florent Boffard, non ? Normalement.
Non, Derrien et Boffard ne se posent pas la question. Il ne leur vient pas à l’esprit de se demander pourquoi la « musique contemporaine » a tant de mal à se faire admettre dans l’univers culturel à égalité avec des programmes plus « conventionnels ». Parce que c’est aussi bizarre, je trouve, que l’on soit encore conduit à apposer l’étiquette « musique contemporaine » sur les productions des compositeurs vivants. A croire que c’est fait pour servir d’appât pour les uns et de repoussoir pour les autres.
Toujours est-il que cent ans après, la musique sérielle n’est toujours pas entrée dans les mœurs, malgré les efforts de damnés produits par ses thuriféraires (Berg, Webern : franchement, vous avez déjà écouté avec un vrai plaisir sensoriel la musique de ce dernier ?) et ses disciples intégristes (Boulez, Stockhausen) pour contraindre les oreilles humaines à se soumettre à leurs diktats.

VOILÀ, C'EST ÇA, LA MUSIQUE SERIELLE (ECOUTEZ).
(désolé, après vérification, la vidéo s'annonce non disponible)
VOUS POUVEZ VERIFIER : IL Y A BIEN LES DOUZE NOTES DE LA GAMME.
Un siècle de résistance passive de la population normale, ça devrait vous inciter à réfléchir, messieurs Derrien et Boffard. Et je n’ai pas parlé de la « musique concrète » de Pierre Schaeffer, de Désert ou d’Amérique d’Edgar Varèse et autres fantaisies électro-acoustiques (François Bayle, Bernard Parmegiani – qui vient de casser sa pipe –, Guy Reibel, Denis Dufour, …).
Aussi longtemps que nul n’aura plaisir à fredonner Stimmung sous sa douche ou dans sa voiture (c’est de Stockhausen), il faudra se résoudre à admettre l’évidence : les oreilles normales n’en veulent pas, un point c’est tout.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts, musique contemporaine, france musique, jean-pierre derrien, florent boffard, pierre schaeffer, edgar varèse, kerlheinz stockhausen, françois bayle, bernard parmegiani, guy reibel, denis dufour, pierre boulez, arnold schönberg, alban berg, anton von webern, pierrot lunaire, moses und aron



