jeudi, 28 mai 2015
POUR TEDI PAPAVRAMI 1
1/2
 Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.
Je n’ai jamais mis les pieds en Albanie. Je connais fort peu d’Albanais. Un très curieux livre d’un nommé Rexhep Qosja (prononcer Redjep Tchossia, paraît-il), intitulé La Mort me vient de ces yeux-là.  Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.
Une BD d’un nommé TBC, Europa, en deux épisodes, sur quelques mafias venues de par là-bas (on va dire Balkans) : plus brutal, plus noir et plus désespéré, j’imagine que c’est toujours possible, mais.
Oh, et puis il y a les faits divers : quelques saisies d’héroïne dans les milieux albanais de la banlieue lyonnaise. Et puis un drôle de business, aussi : un immeuble destiné à la démolition dans un quartier en rénovation, squatté par une bande d’Albanais qui « louent » les « logements » à des compatriotes au tarif de 150 € la semaine. Et la police n’a pas le droit d’intervenir tant que personne n’a porté plainte. Mais est-ce qu’un sans-papiers porte plainte ? Ce serait étonnant, non ? Le monde actuel est décidément délicieux.
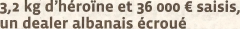
Le Progrès, 27 mai 2015 (p. 10).
Non, l’Albanie, ce n’est pas que ça, faut pas croire. Il y a le grand Ismaïl Kadaré et ses livres, Le Pont aux trois arches, Le Général de l’armée morte, Avril brisé, Les Tambours de la pluie, Qui a ramené Doruntine ?, …. Et puis il y a Tedi Papavrami. Il n’est pas écrivain. Il a quand même écrit un récit autobiographique, à l’incitation des quelques amis conseilleurs. Le livre s’intitule Fugue pour violon seul (éditions Robert Laffont, 2013).
Ne pas s’attendre à de la littérature. L’ouvrage se veut un témoignage. Car l’Albanie dont il parle est celle d’Enver Hoxha (prononcer Hodja ?), alias « Oncle Enver », l’avatar albanais du « Guide Suprême », l’égal des Staline, Ceaucescu, Pol Pot, à l’échelle d’un pays de 3.300.000 habitants, grand comme la région Poitou-Charente (dixit l’auteur, je n'ai pas vérifié). Je veux dire leur égal dans la folie tyrannique, la joie sanguinaire et la férocité des méthodes policières.
Le cher homme était même assez atteint pour quitter le Pacte de Varsovie, au grand dam du « Grand-Frère » soviétique, et se brouiller avec l’autre « Grand-Frère » Mao Dze Dong, et transformer son petit pays en forteresse retranchée du reste du monde, derrière ses barbelés. Ceux qui voulaient s’échapper de ce « paradis communiste » avaient tout intérêt à réussir du premier coup. Il va de soi que le niveau de vie et l’état économique et industriel du pays sont tombés plus bas que ceux du Burkina-Faso, ou même du Malawi. Ça explique peut-être les mafias.
Mais Tedi Papavrami n’était pas un gamin ordinaire : il appartient à l’espèce rarissime des enfants prodiges, des génies précoces. Ça ne s’explique pas : c’est comme ça. Lui, c'est le violon. Quelqu’un qui vous aligne aussi net les Caprices de Paganini à neuf ans, vous dites comme Victor Hugo dans William Shakespeare (2, IV, 3) : « A Pégase donné, je ne regarde point la bride. Un chef d’œuvre est de l’hospitalité, j’y entre chapeau bas ; je trouve beau le visage de mon hôte ». Il faut voir comment un gamin de onze ans est capable de vous envoyer dans la figure la Campanella de Paganini, en Grèce en 1982 (cliquez pour 10' 21" d'étonnement, ce n'est pas toujours « propre » dans les sautillés, mais bon). Il a onze ans. Et même pas peur.
J’ai commenté, il y aura bientôt un an (22-24 juin 2014) le livre de Nikolai Grozni, Wunderkind (« enfant prodige »), qui m’avait frappé de saisissement, par la terrible âpreté de l’aventure. Lui, c'était le piano. Le monde bulgare de l'époque soviétique, comme une jungle où n’évoluent que des fauves, qui n’attendent que l’occasion de s’entredéchirer, sous un ciel de pierre, dans un air irrespirable, au fond d'une bassine où bouillonne la noirceur. Un livre absolument glaçant et passionnant, avec au centre un Chopin hissé jusqu'au tragique.
Avec Papavrami, l’ambiance est plus amène, parfois même pleine d'urbanité. Grozni détestait son père, n’aimait pas trop sa mère. C’était sans doute réciproque. La famille Papavrami, d’origine bourgeoise, est tolérée par le régime communiste, qui lui laisse la maison ancestrale, avec son jardin, ses mandariniers, son mur protecteur, ses souvenirs. Mais c'est une famille solide, à l'ancienne. Une famille, quoi.
L’équilibre, socialement et politiquement, est toutefois instable. Papa travaille au « lycée artistique », dans la section musique, où sa réputation d’excellent pédagogue du violon fait merveille, en même temps qu’elle le protège tant soit peu des rigueurs du régime. C’est simple : tout le monde le respecte, voire le craint.
Il est frustré dans sa carrière depuis la sortie du Pacte de Varsovie, qui l’a obligé à retourner à Tirana avant d’avoir achevé ses études à Vienne (où il a acheté un violon Bergonzi, dans lequel un luthier parisien ne verra plus tard qu'un faux). Mais la famille vit dans une bonne ambiance de tranquillité, dans une maison agréable, avec un jardin clos de murs.
Des privilégiés, somme toute.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, wunderkind, nicolaï grozni, tedi papavrami, virtuosité, albanie, tirana, enver hoxha, ismaïl kadaré, rexhep qosja, la mort me vient de ces yeux-là, bande dessinée, narcotrafic, mafia albanaise, journal le progrès, le pont aux trois arches, le général de l'armée morte, avril brisé, les tambours de la pluie, qui a ramené doruntine, fugue pour violon seul, éditions robert laffont, ceaucescu, pol pot, comunisme, pacte de varsovie, mao tsé toung, caprices de paganini, paganini campanella
mardi, 24 juin 2014
CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 3/3
Résumé : pourquoi Chopin ? Parce que Chopin, quand il invente sa musique, cherche sa propre vie. Et cette vie est âpre. Comme celle des personnage du livre.
 Konstantin, narrateur et personnage principal de Wunderkind, de Nikolai Grozni, est un « enfant prodige », un pianiste virtuose promis, comme quelques autres, à un brillant avenir de soliste. C’est la raison pour laquelle le « Parti », confit dans le culte du « Père de la Nation », lui a fait intégrer le « Conservatoire pour Enfants prodiges ».
Konstantin, narrateur et personnage principal de Wunderkind, de Nikolai Grozni, est un « enfant prodige », un pianiste virtuose promis, comme quelques autres, à un brillant avenir de soliste. C’est la raison pour laquelle le « Parti », confit dans le culte du « Père de la Nation », lui a fait intégrer le « Conservatoire pour Enfants prodiges ».
Malheureusement pour lui, Konstantin a la rage. Il est en guerre contre le communisme et les communistes. C'est un bloc de refus. Plus grave, il est en guerre avec le monde : il déteste ses parents, qui ont eu le tort de s’adapter au moule du système. Et ses parents ne l'aiment guère. Pour le coup, à peu près asocial, aimé par personne et n'aimant personne (croit-il), c’est un authentique révolté, qui ne supporte pas le règne de la bêtise la plus abjecte, surtout jointe à la médiocrité la plus criante, qui exercent un pouvoir sans partage sur les êtres et les choses. Son seul exutoire est dans le piano de Frédéric Chopin. Une condition de survie.
Il le dit : « S’il y avait une raison de rester en vie, de supporter le torrent diurne de la bêtise, de la détresse, de l’insulte et de la bassesse, c’était bien ces moments de ravissement où je respirais au même rythme que Chopin, où le code secret du divin s’inscrivait dans les airs. Il me suffisait de promener les doigts sur le clavier pour y accéder, pour que les portes s’ouvrent toutes grandes ». Sa relation à la musique a quelque chose de névrotique, de pathologique même. Je le sais : je souffre d'un syndrome clinique voisin, sauf que je ne suis pas pianiste, à plus forte raison virtuose. Je suis obligé de me contenter de.
Mais pour lui, c’était ça ou mourir. Le système en effet est tel que si l’on veut espérer survivre, il faut être cinglé. Les seuls personnages vivants, dans Wunderkind, ont tous un grain. Un gros grain. La belle Irina, dont Konstantin se rend compte trop tard qu’il est amoureux, finira d’ailleurs à l’asile, à dix-sept ans, ayant déjà avorté deux fois, capable de déclarer, prémonitoire : « J’ai peur de ne pas atteindre mon vingtième anniversaire. J’ai tout expérimenté, j’ai goûté à tout. Je suis vieille et fatiguée. […]
Ici, le temps ne passe pas à la même vitesse, une année paraît une décennie, voire plus. Mon enfance a pris fin le jour de mes neuf ans. A quatorze ans, j’en avais terminé avec la puberté. Je me suis mariée, j’ai eu des enfants, j’ai voyagé … en quelque sorte. J’ai déjà perdu chacun de ceux qui m’étaient chers. Et tout cela pendant que je jouais de ce foutu violon. Je ne m’en suis même pas rendu compte ». Elle se suicidera. Et le grand Vadim devient militaire, après avoir été chassé de ce « paradis ». Et le superbe Igor le Cygne, un personnage flamboyant, est destitué de son poste.
Tous ces adolescents baisent sans amour, se saoulent à n’importe quoi, fument dès qu’ils le peuvent. La vie les a brutalisés, ils sont vieux avant l’heure. Seule la musique. La musique seule. Comme Irina, Vadim, pianiste prodigieux que Konstantin juge tellement supérieur à lui, est fou à sa façon. L’un des personnages les plus incroyables de tout le livre est professeur de violon. C'est lui qu'on appelle Igor le Cygne. Foutraquement poète, on se demande comment il a fait pour échapper aux camps de travail communistes.
Quand il fait répéter quelque sonate de Bach à Irina son élève et à Konstantin (BWV 1014, 1017 et 1018), les envolées lyriques échevelées dans lesquelles il se lance à deux ou trois reprises sont de vrais morceaux de bravoure : « Les démons de la joie ! Le concierge se fait sucer au moment où je vous parle, c’est de la folie. Je n’en peux plus. Voilà longtemps que j’aurais dû m’inscrire dans une chorale d’eunuques. Peut-être que vous devriez tout bonnement vous mettre nus sous le piano à queue pour baiser, Irina et toi, presto, un menuet, peut-être même une sarabande, et je regarderai de loin … Discrètement ! Je ne dirai pas un mot. C’est une proposition à prendre ou à laisser, je vous mettrai à tous les deux un Très Bien. Une affaire à saisir ! Vous ne savez même pas jouer d’un instrument, de toute façon … Petits merdeux ! De mon temps, on répétait dix heures, quatorze heures par jour, on jouait jusqu’à l’aube, on jouait pour rester en vie ». Comme ça sur des pages.
Seuls quelques-uns sont en vie, tous les autres sont morts ou ressemblent au « Père de la Nation », à la momie duquel la classe entière est allée rendre visite et hommage : « Tu trouves ça drôle Peppy ? Dis à tes camarades ce que tu as appris. – Qu’on est obligé de remplir le ventre du Père de la Nation de barbe à papa pour l’empêcher de puer ». Ce serait hilarant si ce n'était pas terrible. Le surnom de Peppy est « le Voleur ». Et il ne se fait jamais prendre, même quand il vole des kalachnikovs dans les sous-sols du Conservatoire. Lui aussi fait partie des vivants : il connaît par cœur le manuel de survie en milieu hostile.
Et ils sont peu nombreux, les vivants : Igor le Cygne, Irina, Vadim, Peppy, Konstantin, Alexander à la rigueur, bien qu’il sache qu’il peut se permettre d’être insolent, puisque son père est quelqu’un dans le Parti. Il y a aussi « la Coccinelle », le professeur de piano qui considère Konstantin comme le plus doué de ses élèves, et qui finira par émigrer, ayant épousé un Américain.
N’oublions pas de nommer le dédicataire du livre : Ilya. Cet oncle du narrateur a passé quasiment toute sa vie à Lovech puis dans l’île de Parsin à casser des cailloux comme « espion des impérialistes ». Apparition d'une ombre fantomatique surgie du fond des âges totalitaires, qui raconte à son neveu l’horreur du camp de travail, où le kapo Gazdov décide, selon son humeur, de la mort de tel prisonnier, dont le cadavre ira engraisser les cochons, dans l'enclos réservé.
Le prononcé de la sentence se fait par l’entremise du petit miroir où l’officier invite le condamné à se regarder une dernière fois. C’est ainsi, crânement, que finit l’admirable violoniste appelé « le Maestro » : d’un seul coup de club de golf à l’arrière du crâne, après avoir roulé les pointes de sa moustache, en souriant.
Voilà pour le noyau dur des vivants. Tout ce qui les entoure donne l'impression minérale, pétrifiée de la haine (la Hyène, la Chouette, ...). Et la seule « preuve de vie » que les vivants peuvent se donner est la musique qu’ils font, non pas pour « réussir dans la vie », mais parce qu’elle est leur seule manière de donner et de recevoir de l’amour dans ce monde totalement déshumanisé : « Notre corps est la première chose qui disparaît lorsque nous faisons de la musique ». Comme dit Igor, ils font de la musique pour rester en vie. La musique seule.
L’urgence, l’absence, l’impossibilité de l’amour, dans cette existence concentrationnaire, est au centre du livre. Toutes les machines humaines qui gravitent autour du noyau des vivants sont des robots, qui se sont résignés à ne pas exister par eux-mêmes, se contentant de fonctionner docilement. Et de se montrer assez cruels avec ceux qu'ils ont sous leurs ordres pour les contraindre à faire de même. Deux issues pour ceux qui veulent rester vivants : le suicide ou la musique.
Quel tableau terrible, mes amis !
Voilà ce que je dis, moi.
Note : je ne sais pas si Wunderkind, de Nikolai Grozni, est un grand (voire même un bon) livre de littérature. Ce qui me reste de sa lecture, c'est le choc reçu au spectacle de l'affrontement meurtrier de deux mondes : d'un côté celui de la musique des grands (Bach, Beethoven, Chopin) et des rares qui se mettent au service de cette expression sublime de la vie à l'état pur (appelons ça l'amour de l'art) ; de l'autre celui d'un système où la musique n'est qu'une brique de prestige parmi d'autres, dans la muraille à l'abri de laquelle s'édifie l'avenir radieux du paradis socialiste, et qui à ce titre constitue la négation même de la vie.
Le pays totalitaire, ici, est pris dans une contradiction, un double impératif contradictoire : produire des musiciens qui permettent à la Bulgarie de rayonner dans le monde, mais tout faire, dans le même mouvement, pour qu'aucune tête ne dépasse.
Rien que pour l'exactitude radicale dans la peinture de cette bataille de fin du monde, merci monsieur Nikolai Grozni !
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, musique, frédéric chopin, nicolai grozni, wunderkind, éditions plon, bulgarie, communisme, sofia, virtuose, artiste, jean sébastien bach
lundi, 23 juin 2014
CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 2/3
Résumé : je me demandais juste pourquoi Wunderkind, le livre de Nikolai Grozni, m’a secoué. C’est à cause de Chopin.
 « J’avais toujours pensé que la différence entre Chopin et les autres compositeurs était qu’il écrivait à la première personne, et non à la troisième. Beethoven, Mozart, Liszt, Ravel, Schumann, Debussy : tous, ils racontaient ce qui arrivait à d’autre gens, d’autres pays, d’autres sociétés. Seul Chopin parlait de lui. C’était l’honnêteté nue et brûlante de ses phrases musicales qui le distinguait de ses pairs. »
« J’avais toujours pensé que la différence entre Chopin et les autres compositeurs était qu’il écrivait à la première personne, et non à la troisième. Beethoven, Mozart, Liszt, Ravel, Schumann, Debussy : tous, ils racontaient ce qui arrivait à d’autre gens, d’autres pays, d’autres sociétés. Seul Chopin parlait de lui. C’était l’honnêteté nue et brûlante de ses phrases musicales qui le distinguait de ses pairs. »
Bien sûr, Grozni exagère. Il sait forcément que c’est injuste et faux, et que le mouvement lent de la sonate opus 106 de Beethoven ou l’adagio de son quatuor opus 132 (« Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart ») sont pour l’âme humaine d’autres Everest de sincérité absolue. Je note en passant qu’il n'ose pas citer Jean-Sébastien Bach dans sa liste des compositeurs qu’il juge impersonnels. Faudrait quand même pas abuser.
Quoi qu’il en soit, la musique de Chopin constitue le socle sur lequel est construit le livre, dont les chapitres, en même temps que les dates précises, s’ouvrent sur les morceaux de musique que travaille Konstantin, le jeune musicien qui raconte son existence au « Conservatoire pour Enfants Prodiges » de la capitale bulgare et communiste. Rachmaninov fait une apparition, Beethoven, Brahms et Moussorgski deux, Bach trois (eh oui), mais Chopin occupe royalement la première place, très loin devant : quinze chapitre sur vingt-cinq lui sont dédiés.
A ce sujet je me serais presque attendu à ce que les chapitres soient au nombre de vingt-quatre, comme il y a vingt-quatre tonalités dans la musique européenne, célébrées par Bach dans Le Clavier bien tempéré, nombre auquel Chopin lui-même a déféré en composant vingt-quatre Etudes (deux fois douze, opus 10 et 25) et autant de Préludes opus 28.
Je me fais une raison en me souvenant du motif pour lequel Georges Perec a fait exprès de composer La Vie mode d’emploi en quatre-vingt-dix-neuf chapitres et non pas cent, en souvenir de la petite fille de la publicité Lu qui a croqué juste un angle du petit-beurre. Grozni a fait en plus ce que Perec a fait en moins, en quelque sorte. S’est-il seulement préoccupé du nombre ? Pas sûr.
Ce qui m’a secoué, c’est ce que dit Grozni : la musique de Chopin, c’est une personne vivante, avec un épiderme d’écorché vif (si l'on peut dire) connaissant et portant la condition misérable de l’humanité tout entière. A propos de l’opus 20 : « Vadim se redressa, prit une profonde inspiration et déplaça les mains vers le haut du clavier, prêt à frapper le premier accord. Le Scherzo n°1 s’ouvre sur un cri de désespoir absolu : on s’éveille d’un cauchemar pour découvrir que tout ce qu’on a rêvé est vrai ». On trouve ça p. 41. Le Chopin de Grozni, il faut le chercher du côté du tragique.
Et puis : « Le second accord semble à la fois plus résigné et plus agressif : enfermés dans le sablier, on est condamnés à attendre. Prisonniers du temps, hors du temps, conscients de notre finitude. Puis vient la folie qui brise toutes les fenêtres, abat tous les murs, tourbillon de conscience cherchant la sortie. Se peut-il qu’il n’y ait aucun passage secret ? Aucune porte dérobée ? ». La vie, quoi. En plus intense.
Moi qui suis incapable de « voir » des circonstances, des situations ou des personnages (une « narration ») dans la musique (il faut dire que je n’essaie pas : pour moi, à tort ou à raison, les sons musicaux sont des abstractions, ensuite seulement viennent (ou non) les effets parfaitement concrets et physiques), voilà qu’un pianiste doué qui, en plus, sait écrire, met des mots jaillis de sa propre expérience, qui me font « voir » ce que cette œuvre raconte. Des propos que je trouve assez justes et pertinents pour en être intimement touché.
Attention, le Chopin que raconte Grozni n’a rien à voir avec l’éphèbe alangui, légèrement efféminé, que certains pianistes ont longtemps voulu voir, produisant des dégoulinades de sons mélodramatiques et narcissiques : essayez de jouer le Scherzo n°1, tiens, si vous n'avez pas des bras, des poignets, des mains et des doigts en acier !
Ce n'est pas non plus (au risque de paraître paradoxal) le Chopin qui a fait de Vincenzo Bellini son dieu, et qui demande à son piano de porter l'expression la plus accomplie de son profond amour pour le « bel canto » du maître italien de l'opéra (mort à trente-quatre ans, Chopin, mort à trente-neuf a un peu mieux résisté).
Le Chopin de Grozni est âpre, dur comme le granit. Un Chopin confronté à un monde qui, situé à une altitude très inférieure à celle où il a placé ses idéaux. Un Chopin qui affronte des épreuves morales d'une dureté qui met à mal son âme, voire la dévaste.
Mettons que ce Chopin-là s'appelle Nikolai Grozni et soit né en Bulgarie à l'époque de la décrépitude communiste, où plus personne dans le système ne sait où il en est. Où tout le monde s'accroche désespérément aux lézardes du mur. Qui ne tardera pas à tomber.
Avec Wunderkind, le lecteur est face à la figure d’un destin implacable : le Chopin de Grozni est en acier, blindé contre les forces de mort qui l'assaillent. Si c’était une embarcation, ce ne serait en aucun cas une gondole, mais un cuirassé puissant. Une fois le livre refermé, vous ne l'entendrez plus comme avant.
Le Chopin de Grozni est un navire de guerre lancé contre la mort.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, nicolai grozni, wunderkind, éditions plon, musique, chopin, beethoven, mozart, liszt, schumann, ravel, debussy, jean-sébastien bach, sonate opus 106, quatuor opus 132, brahms, rachmaninov, moussorgski, le clavier bien tempéré, georges perec, la vie mode d'emploi
dimanche, 22 juin 2014
CHOPIN CONTRE LE COMMUNISME 1/3
Nikolai Grozni, Wunderkind, Plon, « Feux croisés », 2013

Je ne comprends vraiment pas l'expression de Patti Smith, "prose miroitante", posée bien en évidence sur le guéridon de l'entrée du volume.
Je le dis sans ambages : Wunderkind, du Bulgare Nikolai Grozni, n’est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Peut-être même n’est-il que pour quelques-uns (comme La Chartreuse de Parme, dont le point final s'écrit « to the happy few »). Ce que je ne souhaite pas à l’auteur. Car c’est un livre admirable. Mais Grozni n’a pas choisi la facilité, c’est le moins qu’on puisse dire.
Moi, il m’est rentré dans le chou direct et frontal. Je dirais comme Lino Ventura : « C’est du brutal ». Sauf que là, de la première à la dernière page, personne ne rit, ni les personnages, ni le lecteur. C’est un livre qui vous fait prendre un bain de granit : « Le ciel de Sofia est en granit ». C’est la première phrase. Or nager dans le granit, ce n’est pas évident. Un bain dans un passé sinistre pas si lointain : l’action commence à Sofia, Bulgarie, le 3 novembre 1987 et finit deux ans plus tard, au moment de la chute du mur de Berlin.
On passe trois cents pages enfermé dans l’étroite cellule qu’était un pays communiste où, quand on n’a pas à faire à un mouchard, c’est que c’est un bureaucrate ou un « agent en civil ». Parfois un militaire chargé d'enseigner l'éducation physique, armé de son Makarov 9 mm. En tout cas un médiocre qui peut à tout moment vous menacer de son pouvoir. L’effet est poignant. Comme le narrateur, le lecteur se sent à l'étroit, en permanence traqué par les yeux malveillants au service du « Parti ». Et les yeux sont partout, et ils cognent à l’occasion.
Car ce livre met le lecteur à l’épreuve. Comment fait l’auteur pour lui donner l’impression de passer par les épreuves où lui-même est passé ? Mystère. Ce qui est sûr c’est que c’est violent. Et d’autant plus violent qu’il raconte une guerre impitoyable. Cette guerre de destruction voit s’affronter deux ennemis : Frédéric Chopin et le Communisme (avec tout le système soviétique en prime). Et je peux vous dire qui a gagné : c’est Chopin. Mais à quel épouvantable prix !
Je dois dire, pour être honnête, que, comme lecteur, je suis dans une position singulière, qui ne fait pas de moi un élément statistique décisif. Car moi, Chopin, j’avais huit ans. J'étais vacant, donc disponible, il m’est tombé dessus. Pendant des jours et des jours, j’ai passé et repassé sur le Teppaz du 39 Cours de la Liberté la face du 78 tours où je n’ai jamais su quel pianiste (Braïlovski ?) avait gravé l’étude opus 25 n°11.
Combien de fois l’ai-je fait tourner, pour que le chant implacable et volontaire de la main gauche et les cataractes étincelantes de la droite soient définitivement imprimés, fondus ensemble dans les battements d’un cœur gros comme l’univers, au plus profond de mes profondeurs ? Quarante ? Cinquante ? Cent ? En tout cas, Grand-mère n’en pouvait plus et demandait grâce. J’étais impitoyable. J'avais une excuse : Chopin m’avait révélé la vraie vie.
Le plus étonnant : j’ignorais le nom du compositeur, seule la musique, pendant de longues années, est remontée régulièrement de tout au fond vers la surface, inoubliée et pour ainsi dire originaire, comme un événement fondateur, mais aussi comme un point aveugle. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché : quel enchanteur pouvait avoir écrit cette musique prodigieuse ? Je n’ai plus entendu ce morceau par la suite. Il vivait quelque part, comme un point d’interrogation obstiné.
C’est le hasard d’une programmation de France-Musique entendue sur un mauvais transistor, quelque part au fin fond de la Haute-Loire, qui m’a valu, beaucoup plus tard, de pouvoir enfin nommer l’œuvre et attribuer sa paternité au grand Polonais de France. Je le dis sans fioritures : une commotion ! Un ébranlement vertébral ! A l’instant même, je retrouvais le paradis perdu, pas moins. Je n’y peux rien : c’est comme ça que ça s’est passé.
Ensuite, mon carquois s'est garni d'autres flèches. Le Nocturne opus 48 n°1, par exemple, avec cet extraordinaire changement de tonalité qui suit l'exposé du thème, pour annoncer la brutale mutation de l'humeur, avant le retour à une sorte de paix, mais crépusculaire. Ou bien le Scherzo n°3 (op. 39), avec ses contrastes complexes qui déboulent (« presto con fuoco ») dans une sorte de folie furieuse. Mais l'Etude opus 25 n°11 gardera toujours pour moi le même ineffaçable aspect inaugural que « la première fille qu'on a tenue dans ses bras » (comme dit Tonton Georges).
Devenu le profond sillon dans lequel cette œuvre s’est déposée, je m’autorise à voir dans l’auteur de Wunderkind une sorte de frère éloigné dans l’espace et dans le temps, qui m’apporte soudain sur un plateau les mots et les phrases qui collent exactement à l’idée, jamais formulée, que je me faisais de la musique de Frédéric Chopin.
Là où il est très fort, c’est qu’il m’a fait découvrir des choses que je savais déjà.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, nicolai grozni, bulgarie, roman, wunderkind, éditions plon, collection feux croisés, communisme, urss, guerre froide, parti communiste, sofia, musique, frédéric chopin, études opus 10, études opus 25, france musique

