dimanche, 30 juin 2019
VARÈSE AVAIT TOUT COMPRIS
IL N'Y A PAS DE MUSIQUE SANS SONS,
MAIS IL Y A DES SONS SANS MUSIQUE.
Précision : j'ai pris Varèse pour faire le titre, mais il va de soi que le propos de ce billet s'adresse à tous les compositeurs du 20ème siècle, et même au-delà, aux autres artistes. L'idée générale est la suivante : pour avoir une idée de l'état moral de la civilisation actuelle et du soi-disant "Progrès" qui la guide et l'anime, regardez les œuvres des artistes, et écoutez les œuvres des compositeurs de musique savante.
***
Pelléas et Mélisande-1907, Le Sacre du printemps-1913, Désert-1954 : Claude Debussy, Igor Stravinsky, Edgar Varèse. Autant de scandales éclatés dans la France de la première moitié du 20ème siècle. Fontaine-1917, c’est l'urinoir signé R. Mutt, alias de Marcel Duchamp. Et vlan, encore un scandale. Merda d’artista-1961, c’est Piero Manzoni. Le gobelet d’urine, c’est je ne sais plus qui. Cloaca (la machine à faire caca), c'est Wim Delvoye en 2000. Derniers scandales en date : le « Vagin de la reine », d’Anish Kapoor à Versailles, les « Tulipes » de Jeff Koons, le « plug anal » de Paul Mc Carthy au milieu de la place Vendôme, j’arrête là.
Au théâtre, à l’opéra, on ne compte plus les metteurs en scène qui ont « dépoussiéré » les œuvres majeures du répertoire à coups d’attentats contre les « routines » d’un public « paresseux » et « encroûté », pour « nettoyer les écuries d’Augias » ou « faire souffler un vent nouveau » (rayer la mention inutile). Tiens, dans le Don Giovanni donné ces temps-ci à Strasbourg, Leporello met du poison dans les plats, Donna Anna jette du vin à la figure du séducteur et le Commandeur devient barman : vous le sentez, « l'air frais et vivifiant » ?
Dans le domaine esthétique tout entier, l’histoire du 20ème siècle est jalonnée par les pierres blanches des scandales. Les milieux artistiques, qu’on disait conservateurs, se sont mis au goût du jour et ont adopté le langage cérébral qui convient pour donner à toutes sortes de nouveautés le poids de l’intellect. On s’est mis à idolâtrer les avant-gardes et à guetter l’inouï et le jamais vu. Tous les arts sont touchés par ce phénomène, mais je parlerai ici principalement du domaine musical.
Les beaux esprits qui se font des piquouses à l’air du temps, et tombent dans tous les panneaux pour avoir l’air bien informés, en tirent argument pour en conclure que, quand une œuvre est novatrice, elle commence par « heurter les sensibilités », mais finit toujours par devenir un « classique », sur le refrain : « On s’habitue à tout ». C'est parfois vrai, mais loin d’être la règle (tiens, pour voir si vous le trouvez « classique », essayez la "première" de Déserts de Varèse (27'15") en 1954, et accrochez-vous, je parie que le Sacre de Stravinsky prendra des airs de Mozart. Frank Zappa admirait Varèse).
Ce qui est amusant, c'est que Varèse, qui avait peut-être prévu l'accueil "festif", se débrouille pour qu'il y ait par épisodes plus de bruit sur la scène que dans la salle.
Et le public, dans tout ça ? Eh bien le public, lui, dans sa plus grande partie, est resté sur place. Pendant que les arts (musique, peinture, etc.) montaient dans le TGV et prenaient la voie rectiligne et scintillante de la modernité, le public en restait au pas mesuré du laboureur à sa charrue, derrière son cheval, les sabots dans la glèbe. Et la technique ne l’a pas aidé, on peut le dire, à accélérer l’allure, contrairement à ce qu’on pourrait penser a priori.
Car la technique au 20ème siècle, en plus de donner des moyens révolutionnaires aux compositeurs (qui se sont jetés dessus comme des prédateurs affamés : onde Martenot, Theremine, magnétophone, sampler, etc.), a apporté au public tout ce qu’il fallait pour entretenir son naturel conservatisme esthétique. D’abord la radio, puis la télévision, qui caressent forcément l’auditeur dans le sens du poil ; mais aussi la conservation (enregistrement) et la reproduction (disques) de la musique en train de se faire : ça paraît inconcevable aujourd’hui, mais il fallait auparavant sortir de chez soi pour entendre de la musique, ou alors la pratiquer soi-même pour en faire à la maison.
Du coup, la musique en train de se donner en concert en direct a perdu de sa prégnance et de sa surface commerciale (je ne parle pas du rap). Ce qu’on appelle « musique contemporaine » est devenu une option parmi cent cinquante autres, puisque, grâce à la technique, toutes les musiques sont devenues « contemporaines ».
Et par la vertu des moyens de reproduction, toutes les musiques ont acquis les vertus domestiques de la consommation individuelle, voire solitaire, pour ne pas dire égoïste. Et les étiquettes (on pourrait dire « compartiments », « cases », « ghettos », …), dans les rayons « musique » de la FNAC, se sont mises à proliférer et se multiplier. Pierre Bouteiller avait mis un "s" à "musique" quand il dirigeait l'antenne musicale publique (ceci pour dire que l'élite intellectuelle se fait volontiers la messagère de tout ce qui voudrait la voir morte et en enfer).
Pour ce qui est des musiques savantes, je veux parler des avant-gardes, tout ce beau monde a décidé d’oublier le grand public et d’en revenir à la bonne vieille doctrine de « l’art pour l’art » : moi l’artiste, moi le compositeur, j'oublie que la musique est faite pour être entendue et appréciée par des oreilles humaines, je suis désormais l'explorateur des possibles, l’expérimentateur des formes, le chercheur en blouse blanche, je combine et fabrique au fond de mon laboratoire, j’en sors pour offrir mes trouvailles au monde, et tant pis pour les mélomanes, qui n’ont qu’à me suivre, s’ils ne sont pas trop fossilisés dans une tradition paralysante. Une petite élite d’amateurs préoccupés de « vivre avec leur temps », ça me suffira.
Aparté : j’ai longtemps fait partie de ces gens-là. Je n’en éprouve ni honte ni fierté : cela fut. Cela n'est plus. J'en ai gardé de fort rares prédilections. Mais le plus souvent, je suis obligé de fermer les écoutilles, en me demandant pourquoi les compositeurs modernes et d'aujourd'hui ont banni de leurs préoccupations l'intention de procurer à leurs auditeurs une émotion musicale. Comme s'il était interdit désormais au public d'éprouver du plaisir, et pourquoi pas, de la jouissance. Dans l'immense majorité de sa production, la musique contemporaine déteste le plaisir. (ajouté le 5 juillet)
Le grand public a réagi avec bon sens et à-propos : il a déserté les salles, se disant qu’on ne paie pas son billet d’entrée pour se faire marcher sur les tympans par des bataillons de sons chaussés de bottes à clous (ou inversement, pour chercher dans une botte de foin trois pets inodores qui se courent après). Les directeurs de salles et programmateurs de concerts ont fini par comprendre. En sadiques modérés, ils ont adopté la stratégie du sandwich : une tranche de Stockhausen entre une Quatrième de Beethoven et une Ouverture de Mozart, convaincus qu’à la longue le public s’y fera : « Nous avons les moyens de vous faire aimer la contemporaine » (dit - presque - le SS "Papa Schulz"-Francis Blanche dans Babette s'en va-t-en guerre).
Mais globalement, disons-le, le grand public a résisté à ce qu'il n'arrivait pas à comprendre. C'est un fait : pour entrer dans la musique contemporaine, il faut quelques clés. En particulier, il ne faut pas ignorer que la musique a quelque chose à voir avec le mouvement de l'histoire. Il faut se faire une idée des grandes "problématiques" touchant la tonalité, la mélodie, les timbres, les instruments, la notion d'œuvre (pièces aléatoires de Boucourechliev et autres), l'auditoire (cf. le célèbre 4'33" de Jogn Cage) et autres fantaisies théoriques.
Or le grand public n'avait pas une vue très claire des bouleversements intervenus dans la réalité globale du monde. L'époque, et donc la musique étaient radicalement nouvelles. Quelques révolutions bien réelles avaient eu lieu, changeant de fond en comble les conditions de l'existence et des productions esthétiques. Que peut-on chanter, que peut-on écrire, après deux guerres mondiales, après la bombe atomique, après Auschwitz ? Sûrement pas l'adagio d'Albinoni. L'histoire était passée par là.
En vociférant contre le compositeur qui, selon lui, massacre la "musique", le grand public se trompe de cible (idem en peinture : "Un gamin de cinq ans en ferait autant") : c’est contre l’époque capable d'engendrer de tels monstres, que devraient s’élever les récriminations. Bizarrement, l'auditeur supporte aisément la réalité générale dans laquelle il vit, mais hurle contre des objets esthétiques qui n'en sont que les produits.
Il faut s'en convaincre : la musique contemporaine a tout compris du temps dans lequel elle est composée : elle porte très naturellement les clameurs politiques, les tumultes guerriers, les misères noires, les drames affreux, le chaos sensoriel et l'anarchie conceptuelle qui ont pris les commandes de l'humanité. Il n'y a plus des sons proprement musicaux et spécifiquement organisés sortis d'instruments fabriqués pour ça.
Tous les sons sont devenus égaux, y compris ceux qu'on appelait "bruits" avant que Pierre Schaeffer n'en fasse des "objets musicaux". Par exemple, j'avais assisté à une répétition où les jeunes violonistes, obéissant à Ivo Malec, devaient frapper (pas trop fort, mais "a tempo") le bois de l'instrument avec le bois de l'archet ("Musique nouvelle", Lyon, 1981). Bien des compositeurs sont arrivés à faire pire. Le 20ème siècle ne pouvait pas espérer mieux pour le domaine musical que ce champ de batailles.
La musique faite au 20ème siècle, qui porte tous les bruits et toutes les fureurs du monde, ressemble trait pour trait au siècle où elle a vu le jour (oui, je sais qu'on est au 21ème). Pleine de vacarmes, d'horreurs et de tortures sans précédent, elle est en parfaite adéquation avec lui. C'est l'attitude face au siècle qui doit façonner l'attitude face aux arts, et c'est encore loin d'être le cas. Comme s'il y avait une césure entre les deux. A moins que l'auditeur ne vive dans une bulle protectrice.
Berg, Schönberg, Prokofiev, Partch, Ligeti, Stockhausen, Boulez, Gubaidulina, Barraqué, Schwarz, Xénakis, Penderecki, Nancarrow, Zimmermann, Webern, Boucourechliev, Cage, Berio, Kagel, Greif et tous les autres, ils ont tout compris au siècle, et ils ont composé la musique qui entrait le plus fort en résonance avec lui. Et le grand public, sans même s'en rendre compte, étranger à toutes ces musiques de son temps, vit hors de son propre siècle.
Le grand public n’a pas compris que s’il juge insupportable beaucoup de la musique contemporaine, c’est parce que c’est le siècle qui est insupportable, et que la musique ne fait que l'exprimer. Alors que lui, grand public, qui veut continuer à supporter l'existence, continue à vivre comme si étaient réunies comme avant toutes les conditions pour vivre harmonieusement. Le grand public a mis la tête dans le sable. Les tumultes, les rages, les catastrophes peuvent bien se déchaîner, le grand public se déchaîne quant à lui contre les œuvres qui, dans leur forme ou dans leur contenu, le mettent face à cette réalité sauvage.
Le monde est enragé, mais « la vie continue ». La réalité peut devenir atroce, mais il faut pouvoir continuer à dormir le cœur en paix et à passer des repas tranquilles. Et si, pour mon compte personnel, je déteste une majeure partie de ce qui se fait en musique savante aujourd’hui, c’est parce que je l'inclus dans le tableau d'ensemble. Je sais que notre temps est de moins en moins présentable et habitable (ce qui ne m'empêche pas de jouir de ma petite existence).
J’ai une fois pour toutes cessé d’adhérer à l’ignoble fiction du « Progrès », et cette antipathie va aussi, bien évidemment, aux œuvres qui en sont le fruit. Je coupe le son lorsque viennent les « mercredis de la contemporaine » sur France Musique, sauf en de très rares occasions où, en pleine célébration du culte des sons, du bruit et de la fureur, je vois se dessiner le visage d’une vraie mélodie qui me susurre à l’oreille : « Non, tout n’est pas perdu ».
Voilà ce que je dis, moi.
***
Quelques phrases d'un baratin que j'avais pondu ici même le 9 décembre 2015. Je n'ai guère progressé.
Qui adhère avec enthousiasme à l’époque, est logiquement gourmand d’art contemporain, de musique contemporaine. Qui est rebuté par l’art contemporain, en toute logique, devrait diriger sa vindicte contre l’époque dont celui-ci est issu, et non pas seulement contre l'art qu'elle produit..
L’art contemporain découle de son époque. Tout ce qui apparaît minable dans l’art contemporain découle logiquement du minable de l’époque qui le produit. Ce n’est pas l’art qui pèche : c’est l’époque. Nous avons l’art que notre époque a mérité. Quand la laideur triomphe, c’est que l’époque désire la laideur.
Mais si l’on admet que c’est l’époque qui produit cet art déféqué, c’est moins l’art qui est à dénoncer que l’époque qui l’a vu et fait naître, tout entière.
Mais il y a une certaine continuité. Ajouté le 9 août 2019.
09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, edgar varèse, stockhausen, france musique, france musique, claude debussy, pelléas et mélisande, igor stravinsky, le sacre du printemps, varèse déserts 1954, marcel duchamp, ready-made, merda d'artista, jeff koons, paul mc carthy, wolfgang amadeus mozart, don giovanni, art contemporain, arcon, pierre bouteiller, john cage, boucourechliev, pierre schaeffer, traité des objets musicaux
samedi, 30 avril 2016
CHRISTOPHER LASCH ET L'ARCON
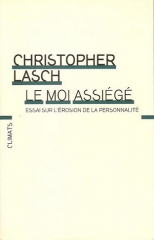 2
2
Alors maintenant, comment Christopher Lasch analyse-t-il l’évolution des pratiques picturales après 1950 ?
« Les équipements d’enregistrement modernes monopolisent la représentation de la réalité, mais ils brouillent également la distinction entre réalité et illusion, entre le monde subjectif et celui des objets, gênant par là même les artistes lorsqu’il s’agit de se réfugier dans le fait brut du moi, comme le disait Roth. Pas plus le moi que son environnement n’est plus un fait brut. » Christopher Lasch, Le Moi assiégé, p. 135. On a déjà croisé une telle idée. On sait qu'elle vient de Guy Debord et de sa Société du spectacle : tout au long de notre existence, toutes nos perceptions (enfin, la plupart) nous parviennent aujourd'hui médiatisées sur un écran où se projettent des images élaborées par d’autres instances que nous-mêmes. Nous n'avons plus d'expérience directe du monde.
« L’artiste romantique projetait des mots et des images dans le vide, en espérant imposer l’ordre au chaos. L’artiste postmoderne et postromantique les voit comme des instruments de surveillance et de contrôle. » C’est l’écrivain William Burroughs qui inspire ici Lasch.
Mais surveillance et contrôle ont été rendus possibles par la généralisation des sciences dites « humaines », au premier rang desquelles on trouve bien sûr la psychologie et la sociologie : « L’observation scientifique et sociologique abolit le sujet en faisant de lui le "sujet" d’expériences censées faire apparaître sa réaction à divers stimuli, ses préférences et ses fantasmes privés. Sur la foi de ses découvertes, la science construit un profil composite des besoins humains sur lesquels elle pourra baser un système (envahissant bien que pas ouvertement oppressif) de régulations comportementales » (p.141). "Régulations comportementales" ? On ne peut être plus clair, me semble-t-il, sur le processus d'asservissement des individus par un système devenu complètement anonyme, du fait que tout ce qui sert à connaître l'homme (les sciences humaines) fournira plus tard des outils perfectionnés pour le contrôler.
L’auteur puise la substance de ce raisonnement chez l’Anglais J.G. Ballard. La préoccupation que ce dernier exprime dans ses romans n’est autre que le processus d’onirisation de la vie, qui résulte de la « saturation de l’environnement par les images et l’effacement consécutif du sujet », tel qu’on peut en voir la manifestation dans le travail d’artistes comme Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Jasper Johns, Robert Morris.


Que ce soient une vignette de BD (Lichtenstein), une aiguille et son fil ou une pince à linge (Oldenburg), l’agrandissement démesuré (x 1000 ou 10000, pour le moins) de l’objet lui fait perdre sa matérialité utilitaire et le coupe de toute réalité concrète. Ce qui fait perdre toute possibilité pour l'œuvre d'art de signifier quoi que ce soit. Sans parler de l'infinie dérision dont de telles œuvres sont porteuses. Il se produit le même phénomène de déréalisation dans la multiplication de la boîte de Campbell Soup ou du portrait de Marylin (Warhol). Il est désormais admis que l’ « œuvre d’art » vole de ses propres ailes, loin de toute basse réalité, offrant au gré des caprices de l’artiste tel objet trivial à l’adoration des foules. On peut voir là une forme de prosternation devant le dérisoire : Clement Greenberg « croyait quant à lui que l’art ne devait jamais tenter de renvoyer à quoi que ce soit en dehors de lui-même ».
Un tel courant a pour conséquence (c’est peut-être le but poursuivi par ces artistes) de dépersonnaliser l’œuvre d’art et d’éliminer la subjectivité (Sol Lewitt), tendant à « brouiller la frontière entre illusion et réalité ». Cette conception de la création artistique procède évidemment des coups inauguraux que Marcel Duchamp, en son temps, a portés au statut de l’artiste. On traitait André Breton de "Pape du surréalisme". Duchamp peut à bon droit être qualifié d' "Empereur du ready-made". Refusant de signer des « chefs-d’œuvre » au bas desquels il serait fier d’apposer sa signature, Duchamp voulut en finir avec la « confiscation » de la créativité par les seuls individus « créatifs ». Idée a priori généreuse et démocratique.
Mais c'est du flan, une vaste blague, une farce grotesque et un désastre général, en vérité, car on sait ce qu’il en est advenu : non seulement le monopole n’a pas été mis à bas, mais il est à présent accaparé, non par des créateurs authentiques, mais par des individus qui se contentent de commercialiser une « idée » artistique, si possible spectaculaire (le bleu de Klein, l’outre-noir de Soulages, la Campbell Soup de Warhol), quand ce n’est pas par de vulgaires hommes d’affaires (Jeff Koons était courtier en matières premières à Wall Street, avant d'être embauché dans la domesticité au service du milliardaire François Pinault).
Il est bien loin, le temps où la société demandait à l’artiste d’administrer la preuve de son savoir-faire et de sa maîtrise technique dans l’art de peindre. Aujourd’hui, tout individu (je ne dis pas "artiste", car tout le monde est concerné par l’appel) un peu astucieux devient une start-up potentiellement dotée d’un bel avenir commercial : sois assez ingénieux pour créer toi-même ton propre « créneau ». Il ne s’agit certes pas du même savoir-faire.
Christopher Lasch se réfère à un essai du philosophe allemand Walter Benjamin, suicidé en 1940 à la frontière franco-espagnole, L’Œuvre d’art à l’heure de sa reproductibilité technique. Qui dit production en série dit forcément société industrielle, société de consommation, société de masse. Chaque tendance de l’art contemporain va s’inscrire dans un « créneau » précis, celui qui lui est dévolu sur le marché d’une consommation donnée. Que cela s’appelle « minimal art », « systemic painting », « optical art », « process art », « earth art » ou conceptualisme, tous participent de ce mouvement de déconstruction (de « démystification »). Et chacun, bien rangé dans sa case, occupe le « segment de marché » qu’il a réussi à s’ouvrir.
Christopher Lasch conclut logiquement à la « fusion du moi et du non-moi », sorte d’indifférenciation des moi, des êtres et des choses, un monde où les distinctions sont abolies, « un monde où tout est interchangeable ». C’en est au point que « la survie de l’art, comme de toute autre chose, est devenue problématique », au motif « que l’affaiblissement de la distinction entre le moi et son environnement – développement fidèlement consigné par l’art moderne jusque dans son refus de devenir figuratif – rend le concept même de réalité, ainsi que celui du moi, de plus en plus indéfendable » (p.155).
Ce qui arrive arrive, ce qui existe existe, ce qui est là est là, c’est tout : il n’y a plus rien sous la surface des choses, toute substance, tout contenu sont révocables, l’unité de la personne est pulvérisée (« Puisque l’individu semble être programmé par des agences extérieures – ou peut-être par sa propre imagination exaltée – il ne peut être tenu pour responsable de ses actes »), l’insignifiance triomphe. Il n'y a plus que de pures apparences : images fabriquées par des gens de métier, et déconnectées de tout contenu humain réel. L'homme en personne devient virtuel.
Les artistes de la fin du 20ème siècle commentent leurs propres œuvres et le « geste » qui les y a conduits comme s’ils inventaient un nouveau monde. Mais c’est une simple grimace. N’est pas Christophe Colomb qui veut.
Au total, Christopher Lasch, en regardant l’évolution de l’art contemporain, semble contempler un champ de ruines. Difficile, je crois, d’aller plus loin dans la dénonciation de l’impasse où se sont engouffrés les artistes depuis cinquante ans et plus.
Plus radical que Christopher Lasch, tu meurs.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : christopher lasch, le moi assiégé, narcissisme, éditions climats, art contemporain, william burroughs, jg ballard, robert rauschenberg, andy warhol, roy lichtenstein, claes oldenburg, jasper johns, robert morris, clement greenberg, marcel duchamp, ready-made, campbell soup, outre-noir soulages, bleu klein, jeff koons, françois pinault, walter benjamin, pop art, op art, art conceptuel, andré breton, surréalisme, sol lewitt, guy debord, la société du spectacle
mardi, 28 octobre 2014
UN « CRÉTIN » PARLE AUX « CRÉTINS »
J’en étais aux caprices des Puissants, hors de prix pour le « vulgum pecus », cela va de soi, car ils ont tellement de moyens qu'ils peuvent TOUT se permettre, et même n'importe quoi. Ils ne s'en privent pas. L'argent, c'est comme les populations, quand on ne sait plus quoi en faire, on le jette (par les fenêtres, à la mer, ...). Sur la place Vendôme, à Paris, cela donne une « œuvre » de Paul McCarthy, cyniquement intitulée « Tree », dont la forme lui a été inspirée par un ustensile en usage (paraît-il, je répète ce que j'ai entendu, moi je suis pour les méthodes naturelles) chez les amateurs d'artifices sodomiques.
De nos jours, tout l'égout est dans la nature, d'où sans doute les préoccupations écologiques. Après tout, peut-être vaut-il mieux que l'objet soit prévu pour, car on retrouve aux urgences hospitalières des gens qui se sont introduit une patate et qui sont alors bien embêtés (authentique et de source sûre, bien sûr, la suite est chirurgicale).

Mais en dehors des très riches, dont la fortune leur permet de satisfaire leurs caprices les plus coûteux, et si possible les plus arrogants, méprisants et insolents à l’égard du pauvre monde, une autre catégorie de personnes met de l’huile dans les rouages de la machine à produire de l’art à usage de monstration collective : ce sont les décideurs. Ça fait du monde.
Le décideur est une espèce en soi : c'est elle qui détient un monopole, qui est un privilège accordé démocratiquement à certains individus depuis que nous sommes en République : le monopole de la SIGNATURE. Le décideur est d'abord celui qui signe, et qui par là assume une responsabilité. Qu'il soit massif ou minuscule, un coffre-fort nécessite une clé pour consentir à s'ouvrir.
Le monde administratif étant ce qu'il est, du chef de bureau au Président de la République, la SIGNATURE est cette clé pour ouvrir le coffre. Alors c'est sûr, le privilège de la signature, il y en a pour boire et pour manger, du plus infinitésimal émargement du chef du service incendie qui vient de viser et d'avaliser le tour de garde du week end, jusqu'au chef qui supervise le chef qui supervise le chef etc ...
Du plus anecdotique au plus notable, le signeur, signateur, signataire, seigneur de décisions foisonne. On peut même dire qu'il pullule. Peut-être même prolifère-t-il, allez savoir, en cas de pépin, ça peut servir pour les assurances ou devant le tribunal : qui est responsable ? Dit autrement : qui décide d'installer un "plug anal" en pleine Place Vendôme ? Qu'on sache contre quel gros responsable porter plainte pour « pretium doloris » (ben oui, ça fait mal, dans ces dimensions).
Car ça finit par faire des sommes ! Pour la ville de Lyon, le budget alloué au fonctionnement seul de la culture pour l’année 2014 était de 113 millions d’euros (source : site municipal). Ce qui permet à l’amateur de Modernité de goûter par exemple, au Musée d’Art Contemporain, l’œuvre iconolâtre et bédélâtre d’Erro, présenté anonymement par monsieur Thierry Raspail (qui dirige l’institution) comme « le premier storyteller de l’histoire de l’art ». Je ne veux pas savoir qui est le signataire en dernier ressort de cette chose. « Erro humanum est. Perseverare diabolicum », je ne sors pas de là.
Il est vrai que, vivant à l’époque de la production industrielle du boudin storytellé et déféqué avec constance et régularité par d’innombrables médias fournis par d’innombrables officines de « communication », nul ne saurait se passer de connaître et d’apprécier les produits de la maison Erro, directement sortis des chaînes de son usine prémonitoire : directement de l'état solide du Réel à l'état gazeux du Virtuel (on appelle ça "sublimation"). Il paraît que ça raconte le passage de l'Âge Archéologique à l'Âge Moderne. Passons.
Il reste que Gérard Colomb (maire), Georges Képénékian (1er adjoint, Culture) et Thierry Raspail (directeur du MAC) illustrent à merveille l’organisation de la chaîne des décisions qui déboucheront plus tard sur la fabrication d’un paysage culturel auquel le spectateur futur est sommé d'adhérer (voir le superbe squelette en acier du « Musée des Confluences »). Ils sont parmi ceux qui vous disent ce qu’il faut avoir vu. Et voir le Musée des Confluences, on ne peut pas faire autrement. On peut dire qu'il s'impose à vous.
Les trois décideurs ci-dessus nommés vous imposent aussi comment le voir : ils ont signé la construction des bâtiments, l'aménagement des espaces, les cheminements, les perspectives et les points de vue, etc. Le Signataire de décision fabrique le cadre de votre existence. Il vous l'inflige. Il vous le fait subir. Et prière d'applaudir : il a tôt fait de vous renvoyer aux élections suivantes si vous n'êtes pas content. Pour la démocratie, vous repasserez dans six ans. Quand je dis "signé", je ne parle bien sûr que de la commande, des autorisations, etc.
Ceux qui sont allés voir il y a quelque temps les « outre-noirs » de monsieur Soulages au Palais des Beaux-Arts de Lyon, qu’ils le veuillent ou non, ont consommé de telles décisions de tels responsables et signataires des dites décisions. Comme les Romains au Cirque, ils en redemandent. Et le grand seigneur qui règne sur ses terres jette sa décision au bon peuple comme la fermière jette son grain à la volaille. Eh oui ! C’est qu’elle vote, la volaille ! Mais si peu, dans le fond !
Si l’on remonte le sillage laissé par les décideurs en matière culturelle, on trouve, entre autres, monsieur Chirac offrant le Pont-Neuf à monsieur Christo pour qu’il en fasse un paquet-cadeau éphémère destiné aux Parisiens (on appelle ça un « événement ») ; on trouve monsieur Aillagon déroulant sous les pas de monsieur Jeff Koons (puis de monsieur Takeshi Murakami) les tapis rouges du château de Versailles pour qu’il y dépose des objets assez furieusement « flashy » pour qu’on entende la puissante détonation produite par le contraste avec ces lieux chargés de leur histoire comme un âne de son fardeau. Plus la déflagration est forte, plus le commanditaire est satisfait. Il faut le comprendre : il a l'impression de faire l'histoire. Sarkozy a montré qu'on peut même en faire une stratégie politique.
C'est sans doute ce que le directeur de Versailles entendait par « dépoussiérer ». Dépoussiérer, pour tout un tas de responsables et de décideurs, ça consiste à nettoyer par le vide (« au Kärcher »), à balayer d'un seul coup tout ce qui a été fait auparavant et surtout faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ah, être le premier ! Malheureusement pour tous ceux qui en rêvent, être le premier en art, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Combien de millions d'artistes se sont rêvés en Marcel Duchamp-bis, et ont désespérément couru après, tentant vainement de répéter le coup de tonnerre de son geste inaugural, radical et fatal, le « ready-made » !!
Demandez à ce pauvre Pierre Pinoncelli, qui souffre depuis tout petit d'un curieux syndrome, qu'il conviendrait de nommer le « Complexe de Marcel Duchamp », une malédiction dont il n'a jamais guéri. Mais c'est comme en alpinisme : la première ascension du Grand Pilier d'Angle, c'est Walter Bonatti en août 1957, et personne d'autre. Après, ça s'appelle la deuxième. Tous les autres sont des suiveurs, imitateurs, émules, épigones, successeurs, etc. Eh oui, Pinoncelli, c'est fini le « ready-made », et depuis 1913, s'il vous plaît. Duchamp a tué le "ready-made" en le mettant au monde. Beaucoup ne s'en sont jamais remis. Pinoncelli mériterait une pension.
D’après monsieur Philippe Dagen (Les nouveaux mécènes de l’art contemporain), c’est un consortium des joailliers de la place Vendôme qui est à la base de la dernière trouvaille monumentale : inviter Paul McCarthy : « Plus remarquable est le fait que l’érection de Tree avait été décidée en accord avec le comité Vendôme, qui réunit les enseignes de luxe installées là » (Le Monde, jeudi 23 octobre 2014). Mais j’aimerais en savoir davantage sur le complément d’agent (laissé ici en blanc) de la tournure passive « avait été décidée » (on attend "par ..."). Autrement dit sur le sujet de l’action : quel bonhomme concret, en dernier ressort, a décidé, c’est-à-dire posé sa signature sur le formulaire officiel, rendant la chose possible ?
Je note en passant que le chapeau de l’article est ainsi formulé : « Pour l’industrie du luxe, la provocation et le scandale sexuel sont des moyens de promotion ». J’abonde, cher monsieur Dagen ! Le mot « décomplexé » a été mis à la mode par un parti de droite. Mais le terme « décomplexé » s’applique encore mieux, depuis quelque temps, aux gens assez riches pour, au mariage de leur fille, donner des louches pour servir le caviar aux centaines d’invités (Pinault ou Arnaud, je ne sais plus).
L’INSEE pourra toujours courir derrière la Réalité avec son double-décimètre et mesurer de combien s’est élargi le fossé qui sépare de plus en plus nettement les 0,01 % plus riches et les 10 % plus pauvres, la Réalité fout le camp loin devant à grandes enjambées, dopée par l’accumulation des super-profits engrangés par les jongleurs de l’économie financiarisée, celle qui est capable de vendre cinquante fois certaines matières premières avant même qu’elles aient été produites. Avec à chaque fois une plus-value, cela va de soi.
Ce sont les nouveaux nababs, richissimes et décomplexés jusqu’à l’ostentation impitoyable de leur bonne conscience en acier inox, jusqu’à la superbe arrogance de leur fatuité sans borne, piaffant d’impatience, pour choquer le populo, d'installer place Vendôme le "plug anal" de Paul McCarthy, sous prétexte de sapin de Noël, godemichet géant, sorte d'énorme pousse-caca vert.
Vous imaginez Maurice Druon publiant aujourd'hui Tistou les pousse-caca verts ? Peut-être en l’incluant dans l’ABCD de l’égalité, vous savez, ce machin destiné, entre autres, à convaincre les petits enfants que le sexe anatomique n’est pas un destin irrévocable.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art contemporain, paul mccarthy, plug anal place vendôme, place vendôme paris, journal le monde, gérard colomb, maire de lyon, georges képénékian, thierry raspail, musée d'art contemporain lyon, mac lyon, erro, musée des confluences, palais des beaux arts lyon, jacques chirac, maire de paris, christo pont neuf, jean-jacques aillagon, château de versailles jeff koons, takeshi murakami, nicolas sarkozy, marcel duchamp, ready-made, pierre pinoncelli, philippe dagen, abcd de l'égalité
dimanche, 26 octobre 2014
UN « CRÉTIN » PARLE AUX « CRÉTINS »
Ce billet fait suite au Manifeste du « Crétin », paru ici il y a quelques jours, titre motivé par celui d’un éditorial du journal Le Monde. J'aurais bien intitulé "Les Crétins parlent ...", mais comme je suis tout seul, ... Tant pis pour le rythme de la phrase, avec sa syllabe "-ent" et sa liaison en plus, à la musique desquelles notre oreille est habituée (vous savez, point-point-point-trait, "ici Londres", etc.).

Je chantais donc le cantique des rebutés de sa Majesté la Modernité, jugés inaptes à l'Art : « Je suis crétin, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien ».
Ce qui m’intrigue, dans l’ « affaire Paul McCarthy-plug anal-place Vendôme », c’est qu’il s’est produit une drôle d’inversion de processus, depuis le premier « ready-made » de pépé Marcel, en 1913. Papy Duchamp, lui, avec sa roue de bicyclette sur un tabouret, il voulait « faire œuvre » (ensuite avec sa « fontaine », son hérisson porte-bouteilles, ses trois « stoppages étalons », tout l’usinage de ses « moules mâliques », sa « broyeuse de chocolat », son « pendu femelle », ses « témoins oculistes », tout ça pour dire qu’on connaît un peu ses classiques …) tout en restant radicalement en dehors du domaine officiel et réservé de l’art, de l’académie, tout ce qu’on voudra.
Commençons par signaler que les gens d’alors, comme prévu, réagissaient comme les gens d’aujourd’hui. Il y avait, dans toute la démarche de Marcel Duchamp un puissant moteur anarchiste, asocial, voire nihiliste qui tirait avec violence tout son autobus (sa « boîte-en-valise ») hors du consensus qui fait la vie collective, hors du champ institutionnel, à commencer par l’Institution du Travail. Les gens avaient une bonne perception de ce nihilisme et de sa haine de l’ordre établi, et lui rendaient bien ses intentions. Tout allait bien, la logique était respectée : le marginal par choix d'un côté, les gens normaux de l'autre, cahin-caha, vaille que vaille.
La différence avec autrefois, elle vient des autorités. Eh oui, c'est elles qui ont pris un virage à 180°. Quand elles levaient les bras au ciel en criant « au fou l’artiste ! », elles hurlaient avec la foule. Aujourd’hui, on assiste à cet incroyable retournement de situation : ce sont les autorités (artistiques, culturelles, politiques, …) qui hurlent contre la foule (on me dira que c'est un groupuscule d'exaltés extrémistes) qui dégonfle le godemichet vert de la place Vendôme, « au fou la foule ! », en « condamnant fermement des actes inqualifiables » commis par des « fascistes », des « réactionnaires », des « mongoliens », bref des « crétins », comme dit souverainement Le Monde.
Aujourd’hui, qu’on se le dise, l’Anarchiste et Nihiliste anti-social, le vaguement escroc, farceur et mystificateur Marcel Duchamp (marchand du sel, comme disait lui-même cet amateur de contrepèteries et autres jeux de mots) a été bombardé Ministre de la Culture. Et son premier décret porte en toutes lettres cette affirmation définitive, au sujet de son « Grand Verre », alias La Mariée mise à nu par ses célibataires, même : « Désormais, la Culture, c’est ça !!! ». Je ne suis pas sûr qu'il ait ajouté « bande de nazes », mais le cœur y est. "Plug" anal compris : il avait bien exposé un urinoir, lui.
Aujourd’hui, pour son « apport décisif à l’histoire de l’art mondial et au rayonnement artistique de la France éternelle », François Hollande en personne a solennellement remis à Marcel Duchamp, le roi du « ready-made », vêtu pour la circonstance de son habit vert d’Académicien Français, la grand-croix de la Légion d’Honneur, dans la cour de l’Elysée, au cours d’une cérémonie grandiose bercée par les flonflons de la fanfare de la Garde Républicaine en grand uniforme, devant une armée de photographes et de cameramen venus du monde entier.
Blague à part, j’aimerais bien qu’on m’explique ce retournement de veste des Puissants. Mais aussi le retournement de veste des Anarchistes, Terroristes et Poseurs de Bombes de l’Art d'avant-garde, qui se sont convertis au métier servile de caniches de leurs Majestés les Puissants. Comment ont-ils fait pour troquer le rôle d'épouvantails et de croquemitaines contre celui de faire-valoir et de bouffons de Sa Majesté ? Comment les Autorités ont-elles pu accepter de faire entrer ces Loups dans la Bergerie Sociale ?
Je risque une première approximation de réponse : parce que nier le Système où règnent ces Puissants est devenu un « fromage ». Alors dis-moi pourquoi la Subversion du Système est devenue un « fromage » ? Parce qu'elle en est devenue un Aliment. Le Carburant de ce Système s'appelle en effet "Négation de soi", "Effacement des données identitaires", "Du Passé faisons Table Rase" (eh oui, aussi étonnant que ça paraisse, le refrain communiste est devenu un chant purement capitaliste).
Le Système a compris que l'Art est absolument inoffensif. La Subversion Politique c'est fini ! Vive la Subversion Idéologique ! La Subversion inoffensive de l'ordre établi par l'Art (et domaines connexes), qu'on se le dise, est devenue un moyen extrêmement prisé de gouvernement des masses. Le "plug anal" de Paul McCarthy place Vendôme a ça d'inscrit dans ses significations prioritaires.
Mais j'ajoute aussitôt qu'à la différence des "Bouffons de Sa Majesté", dont les saillies étaient censées corriger la trajectoire du monarque quand elle devenait erratique, les individus admis à jouer le rôle de "Grands Négateurs Institutionnels" récitent leur Manuel Officiel de la Subversion Permanente à l'intention exclusive du bon peuple, celui qui ne sait pas. Celui qui ne sait plus rien est ainsi appelé à consentir à la subversion permanente de ses propres valeurs, de ses repères, de son histoire, de son identité. A se soumettre à des institutions devenues elles-mêmes subversives. Il y a des exemples récents hors du domaine de l'Art, que les valets des Puissants s'empressent de classer parmi les Progrès décisifs de la Civilisation (je peux mettre les points sur les i si vous voulez).
Le "bon peuple" est celui que les nouvelles élites au service des Puissants ont pour charge de guider sur le chemin qui mène à la définition d'un Homme Nouveau et d'une Humanité Nouvelle. Il faut que cela se sache : le Puissant a désormais besoin du Négateur pour confirmer sa Puissance. Tout simplement parce que le Négateur, en produisant des objets qui manifestent aux yeux de tous la Négation de la Puissance, prouve que le Puissant est plus puissant que sa Négation même, puisqu'il lui ouvre ses portes et lui offre sa protection. C'est la raison pour laquelle Jeff Koons, Takeshi Murakami ou dernièrement Paul McCarthy sont des "Bouffons de Sa Majesté". J'espère que vous suivez.

Jeff Koons et François Pinault, posant lors d'une conférence de presse à Séoul, devant le buste en marbre représentant JK en compagnie d'Ilona. C'est sûrement pour d'excellentes raisons qu'ils se marrent.
Quand je dis « puissants », je renvoie à toutes sortes de gens, mais en premier lieu, évidemment, à ceux qui ont les plus gros moyens. M. François Pinault a dédié un des joyaux vénitiens à ce qui se fait de plus con et temporain dans l’arcon : le Palazzo Grassi. Pour faire pièce à ce grand rival dans la course au titre de « Français le plus riche », Bernard Arnaud (LVMH) a déposé (je suppose) un tas d’or suffisant au pied de Frank Gehry pour que celui-ci lui construise l’écrin rêvé pour ses collections de la plus grande classe. Le bon choix, le premier milliardaire venu vous le dira.

Gehry n’est-il pas l’immortel auteur de l’immeuble (ci-dessus) « Dancing House » de Prague ? Cela vous pose un homme. Ça a de la « patte », voire de la « cuisse ». C’est une « signature ». Walt Disney à Los Angeles, Guggenheim à Bilbao, maintenant la Fondation Vuitton à Paris : mieux qu’un grand chelem à l’ATP, plus fort que mettre tous les œufs dans le même panier, non seulement ça vous en bouche un coin, mais ça vous en colmate une fissure ! Ce brave philanthrope de Bernard Arnaud se voit décerner le label de « mécène respectable ». Pas comme ce pillandre (j’essaie de réhabiliter le patois lyonnais) ostentatoire de Pinault à Venise.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans L'ARCON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arts, art contemporain, paul mccarthy, plug anal place vendôme, marcel duchamp, ready-made, grand verre, la mariée mise à nu par ses célibataires même, journal le monde, jeff koons, takeshi murakami, bernard arnaud, françois pinault, palazzo grassi venise, fondation vuitton paris, frank gehry, guggenheim bilbao

