samedi, 28 mai 2016
NARCISSE SERA LE GENRE HUMAIN
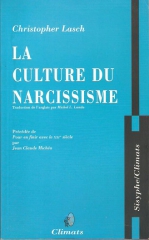 1
1
La Culture du narcissisme (Climats, 1979) est la « Sublime Porte » par laquelle j’étais entré dans l’œuvre de Christopher Lasch (après avoir été incité à lire l’œuvre de ce penseur puissant par la première page de L’Enseignement de l’ignorance, de Jean-Claude Michéa, tout petit livre au titre percutant et pertinent). J’avais lu ce maître-livre en 2006. Dix ans après, j’y suis revenu, et je ne le regrette pas : la teneur du propos m’apparaît, me semble-t-il, de façon plus claire et probante qu’à la première lecture.
Christopher Lasch commence très fort. Pour donner le ton, dernière phrase de la préface de l’auteur : « Le refus du passé, attitude superficiellement progressiste et optimiste, se révèle, à l’analyse, la manifestation du désespoir d’une société incapable de faire face à l’avenir ». Avis à tous les fidèles croyants qui se prosternent devant le dieu « Progrès », devant la moindre « avancée » sociétale et devant la moindre innovation technique, et qui pensent régler les problèmes actuels en persévérant dans la même voie, par exemple en ajoutant de la technique à la technique pour résoudre les problèmes posés par l'expansion des moyens techniques.
Le même mépris pour les incroyants, la même foi, le même aveuglement, le même fanatisme les poussent à traiter de « passéistes », « nostalgiques », « archaïques », « arriérés », « dépassés », « obsolètes » et autres fadaises à la mode, si possible injurieuses, ces affreux pessimistes qui, face à la montée des multiples menaces suspendues au-dessus de l’humanité et de la planète, regardent la réalité en face, et crient « au fou ! ». Bien sûr sans aucune chance d’être entendus. "Au fou ! Au fou !" Damia chantait déjà ça il y a fort longtemps (« Tout fout le camp », 2'51", 1937 ou 1939, suivant les sources en ligne - "Damia" ou "Raymond Asso", le parolier).
Ce que j’apprécie dans la prose de Christopher Lasch, c’est d’abord l’effort de lucidité sur le sens qu’il faut accorder à la façon dont la civilisation évolue, et que le système en place présente comme le Progrès, forcément désirable. Et l’effort est intense : que n’a-t-il pas lu pour alimenter sa réflexion ! Le nombre et la diversité des auteurs chez lesquels il puise impressionnent.
Ensuite, je suis reconnaissant à Christopher Lasch de ne pas se payer de mots, je veux dire qu’il ne se réfère pas aux grands penseurs qui ont élaboré de complexes systèmes philosophiques très abstraits, purement théoriques (Kant, Hegel, Heidegger, …), et qui vous martèlent le crâne à coups de concepts abstrus et baragouineux. Les paroles verbales, c’est pas son truc. L’auteur ne s’adresse pas à de purs esprits, à des initiés, à des spécialistes : il veut se faire comprendre du vulgum pecus. Cela tombe bien : je suis du vulgum pecus. S’il est philosophe, c’est à hauteur d’homme ordinaire.
Pour faire contraste, je viens de faire l’effort de tenter de relire La Barbarie de Michel Henry (Grasset, 1987) : je n'ai pas pu, il m’est tombé des mains. Il y a des phrases qui me font hurler de rire : « Mais l’auto-affection n’est pas un concept vide ou formel, une proposition spéculative, elle définit la réalité phénoménologique de la vie elle-même – une réalité dont la substantialité est sa phénoménalité pure et dont la phénoménalité pure est l’affectivité transcendantale » (p.30-31). Faut-il vous l’envelopper ? Rien à voir avec La Défaite de la pensée, d’Alain Finkielkraut, paru la même année. Le pire, c’est que l’auteur de cette phrase (qui n’est pas la pire qui se puisse trouver) devait en être assez fier.
Le registre auquel se tient Christopher Lasch, tout à fait concret, recourt heureusement à des écrivains, sociologues, chercheurs qui, observant leur époque et s’interrogeant sur la direction prise par la civilisation et sur la signification des innovations techniques et sociétales qu’elle met en place, proposent des analyses qui tantôt applaudissent à la façon dont la société évolue, tantôt critiquent tel ou tel aspect de cette évolution, mais d’une façon qui selon l’auteur ne va pas au fond des choses ou tape à côté de la cible. Lasch s'en prend à la façon dont les différents pouvoirs tentent d'imposer des représentations qui leur soient idéologiquement favorables, plus ou moins relayés par les auteurs auxquels il se réfère. Il soumet à des critiques de fond, les plus englobantes possibles, ces représentations et les discours qu'elles fabriquent.
Que dit Christopher Lasch de la société américaine et de la civilisation qu’elle a fini par imposer au reste du monde, y compris à toutes sortes d’islamo-machins qui traitent (officiellement, car il faut regarder derrière le rideau pour savoir ce qu’il en est en réalité) les Etats-Unis de « Grand Satan » ? Eh bien, pour tout dire, il n’est pas fier du résultat, non plus que de la tournure qu’ont prise les choses au moment où il publie son livre (1979, c’était hier).
Il puise son pessimisme, je l’ai dit, dans des écrits de tous horizons, qui vont d’ouvrages de sciences humaines, philosophiques ou autres, à la littérature pure. Ce qu’il cherche, c’est à s’imprégner de la façon dont ces écrivains perçoivent le monde dans lequel ils vivent, dont ils l’interprètent et en rendent compte. De tout ce matériau qu’il s’efforce de synthétiser, il élabore sa propre interprétation en la situant au fur et à mesure par rapport à eux.
La tendance dominante qui permet de comprendre et d’expliquer ce qui se passe est, selon lui, au premier chef, le narcissisme. Le titre de son premier chapitre, « L’invasion de la société par le moi », n'y va pas par quatre chemins. Il attribue la montée irrésistible du narcissisme dans la psychologie collective à une résignation devant l’ordre des choses, que les gens ont longtemps espéré pouvoir changer, et qui s’est révélé beaucoup plus rétif aux changements qu’ils ne l’envisageaient.
D’où un certain désenchantement : « Après le tumulte politique des années 1960, les Américains se sont repliés vers des préoccupations purement personnelles. N’ayant pas l’espoir d’améliorer leur vie de manière significative, les gens se sont convaincus que, ce qui comptait, c’était d’améliorer leur psychisme » (p.31). S’ensuivent un tas d’activités qui se développent autour des soins du corps et de l’âme, et un centrage de l’attention sur soi-même.
J’ajoute pour mon compte qu’on a pu observer l’invraisemblable allongement des rayons consacrés par les supermarchés du livre aux rubriques « bien-être » et « développement personnel ». Et tout cela est produit par le désinvestissement du politique, c’est-à-dire par l’abandon de l’idée qu’une volonté politique peut agir sur le réel pour le transformer et l’améliorer. Ce que Hannah Arendt considère comme l'activité humaine la plus noble est l'action, et dans la sphère politique : la faculté d'agir collectivement pour orienter la société dans telle ou telle direction. C'est en cette affirmation de la liberté que les gens, selon Lasch, ne croient plus.
A la longue, ce besoin régressif d’être pris en charge, ce besoin que quelqu’un vous donne des conseils sur la marche à suivre, ce besoin que quelqu’un vous mette en sécurité et vous donne la solution du bonheur immédiat a, depuis l’écriture du livre de Christopher Lasch, donné naissance à un monde où les gens, se sentant de moins en moins autonomes, ont remis les clés de leur existence à je ne sais combien de « spécialistes », « entraîneurs » et autres « guides spirituels » plus ou moins illuminés. Le métier de « coach » prolifère comme la vermine, comme si les gens avaient perdu leur propre nord. Il y a ici à l'oeuvre un processus d'infantilisation.
De quoi se demander, quand les populations elles-mêmes sont dans un tel état de délabrement intérieur, ce que devient la volonté de liberté, condition sine qua non de l’exercice effectif de la démocratie.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, christopher lasch, éditions climats, la culture du narcissisme, jean-claude michéa, l'enseignement de l'ignorance, société, chanson, damia tout fout le camp, philosophie, michel henry la barbarie, alain finkielkraut, la défaite de la pensée, états-unis grand satan, hannah arendt, condition de l'homme moderne
mardi, 19 avril 2016
I WILL SURVIVE
CHRISTOPHER LASCH : LE MOI ASSIÉGÉ
Quelques réflexions après lecture. Attention : la lecture de ce billet est déconseillée aux personnes à tendance dépressive : Le Moi assiégé est un livre démoralisant, ... et indispensable pour comprendre un aspect non négligeable et peu reluisant des conditions qui sont faites aux gens qui vivent dans le monde moderne (cf. Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne).
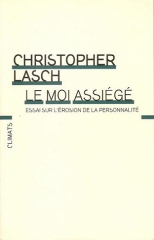 Une autre idée pas drôle du tout, développée par Christopher Lasch dans Le Moi assiégé tourne autour de la notion de « survivalisme ». Vous avez dit Survivalisme ? C’est quoi, cette bête ? La première approximation qui me vient à l’esprit est contenue dans deux titres de films, qui disent bien, à mon avis, ce que la notion veut dire : Vivre pour vivre (Claude Lelouch, 1967) et La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989, je ne parle que des titres, pas des films). Voilà : la vie sans dimension, sans horizon, quasiment réduite aux fonctions animales, l’homme s’éprouvant comme une sorte de bête traquée qui n’a qu’une idée en tête : durer : « … renforce la tournure d’esprit qui considère la préservation de la vie comme une fin en soi » (p.76).
Une autre idée pas drôle du tout, développée par Christopher Lasch dans Le Moi assiégé tourne autour de la notion de « survivalisme ». Vous avez dit Survivalisme ? C’est quoi, cette bête ? La première approximation qui me vient à l’esprit est contenue dans deux titres de films, qui disent bien, à mon avis, ce que la notion veut dire : Vivre pour vivre (Claude Lelouch, 1967) et La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989, je ne parle que des titres, pas des films). Voilà : la vie sans dimension, sans horizon, quasiment réduite aux fonctions animales, l’homme s’éprouvant comme une sorte de bête traquée qui n’a qu’une idée en tête : durer : « … renforce la tournure d’esprit qui considère la préservation de la vie comme une fin en soi » (p.76).
Gloria Gaynor, c'est juste pour mettre un peu de baume sur la plaie.
C’est une obsession particulièrement américaine : « Elle trouve son obsession la plus caractéristique et insidieuse, son expression ultime, dans l’illusion de guerres nucléaires que l’on pourrait remporter ; mais elle ne s’épuise aucunement dans l’anticipation de calamités ahurissantes » (p.57). Il parle sans doute de ces citoyens qui ont assez de moyens pour se doter de bunkers souterrains dans leurs jardins et de réserves de survie pour une durée suffisante en vue de ressortir à l’air libre sans risquer la mort, dans on ne sait combien de temps.
Je ne suis pas sûr que l’Américain moyen soit en possession de ces moyens. Mais la mentalité qui va avec, qu’on ait les moyens ou pas, s’est répandue ailleurs qu’aux USA, quoiqu’avec retard, en même temps que la culture spécifiquement américaine conquérait les esprits un peu partout. Car cette mentalité a gagné le monde (des vertus du "soft power") : qu'on le veuille ou non, le monde est grosso modo américanisé. L'Amérique a universalisé beaucoup de ses problématiques propres, même si celles-ci sont plus ou moins forcées de s'adapter aux cultures locales pour coller au terrain et avoir une chance de prendre racine (pour vendre les produits qui vont avec).
Il ne s’agit donc pas que de moyens : c’est toute une mentalité qui s’est ainsi organisée autour de la nécessité de se préparer à survivre à des conditions extrêmes faites à l’existence de l’humanité ordinaire. L’une des conséquences de la montée du survivalisme, c’est la disparition dans les mentalités de toute possibilité de consacrer son existence à la réalisation d’idéaux quels qu’ils soient, pour lesquels on serait capable d’aller jusqu’au « sacrifice personnel ». Tout ce qui ressemble à de l’héroïsme apparaît comme étrange ou incongru, voire anormal.
Or, avoir un idéal, quel qu’il soit, permet de donner un sens à sa vie (à tort ou à raison, on y croit). Le dilemme est le suivant : dans les conditions qui sont faites à toutes les populations par le système industriel et la société marchande, faut-il se contenter de survivre par tous les moyens, ou doit-on chercher à donner un sens à la présence humaine sur terre ? L’homme ne se considère plus comme un « agent moral » (doté de volonté et de rationalité), mais comme la « victime » d'un système impitoyable qui le domine et l'exploite : « … la protestation politique dégénère en apitoiement sur soi » (p.75).
Le plus effrayant dans le survivalisme, par la folie qu’il y a à faire certains rapprochements, c’est que ses partisans vont chercher dans l’histoire du 20ème siècle des points de comparaison pour qualifier le sort que la société moderne fait aux hommes et pour justifier leur théorie. C’est dans ce but qu’ils s’appuient sur l’exemple des camps de concentration et des camps de la mort, malgré l’énormité du culot et la disproportion flagrante des situations en nombre de victimes et en atrocités subies.
Christopher Lasch se réfère ici à Hannah Arendt, qui pense que les totalitarismes du 20ème siècle, hitlérisme et stalinisme, représentent « une solution, certes irrationnelle, aux problèmes non résolus de la société industrielle » (p.106), problèmes au premier rang desquels se situe la production par la dite société d’une part toujours plus grande de « populations superflues ». Que faut-il faire de l'hitlérisme et du stalinisme ? Des repoussoirs ? Des préfigurations ?
Faut-il, à la suite d’Arendt, considérer le génocide des juifs par Hitler comme un fait radicalement sans précédent ? On perd alors « la faculté de la mettre en perspective » historique pour établir des comparaisons et des correspondances possibles. Faut-il au contraire englober le génocide des juifs dans une problématique plus vaste qui permettrait d’évaluer « la culture et la politique modernes » ? On masque alors « son horreur particulière » (p.103), tout à fait spécifique du sort fait aux juifs sous le régime hitlérien.
On le voit, la question est difficile à trancher. Quand je vois le sort fait aux aliments destinés aux hommes dans les système de la production agricole industrielle, quand je vois le sort fait aux animaux destinés à l'alimentation des hommes dans la production industrielle des animaux comestibles, j'ai tendance à me dire que la structure même qui a permis aux camps de la mort d'exister a été grosso modo transplantée de l'univers nazi dans l'univers capitaliste, sans que la signification intime et profonde de la structure en soit bouleversée.
J’ai personnellement du mal à perdre de vue que l’uniformisation actuelle du monde sous la bannière de la production industrielle généralisée de la totalité de ce dont nous avons besoin pour vivre, rend les produits comme les hommes insignifiants, interchangeables, et par suite, jetables : les camps de la mort, pour aberrants, odieux et innommables qu’ils soient, n'étaient d’une certaine manière que l’application du même principe, sauf que, cette fois, c’est de la mort que l’industrie rendue folle s’était mise à produire.
L’horreur en moins, le sort de l’humanité en devient-il pour autant plus enviable ? L’idolâtrie et le culte fasciné dont l’innovation technologique (dernièrement, la puce qui rend possible au tétraplégique des gestes de la main, demain l’humanité « augmentée ») est aujourd’hui l’objet a tendance à m’apparaître comme le symptôme inquiétant d’un mal moral délétère (irréversible ?), qui voit l’homme se réjouir d’être bientôt débarrassé du fardeau de la liberté et de la volonté, et de pouvoir bientôt s’en remettre aux machines du souci d’exister.
Christopher Lasch, dans Le Moi assiégé, ne s’aventure pas aussi loin ni sur un terrain aussi risqué : c'est moi qui parle ici. Il semble trancher le dilemme en laissant la parole aux survivants des camps eux-mêmes : « Ce sont les survivants qui voient leur expérience comme une lutte non pas pour survivre mais pour rester humains » (p.129). Rester humain ? Je pense à l'inoubliable L'espèce humaine, du grand et bien oublié Robert Antelme. Rester humain, c'est tout de même tout autre chose que survivre !
Si tel est bien le cas, quand le personnage principal du film Pasqualino (Lina Wertmüller, 1976), un petit truand minable qui survivra au camp grâce à sa débrouillardise et sa totale absence de scrupules, suscitera l’admiration des foules, Lasch semble pointer ce qui différencie radicalement l’expérience réelle rapportée par les survivants des camps, et la dérision de toute valeur dans l’exaltation d’un personnage moralement infinitésimal, voire répugnant.
Car si les foules se reconnaissent en lui, une triste perspective s’ouvre, qui en dit long sur la valeur du mot "valeur", que tant d'authentiques salopards au pouvoir ont en permanence à la bouche, alors qu'ils savent que c'est l'insignifiance et la dérision qui nous guettent.
On les comprend : eux aussi, ils veulent "survivre".
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MES CHANSONS, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christopher lasch, le moi assiégé, survivalisme, lelouch vivre pour vivre, tavernier la vie et rien d'autre, claude lelouch, bertrand tavernier, hannah arendt, amérique, usa, états-unis, condition de l'homme moderne, juifs, camps de la mort, auschwitz, camps de concentration, adolf hitler, staline, lina wertmüller pasqualino, robert antelme l'espèce humaine, gloria gaynor, i will survive, génocide, la destruction des juifs d'europe
mardi, 29 novembre 2011
DE LA COURTOISIE EN PHILOSOPHIE
Résumé de l’épisode précédent : HANNAH ARENDT est très belle et Monsieur BERNARD est mort.
Monsieur STORA, le remplaçant de Monsieur BERNARD pour enseigner la philo, je ne sais absolument pas si c’est le BENJAMIN STORA qu’on entend régulièrement sur les ondes quand il s’agit pour les Français de comprendre le Maghreb. Je ne pense pas, parce que, pour s’occuper de l’Afrique du Nord, il faut être historien ou géographe, pas philosophe. Quoique ... (comme disait RAYMOND DEVOS).
« Non-conformiste » résumera le mieux la situation. Je ne pense pas que, sous la houlette décontractée de Monsieur STORA, nous ayons fourni des efforts démesurés. Je me souviens plutôt de causeries informelles. Evidemment, ce n’est pas désagréable, et puis ça fait passer le temps. Et puis, aussi, il m’en reste quelque chose.
Car j’ai gardé un souvenir de son passage dans notre classe, un souvenir non négligeable, comme on va le voir. Je préviens qu’il ne préjuge en rien du fait que Monsieur STORA était ou non excellent, mais il m’a permis au moins d’enrichir mon vocabulaire d’un mot, d'un seul.
Il nous parla en effet un jour des fauteuils conçus par des dessinateurs d’avant-garde (pardon : des designers), qu’il avait qualifiés de vrais « baisodromes ». La preuve qu’il l’a dit, c’est que je m’en souviens. C’était sans doute ça, l’avant-garde pédagogique. Et ça annonçait 1968. Et puis, baisodrome, c’est une philosophie comme une autre, demandez à DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.
Quant au troisième, Monsieur GIRERD, quand il a bien fallu remplacer Monsieur STORA, là, j’ai vraiment eu l’impression d’entrer dans une « classe-de-philo ». Affreux ! Le couvercle, pour le moins ! Quand on entrait dans sa classe, l'espace était déjà plus étroit, les murs s'étaient resserrés, le plafond s'était abaissé, on respirait plus difficilement. J’étais assis à côté de X…, et nous mettions une coche au crayon sur une feuille de brouillon, chaque fois que Monsieur GIRERD prononçait sa formule : « si-vous-voulez ». A la fin, on comparait nos décomptes, pour montrer que nous avions été des élèves excessivement attentifs et studieux.
L’année suivante, j’ai passé toutes mes notes prises en cours à SYLVIE, qui préparait son bac. SYLVIE attendit plusieurs années avant de m’avouer qu’elle s’y était fort amusée et divertie, en particulier à cause des nombreux petits dessins et du nombre appréciable des « je m’emmerde » dont j’avais pris soin de farcir les dites notes. J’avais bien sûr totalement oublié ces détails poétiques.
Si l’on pouvait mourir d’ennui, je serais mort dans un cours de Monsieur GIRERD qui, pourtant, dans son costume impeccable, avait une façon fort élégante de sortir un mouchoir impeccable de sa poche pour s’en essuyer le front dans un sourire dénué, sinon d’humanité, du moins de justification, avant de soulever d’un doigt le bas de sa veste impeccablement coupée pour réinsérer le mouchoir dans sa poche.
Ce dont je me souviens, c’est que ce monsieur, finalement et tout compte fait, n’était pas trop mécontent d’être lui-même. On comprenait très vite qu’il était moins un philosophe que quelqu’un qui s’acquittait contre rémunération statutaire de sa tâche, qui consistait à enseigner la philosophie contenue dans les manuels, pour le compte de l’Etat français. Il n’était certes pas du côté du doute, au moment même où il parlait de DESCARTES.
Je suppose que ma haine de ce qu’on appelle « scolaire », la pire antithèse de ce qu'on appelle « humaniste », je la dois au moins en partie à Monsieur GIRERD. A ce titre, je lui dois aussi une certaine gratitude. Et puis après tout, malgré ses efforts, je me dis qu’il n’a pas réussi à me dégoûter de toute philosophie. Conclusion : je me dis qu'il y a d’un côté les philosophes "pour philosophes et profs de philo", et de l’autre des hommes qui philosophent avec un sens aigu de la courtoisie.
Mon pire souvenir, en philosophie, fut certainement Anthropologie philosophique, de BERNARD GROETHUYSEN, livre entamé librement, je le précise, mais sans précaution aucune, inconsidérément et à l’aveuglette. Je ne souhaite pas une pareille épreuve à mon pire ennemi. Très courte, l’épreuve, il ne faut rien exagérer.
D’une manière générale, autant le dire, je déteste le spécialiste ou l’expert qui pense que, quand il s’adresse à des non-spécialistes, plus il les assommera de termes assommants, c’est-à-dire moins son public aura compris ce qu’il a dit, plus il en ressortira muni d’une auréole d’expert patenté, et plus son propos a des chances de devenir parole d’évangile. Ça, laissez-moi vous dire que ça n’attrape que les gogos, qui regardent le nœud de cravate de travers et le brushing défait avant d’écouter les paroles.
L’actualité économique nous offre mille exemples de ce vice radical qui a contaminé les économistes (avec la liaison « z », j’ai toujours envie de les appeler les « zéroconomistes »). Heureusement, l’actualité, quelle qu’elle soit, nous offre pour compenser une constante et parfaite illustration du bien connu proverbe : « Un clou chasse l’autre ».
Heureusement, aussi, le bureau de Madame Actualité est organisé comme celui de GASTON LAGAFFE qui, ajoutant le courrier du jour à la masse du courrier accumulé, précipite le courrier ancien dans la poubelle située de l’autre côté. Cela ne rend pas plus humbles, pourtant, les professionnels dont le métier est de s’occuper des charmes de Madame Actualité et qui, tous les matins, sont obligés de repartir à l’assaut de son corps inépuisable, toujours nouveau et toujours pareil, aussi vieux et aussi pimpant de jeunesse éclatante.
J’avais lu, il y a fort longtemps, un livre formidable, bien que de taille conséquente : L’Auto-analyse de Freud, de DIDIER ANZIEU. Voilà, me disais-je, une façon courtoise de s’adresser à moi, lecteur : quand je referme le livre, j’ai l’impression d’avoir compris ce qu’on m’a dit. Oui, je dirai qu’il s’agit là de courtoisie.
JACQUES LACAN a certainement eu ses raisons (précision et exactitude) pour s’exprimer, dans le même domaine qu’ANZIEU (la psychanalyse), mais s’il avait envie de rester entre spécialistes en s’adressant à des spécialistes, grand bien lui fasse et je ne m’en mêle pas. Après tout, on ne demande pas au chercheur en biotechnologie d’écrire le billet d’humeur du journal du jour en langage biotechnologique.
Mettez le nez, si ça vous dit vraiment, dans Télévision, du dit JACQUES LACAN (mince comme une jambon de sandwich de chemin de fer, et aussi indigeste, qui commence par le célèbre : "Je dis toujous la vérité. Pas toute."), et vous m’en direz des nouvelles. Sans entrer dans l’étude du cas « JACQUES LACAN », il y a quand même quelque chose de curieux, voire de rigolo. La question qui se pose, en effet, c’est de savoir comment il se fait que cette parole pour le club très fermé d’une élite d’initiés se retrouve galvaudée sur la place publique.
N’y aurait-il pas une petite envie de gloriole ? Allez, avoue JACQUOT, on t’en voudra pas. Le créneau est original : il fallait le trouver ! JACQUES LACAN fondateur de l’école
« HERMETISME DE PLACE PUBLIQUE » !
C’est pas rigolo, ça ? L'oxymore de compétition ! L'oxymore du mépris affiché ! Il fallait y penser ! « Regardez-moi ! Je parade, et vous êtes incapables de savoir pourquoi, mais vous êtes convaincus que je vous suis supérieur. D'ailleurs tout le monde le dit. Au diable la courtoisie ! »
Je les vois très bien, les douze psychanalystes, les conspirateurs en mie de pain, place de la Concorde, avec leurs lunettes noires, leurs imperméables mastic, leurs chapeaux mous, qui murmurent entre eux tout en jetant des coups d’œil autour d’eux, comptant les badauds qui s’arrêtent autour de leur manège de complot de farce. Une belle idée publicitaire quand même. Je lui prédis le plus bel avenir. Ah, on me dit que LACAN est mort ? Peut-être qu’il avait l’âge ?
Attention, fin de déviation, retour à l’itinéraire de départ. Retour à HANNAH ARENDT et à Condition de l’homme moderne. J’ai dit les efforts que ce livre m’a demandés. Là, j’ai eu envie de m’accrocher, au seul motif que j’avais déjà lu quelques choses de la dame qui m’avaient bien parlé. Je tâcherai d’être clair, dans la modeste mesure où j’ai moi-même mesuré enjeux, tenants et aboutissants, ce qui n’est pas gagné d’avance. Je ne vais pas résumer le livre, juste essayer de dire pourquoi je ne regrette pas de l'avoir lu.
A suivre, si je me sens de taille, ... et d’humeur.
lundi, 28 novembre 2011
HANNAH ARENDT ET MONSIEUR BERNARD
Hannah Arendt est une philosophe magnifique. Et magnifique à tout point de vue. Regardez donc la photo que Gallimard a choisie pour orner le dos de son volume « Quarto » : je craque, j'attends qu'on me la présente. Elle est belle. Une jeune femme superbe, au regard ardent, au visage ovale de madone.
On comprend que Martin Heidegger ait succombé, même si c'est Günther Anders qui l'eut le premier, comme premier mari de la dame, lui-même un gusse de première, avec L’Obsolescence de l’homme, que je recommande chaudement.
J’ai lu, il y a quelques années, Les Origines du totalitarisme, le gros maître-livre de Hannah Arendt, le livre d’une vie, même si l’ouvrage est loin d’épuiser l’œuvre de la philosophe. Sa lecture constitue néanmoins une grande aventure, dont mes modestes moyens sont bien loin de pouvoir prétendre dénouer tous les fils.
Je dois dire ici que la lecture des Origines du totalitarisme restera pour moi un moment de basculement. Ce livre, avec quelques autres de la même que j’ai lus, sinon assimilés, a modifié en profondeur ma façon d’être au monde. Peu de livres peuvent se vanter de cet exploit. L’une des premières raisons, c’est probablement l’énormité de la matière brassée et l’impression de maîtrise qui s’en dégage.
Mine de rien et à part ça, je suis épastrouillé du nombre et de la diversité des gens qui se réfèrent à ses travaux, fût-ce pour en critiquer tel aspect. En particulier, les critiques se concentrent sur Eichmann à Jérusalem, que j’avais lu dans la foulée. Il est vrai qu’elle a assisté au procès en tant que journaliste envoyée par le New Yorker, mais qu’elle en est partie avant la fin. Sa thèse sur la « banalité du Mal » est connue, souvent mal comprise.
Mais ce qui lui est surtout reproché, c’est d’avoir minimisé le rôle d’Eichmann dans l’exécution de la « solution finale », en en faisant un exécutant de bas étage, ce qu’elle aurait évité en assistant à la fin du procès, où la véritable personnalité de l’accusé est alors, semble-t-il, apparue en pleine lumière.
Pour ne rien arranger, Hannah Arendt ne porte visiblement pas dans son cœur le président du tribunal, qu’elle trouve, si je me souviens bien, d’une partialité assez marquée. On comprend que ça la chiffonne, malgré tout, d’assister au procès du bourreau par les coreligionnaires de ses victimes : il y a quelque chose de bizarre dans le tableau. Sans parler de l’enlèvement du bourreau (en Argentine, je crois).
La « banalité du Mal », en gros, c’est quand un individu, parce qu’il est pris dans une organisation sociale où il est intégré en se réduisant à un simple rouage mécanique, en vient à infliger le Mal à d’autres individus au nom du bon fonctionnement de la dite organisation. Un Mal infligé de façon administrative et neutre, en quelque sorte. Je parlerai quelque jour prochain de La Crise de la culture, le livre sans doute le plus diffusé de Hannah Arendt.
Aujourd’hui, c’est plutôt de Condition de l’homme moderne que je voudrais parler, un livre fort et dense. Heureusement, il faut attendre la page 280 pour tomber sur une énorme bourde grammaticale, l’impardonnable faute de conjugaison qui déconsidère son auteur : « le moins remarqué certainement fut l’addition d’un certain instrument à l’outillage déjà considérable de l’homme, bien qu’il s’agissât du premier appareil purement scientifique qui eût jamais été inventé ». Même mon correcteur grammatical, qui ne remarque pas grand-chose, l’a souligné en rouge.
Le coupable s’appelle Georges Fradier, le traducteur. Faisons-lui : « Hououou, les cornes ! », qu’il paie sa tournée, et passons à autre chose. Le titre lui-même pourrait poser un petit problème : comment passe-t-on de The Human condition à Condition de l’homme moderne ? Je n’ai pas l’explication.
Ne cherchons pas à le nier : ce livre m’a demandé quelque effort de contention mentale. Je le conseillerais moins à un ami qui voudrais découvrir Hannah Arendt, que La Crise de la culture, de hautes volée et portée, sans doute, mais beaucoup plus accessible.
Attention, déviation. Mesdames et messieurs, nous allons digresser.
En général, je n’aime guère me plonger dans les livres de « philosophie philosophique ». Soit dit aussi en général, je n’ai pas grand-chose à faire avec les constructeurs de systèmes (philosophiques, politiques, et tout ça). C’est ce qui m’a vite éloigné d’un auteur comme René Girard, dont je dois bien avouer que La Violence et le sacré m’avait passionné.
Pour tout dire, les constructeurs de systèmes sont de deux sortes : soit ce sont des utopistes, et dans ce cas, rien n’empêche de les laisser rêver, quitte à ce que leurs projets fassent semblant de se réaliser (Phalanstère, communauté de la Cecilia, etc.) avant de se casser la gueule sans faire trop de bruit. C’est le cas des « écoles parallèles » suscitées par 1968, dans la foulée de Summerhill et A. S. Neill.
Soit ils sont dangereux, comme Lénine, ses sbires et ses suiveurs sinistres, qui ont fait croire qu’ils construisaient la société communiste, alors que ce qui s’est effondré en 1989-1991 n’est rien d’autre qu’un système où régnait un Capitalisme d’Etat (totalitaire, au surplus), simple rival du Capitalisme Libéral (dont je ne suis pas sûr qu’il ne soit pas lui-même totalitaire, à sa manière). Alors là, il faut évidemment les combattre.
Pierre Bourdieu est un autre de ces systémistes que je redoute et fuis autant que je peux. Pour vous dire, mon premier contact avec la philosophie, je veux dire en dehors de toute école, ce furent Friedrich Nietzsche, Henri Bergson et Gaston Bachelard. Je mets Platon à part, dont les dialogues ressemblent plutôt à des conversations familières qu'à des manuels de philosophie. Rien de moins scolaire. Rien de plus courtois.
J'ai fait, comme tout le monde un tout petit détour du côté d’Alain. Propos sur le bonheur, c'est le livre de la philosophie du gros bon sens ("il faut attendre que le sucre fonde", "cherchez l'épingle", etc.), le livre d'un philosophe qui sent encore la glèbe et le cul des vaches, un livre pour adolescents. Globalement, c'est quand même un détour qui vaut le détour. J’avais seize ou dix-sept ans. Tous ces livres ouverts au hasard, je ne savais pas que c'était ça, la philosophie. C’était avant la classe de philo, les manuels, l'ennui.
La Généalogie de la morale, La Naissance de la tragédie, Les Deux sources de la morale et de la religion, Essai sur les données immédiates de la conscience, La Terre et les rêveries du repos, La Terre et les rêveries de la volonté, L’Eau et les rêves, L’Air et les songes. Il est là, mon premier manuel de philosophie, d’avant la classe de philo. Je lisais ça à la façon dont j’ai lu plus tard la poésie. Avec le même sentiment de m’élever et d'explorer.
Avec la classe de philo, ce ne fut plus jamais pareil, mais « ce-qu’il-faut-savoir-pour-réussir-l’examen ». Emmanuel Kant m’a fait mal au pied quand Critique de la raison pure m’est tombé des mains à la moitié de la page douze. S’il m’a fallu côtoyer René Descartes, nous nous croisons depuis ce temps, le matin, à la boulangerie, courtoisement, sans toutefois nous serrer la main.
J’ai suivi quelques conférences de Jacques Bouveresse exposant les détails de la grande controverse entre Leibniz et Spinoza. Voyez un peu ce qu’il m’en reste : nib de nib. Dans le fond, j’ai gardé précieusement mes affections et fantaisies dénuées d’école. Nietzsche et Bergson me semblent toujours éminemment courtois, parce que lisibles.
Car la classe de philo, pour moi, ce ne furent pas les grands philosophes, à l'exception des noms que j'ai cités, plus quelques autres. Ce furent Monsieur Bernard, Monsieur Stora, Monsieur Girerd. Trois professeurs pour le prix d’un. En une seule année. Le premier, on l’a gardé six ou huit semaines, et puis il est mort. C’est dommage, parce que les débuts étaient prometteurs. Je m’en souviens comme si c’était hier. Nous n'étions pour rien dans ce décès, je le jure.
Premier cours avec Monsieur Bernard, vous voulez que je vous fasse le dessin ? Il entre dans la salle, il chope une chaise à la volée, il la place au fond de la travée centrale, il s’assied, il commence à parler. Déjà ça, c’est du brutal. Mais quand on sait que son premier cours, c’est Le Cimetière marin de Paul Valéry, ça refroidit le plus audacieux. On dira « élitiste », bien sûr. J’étais émerveillé, tétanisé sur mon siège et ne comprenant que pouic.
Souvenir extraordinaire d’un choc, même si je reconnais que la poésie de Paul Valéry me semble aujourd’hui avoir quelque chose de fané, de desséché. Quelque chose du stérile des mécaniques horlogères de haute précision, je ne sais comment dire. Quoi qu’il en soit, ceci reste bien beau :
« Ce toit tranquille où marchent les colombes,
Entre les pins palpite, entre les tombes ;
Midi le juste y compose de feux
La mer, la mer, toujours recommencée !
Ô récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux ! »
Je suis allé à son enterrement, qui a dû avoir lieu en décembre. Il fumait (pas ce jour-là, qu'est-ce que vous allez me faire dire !) comme trois pompiers (les professeurs fumaient pendant leurs cours ! ah ! la pipe de tabac gris de Monsieur Zilliox !), et ne dédaignait pas « l’annexe », pendant les récréations, avec un agréable Côtes-du-Rhône, en compagnie de Delmas et Wulschleger. Ce fut donc un cours plutôt bref.
Je revois encore, dans la cour n°1 (des « grands ») du lycée Ampère, ce grand monsieur Bernard, finir sa cigarette avant d’entrer en cours. Son collègue Chopelin lui parlait fiévreusement, l’asticotait, vibrionnait et semblait monter à l’assaut de la haute stature qui restait de marbre, mais toujours courtois. C'est ça qui compte, non ?
A suivre, pour la suite et la fin de la digression, promis.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monsieur bernard, hannah arendt, philosophie, enseignement, lycée ampère, martin heidegger, günther anders, l'obsolescence de l'homme, les origines du totalitarisme, eichmann à jérusalem, banalité du mal, la crise de la culture, condition de l'homme moderne, rené girard, nietzsche, bergson, gaston bachelard, paul valéry, le cimetière marin, poésie
vendredi, 25 novembre 2011
LA TECHNIQUE ET LA FEMME SOÛLE
Donc, le progrès, le bienfaisant progrès, le prometteur progrès, c’est finalement un avorton de progrès, il s’est réduit et se résume à son aspect technique. Pour le progrès culturel, le progrès intellectuel, le progrès moral, le progrès humain, le progrès de civilisation, enfin bref, toutes ces vieilles lunes pour idéalistes attardés, l’humanité repassera. Plus tard. La prochaine fois. Une autre humanité, si possible. S’il y a de la place. Et on n’a pas réservé.
En attendant cette bienheureuse apocalypse (le cuistre qui sommeille en moi ne peut pas s’empêcher : ça veut juste dire « dévoilement »), on se contentera de jouer avec nos gadgets, ces objets dont nous sommes si fiers, ces objets sur lesquels je suis en train de m’escrimer dans le fol espoir que ça serve à quelque chose ou à quelqu’un, ces objets dont tout porte à croire que nous sommes en train de devenir de simples prothèses animées, si ce n’est déjà fait. Je sais que mon espoir est « fol », mais, comme disent ceux qui jouent au loto, « on ne sait jamais ».
Ce ne sera pourtant pas faute d’avoir été avertis. Il y a quelque chose chez Goethe (je crois que c’est dans le second Faust), qui dit que, certes, l’homme est capable de prouesses techniques infinies, mais que c’est au prix d’un pacte avec Méphistophélès en personne. Le Diable. Satan. L’Ange du Mal. Le message ? En inventant les bonnes intentions du progrès technique sans fin, l’Europe a commencé à paver le joli petit enfer promis à l’humanité. Mais Goethe est-il prophète ?
D’autres devins se collèrent à cette noble tâche d’endosser le rôle ingrat de Cassandre. J’aime beaucoup Cassandre. D’abord, elle est d’une beauté à couper le sifflet, tous ceux à qui je l’ai présentée sont d’accord. Et puis aussi, c’est un caractère. Comment ? Se refuser à l’étreinte d’Apollon en personne ? Il faut en avoir où je pense. Non, ça, c’est vulgaire, et je ne voudrais pas tomber trop bas.
Et puis, dans la version que j’aime des Troyens, de notre Hector Berlioz, la Cassandre de Deborah Voigt est d’une justesse irréprochable, même qu’elle parvient à donner un peu de consistance au falot personnage de Chorèbe, avant de laisser toute la magistrale place dans le lit à la Didon de Françoise Pollet. Tout ça se passe sous la baguette de maître Charles Dutoit.
Je voulais seulement parler de quelques nobles individus qui, à force de bien regarder dans les yeux l’époque et le monde dans le bain desquels ils ont été plongés malgré eux, ont jugé que tout ça n’était pas bien beau, ni très ragoûtant, et qui ont désiré faire part de leurs observations à leurs contemporains. Et qui ont donc « endossé le rôle ingrat de Cassandre » (je me cite, voir plus haut).
Je pense à Hans Jonas et à son Principe responsabilité, mais si j’ai bien compris sa démarche, il ne remet pas en question la technique en tant que telle, mais seulement l’usage qui en est fait : si les conséquences de cet usage portent un risque de déshumanisation de l’homme, alors il faut s’abstenir. Je caricature évidemment, mais il y a de ça.
Cette position me paraît bien vaine, car elle ne va pas au fond des choses : un objet technique n’existe que parce que quelqu’un lui a trouvé une utilité. Il se trouve que, soit quelqu’un a trouvé un usage destructeur (poudre à canon, radioactivité), soit que l’objet comporte à terme des effets pervers (au hasard : la télévision, la voiture).
L’expérience montre que le meilleur et le pire sont comme l’avers et le revers de la médaille « technique ». J’ai assisté à des procès d’Assises où le meurtrier s’était servi, au moment des faits, d’un marteau, d’une pelle à poussière ou d’une casserole. Ce que les pénalistes appellent des « armes par destination ». Le tournevis aussi n’est qu’un outil, conçu au départ pour visser. Côté invention, si le pire advient aussi, le meilleur vaut-il la peine ?
J’ai déjà parlé de Lewis Mumford, un des rares Américains éclairés (non, j’exagère, ils sont quelques-uns). Son livre Les Transformations de l’homme, dans sa plus grande part, décrit l’émergence de la technique, son triomphe, puis l’implacable logique de destruction et de déshumanisation que ce triomphe annonce, avant le spectaculaire retournement des deux derniers chapitres, où il étale un improbable optimisme de catéchisme, quant à l’avenir radieux promis à l’humanité souffrante.
Dans le genre « Zorro est arrivé », ce n’est pas mal, je trouve. Très curieux. Bon, je sais bien qu’il ne saurait s’avancer à prédire l’avenir et que la plus élémentaire prudence universitaire interdit d’ôter tout espoir. Ce qui me semble curieux, en fait, c’est que tout le bouquin montre une logique en marche, un processus quasiment mécanique. Et tout d’un coup, miracle, on ne sait quoi vient inverser le processus.
Je pense à Günther Anders et à L’Obsolescence de l’homme. Le tome II, qui a paru très récemment, est sous-titré « Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle ». Son attitude face à la technique, on le comprend déjà, est radicale. Parce qu’il admet qu’il faut aller au bout des hypothèses, soit pour les invalider par l’absurde, soit, évidemment, pour les valider.
Il est vrai que c’était un homme intransigeant, refusant de retourner en Allemagne après la fin de la guerre, refusant un poste enviable à l’université de Halle, refusant, plus tard, un poste encore plus enviable à Berlin. Sa méthode consciente et explicite est celle de l’exagération. Mais c’est pour mieux lutter contre le fait que les phénomènes observés sont, selon un consentement général, minimisés.
Je pense à Hannah Arendt. Elle non plus n’attaque pas la technique en tant que telle, que ce soit dans La Crise de la culture ou dans Condition de l’homme moderne. Je regrette un peu qu’une telle femme ait préféré faire porter son attention sur les aspects culturels, politiques et philosophiques de l’existence humaine, et qu’elle ait délaissé la technique en tant que problème en soi.
La Crise de la culture n’aborde la technique qu’à la toute fin, à travers « la conquête de l’espace ». Hannah Arendt, visiblement, adhère au monde qui est le sien, et néglige la technique comme problème en soi. Au contraire, elle parle de « la grandeur de l’entreprise spatiale », et réfute nettement les arguments qui la remettent en question.
A ses yeux, l’entreprise scientifique est louable en soi : « Ce fut la gloire de la science moderne que d’avoir été capable de s’affranchir de toutes ces préoccupations anthropocentriques, c’est-à-dire authentiquement humanistes ».
Ce qui l’intéresse, ce n’est pas la technique en tant que telle, donc, c’est le fossé grandissant entre l’expérience sensorielle de l’homme ordinaire et le langage scientifique, toujours plus abstrait et désincarné, toujours plus déshumanisé. Mais cette déshumanisation n’a pas l’air de l’inquiéter outre-mesure. Elle irait même jusqu’à s’extasier devant : « une véritable avalanche d’instruments fabuleux et de machines toujours plus ingénieuses ».
Mon dieu, je me permets de critiquer la grande Hannah Arendt ! C’est peut-être dû au fait qu’elle reste vissée dans la logique imperturbable du raisonnement philosophique. Le texte de ce dernier chapitre de La Crise de la culture doit dater de 1959. J’avoue que je le trouve le moins convaincant de l’ouvrage.
Ce qui est curieux, c’est qu’elle insiste beaucoup sur le « point d’Archimède », ce point fixe qui, s’il avait été donné à celui-ci, lui aurait permis de « soulever l’univers ». Ce point qui, dans l’esprit de la philosophe, constitue comme un œil qui regarderait la Terre depuis l’espace. C’est cet œil fictif qui, pour Hannah Arendt, signe l’éloignement radical du discours scientifique par rapport à l’expérience de la perception sensorielle de monsieur tout-le-monde, et à son langage.
Dans le fond, je le trouve fumeux, ce dernier chapitre de La Crise de la culture.
Et pourtant, ce « point d'Archimède », elle le reprend dans Condition de l'homme moderne. Il s'agit vraiment, à ses yeux, d'un point de basculement dans la vision que l'homme se fait de son propre monde : pour la première fois, c'est comme s'il voyait la planète et l'humanité de l'extérieur. Cela ne l'amène pas pour autant à porter un regard critique sur tout ce qui en découlera plus tard, je veux parler de la permanence et de l'accélération incontrôlée de l'innovation technique. J'y vois, pour ma modeste part, un certain aveuglement.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : progrès technique, philosophie, politique, société, goethe, faust, le second faust, diable, satan, cassandre, apollon, hector berlioz, les troyens, hans jonas, lewis mumford, günther anders, l'obsolescence de l'homme, hannah arendt, la crise de la culture, condition de l'homme moderne
jeudi, 24 novembre 2011
POLITIQUE ET ENVIE DE VOMIR
Quelques billevesées, balivernes, calembredaines et autres coquecigrues bien de saison :
I – La philosophe HANNAH ARENDT, dans Condition de l’homme moderne, hiérarchise ainsi les activités humaines :
1 – Tout en bas, le travail, qui traduit un asservissement à la nécessité. Son statut est le même que celui du servage.
2 – Un peu au-dessus du travail, l’œuvre, c’est-à-dire tout ce que l’homme interpose entre le monde et lui. On pourrait dire : tout ce qu’il ajoute à la réalité naturelle.
3 – Tout en haut des activités humaines : l’action. Essentiellement l’action politique, celle par laquelle les individus décident de leur appartenance au monde humain.
Bien sûr, il s’agit là de l’os. Je ne vais pas résumer le bouquin. Je laisse à chacun le soin de disséquer toute l’abondante et forte viande que HANNAH ARENDT a mise autour.
*
II – Le sociologue EMMANUEL TODD qui, à mon avis, porte sur le monde qui est le nôtre un regard original et non dépourvu de pertinence, déclarait à la radio il y a déjà quelque temps que les personnels politiques occidentaux en général, et français en particulier, se caractérisaient par une énorme, une inconcevable, une colossale MEDIOCRITÉ. Je pense qu’il voulait parler spécifiquement de leur médiocrité politique.
*
III – Le philosophe PLATON me déclarait, pas plus tard que la semaine dernière, que la pire des calamités qui puissent s’abattre sur un peuple, c’est que le pouvoir soit exercé par quelqu’un qui l’a ardemment désiré. Moralité : je ne vise personne, mais suivez mon regard. La juxtaposition de ces trois « jalons » constitue sans doute une claire indication de la direction.
***
Avant de commencer, un peu de correction du langage : il devrait être interdit de parler des élections présidentielles, qui supposeraient qu’on élit plusieurs présidents. Parlons, oui, des élections législatives : 577 députés, c’est certain, ça mérite le pluriel. Mais tant qu’il n’y a qu’un président élu, parlons, s’il vous plaît, de l’élection présidentielle. Merci d’avance.
***
Qui gouvernera la France en 2012 ? En l’état actuel des choses, je dirais volontiers que ma crainte est la réélection de notre nabot national. Mon raisonnement est le suivant. Ce ne sont pas tant le charisme, le prestige ou l’infaillibilité de NICOLAS SARKOZY qui plaident en faveur de cette hypothèse, que la médiocrité de ses adversaires putatifs.
Mais il y a aussi et surtout, à son service, une machine à conquérir le pouvoir redoutablement huilée et entraînée. Pour reprendre les trois jalons ci-dessus, personne en France, aujourd’hui, ne désire plus ardemment le pouvoir que NICOLAS SARKOZY. La politique, il s’en balance, il s’en fout, il s’en gausse.
La politique ? Mais il la méprise ! Il faut bien s’en convaincre : NICOLAS SARKOZY n’est pas un homme politique. C’est un APPÉTIT. C’est une des raisons qui font qu’EMMANUEL TODD a raison : nos personnels politiques sont incomparablement MEDIOCRES.
Pour lui, la politique se réduit à quelques données fondamentales : MANIPULER, MENTIR, PROMETTRE, ACHETER.
Mentir, ça a commencé très tôt : « Je ne vous mentirai pas, je ne vous trahirai pas ». Manipuler, c’est, par exemple, un homme de droite qui cite JEAN JAURÈS, célèbre GUY MÔQUET, débauche quelques bâtons merdeux du Parti Socialiste (KOUCHNER, BESSON, etc.). Acheter, c’est nommer à un poste prestigieux ou très rémunérateur des gêneurs ou des adversaires possibles. On appelle ça « voie de garage ».
Voilà le seul « credo » politique de NICOLAS SARKOZY. Cet homme (excusez-moi pour le terme, je n’en trouve pas d’autre) a compris l’état de déliquescence au stade terminal dans lequel se trouve le système politique français (l’italien n’est pas mal non plus, et quelques autres). Il a compris qu’il n’y a plus d’idées politiques. Il a compris que le monde actuel est guidé par deux certitudes qui se foutent éperdument de toute doctrine : la GESTION d’une part, et la COMPETITION d’autre part.
Il a compris que le monde actuel est une COQUILLE POLITIQUEMENT VIDE, dans laquelle se contentent de jouer des FORCES voraces, qui n’ont besoin que de gestionnaires très compétents, de bons élèves sortis de bonnes écoles. Pour un tel opportuniste, c’est pain bénit.
Car NICOLAS SARKOZY a un seul objectif : LE POUVOIR. Si ce n’est pas pour le conquérir, c’est qu’il l’a déjà conquis et, avis à la population, qu’il fera TOUT pour le garder. Pour cela, il profite et abuse d’un outil aberrant, mais qui est entré dans les mœurs, au point d’imposer son hégémonie contre toute raison. Je veux parler du tout puissant SONDAGE.
Cette obsession du sondage chez NICOLAS SARKOZY est une preuve suffisante et aveuglante que son premier objectif n’est pas la politique à proprement parler, mais L’IMAGE que la population se fait (ou plutôt dont on lui bourre le crâne) de la politique. Toute l’action de NICOLAS SARKOZY se limite à la construction, à l’élaboration, à la fabrication et à l’invention de l’image de la politique, qui doit se résumer, dans son esprit, à son image à lui.
D’où l’explosion des factures de l’Elysée en dépenses de sondages pullulants et proliférants, fiévreusement décortiqués et analysés. D’où l’explosion du budget que l’Elysée consacre à la « communication » (voir par exemple ce qui s’est passé avec l’arrivée de THIERRY SAUSSEZ à l’Elysée). D’où le verrouillage minutieux et permanent des « éléments de langage » colportés par les équipes du gouvernement et des communicants, et le rappel à l’ordre impérieux des maladroits et des récalcitrants.
Si après les intimidations et menaces diverses, le « bug » insiste et refuse de s’écraser, on fait le ménage, et on débarque sans ménagement le coupable sur quelqu’une des nombreuses îles sécrétées par les institutions de la République (laissez-moi pouffer !), îles aussi désertes que princièrement rémunérées. La promotion éliminatoire est en effet un des procédés favoris de NICOLAS SARKOZY (et soyons jute : de ses prédécesseurs) pour se débarrasser d’un adversaire potentiel (en l’achetant).
Une autre pièce d’importance sur l’échiquier « politique » de NICOLAS SARKOZY : le FOU. Je veux dire, évidemment, le JOURNALISTE, dont il achète l’attention à coup de sièges et de confidences « off the record » dans l’avion présidentiel, ou qu’il punit à l’occasion, comme LAURENT MOUCHARD dit JOFFRIN, à une conférence de presse remarquée. Le principe est le même que pour les publicités BENETTON après le scandale qu’elles ont volontairement déclenché : dites du mal ou dites du bien de moi, je m’en fous, pourvu que vous parliez de moi.
L’important est le positionnement : toujours au centre du foyer (on parle alors de « focalisation »), par exemple en lançant de belles et saignantes polémiques. Etre celui qui suscite reste une des bases de la communication de toute l’équipe de NICOLAS SARKOZY. Le journaliste suivra comme le mouton suit celui qui le précède. Et tout ça est évidemment soigneusement concerté, calculé, supputé dans l’équipe de communication.
Dernier point sur la mécanique de conquête, je n’y insisterai pas : L’entente avec les puissants et les riches. On n’a pas oublié ERIC WOERTH flattant les membres du « Premier cercle » au cours de réunions discrètes et hautement rémunératrices pour les caisses de l’UMP. C’est la litanie bien connue : FOUQUET’S, BOLLORÉ, LAGARDERE, BOUYGUES et compagnie.
Les premiers éléments indiquant que NICOLAS SARKOZY a toutes les chances d’être réélu sont là. Les autres éléments sont exactement en face. Et regardez-les, les éléments-en-face. Un énigmatique monsieur POUTOU clair comme de l’eau de roche : il découle de la LCR déguisée en NPA, lui-même hérité de BESANCENOT. Un JEAN-LUC MELENCHON qui veut faire croire que quoi ? Qu’il est honnête, quand il tempête à une tribune ou sur un plateau de télévision ? A qui fera-t-on croire ce conte de fées ?
Une EVA JOLY bientôt vierge et martyr jetée dans le panier de vieux crabes, qui tâche d’exister en pariant sur l’intransigeance, mais qui est déjà bien abîmée avant même d’être vraiment entrée en scène. Si elle s’appelait JEANNE D’ARC, je parie qu’elle irait faire sacrer le roi à Reims.
Une MARINE LE PEN, autopromue chevalier blanc en lieu et place du chevalier blanc « tête haute, mains propres », et qui défend des « idées », paraît-il, comme ce très improbable retour de la NATION. Si vous voulez mon avis, la nation, si elle n’est pas tout à fait « en trépas », n’est plus tout à fait « en vie ».
Et maintenant, « grelot, grelot, combien j’ai de sous dans mon sabot ? », « last, but not least », le pauvre FRANÇOIS HOLLANDE. Pourquoi « pauvre » ? Je ne parle évidemment pas de son patrimoine : je crois savoir qu’il est supérieur au mien (voir les quelques pages de journaux y consacrées il y a quelques années).
Je parle de la tête qu’il fait sur les photos. On me dira ce qu’on voudra, cet homme, quand il ne fait pas des yeux de bête traquée, a l’air d’un élève de CM 2 récompensé par la maîtresse d’école. A la rigueur, je l’admets comme le comptable de l’entreprise, que le patron vient de remercier chaleureusement pour la clarté de son bilan, à la fin du conseil d’administration. Lui aussi, il essaie de faire croire. Mais quoi ?
Un dernier mot sur la médiocrité de nos personnels politiques. Vous avez forcément remarqué que ce sont TOUS d’excellents élèves, et même des premiers de la classe (regardez bien COPÉ, MONTEBOURG, FILLON, PEILLON ; regardez-les bien tous en version « premiers de la classe »). Ils ont choisi de « faire carrière », aidés en cela par le cumul des mandats.
Ces quelques centaines de membres de l’élite de notre pays qui, droite ou gauche, fonctionnent comme une « famille » sicilienne qui intronise ou repousse qui elle veut, ne font rien d’autre que se partager des gâteaux, même s’ils proclament être « portés par de fortes convictions ». Droite ou gauche, ils sont formatés intellectuellement de façon strictement identique (la caricature, c’est l’E. N. A.).
Vous avez compris pourquoi je crains, en 2012, le retour du nabot.
Voilà ce que je dis, moi.
Question subsidiaire : lecteur attentif, fûté et affûté, sauras-tu deviner l'anagramme dissimulée dans "nabot" ? Quand je te dis qu'il faut craindre le "retour de bâton" !
09:15 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hannah arendt, philosophie, condition de l'homme moderne, politique, société, emmanuel todd, hommes politiques, platon, élection présidentielle, nicolas sarkozy, jean jaurès, guy môquet, kouchner, éric besson, parti socialiste, ump, sondages, élysée, lucien sfez, laurent joffrin, benetton, françois hollande, éva joly, marine le pen
lundi, 21 novembre 2011
PROGRES TECHNIQUE ET NEF DES FOUS
Avant de commencer, je précise que l'expression "nef des fous" m'est bien entendu inspirée par maître Sebastian Brant (1458-1521) et de son chef d'oeuvre La Nef des fous, qui est un peu le pendant de cet autre chef d'oeuvre : Eloge de la folie, de maître Erasme, un peu à la même époque. Ceci pour dire en préambule qu'il y a peut-être de la folie à avoir ainsi laissé la bride sur le cou à la technique, notre sujet du jour. Il est temps d'entrer en matière.
1 - Alors là, attention, on attaque du béton lourd et compact. Bon, comme d’habe, je vais me décarcasser pour faire simple. Aujourd’hui, sans un minimum d’éthique et de déontologie, on n’arrive même plus à se payer une Rolex à quarante neuf ans et demi. Mais on ne sait jamais. Il va peut-être falloir que je m’efforce. Heureusement, je n’éternue pas comme Gaston Lagaffe, chaque fois que le docteur prononce en sa présence le mot « effort ». Même que ça amuse le docteur, et qu’il fait exprès.
Si ça devient trop abstrait, vous m’arrêtez. Parce que je supporte mal l’abstrait. Quand ça prend de l’altitude, je respire moins bien. Et à l’altitude marquée « intello », celle des gens bien nés, beaux parleurs et bien conditionnés, je suffoque, c’est vite vu. Bon, je vais garder ma Ventoline à portée de main. Comme j’ai dit, on ne sait jamais.
Et puis pas loin, j’ai mes deux balises, Argos et Arva. Je les déclenche en même temps quand il se produit une avalanche de poudreuse en pleins 40èmes rugissants. Je tiens à vérifier moi-même que les secours sont sur le qui-vive. Ça leur fait un exercice inopiné. Excellent pour les réflexes. Après, je me fais une verveine, je peux rajuster mon bonnet de nuit et me rendormir. On ne sait jamais.
Donc, dans un précédent article, je soutiens (« jusques au feu exclusivement », selon la formule déposée par François Rabelais en personne à l’INPI en 1534, j’ai vérifié, inutile de vous donner la peine) que l’Europe est le berceau universel du progrès technique. Personnellement, je suis assez content de l’expression « berceau universel ». Qu’en pensez-vous ? Promis, j’arrête de déparler, comme on dit chez moi, entre Saône et Beaujolais.
Si je me souviens bien de ce que je me rappelle (vous demandiez un moyen mnémotechnique, en voilà un, à condition de mettre « souviens » en tête), j’allusais même que si, dans la course, l’Europe a littéralement semé sur place tous les peuples du monde qui ont assisté médusés au fulgurant départ de son échappée, c’est qu’elle s’est donné un chef, un parrain, une idole incontestable, indestructible, indéboulonnable : la technique. Personne au monde avant elle n’y avait pensé.
Parce que, avec les humains, on ne sait jamais : ça se succède, ça s’envie, ça se vole, ça vote mal, ça se tue de temps en temps. L'humain, c’est instable, soupçonnable, pour ne pas dire suspect, voire méchant. Bref : on ne peut pas compter dessus. Tandis que la technique, tranquille : comme ça a l’air inerte, comme c’est inoffensif tant que tu ne t’en sers pas, tu accumules les savoir-faire, tu collectionnes les acquis, tu mets bout à bout les expériences. Rien de plus sûr.
Pour les bases, le socle si tu préfères, ça a dû se passer entre 1000 et 1400, je n’étais pas là. Ce qu’on appelle bêtement le « moyen âge », juste pour déprécier. A vrai dire, personne n’était là, que les vivants de l’époque qui, de toute façon, n’ont rien vu venir. Tiens, regarde : tu es sur le port d’Aigues-Mortes. Pourquoi Aigues-Mortes ? Mais parce que c’est joli et pas encore ensablé ! C’est qu’il fait beau, en ce 18 juin 1080. On en est au pastis. Tu vois Marius le charpentier qui retape un rafiot.
Tout d’un coup, il a l’idée, le gars, de fixer le gouvernail à la structure. Toi, tu te dis : « Tiens, c’est pas bête ». Avant, il fallait que le barreur se démène comme un diable pour que tout reste dans l’axe et suive le cap. A la rigueur, il godillait. Comment tu veux deviner que le gars a eu une idée géniale, qui facilitera désormais le boulot de tous les skippers du monde ? Quoi, ça s’appelle pas « skipper » à l’époque ? Eh bien mettons, tiens, « cybernète ». Oui, ça veut dire « pilote », en savant. C’est ce qui a donné « gouverner ». Juré, craché.
Le rigolo de l’histoire, c’est que Joseph Ressel, en 1829, aura l’idée de l’hélice, invention révolutionnaire, en regardant faire un matelot en train de godiller, c’est-à-dire de guider son bateau sans gouvernail fixe, en faisant simplement tourner savamment sa rame. Comme quoi, heureusement que ça ne s’est pas perdu en route.
Le progrès technique, personne le voit démarrer. Et surtout, personne sait que c’est ça, le progrès. Trop lent. Trop dispersé. C’est un sournois. Il ne veut pas attirer l’attention sur lui. Un gouvernail fixe par ici, une horloge mécanique par là, des lentilles optiques composées en 1270, un rouet en 1298, une poulie à Nuremberg, une première anatomie scientifique à Bologne. Impossible de synthétiser. Ce n’est qu’à l’arrivée qu’on voit le résultat. Franchement, comment veux-tu deviner ce qui est en train de se passer ? Tu auras beau envoyer Sherlock Holmes, Herlock Sholmes ou Isidore Bautrelet, cet Arsène Lupin-là filera toujours entre les doigts.
Mais parlons du télescope. Galilée fait ses premières observations astronomiques en 1609. Lui, il est convaincu de la nouveauté absolue de sa découverte (ce n’est pas moi qui dis ça, c'est la dame ci-dessous). Mais qui d’autre ? Gregory, Newton, Herschel perfectionnent l’engin. Mais est-ce que tous ces gugusses se rendent compte de la rupture qu’introduit le télescope dans la représentation humaine du monde ? Ça, c’est une idée de Hannah Arendt, qui n’est pas la première venue.
Bon, je ne vais pas vous bassiner avec les détails de son analyse. En gros et pour résumer, le télescope nous fait voir les planètes autres que la Terre, mais surtout, nous oblige à admettre que la Terre est une planète parmi d’autres. Tout le truc est là. L’homme se met à voir son monde comme s’il l’observait de l’extérieur.
On a du mal à se rendre compte aujourd’hui qu’il s’agit là d’une rupture radicale. C’est dans Condition de l’homme moderne. Hannah Arendt renvoie à cette occasion à la parole d’Archimède : « Donnez-moi un point fixe, et je soulève l’univers ». Le télescope, c’est ça, ou peu s’en faut. « Nous sommes les premiers à vivre dans un monde (…) dans lequel on applique à la nature terrestre (…) un savoir acquis en choisissant un point de référence hors de la Terre », comme dit la dame. Il fallait quand même que je cite cette phrase, même élaguée.
Ajoutez à ça le premier globe terrestre, réalisé en 1492 par Martin Belhaim, on est bien obligé d’admettre que l’homme, à partir de là, voit les choses autrement, même s’il ne s’en rend pas compte sur-le-champ. Ajoutez à ça la carte géographique (la vraie), tout est prêt pour « faire entrer l’univers dans les salons », comme dit Hannah Arendt. Nous, on est nés dans ce bain-là : c’est devenu si « naturel » qu’on l’apprend à l’école primaire. Mais sur le moment, c’est comme une gifle donnée par la technique à l’humanité.
A suivre ...
09:00 Publié dans LITTERATURE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaston lagaffe, rolex, déontologie, docteur, balise argos, balise arva, rabelais, inpi, progrès technique, europe, aigues-mortes, gouvenail, hélice, sherlock holmes, arsène lupin, galilée, hannah arendt, newton, archimède, condition de l'homme moderne

