mardi, 19 avril 2016
I WILL SURVIVE
CHRISTOPHER LASCH : LE MOI ASSIÉGÉ
Quelques réflexions après lecture. Attention : la lecture de ce billet est déconseillée aux personnes à tendance dépressive : Le Moi assiégé est un livre démoralisant, ... et indispensable pour comprendre un aspect non négligeable et peu reluisant des conditions qui sont faites aux gens qui vivent dans le monde moderne (cf. Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne).
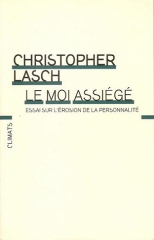 Une autre idée pas drôle du tout, développée par Christopher Lasch dans Le Moi assiégé tourne autour de la notion de « survivalisme ». Vous avez dit Survivalisme ? C’est quoi, cette bête ? La première approximation qui me vient à l’esprit est contenue dans deux titres de films, qui disent bien, à mon avis, ce que la notion veut dire : Vivre pour vivre (Claude Lelouch, 1967) et La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989, je ne parle que des titres, pas des films). Voilà : la vie sans dimension, sans horizon, quasiment réduite aux fonctions animales, l’homme s’éprouvant comme une sorte de bête traquée qui n’a qu’une idée en tête : durer : « … renforce la tournure d’esprit qui considère la préservation de la vie comme une fin en soi » (p.76).
Une autre idée pas drôle du tout, développée par Christopher Lasch dans Le Moi assiégé tourne autour de la notion de « survivalisme ». Vous avez dit Survivalisme ? C’est quoi, cette bête ? La première approximation qui me vient à l’esprit est contenue dans deux titres de films, qui disent bien, à mon avis, ce que la notion veut dire : Vivre pour vivre (Claude Lelouch, 1967) et La Vie et rien d’autre (Bertrand Tavernier, 1989, je ne parle que des titres, pas des films). Voilà : la vie sans dimension, sans horizon, quasiment réduite aux fonctions animales, l’homme s’éprouvant comme une sorte de bête traquée qui n’a qu’une idée en tête : durer : « … renforce la tournure d’esprit qui considère la préservation de la vie comme une fin en soi » (p.76).
Gloria Gaynor, c'est juste pour mettre un peu de baume sur la plaie.
C’est une obsession particulièrement américaine : « Elle trouve son obsession la plus caractéristique et insidieuse, son expression ultime, dans l’illusion de guerres nucléaires que l’on pourrait remporter ; mais elle ne s’épuise aucunement dans l’anticipation de calamités ahurissantes » (p.57). Il parle sans doute de ces citoyens qui ont assez de moyens pour se doter de bunkers souterrains dans leurs jardins et de réserves de survie pour une durée suffisante en vue de ressortir à l’air libre sans risquer la mort, dans on ne sait combien de temps.
Je ne suis pas sûr que l’Américain moyen soit en possession de ces moyens. Mais la mentalité qui va avec, qu’on ait les moyens ou pas, s’est répandue ailleurs qu’aux USA, quoiqu’avec retard, en même temps que la culture spécifiquement américaine conquérait les esprits un peu partout. Car cette mentalité a gagné le monde (des vertus du "soft power") : qu'on le veuille ou non, le monde est grosso modo américanisé. L'Amérique a universalisé beaucoup de ses problématiques propres, même si celles-ci sont plus ou moins forcées de s'adapter aux cultures locales pour coller au terrain et avoir une chance de prendre racine (pour vendre les produits qui vont avec).
Il ne s’agit donc pas que de moyens : c’est toute une mentalité qui s’est ainsi organisée autour de la nécessité de se préparer à survivre à des conditions extrêmes faites à l’existence de l’humanité ordinaire. L’une des conséquences de la montée du survivalisme, c’est la disparition dans les mentalités de toute possibilité de consacrer son existence à la réalisation d’idéaux quels qu’ils soient, pour lesquels on serait capable d’aller jusqu’au « sacrifice personnel ». Tout ce qui ressemble à de l’héroïsme apparaît comme étrange ou incongru, voire anormal.
Or, avoir un idéal, quel qu’il soit, permet de donner un sens à sa vie (à tort ou à raison, on y croit). Le dilemme est le suivant : dans les conditions qui sont faites à toutes les populations par le système industriel et la société marchande, faut-il se contenter de survivre par tous les moyens, ou doit-on chercher à donner un sens à la présence humaine sur terre ? L’homme ne se considère plus comme un « agent moral » (doté de volonté et de rationalité), mais comme la « victime » d'un système impitoyable qui le domine et l'exploite : « … la protestation politique dégénère en apitoiement sur soi » (p.75).
Le plus effrayant dans le survivalisme, par la folie qu’il y a à faire certains rapprochements, c’est que ses partisans vont chercher dans l’histoire du 20ème siècle des points de comparaison pour qualifier le sort que la société moderne fait aux hommes et pour justifier leur théorie. C’est dans ce but qu’ils s’appuient sur l’exemple des camps de concentration et des camps de la mort, malgré l’énormité du culot et la disproportion flagrante des situations en nombre de victimes et en atrocités subies.
Christopher Lasch se réfère ici à Hannah Arendt, qui pense que les totalitarismes du 20ème siècle, hitlérisme et stalinisme, représentent « une solution, certes irrationnelle, aux problèmes non résolus de la société industrielle » (p.106), problèmes au premier rang desquels se situe la production par la dite société d’une part toujours plus grande de « populations superflues ». Que faut-il faire de l'hitlérisme et du stalinisme ? Des repoussoirs ? Des préfigurations ?
Faut-il, à la suite d’Arendt, considérer le génocide des juifs par Hitler comme un fait radicalement sans précédent ? On perd alors « la faculté de la mettre en perspective » historique pour établir des comparaisons et des correspondances possibles. Faut-il au contraire englober le génocide des juifs dans une problématique plus vaste qui permettrait d’évaluer « la culture et la politique modernes » ? On masque alors « son horreur particulière » (p.103), tout à fait spécifique du sort fait aux juifs sous le régime hitlérien.
On le voit, la question est difficile à trancher. Quand je vois le sort fait aux aliments destinés aux hommes dans les système de la production agricole industrielle, quand je vois le sort fait aux animaux destinés à l'alimentation des hommes dans la production industrielle des animaux comestibles, j'ai tendance à me dire que la structure même qui a permis aux camps de la mort d'exister a été grosso modo transplantée de l'univers nazi dans l'univers capitaliste, sans que la signification intime et profonde de la structure en soit bouleversée.
J’ai personnellement du mal à perdre de vue que l’uniformisation actuelle du monde sous la bannière de la production industrielle généralisée de la totalité de ce dont nous avons besoin pour vivre, rend les produits comme les hommes insignifiants, interchangeables, et par suite, jetables : les camps de la mort, pour aberrants, odieux et innommables qu’ils soient, n'étaient d’une certaine manière que l’application du même principe, sauf que, cette fois, c’est de la mort que l’industrie rendue folle s’était mise à produire.
L’horreur en moins, le sort de l’humanité en devient-il pour autant plus enviable ? L’idolâtrie et le culte fasciné dont l’innovation technologique (dernièrement, la puce qui rend possible au tétraplégique des gestes de la main, demain l’humanité « augmentée ») est aujourd’hui l’objet a tendance à m’apparaître comme le symptôme inquiétant d’un mal moral délétère (irréversible ?), qui voit l’homme se réjouir d’être bientôt débarrassé du fardeau de la liberté et de la volonté, et de pouvoir bientôt s’en remettre aux machines du souci d’exister.
Christopher Lasch, dans Le Moi assiégé, ne s’aventure pas aussi loin ni sur un terrain aussi risqué : c'est moi qui parle ici. Il semble trancher le dilemme en laissant la parole aux survivants des camps eux-mêmes : « Ce sont les survivants qui voient leur expérience comme une lutte non pas pour survivre mais pour rester humains » (p.129). Rester humain ? Je pense à l'inoubliable L'espèce humaine, du grand et bien oublié Robert Antelme. Rester humain, c'est tout de même tout autre chose que survivre !
Si tel est bien le cas, quand le personnage principal du film Pasqualino (Lina Wertmüller, 1976), un petit truand minable qui survivra au camp grâce à sa débrouillardise et sa totale absence de scrupules, suscitera l’admiration des foules, Lasch semble pointer ce qui différencie radicalement l’expérience réelle rapportée par les survivants des camps, et la dérision de toute valeur dans l’exaltation d’un personnage moralement infinitésimal, voire répugnant.
Car si les foules se reconnaissent en lui, une triste perspective s’ouvre, qui en dit long sur la valeur du mot "valeur", que tant d'authentiques salopards au pouvoir ont en permanence à la bouche, alors qu'ils savent que c'est l'insignifiance et la dérision qui nous guettent.
On les comprend : eux aussi, ils veulent "survivre".
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans MES CHANSONS, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christopher lasch, le moi assiégé, survivalisme, lelouch vivre pour vivre, tavernier la vie et rien d'autre, claude lelouch, bertrand tavernier, hannah arendt, amérique, usa, états-unis, condition de l'homme moderne, juifs, camps de la mort, auschwitz, camps de concentration, adolf hitler, staline, lina wertmüller pasqualino, robert antelme l'espèce humaine, gloria gaynor, i will survive, génocide, la destruction des juifs d'europe

