mercredi, 15 janvier 2020
2020 : VIVE LA CENSURE !
2
POUR LE DROIT DE HEURTER TOUTES LES SENSIBILITÉS
La même déconvenue a touché Keira Drake, auteur américain de romans pour adolescents. Sa faute à elle ? « Dans un monde futuriste, une jeune femme se retrouvait prise au piège au milieu d’une guerre entre deux peuples ». Quand des extraits sont publiés, la furie embrase Twitter : « Raciste ! ». La description des deux peuples, trop « stéréotypée », fait de l’un des Amérindiens et de l’autre des Japonais. Finie la « belle peau bronzée », finie la « peau brun rougeâtre » : la dame accepte que son livre soit réécrit sous l’œil d’un « sensitivity reader ». Capitulation en rase campagne : elle « présente ses plus plates excuses ».
Tout ça se passe en Amérique, dira-t-on. Soit, mais les éditeurs français ont déjà pris le pli. Sigolène Vinson a écrit un livre où elle décrit un petit garçon de 12 ans, en s’efforçant de donner une existence concrète et sensible à son personnage. Le manuscrit lui revient avec dans la marge ce commentaire de l’éditrice : « Erotisation du corps d’un enfant ». Par les temps qui courent, c’est plutôt dangereux.
Résultat ? Sigolène Vinson s’arrache méthodiquement les cheveux, « parce que je n’arrive pas à me résoudre à ne lui donner que deux bras, deux jambes ». Ce qu’elle voudrait, c’est décrire « ses pieds », « sa nuque, son odeur de sel, de sueur surtout ». L'odeur corporelle. Ni une silhouette, ni un schéma, ni un stéréotype : une vraie personne qui vit et qui respire, quoi.
Alors que fait l’écrivain ? « Mais voilà, j’efface de mon roman toute trace d’un désir que je n’ai pas pour les petits garçons. Ma confiance sapée, je m’interroge sur mes autres personnages. Ai-je le droit d’en avoir un gros alors que je ne le suis pas ? Une mère alors que je ne connais rien du bonheur ou de la souffrance d’en être une ? Un vieux alors que je suis encore jeune, heureusement plus pour très longtemps ? Un Algérien alors que je ne suis que la petite fille d’un porteur de valise du FLN ? ». Elle est là, la censure ! La censure, c'est ce que dessine le même Foolz (?) (voir hier et ci-dessous).

Sigolène Vinson cite dans son article Manon Fargetton, qui écrit pour les adultes et la jeunesse : « Comment refléter le réel dans sa complexité. J’ai une vraie envie de diversité dans mes romans. J’ai envie que des lecteurs s’y retrouvent, et en même temps, j’ai toujours peur de voler l’espace d’une communauté ou d’une autre. Et s’imposer des quotas n’aurait aucun sens ».
Vous vous rendez compte : « voler l’espace d’une communauté » ! Jusqu’où ira cette dégringolade de la qualité des relations sociales et des conditions de la vie en collectivité ? Dans quelle misère vivons-nous, quand un auteur se sent coupable parce qu'il se dit, en écrivant sa littérature, qu'il est en train de "voler l'espace d'une communauté" ? Pour les quotas, je suis entièrement d'accord : c'est absurde en toute circonstances, élections comprises (vous savez, "parité" obligatoire, "visibilité" des minorités, etc.).
Quel monde, quand l’auteur d’un ouvrage d’imagination se demande s’il a le droit d’imaginer ? Quand les auteurs d’œuvres littéraires craignent par-dessus tout de déplaire à telle ou telle catégorie de la population à laquelle ils ont oublié de penser ? Quand tous les gens normaux commencent à faire dans leur tête la liste de tous les gens dont il faut se garder de heurter la sensibilité ? La liste de tous ceux qui ont l’épiderme tellement sensible qu’à la moindre allusion dont ils peuvent se froisser, ils voient leur petite personne envahie par une urticaire narcissique géante ? La liste de tous ceux qui trouvent ça si insupportable qu’ils crient à l’assassin et appellent Police-Secours ?
C’est cela que Riss, dans son éditorial, dénonce, même s’il met des guillemets, c’est cela qu’il n’ose plus proférer sans guillemets, même si ça le démange : « "couille molle, enculé, pédé, connasse, poufiasse, salope, trou du cul, pine d’huître, sac à foutre" ». Hélas, Riss lui-même semble se garder de heurter de front ces épidermes ultrasensibles qui le dégoûtent. Trop dangereux, se dit-il peut-être. Il n’a pas tort de se méfier : le Code Pénal veille, grâce à la surveillance méticuleuse des "associations" féministes et des "associations" homosexuelles.
Le vrai Charlie, le grand Charlie se foutait pas mal de « heurter les sensibilités ». Il les piétinait, les sensibilités, et joyeusement, et férocement. C'est notre époque qui a inventé ce geste ridicule censé mettre des guillemets à ce que la personne qui parle est en train de dire. Vous l'imaginez, Cavanna, vous l'imaginez, Choron, en train de plier vite fait deux doigts de chaque main pour atténuer la brutalité des mots qu'ils éructaient ?

Ça, c'est quand Sadate a rendu visite à Begin (1977), et c'est en "une". « Raciste ! », « Antisémite ! ».
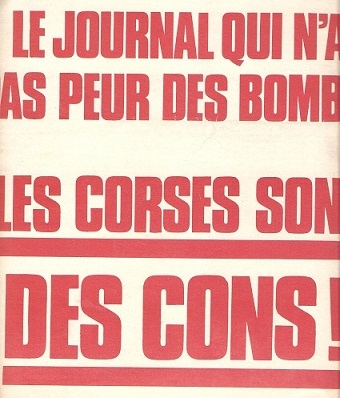
"Le journal qui n'a pas peur des bombes. Les Corses sont des cons ! " Il fallait oser, parce que ça pétait à l'époque (1975) !

Un tel dessin (Wolinski, 1978) serait-il seulement possible aujourd'hui ?
Elle est là, la liberté ! Le grand Charlie balayait d’un revers de la moustache de Cavanna les foutaises du genre : « La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres ». Quelle ineptie et quelle sottise !! Mais pauvre pomme, répliquerait Cavanna, tu ne vois pas que les gens, dans la vraie vie, n’arrêtent pas de se frotter aux autres ? De se griffer l'épiderme ? De se frictionner le pelage ? De se piétiner les godasses du matin au soir ? D’empiéter sur l’espace des autres et de voir violer leur propre espace aérien par des missiles envoyés par autrui ? De se jauger ? De s'épier ? De se juger les uns les autres ? Le quotidien, si on sort un peu de chez soi, ce n'est que heurts, cognements, attractions, répulsions, intersections, transactions, rencontres. Ce n'est rien d'autre que la vie.
La liberté d’expression est en train d’étouffer sous le poids de la sottise abyssale d’un crétinisme jaloux de ses prérogatives mortifères : le droit de chacun à vivre dans sa bulle, dans le cocon de l' « identité » sacralisée qu'il s'est tissée, sans que quiconque ose formuler le moindre propos qui effleure sa sensibilité particulière à rebrousse-poil. Le droit de chacun à vivre en chien montant une garde féroce devant son petit lopin. A vivre dans un monde où il règne, obligeant les autres à se rogner les griffes. Un monde où ils mordent quand les autres ont été contraints de se limer les dents. "Incitation à la haine en raison de ..." vous confisquera la parole.
Cavanna et Choron ? Ils passaient beaucoup de temps à se voler dans les plumes, à s'invectiver, à s'injurier, et tout ça fraternellement. Pour ça qu'ils se proclamaient « BÊTES ET MÉCHANTS ». Ils ne concevaient pas leur propre vie lisse et fluide, mais bourrée de rudesses et d'aspérités. Et bourrée de vitupérations, d'éclats de rire et d'une intense joie de vivre. Vous les imaginez, Cavanna et Choron, en éteignoirs ? En rabat-joie ? En employés des pompes funèbres ? En chœur des pleureuses ?
Dans cette exigence de "ne pas être heurté dans sa sensibilité", j'entends comme un caprice d'esthète, une commination d'Ancien Régime : « Manants, passez au large ! Du respect pour mon auguste personne, mille diables ! ». Dans cette conception fliquée de la vie en société, je vois des gens dont la vie se déroule selon des parallèles qui ne se rencontrent que provisoirement ou par l'effet d'un "clinamen" (potassez votre Lucrèce). C'est ça, une société ? Peut-être, mais c'est une société éteinte : encéphalogramme plat.

Dessin de Fournier, Charlie Hebdo n°2, 30 novembre 1970.
La liberté d’expression est en train de crever de cette folle exigence des individus d’être bien à l'abri des interpellations, épargnés par le tumulte du monde et par les avis non autorisés que les autres (tous les autres) portent sur eux, leurs opinions, leurs façons de faire et de vivre. Autrement dit d’être épargnés par la liberté d’expression des autres (tous les autres). Le projet secret de toutes ces petites communautés qui portent plainte à la moindre « atteinte à leur dignité », c’est d’abord et avant tout de faire taire les avis divergents. Plus personne n'accepte d'être jugé par ses semblables, mais tout le monde s'érige en juge de ses semblables : « J'ai tous les droits ». Comme dit André Marcueil quelque part dans Le Surmâle : « Il faut du bruit pour les faire taire ! ».
Et le Charlie Hebdo du 7 janvier 2020 a beau écrire en grosses lettres sur son plastron « Nouvelles censures … Nouvelles dictatures », ce n’est pas Charlie Hebdo qui sauvera la liberté d’expression. Tout simplement parce que Charlie Hebdo n’ose pas (n'a plus les moyens de ?) poser des noms précis sur ces « nouvelles dictatures ». Cela m’écorche la bouche de le dire, mais c’est Nicolas Sarkozy qui, quand il était président, fustigeait la « dictature des minorités ». C'était Sarkozy, mais c'est lui qui avait raison.
Il ne s'agit pas de revendiquer le "Droit au Blasphème". Qui, en dehors des musulmans, se soucie du blasphème ? Il faut proclamer bien haut le droit imprescriptible de chacun à heurter toutes les sensibilités, à commencer par celle des « associations tyranniques » et des « minorités nombrilistes » (tout le monde a compris dans quelle direction porter son regard, mais chut !). Il faut maintenant penser très sérieusement à rédiger une
DÉCLARATION DU DROIT DE HEURTER TOUTES LES SENSIBILITÉS.
Y compris celle des handicapés, des mongoliens, des pains de sucre, des présidents de la république, des pédés, des yaourts aux fruits, des ministres, des juifs, des huîtres de Cancale, des gonzesses, des musulmans, des curés, des mémés, des tickets de métro usagés, des pépés, des mourants, des immigrés, des poulets aux hormones, des noirs, des SDF, des victimes d'attentats, des affamés du tiers-monde, des blocs opératoires, des noyés de la Méditerranée ... et des ratons laveurs.
Car si je vous disais tout ce qui heurte MA sensibilité, on serait encore là à Noël. Mais ça, tout le monde s'en fout.
Voilà ce que je dis, moi.
Note : comme hier, je me refuse, par compassion, à dire quoi que ce soit du travail des dessinateurs de l'actuel Charlie Hebdo. Mais franchement, qu'est-ce que c'est laid !
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie hebdo, cabu, wolinski, bernard maris, 7 janvier 2015, riss, politiquement correct, racisme, misogynie, homophobie, reiser, cavanna, choron, féministes, homosexuels, militantisme, hara kiri, yannick haenel, ivan jablonka, #metoo, richard malka, denis robert mohicans, luce lapin, véganisme, guillaume erner, france culture, yann diener, fabrice nicolino, nous voulons des coquelicots, sigmund freud, claude allègre, gérard biard, philippe lançon, gauguin pédophile, laure daussy, sigolène vinson, frères kouachi, marion van renterghem, journal le monde, sensitivity readers, kosoko jackson, gabriel matzneff, antonio moreira antunes, new york times, réseaux sociaux, facebook, twitter, keira drake, nicolas sarkozy, droit au blasphème
mardi, 14 janvier 2020
2020 : VIVE LA CENSURE !

1
Cinq ans après la tuerie de Charlie Hebdo et l'assassinat de Cabu, Wolinski, Maris et les autres, la revue rend hommage à l'équipe décimée. Daté 7 janvier 2020 pour le symbole (le mercredi, jour normal de parution, tombait un 8), le numéro est entièrement consacré aux nouvelles formes de censure ("Nouvelles censures... Nouvelles dictatures).
Vaste programme, me suis-je dit. Contrairement à mon habitude, j'ai acheté ce n°1433 : je voulais me faire une idée un peu précise de l'idée que la rédaction actuelle de l'hebdomadaire se fait de la défense de la liberté d'expression, qui formait l'ADN de ses membres fondateurs en 1970. Cavanna, Choron, Gébé, Cabu, Reiser : vous pouviez compter sur ceux-là pour la faire entrer en action, la liberté d'expression.
Résultat des courses ? Eh bien on peut dire que les temps ont changé. L'équipe actuelle de Charlie Hebdo a la liberté d'expression en vénération, c'est sûr, mais c'est beaucoup moins un vrai et sincère choix d'existence qu'une statue en or devant laquelle il convient de se prosterner. Comme si la liberté d'expression était devenue un simple lieu de mémoire. Si je parle de "choix d'existence" c'est en pensant d'abord à Cavanna et Choron.
Oh, on ne peut pas dire que l'intention n'y est pas : « Hier, on disait merde à Dieu, à l'armée, à l'Eglise, à l'Etat. Aujourd'hui, il faut apprendre à dire merde aux associations tyranniques, aux minorités nombrilistes, aux blogueurs et blogueuses qui nous tapent sur les doigts comme des petits maîtres d'école quand au fond de la classe on ne les écoute pas et qu'on prononce des gros mots : " couille molle, enculé, pédé, connasse, poufiasse, salope, trou du cul, pine d'huître, sac à foutre". Ecrivez ces mots sur votre compte Twitter, et aussitôt 10000 petits Torquemada vous jetteront au bûcher. » Notez qu'il ne dit pas "dire merde", mais "apprendre à dire merde" : pas la même chose. Lâche-toi, Riss : à qui veux-tu dire merde ? Qui est-ce qui te tape sur les doigts quand tu dis "pédé" ? Quand tu dis "poufiasse" ?
Car c'est Riss qui s'épanche ainsi dans son "Edito". Il laisse pointer le bout de l'oreille de sa rage. Mais pourquoi faut-il que, quelques lignes plus haut, il ait commencé par chausser les pantoufles du "politiquement correct" le plus confortable ? Pourquoi faut-il qu'il enfourche le cheval de bois (cheval de retour) le plus convenu ? « Il y a trente ou quarante ans, on appelait ça le "politiquement correct", et cela consistait à combattre le racisme, la misogynie ou l'homophobie, ce qui en soi était plutôt logique et évident ». Drôle de pirouette, ou paradoxe mal assumé. Il faudrait préciser les noms exacts que recouvrent concrètement les étiquettes "associations tyranniques" ou "minorités nombrilistes" : est-ce qu'il ne viserait pas par hasard les fanatiques du féminisme, de la "cause" homosexuelle ou de la "cause" musulmane ? Misogynie et homophobie furent-ils un jour des combats "évidents" ?
Quoi qu'il en soit, il y a du mou dans la corde à nœuds. Que je sache, ni Reiser, ni Cabu, ni Cavanna, ni Choron n'ont jamais épargné les militantes féministes ou les militants homosexuels. C'est le militantisme, surtout inféodé à des "causes" et organisé comme à l'armée, qui leur sortait par les trous de nez. Riss avoue ici, bien qu'il s'en défende et que ça me fasse mal au cœur, que Charlie n'est plus dans Charlie. Je veux dire que l'esprit qui animait ceux qui ont fait Charlie (et Hara Kiri avant lui) n'est plus le cœur battant de son descendant.
Prenez le papier du petit Yannick Haenel : bon, ce qu'il dit à propos des USA et de leur obsession de sexe et de bondieuserie n'est pas faux, mais pourquoi faut-il qu'il se mette à la remorque de "la cause des femmes" et qu'il entonne ce refrain qui sert de vaseline passe-partout à quelques hommes en vue occupant certains "créneaux" (cf. Ivan Jablonka et la "nouvelle masculinité") ? « Le sexe est évidemment ce qui rend fou ce pays ; et avec lui la planète entière. Mais grâce à la libération de la parole féminine, qui est le grand événement de ce début de siècle, on se rend compte à quel point cette folie est criminelle : ce que dissimulait la censure (masculine), ce qu'elle continue à obscurcir par son mensonge (patriarcal), c'est l'existence du viol ».
Raisonnement et vocabulaire sont de la pure démagogie à base d'air du temps : se rend-il compte à quelle dictature potentielle risque de conduire le mouvement #metoo ? Et j'ignore jusqu'où Haenel est allé fouiller dans les dessous de la société française pour y trouver des traces de "patriarcat". Et puis vous imaginez, vous, Cavanna et Choron se joindre au chœur des tendances lourdes de leur temps ? Vous les voyez, Cavanna et Choron embrigadés ? Quel contresens ! Mais que vient faire ici le petit Yannick Haenel ?
L'avocat Richard Malka fait son boulot d'avocat, sans plus : il brasse. Je veux oublier ce que dit Denis Robert de cette personne peu recommandable dans son livre Mohicans. Je laisse de côté le papier de Luce Lapin, qui vient au secours de la cause du véganisme. Je rappellerai seulement à la dame que « toute chair est comme l’herbe » (Psaume 103) et que quand je mange de l’herbivore bien rouge et goûteux, je m’assimile forcément l’herbe qui l’a nourri. Je suis donc moi-même indirectement herbivore. Guillaume Erner, l'intellectuel, l’animateur, talentueux mais un tantinet "mainstream" des matins de France Culture, vasouille en déplorant que l’existence actuelle de la censure apporte la preuve par défaut de la défiance dans laquelle ses partisans actuels tiennent le langage et les pouvoirs de l’argumentation rationnelle (ce qu'il appelle "molle conviction").
Yann Diener et Fabrice Nicolino ("Nous voulons des coquelicots") dressent de brefs historiques, le premier de la façon dont les premiers traducteurs de l’œuvre de Freud ont lissé la pensée du maître en donnant de ses concepts des équivalents linguistiques castrateurs ; le second rappelle la puissance des lobbies dans la mise en doute de la vérité scientifique (tabac, amiante, réchauffement), Claude Allègre étant l’invraisemblable cerise sur le gâteau du climato-scepticisme. Le papier de Gérard Biard n'apprend pas grand-chose : je dirai qu'il ne se mouille pas trop et ne sort guère du tout-venant. Il est conforme au cahier des charges.
Bref, jusque-là, pas besoin de se relever la nuit pour aller acheter Charlie Hebdo spécial censure : au lieu de l’explosion annoncée en couverture, on a un pétard mouillé. Heureusement, Philippe Lançon me semble à la fois plus subtil et plus vrai quand, à propos de Gauguin, il s'inquiète de ce que les musées américains exposant ses œuvres les assortiront de cartels portant la mention « Pédophile ». L’emprise du « politiquement correct » aux Etats-Unis ne cesse de s’étendre et de tout contaminer.
Et encore plus heureusement, on trouve du beaucoup plus consistant dans le papier (« Littérature amputée au nom du "bien" ») de Laure Daussy, et dans l’intervention (« Et si le nouveau censeur c’était moi ») de Sigolène Vinson qui vient en quelque sorte l'illustrer. Sigolène Vinson ? Mais si, vous savez, cette fille stupéfiante qui, un certain 7 janvier, a réussi à "hypnotiser" Saïd Kouachi pour qu’il n’aperçoive pas son collègue Jean-Luc, le maquettiste, abrité sous une table. « On ne tue pas les femmes », avait crié l’assassin à son frère Chérif : trop tard pour Elsa Cayat (se reporter à l'article formidable de Marion van Renterghem dans Le Monde du 14 janvier 2015). Moi, en tout cas, je n'oublie pas le récit de cette scène d'une intensité à couper le souffle.
L’article de Laure Daussy étudie les ravages du "politiquement correct" dans le domaine de la création littéraire. Biard a bien raison de rappeler ce qu’a d’insupportable l’interdiction de fait qui empêcha les représentations en Sorbonne des Suppliantes d’Eschyle au motif que les acteurs portaient une « black face » (un masque de cuivre qui les assimilait à des noirs). On ne peut plus montrer les souffrances d'un peuple dans un spectacle si ce n'est pas ce peuple lui-même qui conçoit et réalise le dit spectacle. Daussy montre que ce genre de censure s’est désormais introduit en amont du geste même de l’écriture des livres de fiction.
L’écrivain, dans ce nouveau monde, aura un ange gardien, dont le métier sera de relire tout ce qu’il aura écrit, pour en signaler en haut lieu ce qui risque d’attirer la rogne, la hargne et la haine des « réseaux sociaux », et pour que toute aspérité soit éliminée du texte avant sa publication. J'entends par "aspérité" toute idée risquant de heurter des sensibilités quelles qu'elles soient.
Ce métier existe déjà : ce sont les « sensitivity readers » (littéralement « lecteurs de sensibilité »), des gens qui sont à l'écoute de toutes les "communautés" qui constituent de nos jour une société.
Il s’agit pour l’éditeur du livre d’éviter toute critique morale et d'effacer toute assertion comportant des risques médiatiques ou judiciaires. Pour cela, il ne faut donner prise à aucun reproche éventuel. Je me suis laissé dire que certaines grosses maisons d'éditions font appel (depuis combien ?) à des spécialistes juridiques pour réécrire les épanchements d'écrivains pour éviter les procès.
Le but à atteindre est parfaitement clair. M. Kosoko Jackson, « qui se présente comme sensitivity reader noir et queer, tweetait en mai 2018 : "Les histoires sur le mouvement des droits civiques devraient être écrites par les Noirs, les histoires sur le droit de vote devraient être écrites par les femmes, les histoires sur l’épidémie de sida devraient être écrites par des gays, est-ce que c’est difficile à comprendre ?" ». En clair : seuls des noirs peuvent parler des noirs, même chose pour les femmes, les musulmans, les homosexuels, les handicapés, etc. Comme le dessine drôlement un nommé Foolz (?), en page 11 : dans cette logique délirante, seul Gabriel Matzneff serait habilité à parler de la pédophilie.

Comment en est-on arrivé là ? Pour aller vite : la faute aux réseaux sociaux. Leur capacité de nuisance est terrifiante et absurde. Le dessinateur Antonio Moreira Antunes l’a appris à ses dépens : le New York Times a banni de ses pages tout dessin de presse depuis qu’il a représenté Donald Trump comme un aveugle portant la kippa et guidé par un chien à tête de Nétanyahou portant un collier à étoile de David. La faute aux réseaux sociaux, qui ont brandi l’accusation d’antisémitisme. Le grand journal américain a baissé la culotte devant cette arme de destruction massive. [Le contenu de ce paragraphe n'est pas pris dans l'article.]
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
Note : je me refuse, par compassion, à dire quoi que ce soit du travail des dessinateurs de l'actuel Charlie Hebdo.
09:00 Publié dans L'ETAT DU MONDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charlie hebdo, cabu, wolinski, bernard maris, 7 janvier 2015, riss, politiquement correct, racisme, misogynie, homophobie, reiser, cavanna, choron, féministes, homosexuels, militantisme, hara kiri, yannick haenel, ivan jablonka, #metoo, richard malka, denis robert mohicans, luce lapin, véganisme, guillaume erner, france culture, yann diener, fabrice nicolino, nous voulons des coquelicots, sigmund freud, claude allègre, gérard biard, philippe lançon, gauguin pédophile, laure daussy, sigolène vinson, frères kouachi, marion van renterghem, journal le monde, sensitivity readers, kosoko jackson, gabriel matzneff, antonio moreira antunes, new york times, philippe val
mercredi, 02 mai 2018
EN ATTENDANT L'EFFONDREMENT 3
24 juin 2015
3/3
 Bon, je ne vais pas refaire le bouquin. J’en viens au reproche principal : Pablo Servigne et Raphaël Stevens sont finalement des « fashion-victims » : victimes de la mode de la psychologie sociale, qui sévit apparemment plus que jamais outre-Atlantique. Ils font de la psychosociologie LA clé à ouvrir toutes les portes de toutes les serrures de toutes les sociétés modernes : tout se passe dans le crâne des gens, autrement dit : il suffit d'appliquer à la psychologie des foules quelques techniques adéquates et de savoir sur quels boutons appuyer pour amener les dites foules à agir dans le sens souhaité par quelques décideurs "éclairés". On appelle ça la propagande. Cela pourrait s'appeler avec plus de justesse : la dénégation du réel.
Bon, je ne vais pas refaire le bouquin. J’en viens au reproche principal : Pablo Servigne et Raphaël Stevens sont finalement des « fashion-victims » : victimes de la mode de la psychologie sociale, qui sévit apparemment plus que jamais outre-Atlantique. Ils font de la psychosociologie LA clé à ouvrir toutes les portes de toutes les serrures de toutes les sociétés modernes : tout se passe dans le crâne des gens, autrement dit : il suffit d'appliquer à la psychologie des foules quelques techniques adéquates et de savoir sur quels boutons appuyer pour amener les dites foules à agir dans le sens souhaité par quelques décideurs "éclairés". On appelle ça la propagande. Cela pourrait s'appeler avec plus de justesse : la dénégation du réel.
Je résume un peu brutalement les présupposés des auteurs, mais c'est à peu près à ça que revient l'ensemble de la démarche, qui repose sur le socle d'un optimisme à toute épreuve (pourtant nié par les auteurs). Je m'étonne que Paul Jorion ait manifesté tant de considération pour un tel "manuel" (sous-titre lisible en couverture : "Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes", décalque du titre de Beauvois et Joule sur la "Manipulation" : voir hier). A la question : "Que faire ? ", ils répondent : "Agir sur les mentalités". Et c'est là que je me mets à les considérer comme des foutriquets. Des olibrius. D'ailleurs, il suffit de lire pour s'en faire une idée.
Cela commence avec la quatrième de couverture, qui nous apprend en effet que le premier est ingénieur agronome et docteur en biologie. Jusque-là, tout va bien. Mais il est présenté, plus étrangement, comme un « spécialiste des questions d'effondrement, de transition, d'agroécologie et des mécanismes de l'entraide ». Disons que ça devient pour le moins "bigarré". Le second affiche plus frontalement sa bizarrerie : il « est éco-conseiller. Expert en résilience des systèmes socio-écologiques, il est cofondateur du bureau de consultance Greenloop ».
"Expert en résilience" ! "Bureau de consultance" ! Tudieu ! Mazette ! Quelles cartes de visite ! Mais ça me donne plus envie de ricaner que de me laisser impressionner : "spécialiste", "expert" et, pire encore, "consultant", Allez, vas-y, fais mousser ! Non, franchement, il y a amplement de quoi se méfier. Quand des auteurs mettent en avant autant de "spécialités" (sic) disparates, pour ne pas dire hétéroclites, ça commence à sentir le "pipeau". J'ajoute que de telles cartes de visite vous ont un furieux parfum d'Amérique, ce que confirme l'origine très largement américaine des travaux auxquels ils se réfèrent dans leurs 429 notes en fin de volume.
Et puis qu’est-ce qui leur prend, à ces "lucides", de poser pour finir la question de savoir ce que pense l’opinion publique et comment on pourrait corriger les mentalités et les façons d’agir ? Je ne fais quant à moi aucune confiance aux « petits gestes quotidiens », grand slogan de l'intimidation et de la culpabilisation de la masse des gens qui ne font que subir le mode de vie de tout un chacun, mode de vie qui ne dépend de personne en particulier, mais découle d'un système organisé. Tous les acteurs de l'économie, depuis la prospection et l'extraction jusqu'à la gestion des déchets produits, en passant par la conception, la fabrication et la distribution des objets, sont les maillons d'une seule chaîne.
Le bouquin de Beauvois et Joule (voir hier) est très instructif, mais je me méfie de la propagande et de la manipulation comme de la peste. La psychologie sociale qui nous vient des USA a trop de relents de "gestion" des foules, si vous voyez ce que je veux dire. Quitter l'examen des faits pour explorer le champ de l'opinion, est-ce bien sérieux ? Se proposent-ils de lutter contre le capitalisme en bourrant le crâne des masses ? En pratiquant la "psychologie comportementale", cette discipline à tendance totalitaire qui ne vise à rien de moins qu'adapter l'individu aux contraintes qui lui sont faites par ses conditions de vie.
L’essentiel se passe-t-il dans le monde des représentations ou dans le monde concret ? S’agit-il de modifier les façons de voir ou les façons de faire ? S'agit-il d'adapter les individus à un monde de plus en plus invivable ? On le sait, la psychologie sociale sert principalement à peser sur les représentations pour corriger les comportements (ou de préférence l'inverse, selon Beauvois et Joule, et leurs inspirateurs américains), mais seulement en direction des masses laborieuses. Et son moyen d'action est la propagande. Il serait plus intéressant de se demander comment modifier le regard des grands décideurs.
On voit bien là l’influence de redoutables gourous, dont l’ancêtre se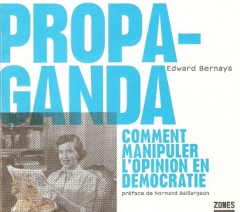 nomme Edward Bernays, le prophète du « gouvernement invisible », le double neveu de Sigmund Freud (par sa mère et par sa tante), qui est à l’origine de l'emprise actuelle de la publicité, qui est allée chercher dans le subconscient, grâce aux découvertes de la psychanalyse, les « motivations profondes » qui orientent les comportements des acheteurs de marchandises. Le cœur du bouquin de Servigne et Stevens est en définitive un éloge "de fait" de la propagande, et un appel pathétique à son intensification. Le livre de Bernays date de 1928. C'était le livre de chevet d'un certain Joseph Goebbels, ministre de la propagande sous un certain Führer nommé Adolf Hitler.
nomme Edward Bernays, le prophète du « gouvernement invisible », le double neveu de Sigmund Freud (par sa mère et par sa tante), qui est à l’origine de l'emprise actuelle de la publicité, qui est allée chercher dans le subconscient, grâce aux découvertes de la psychanalyse, les « motivations profondes » qui orientent les comportements des acheteurs de marchandises. Le cœur du bouquin de Servigne et Stevens est en définitive un éloge "de fait" de la propagande, et un appel pathétique à son intensification. Le livre de Bernays date de 1928. C'était le livre de chevet d'un certain Joseph Goebbels, ministre de la propagande sous un certain Führer nommé Adolf Hitler.
Comme si l’histoire du capitalisme se réduisait à une sorte d’histoire des mentalités. Une histoire fondée sur l'individu quintessentiel et ses croyances. C’est aussi faux que niais. L’énormité de cette façon de voir éclate dans quelques formules qui dessinent une sorte de paysage façonné par l’idéologie dominante : « Le processus de deuil traverse plusieurs étapes, selon le processus bien connu établi par Elisabeth Kübler-Ross, la psychologue américaine spécialiste du deuil … » (p. 232-233). Pour les auteurs, le deuil en question est celui qu'il faudra faire un jour prochain de la civilisation thermo-industrielle : retour à "Silex and the city" ? Prennent-ils acte, ce faisant, du caractère inéluctable de l'effondrement ? Non, ce serait trop simple.
La phrase citée ne me semble pas sérieuse : on est dans la gestion psychologique des foules (on pense à l'intervention des « cellules psychologiques » dans les collèges où a eu lieu un drame). Que je sache, le deuil n’est pas un concept scientifique, même si les psychologues s'entendent pour m'affirmer le contraire : il est d'abord un fait, qui découle d'un événement précis. Un fait aux effets imprévisibles : il y a des "veuves joyeuses". L'effondrement en cours, au contraire, est un événement diffus et insidieux : quand on voit le même paysage ou le même visage tous les jours, on a bien du mal à en percevoir la dégradation.
Comment faire son deuil d'un événement qui n'a même pas encore eu lieu ? D'un événement présenté comme possible ou probable, mais à déroulement lent, et au surplus indéfini ? Tant que les auteurs en restent au constat et à l'analyse des faits, leur démarche est d'une pertinence de marbre. La perfection dure 133 pages. Tout le reste, c'est-à-dire la plus grosse partie, qui s'attache à répondre à la question "Que Faire ?", sombre dans le ridicule et la pantalonnade. Voilà ce que ça donne, quand des intellos (en fait, "psychosociologie", c'est un grand sac d'abstractions hétéroclites) se prennent pour Superman et que l'idée leur prend de sauver le monde. Contentez-vous d'observer, de comprendre et d'analyser. Et d'expliquer ce qui se passe. Des scientifiques n'ont pas à s'efforcer de convaincre : ils ont à démontrer.
Petit florilège de la prose qu’on trouve à la fin de ce bouquin : « Le "travail" de deuil est donc à la fois collectif et personnel. Comme le soulignent les remarquables travaux de Clive Hamilton, Joanna Macy, Bill Plotkin ou Carolyn Baker, ce n’est qu’en plongeant et en partageant ces émotions que nous retrouverons le goût de l’action et un sens à nos vies. Il s’agit ni plus ni moins que d’un passage symbolique à l’âge adulte » (p. 233). L'âge adulte ? Non mais je rêve ! Ils en sont là, les auteurs ? A qui croient-ils s'adresser ? Et puis "remarquables travaux" : le lecteur est-il obligé de les croire ?
Un livre qui commence sur un ton on ne peut plus sérieux, mais qui finit sur le ton de la farce : non, messieurs Servigne et Stevens, vous n'êtes pas sérieux : vous êtes des clowns et même pas drôles. Allez, quelques drôleries quand même pour finir : « L’action constructive et si possible non-violente ne peut clairement venir qu’après avoir franchi – individuellement et collectivement – certaines étapes psychologiques » (p. 235). Vous avez noté "si possible non-violente" : on ne promet rien. Et toujours la sacro-sainte psychologie, bien sûr.
« D’abord parce qu’il est trop tard pour [faire son deuil], et ensuite, parce que l’humain ne fonctionne pas de la sorte. » « [L’action] permet dès le début de la prise de conscience de sortir d’une position d’impuissance inconfortable en apportant quotidiennement des satisfactions qui maintiennent optimistes » (p. 235). Il faut positiver, on vous dit.
Et cette perle : « Et si, tout en regardant les catastrophes les yeux dans les yeux, nous arrivions à nous raconter de belles histoires ? » (p. 217). Dans la gueule du dragon, souriez encore, vous êtes filmé.
Remarquez que celle-ci n'est pas mal non plus : « Ecrire, conter, imaginer, faire ressentir ... il y aura beaucoup de travail pour les artistes dans les années qui viennent » (p. 218). Des missions de l'art contemporain : il ne manquait plus que ça.
Et puis celle-ci : « ... car nous aurons grandement besoin de réconfort affectif et émotionnel pour traverser ces temps de troubles et d'incertitudes » (p. 236). Traduction : il est urgent de préparer les masses au pire et de les diriger vers le divan des psy, auprès desquels ils trouverons du réconfort en modifiant leur manière de voir. Besoin de consolation ? Adressez-vous à Leporello, quand il dit à Donna Elvira, au début de Don Giovanni : « Eh ! consolatevi ; non siete voi, non foste e non sarete né la prima, né l'ultima » (c'est pour introduire l' "air du catalogue" : consolez-vous, vous n'êtes ni la première, ni la dernière). Mais Stig  Dagerman a définitivement répondu : Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (Actes Sud, cf. aussi la prenante œuvre musicale de Denis Dufour (même titre), le compositeur électro-acoustique aux pieds nus). Passons sur cette tentative de recours désespéré au sein maternel.
Dagerman a définitivement répondu : Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (Actes Sud, cf. aussi la prenante œuvre musicale de Denis Dufour (même titre), le compositeur électro-acoustique aux pieds nus). Passons sur cette tentative de recours désespéré au sein maternel.
Plus américain que ça, tu meurs. Et je n'ai pas parlé de l'intuition et des émotions, indispensables ingrédients que les auteurs ajoutent à leur salade. « C’est en agissant que notre imaginaire se transforme » (p. 235). Certes ! Soit dit en passant, c’est tiré de la « théorie de l’engagement » chère à Beauvois et Joule (calquée sur des théoriciens américains), dans laquelle la « dissonance cognitive » (accomplir un geste en contradiction avec ses convictions supposées, qu'ils intitulent "soumission sans contrainte") se résout bientôt par une modification de la façon de penser pour adapter celle-ci aux actes qu'un manipulateur a obtenu que nous accomplissions. Le geste engage, paraît-il, et l'esprit, serviteur servile, apprend ce qu'il doit penser des actes qu'il a accomplis sous influence. Je rappelle que le titre de Beauvois et Joule est Petit traité de manipulation ...
C’est dans cette perspective que Servigne et Stevens nous invitent à changer radicalement notre façon de voir le monde : « … faire le deuil de notre civilisation industrielle … » (p. 238). Je vais vous dire : le problème de ce livre est double. Faisons abstraction de la première partie : il souffre 1 - d’être écrit au futur et 2 - de tomber dans la bouillasse psycho-sociale.
Le plus curieux ici est que les auteurs ont bien prévenu le lecteur au début : « Ce n’est pas non plus un livre pessimiste qui ne croit pas en l’avenir, pas plus qu’un livre "positif" qui minimise le problème en donnant des "solutions" au dernier chapitre » (p. 21). Toute la fin, malgré cette grande déclaration, est consacrée au « changement de mentalité », c'est-à-dire au "travail sur les représentations", et non pas au travail sur les faits et les choses. Autrement dit, elle tente de répondre à la question « Que faire ? ». Autrement dit, elle ne fait rien d'autre que de proposer des solutions. Autrement dit, les deux auteurs restent d'un optimisme indécrottable. Et c'est peu de dire que les solutions envisagées sont d'une niaiserie confondante, aussi aériennes que vaporeuses, pour ne pas dire nébuleuses.
Le recours à outrance à la psychologie sociale veut seulement dire que les auteurs croisent les doigts (et autres gestes magiques de conjuration du mauvais sort : pourvu que ...), et s'en remettent à l'espoir que les choses s'arrangeront toutes seules. On n'est pas loin de la pensée magique.
En réalité, le message involontaire du livre est d’un pessimisme noir, faute d’entrevoir des manières crédibles et fondées d’inverser les processus en cours. Peut-être Servigne et Stevens pensent-ils qu’un effort massif de propagande serait en mesure d’agir avec assez de force sur les mentalités pour obliger les populations à ... à quoi, au fait ? A se préparer au pire ? Tous deux votent, en masse et à l'unanimité, pour la manipulation des foules. Ils sont dans la croyance en la croyance.
Sans compter qu'on avale déjà des overdoses de propagande, je pose juste la question : qui détient le cordon de la bourse du financement de cette propagande ? Les ennemis de l’aéroport de Notre-Dame des Landes ? Soyons sérieux : sachant de quel côté se trouve le coffre aux picaillons, nous n'avons pas fini d'entendre chanter les louanges de ce "meilleur des mondes" qui est le nôtre. Et nous n'avons pas fini d'entendre le silence sur les conséquences qu'il entraîne.
Dommage que la cause environnementale soit défendue par de tels ouvrages.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : environnement, écologie, réchauffement climatique, comment tout peut s'effondrer, éditions du seuil, anthropocène, psychologie sociale, pablo servigne, raphaël stevens, ingénieur agronome, beauvois et joule, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, pape françois, nicolas hulot, edward bernays, propaganda, sigmund freud, élisabeth kübler-ross, silex and the city, jul dessinateur, bande dessinée, leporello, don giovanni, donn'elvira, stig dagerman, notre besoin de consolation est impossible à rassasier, éditions actes sud, air du catalogue, denis dufour, notre dame des landes
jeudi, 05 novembre 2015
NE PAS DERANGER

******************************************************
Hommage à René Girard, qui vient de rendre son tablier, qui a fini par se résoudre à plier ses cannes. Je n'oublierai pas le choc tectonique que fut pour moi la lecture de La Violence et le sacré, d'une érudition ébouriffante. C'était dans les années 1970. Même si on peut être agacé par la prétention de l'auteur à donner à sa théorie du désir mimétique, et sur un ton de certitude péremptoire, une dimension tellement englobante que Freud, avec toute sa psychanalyse, pouvait aller se rhabiller.
09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gaston lagaffe, andré franquin, bande dessinée, humour, spirou, littérature, anthropologie, rené girard, la violence et le sacré, mensonge romantique et vérité romanesque, des choses cachées depuis la fondation du monde, sigmund freud, psychanalyse
mardi, 13 octobre 2015
LES ÂNERIES DE TISSERON

Nous sommes en compagnie de M. Serge Tisseron, psychanalyste qui, dans les colonnes du Monde, étrille les « intellectuels » en leur reprochant de n'être plus d'aucun poids pour influer sur l'époque.
2/2
Comment le monsieur voit-il les choses ? A sa façon. Et ça vaut le coup de le citer en longueur : « Or le monde a changé. Il n’est justement plus binaire, il est devenu multiple, et fondamentalement instable. Ce ne sont plus seulement les idéologies qui se succèdent à un rythme accéléré, ce sont les situations économiques, politiques et militaires. Les idéologies suivent, s’adaptent, se métissent. Ce ne sont plus elles, et les intellectuels qui prétendent en être les garants, qui impulsent les actions. Aujourd’hui, l’extrême fragmentation des rapports de force entre entité politique ou idéologique rend impossible la délimitation d’affrontements entre des forces clairement identifiées et circonscrites ».
Si vous pouvez tirer une vision claire de ce joyeux mélange de clichés, faites-moi signe. J’apprécie particulièrement ces idéologies qui "se succèdent", "s’adaptent" et, surtout, "se métissent". Je pose la question : qu'est-ce qu'une idéologie métissée ? Et je passe sur la faute de français (« rapports de force entre entité » : quand quelque chose est "entre", ce qui suit est au moins deux, comme le montre l’occurrence suivante dans la citation), qui révèle au moins, disons ... un flou notionnel.
Il évoque ensuite les « progrès technologiques qui évoluent à une vitesse exponentielle » (Tisseron aime tant le mot "exponentiel" qu'il le répète deux paragraphes plus loin). Est-ce la numérisation de tout, l’informatisation et la robotisation galopantes qu’il a en tête ? Il faudrait alors commencer par démontrer que ce sont des progrès, ce qui n'est pas sûr du tout.
De plus, affirmer que les progrès technologiques avancent à une vitesse exponentielle est une bêtise et un abus de langage : l'apparente évolution actuelle découle de l'exploitation tous azimuts et de l'application aux domaines les plus divers d'une innovation décisive (numérisation, puis robotisation). Quant à la « vitesse exponentielle », s’agissant du monde tel qu’il va, j’ai un peu de mal à l’envisager. Je vois surtout un bolide lancé à toute allure sur l’autoroute, de nuit et dans le brouillard. Mais ça ne l’inquiète pas : il est au spectacle. Dans le brouillard ! Trop fort, Serge Tisseron !
La preuve, c’est qu’il ajoute ensuite : « L’atomisation des rapports de force et le métissage des idéologies [encore lui !] sont d’abord à considérer comme un effet des bouleversements technologiques, de leur intrication croissante, et des nouveaux paysages économiques et politiques qui en découlent ». J’ai l’impression que Tisseron est installé dans son laboratoire et que, de là, il regarde le monde comme une gigantesque éprouvette dans laquelle est en train de se faire une expérience inédite, mais passionnante. Il est impatient d’en observer le résultat, tout en avouant dans le même temps qu'il ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. A se demander s'il en pense quelque chose.
Puis il reproche à Régis Debray d’oublier dans le débat actuel une phrase qu’il a écrite, une des rares qui aient retenu sa considération : « … nous finissons toujours par avoir l’idéologie de nos technologies », et de : « … ne voir aucune idéologie de remplacement à celles que les naufrages du XX° siècle ont englouties, aucune nouvelle "religion" ne pointant son nez à l’aube du XXI° siècle ». D’abord, pour ce qui est de la religion, je ne sais pas ce qu’il lui faut : d’accord, l’islam n’est pas vraiment nouveau, mais l'élan conquérant qui l’anime actuellement est pour le coup une vraie nouveauté.
Ensuite, je dirai juste qu'en matière d'idéologie de remplacement, l'humanité actuelle est servie : que faut-il à Serge Tisseron pour qu'il ne voie pas que la course en avant effrénée de la technique est en soi un idéologie ? Je rappelle que le propre d'une idéologie se reconnaît d'abord à ce qu'elle refuse de se reconnaître comme telle, ce qui est bien le cas du discours des fanatiques de l'innovation technologique. Et les « transhumanistes » (adeptes de la fusion homme-machine) vont jusqu'à ériger cette idéologie en utopie.
Quant aux idéologies du 20ème siècle (grosso modo communisme et nazisme, ajoutées aux grandes religions monothéistes), héritières des utopies du 19ème, il omet de préciser qu’elles contenaient et proposaient de grands projets pour l’humanité. Or l’humanité actuelle semble bel et bien avoir abandonné tout effort pour élaborer un quelconque projet lui dessinant un avenir. Pas forcément un mal, vu les catastrophes qui en ont découlé dans le passé. Mais pour laisser place à quoi ? Au libre affrontement des forces en présence.
Où prendrait place un tel projet, sur une planète qui est un champ de bataille autour des ressources ; un champ de bataille qui voit s'affronter des nations prises dans une compétition généralisée, sorte de « guerre de tous contre tous » ? Quand l'heure est à la lutte pour la conquête ou pour la survie, rien d'autre ne compte que le temps présent. Le temps de l'appétit ou de l'angoisse (manger pour ne pas être mangé). Et vous n'avez pas le choix. Comme dit Jorge Luis Borges, je ne sais plus dans laquelle de ses nouvelles : « Il faut subir ce qu'on ne peut empêcher ».
La seule idéologie, la seule religion si l’on veut, qui continue à faire luire à l’horizon une lueur d’espoir dans la nuit de l’humanité, c’est précisément la foi dans les technologies : « … la génomique, la robotique, la recherche en intelligence artificielle et les nanotechnologies ». Je crois quant à moi que les adeptes de cette religion sont des fous furieux, qui ne font qu'accélérer la course à l'abîme.
Mais Tisseron se garde bien de dire ce qu’il en pense. Que pense-t-il des théoriciens du « transhumanisme » et de leurs partisans, qui s’agitent fiévreusement quelque part dans la Silicon valley, en vue de l'avènement de l'homme programmable ? On ne le saura pas : l’auteur réserve pour une autre occasion l’expression de son jugement.
« Car le monde est en train d’échapper aux intellectuels de l’ancien monde », affirme fièrement l’auteur de l’article. L’objection que je ferai à Serge Tisseron sera globale : à quel haut responsable politique, à quel grand scientifique, à quelle grande conscience morale le monde actuel n’est-il pas en train d’échapper ? Tout le monde, à commencer par les décideurs, a « perdu toute prise sur notre époque » (cf. titre). Le temps est fini des grands arrangements entre puissances. Plus personne ne sait quelle créature va sortir du chaudron magique, en fin de cuisson.
Pas besoin d’être un « intellectuel », qu’il soit de l’ancien ou du nouveau monde. Car ce qui apparaît de façon de plus en plus flagrante, c’est que plus personne n’est en mesure de comprendre le monde tel qu’il est. Le monde est en train d’échapper à tout contrôle. D’échapper à l’humanité. Ce que Serge Tisseron n’a peut-être pas très envie de regarder en face. La planète semble aujourd’hui, plus que jamais auparavant, un bateau ivre.

Le bateau ivre d'Arthur Rimbaud, vu par le grand Aristidès (Othon Frédéric Wilfried), dit Fred.
Serge Tisseron se trompe de cible. Cet intellectuel a donc perdu une bonne occasion de la boucler.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal le monde, serge tisseron, les intellectuels, rabelais, gargantua, jean-paul sartre, pierre bourdieu, michel foucault, alain finkielkraut, michel onfray crépuscule d'une idole, régis debray, éric zemmour, laurent ruquier, onpc, on n'est pas couché, sigmund freud, secrets de famille, tintin et milou, hergé, psychanalyse, jorge luis borges, transhumanistes, bande dessinée, fred philémon, arthur rimbaud
lundi, 12 octobre 2015
LES ÂNERIES DE TISSERON

1/2
Ah qu’elle est belle, la tribune signée jeudi 8 octobre dans Le Monde par Serge Tisseron. Il intervient dans le débat actuel sur « Les Intellectuels », un débat ô combien franco-français, plein de bruit et de fureur, mais qu’on pourrait à aussi bon droit regarder comme une machine à fabriquer du brouillard, ou encore qualifier de bonne séance collective de branlette cérébrale. Ces prises de becs essentiellement médiatiques (tout le monde veut se faire une place sur le devant de la scène) moulinent en général du vent, et encore : à peine un petit zéphyr. Autant le dire d’un mot : une flatulence.
Le fondement de M. Tisseron ne pouvait pas rester silencieux et, par chance, Le Monde lui a déroulé sa toile cirée pour lui permettre de participer à ce grand concours de pets, qui nous ramène aux joyeux temps des internats masculins et de cours de physique animés et odoriférants, et de joindre le bruit de ses entrailles au concert. Il se dit peut-être que le bruit de ses entrailles est béni ? Pour illustrer une fois de plus le proverbe cité par Rabelais (« A cul de foyrard toujours abunde merde », Gargantua, IX), précisons qu’à la fragrance intestinale, ce genre de débat ajoute le plus souvent une substance intellectuellement breneuse.
Il est donc question des « intellectuels ». M. Tisseron nous dit (c’est son titre) que « les intellectuels d’aujourd’hui ont perdu toute prise sur notre époque ». On se dit "Encore un qui nous joue la rengaine du bon vieux temps". N’est pas Sartre, Foucault ou Bourdieu qui veut. Pour rétorquer, on se demandera quelle prise sur l’époque eut en son temps un Sartre juché sur son fût, haranguant les ouvriers de Billancourt. Pareil pour les deux autres. Mais Tisseron pense peut-être davantage à l’envergure intellectuelle de leur œuvre qu’aux actions d’éclat qu’ils ont menées.
Les intellectuels, donc. Mais quels intellectuels ? En réalité, si « les intellectuels » se réduisent à Michel Onfray et Régis Debray, les seuls dont il cite le nom, Tisseron commet un abus de langage. D’abord il aurait pu ajouter Alain Finkielkraut (L’Identité malheureuse) et, à l’extrême rigueur, Eric Zemmour (Le Suicide français).
Ensuite, il aurait pu ajouter son propre nom : ne fait-il pas partie de la confrérie des intellectuels ? Il entre bien dans le débat, non ? A quel titre si ce n’est parce qu’il est de la même espèce ? Peut-être, en fin de compte, n’est-il qu’un vilain jaloux qui leur en veut d’être plus souvent que lui invités par Ruquier et compagnie ? Moins brillant des gencives, il fait peut-être un « client » plus fade.
Que reproche Serge Tisseron aux « intellectuels », tout au moins à ceux que quelques animateurs-vedettes invitent régulièrement à venir jouer les bateleurs sur leurs tréteaux ? La binarité de leur pensée. Il les accuse d’être de piteux pétochards : « Mon hypothèse est que l’évolution du monde leur fait craindre que leurs outils théoriques ne leur soient plus d’aucune utilité pour comprendre celui qui s’annonce ». Quelle clairvoyance ! Quelle perspicacité !
Si Michel Onfray ne comprend rien au monde actuel, Tisseron, lui, a tout compris d’Onfray. Je ne vais pas défendre le monsieur, dont le ton péremptoire et tranchant a le don de m’exaspérer. Le Niagara de ses ouvrages, à raison de trois ou quatre par an, submerge les rayons des librairies. On se demande combien de mains il possède pour écrire comme Lucky Luke tire au revolver : plus vite que son ombre. Et il se permet d’évacuer en trois coups de cuiller à pot toute l’œuvre de Sigmund Freud (Le Crépuscule d'une idole, Grasset, 2010). Je veux bien mais.
Tout ça pour dire que je ne me fie pas à Michel Onfray pour me guider dans les méandres de la pensée. Libre à Serge Tisseron de lui planter quelques banderilles dans le derrière : Onfray s’en remettra. Mais l'auteur de l'article reproche aux « intellectuels », par-dessus le marché, de voir tout en noir : « Leur point commun ? Penser que rien ne va plus. Leur programme ? Rien de bien clair encore. Leur force ? Transformer ce qui devrait être un débat d’idées en un plébiscite sur leur personne : pour ou contre, d’autres diraient : "j’aime" ou "je n’aime pas" ». Pour ma part, je demanderais volontiers à Tisseron de m’indiquer ce qui, aujourd’hui, va bien.
Si, quelque chose continue à aller bien : la choucroute exquise de la semaine passée. Ou alors le quatuor op. 132 en ut mineur, du grand Ludwig van B. par le Quartetto italiano. Quoi d’autre ? What else ?
Voilà ce que je dis, moi.
Note : j’ai omis de préciser que Serge Tisseron est psychanalyste, et que le haut fait de guerre qui l’a fait connaître est d’avoir mis au jour un secret enfoui dans la famille d’Hergé, rien qu’en lisant les aventures de Tintin et Milou.
09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal le monde, serge tisseron, les intellectuels, rabelais, gargantua, jean-paul sartre, pierre bourdieu, michel foucault, alain finkielkraut, michel onfray crépuscule d'une idole, régis debray, éric zemmour, laurent ruquier, onpc, on n'est pas couché, sigmund freud, secrets de famille, tintin et milou, hergé
vendredi, 15 mai 2015
IL Y A DU TOTALITAIRE ...
... DANS LA STATISTIQUE
1/2
A quoi servent les statistiques ? Est-ce seulement ce merveilleux outil de connaissance, qui permet de mettre en lumière des aspects de la réalité inaccessibles à la simple perception individuelle ? Faits sociaux, situations politiques, données économiques, recherches scientifiques, les statistiques font partie intégrante de notre monde, dans tous les domaines qui concernent (de très près ou de très loin) notre vie quotidienne.
Non, elles ne sont pas seulement un outil de connaissance : elles sont aussi un outil de gouvernement. Un outil qui peut se révéler terrible à l'usage. Il en est d'ailleurs ainsi pour les sciences humaines : inutile sans doute de s'appesantir sur l'utilisation des avancées dans la connaissance du psychisme humain par la publicité, par la propagande et par toutes les techniques de manipulation mentale. Vous vous rendez compte : sans Sigmund Freud, pas de Scientologie. Pas d'agressions Coca-Cola par panneaux 4 m. x 3. Pas de surréalisme. « Que la vie serait belle en toute circonstance Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards » (Tonton Georges a toujours raison).
Les statistiques sont donc entrées dans les mœurs. Il faudrait même dire : « Dans les têtes », tant chacun a désormais intériorisé la notion abstraite de « catégorie de la population », dans laquelle, à force de bourrage de crâne, il tend aujourd’hui à se ranger spontanément, sans qu’un seul flic lui en ait seulement intimé l’ordre.
Qu’il le veuille ou non, chacun a désormais une connaissance statistique de lui-même. Chacun est prié de s'éprouver non plus à partir de ses confrontations concrètes à des réalités contondantes ou suaves, mais par le médium infaillible des chiffres élaborés par des experts dont la science le dépasse de trop loin. Chacun est prié d'acquérir une connaissance objective de lui-même. Les statistiques portent le négationnisme de la subjectivité. C'est en cela qu'elles sont porteuses du germe totalitaire.
Chaque jour, journalistes, économistes, politiciens, « experts » et « spécialistes » produisent à qui mieux-mieux, à destination de tous les individus, l’inépuisable spectacle des statistiques dans le fatras desquelles tous ces "sachants" leur intiment l’ordre de trouver leur place. Les statistiques sont la nouvelle figure de la « collectivité », de la « société ». Si ça se trouve, vous appartenez à des catégories dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. On vous définit sans vous demander votre avis. On vous assigne une identité dont vous n'avez nulle idée.
La statistique est par nature l’action de compartimenter les comportements humains en les rangeant successivement dans toutes sortes de cases soigneusement étiquetées en un nombre incalculable de catégories abstraites. La statistique a quelque chose à voir avec la dissection : il s’agit de segmenter un corps pour en étudier de plus près chacun des segments.
Evidemment, comme dans toute dissection, on n’étudie valablement que quelque chose qui fut vivant, mais qui ne l’est plus. Sinon, ça s’appelle un supplice. Premier effet des statistiques : elles font de populations de chair, d’os et d’existences concrètes des abstractions pures et simples. Autrement dit, une population statistique est une humanité chiffrée, comme l’énonce clairement le titre d’Alain Supiot, sur le blog de Paul Jorion : La Gouvernance par les nombres. L’humanité accède enfin à l’existence numérique, seule collectivité sociale aux yeux du statisticien.
Définitions : « 1 – Etude méthodique des faits sociaux, par des procédés numériques (classements, dénombrements, inventaires chiffrés, recensements, tableaux …). 2 – Ensemble de techniques d’interprétation mathématique appliquées à des phénomènes pour lesquels une étude exhaustive de tous les facteurs est impossible, à cause de leur grand nombre ou de leur complexité ».
Historique : « Statistique : n. f. et adj. est un emprunt (1771 selon F. e. w.) au latin moderne statisticus "relatif à l’Etat" (1672), formé à partir de l’italien "statistica" (1663), dérivé de "statista" (homme d’Etat), lui-même de "stato", du latin classique "status" ».
La statistique établit donc des catégories. Ça a des aspects éventuellement rigolos : on peut être « contribuable » et « automobiliste », « électeur » et « pêcheur à la ligne » (on peut s'amuser longtemps à juxtaposer les carpes et les lapins) ; on est rangé par sexe, par appartenance professionnelle, par âge, par situation géographique, que sais-je. On n’en finirait pas. Ce sont les « critères ». Le résultat de tout ça, c’est qu’on a fini par réaliser ce que Voltaire dit de l’homme vu par Micromégas : un amas d’atomes. Voilà, la statistique atomise l’humanité : vous appartenez sans le savoir à mille huit cent quatre-vingt-douze catégories de la population suivant le critère qui est retenu contre vous.
Première fonction selon moi de la statistique : quantifier à l'infini en subdivisant à l'infini. Etablir des nombres. La statistique instaure le règne des comptables sur le corps social et réduit la vie sociale à une gestion bureaucratique. Elle établit une dichotomie rigoureuse entre sujet et objet, étant entendu que, pour le statisticien, personne n'est une personne, vu qu'il n'y a que des objets.
Elle vous apprend qu’au 1er janvier 2015, la France comptait 32.126.316 hommes et 34.191.678 femmes. Soit dit en passant, on voit que la statistique établit clairement que la génétique se moque éperdument de la parité entre les sexes et de l'égalité hommes-femmes.
On en pense ce qu'on veut.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : totalitaire, totalitarisme, statistique, sciences humaines, publicité, propagande, manipulation mentale, journalisme, presse, politique, société, paul jorion, alain supiot, la gouvernance par les nombres, voltaire, micromégas, recenssement, georges brassens, sigmund freud, psychanalyse, scientologie, coca-cola, surréalisme
samedi, 07 décembre 2013
UN CAS D'ARROGANCE SOCIALE
La police de la pensée produit nécessairement la police de la parole. Le mot d’ordre ? « Il faut punir. » Ce ne sont pas les infractions à la « bonne pensée » ou à la « bonne parole » qui manquent. Tous ceux qui veillent à faire advenir le « meilleur des mondes », tous ceux qui rêvent d’un « Big Brother », d’un « Grand Frère » pour traquer les fautifs, tous vous le diront. Qui sont-ils, ces « purs » ? Tous ceux qui croient qu’on peut, et donc qu’on doit créer « l’homme nouveau », tous ceux qui veulent éliminer le Mal de la surface de la Terre.
Mais qu’est-ce que c’est, le Mal ? Ah, alors là, ça dépend. Prenez la prostitution. Il paraît que c’est très mal de se prostituer. Du moins le dit-on. Personnellement je n’en sais rien. Les avis divergent, c’est le moins qu’on puisse dire. Certains se dressent sur leurs ergots (de seigle ?) au motif que la traite des humains est un scandale révoltant. Ils ont bien raison. D’autres soutiennent que c’est un métier comme les autres, et qu’on n’a pas le droit d’empêcher ceux et celles qui le pratiquent volontairement de le faire. Ils ont bien raison.

C'EST GRÂCE À L'ERGOT DE SEIGLE QU'ON PEUT PRODUIRE L'ACIDE D-LYSERGIQUE, ALIAS L.S.D.
J’ai dernièrement entendu Françoise Sivignon (médecin, vice-présidente de Médecins du Monde) et Catherine Deschamps (sociologue, anthropologue) déclarer qu’avant de faire voter une loi punissant les clients, les députés auraient pu (donc dû) demander aux putes, maquées ou non, ce qu’elles en pensent. Elles ont bien raison. Et c’est bien le problème : comme souvent dans un débat, tout le monde a raison. Tout dépend juste du point de vue auquel on se place.
Alors, victimes ou pas victimes ? C’est clair pour les filles de l’Est de l’Europe, prises par des réseaux criminels, des mafias qui appliquent au commerce de la chair les règles du capitalisme le plus débridé : « investissement minimum, rentabilité maximum », au besoin en usant de la force. Réprimer un commerce aussi répugnant est légitime. Celles-ci sont bien des victimes.
Mais demandez à cette étudiante timide interviewée dans Le Monde du 6 décembre ce qu’elle en pense. Pour vendre à qui en veut ses services sexuels, elle n’a demandé l’autorisation de personne. Elle qui ne suce pas, au motif qu’elle a besoin pour ça d’être amoureuse, elle veut juste améliorer l’ordinaire. Une fois par mois en général. A 300 euros l’heure de sexe. « Ça met du beurre dans les épinards », comme elle dit elle-même. Dans ce débat, elle ne porte pas de drapeau « pour » ou d’étendard « contre ». Elle fait la pute, c’est tout, plus ou moins poussée par la nécessité. Enfin, la nécessité … Peut-être après tout y trouve-t-elle autre chose ? Elle se fait appeler Laura.
Face à ce dilemme (réprimer le crime sans porter atteinte à la liberté individuelle), ce qui m’étonne par-dessus tout, c’est qu’il se trouve des responsables politiques pour agiter le Code Pénal au-dessus du client pour éliminer le problème du paysage. Du moins le croient-ils. J’ai du mal à penser qu’ils se disent qu’ils vont débarrasser l’humanité de toutes les pensées lubriques et de tous les délires sexuels qui y sévissent depuis des milliers d’années.
Je n’arrive pas à croire que des gens apparemment sains d’esprit puissent sérieusement se considérer comme des chevaliers blancs en lutte contre « le Mal ». J’aurais plutôt tendance à rapprocher leur fantasme de l’hystérie d’un George W. Bush, partant en « croisade » contre « l’Axe du Mal ». Comme le chante Bob Dylan : « With guns in their hands And God on their side ».
Je n’arrive pas à m’expliquer ce que le grand Philippe Muray appelait « l’envie de punir » (Freud parlait de « l’envie de pénis » des petites filles). Qu’on puisse jouir de punir, je sais que c’est possible : j’ai des lectures. Cela n’empêche pas que ça me reste inexplicable. Ici, le recours à la pénalisation du client me semble singulièrement absurde.
Car ce faisant, le politique avoue son impuissance : impossible de faire disparaître le marché du sexe. Et puisqu’il renonce à punir la prostituée (bien sûr, elle est une victime), sans renoncer à punir le proxénétisme, il attaque le client. Pour résumer : la vente est autorisée, mais l’achat est interdit. Pour s’amuser, on peut imaginer ce que ça donnerait, un supermarché qui mettrait l’équation en pratique. C’est ce qu’on appelle une « injonction paradoxale » (du genre « soyez libres ! » ou « Indignez-vous ! »). A la rigueur un « double bind » (en anglais) ou « double impératif contradictoire » (en français).
Non, le plus insupportable dans cette affaire, c’est le recours policier à l’argument moral. Quel invraisemblable curé sommeille en madame Najat Vallaud-Belkacem ? Enfin, quand je dis « curé », c’est peut-être « flic » qu’il faudrait dire. Et ce qui me fait assez peur, dans la société qui vient, c’est de voir se lever des foules de curés sans religion et de flics sans uniformes, qui prennent sous leur bonnet de régenter la vie des autres. Régenter la vie des autres ! A-t-on idée !
Tous ces flics et curés d’un nouveau genre s’arrogent le droit de faire régner leur ordre répressif sur la collectivité tout entière. Et qu’ils ne se drapent pas dans la « noblesse » de leurs motivations. A force de resserrer le nœud de la loi autour du cou des désirs individuels, même et surtout mauvais, ils dessinent une société calquée sur l’ordre militaire. Ce ne sera plus une population. Ce sera un régiment.
Et en plus, ça n'empêchera jamais le Mal, inhérent à l'humain, de sévir.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bob dylan, robert zimmerman, george w. bush, police de la pensée, police de la parole, big brother, société policière, ergot de seigle, lsd, prostitution, pute, code pénal, françoise sivignon, médecins du monde, catherine deschamps, chambre des députés, capitalisme, journal le monde, philippe muray, sigmund freud, najat vallaud-belkacem, société
mardi, 23 avril 2013
QUE FAIRE AVEC LE MAL ? (4)

UN QUI L'A OUVERTE, SA GUEULE
(DESSIN DU REGRETTÉ PIERRE FOURNIER)
***
Je disais donc du bien de La Violence et le sacré, grand livre de René Girard, et je laissais entendre qu’ensuite, ça se gâtait. Mais on peut déjà faire un reproche à l’auteur, à propos de son maître-livre, c’est de ne pas se prendre pour un flacon d'urine éventée. Franco de port, il ne vous l’envoie pas dire : sa théorie du désir mimétique et de la victime émissaire est tout simplement "révolutionnaire". Elle envoie à la poubelle, en même temps qu’aux oubliettes, toute la psychanalyse de Papa Freud.
Mieux : elle l’englobe ! Pour vous dire la supériorité de son « pouvoir heuristique », comme on dit à l’université, pour dire qu’une théorie parvient à expliquer d'un seul jet homogène un ensemble de phénomènes éparpillés, que l’état précédent des connaissances ne permettait d’aborder qu’en ordre dispersé.
Remarquez que j’avais demandé (c’était entre deux portes, il est vrai) au père Denis Vasse, psychanalyste renommé, ce qu’il pensait des travaux de René Girard. Il m’avait regardé, puis m’avait répondu (je cite de vieille mémoire et en substance) : « Mais c’est qu’il ne s’occupe de rien de ce que nous faisons ». Circulez, y a rien à voir ! Un partout la balle au centre.
J’aurais quant à moi tendance à me méfier davantage de Girard que de la psychanalyse, et pour une raison précise : avec, et surtout après la publication de Des Choses cachées depuis la fondation du monde, il a viré au militant chrétien. Je précise que Denis Vasse était prêtre jésuite, mais n'a jamais confondu sa foi avec les choses de la science. Je n'en dirai pas autant de Girard. Chacun fait ce qu’il veut, mais quand on est militant, cela jette un drôle de jour sur l’objectivité des savoirs établis à l’université, qui sont davantage faits pour enrôler les adeptes d’une croyance que pour former des esprits à la méthode scientifique.
Je ne prendrai comme exemple que Judith Butler, militante avouée de la cause lesbienne, avec sa théorie du « genre ». Soit dit par parenthèse, on peut s’étonner que les affirmations qui forment le socle du « genrisme », et qui enfoncent les vieilles portes ouvertes du vieux débat « nature / culture », aient contaminé aussi facilement autant de soi-disant bons esprits, dotés d'un soi-disant bon sens, lui-même soi-disant rassis.
On s’étonne moins quand on voit que la théorie du genre sert de drapeau à tous les militants de la « cause » homosexuelle : nulle objectivité là-dedans, mais une arme, et une arme aux effets dévastateurs, car son champ d’action est le langage lui-même, le sens des mots et la façon dont ils désignent les choses. Les adeptes, ici, obéissent au raisonnement : « Puisqu'on ne peut pas tordre les choses, commençons par tordre les mots ». Et on peut dire qu'ils ont réussi, au-delà de toutes leurs espérances, à les tordre, les mots. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui, au nom de l' « ÉGALITÉ » !
Revenons à René Girard et à Des Choses cachées …. En dehors des salades que l’auteur commence à débiter sur la supériorité du christianisme, je garde de la lecture de ce gros bouquin le souvenir d’une idée qui me semble encore étonnante de pertinence : à observer les bases du christianisme à travers une grille de lecture « sacrificielle » (le rite religieux conçu et mis en œuvre pour expulser d’une communauté humaine la violence accumulée, dangereuse pour sa survie, en la déviant sur un seul individu), Jésus Christ apporte une innovation radicale.
Si j’ai bien tout compris, la mort du Christ sur la croix est le premier sacrifice raté, le premier sacrifice qui échoue à rétablir la paix dans la communauté dont il devait raffermir la cohésion. En tant que sacrifice humain comparé à tout ce qui s’est pratiqué et se pratique dans les sociétés, primitives ou non, la mort du Christ est un ratage complet. Le dernier des sacrifices humains, si l’on veut, du fait qu’il est le premier sacrifice inefficace. Et en même temps, il s’avère comme façon radicalement nouvelle d’envisager le Mal.
Un ratage, pour la raison très simple que la victime est reconnue et déclarée innocente, alors que la « bonne » victime est celle sur la tête de laquelle s’est concentré tout le Mal accumulé, et dont toute la communauté doit pouvoir dire qu’il était juste de la tuer, au motif qu’elle était coupable.
Le message du Christ, de ce point de vue, est clair : s’en prendre à un individu innocent, et croire ainsi expulser hors de soi le Mal, c’est commettre une injustice, voire un crime. Ce n’est pas parce que vous tuez un homme (choisi ou non au hasard) que vous chassez le Mal de la communauté. A cet égard, je suis bien obligé de reconnaître que la base du christianisme constitue une avancée décisive sur ce qu’on appelle la « mentalité primitive ». Le Christ est le premier à dire que le Mal est au-dedans de chacun, et que pour le rejeter au-dehors, il faut s’y prendre autrement.
On dira ce qu’on veut, mais c’est un vrai Progrès.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la gueule ouverte, pierre fournier, écologie, rené girard, la violence et le sacré, des choses cachées depuis la fondation du monde, psychanalyse, denis vasse, sigmund freud, judith butler, lesbienne, théorie du genre, jésus christ, christianisme, bouc émissaire
samedi, 02 mars 2013
VOLUME TROIS : CANETTI ET LE MONDE

JOHN DOOGS, DIT "L'INDESCRIPTIBLE"
***
Dans les trois volumes d’Histoire d’une vie, d’Elias Canetti, apparaît en de multiples occasions un trait de caractère que je trouve central. Quand commencent les premiers heurts avec sa mère, qui tempête contre ses goûts littéraires et artistiques, qu’elle juge trop peu virils, on le voit poindre, ce trait de caractère : un rocher qui reçoit, les unes après les autres, les déferlantes de la mer déchaînée. Du moins est-ce l’impression que ça m’a donnée.
La mère est évidemment un personnage trop particulier pour servir de preuve. On dirait qu’il attend que ça passe, mais sans jamais rien concéder de ce qui lui importe. En une seule occasion, il se laisse aller à lui raconter des bobards. Elle vit à Paris avec ses deux autres fils, Georg et Nissim, devenu Jacques, celui-là même qui, plus tard allait faire la pluie et le beau temps dans la chanson parisienne. Canetti vit à Vienne. La femme de sa vie est Veza. Sa mère le sait, et ça lui ronge les sangs de jalousie : elle ne supporte pas l’idée que son fils puisse être sous l’emprise d’une autre femme qu’elle-même.
Alors Elias, pour avoir la paix à cet égard au moins, invente non pas une mais deux femmes, entre lesquelles son cœur balance. Il brode à l’infini des circonstances et des anecdotes qui sont autant de rideaux de fumée dressés entre sa mère et son amour. Car il redoute par-dessus tout que sa mère, en cas de rencontre avec Veza, ne lui détruise beaucoup de choses qui lui sont essentielles, voire vitales. Son frère Georg, dont il est le plus proche par l’âge, y croit tellement qu’il reproche à Elias d’avoir indignement laissé tomber Veza. Elias ne le détrompe pas.
Ce qui caractérise Elias Canetti, c’est la connaissance aiguë de ce qu’il est, doublée de la volonté indomptable de faire ce qu’il a décidé de faire. Certes, il les a bien achevées, ses études de chimie, elles donnent même lieu à quelques scènes croustillantes, quand il travaille au laboratoire. Donner quatre ans de sa vie pour donner le change, il faut quand même le faire. Mais ce fils avait le sens de l’obéissance à l’autorité : quand sa mère lui avait, tout jeune, interdit de lire Strindberg, dont les livres jaunes étaient empilés sur la table, l’idée d’en ouvrir un ne lui serait pas venue à l’esprit.
Ce que je voulais dire, avec l’image du rocher, c’est que même face à des gens qu’il respecte, admire ou aime, il ne cède rien de ce qu’il est ou croit. Il a de longues confrontations verbales avec Veza, la bien aimée qui sait lui résister, et même faire jeu égal avec lui dans des conversations de haute tenue. Ce sont deux existences solides qui se font face. Il ne lui cache rien de l’écriture de son roman. Elle le critique. Il n’en a cure et va son chemin. Mais elle aussi est solide comme un roc.
Mais si Veza deviendra sa femme, il croise bien d’autres grandes personnalités du Vienne des années 1930, à commencer par Hermann Broch, qui a écrit un premier chef d’œuvre avec Les Somnambules, et qui est en train de mijoter La Mort de Virgile, autre chef d’œuvre, dont la lecture laisse confondu de respect. Robert Musil, l’auteur de l’énorme (à tous les points de vue) L’Homme sans qualités, est une autre de ces personnalités marquantes.
Il se trouve que j’ai la chance d’avoir lu ces œuvres avant celle de Canetti, et qu’en lisant ce dernier, ces divers univers littéraires sont entrés dans une singulière résonance. Musil est un homme étrange, très sobre dans l’expression de ses sentiments à l’égard des personnes. Il marque une sympathie à Canetti après avoir assisté à une lecture (par les soins de l’auteur) de son manuscrit dans un salon viennois.
Musil est un homme étrange, très sobre dans l’expression de ses sentiments à l’égard des personnes. Il marque une sympathie à Canetti après avoir assisté à une lecture (par les soins de l’auteur) de son manuscrit dans un salon viennois.
Malheureusement, le jour où cette sympathie doit se renforcer, Elias commet l’impair impardonnable de citer à Musil la longue lettre que vient de lui envoyer Thomas Mann (que celui-ci déteste sans doute, comme il déteste James Joyce), à qui il a envoyé son livre enfin publié. Musil lui donne à peine la main, pour s’éloigner de lui à tout jamais.
 Hermann Broch n’est pas n’importe qui non plus, et Canetti a lu Les Somnambules, qui vient de paraître (1931). Lui n’a rien publié. Il respecte le livre, mais il respecte encore plus la démarche qu’un tel ouvrage suppose de la part de l’homme qui l’a écrit, en particulier la dernière partie (1918. Huguenau ou le réalisme), assez directement inspirée des techniques d’écriture de James Joyce dans Ulysse (que j’ai lu en 2009).
Hermann Broch n’est pas n’importe qui non plus, et Canetti a lu Les Somnambules, qui vient de paraître (1931). Lui n’a rien publié. Il respecte le livre, mais il respecte encore plus la démarche qu’un tel ouvrage suppose de la part de l’homme qui l’a écrit, en particulier la dernière partie (1918. Huguenau ou le réalisme), assez directement inspirée des techniques d’écriture de James Joyce dans Ulysse (que j’ai lu en 2009).
Plusieurs choses importantes séparent Broch et Canetti sur le plan intellectuel, à commencer par la psychanalyse, dont Broch est un adepte, alors que Canetti la rejette formellement (il a été très déçu par la lecture de Psychologie des masses de Sigmund Freud qui, selon lui, n’explique pas grand-chose).
Ces différences ne les empêchent pas de se tenir en haute estime mutuelle et d’avoir des conversations de haute altitude, dont il livre un exemple fascinant en cours de route. Ici revient la même image du rocher, encore que celui-ci soit double : deux rocs d’égale compacité échangent leurs vues au sujet de quelques petites choses : l’humanité, l’art, la littérature, … On a l’impression qu’ils ont non seulement tout lu, mais qu’ils ont tiré de leurs lectures une façon de penser le monde, une morale, une esthétique. Imaginez deux rochers en conversation.
Je ne voudrais pas que ces notes s’allongent démesurément. Je n'ai pas parlé d'autres rencontres, qui donnent lieu à des portraits très forts : le sculpteur Wotruba, le terrible chef d'orchestre Hermann Scherchen, le compositeur Alban Berg, le peintre Merkel (avec au front le troisième oeil de sa blessure de guerre).
Je n'ai rien dit du bain de vitriol dans lequel il plonge Alma, la veuve de Gustav Mahler, qui prétend faire la pluie et le beau temps dans le bocal culturel viennois. Ni de sa fille Anna, sculpteur élève de Wotruba, avec qui il a une très brève histoire d'amour mais qui lui gardera de l'amitié. Ni de sa fille Manon Gropius à la vie et à l'enterrement déchirants. Ni de l'insupportable Werfel, l'écrivain arrogant parce qu'il est le protégé (l'amant?) d'Alma.
Je n'ai rien dit de tant de choses. Tiens, quand il est à Zurich, le vieux qui promène son saint-bernard : « Dchoddo ! Viens chez papa ! ». Eh bien, le chien s'appelle Giotto, et le monsieur Ferruccio Busoni en personne.
Je me suis restreint à quelques points, peut-être même pas tous ceux qui ont le plus retenu mon attention en lisant : la sélection présente est d’une lamentable pauvreté, et ne saurait rendre compte du foisonnement bourgeonnant qu’on découvre dans cette œuvre importante. J’envie ceux qui ont encore à la découvrir.
Monsieur Canetti, merci pour tout. Humble respect.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, monstres, freaks, littérature, élias canetti, vienne, histoire d'une vie, hermann broch, les somnambules, la mort de virgile, robert musil, l'homme sans qualités, thomas mann, james joyce, ulysse, sigmund freud, psychologie des masses, wotruba, hermann scherchen, alban berg, gustav mahler, alma mahler
lundi, 10 décembre 2012
EDWARD BERNAYS, HERAUT, ZERO OU HEROS ?
Pensée du jour :

PHOTOGRAPHIE DE GUILLAUME HERBAUT, ENVIRONS DE TCHERNOBYL
« "Il y a beaucoup de choses dans le grand chosier", écrit Littré au mot "chosier", qui n'a jamais été employé qu'une fois dans la littérature française. Précisément dans cette expression-là. Par Rabelais, si j'ai bonne mémoire. Et Littré reste vague dans sa définition. Mais il n'a pas besoin d'être précis. Tout le monde comprend que dans le grand chosier il ne saurait y avoir que beaucoup de choses ».
ALEXANDRE VIALATTE
NB : la mémoire de VIALATTE (cf. Antiquité du grand chosier, éditions Julliard, tiens, à ce propos, coucou, J.) lui joue des tours, voici "in extenso" la notice de LITTRÉ : « chosier, s.m. Usité seulement dans cette locution proverbiale : va, va, quand tu seras grand, tu verras qu'il y a bien des choses dans un chosier. Cela se dit pour indiquer à un enfant et même à une grande personne qu'il y a bien des choses dont on ne peut rendre compte ».
Comme disait ma grand-mère, un peu de culture éloigne de l'absolu, beaucoup de culture en rapproche.
***
Résumé : je demandais ce qui faisait d’EDWARD BERNAYS (mort à 103 ans !!), le roi de la manipulation des foules et de l’opinion publique, un génie révolutionnaire du 20èmesiècle. Son rôle est loin d’être négligeable dans l’avènement du culte de la marchandise, promue au rang d’unique idole devant laquelle l’humanité est appelée à se prosterner.

Ben voilà : il a pioché dans deux univers radicalement différents pour élaborer une théorie radicalement nouvelle. D’un côté, les analyses de GUSTAVE LE BON sur la psychologie des foules (soit dit en passant, cet homme mériterait aussi qu’on s’intéresse à lui). De l’autre, les motivations inconscientes qui font agir les individus, mises au jour par le tonton SIGMUND FREUD de BERNAYS, avec la psychanalyse.
Pour EDWARD BERNAYS, ce qui meut une foule n’a rien à voir avec ce qui peut mouvoir un individu, et d’autre part et surtout, en aucune manière, ce qui meut la foule n’est lié à ce qu’il y a en elle de rationnel, mais dépend du « ÇA ». Dans la théorie de FREUD, le « ça » est la partie la plus enfouie de l’individu, et partant la moins contrôlée par le « moi » et le « surmoi ».
Sans entrer dans les détails, comparons simplement le « ça » à une sorte de réservoir de pulsions et de motivations secrètes, méconnues de l'individu, qui n’attendent qu’un déclic pour se manifester. Ce qui fait bouger une foule, selon BERNAYS, est situé au-dessous du seuil de la conscience. FREUD appelait ça le « subconscient ».
Aujourd’hui, les agences de publicité maîtrisent parfaitement la chose et ont élaboré en conséquence des questionnaires susceptibles de renouveler le répertoire des arguments et des images susceptibles de déclencher l’acte d’achat en allant fouiller dans les motivations secrètes que les gens portent dans leur tête, sans le savoir. Cela porte le nom d’ « enquête de motivations ».

C'EST SÛR, CET EXEMPLAIRE A BEAUCOUP VECU (année de publication) !
L’excellent GEORGES PEREC les nomme (on est en 1965, dans Les Choses, prix Renaudot, me semble-t-il) « études de motivations ». Dans ce bouquin mémorable, Jérôme et Sylvie participent à l’installation balbutiante dans le paysage social de ces lointains ancêtres des sinistres et obsédants SONDAGES (qui a tiré de son chapeau que 61 % de Français sont favorables au mariage homosexuel ? L'IFOP de madame LAURENCE PARISOT).

IL FUMAIT BEAUCOUP TROP. IL EN EST MORT.
Mais à l’époque de BERNAYS (il publie Propaganda en 1928), comme je l’ai dit précédemment, la publicité balbutiait, se contentant de vanter les mérites pratiques, la fonctionnalité et l’adéquation du produit à l’usage auquel il était destiné. Elle parlait au côté rationnel des gens. Elle avait un côté terriblement objectif. Autrement dit : dépassé.
C’est en cela que le travail de BERNAYS est révolutionnaire : il a répondu à la grave question que tous les gouvernements du monde se posent : « Comment amener des masses de gens à se comporter comme le voudraient les dirigeants, sans transformer la société en caserne militaire ? ».
Son idée principale consiste à se fixer comme objectif de vendre à des masses de gens des masses de produits AVANT que les produits précédents aient cessé de fonctionner. Tiens c’est drôle : l’idée est à peu près contemporaine de l’invention du concept d’ « obsolescence programmée ». Comme dit quelqu’un : EDWARD BERNAYS a fait beaucoup pour que l’Amérique passe d’une « économie du besoin » à une « économie du désir ». Comme c’est bien dit.
Et pour donner envie aux gens d’acheter des choses dont ils n’ont aucun besoin (sinon dans un futur bien vague), il faut aller chercher en eux la source de leur envie. C’est ainsi que, selon GEORGES PEREC, toujours dans Les Choses, toujours en 1965, Jérôme et Sylvie sont déjà atteints de la maladie du désir, qui a désormais cancérisé la planète : « Dans le monde qui était le leur, il était presque de règle de désirer toujours plus qu’on ne pouvait acquérir ». Ah ! La maladie du désir ! Plus grave que la "maladie d'amour" que chante le désolant MICHEL SARDOU.

Jérôme et Sylvie ont été contaminés (peut-être) par leur activité professionnelle. Il faut dire qu’ils passent leurs journées à poser des questions à des foules de gens : « Pourquoi les aspirateurs-balais se vendent-ils si mal ? Que pense-t-on, dans les milieux de modeste extraction, de la chicorée ? Aime-t-on la purée toute faite, et pourquoi ? Parce qu’elle est légère ? Parce qu’elle est onctueuse ? Parce qu’elle est si facile à faire : un geste et hop ? (…) ». La liste figure pages 29-30 (dans mon exemplaire, imprimé en 1965 !). Avouez qu’il y a de quoi se laisser gangrener.

LE BOULOT DE JERÔME ET SYLVIE
GEORGES PEREC ADORE LA LISTE, L'ENUMERATION, L'ACCUMULATION, ... LA PARATAXE, QUOI
La maladie de tous les désirs qu’on n’a pas eu le temps de désirer. Voilà le monde qui nous a faits. Voilà le monde qui nous habite. Qui occupe indûment notre territoire intérieur, que nous le voulions ou non. Et nous en devons une bonne part au sinistre EDWARD BERNAYS.
Accessoirement, l'efficacité pratique des campagnes de propagande menées par EDWARD BERNAYS prouve l'effroyable justesse de sa théorie, exposée dès 1928 dans Propaganda. Et par voie de conséquence, l'incontestable VÉRITÉ manifestée dans la psychanalyse. La propagande comme preuve irréfutable que SIGMUND FREUD a tout vu juste, avouez que c'est drôle, comme retour de boomerang !
Et ça prouve aussi que tous ceux qui fouillent dans l'âme humaine (les sociologues, les psychologues, les ethnologues et tous les x...logues, je veux dire concernant les « Sciences » de l'Homme) ne se contentent pas d'établir de simples connaissances, qui s'avèreraient utiles, mais élaborent et fabriquent des instruments de domination dont tous les pouvoirs se servent allègrement pour s'établir et perdurer (= mentir et manipuler). En particulier un pouvoir que je n'ai pas cité ici : le « management » (faire adhérer tous les "collaborateurs" au "projet d'entreprise"), le fléau de la "gestion" des hommes selon le modèle envoyé par ... les Américains.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, guillaume herbaut, tchernobyl, alexandre vialatte, littérature, littré, antiquité du grand chosier, edward bernays, publicité, propagande, gustave le bon, sigmund freud, georges perec, les choses, prix renaudot, sondages, ifop, sofres, laurence parisot, études de motivation, france, économie, propaganda, gouvernement, michel sardou, sciences humaines, société
dimanche, 09 décembre 2012
L'HOMME QUI FIT FUMER LA FEMME
Pensée du jour :

QUAND UN AVEUGLE PREND DES PHOTOS, VOILA CE QUE CA DONNE
IL S'APPELLE EVGEN BAVCAR, IL EST NE EN SLOVENIE
(authentique, évidemment, et il sait visiblement ce que c'est, une femme nue !)
« Rien n'est plus étrange que la mer. Elle part, elle vient, repart, revient, elle se berce ; et elle fait des songes. Elle rêve des îles, des ports et des soleils couchants ; au sud, à l'horizon, elle rêve Alexandrie, mirage nacré, impalpable vapeur, jeu d'étincelles ; au nord, houleuse et couleur de hareng, elle rêve de grands clairs de lune, et les phares de la côte anglaise. Elle rêve les jonques et les lanternes vénitiennes, les éponges et les madrépores, elle rêve de tout, elle se nourrit de reflets et se nourrit de coquillages, des baleines mortes et des cadavres de marins ; elle enfante surtout les nuages, formes mouvantes commes les sculptures de Brancusi, qui s'entre-effacent et s'entre-engendrent à la façon des musiques de Mozart : la mer est un sculpteur abstrait ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé de l’épisode précédent (d'avant-hier, en fait) : le petit EDWARD BERNAYS est devenu grand en écrivant Propaganda (1928), un livre de chevet pour GOEBBELS, HITLER, STALINE, et un « credo » pour tout publicitaire qui se respecte un peu.

SALE ENGEANCE : ÇA MEURT A 103 ANS !!!
Chargé de vendre la cigarette à toute la gent féminine (et pas « gente », qui est un adjectif qualificatif, comme l'ignorent les ignares), il « libère » la femme en établissant un lien entre la « Torch of Freedom » de la Statue de la Liberté et la cigarette allumée, que seront dès lors autorisées à arborer toutes les femmes américaines.
Soit dit en passant, on ne m'enlèvera pas de l'idée que le BOUT DE SEIN joue pour l'imaginaire des hommes un rôle assez voisin de celui du GLAND (selon la psychanalyse) pour l'imaginaire des femmes, et que l'incandescence du bout de la cigarette a quelque chose à voir avec le BOUT DE SEIN, dans l'imaginaire masculin. On nage en plein érotisme, comme on le voit, par exemple avec la photo de la pin-up à poils (de moustache) ci-dessous.

 Oui, il faut préciser que la torche que la Liberté tient dans la main droite s’appelle en américain : « Torch of Freedom ». C’est comme ça que la cigarette allumée, délicatement tenue par deux doigts d’une exquise main féminine, devint à son tour la « Torche de la Liberté ». Et vive la métaphore ! Tout est dans la nomination, on vous dit.
Oui, il faut préciser que la torche que la Liberté tient dans la main droite s’appelle en américain : « Torch of Freedom ». C’est comme ça que la cigarette allumée, délicatement tenue par deux doigts d’une exquise main féminine, devint à son tour la « Torche de la Liberté ». Et vive la métaphore ! Tout est dans la nomination, on vous dit.
Ben oui, il suffit de donner à la chose désagréable le nom adéquat pour faire passer sans douleur la dite chose : appelez donc votre plan de licenciements massifs « Plan de Sauvegarde de l’Emploi », et soudain vous verrez, tout change. On appelle ça la magie de l'EUPHEMISME.  VICTOR KLEMPERER a longuement étudié ça sous le règne d’HITLER (dans LTI, la langue du 3ème Reich, une lecture indispensable).
VICTOR KLEMPERER a longuement étudié ça sous le règne d’HITLER (dans LTI, la langue du 3ème Reich, une lecture indispensable).
GEORGE ORWELL, avec sa "novlangue" (dans 1984), a lui aussi bien cerné le problème ("l'esclavage, c'est la liberté"). C'est pourquoi on peut se demander si la théorie de SIGMUND FREUD n'a pas nourri indirectement le système hitlérien, à commencer par sa dimension de propagande ? Il y a de quoi se demander, non ? Mais pour revenir à la campagne publicitaire d'EDWARD BERNAYS, ça ne suffisait pas.
a lui aussi bien cerné le problème ("l'esclavage, c'est la liberté"). C'est pourquoi on peut se demander si la théorie de SIGMUND FREUD n'a pas nourri indirectement le système hitlérien, à commencer par sa dimension de propagande ? Il y a de quoi se demander, non ? Mais pour revenir à la campagne publicitaire d'EDWARD BERNAYS, ça ne suffisait pas.
Pour que l’événement fasse date, pour que la campagne atteigne efficacement son objectif, il faut frapper les imaginations, il faut que toute la presse en parle, il faut que tout le pays en parle, il faut du spectaculaire et du scandaleux. Et c’est là que le savoir-faire d’EDWARD BERNAYS va faire merveille.
Chaque année, la ville de New York organise une « manifestation-spectacle ». « New York Easter Parade », ça s’appelle. Un événement annuel de portée nationale, qui a lieu depuis 1880. On va stipendier une cohorte d’accortes bougresses artistement vêtues, on va prévenir en douce les photographes et autres journalistes qu’il va se passer quelque chose et qu’ils doivent se tenir prêts.

NEW YORK EASTER PARADE 2012 !!!!! ÇA CONTINUE !!!!
Et le jour du « Easter Sunday » 1929, quand la troupe des jolies femmes sort des sacs à main une cigarette, que chacune la porte à ses lèvres pulpeuses et, comble du culot, en allume l’extrémité, tout est prêt, EDWARD BERNAYS peut dire que sa campagne est un succès et qu’il a mérité son gros chèque. Les images scandaleuses s’étalent en « une » des journaux, de l’Atlantique au Pacifique.
Les femmes peuvent désormais se proclamer « libérées » par la grâce d’une magistrale campagne de publicité. On est en 1929. L’industrie du tabac peut se frotter les mains. « La moitié du ciel » (les femmes, selon MAO TSE TOUNG) va faire pleuvoir les pépètes, pésètes et autres picaillons dans son porte-monnaie largement ouvert sur les profondeurs abyssales des comptes en banque des actionnaires enchantés. Le « marché », en un clic, a tout simplement doublé de surface.
Bon, alors, le lecteur va me dire maintenant : « Mais qu’est-ce qui te permet, blogueur excessif, de considérer EDWARD BERNAYS comme un quasi-génie ? ». Bonne question. Qu’est-ce qu’elle prouve, la campagne pro-tabac de 1929 ? Qu’est-ce qui fait de son auteur un révolutionnaire ? Tiens, juste un avant-goût : le premier paragraphe de Propaganda.

Au moins, on se dit qi'il ne prend pas de gants, EDWARD BERNAYS. Et ça n'est que le tout début de 110 pages qui décoiffent (je ne compte pas la préface). J'attire juste l'attention sur "gouvernement invisible".
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, art, france, société, culture, alexandre vialatte, littérature, humour, edward bernays, propagande, publicité, public relations, goebbels, hitler, staline, communication, statue de la liberté, sigmund freud, victor klemperer, lti, new york, mao tse toung, grammaire, langue française, propaganda
vendredi, 07 décembre 2012
LIBEREZ-VOUS, MESDAMES : FUMEZ !
Pensée du jour :

AUTRE IDEE DE LA BEAUTE SELON LUCIEN CLERGUE
« Je vous cèderais volontiers ma place, malheureusement, elle est occupée ! ».
GROUCHO MARX
 Résumé de l’épisode précédent : les femmes doivent leur « libération », non pas aux « luttes » féministes, comme la rumeur s’en colporte encore aujourd’hui avec une veule complaisance, mais à EDWARD BERNAYS, dont elles ont obtenu – et de façon spectaculaire – l’autorisation de brandir en public un petit cylindre d’une substance végétale délicatement et finement découpée, et soigneusement enveloppée d’une feuille extrêmement fine de papier de riz, dont l’extrémité peut à volonté être portée à incandescence, une fois que l’autre extrémité a été sensuellement glissée entre les lèvres féminines.
Résumé de l’épisode précédent : les femmes doivent leur « libération », non pas aux « luttes » féministes, comme la rumeur s’en colporte encore aujourd’hui avec une veule complaisance, mais à EDWARD BERNAYS, dont elles ont obtenu – et de façon spectaculaire – l’autorisation de brandir en public un petit cylindre d’une substance végétale délicatement et finement découpée, et soigneusement enveloppée d’une feuille extrêmement fine de papier de riz, dont l’extrémité peut à volonté être portée à incandescence, une fois que l’autre extrémité a été sensuellement glissée entre les lèvres féminines.

EDWARD BERNAYS, donc, et personne d’autre. EDWARD BERNAYS, que le magazine Life, en son temps, a désigné comme l’une des personnes les plus influentes du 20ème siècle. EDWARD BERNAYS, injustement maintenu dans un obscur cagibi du purgatoire des célébrités.

JOSEPH GOEBBELS, INITIATEUR DE LA "PROPAGANDASTAFFEL"
A LA DEMANDE DE SON MENTOR
Il s’agit bien de lui, et les notes que ce blog lui consacre ne visent qu’à réparer une sorte d’injustice : oui, il est temps de rendre justice à un homme dont les travaux ont brillamment inspiré des communicants aussi renommés et efficaces que JOSEPH GOEBBELS, ADOLF HITLER et JOSEPH STALINE, qui avaient sur leur table de chevet le maître-ouvrage du maître : Propaganda ou comment manipuler l’opinion en démocratie (éditions Zones-La Découverte, 2007, 141 p., 12 euros, c’est quasiment donné, et ça fait tomber quelques peau de "soss" devant les yeux qui en avaient).
Si je reformule le sous-titre, ça donne quelque chose comme : « Comment faire adhérer sans contrainte les masses aux discours d'un homme au pouvoir, et jusqu'aux folies d'un dictateur ». En regardant bien, on constate que c'est le principe qui régit tous les gouvernements actuels.

UN AMI DE L'HUMANITE QU'ON NE PRESENTE PLUS
Je vous explique : comme sa mère s’appelle ANNA FREUD, sœur de SIGMUND, et que son père est le frère de MARTHA BERNAYS, qui se trouve être l’épouse du dit SIGMUND, il devient à sa naissance neveu au carré d’un certain SIGMUND FREUD, l’écrasant papa d’une grosse bête appelée « Inconscient » et de tout ce qui se trouve dedans quand on la dissèque. Il est d’ailleurs sympa avec son neveu, le grand FREUD : il lui dédicace un exemplaire de son Introduction à la psychanalyse. Et le neveu, il va y mettre le nez, et pas qu’un peu.

En 1929, le président du consortium des producteurs de tabac, futur gros client de son officine, lui dit : « Comme les femmes ne peuvent pas fumer en public, nous perdons la moitié d’un énorme marché. Pouvez-vous faire quelque chose ? ». EDWARD BERNAYS répond : « Laissez-moi y réfléchir ». Puis il demande : « M’autorisez-vous à chercher du côté de la psychanalyse ? – Mais œuf corse ! Ne vous gênez pas ». Rappelons qu'à l'époque, la femme qui fume sur un trottoir est traitée de pute, ni plus ni moins.
Ni une ni deux, il se précipite chez ABRAHAM A. BRILL, un des premiers grands psychanalystes des Etats-Unis, non pas pour s’étendre sur un quelconque divan, mais pour poser une question au savant : « Que représente la cigarette pour la femme ? ». La réponse fuse : « Le pénis ! ». C’est clair, net et précis. Autrement dit la berdouillette, le scoubidou, la merguez (ou chipolata, au point où on en est), le cigare à moustaches, la bistouquette. En trois mots comme en cent : la BITE, la PINE, le CHIBRE.
EDWARD BERNAYS ne se démonte pas pour autant, c’est un esprit pratique. Il a un gros client, et le client, surtout le gros, est roi. Alors il a l’idée du siècle : le symbole de l’Amérique, c’est le cadeau fait par la France à l’occasion de son centenaire (celui des Etats-Unis !). J’ai nommé le chef d’œuvre d’AUGUSTE BARTHOLDI. J’ai nommé la statue de La Liberté éclairant le monde (inaugurée en 1886).

Deuxième étape dans l’élaboration du message : la torche que tient la Liberté est incandescente, le bout de la cigarette allumée est incandescent. Il faudrait être stupide pour ne pas faire le rapprochement, avouez ! Qui plus est, la Liberté, qu’elle guide le peuple ou qu’elle éclaire le monde, c’est une Femme, regardez DELACROIX. Concluez vous-même : EDWARD BERNAYS a sa campagne de « public relations » en poche, c’est comme si c’était fait.

LÀ, ELLE GUIDE LE PEUPLE.
C'EST BIEN UNE FEMME, SELON TOUTE APPARENCE.
Voilà ce que je dis, moi.
P.S. DERNIERE MINUTE : nous apprenons une triste nouvelle :

Adressons donc nos très sincères condoléances à l'U.M.P., et surtout à son "président autoproclamé".
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE, UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : femme, féminisme, mlf, photographie, lucien clergue, beauté féminine, humour, groucho marx, edward bernays, communication, propagande, publicité, tabac, magazine life, goebbels, adolf hitler, joseph staline, propaganda, manipulation, sigmund freud, psychanalyse, sexe, cigarette, bartholdi, statue de la liberté, la liberté éclairant le monde, eugène delacroix, inconscient, anna freud, françois fillon, ump, jean-françois copé
samedi, 10 novembre 2012
VOUS AVEZ DIT LACAN ? (fin)
Pensée du jour :
« Cette chronique ne cesse de se préoccuper de l'homme, de le poursuivre, de le piéger, de le traquer à travers l'apparence, de chercher à tracer son portrait éternel. Tout au moins son ombre chinoise ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé : le style écrit de JACQUES LACAN, c’est bien connu, est une sorte d’Everest pour un lecteur ordinaire. C’était tout à fait concerté et volontaire de sa part. C’en était au point que même ses collègues psychanalystes le trouvaient illisible, et qu’il a dû, dans certaines circonstances que ROUDINESCO expose, faire un (petit) effort de lisibilité.
L’autre aspect négatif de LACAN que je retiens du livre de ROUDINESCO, c’est le caractère très moyennement sympathique du personnage. L’une des principales raisons est l’obsession de l’argent. L’auteur écrit : « A sa mort, à la différence de Balthazar Claës [drôle de renvoi au personnage de La Recherche de l’absolu (BALZAC), mais la 8ème partie du livre porte précisément ce titre], Lacan était donc richissime : en or, en patrimoine, en argent liquide, en collections de livres, d’objets d’art et de tableaux » (p.514). Richissime !
Je me rappelle avoir lu dans le temps (dans la revue Actuel, 2ème mouture) un article insolent sur maître LACAN, illustré entre autres d’un dessin le représentant brassant plein de billets de banque dans un grand tiroir ouvert. Il y avait donc du vrai.
Une de ses filles est d’ailleurs, si je me souviens bien, devenue conseil en immobilier, pendant qu’un fils opérait dans la finance. Sa fille préférée, JUDITH, à la suite de je ne sais plus quel micmac, n’a porté son nom que deux ans, intervalle entre la démarche administrative pour avaliser la filiation et son mariage avec le redoutable JACQUES-ALAIN MILLER, dont elle a adopté le patronyme.
Cette richesse énorme, il la devait à son incomparable maîtrise dans la discipline psychanalytique et à l’incontestable (voire incroyable) succès rencontré par son enseignement auprès de différentes générations d’analystes. Les gens (y compris des célébrités parisiennes) se bousculaient à son séminaire.
Mais cette richesse, il la devait aussi à l’une des raisons qui l’ont coupé des autorités de la profession : la durée de la séance. L’IPA (l’association internationale) tenait à des séances uniformément étendues sur trois quarts d’heure. LACAN inventa la « durée variable », autrement dit les séances réduites à quelques minutes à la fin, voire interrompues au bout de quelques instants.
On se pose forcément la question de l'escroquerie (ce n'est pas la même chose de recevoir 15 patients et d'en recevoir 60 ou 80 dans la journée ; on pense aux "gagneuses" de Barbès qui épongeaient autrefois le micheton à la chaîne et à 100 balles).
Une autre raison est à chercher du côté de la certitude absolue qu’il a de son propre génie, et de la confiance infinie qu’il a en lui-même. Plongé dans sa recherche, plus rien d’autre n’existe que celle-ci. On peut se dire que BALZAC ou CÉLINE non plus ne doutaient de rien.
Mais cela peut rendre les relations délicates : LACAN n’hésite pas à réveiller ANDRÉ WEISS en pleine nuit pour le supplier de lui donner la solution de l’énigme que celui-ci lui a posée pendant la soirée (les « trois prisonniers », intéressant, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, parce qu’il faudrait encore développer). C’est sûr que cela comporte un aspect fascinant.
Qu’est-ce que je retiens d’autre, de la lecture d’un ouvrage consacré à un homme qui a, en son temps, défrayé la chronique ? J’ai connu un homme (que je suis très heureux d’avoir perdu de vue) qui a croisé LACAN. C’était à l’hôtel Pigonnet (catégorie *****, oui, 5 étoiles), à Aix-en-Provence.
Je n’ai pas retenu toutes les circonstances, mais au moment où il était assis dans le salon de réception, il a vu un monsieur descendre l’escalier, se diriger vers l’Accueil pour je ne sais plus quoi. C’était JACQUES LACAN, et d'une, et il était à poil, et de deux. Ma foi, pourquoi pas ? Quand on est riche et célèbre, on peut se permettre l’excentricité, au motif que le riche est plus libre que le pauvre.
Je retiens encore le fait que, si une foule de gens reconnaissent que LACAN a renouvelé en profondeur la lecture de l’œuvre de SIGMUND FREUD, c’est en bonne partie parce qu’il a énormément travaillé les philosophes (et avec eux) de son temps : HUSSERL, JASPERS, KOYRÉ, KOJÈVE, HEIDEGGER, et d’autres plus anciens, dont HEGEL.
Ce sont ses lectures et échanges philosophiques qui ont nourri ce renouvellement. ROUDINESCO pointe d’ailleurs les trois sources de l’inspiration lacanienne : médicale (c’est un médecin), intellectuelle et artistique (copain de DALI et d’ANDRÉ MASSON, passés par le surréalisme). A cet égard, la biographie de LACAN par ROUDINESCO (je dis ça, moi qui n’ai guère de points communs avec la psychanalyse) est un excellent travail de reconstitution d’une démarche et d’une trajectoire, tant pour la vie que pour l’œuvre du personnage.
J’ajouterai pour finir que ce n’est pas un livre sans faiblesses. Celle que je considère comme principale est dans la composition elle-même. Plus on descend le cours du temps, plus l’exposé perd en esprit de synthèse, et tombe un peu, disons-le, dans l’anecdotique, pour ne pas dire le « people ». Et plus on se perd dans des détails qui s’étalent indûment.
Si je peux avancer une explication : l’auteur est entré dans le circuit parisien organisé autour de LACAN à une certaine époque. Et ce dont elle-même a été témoin direct (ou presque) prend une ampleur que n’ont pas des sources plus anciennes (écrits et entretiens divers). Le synthétique résulte d’un travail de reconstruction a posteriori, comme « en laboratoire », le dilué venant d’un relatif manque de recul, dû à la présence "in vivo".
Et le moment où la biographie donne l’impression de s’effilocher et de tirer en longueur, je le situe quand l’auteur devient elle-même partie prenante. Qu’elle soit entrée dans le jeu n’a rien d’étonnant : elle est la fille de JENNY AUBRY (née WEISS, puis épouse ROUDINESCO, puis ...). Le monde est petit, comme on l’a vu avec DIDIER ANZIEU, le fils de MARGUERITE PANTAINE, qui a, sous le nom d’ « Aimée », servi de marchepied (de paillasson ?) à JACQUES LACAN.
Dernière remarque, inspirée par le dernier chapitre, intitulé « France freudienne : état des lieux ». Impressionnant, franchement. Il y avait la SPP et l’APF (je ne détaille pas, le P est pour "psychanalyse", le F pour Freud), augmentées de l’OPLF et du Collège de psychanalystes. Ce sont des associations professionnelles. Ajoutons l’EFP fondée par LACAN. Je me contente d’énumérer la suite : ECF, AF, CFRP, Cercle freudien, CCAF, EF, FAP, CP, Coût freudien (sic !), GRP, Errata, ELP, Psychanalyse actuelle.
Et moi qui croyais que le pompon de la scission et autres formes de scissiparité était détenu haut la main par les sectes trotskistes ! Quel désappointement ! Je vais être obligé désormais de changer de cible, et sans même avoir à caricaturer : la cible se caricature elle-même !!! Parce que la liste ci-dessus s’allonge dès la page suivante : entre 1985 et 1993, pas moins de « quatorze associations supplémentaires ont vu le jour. Six d’entre elles sont des créations nouvelles, deux sont le résultat de scissions, et six sont des lieux fédératifs » (p. 552).
Vous voulez une image du sac de nœuds ? Une représentation du nœud de vipères ? Du merdier ? De la confusion générale ? De l’imbroglio ? De l’enchevêtrement ? Alors, mieux que les sectes trotskistes, ouvrez la caisse aux psychanalystes, regardez-les grouiller, ... et vous serez servis.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, alexandre vialatte, littérature, jacques lacan, psychanalyse, psychanalyste, élisabeth roudinesco, la recherche de l'absolu, honoré de balzac, revue actuel, judith miller, jacques-alain miller, école freudienne de paris, louis-ferdinand céline, sigmund freud, heidegger, husserl, jaspers, kojève, salavador dali, andré masson, jenny aubry, didier anzieu
jeudi, 08 novembre 2012
VOUS AVEZ DIT LACAN ?
Pensée du jour :

"RUPESTRE" N°1
« L'indignation ne saurait en aucun cas être une attitude politique ».
TALLEYRAND
(à transmettre à STEPHANE HESSEL)
Résumé : j’ai beaucoup d’estime pour l’anthropologue, l’historien, le sociologue, bref, pour le spécialiste de « sciences humaines » quand, sans rien céder sur ce qu’il y a de « pointu » dans la doctrine, il parvient à créer une œuvre qui ait des qualités littéraires.
Je n’en ai guère pour ceux, tels DENIS GUEDJ ou JOSTEIN GAARDER, qui passent par le roman pour faire une sorte de propagande simplificatrice à la "petite semelle" (excusez-moi). Ils ne sont que des intermédiaires entre la discipline et le grand public, des « vulgarisateurs », qui peuvent bien sûr briller sur les plateaux de télévision. Ils vous disent : « Moi je sais. Je vais tout vous expliquer, voyez comme je suis bon ». Mais ils se révèlent à la fois des romanciers infirmes et de piètres professeurs. De plus, cette attitude a quelque chose de toute à fait déplaisant.
Le vrai savant qui consent à faire entrer son lecteur dans la Science par le biais de la littérature est donc un esprit supérieur. EINSTEIN disait : « Il faut s'efforcer de rendre les choses simples, mais pas plus simples ». Réciproquement, la Science contenue dans la littérature est infiniment supérieure à ces balbutiements de pédagogues empêtrés et de vulgarisateurs à succès, mais aussi supérieure aux plus arides traités austères de science pure.
S’il en est ainsi, c’est que la dite Science, dans les ouvrages que je privilégie, ceux dont je parle, n’apparaît que comme un élément parmi d’autres dans ce qu’on appelle communément LA VIE. C’est cette science-là que BALZAC a élaborée et transmise dans La Comédie humaine.
C’est pour ça que je tire mon chapeau à quelques psychanalystes. Tiens, je me rappelle une histoire de cas racontée par un monsieur MASUD KHAN (quelque suspecte que soit sa réputation par ailleurs) dans un numéro de la Nouvelle revue de psychanalyse (n° 24, « L’emprise »), repris dans Passion, solitude et folie (Gallimard, 1985), histoire intitulée La Main mauvaise.
Sans me rappeler le détail, je me souviens du drame épouvantable vécu par un artiste habité par un fantasme qu’il tâche de transformer en œuvre d’art (y a-t-il un vélo en bois ?), jusqu’au jour où le hasard d’une rencontre féminine le met face à des circonstances et un déroulement d’événements qui ressemblent trait pour trait (et de façon épouvantable) aux forces de son fantasme. J’ai oublié s’il devient fou à la fin, ou quoi.
Dans mon souvenir, ce récit ne présente guère (en dehors des références proprement psychanalytiques) de différence avec les ambiances qu’on trouve dans les nouvelles, par exemple, de MAURICE PONS (Douce-amère, Denoël, 1985). MAURICE PONS, parmi les romanciers, est sûrement ce qu’on peut appeler un « petit maître ». Mais parmi les petits maîtres, c’est un bon.
références proprement psychanalytiques) de différence avec les ambiances qu’on trouve dans les nouvelles, par exemple, de MAURICE PONS (Douce-amère, Denoël, 1985). MAURICE PONS, parmi les romanciers, est sûrement ce qu’on peut appeler un « petit maître ». Mais parmi les petits maîtres, c’est un bon.
Pour moi il reste le bel auteur de quelques livres qui ont tracé leur sillage indélébile (il faut le faire, non ?) dans mon imaginaire, au premier rang desquels le lent, lugubre et remarquable Les Saisons. Il y a aussi Rosa et le complètement foutraque La Passion de Sébastien N. (bêtement rebaptisé Le Festin de Sébastien pour sa réédition au Dilettante, une histoire de droits, j'imagine).
Le héros finit par dévorer une automobile, des sièges à la carrosserie, avant de s’élancer à toute allure sur les routes, carburateur refait à neuf. Mais ça finit mal. Pris en chasse par deux motards : « … il alla s’écraser, la tête en avant, contre un pylône de béton édifié au milieu de la chaussée en prévision de l’éventuel projet du futur tronçon de l’autoroute Moyenvic-Vézelise ». Alors, « une bouillie d’organes et d’ossements se répandit sur la chaussée, mêlée à des fragments d’acier et des débris de tôle ». « A l’aube, les fossoyeurs et les ferrailleurs de Verveine, accourus en hâte, se disputaient ses restes ». Comme foutraque (et comme fantasme), on ne fait pas mieux.
Je reviens à DIDIER ANZIEU, dont je vantais les mérites hier, pour la lisibilité de L’Auto-analyse de Freud. Il se trouve qu’ELISABETH ROUDINESCO parle de lui dans sa biographie de JACQUES LACAN. Et pour cause : le premier coup d’éclat de celui-ci est la thèse qu’il soutient et publie en 1932 : De la Psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité (Seuil, 1975, rééd.).
Je me fiche éperdument de ce qu’y raconte le père du « lacanisme ». Ce qui m’a interpellé, c’est que ce livre traite du cas de MARGUERITE PANTAINE. Car c’est un « cas », au sens psychiatrique. Il se trouve que cette femme, à 38 ans, est allée attendre l’actrice HUGUETTE DUFLOS à son arrivée au théâtre Saint-Georges, qu’elle a sorti de son sac un couteau de cuisine et qu’elle a tenté de l’assassiner. Après quoi elle fut solidement hospitalisée pour paranoïa.
Dans le livre de LACAN, elle est devenue « Aimée », ou « le cas Aimée ». Le peu que je retiens du livre, c’est que LACAN refuse de faire résulter la folie d’ « Aimée » d’un désordre organique. Pour lui, la folie est une composante « comme les autres » de l’existence, une donnée possible de la vie humaine (je simplifie). Et, dit-il, si tout le monde est potentiellement fou, tout le monde n’a pas la liberté de le devenir. Je trouve l’idée passionnante.
D’autant plus passionnante qu’il se trouve que MARGUERITE PANTAINE est la mère de DIDIER ANZIEU. C’est ce que la biographie de LACAN m’a appris. DIDIER ANZIEU qui est devenu ensuite un des plus importants psychanalystes français. Ces circonstances ont quelque chose d’éminemment romanesque, ne trouvez-vous pas ?
D’autant que, d’après ROUDINESCO, LACAN s’est assez mal conduit avec « Aimée », et qu’il s’est servi d’elle plus qu’il n’a eu le souci de sa santé mentale. Il s’en est servi, plus qu’il ne l’a servie, comme d’un tremplin professionnel inespéré. Aux yeux d’ « Aimée » : « … il lui avait volé son histoire pour construire une thèse. Quand il devint célèbre, elle en fut dépitée et sentit resurgir en elle un fort sentiment de persécution. Jamais elle ne lui pardonna de ne pas lui avoir restitué ses manuscrits » (p.257).
Et, après la mort du maître, ROUDINESCO eut beau intervenir auprès du tout-puissant exécuteur testamentaire de LACAN, son gendre JACQUES-ALAIN MILLER, pour faire rendre à DIDIER ANZIEU, le fils de MARGUERITE, les cahiers rédigés par celle-ci pendant son enfermement à l’asile, le gendre ne daigna même pas répondre. Ce dédain constitue une signature morale. Avec quelque chose d'une odeur infamante. Une odeur de faux-cul. Et de cynisme racinaire.

VOUS AVEZ DIT JACQUES-ALAIN ?
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, vulgarisation, denis guedj, jostein gaarder, le théorème du perroquet, le monde de sophie, science, sciences humaines, littérature, balzac, la comédie humaine, psychanalyse, masud khan, passion solitude et folie, la main mauvaise, nouvelle revue de psychanalyse, nouvelles, maurice pons, douce-amère, les saisons, didier anzieu, jacques lacan, élisabeth roudinesco, l'auto-analyse de freud, sigmund freud, le cas aimée, paranoïa, psychose paranoïaque, jacques-alain miller, albert einstein
mercredi, 07 novembre 2012
VOUS AVEZ DIT BIOGRAPHIE ? (3)
Pensée du jour :

"SOUPIRAIL" N°8
« Nous vivons une époque tragique. Et même sérieuse ».
ALEXANDRE VIALATTE
Résumé : je supporte de lire ce qu’écrivent des spécialistes en sciences humaines à condition qu’ils se donnent la peine de traduire leur haut savoir dans une langue lisible, et même de bonne ambition littéraire, voire qu’on puisse considérer comme de la littérature. Et c’est possible. FREUD (c’est traduit, mais …), pour la psychanalyse, le montre bien, et après lui des gens comme DIDIER ANZIEU, MAUD MANNONI, … Dans d’autres domaines, CLAUDE LEVI-STRAUSS est un véritable écrivain, JEAN-PIERRE VERNANT aussi, d’autres …
Un autre ouvrage m’a marqué de son empreinte : L’Auto-analyse de Freud, sous-titré et la découverte de la psychanalyse (Presses Universitaires de France, éditions de 1975, 752 pages à lire, mais la lecture est très facile, si l’on excepte la doctrine psychanalytique). L’auteur est DIDIER ANZIEU, cité ci-dessus.
Le livre constitue sa thèse de doctorat ès lettres soutenue à la Sorbonne. Je soutiens l’idée que ce livre constitue une base culturelle de l’Occident, parce qu’en racontant comment l’inconscient est devenu « incontournable », il établit au moins un tiers des points de repère de la « modernité ».
Et vous allez voir qu’avec ANZIEU, on se rapproche de JACQUES LACAN, quoi de façon étonnante, comme je l’ai appris dans la biographie qu’ELISABETH ROUDINESCO consacre à ce dernier. Vous voyez que je ne perds pas mon fil. Car je parlerai de JACQUES LACAN. Qu’on se le dise. « Un de plus », diront les connaisseurs. Mais c’est juste pour ajouter mon grain de sel de spectateur profane.
Ce bouquin d’ANZIEU, comme je l’ai lu il y a longtemps, je ne m’y attarderai guère. L’auteur y montre, de façon terriblement savante et détaillée, comment les concepts freudiens se mettent peu à peu en place, comment ils s’agencent, s’échafaudent et s’enchaînent jusqu’en 1900-1902, époque de publication de L’Interprétation des rêves, jusqu’à former un corps de doctrine à peu près cohérent, même s’il ne cessera d’évoluer au cours du temps, du vivant même de FREUD, donnant par là du grain à moudre à tous les disciples, à tous les renégats (qui furent souvent les mêmes), à tous les captateurs d’héritages et autres fondateurs de sectes.
Je me rappelle qu’ANZIEU insiste beaucoup sur l’analyse que FREUD élabore à partir d’un de ses propres rêves : « L’injection faite à Irma ». Le récit tient sur une page entière, et son analyse remplit un plein chapitre, alors je ne vais pas entrer dans les détails. Ce que je peux dire, c’est qu’ANZIEU parvient à rendre compte de ce qu’il appelle la « découverte » de la psychanalyse en mettant celle-ci à la portée, sans doute pas du grand public, disons au moins de la personne qui décide de s’y plonger, sans rien céder sur l’exactitude des notions et concepts.
J’avoue que j’ai été « bluffé » (comme on dit volontiers aujourd’hui) par la performance de monsieur DIDIER ANZIEU.
C’est cette même capacité du savant de s’adresser à un public, tout en restant rigoureux dans sa discipline, qui m’a fait plonger dans les Cinq psychanalyses de SIGMUND FREUD en personne. Comme ailleurs, ce que j’apprécie ici, c’est la capacité d’un maître à asseoir des bases théoriques sur un socle narratif. Le livre est trop connu pour que je me risque à ajouter ici un commentaire par avance nul et non avenu.
Je veux dire que, quand le psychanalyste condescend à se faire romancier, même si c’est pour du beurre et que tout ce qu’il raconte est scientifique et prouvé, le statut de ce qu’il écrit s’apparente au statut de la littérature et de la fiction romanesque.
Je signale en passant que MAUD MANNONI, citée ci-dessus, a écrit un livre dont le titre seul me ravit : La Théorie comme fiction. Bien qu’elle soit une lacanienne pur jus, je l’interprète pour mon compte comme un conseil à tous les théoriciens, d’avoir à montrer de la modestie quand ils élaborent leurs systèmes, et à considérer ceux-ci comme de simples détours narratifs n’excluant pas de faire appel à l’imaginaire.
Car on aura beau faire, il y a plus de vraie science de l’homme dans la littérature que dans tous les traités scientifiques de la Terre, du Ciel et des Planètes. Car la littérature, c’est de la Science destinée à l’Homme, et à personne d’autre, et ce n’est surtout pas une espèce de Statue en or massif que le public est prié d’admirer et d’adorer de loin, de derrière les barrières du langage que les spécialistes ont élevées. Il y a du Prométhée voleur de feu et bienfaiteur de l’humanité, chez le spécialiste qui accepte le détour littéraire de la fiction romanesque pour expliquer ce qu’il sait.
Je ne parle pas des petits clowns comme DENIS GUEDJ (Le Théorème du perroquet) ou JOSTEIN GAARDER (Le Monde de Sophie), tâcherons sans imaginaire ni imagination qui tissent à la diable un semblant de roman pour vulgariser, l’un l’histoire des mathématiques (GUEDJ), l’autre la philosophie (GAARDER), quel que soit à l’arrivée le succès de leur livre.
Dans les deux cas, l’intrigue, sorte de squelette laissé par l’être vivant après sa mort, est simplement posée sur le contenu, sorte de viande synthétique censée faire office de substance nourricière. Mais ce genre de livre ne tient pas debout.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre vialatte, littérature, humour, psychanalyse, philosophie, sigmund freud, didier anzieu, maud mannoni, claude lévi-strauss, jean-pierre vernant, l'auto-analyse de freud, rêve, l'injection faire à irma, élisabeth roudinesco, jacques lacan, l'interprétation des rêves, cinq psychanalyses, la théorie comme fiction, imaginaire, imagination, denis guedj, le théorème du perroquet, jostein gaarder, le monde de sophie
dimanche, 30 septembre 2012
L'AMOUR ABSOLU
Pensée du jour :
« J'aime le son du bois, le soir au fond du corps,
Ma louve dévêtue.
Je sonne l'olifant dans ton camp du drap d'or :
Qu'il est crépu, ce cul ! »
Trêve de calembours ? Alors, un peu de littérature ? Bon, alors voici. Je suis à vos
ordres.
« Il habite une des branches de l’étoile de pierre.
La prison de LA SANTÉ.
Comme il est condamné à mort, la branche où se cataloguent les condamnés à mort.
L’astérie pétrifiée n’a attendu pour s’épanouir, miroir des étoiles, que l’heure des étoiles. »
Ce sont les premières lignes de L’Amour absolu.
Ça faisait bien longtemps que je n’avais pas parlé d’un de mes fétiches en littérature : ALFRED JARRY, l'immarcescible inventeur de la 'pataphysique et du docteur Faustroll, pataphysicien.
Cinquante pages en « Poésie-Gallimard », quarante en Pléiade, tu te rends compte, et ALFRED JARRY ose appeler ça « roman ». Bon, c’est vrai, il devait constituer, à l’origine, un simple chapitre de L’Amour en Visites. On ne va pas chipoter. Car ce livre, c’est bien une aura de beauté qui en émane.
Comme le disait le regretté NOËL ARNAUD, c’est vrai que l’auteur ne s’adresse pas au lecteur paresseux, consommateur d’histoires plus ou moins bien torchées, davantage habitué à la production qu’à la création. Qu’à une vraie littérature d’invention. Si tu penses en être, cher lecteur, il vaudrait peut-être mieux que tu passes ton chemin. Ce territoire est celui de la littérature, la vraie, la pure et dure, peut-être l’intégriste. La preuve ? Qui a lu L’Amour absolu ?
Emmanuel Dieu (c'est le "héros"), ancien enfant trouvé, le jour de Noël, dans un « doué » (lavoir en Bretagne), a été condamné à mort, et il attend son exécution. Voilà tout ce que je dirai de « l’intrigue ». A-t-il tué, d’ailleurs ? Rien n’est moins sûr : « S’il n’a pas tué, pourtant, ou si l’on n’a pas compris qu’il tuait, il n’a d’autre prison que la boîte de son crâne, et n’est qu’un homme qui rêve assis près de sa lampe ».
J’ai naturellement, comme tout le monde, découvert ALFRED JARRY par son côté face : le père Ubu. Je me rappelle même avoir, ô combien laborieusement, avec des potes, enregistré quelques scènes d’Ubu roi sur un magnétophone à bande. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à débusquer, à éplucher les autres œuvres, en particulier L’Amour absolu. C'est même cette première fusée qui m'a offert des photos de la face cachée de cette planète qu'est l'oeuvre après tout copieuse de cet auteur mort à 34 ans.
Qu’est-ce qui attire ? Qu’est-ce qui fascine, ici ? Je réponds : la force et la beauté poétiques du texte, où se télescopent les histoires et les mythes les plus divers, dans une sarabande enfiévrée : Ahasvérus, le juif errant, qui devient le « Christ-errant », le dieu Odin et ses loups, la fée Mélusine, des souvenirs de Rabelais, de Cervantès et des Mille et Une Nuits, Joseph et Marie, la Bretagne, l’enfance et l’adolescence, etc. Vous comprenez qu’on ne peut se hasarder à en dérouler l’intrigue.
Ce texte n’a pas pris une ride, contrairement à toute la littérature symbolarde, épouvantablement ligotée dans l’époque qui l’a vu produire. Je ne qualifierai pas sa modernité du trop galvaudé « stupéfiante ». Plus simplement, j’en donnerai un exemple. On sait que L’Interprétation des rêves, ouvrage fondateur s’il en est, paraît en 1895.
Bon, je sais que le professeur de philo de Jarry, M. Bourdon, faisait, dès 1890, des cours sur NIETZSCHE, non encore traduit en français, mais je doute fort qu’Alfred ait pu avoir connaissance du livre de Freud, qui définit le rêve, comme chacun sait : « un accomplissement de désir ». Or, voilà-t-il pas qu’ALFRED JARRY écrit, en 1899 :
« La Vérité humaine, c’est ce que l’homme veut : un désir.
La Vérité de Dieu, ce qu’il crée.
Quand on n’est ni l’un ni l’autre – Emmanuel –, sa Vérité, c’est la création de son désir. »
Voyez la citation de FREUD, et on dira ce qu’on voudra, mais … Convaincant, n’est-ce pas ?
D’une manière plus générale, certains font la fine bouche, et trouvent singulièrement « datée » cette façon d’écrire. Ce n’est pas impossible. Je reste malgré tout attaché à cette prose poétique, par laquelle je suis entré jadis dans l’autre facette de l’œuvre d’ALFRED JARRY, tout ce qui ne tourne pas autour de la très encombrante gidouille d’Ubu, dont les extravagances ne font plus aujourd'hui que m'ennuyer.
Ce qui me frappe, aussi, c’est l’intensité du récit, sa densité, ainsi que le mystère obstiné qui plane sur ce que certains appellent la « réalité ». Y a-t-il eu adultère ou inceste ? Meurtre ou naissance ? Est-ce la mort ou le sommeil ? Le rêve ou la réalité ? La femme s’appelle-t-elle Varia ou Miriam ? Dors-je ou veillé-je ? JARRY tente de relever à sa manière le même défi que s’est lancé GUSTAV MEYRINK dans La Nuit de Walpurgis ou dans Le Golem, deux livres qui vous font vous demander, quand vous les refermez, si vous n’avez pas rêvé.
« Absolu – ment.
C’est une charade.
Ce que ne qualifie pas le premier est le sujet du second.
Tout dans l’univers se définit par ce verbe ou cet adjectif. »
Indispensable.
Voilà ce que je dis, moi.
09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, poésie, alfred jarry, l'amour absolu, amour, énigme, l'amour en visites, noël arnaud, gustav mayrink, la nuit de walpurgis, le golem, ubu roi, sigmund freud, l'interprétation des rêves, pataphysique
vendredi, 06 juillet 2012
UN PARFUM DE TROISIEME REICH (1)
Bérurier, vous savez, c’est, pour le commissaire San Antonio, comme un alter-ego, mais ce que San Antonio est en propre, jeune premier et séduisant, Bérurier l’est en sale, et le plus souvent répugnant. N’empêche que FREDERIC DARD a élaboré un sacré personnage : gras du bide, la braguette ouverte, c’est lui qui s’arrache les poils du nez et laisse échapper une larme suite à l’opération.

LE "GRAVOS"
Dans Votez Bérurier (Fleuve Noir n° 56, 1964), comme il y a une élection municipale dans le village de Bellecombe, où le commissaire enquête, l’inspecteur, incognito, se porte candidat, et son discours de candidature débute sur ces fortes paroles : « Bellecombais, Bellecombaises… ». L’amateur que je suis raffole de ces petites facéties de l’écrivain, même si l’adjoint de San Antonio se permet de faire passer les messieurs avant les dames, sans quoi l'effet du jeu de mots serait raté. Mais Bérurier n’est pas un homme politique.
Car oui, l’homme politique, élevé dans la langue de bois maternelle et le « politiquement correct », inverse et déclare : « Les Françaises et les Français… ». Le maire de Paris : « Les Parisiennes et les Parisiens… », de Marseille : « Les Marseillaises et les Marseillais… ». Qu’y a-t-il là de politiquement correct, me dira-t-on ?
Eh bien, tout simplement qu'en bonne grammaire, le masculin est « générique », alors que le féminin est « marqué ». On dit aussi : le masculin l’emporte sur le féminin, mais c’est mal vu et C'EST EXACTEMENT ÇA, le politiquement correct : cette formule est une insulte à l’égalité de l’homme et de la femme. Inutile (ou utile au contraire) de dire que l’idée même d’insulte est proprement ridicule.
La pensée choisit peut-être les mots capables de l'exprimer, c'est bien possible, mais aujourd'hui, les mots médiatisés façonnent la pensée des masses. Sinon, je ne comprends pas comment NICOLAS SARKOZY a pu être élu en 2007, pas plus que FRANÇOIS HOLLANDE en 2012. On appelle ça la PROPAGANDE (lisez Propaganda, d'EDWARD BERNAYS, le neveu de SIGMUND FREUD, un des principaux inventeurs de la gestion des populations au vingtième siècle).

VICTOR KLEMPERER, L'HUMBLE ET NOBLE
SCRIBE DE LA LANGUE HITLERIENNE
VICTOR KLEMPERER a écrit un ouvrage mémorable sur la langue du III° Reich : LTI – Notes d’un philologue, paru en 1947 (édition Pocket, collection Agora, n° 202), où LTI signifie, en français, Langue du Troisième Reich (« Lingua Tertii Imperii »). George Orwell, en 1948 (dans le livre plus célèbre que lu 1984), imagina la « Novlangue », autrement dit la réécriture de l’histoire et de la réalité (voir les retouches de photos officielles sous STALINE).
Le point commun de toutes ces conquêtes impériales de la langue de tous, celle que nous parlons, c’est la généralisation de l’euphémisme : on ne dit plus « élève borné » ou « cancre », mais « apprenant à apprentissage différé », car il ne faut plus humilier personne, dans notre société d’égalité (handicapés, femmes, homosexuels, arabes, noirs, juifs et tutti quanti), ce qui est un progrès indéniable et décisif, n’est-ce pas.
Cela veut dire qu’on a le droit d’être con ou salaud (on est en démocratie), mais personne n’a le droit de le dire, sous peine de correctionnelle (on est sous l’œil des miradors et des gardes-chiourme, il paraît que c’est compatible avec la démocratie, si, si !). Il est désormais interdit de porter un jugement. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il soit encore permis d'exercer son jugement, comme nous l'ont enseigné les LUMIERES.
Mais il faut aussi compter avec la liste toujours plus longue des interdits : le vrai et juste combat des minorités américaines (les noirs, pour tout dire) pour la reconnaissance de leurs droits a abouti paradoxalement à installer une POLICE DE LA LANGUE (on ne dit plus un noir, mais un Africain-Américain, alors même qu'entre eux, les noirs s'interpellent "hey, nigga" ; on ne dit plus un nain, mot affreux, mais une « personne contrariée dans sa croissance verticale »), en attendant la POLICE DE LA PENSEE, qui s’est déjà imposée dans le paysage.
On ne doit plus, aux Etats-Unis, dire "un noir", mais un "africain-américain". Il n'y a plus de "bombardements", mais des "frappes", éventuellement "chirurgicales". Il n'y a plus de "victimes civiles", mais des "dommages collatéraux". On ne parle ni de "rigueur", ni d'"austérité", mais "du sérieux dans la gestion comptable des deniers publics". Je pourrais continuer longtemps.
Attention, mon frère, aux mots que tu prends pour parler des handicapés, des femmes, des homosexuels, des arabes, des noirs, des juifs (surtout des juifs, mais ils sont talonnés, pour ce qui est des moyens de pression) et des tutti quanti.
FRANÇOIS RABELAIS, en son temps, eut des problèmes avec les autorités et la justice, mais jamais pour une histoire de mots : ce sont les idées qui sont ou non porteuses de force, subversive ou non. De nos jours, la police a resserré son étreinte : il ne s’agit plus d’idées subversives – puisque plus RIEN n’est désormais subversif (c’est la société tout entière qui se subvertit elle-même en permanence), du fait même que TOUT est en soi subversif (se prétend tel, ou est célébré comme tel, évidemment). Du coup, le policier et le juge s'en prennent aux mots mêmes.
Voilà ce que je dis, moi.
A suivre.
09:00 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : san antonio, bérurier, littérature, politique, novlangue, frédéric dard, votez bérurier, fleuve noir, politiquement correct, political correctness, nicolas sarkozy, françois hollande, propagande, edward bernays, sigmund freud, victor klemperer, lti, staline, george orwell, handicapés, femmes, homosexuels, arabes, juifs, noirs, euphémisme, françois rabelais
dimanche, 29 janvier 2012
CONNAIS-TOI TOI-MÊME, C'EST UN ORDRE !
PREAMBULE VENU DU FOND DES ÂGES
(Attention, c'est du lourd !)
Madame Coutufon m'a dit avant-hier que « connais-toi toi-même » est le plus célèbre des préceptes que les Grecs avaient gravé sur le fronton du temple d’Apollon à Delphes.
Γνῶθι σεαυτὸν
(= gnôthi séautonn)
Madame Coutufon, vous ne le savez peut-être pas, c'est chez elle que j’achète mon beurre demi-sel, mes épinards et mes conserves, me l’a dit, pas plus tard que ce matin : « Un peu de grec dans la conversation, ça vous pose un homme ». Alors je m’exécute. Est-ce que j’en suis plus « posé » pour autant ? Rien n’est moins sûr. J’en suis marri.
DEVELOPPEMENT GRAVE ET PROCESSIONNEL
J’ai connu un type, dans le temps, il s’appelait Œdipe. Eh bien, ça lui aurait fait du bien d’au moins passer devant ce foutu temple, et de la voir, cette foutue devise, au lieu d’aller voir cette vieille sorcière, sur son trépied, au fond de sa grotte enfumée. « What a pity ! », s’exclame l’anglais peu au fait de l’orthographe grecque. Ça aurait évité au nommé Œdipe tous les ennuis qu’il a pris sur le paletot par la suite.
Ben oui, il se serait posé les bonnes questions : « Qui suis-je ? Où cours-je ? Dans quel état j’erre ? ». Il aurait pris le temps d’y répondre. Au lieu que là, bille en tête, il est parti dans les pires embiernes (comme on disait chez moi) : « Tu tueras ton père et tu épouseras ta mère ». Il a pris ça pour des ordres, le con ! Alors que c'était le dernier avertissement avant la sanction !
Pourtant, le premier commandement du Décalogue (que c’est Dieu qui l’a dit, alors !) le stipule expressément : « Tu ne tueras point », et le vingt-deuxième et demi : « Tu n’épouseras pas ta mère, même si elle te le demande poliment ». En tout cas, c’est pas moi, c’est la Bible. Il faut tout leur dire.
De toute façon, ce type-là, je vais vous dire, je le sentais pas bien. D’abord, il la ramenait sans arrêt. Tu lui voyais les chevilles enfler à vue d’œil. C’est tellement vrai que c’était devenu son surnom (« chevilles enflées »), je te jure que c’est vrai. Va voir la voisine, Madame Etymologie, si tu me crois pas. Et mouche-toi avant de lui parler. Œdipe ? Personne pouvait le piffer, parce qu’on voyait bien que tout ce qu’il voulait, c’était flanquer des complexes à tout le monde. Qu’est-ce qu’il s’en croyait !
Le pire, c’est que ça marchait. Et que ça marche encore. Infect, je vous dis. J’ai eu beau en parler à Sigmund, son meilleur pote, rien n’y a fait. Au contraire, Sigmund, ce salaud, il a tout de suite flairé la bonne affaire, et il a illico monté sa boîte, qu’il a appelée « Au Complexe d’Œdipe ». Je te dis pas le succès monstre : il a ouvert une boutique, et tout de suite ça a été l’affluence.
Au point qu’il a été obligé d’ouvrir des boutiques en série un peu partout, et de les confier à des gérants – pas toujours bien nets, il faut bien le dire. Et ça a marché du feu de dieu. La boîte principale s’est progressivement scindée en succursales multiples, sous les « raisons sociales » les plus diverses.
Ça a d’abord été la succursale « Jung », puis la « Rank » ou « Reik », je ne sais plus, et puis les scissions se sont multipliées, comme n’importe quel groupuscule trotskiste en ordre de marche, et l’on ne compte plus, aujourd’hui les « appellations d’origine » plus ou moins contrôlées. Il y a eu la « Reich », la « Lacan », et tellement d’autres que tu peux pas imaginer ; tout est bon dans le cochon pour appâter le gogo.
En fait, Sigmund se démerdait pour instaurer une concurrence acharnée entre toutes ces succursales. Les bisbilles entre « Néo-école freudienne » et « Ecole néo-freudienne », c’était du chiqué, juste pour la galerie, juste pour mettre de l’animation, quoi !
Il mettait de l’huile sur le feu de dieu, et en sous-main, c’est lui qui tirait les marrons du feu de dieu. Un jour, on a appris par les journaux qu’en fait, depuis le départ, une holding appelée « Œdipe et Sigmund », chapeautant l’ensemble du groupe, avait été fondée et astucieusement domiciliée aux îles Caïman, l'empereur du paradis fiscal dans l'empire des paradis fiscaux.
La thune qu’ils se font, les gaillards, à se prélasser sur la plage, avec plein de bimbos en pleines formes qui viennent leur caresser le cuir et le reste, et plus si affinités, pendant que leurs milliers de comptes en banque leur crachent du cash sans qu’ils aient à lever le petit doigt pour ça. Ecœurant. Tout ça parce qu’ils ont trouvé l’idée du siècle, allonger sur des milliers de divans des dizaines de milliers de paumés pour qu’ils racontent leur vie. Ces gars-là, ils gagnent des fortunes rien qu’en respirant (réplique piquée à La Vérité si je mens).
Il y aurait même une affaire « Œdipe et Sigmund », si l’on en croit les révélations fracassantes de Pierre Péan, l’enquêteur justicier bien connu, qui a reçu bien des menaces de mort à cause de ça. Selon lui, la Mafia serait une assemblée d’enfants de chœur, comparée aux réseaux tentaculaires et inextricables de la holding « Œdipe et Sigmund ».
Leur spécialité ? Une multinationale du racket. Avec le consentement exprès des victimes, s’il vous plaît. Aucun juge, aucun policier n’a jamais pu apporter la moindre preuve du plus minime délit. Même pas un témoin repenti. Bien mieux et plus efficace que la Scientologie, c'est dire. Soit dit entre parenthèses, il se murmure dans les cercles bien informés que Pierre Péan serait le « ghost writer » du « best seller » de Michel Onfray, Le Crépuscule d’une idole.
On s’en souvient, l’intrépide chevalier-philosophe de Caen, et par ailleurs graphomane infatigable (jusqu’à dix gros ouvrages publiés en une seule année !), était parti en guerre contre les moulins à vent de la mystérieuse confrérie. Sans plus de succès au demeurant que Le Livre noir de la psychanalyse, quelques années plus tôt. La puissance de l’hydre est encore telle que rien ne peut en ébrécher la carapace.
En attendant, on se perd en conjectures sur les motifs d’un succès que rien ni le temps qui passe ne semble devoir amoindrir. Une hypothèse audacieuse a cependant été formulée récemment : et si, après tout, le nommé Œdipe était tout de même passé devant ce foutu temple d’Apollon et avait lu la foutue devise ? Γνῶθι σεαυτὸν ? « Connais-toi toi-même » ? Ce n’est pas impossible. Le temps de vérifier, et je vous tiens au courant.
Voilà ce que je dis, moi.
On verra si c'est à suivre, cette affaire.
09:04 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : connais-toi toi-même, apollon, delphes, antiquité grecque, oedipe, complexe d'oedipe, pythie, bible, étymologie, sigmund freud, pierre péan, michel onfray, la vérité si je mens, psychanalyse, littérature, modernité
mardi, 17 janvier 2012
CHERIE, QUI MANIPULE-T-ON, CE SOIR ?
Résumé et sommaire : la démocratie s’est inspirée des totalitarismes. En douceur, elle s’est imprégnée de totalitaire sur plusieurs points : eugénisme, abrutissement télévisuel, contrôle des populations par toutes sortes de moyens : caméras, puces électroniques, facebook, téléphones portables, G. P. S., etc.
Etre manipulé, c’est donc être gouverné sans le savoir. Etre gouverné sans savoir par qui. Sans savoir comment. Sans s’en rendre compte. On me dira que les Allemands sous Hitler et les Russes sous Staline savaient qu’ils étaient gouvernés. Ô combien. Et qu’ils auraient souhaité l’être moins, sans doute.
Mais remplacez la police politique et la délation par l’œil des caméras de surveillance et l’oreille des puces électroniques (pour ne rien dire des puces RFID), le résultat sera aussi vigoureux, mais aura été obtenu en douceur, s’il vous plaît. On a éliminé la violence des procédés, mais on arrive quand même au résultat souhaité. Avec l’adhésion des populations, s’il vous plaît.
Cette adhésion n’est pas le moins intéressant, car elle montre que la police n’est plus seulement une force extérieure visible de coercition, mais loge aussi à présent dans une case de toutes les têtes individuelles. Dans un tel système, la police a été intériorisée. Chacun porte en lui-même son flic. Comme le téléphone et l’ordinateur, la police est devenue portable. On la porte sur soi. On la porte en soi.
Et ça n’a pas grand-chose à voir avec ce que la psychanalyse appelle le « surmoi », tu sais, ce paquet d'interdit que l'éducation a pour mission de te transmettre dès ton âge le plus tendre, paquet qui sert à t'occuper les mains de l'esprit pour t'empêcher de faire n'importe quoi. La police intérieure n’érige pas seulement des proscriptions, mais aussi des prescriptions.
Ça veut dire qu'elle te dit ce que tu dois faire. Des choses que tu as l'impression d'avoir envie de les faire, mais que c'est rien que des obligations. Mais des obligations que tu t'es même pas rendu compte qu'elles sont entrées en toi, et que tu sais encore moins comment.
L’une des caractéristiques du régime totalitaire, selon Hannah Arendt, c’est le règne des polices secrètes, polices politiques etc. Il paraît qu'il y a en Syrie, aujourd'hui, pas moins de sept services faits pour ça, dont les attributions se chevauchent pour qu'ils puissent se faire concurrence et se surveiller plus commodément.
Regardez l’Angleterre en 2011, les émeutes, les pillages. Eh bien la police en est toujours à courir après les pillards, à les identifier, à les condamner sévèrement. Grâce aux caméras. Vous me direz que ce n’est pas bien de piller. Mais ce n’était pas bien vu non plus de dire du mal de Staline. Du moins de son vivant.
Nous sommes en démocratie, oui. Quelque chose me dit pourtant que si l’on voulait regarder d’assez près (et sans passion, s’il vous plaît) les points de ressemblance entre notre monde merveilleux et certaines caractéristiques de l’hitlérisme et du stalinisme, ceux-ci seraient moins honnis des manuels d’histoire, et notre monde merveilleux serait moins ovationné. Que se passerait-il si les gens commençaient à se dire : « l’esprit d’Hitler est en nous » ? Ça ferait une sacrée Pentecôte, vous ne croyez pas ? Et sans les langues de feu de l’Esprit Saint.
C’est la raison de l’ambiguïté foncière de Beauvois et Joule. Tenus par leur rigueur « scientifique » à ne pas sortir de leur champ, ils ne font qu’effleurer cette question. Pourtant, il y a peu de chances que Beauvois et Joule ignorent le nom et l’œuvre d'Edward Bernays, père fondateur de la manipulation des foules.
Qui connaît cet immense bienfaiteur de la « démocratie » américaine ?
« La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans les sociétés démocratiques. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays ».
Voilà ce qu’il dit, Edward Bernays. En 1928. C’est exactement le premier paragraphe de son livre Propaganda. Ce neveu devenu américain de Sigmund Freud a su mettre à profit la découverte principale de son tonton (l’inconscient), et s’en servir pour élaborer sa théorie pour « la manipulation consciente (…) des masses ».
Une réussite de Bernays est d'avoir, lors d'une campagne pour le compte de la marque de cigarettes Lucky Strike, amené la masse des Américaines à fumer, y compris sur et à commencer par la voie publique. Parce que zut, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les hommes qui ... Je propose en passant de restituer, chaque fois qu'il est utilisé, à la place du terme tout innocent de publicité, le mot propagande, plus franc et plus près de la réalité manipulatoire. Dites-vous ça chaque fois que le mot publicité apparaît sur l'écran de la télé.
La question à laquelle s’est efforcé de répondre Bernays se situe en amont de celle que je me posais hier ici même : si 60.000.000 de Français (environ, ne chipotons pas) étaient vraiment libres, quel miracle faudrait-il imaginer pour qu’ils désirent et décident, au même moment, de faire la même chose que tout le monde (supermarché, plage, télévision, …), comme ça se passe dans la réalité ?
On imagine bien le tableau : si, au même moment, 60.000.000 de désirs et de décisions différents surgissent, émanant d’individus parfaitement autonomes et libres, ça ne va pas tarder à être le chaos. Pour Bernays, c'est clair : la liberté est une facteur de risque, car elle amène le chaos. Ça va partir dans tous les sens, comme dans un mouvement brownien. Ça va devenir rapidement « ingérable », comme on dit. A côté de ce cataclysme, l’anarchie ressemblerait à de la natation à peu près synchronisée. Il a donc fallu l’inventer, le miracle.
Parce que, précisément, ce n’est pas un miracle. Ou, dit autrement, c’est un miracle minutieusement conçu et fabriqué. Par Edward Bernays. Le sous-titre de son Propaganda, est « Comment manipuler l’opinion en démocratie » (éditions Zones-La Découvertes, 2007, 12 euros). L’auteur a le mérite de la franchise, et n’y va pas par quatre chemins. Ce n’est pas un aveu naïf. C’est la proclamation claire et nette d’une doctrine explicite. Edward Bernays entend être utile à son pays, et pour cela à faire triompher son idée du Bien.
« Théoriquement, chaque citoyen peut voter pour qui il veut. (…)Les électeurs américains se sont cependant vite aperçus que, faute d’organisation et de direction, la dispersion de leurs voix entre, pourquoi pas, des milliers de candidats ne pouvait que produire la confusion. Le gouvernement invisible a surgi presque du jour au lendemain, sous forme de partis politiques rudimentaires. » Cela s’appelle limiter les risques de centrifugation.
Dire que la lecture de ce petit livre (100 pages + la préface) est instructive ne dirait pas grand-chose. Le projet de l’auteur ne souffre pas l’ambiguïté : il s’agit de prescrire « un code de conduite sociale standardisé », d’user de « techniques servant à enrégimenter l’opinion ».
Pour que ça fonctionne, « la société accepte de laisser à la classe dirigeante et à la propagande le soin d’organiser la libre concurrence ». C’est-y pas merveilleux ? Chaque terme compte : « …organiser la libre concurrence … ». Il s’agit de mettre un peu d’ordre dans la loi de la jungle. En contournant au passage ceux qui sont élus pour écrire les lois.
Voilà ce que je dis, moi.
A finir, si vous le voulez bien.
09:00 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hitler, staline, liberté, manipulation, opinion publique, psychanalyse, surmoi, hannah arendt, beauvois et joule, petit traité de manipulation, edward bernays, sigmund freud, propagande, publicité, puce électronique, caméra de surveillance, contrôler l'opinion, propaganda bernays, démocratie
dimanche, 29 mai 2011
TELEVISION : HITLER EN A RÊVE
EPISODE 1
Si l’on m’objecte que l’exemple est terriblement rebattu, je répondrai qu’il est excellent, et que c’est sans doute parce qu’il est excellent qu’il est, précisément, rebattu. Il s’agit du fameux « télécran » inventé en 1948 par George Orwell pour le monde fabuleux sur lequel règne Big Brother (lui aussi, tout le monde le connaît) : évidemment 1984. C’est l’écran quasi-magique qui fonctionne dans les deux sens : il retransmet les discours du chef bien-aimé, et il espionne les faits et gestes de la personne qui habite les lieux. Pour un roman d’anticipation, on peut dire que c’est réussi : exception faite de la séparation des deux fonctions (propagande et espionnage), d’une part dans la télévision, d’autre part dans la caméra de surveillance, tout le reste ou pas loin s’est réalisé, y compris la « novlangue » et la Police de la Pensée. Espionnage (donc sécurité) et propagande.
La seule vraie faiblesse du livre d’Orwell, c’est qu’il réserve le monde de 1984, exclusivement, aux régimes totalitaires, alors que les espaces où il s’est aujourd’hui épanoui et accompli s’intitulent pompeusement démocraties, comme j’essaie de le montrer. C’est dans les démocraties que s’est développée une industrie du divertissement qui passe pour une bonne part par la télévision. Et les démocraties ne sont pas épargnées par l’obsession de la sécurité : elles ont vu se multiplier les « mesures de sécurité », les « normes de sécurité ». C’est flagrant depuis le 11 septembre 2001, mais cela date de bien avant. L’industrie de la sécurité est une affaire qui marche (pas de grands magasins sans vigiles).
Moyennant quoi, l’individu n’a jamais été aussi libre de faire ce qu’il veut (ça c’est pour « démocratie »), mais je fais remarquer que, comme il veut les mêmes choses que tout le monde, il fait comme tout le monde : les gens se conduisent à peu près comme on attend qu’ils le fassent (mais attention, il ne faudrait surtout pas réduire ignoblement la liberté à la simple liberté de choix : même s’il y a d’innombrables marques, sortes et goûts de yaourts, ça reste des yaourts). La seule et vraie différence, c’est que ce résultat est obtenu sans violence physique, car ils adhèrent spontanément à ce monde, disant que, de toute façon, « ils n’ont rien à se reprocher », et que quand on est irréprochable, il n’y a pas de raison d’être choqué par les caméras de surveillance (le terrifiant « Souriez, vous êtes filmé. »). Pour ce qui est du divertissement ou des mœurs, à la question : « Pourquoi faites-vous ça ? », ils ont cette terrifiante réponse : « C’est mon choix ! ». Je ne suis pas le. C'est un système qui fonctionne d’une façon implacablement logique : sans la télévision et le divertissement, pas d’adhésion ; sans adhésion, pas de caméras de surveillance. Tout se tient.
Enfin, quand je dis « spontanément », je fais semblant. C’est là que la télévision, entre autres, dévoile une de ses fonctions principales. On sait qu’Adolf Hitler, en accédant au pouvoir en 1933, a créé aussitôt un Ministère de la Propagande, confié d’emblée à Joseph Goebbels. On sait que par là, il voulait développer la force de l’action de frapper les esprits, d’y pénétrer pour y introduire des idées, des images, des « valeurs » qui n’y étaient pas précédemment. Il voulait donner à cette action toute la dimension et toute la démesure dont il rêvait. Il fallait aussi que les esprits en question gardent l’impression que les idées qu’ils exprimaient ne germaient pas ailleurs qu’en eux-mêmes, et ne s’aperçoivent pas de l’intrusion. Exactement comme dans le film Maine-Océan, la scène nocturne où, pendant que le propriétaire de la maison dort profondément, quelques copains, qui ont un compte à régler, s’introduisent dans sa cuisine et vident consciencieusement son frigo et ses bouteilles en étouffant leur fou-rire.
J’ai déjà parlé d’Edward Bernays (le 16 mai), neveu de Freud, inventeur des « public relations », qui a su mettre à profit les concepts élaborés par son oncle, pour en tirer des préceptes « utiles ». Propaganda est paru en 1928 (éditions Zone, 12 euros). Comme le titre, le sous-titre est un aveu : « Comment manipuler l’opinion en démocratie ». Je ne résiste pas au plaisir de citer les deux premières phrases du bouquin : « La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays » (c’est moi qui souligne). A déguster lentement, non ? Et ce n’est pas un nazi qui parle, mais un Américain, un conseiller des présidents. Je cite la 4ème de couverture : « Un document édifiant où l’on apprend que la propagande politique au 20ème siècle n’est pas née dans les régimes totalitaires, mais au cœur même de la démocratie libérale américaine ». Ce n’est pas moi qui le dis : vous m’auriez taxé de parti pris.
Goebbels n’a eu qu’à piller, et il ne s’en est pas privé, les théories de Bernays pour développer les activités de son ministère de la Propagande. Mais ces théories ont aussi inspiré les gouvernants des régimes démocratiques. Car partout, sur la planète, leur grand problème a été au 20ème siècle de répondre à la question : « Comment obtenir des masses qu’elles obéissent ? ». Deux types de régimes servent à ça : les autoritaires et les démocratiques. Terreur, police, délation d’un côté. Liberté, bonheur, consommation de l’autre. Dans l’un, le bâton. Dans l’autre la carotte. Mais ne croyez pas que la question qui se pose, par exemple, dans la Tunisie de Ben Ali ne se pose pas dans nos belles démocraties. Il s’agit toujours d’obtenir la soumission, mais en prenant, cette fois, la mouche avec du miel. Il faut bien que les trouvailles de tonton Freud servent à quelque chose ! La théorie psychanalytique pour éviter la Terreur, en quelque sorte ! Qu'en aurait pensé Robespierre en 1793 ?
Tout a été dit sur le thème « nazisme et propagande ». Toujours, évidemment, pour condamner sans appel l’entreprise de formatage des masses voulue par Hitler. Mais ils tiennent coûte que coûte à en faire un repoussoir. Pour ériger nos belles démocraties en contre-modèle. Le nazisme, ses horreurs, sa propagande fonctionnent en épouvantail absolu : les commentateurs, en général, mettent l’accent sur le fossé, l’abîme qui sépare notre système du sien. C’est sûr, il n’y a rien de commun entre les deux. Mais en est-on si sûr que ça ?
Car, en matière de manipulation des foules, les nazi (et sans doute aussi Staline, il faudrait voir, parce que l’histoire du « petit père des peuples », comme propagande, ce n’est pas mal non plus) ont bel et bien piqué les idées d’un Américain. Les idées de Bernays servent de base large et solide, aux Etats-Unis, à tout ce qu’on appelle la propagande (ou publicité), la « communication », la manipulation des foules. Quand on nous bassine avec l’idée que l’Europe copie les Etats-Unis avec dix ans de retard, il faudrait rétablir le lien, le « missing link » (le chaînon manquant), qui n’est autre que Goebbels et le nazisme, qu’on présente le plus souvent comme une exception historique, ce soi-disant fossé qui dresse un mur infranchissable (petit hommage en passant au maire de Champignac, et à Franquin, bien sûr) entre lui et nous : il y a bel et bien continuité. La seule rupture, énorme évidemment, ce sont la Shoah, les chambres à gaz, le système concentrationnaire, la terreur, etc. (l’U.R.S.S. de Staline n’est pas loin derrière pour ce qui est des « performances », si l’on peut parler ainsi, elle est même peut-être devant) : en gros, toutes les procédures d’élimination pure, simple, brutale. Pour ce qui est de la liberté de l’esprit (je ne parle pas de la liberté d’expression), cela demande un examen approfondi.
Les Etats-Unis étant une démocratie, il n’était pas question pour eux de recourir à la terreur pour faire marcher toute la population au même pas. Mais ils étaient face à un problème : par quel moyen arriver au même résultat ? Il fallait quand même faire marcher le pays, le faire prospérer, croître et embellir. Comment diriger 122.780.000 de personnes (on est en 1930), sans violence, mais en étant aussi efficace ? La grande habileté de l’Amérique a été d’utilise à outrance la connaissance du psychisme humain (Freud et ses continuateurs, Bernays et Lippmann) pour obtenir l'adhésion des masses.
Je renverrai toujours, à ce sujet, à l’essai de Beauvois et Joule sur la « soumission librement consentie » : Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens (quand les choses sont présentées habilement, l’individu, en régime de liberté, a tendance à se soumettre). Les auteurs, cependant, ne poussent pas au bout leur raisonnement dans ce qu’il a de critique : ils prennent le parti de l’optimisme libéral. Pour obtenir des masses qu’elles adhèrent, et même qu’elles désirent leur propre embrigadement, il suffit de perfectionner d’une part la connaissance de la psychologie des foules, d’autre part quelques techniques de communication bien venues.
A SUIVRE ...
20:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george orwell, télévision, littérature, big brother, liberté, hitler, nazisme, goebbels, edward bernays, sigmund freud, propagande, manipulation des foules, obéissance, soumission
lundi, 16 mai 2011
VOUS AVEZ DIT PSYCHANALYSE ?
Quoi que puisse en dire le nouveau pape auto-proclamé de la philosophie Michel Onfray dans Le Crépuscule d’une idole (sous-titré « l’affabulation freudienne »), la théorie freudienne n’a pas disparu, submergée, paraît-il, par ses « affabulations ». En passant, de même que Nicolae Ceaucescu était de son vivant immortalisé dans la formule « Danube de la pensée », on pourrait surnommer Michel Onfray « Amazone de la philosophie », si j’en juge au débit du fleuve éditorial qu’il fait couler : wikipédia indique, depuis l’an 2000, pas moins de 49 titres d’ouvrages. Cet homme-là doit être quadrumane et insomniaque : il faut des mains au bout des bras et des jambes et travailler 24/24, 7/7. Six titres en 2008, cinq titres en 2010 : Comment fait-il ? Ce n’est plus de la pensée. On appelle ça « logorrhée ». C’est une pathologie. Mais revenons à Sigmund Freud.
L’effort d’Onfray pour abolir la psychanalyse est pathétique, et peut-être pathologique : je ne me prononce pas (enfin : presque pas). Il est sûr que Freud, avec la psychanalyse, aura réussi à contrarier, à emmerder le maximum de monde, et les tentatives d’annulation sont innombrables, indénombrables et insubmersibles. Aussi insubmersibles que la psychanalyse elle-même. Je me souviens du chapitre que le grand René Girard consacre au freudisme dans son grand ouvrage La Violence et le sacré (Grasset, 1972) : il estime que sa théorie du « désir mimétique » englobe et invalide celle du « complexe d’Œdipe ». Je n’entre pas ici dans le débat.
Ce qui m’intéresse, c’est l’incomparable succès, l’invraisemblable prospérité, l’inimaginable fortune accumulée par la théorie psychanalytique : je n’exagère pas. C’est une véritable caverne d'Ali Baba. Si un lecteur frotté de psychanalyse découvre cette affirmation, il doit déjà être en train de se tapoter la tempe droite avec l’index (s’il est droitier). Certes, il y a de l’argent, dans les circuits, tous « psys » confondus (y compris la saloperie importée d’Amérique qu’on appelle « cognitivo-comportementale », dont la principale finalité est de fonctionner comme les « camps de réadaptation » mis en place en Chine sous Mao, sauf que là, il faut, en plus, payer le tortionnaire), mais moins que dans la poche de Zinedine Zidane. Et puis surtout, la caverne est métaphorique et même involontaire. C’en est au point que Sigmund Freud lui-même n’aurait pour rien au monde voulu ça, s’il avait pu le prévoir (enfin j’espère).
C’est comme Pierre et Marie Curie : s’ils avaient pu prévoir quels usages seraient faits du « radium » et de la radioactivité, peut-être auraient-ils laissé en plan leurs travaux, un demi-siècle avant Hiroshima. S’ils avaient pu deviner les dégâts que causerait, du vivant même de Marie, un médicament comme le Radithor (on lit distinctement sur l’étiquette : « radioactive water »), ils auraient sans doute fermé leur laboratoire. C’est la même chose pour la psychanalyse : quel cerveau de psychanalyste malade, qu’il fût orthodoxe ou hétérodoxe, aurait pu imaginer que quelques piliers de la théorie serviraient un jour à la plus gigantesque entreprise de domestication des peuples ? J’exagère à peine, comme je vais essayer de le montrer.
On n’est jamais si bien trahi que par les siens, et personne n’est parfait : Sigmund Freud a un neveu, et plutôt deux fois qu’une, puisque fils de sa sœur et du frère de sa femme (une variante, sans doute, de la double peine). Freud épouse Martha Bernays. Monsieur Bernays épouse Anna, sœur de Freud. Naîtra de cette union, en 1891, le petit Edward, Eddy pour les intimes, qui portera donc, et pendant 103 ans, le nom d’Edward Bernays (il est mort en 1995 : y a de la veine que pour la canaille). Cela valait le coup de s’attarder un peu : vous allez voir. Je ne sais pas quand sa famille a émigré en Amérique. Toujours est-il qu’il a eu le génie d’organiser un drôle de mariage entre les Etats-Unis et la vieille Europe, un mariage d’une originalité inouïe, jugez plutôt.
D’un côté, la théorie révolutionnaire d’un Autrichien qui dévoile les petits secrets bien cachés de l’âme humaine (c’est de tonton Freud que je parle). De l’autre, l’industrieuse et industrielle Amérique, en plein processus d’invention de la future « société de consommation ». D’un côté, la découverte de l’inconscient, du subconscient, bref, des motivations secrètes des individus. De l’autre, la découverte du moyen le plus moderne de s’enrichir : produire en masse, donc vendre en masse. D’un côté, une connaissance qui ira en s’affinant et se perfectionnant sans cesse des ressorts secrets du psychisme. De l’autre, le besoin pressant des industriels de convaincre le plus de gens possible d’acheter toutes affaires cessantes les marchandises produites.
Edward Bernay est encore bien jeune quand il fait partie d’un groupe mis en place par le président américain, chargé de trouver les moyens de convaincre la population du bien-fondé d’une entrée des Etats-Unis dans la 1ère guerre mondiale. Très tôt donc, il est mis en face de la question : comment amener une masse de gens à changer d’avis sur des questions importantes ? Autrement dit : comment agir sur l’esprit et le comportement des hommes, sans que ceux-ci s’en rendent compte ? Dit encore autrement : comment manipuler les esprits ? Et il était malin, le bougre, et s’était fait une doctrine solide sur les masses, considérées comme incapables de penser, tout juste capables d’exprimer des pulsions. C’est là que les idées de son tonton vont lui être très utiles : pour agir sur les foules, il ne faut surtout pas s’adresser à la Raison, par un Discours. C’est peine perdue.
Bon, c’est vrai qu’il n’est pas tout seul à penser ainsi : Walter Lippmann, par exemple, qui se demande, on est dans les années 1920, comment « fabriquer du consentement » (manufacture of consent, en langue originale). Années 1920 : c’est dire combien tout cela a été mûrement, longuement réfléchi, mis au point dans les moindres détails, et combien le travail sur les effets attendus a été minutieusement conduit, longtemps avant Patrick Champagne (Faire l’opinion, 1990) qui, lui, se contente de « décrypter » les données d’une pratique (les sondages) qui s’est tellement banalisée qu’elle en a acquis la force de l’évidence. Alors que des gens comme Lippmann et Bernays, entre autres, ont établi les codes qui servent encore de base à tout ce qui travaille sur l’opinion.
Bref : l’idée est certainement dans l’air, comme on dit. Donc, il s’agit de s’adresser tout de suite à l’en-deçà de la conscience, qu’on appelle le « subconscient ». On ne va pas construire des raisonnements et des discours comme dans l’ancien temps (vous savez, les vieilles lunes de la rhétorique classique : « inventio, dispositio, elocutio »). On va montrer des images, des formes symboliques : c’est d’autant plus facile que les moyens de communication sont en train de faire un véritable bond technologique (les « médias de masse »). Par exemple, Bernays, qui travailla pour l’industrie de la cigarette, va utiliser le « symbole phallique » (merci tonton Freud) pour étendre l’usage de ladite cigarette à l’autre moitié de la population américaine, celle pour laquelle fumer était très vilain, autrement dit à ce « gisement inexploité », ce « marché potentiel » constitué par les femmes. Et ça marche ! A coups de défilés de jeunes et jolies fumeuses (« les torches de la liberté », selon la notice wikipédia) : la femme aussi est libre de se goudronner les poumons.
C’est donc ça, la publicité ? Oui : ni plus ni moins. Et ça marche. Et depuis toutes ces dizaines d’années. Public opinion de Walter Lippmann date de 1922. Edward Bernays publie son ouvrage principal en 1928, sous le titre Propaganda. Propagande : le mot sert aujourd’hui dans les petites joutes politiques pour accuser l’adversaire de « bourrer le crâne », ou alors il est censuré, rhabillé en « publicité », en « communication », en « communication politique » : cela s’appelle des euphémisme (vous savez : « non voyant », « à mobilité réduite », etc.). J’ai déjà parlé de la « propagande », dont un pape fut l’inventeur en 1622, quand il s’agissait de propager la « vraie foi » (autrement dit de convertir les mécréants). Il n’y a aucun hasard si Joseph Goebbels, « ministre du Reich à l’éducation et à la Propagande », s’inspirera de la théorie d’Edward Bernays, de même que Staline.
Cela veut dire quelque chose de finalement assez simple : En quoi, aujourd’hui, se différencient régime de terreur et régime « démocratique » ? Dans l'un comme dans l'autre, le principal problème d’un gouvernement, c’est de savoir comment diriger une population (on ne parle évidemment plus du tout de « peuple ») : susciter son adhésion, spontanée ou imposée, à ceux qui gouvernent, lui faire admettre la domination des dominants. Face à la « nécessité » d’adapter l’idée démocratique à la complexité du système économique, donc à la « nécessité » de gérer les foules, Edward Bernays et Walter Lippmann, par des chemins différents, ont abouti aux mêmes conclusions : il est indispensable de façonner les esprits, de manipuler les gens, de les amener à penser et à agir dans le sens voulu par les dirigeants. C'est pour avoir compris ça que le capitalisme a triomphé du communisme.
Cela veut dire aussi que la « démocratie » repose aujourd’hui sur une industrie qui, grâce à la psychanalyse, s’est développée en allant débusquer dans la tête des gens le moindre détail de leurs désirs plus ou moins secrets et de leurs motivations intimes : l'industrie de la propagande, tant dans la politique que dans le commerce marchand (pardon pour le pléonasme). Il n’y a plus aucun secret pour ceux qui gouvernent (président d’un pays ou d’une grande société commerciale) : après leur enquête dans les tréfonds autrefois obscurs de l’individu (le « subconscient »), ils élaborent en laboratoire des produits qui sont ensuite vendus au même gogo, qui ne se demande même pas : « Mais comment ont-ils fait pour deviner ce dont j’avais envie ? », et qui paie pour se procurer la marchandise qu’on a, en réalité, tirée de lui-même (à la caisse du supermarché ou dans l’urne électorale : le processus est strictement le même, et Edward Bernays, le père du marketing, vendra ses « conseils » aussi bien aux hommes politiques qu’aux grandes entreprises). Faut-il vous l’envelopper, votre « idéal du moi » ? De quelle couleur la voulez-vous, votre « libido » ? Nos créatifs ont fait de gros efforts sur le packaging de votre « refoulé ». Mes yaourts sont-ils assez « narcissiques » ?
Cela veut dire, enfin, qu’une découverte majeure du 20ème siècle, la psychanalyse, même si elle reste tout à fait controversée dans ses principes, ses modalités, son efficacité, son prix, tant qu’on se limite à son domaine (thérapeutique des névroses), s’est répandue très concrètement dans tous les aspects et tous les moments de la vie quotidienne, tout simplement parce qu’Edward Bernays (et quelques autres) ont compris à quoi elle pouvait très concrètement servir : gérer les masses humaines. Et je me demande pour finir, si ce n’est pas exactement la même chose pour toutes les disciplines qu’on appelle « sciences humaines ». Il ne s’est passé rien d’autre dans les sciences « dures » : aurait-on eu la bombe H sans la physique ? La dernière catastrophe financière sans les mathématiques ? Le contrôle social le plus dur sans la puce électronique ? L’explosion démographique sans la médecine ? Aurait-on eu l’infamie publicitaire sans Sigmund Freud (c’est vrai qu’il est loin d’être tout seul) ?
Le savant est tout à fait inoffensif, dans son laboratoire, avec sa blouse blanche, son air gentil, tout obsédé de compréhension et de connaissance, et pour qui le monde dans lequel il vit est une entité vague et vaguement abstraite. Mais il y a son double démoniaque : l’aventurier, l’explorateur, l’homme d’action, tout avide de richesse, de gloire et de puissance, qui guette tout ce qui va sortir de ce « bureau d’études » pour en tirer le maximum, très concrètement. C’est un médecin, le docteur Freud, qui a inventé la psychanalyse, dans le but de soigner l’homme, peut-être même de le guérir. C’est un homme d’action, son neveu Edward Bernays, qui va mettre à profit (au sens plein du terme) la découverte, très concrètement. D'un côté, la connaissance, qu'on nous vend comme le bien suprême. De l'autre, l'action, mot dont les médias regorgent dans le registre positif. Mais soigeusement séparés : on appelle ça la division du travail : que ma main gauche, surtout, ignore ce que fait ma main droite. La "main gauche" (Freud) s'appelle la science. La "main droite" (Edward Bernays) s'appelle la technique.
C’est Edward Bernays qui déclara : « L’ingénierie du consentement est l’essence même de la démocratie, la liberté de persuader et de suggérer ». Et « La propagande est l’organe exécutif du gouvernement invisible ». C’est cet homme qui est souvent considéré comme un des personnages les plus influents du 20ème siècle.
Elle est pas belle, ma « démocratie » ? Allez, quoi : achetez !!!
A suivre …
13:44 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : michel onfray, psychanalyse, edward bernays, sigmund freud, rené girard, littérature, société, progrès, science, sciences humaines

